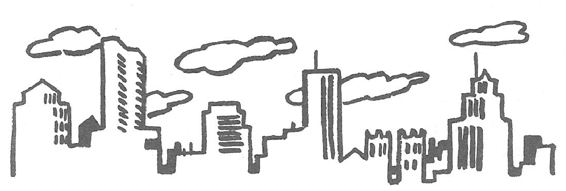
En remontant l’interminable rue Sherbrooke pour me rendre chez Bertrand et Manon, je respire l’automne montréalais. Autour de moi s’étale le gigantesque chantier des villes du Nouveau Monde. Des terrains vagues bordés de cubes en béton succèdent aux gratte-ciel roses, verts et bleus qui, par moments, semblent se soulager en lâchant de grandes bouffées de fumée blanche ; puis une forêt de petits immeubles surgit. Les rues sont tapissées de grosses carrosseries américaines qui, dans les virages, bercent mollement leur conducteur sur des amortisseurs élastiques.
Rien n’est vraiment très beau ; tout m’émerveille et me charme.
A chaque fois que je retourne à Montréal, j’ai le sentiment de revenir à moi. Je n’y suis pas né mais ce pays sourit à ceux qui n’ont pas mis à mort l’enfant qui tente de survivre en soi. Il y a, me semble-t-il, moins de grandes personnes au Québec qu’en France. Au bord du Saint-Laurent vit une poignée d’enfants francophones qui jouent aux adultes, et qui le savent. A Paris, nous nous livrons également à cette comédie ; mais nous ne savons pas que nous jouons.
Rue Hutchinson, j’aperçois une enfilade de maisons anciennes en brique. On accède au premier étage par un escalier métallique extérieur. L’une d’elles est à louer ; un endroit possible pour s’entraîner au bonheur avec une femme. Je prends en note le numéro de téléphone indiqué sur le panneau publicitaire. C’est sous ce toit d’Amérique du Nord que je veux faire des petits à Manon, dans cette contrée dont nos gamins attraperont l’accent, cette musique sur laquelle il est difficile de mettre des paroles vides d’émotions. D’ailleurs j’apprendrai cet accent qui rend gai, inconsolable et tendre à la fois. Ma mue sera alors achevée.
Sur Prince Arthur Ouest, je cherche le numéro 315. Fanny de Tonnerre m’a donné l’adresse de Manon avant de partir. Le 315 est une église ; j’ai dû mal écrire le numéro.
Je trouve une cabine téléphonique, appelle les renseignements qui me confirment que Bertrand et Manon Watteau ont bien élu domicile au 315 Prince Arthur Ouest. Perplexe, je retourne à l’église, pousse le grand portail de bois et, ô surprise, tombe sur une porte vitrée et un interphone. L’église a été transformée et divisée en appartements ! Je suis bien en Amérique. Mon Dieu – Manon – vit dans une église…
Je sonne. Personne. Le soir tombe ; la froidure automnale commence à se faire sentir. Je ne vais pas patienter dans la rue. Le décalage horaire m’engourdit d’épuisement. Un trombone me permet de franchir l’obstacle de la porte vitrée – ne suis-je pas un ex-fabricant de clefs ? – puis, en maniant le même objet avec soin, je parviens à faire jouer la serrure de leur deux-pièces, sans la brusquer.
Je pénètre chez Manon et Bertrand, sous les toits qui abritent le cœur de l’église. L’un et l’autre sont absents. Je suis trop groggy de fatigue pour éprouver la moindre gêne. Dans un miroir, j’aperçois un homme livide qui a oublié de se raser. Je lève la main ; il lève également la sienne. C’est donc moi. Un brin de toilette me ferait le plus grand bien. Je ne peux pas me présenter devant Manon dans un tel état ! Au fond de la salle de bains, la baignoire me paraît accueillante. J’ouvre les robinets, me dévêts et m’allonge dans l’eau chaude. Mm… Mmm… délices et voluptés du bain…