CHAPITRE XIX
Bravo, les Cinq !

FATIGUÉS par une journée si bien remplie, les enfants avaient besoin de repos. Mais les jumeaux se rappelèrent que les poules n’avaient rien à manger ; quelques poignées de grains leur feraient plaisir.
« Mieux vaut tard que jamais, dirent-ils en même temps.
— Où sont M. Henning, M. Durleston et cet horrible Junior, madame Bonnard ? demanda Claude qui se levait pour aider à laver la vaisselle.
— M. Henning a annoncé qu’il dînerait à l’hôtel avec M. Durleston et Junior, répondit Mme Bonnard. Son visage était rayonnant. À l’en croire, les ouvriers ont atteint les souterrains du vieux château ; il espère y faire des découvertes et m’a promis un second chèque.
— Vous ne l’accepterez pas, n’est-ce pas, madame Bonnard ? s’écria François. Les objets qui remplissent les caves sont très précieux ; M. Henning ne vous les paiera pas à leur valeur. Il veut les vendre en Amérique pour réaliser de gros bénéfices. Vous n’allez tout de même pas le laisser faire ?
— M. Francville, l’antiquaire, pourra expertiser les armes et les bijoux, ajouta Claude. C’est un descendant des châtelains ; quand il apprendra ce qui s’est passé, il sera bien étonné.
— Nous le prierons de venir demain, déclara Mme Bonnard. Après tout, M. Henning a son conseiller, M. Durleston. M. Francville sera le nôtre. Grand-père s’en réjouira ; son cousin a toujours été son meilleur ami. »
Cependant, ce ne fut pas la peine d’envoyer chercher M. Francville. Le grand-père était allé tout de suite porter la nouvelle à son vieux camarade.
« Des pièces d’or, des bijoux, des cuirasses, des épées, Dieu sait quoi encore ! » disait le grand-père pour la vingtième fois.
M. Francville l’écoutait gravement en hochant la tête.
« Cette magnifique épée, continua le grand-père, c’est juste ce qu’il me faut. Si j’avais vécu dans l’ancien temps, elle m’aurait appartenu, je le sens. Je ne la vendrai jamais. Je la garderai pour le plaisir de la brandir de temps en temps quand je serai en colère.
— Oui, oui… mais j’espère que tu ne le feras que lorsque tu seras seul, protesta M. Francville, un peu alarmé. Tu n’auras pas la permission de garder tout l’argent, j’en ai peur. Une partie reviendra à l’État. Mais les bijoux, les cuirasses, les épées représentent un véritable trésor.
— Assez pour acheter des champs et plusieurs tracteurs, dit le grand-père. Et aussi une voiture neuve. La nôtre ne tient plus debout. Il me faut des hommes pour déblayer ces souterrains. Si nous gardions les ouvriers qu’Henning a embauchés ? Il n’aura plus la permission de continuer ses fouilles. Il m’a toujours été antipathique ; je vais pouvoir me payer le luxe de lui dire ce que je pense. Toi, ferme ta boutique ; j’ai besoin que tu me conseilles ; tu ne me quitteras pas. Je ne veux pas que cet Américain prenne ses grands airs avec moi ni que ce Durleston me tarabuste.
— Calme-toi, tu es rouge comme une écrevisse, dit M. Francville. Tu auras une attaque si tu ne fais pas attention. Retourne chez toi, j’irai te voir demain matin. Je prendrai des dispositions pour les ouvriers. Ne joue pas trop avec cette vieille épée, tu pourrais couper la tête de quelqu’un sans le vouloir.
— C’est bien possible, dit le grand-père, une lueur dans les yeux. Si Junior passe près de moi quand j’aurai l’épée dans la main… Ne t’inquiète pas. C’est une plaisanterie, une simple plaisanterie ! »
Riant dans sa barbe, le grand-père retourna à la ferme, très satisfait de lui et de la vie.
M. Henning, M. Durleston et Junior ne revinrent pas cette nuit-là. Heureux d’avoir trouvé le souterrain, ils se firent servir un excellent dîner pour fêter le succès des fouilles ; quand ils se levèrent de table, l’heure était si avancée qu’ils décidèrent de prendre des chambres à l’hôtel. Mme Bonnard ne s’en plaignit pas.
« Les campagnards se couchent comme les poules, remarqua M. Henning. Nous trouverions porte close. Nous retournerons là-bas demain matin pour faire signer aux Bonnard le contrat que vous avez rédigé, Durleston. Ils sont tellement à court d’argent qu’ils accepteront notre offre. Vous aurez soin de déclarer que les souterrains ne contiennent aucun objet de valeur ; ils seront tout heureux de toucher cinq cents dollars, et nous, nous ferons fortune. »
Le lendemain matin, les deux hommes et Junior — que M. Durleston jugeait odieux — se présentèrent à la ferme vers dix heures. M. Henning avait d’abord envoyé le petit garçon de l’hôtel pour annoncer leur venue.
Toute la famille s’était réunie pour les recevoir, le grand-père, M. et Mme Bonnard, les jumeaux. Le vieux M. Francville, dont les yeux brillaient pour la première fois depuis des années, assis au fond de la pièce, attendait avec curiosité les événements.
Les Cinq étaient là aussi ; Dagobert se demandait ce que signifiait la surexcitation générale. Couché sous la chaise de Claude, il grondait chaque fois que Friquet s’approchait de lui. Le caniche, par jeu, répondait sur le même ton.
Une voiture s’arrêta devant la ferme. M. Henning, M. Durleston et Junior firent leur apparition.
« Bonjour tout le monde ! cria Junior avec son effronterie habituelle. Comment va ? »
Personne ne lui répondit, à l’exception de Dagobert ; en l’entendant grogner, Junior fit un petit saut de côté.
« Tais-toi, sale chien ! s’écria-t-il.
— Vous a-t-on servi votre déjeuner au lit à l’hôtel ? interrogea Claude. Vous vous rappelez le matin où je vous ai monté votre plateau, accompagnée de Dagobert ?
— Ça suffit ! » interrompit Junior d’un ton hargneux.
Il s’assit près de son père et n’ouvrit plus la bouche. La discussion s’engagea rapidement.
« Monsieur Bonnard, j’ai le plaisir de vous annoncer que, sur le conseil de M. Durleston, je peux vous offrir un nouveau chèque de cinq cents dollars, commença M. Henning. D’après ce que nous en avons aperçu, le contenu des souterrains nous déçoit beaucoup, mais nous ne voulons pas diminuer la somme proposée. Vous êtes d’accord, monsieur Durleston ?
— Tout à fait, répondit M. Durleston, le regard dur derrière ses verres épais. Voici le contrat. M. Henning est très généreux. Très. Il n’y a rien de valeur dans vos caves.
— Je regrette de vous contredire, déclara M. Bonnard, mais mon opinion est toute différente. M. Francville ici présent est de mon avis. Nous nous chargeons des fouilles, monsieur Henning ; si nous avons une déception, ce sera tant pis pour nous.
— Qu’est-ce que cela signifie ? s’écria M. Henning. Durleston, qu’en dites-vous ? Le procédé est tout à fait déloyal, n’est-ce pas ?
— Offrez-lui mille dollars, proposa M. Durleston, déconcerté par l’attitude du fermier.
— Offrez ce que vous voudrez, je préfère rester le maître chez moi, riposta M. Bonnard. Je vais vous rendre le chèque que vous m’avez donné hier. J’ai l’intention de garder les ouvriers que vous avez embauchés ; je les paierai moi-même. Ne prenez pas la peine de les congédier ; ils travailleront désormais sous mes ordres,
— C’est monstrueux ! » cria M. Henning en se levant.
Il assena un coup de poing sur la table et foudroya du regard M. et Mme Bonnard.
« Que croyez-vous trouver dans ce vieux souterrain ? Il ne contient pour ainsi dire rien. Nous avons percé la voûte et nous avons jeté un coup d’œil à l’intérieur. Je vous ai fait une offre très généreuse, mais je veux bien la porter à quinze cents dollars.
— Non », dit M. Bonnard sans perdre son calme.
Le grand-père jugea que l’Américain méritait une réponse plus énergique. Il se leva aussi et frappa à son tour sur la table. Tous sursautèrent ; Dagobert aboya, Friquet se sauva à toute vitesse.
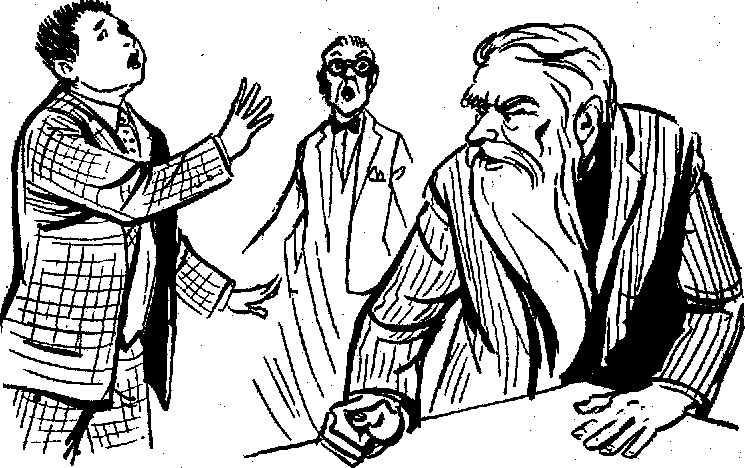
« Taisez-vous et écoutez ! cria le vieillard. Cette ferme appartient à M. et Mme Bonnard et à moi. Mes arrière-petits-enfants en hériteront plus tard. Ma famille l’habite depuis des siècles ; je m’affligeais de la voir péricliter à cause de notre pauvreté. Maintenant je sais qu’il y a de l’argent, beaucoup d’argent dans nos souterrains, tout l’argent que nous voulons pour acheter des champs, des tracteurs, tout ce que nous pouvons désirer. Nous refusons vos chèques. Oui, monsieur, gardez vos dollars. Offrez-m’en le double ou le triple si vous voulez, vous verrez ce que je répondrai ! »
M. Henning se hâta de jeter un regard interrogateur à M. Durleston qui hocha la tête.
« C’est bien, dit l’Américain au grand-père. Cinq mille dollars. Marché conclu ?
— Non », répliqua le grand-père, plus heureux qu’il ne l’avait été depuis des années. « Il y a de l’or dans ces souterrains, des bijoux, des cuirasses, des épées, des poignards, des couteaux vieux de plusieurs siècles…
— En voilà un conte à dormir debout ! s’écria M. Henning avec un rire moqueur. Vous prenez vos désirs pour des réalités ! »
Le grand-père abattit de nouveau son poing sur-la table.
« Les jumeaux, cria-t-il de sa voix sonore, allez chercher les objets que vous avez remontés d’en bas !… Apportez-les ici. Montrez à ce monsieur que je ne suis ni un fou ni un menteur ! »
Sous les yeux étonnés de M. Henning, de M. Durleston et de Junior, les jumeaux étalèrent sur la table les pièces d’or, les bijoux, les épées et les poignards. M. Durleston resta confondu.
« Qu’en dites-vous ? demanda le vieux grand-père en tapant de nouveau sur la table.
— De la camelote ! » déclara M. Durleston.
M. Francville se leva à son tour et prit la parole. M. Durleston n’avait pas remarqué le vieillard immobile dans un coin de la salle ; il fut horrifié de reconnaître l’antiquaire qui, toute sa vie, avait étudié l’histoire du vieux château.
« Mesdames et messieurs », commença M. Francville d’un ton solennel comme s’il faisait un discours devant une nombreuse assemblée, « j’ai acquis un certain renom dans le commerce des antiquités. À mon grand regret, je dois déclarer que si M. Durleston considère comme de la camelote les objets étalés sur cette table, il n’a pas droit à son titre d’expert. Ces armes et ces bijoux feraient le bonheur des collectionneurs. Demain, si je veux, je les vendrai à Paris pour une somme bien supérieure à celle qu’offre M. Henning. Mesdames et messieurs, je vous remercie de votre bienveillante attention. »
Avant de se rasseoir, il salua courtoisement. Annie avait envie d’applaudir.
« Je crois que nous n’avons plus rien à nous dire, déclara M. Bonnard en se levant. Si vous voulez nous indiquer l’hôtel où vous descendrez, monsieur Henning, je vous enverrai vos valises. Je suppose que vous ne tenez pas à prolonger votre séjour chez nous ?
— Papa, je ne veux pas aller à l’hôtel, je veux rester ici ! cria Junior à l’étonnement de tous. Je veux voir ces souterrains. Je veux participer aux fouilles. Je veux rester !
— Nous n’avons pas besoin de vous ! riposta Daniel, furieux. Vous êtes toujours à nous espionner, à vous vanter, à nous faire gronder. Monsieur déjeune au lit ! Monsieur n’est pas capable de cirer ses souliers ! Monsieur crie quand on ne lui obéit pas au doigt et à l’œil ! Monsieur…
— En voilà assez, Daniel, dit sévèrement Mme Bonnard. Je veux bien que Junior reste s’il promet d’être sage. Nous n’acceptons pas la proposition de son père, mais lui est en dehors de nos discussions.
— Je veux rester ! » répéta Junior en trépignant. Par malheur pour lui, son pied frappa le nez de Dagobert ; le gros chien gronda et montra les dents. Junior courut vers la porte.
« Vous voulez toujours rester ? cria Claude.
— Non, répondit le jeune Américain en sortant.
— Dagobert, merci de l’avoir aidé à prendre une décision », dit Claude en caressant son chien.
M. Henning était violet de rage.
« Si ce chien mord mon fils, je le ferai tuer, dit-il. Je vous poursuivrai…
— Je vous en prie, partez, dit Mme Bonnard pâle de fatigue. Il faut que je me remette au travail.
— Je prendrai mon temps, déclara pompeusement M. Henning. Je n’accepte pas d’être mis à la porte comme si je n’avais pas payé ma pension.
— Vous voyez cette épée, Henning ? » demanda brusquement le grand-père en prenant sur la table l’épée qu’il aimait tant. « Elle est belle, hein ? Les hommes d’autrefois savaient se débarrasser de leurs ennemis. Ils la brandissaient de ce côté, puis de celui-ci et…
— Arrêtez ! Vous êtes fou ! Vous avez failli me blesser ! cria M. Henning pris de panique. Posez cette arme !
— Non, elle est à moi, je ne la vends pas », dit le grand-père.
Il brandit de nouveau l’épée qui cassa l’ampoule de la lampe suspendue au plafond ; les débris de verre tombèrent de tous côtés. Abandonnant M. Henning à son sort, M. Durleston s’enfuit de la cuisine ; il se heurta violemment à Roger qui entrait.
« Attention, il est fou… Ce vieillard est fou ! cria M. Durleston. Henning, sauvez-vous ! Il est capable de vous couper la tête ! »
M. Henning s’enfuit aussi. Le grand-père le poursuivit jusqu’à la porte, les yeux flamboyants et la barbe en bataille. Croyant à un jeu, les deux chiens jappaient à qui mieux mieux ; les enfants n’en pouvaient plus de rire.
« Grand-père, qu’est-ce qui vous a pris ? » demanda M. Bonnard.
Un sourire rayonnant éclaira le vieux visage ridé.
« Nous voilà débarrassés de ces clients de malheur ! De la camelote, quel toupet ! En voilà un expert ! De la camelote ! Tu as entendu, Francville ?
— Pose cette épée. Les vieilles choses, il faut les manier avec respect, dit M. Francville qui connaissait bien son vieil ami. Allons boire un verre à l’auberge tout en parlant de nos projets. Mais d’abord, lâche cette arme. Je ne veux pas me montrer dans les rues du village avec un homme qui brandit une épée. »
Le grand-père se laissa convaincre ; les deux vieux amis sortirent de la ferme, bras dessus, bras dessous. Mme Bonnard tomba dans un fauteuil en poussant un soupir de soulagement. Puis, à la consternation des enfants, elle fondit en larmes. Les jumeaux coururent l’embrasser.
« Ne faites pas attention, dit-elle. C’est de joie que je pleure. Pensez un peu, plus de soucis… Nous n’aurons plus besoin de prendre des pensionnaires. Votre père pourra racheter ces champs dont il avait tant envie… Que je suis sotte de pleurer ainsi !
— Madame Bonnard, voulez-vous que nous partions aussi ? » demanda Annie.
Ses frères, sa cousine et elle étaient également des pensionnaires, c’est-à-dire une charge pour la pauvre Mme Bonnard.
« Oh ! non, vous, vous êtes des amis ! protesta Mme Bonnard en souriant à travers ses larmes. Je ne vous demanderai pas un sou de pension ; vous nous avez apporté la fortune et le bonheur.
— Nous serons bien contents de rester, dit Annie, Ce sera si amusant d’aider à déblayer les souterrains. N’est-ce pas, Claude ?
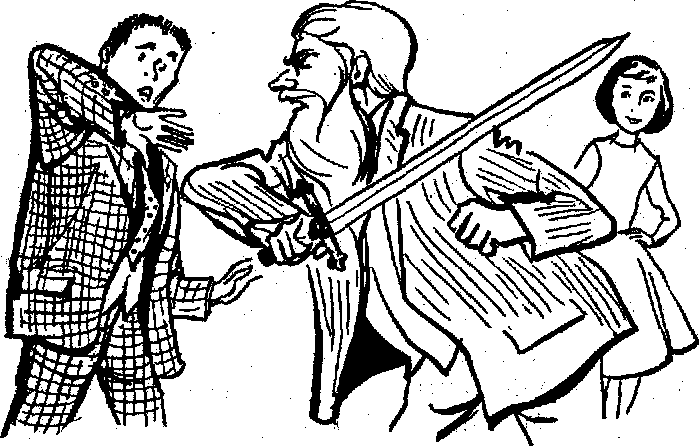
— Bien sûr, dit Claude. Pour rien au monde je ne voudrais partir maintenant. De toutes nos aventures, c’est la plus palpitante.
— C’est ce que nous disons chaque fois, répliqua Annie. Celle-ci a l’avantage de ne pas être terminée. Nous regarderons travailler les ouvriers ; nous ferons la chasse aux trésors cachés dans les caves… Nous nous promènerons dans les champs que M. et Mme Bonnard vont racheter ; nous verrons le tracteur neuf. Je crois que le second chapitre de cette aventure sera plus agréable que le premier. Tu ne le crois pas, Dago ?
— Ouah ! ouah ! » approuva Dagobert en agitant si fort la queue qu’il renversa Friquet.
Au revoir, les Cinq ! Profitez de vos vacances, amusez-vous bien… et veillez à ce que le grand-père ne décapite personne avec cette vieille épée !
FIN