CHAPITRE VIII
Une promenade an milieu des champs
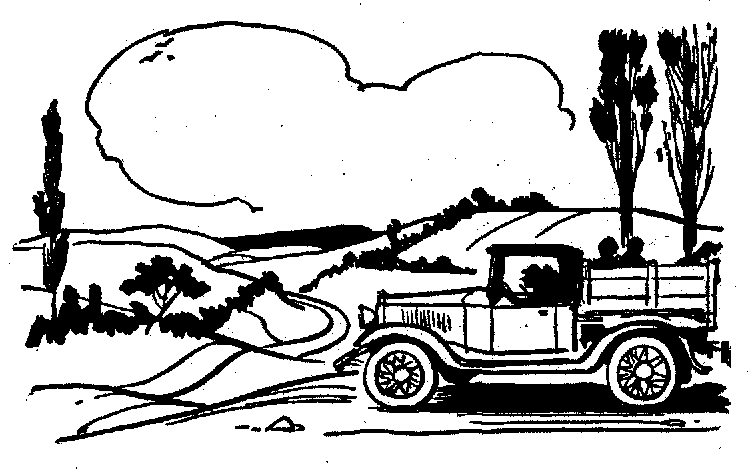
L’EXCURSION était pittoresque à souhait. C’était comme le jeu des montagnes russes. La Ford gravissait des collines, les redescendait et prenait des virages audacieux. Roger s’arrêtait de temps en temps pour permettre à ses passagers d’admirer le panorama. Il énumérait les noms des champs et des bois devant lesquels ils passaient.
« Le champ des Trois-Chênes, le bois du Pendu, le bois des Rétameurs, le champ du Bout-du-Monde, Tout ça appartenait autrefois aux Bonnard. »
Ces paysages, qu’il connaissait depuis sa naissance, étaient chers à son cœur. La sympathie que les enfants lui témoignaient l’incitait à parler.
« Vous voyez ces vaches dans ce pré ? De belles bêtes. Mais les nôtres les valent bien. M. Bonnard en prend soin ; pour un bon fermier, c’est un bon fermier. Nous allons passer devant nos pâturages. Les moutons broutent sur la pente de cette colline là-bas. Je vous y mènerai un jour. Le vieux berger n’était pas plus âgé que vous quand il est entré à la ferme des Trois-Pignons. »
Après ce long discours, il retomba dans son silence habituel. Pour le retour, il prit un autre chemin pour montrer aux enfants de nouveaux sites. Les prairies étaient d’un vert d’émeraude, et une légère brise agitait les longues herbes.
« C’est un spectacle dont je ne me lasserais jamais, dit Annie. Je pourrais le contempler pendant des heures.
— Alors n’épousez pas un fermier, vous n’en auriez pas le temps », riposta Roger.
Tous se mirent à rire.
« Des vaches, des veaux, des moutons, des agneaux, des bœufs, des chiens, des canards, des poulets,… énumérait Annie. Attention, Roger ! »
Effrayée par un cahot plus violent que les autres, elle croyait à un accident. Dagobert poussa un jappement.
« Ce n’est rien, Dago, dit Claude pour le rassurer. Une ornière un peu profonde, voilà tout.
— Cette vieille voiture est encore solide », dit Roger en riant.
Il appuya sur l’accélérateur, et la pauvre Annie poussa de nouveau un gémissement.
« On se croirait dans un panier à salade », murmura-t-elle à l’oreille de François.
Malgré ces petits inconvénients, les Cinq étaient enchantés de leur promenade.
« Maintenant, nous connaissons la région », dit François lorsque la Ford s’arrêta dans une secousse qui les jeta les uns sur les autres. « Elle est magnifique ; je ne suis pas étonné que le vieux grand-père et M. et Mme Bonnard tiennent tant à leur propriété. Dommage qu’ils n’aient pas conservé tous leurs champs. Merci beaucoup, Roger. Nous avons passé une excellente matinée. Je voudrais bien que mes parents aient une ferme comme celle-ci.
— Un ferme comme celle-ci ! Il en a fallu, du temps, pour en faire ce qu’elle est. Notre Normandie est pleine de souvenirs des siècles passés. Personne ne sait maintenant qui a été pendu au bois du Pendu ni quels rétameurs venaient dans le bois qui porte leur nom. Pourtant c’est un peu comme s’ils vivaient encore. »
Annie regarda Roger avec étonnement. L’ouvrier agricole était poète à ses heures. Il rencontra son regard.
« Vous comprenez, n’est-ce pas ? dit-il en hochant la tête. Il y en a d’autres qui ne saisissent pas. Ce M. Henning par exemple : il admire tout de confiance mais il ne comprend rien. Quant à son gamin !
À la grande surprise d’Annie, il se retourna pour cracher par terre.
« Voilà ce que je pense de lui.
— C’est la façon dont il a été élevé, dit Annie. J’ai connu des petits Américains très gentils…
— Eh bien, celui-là a une tête à claques, dit Roger. Si Mme Bonnard ne m’avait pas supplié de ne pas le toucher, il aurait déjà reçu une bonne correction. Il poursuit les veaux et les poules, jette des pierres aux canards, éparpille le blé à pleines mains pour s’amuser. Chaque fois que je le vois, la main me démange ! »
Les quatre écoutaient en silence, horrifiés. Junior était donc encore plus désagréable qu’ils ne l’avaient imaginé. Claude se réjouissait de lui avoir donné une bonne leçon.
« Ne vous tourmentez plus au sujet de Junior, dit François. Nous le surveillerons ! »
Après avoir dit au revoir à Roger et l’avoir remercié, ils retournèrent à la maison, un peu endoloris et ankylosés, mais gardant dans les yeux l’image des prairies vertes, des gras pâturages, des belles bêtes bien soignées.
« C’était très beau, dit François qui exprimait le sentiment de tous. Très beau. J’aime encore mieux la campagne depuis que j’ai vu ces champs de Normandie si paisibles sous le soleil.
— Roger me plaît beaucoup, ajouta Annie. On le sent attaché à son pays. Tous les deux ne font qu’un.
— Annie a découvert ce que c’est que l’amour de la terre, dit Michel. Je meurs de faim ; je n’aurai pas la patience d’attendre jusqu’au déjeuner. Allons manger des gâteaux à la pâtisserie du village.
— Excellente idée », approuvèrent Annie et Claude.
Dagobert lui-même aboya pour montrer qu’il donnait son assentiment. Ils descendirent le chemin qui menait au village. Quand ils poussèrent la porte de la boutique, Ginette, la petite bavarde, accourut.
« Je suis contente de vous voir, dit-elle en souriant. Maman a fait des macarons ce matin ; ils sont délicieux.
— Comment a-t-elle deviné que nous adorons les macarons ? dit Michel en s’asseyant à une table. Donne-nous-en tout un plat.
— Tout un plat ! s’écria Ginette. Mais il y en a au moins vingt.
— Ce ne sera pas trop, répliqua Michel. Et une glace pour chacun. N’oublie pas notre chien.
— Ça non, dit Ginette. Il est si beau ! Vous avez remarqué comme il a des yeux expressifs ?
— Bien sûr. Nous le connaissons depuis longtemps », dit Michel amusé.
Claude se rengorgeait ; les compliments adressés à son chien la comblaient d’aise. Dagobert, pour manifester sa satisfaction, lécha la main de Ginette.
Les macarons étaient délicieux. Claude en donna un à Dagobert mais il ne prit pas le temps de le savourer et n’en fit qu’une bouchée. Puis il promena sa glace dans toute la boutique, au grand amusement de Ginette.
« Vous êtes bien chez Mme Bonnard ? demanda la fillette. Elle est gentille, n’est-ce pas ?
— Très gentille, approuvèrent tous les autres.
— Nous sommes enchantés d’être à la ferme, ajouta Annie. Ce matin, nous avons fait une promenade dans la Ford.
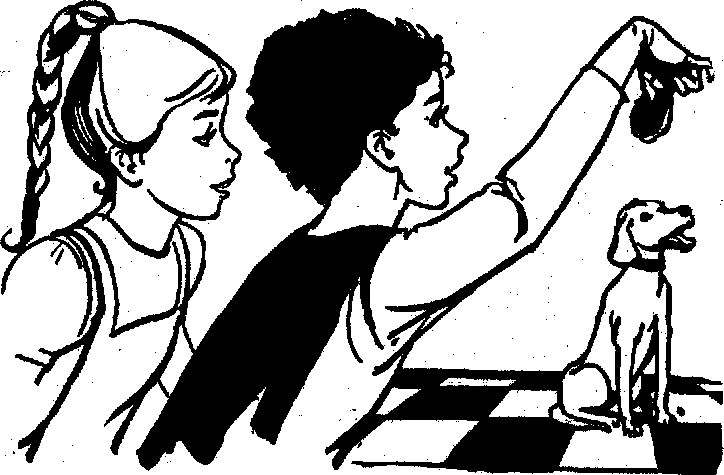
— C’est mon oncle Roger qui vous conduisait ? demanda Ginette. Il est très silencieux avec les gens qu’il ne connaît pas.
— Il nous a beaucoup parlé, protesta François. Il est très intéressant. Est-ce qu’il aime les macarons ?
— Bien sûr ! répliqua Ginette un peu surprise. Tout le monde aime les macarons de maman.
— Crois-tu qu’il en mangerait six ? demanda François.
— Certainement, dit Ginette, les yeux écarquillés par l’étonnement.
— Bon, mets-en six dans un sac, dit François. Je les lui donnerai pour le remercier de la belle promenade qu’il nous a fait faire.
— Ça, c’est gentil ! s’écria Ginette. Mon oncle a passé toute sa vie à la ferme des Trois-Pignons. Vous lui demanderez de vous montrer l’emplacement du château de Francville qui a brûlé et…
— Le château ? interrompit Claude surprise. Nous avons parcouru tous les alentours de la ferme et nous n’avons aperçu aucune ruine.
— Il n’en reste plus rien, expliqua Ginette. Le château a été brûlé il y a des siècles. La ferme en faisait partie. Dans le petit magasin d’antiquités, j’ai vu des gravures qui le représentent.
— Ginette, combien de fois t’ai-je dit de ne pas bavarder avec les clients ? dit la mère qui entrait. Quelle langue tu as ! Tu fatigues les gens !
— Non, protesta François. Elle nous raconte des choses très intéressantes. Je vous en prie, ne la renvoyez pas. »
Mais Ginette, rouge et confuse, s’était enfuie. Sa mère arrangeait les gâteaux sur le comptoir.
« Qu’avez-vous pris ? demanda-t-elle. Mon Dieu, où sont passés tous les macarons ? Il y en avait au moins deux douzaines.
— Nous en avons mangé dix-huit ; notre chien nous a aidés. Et nous en emportons six que Ginette a mis dans un sac.
— Vingt-quatre macarons ! dit la mère de Ginette, étonnée.
— Et cinq glaces, dit François. Cela fait combien ? Les macarons étaient délicieux. »
La mère de Ginette ne put s’empêcher de sourire. Elle fit le compte et François paya.
« Revenez, dit-elle, mais faites taire ma petite bavarde si elle vous ennuie. »
Heureux de vivre, ils sortirent de la boutique. Dagobert se léchait les babines dans l’espoir d’y retrouver une miette de macaron. Arrivée au chemin qui conduisait à la ferme, Annie s’arrêta.
« Je voudrais voir ce qu’il y a dans le petit magasin d’antiquités, dit-elle. Ne m’attendez pas ; je vous rejoindrai dans un moment.
— Je t’accompagne », dit Claude.
Toutes les deux se dirigèrent vers la petite boutique. Les garçons continuèrent leur chemin.
« Nous allons proposer notre aide aux jumeaux ! cria Michel. À tout à l’heure. »
En entrant dans le magasin, Claude et Annie se heurtèrent à deux personnes qui en sortaient : M. Henning et un homme qu’elles n’avaient jamais vu.
« Bonjour », dit M. Henning.
Il s’éloigna avec son ami. Annie et Claude pénétrèrent dans la petite boutique obscure. Un vieillard tambourinait sur le comptoir. La colère contractait son visage. Les deux fillettes furent effrayées par le regard qu’il leur lança.
« Cet homme ! »dit le vieillard avec un tel froncement de sourcils que ses lunettes tombèrent.
Annie l’aida à les retrouver au milieu des bibelots qui encombraient le comptoir. Il les plaça de nouveau sur son nez et regarda sévèrement les deux visiteuses accompagnées de Dagobert.
« Allez-vous-en, je n’ai pas de temps à perdre, dit-il. Je suis occupé. Je n’aime pas les enfants. Ils touchent à tout sans jamais rien acheter ! Ce petit Américain par exemple… Mais vous ne savez pas de qui je parle, n’est-ce pas ? Je suis hors de moi. Quel déchirement de voir des gens acheter mes beaux objets anciens pour les emporter dans des contrées lointaines où ils seront dépaysés. Maintenant…
— Je vous en prie, monsieur Francville, ne nous chassez pas, dit Annie de sa voix douce. Vous êtes M. Francville, n’est-ce pas ? Je voudrais regarder ces beaux vieux chandeliers de cuivre. Je ne vous dérangerai pas longtemps, Nous sommes à la ferme des Trois-Pignons…
— À la ferme des Trois-Pignons ? s’écria le vieillard qui se radoucit. Alors vous connaissez mon grand ami Albert, mon très grand ami.
— Le père des jumeaux ? demanda Claude. Je croyais qu’il s’appelait André.
— Non, non, Albert Francville, le grand-père. C’est un de mes cousins éloignés. Nous étions à l’école ensemble, dit le vieillard tout ému. Ah ! Je pourrais vous en dire sur les Francville et le château qu’ils possédaient autrefois. Oui, je suis un descendant des propriétaires de ce château, voyez-vous, celui qui a été brûlé. Je pourrais vous en raconter, des histoires ! »
Ce fut à ce moment que l’aventure commença. L’aventure de la ferme des Trois-Pignons qui devait laisser aux Cinq un souvenir ineffaçable !