CHAPITRE XII
De plus en plus palpitant
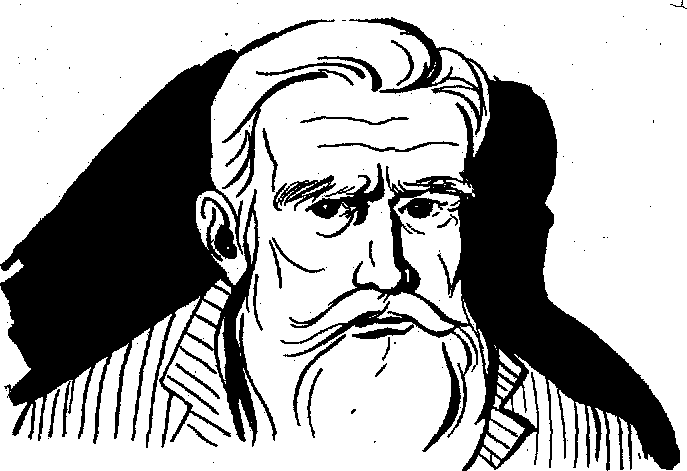
PENDANT le goûter, François parla de la vieille porte à Mme Bonnard.
« Elle est très belle, dit-il. Croyez-vous qu’elle vienne du château fort ?
— C’est ce que l’on prétend, répondit Mme Bonnard. Grand-père en sait plus que moi à ce sujet. »
Le grand-père n’avait pas pris place à table. Il était assis dans son grand fauteuil près de la fenêtre, Friquet à ses pieds. Il fumait paisiblement sa pipe ; un verre de vin était placé près de lui sur le rebord de la fenêtre.
« Qu’est-ce que c’est ? cria-t-il. Parlez plus fort. »
François répéta les paroles de Mme Bonnard ; le vieillard hocha la tête.
« Oui, la porte vient du château fort. Elle est en chêne comme les poutres des granges et les parquets des chambres. Ce M. Henning veut aussi l’acheter ! cria-t-il d’une voix irritée. Il m’en a offert une grosse somme, cent dollars. Je n’accepterais pas, quand même il me donnerait le triple. À l’idée que cette vieille porte peut être placée dans un gratte-ciel, j’ai le frisson. J’ai dit non ; je le répéterai jusqu’à ma mort.
— Calmez-vous, grand-père », dit Mme Bonnard, et elle ajouta tout bas à l’adresse de François : « Vite, parlez d’autre chose ; sinon il va de nouveau se mettre en colère. »
François se creusa la tête pour trouver un sujet de conversation. Soudain, il pensa au poulailler. Il se hâta de décrire les travaux de l’après-midi ; le grand-père s’apaisa aussitôt ; il daigna même complimenter les ouvriers improvisés. Friquet qui, effrayé par les cris, s’était réfugié à côté des jumeaux, retourna à sa place accoutumée. Dagobert le rejoignit.
Le grand-père était maintenant l’image du bonheur, tirant sur sa vieille pipe, un chien à ses pieds et caressant la grosse tête que l’autre avait posée sur ses genoux. Dagobert s’était pris d’amitié pour le patriarche de la ferme.
M. Henning ne revint pas ce soir-là, à la grande joie de tous, mais le lendemain avant le déjeuner il reparut, accompagné d’un petit homme desséché qui portait des lunettes aux verres épais. Il le présenta sous le nom de M. Richard Durleston.
« Le grand Richard Durleston, dit-il avec fierté. C’est l’expert en antiquités le plus érudit des Etats-Unis. J’aimerais lui faire voir votre vieille porte après le déjeuner, madame Bonnard, ainsi que la belle cheminée de la chambre du premier étage ».
Par bonheur, le grand-père n’était pas là ; le repas terminé, Mme Bonnard montra la vieille porte à M. Durleston.
« Oui, dit-il. Elle est tout à fait authentique. Elle est très belle. Je vous en offrirai une grosse somme. »
Mme Bonnard avait bien envie d’accepter. Ce serait une telle aubaine pour la ferme ! Mais elle secoua la tête.
« Il faudra en parler au grand-père, dit-elle. J’ai bien peur qu’il ne refuse. Je vais vous montrer maintenant la cheminée. »
Elle fit monter M. Henning et M. Durleston dans la chambre des filles. Les quatre suivirent avec Dagobert Ils avaient déjà admiré la cheminée assez vaste pour y brûler un tronc de chêne ; elle était en briques sculptées qui portaient la patine des siècles ; ses chenets en fer forgé, ses accessoires, la pelle, les pincettes, le soufflet avaient le charme des objets qui évoquent le passé. Des chandeliers de cuivre s’alignaient sur le manteau.
Les deux hommes examinèrent attentivement chaque détail. Les enfants les imitèrent.
La fermière, un peu à l’écart, attendait, l’air anxieux. Annie devinait qu’elle ne se séparerait pas sans tristesse de ces souvenirs de famille, mais qu’elle s’y résignerait pour ses enfants et dans l’intérêt de la ferme.
« C’est très intéressant. Il est rare de trouver une cheminée ancienne aussi belle, déclara M. Durleston, les yeux presque invisibles derrière ses verres épais. Je vous conseille de l’acheter, monsieur Henning. Cette vieille maison est très pittoresque. Nous jetterons un coup d’œil dans les granges et dans les hangars. Nous y dénicherons peut-être des objets curieux. »
Claude se réjouit que les jumeaux ne fussent pas là pour entendre ces paroles. À l’exemple de leur grand-père, ils auraient tempêté contre ces acheteurs qui avaient la prétention de les dépouiller. Mme Bonnard fit redescendre les deux Américains ; les quatre enfants suivirent.
« Vous permettez que je conduise M. Durleston à la vieille chapelle ? » demanda M. Henning.
Mme Bonnard hocha la tête. Elle retourna dans la cuisine afin de préparer un gâteau pour le goûter. Les quatre échangèrent un regard, et François, d’un signe de tête, indiqua les deux hommes qui s’éloignaient.
« Si nous y allions aussi ? proposa-t-il. Nous n’avons pas encore vu cette chapelle. »
Quelques minutes plus tard, ils arrivaient devant un petit édifice au haut fronton et aux belles fenêtres en ogive. Ils entrèrent à la suite des Américains, puis s’arrêtèrent pour jeter un coup d’œil autour d’eux.
« Oui, on voit bien que c’était autrefois une chapelle, dit François qui, instinctivement, baissait la voix. Ces vieilles fenêtres, ce cintre là-bas…
—Et cette atmosphère ! renchérit Annie. M. Francville a dit qu’elle était encore pleine de prières. Je comprends maintenant le sens de ses paroles. Quel dommage que cette chapelle ne soit plus qu’une resserre.
— Le vieil antiquaire du village m’a raconté qu’au XIIe siècle dame Philippine, la châtelaine, venait tous les soirs ici avec ses enfants, dit M. Durleston. Simple légende peut-être, mais qui n’a rien d’invraisemblable. Je me demande quel chemin conduisait au château. Il ne reste plus rien.
— J’aimerais acheter cette chapelle, la démolir et l’emporter pierre par pierre dans ma propriété des États-Unis ! s’écria M. Henning d’une voix enthousiaste. Elle ferait très bel effet dans mon parc, entre la piscine et le tennis.
— Je ne vous le conseille pas, protesta M. Durleston en hochant la tête. Ce ne serait pas de très bon goût. Allons visiter ces hangars là-bas. Vous dites qu’ils sont encombrés de bric-à-brac. Nous y ferons peut-être des trouvailles. »
Ils s’éloignèrent ; les enfants restèrent dans la petite chapelle. Des sacs de grains s’entassaient sur les dalles ; une chatte léchait ses trois petits dans un coin, une tourterelle roucoulait sur le toit sans troubler le silence. Au bout d’un moment, les enfants sortirent sans bruit ; ils n’avaient plus aucune envie d’accompagner M. Henning dans sa tournée.
« Du moins l’autre l’a empêché de démolir la chapelle pour la reconstruire ailleurs, dit Annie. Vous la voyez dans son parc entre une piscine et un tennis ! Je lui aurais volontiers griffé la figure.
— Te voilà aussi irritée que le vieux grand-père, Annie, remarqua François en prenant le bras de sa sœur. Je ne crois pas d’ailleurs que les Bonnard accepteraient de vendre la chapelle, même si M. Henning en offrait des milliers de dollars.
— Ce M. Henning m’est tout à fait antipathique, reprit Annie. Il veut acheter des souvenirs historiques comme on achète du chocolat ou des bonbons. »
Les autres éclatèrent de rire. « Puisque nous sommes dehors, profitons-en, dit François. Commençons à chercher l’emplacement du château. Je suppose qu’il n’est pas très loin de la chapelle.
— Oui, dit Michel. En toute probabilité sur une colline. L’ennui, c’est que les collines ne manquent pas autour de la ferme.
— Explorons la plus proche, proposa Claude. Voici les jumeaux. Appelons-les ; ils seront peut-être contents de venir. »
Les jumeaux les rejoignirent ; ils acceptèrent avec joie de se joindre aux recherches.
« Nous en avons pour des années avant d’avoir inspecté tous les alentours, remarqua Daniel. Pour ma part, je n’ai pas grand espoir.
— Nous avons l’intention de monter sur la colline la plus proche, dit François. Dago, Friquet, suivez-nous. Voici Zoé. Pas sur moi, si ça ne te fait rien, Zoé. Je tiens à mes oreilles.
— Crâ ! Crâ !. »dit la pie.
Elle se percha sur l’épaule de Danièle. Ils commencèrent à gravir la colline sans voir autre chose qu’une herbe verte et luxuriante. Puis, un haut monticule se dressa sur leur chemin. À sa base s’ouvraient de nombreux terriers de lapins.
Dagobert ne pouvait pas voir l’ouverture d’un terrier sans avoir envie d’y pénétrer ; Friquet et lui se mirent à gratter le sol avec frénésie. Friquet était assez petit pour disparaître dans le trou ; il en ressortit avec un morceau de poterie entre les dents. François, étonné, le lui enleva.
« Une poterie cassée, dit-il. Elle est d’une couleur indéfinissable et ne ressemble pas à ce que l’on fait aujourd’hui. Comment est-elle arrivée ici ? Retourne là-dedans, Friquet. Gratte plus fort, Dagobert. J’ai une idée. »

Dagobert obéit sans se faire prier ; quand Friquet eut fait plusieurs allées et venues, les enfants furent en possession d’un petit tas de fragments de poterie et d’os de toutes tailles.
« C’est curieux ! dit François. Ou je me trompe fort, ou nous avons découvert un kjœkkenmœdding.
— Un quoi ? Qu’est-ce que ça veut dire ? demanda Claude.
— C’est un terme archéologique pour désigner les dépôts d’ordures des temps anciens, expliqua François en ramassant quelques débris. Notre professeur d’histoire nous en a parlé juste avant les vacances. C’était un grand trou où l’on enfouissait les détritus des maisons ou des châteaux forts. Les os et les poteries ne pourrissent pas comme le reste ; je crois que nous avons devant nous le kjœkkenmœdding du château de Francville. Ma parole… quelle découverte ! Elle nous donne un renseignement précieux.
— Lequel ? demandèrent les autres.
— Le château s’élevait quelque part sur cette colline, expliqua François. Le dépôt d’ordures n’était sans doute pas très loin de ses murs. Nous sommes sur la piste, mes amis, sur la bonne piste ! Montons un peu plus haut. Examinons le terrain, centimètre par centimètre. »