La promptitude est l’essence même de la guerre. Tirez parti du manque de préparation de l’ennemi ; empruntez des itinéraires imprévus et frappez-le là où il ne s’est pas prémuni.
L’art de la guerre, Les neuf sortes de terrain,
Sun Tzu, général de l’Empire du Milieu entre l’an 400 et 320 av. J. -C.
À Rouffillac, à Sarlat, puis près d’Angoulême au cours de l’été de l’an de grâce MCCCLIII{48}.
L’incendie qui s’était déclaré en notre manoir de Braulen avait fait des dégâts considérables. Pas autant toutefois que Guilbaud l’avait craint. Seuls les dépendances, les granges, le grenier à blé et les écuries étaient détruits. Ils fumaient encore à notre arrivée, la nuit même. Des retours de flamme surgissaient des ténèbres, au moindre souffle d’air.
Des communs, où logeaient nos serviteurs, nos servantes, nos palefreniers et notre modeste garnison de gens d’armes et d’archers, il ne restait que des murs. Les bâtiments étaient inhabitables Nous dûmes les héberger en le château de Rouffillac, beaucoup plus vaste que les dépendances calcinées de notre manoir, en attendant qu’elles soient reconstruites.
Nos réserves de foin et de paille s’étaient embrasées, ce qui n’était point si grave, puisqu’elles étaient presque épuisées et que les fenaisons d’été approchaient.
Si le vent avait soufflé de l’est, il ne serait resté de notre demeure qu’un amas de pierre et de poutres calcinées. Par la grâce de Dieu, il n’en avait pas été ainsi. Les palefreniers avaient ouvert les portes des écuries à temps et tous nos chevaux paissaient paisiblement dans le pré, autant que nous pûmes en juger par cette nuit de lune ronde.
Palefreniers et chevaux furent remerciés, chacun selon leurs mérites. Nos chevaux reçurent double ration de ce qu’il nous restait d’avoine. Avec l’herbe tendre de la reverdie, ils deviendraient haut la main et devraient être montés très vite. Les palefreniers, quant à eux, remercièrent Marguerite de sa générosité : elle avait bourse déliée et décidé de doubler leur maigre solde.
En revanche, d’autres malheurs beaucoup plus prégnants s’étaient abattus sur nous et notre famille.
Notre fils, Hugues, jouait dans la basse-cour avec Guillaume de Lebestourac lorsqu’une bride, que tous croyaient alors être de ces grandes compagnies de routiers, avait surgi et surpris notre petite garnison qui n’avait pas eu le temps de se mettre à l’arme.
D’après les témoignages que je recueillis, d’aucuns portaient des surcots aux couleurs écartelées de France et d’Angleterre. Il ne pouvait s’agir que d’une bride anglaise.
Mon compère en chevalerie, le chevalier Guillaume de Lebestourac s’était battu comme un lion et avait occis moult de nos assaillants.
Sur l’heure, il luttait contre la mort dans l’une des chambres de notre manoir, veillé par Marguerite. Il souffrait de graves blessures au chef, aux bras et à la poitrine. D’après des témoins, il avait été surpris alors qu’il enseignait sa façon d’escrémir à notre fils Hugues. Ne pouvant desforer l’épée qu’il ne portait point, il avait affronté l’un des cavaliers, à pied, avec pour seule arme, une épée de bois, avant de le désarçonner, de lui emprunter celle qu’il brandissait, de l’occire et de faire grand foison de nos ennemis.
D’aucuns parmi nos archers avaient cloué au sol cinq ou six Godons. Làs, profitant de la mêlée, l’un d’iceux avait arraché notre fils Hugues avant de s’enfuir au galop avec le reste de sa bride qui avait lancé des torches sur les communs, les écuries, le grenier aux grains et la grange.
Guillaume de Lebestourac avait ordonné à nos deux écuyers de l’aire fi de la défense du manoir dont il se chargeait, pour nous quérir à brides avalées, avant de s’effondrer. Michel de Ferregaye commandait notre garnison de Rouffillac. Il ne s’était pas porté à leur secours, ignorant tout de cette chevauchée.
Alors qu’il avait sauté sur son destrier, Onfroi de Salignac avait été atteint par la flèche d’un de nos archers qui, dans la confusion générale, l’avait pris pour un Anglais. Il l’avait arraché de son épaule sans prendre le soin de bander la plaie pour arrêter l’écoulement du sang. C’était miracle qu’il n’ait pas vidé les arçons avant d’arriver à une lieue de la porte du Figuier où Guilbaud de Rouffignac l’avait rejoint bien plus tard.
Confié aux bons soins des mires de l’hôpital Saint-Jean, il avait regagné notre logis le surlendemain, se plaignant non pas de ses navrures, mais de l’état impraticable des routes que son charnu avait dû affronter sans pouvoir éviter les ornières et les saillies des rochers qui entravaient chaque tour de roue.
Par la grâce de Dieu, il était sauf et se rétablit très vite. Fort heureusement pour lui. Pour moi aussi qui devrais rendre des comptes à son oncle, monseigneur de Salignac, de l’échec de ma mission.
Point de fioles, point de pardon. Plus le péché était grave, plus l’indulgence se baillait cher. Et point d’information sur Arnaud de la Vigerie, aussi. Alors, si le neveu avait passé les pieds outre...
![]()
Marguerite était de méchante humeur. Elle m’avait reproché vertement de n’être pas encore parti à la recherche de notre fils enlevé par les Godons. J’avais bien tenté de lui faire comprendre que je devais d’abord réunir des informations sur la direction que le groupe de cavaliers avait prise avant de me lancer à leur recherche à travers tout le royaume, que nenni. Elle n’avait rien voulu savoir, convaincue que je commettais un acte de récréance puisque je refusais de me porter au secours de l’un de nos enfants :
« Votre fils aîné, qui plus est !
— Parce qu’il n’est plus le vôtre, peut-être ? »
Marguerite ne comprenait pas pourquoi, après notre pèlerinage et les heures qu’elle avait passées à prier dans la chapelle Notre-Dame, le Bon Dieu lui avait infligé pareils malheurs, et j’enrageai à l’idée qu’elle m’en avait attribué la responsabilité, plus ou moins consciemment. Ma quête du Graal, ma haine à l’égard d’Arnaud de la Vigerie ?
Nos rapports, déjà tendus, viraient à l’aigre-doux. J’étais sûr que ma Mie en souffrait autant que moi mais, depuis le décès de notre petit Louis, nous semblions impuissants à rétablir la confiance entre nous dans la plénitude d’une communion du corps et de l’esprit, dans cette belle connivence que nous avions connue autrefois.
Jusqu’au jour où elle me mortifia en m’accusant de tous les maux qui nous frappaient : si je m’étais débarrassé plus tôt de ces fioles maudites qui ne pouvaient contenir que la pestilence, m’avait-elle dit, rien de tout cela ne serait arrivé, meurtres, tentatives d’assassinat sur ma personne et sur la sienne, enlèvement de notre enfant...
À la parfin, elle avait peut-être raison, mais j’entendais bien poursuivre mes investigations jusqu’au bout, quoiqu’il puisse nous en coûter.
Ce fut donc avec la plus grande discrétion que j’interrogeai le maître des maçons qui terminaient les travaux d’agrandissement et de fortification de notre château de Rouffillac. Il reconnut avoir œuvré avec les compains de sa loge à des travaux de maçonnerie, tant à la cathédrale Saint-Front qu’à l’édification d’une partie des nouveaux remparts de la cité sainte.
Lorsque je lui collai sous le nez le document qui portait son sceau et celui de Pierre Tison, évêque de Pierreguys, il reconnut tout de suite qu’un clerc de Roc-Amadour lui avait confié un ancien parchemin, une sorte de relique, qui lui appartenait et dont il souhaitait gratifier en grand secret saint Front lui-même.
À charge pour lui de l’enchâsser dans la pierre de l’un des piliers de la cathédrale et de n’en informer que le porteur du message que je lui avais fourré sous le nez, s’il se faisait reconnaître de lui.
Ne sachant si le clerc avait l’esprit dérangé ou s’il était en proie à quelque fantasmorie, il avait suivi ses instructions à la lettre par respect pour ce vieillard décharné, au regard étrangement lumineux, et scellé le parchemin à deux toises de hauteur à un endroit qu’il me précisa.
Je lui confirmai que le vieillard avait été le confident de feu mon père. Son esprit était dérangé depuis qu’il avait reçu un violent choc à la tête, et la relique n’avait aucune valeur, mentis-je sans vergogne, mais il convenait d’en taire l’existence pour le repos de l’âme de ce saint homme qui serait rappelé à Dieu d’un jour à l’autre.
Je lui tendis une bourse qui contenait quelques florins d’or pour prix de sa discrétion. Il la refusa tout d’abord, le vieux clerc lui ayant déjà baillé richement le prix de ce menu service. Lorsqu’il soupesa la bourse, il se résigna à accepter mon aumône dont il me promit de gratifier les troncs de nos églises.
Sur l’heure, je ne savais pas où le compain d’armes de feu mon père Thibaut avait caché les fioles, mais ne doutais pas que le parchemin scellé dans les pierres de la cathédrale Saint-Front, à Pierreguys, l’indiquerait, le moment venu. Et le moment n’était pas encore venu. Où qu’elles soient, elles étaient en sûreté où il les avait placées. En outre, je pouvais affirmer à monseigneur Elie de Salignac, sans lui mentir, que je l’ignorais.
Ainsi l’explication alambiquée que je pensais donner à monseigneur Elie de Salignac pour lui expliquer la disparition d’une des deux fioles (j’entendais conserver l’autre), ne présentait plus aucun intérêt. Le saint homme à qui je les avais confiées avait été garrotté par un inconnu et il avait emporté le secret dans sa tombe.
Il était grand temps que je sollicite une nouvelle audience de l’évêque de Sarlat, dont je retardais de jour en jour le moment fatal. Avant que je ne sois accusé derechef de ce crime crapuleux, arrêté par le prévôt et desferé devant le tribunal qui jugeait en les affaires criminelles, mis au pilori avant d’être roué et pendu sur l’un des gibets ou enfermé dans un sac solidement cousu, et jeté dans la Cuze.
Le pire supplice pouvait être aussi l’écartèlement qui me priverait de la suscitation, un corps démembré étant condamné à errer pour l’éternité dans les enfers.
![]()
L’entretien fut houleux. Et c’est un euphémisme. Il fut bien pire que ce que je redoutais. Ma vie se joua ce jour-là à pile et croix. Elie de Salignac rentra dans une grande colère, m’invectiva et m’accabla de mots indignes d’un prélat. Son neveu était grièvement blessé et je ne rapportai pas les saintes reliques.
L’évêque avait déjà été informé de la pendaison mystérieuse du pauvre homme de Roc-Amadour. Il me menaça de me faire arrêter par le prévôt sur le champ et de me soumettre à la question, si je n’avouais pas avoir été l’auteur de ce crime sordide que j’aurais commis pour ne pas avoir à lui remettre les précieuses fioles.
En vérité, j’avais l’intime conviction qu’il n’en croyait pas un mot, prêchant une nouvelle fois le faux pour m’extorquer le vrai sous menace de mort.
De sorte que, loin de me démonter, je le menaçais à mon tour de faire appel devant le Conseil du roi de tout jugement ignominieux qui pourrait être prononcé contre moi par le tribunal de Sarlat.
« Et quand bien même j’aurais avoué sous la torture, je me rétracterais !
— Vous seriez relaps et conduit sur le bûcher !
— Ainsi que l’on fit pour le grand maître du Temple, Jacques de Molay ?
— Nous nous égarons, messire Brachet, nous nous égarons… »
Et de lui exposer les deux raisons évidentes pour lesquelles on ne pouvait faire accroire que j’avais été l’auteur de ce crime. Une majeure et une mineure :
I. Parmi la foule considérable des pèlerins qui s’était rassemblée pour la Fête-Dieu, comment prouver ma culpabilité ? Je pouvais faire citer plusieurs témoins qui auraient esté qu’ils ne m’avaient pas quitté d’une semelle (ce qui était évidemment un vrai mensonge dont il ne fut probablement pas dupe, puisqu’il ne manifesta pas le désir de m’entendre en confession).
II. Quel intérêt aurais-je eu à ne pas lui rapporter les fioles que je devais lui livrer pour le prestige de notre cathédrale et le sien, en échange des magnifiques informations qu’il m’avait promises sur Arnaud de la Vigerie ? Mon seul espoir de retrouver la trace de ma sœur et de tendre à icelui le piège que je préparais de longue date pour livrer à Son Excellence le plus grand criminel que la terre ait connu.
Alors, s’il voulait s’assurer que les tourmenteurs de sa chambre de torture n’avaient point perdu la main, il pourrait toujours leur livrer mon ancien compain d’armes qui ne manquerait pas d’avouer ses crimes et l’usage qu’il avait fait de la fiole qu’il avait soustraite, Famagouste, de la boîte à messages que portait l’Aumônier général de la Pignotte, le père Louis-Jean d’Aigrefeuille !
De surcroît, n’était-il pas possible qu’Arnaud de la Vigerie fut le commanditaire du meurtre du sacristain ? N’aurait-il pas chargé un homme de main de cette sale besogne pour mettre la main sur les deux autres fioles ? Trop de monde savait que nous préparions, dame Marguerite et moi, un pèlerinage et le bruit ne serait-il pas parvenu à ses oreilles ? Son Excellence ne m’avait-elle pas dit elle-même que le mal rôdait autour de moi ? Ou alors, était-il impossible qu’un espion se soit glissé dans mon entourage ?
Le doute s’insinuait lentement dans le chef de l’évêque. Il objecta mollement que, si tel avait été le cas, le meurtrier du sacristain aurait pu attendre que je récupère moi-même les fioles pour s’en saisir sur ma personne.
Je lui répondis tout à trac que seul un échelon de cavalerie aurait pu venir à bout de mon escorte composée de l’élite de mes sergents et de mes archers montés, ce qui me paraissait bien peu vraisemblable de la part de quiquionques agiraient dans la plus grande discrétion.
Pendant plus d’une heure, je dus me prêter au jeu des questions et des réponses. À la parfin, monseigneur de Salignac me congédia sur ces simples mots :
« Messire Barthélémy Méhée de Largoët est le nouveau seigneur de la forteresse du même nom, près la ville fortifiée de Vannes, à quelques lieues du golfe du Morbihan.
« Ramenez-le moi vif. Sinon, je vous tiendrais pour responsable de ce nouvel échec. Et il est toujours possible de faire ressortir de vieux dossiers de nos archives, messire Brachet. »
La menace était à peine voilée, la bouche en lame de cotel, le regard froid entre des paupières plissées.
« Il répondra de ses crimes devant mon tribunal, s’ils sont avérés. Et onques, n’oubliez les fioles ! Mes fioles ! Vous êtes trop retors pour ne pas réussir à les récupérer un jour ou l’autre. Le plus tôt sera le mieux. Tel était notre pacte. Il tient toujours. Sur l’heure, je ne lève pas ma main de dessus vous. Faites bonne usage de ma mansuétude. »
Je le remerciai et me retirai, sans oublier de passer par le bureau du camérier, histoire de soulager mon aumônière de quelques louis d’or. Cette fois, monseigneur de Salignac n’avait pas eu besoin de me le rappeler. Je connaissais la procédure ; elle coulait désormais de source.
Sur la place de la cathédrale Saint-Sacerdoce, je mis le pied sur le haussepied pour me hisser à cheval et me calai sur les arçons. Je jubilai : je détenais toujours les fioles (tout au moins l’espérais-je) et savais où s’était réfugié le monstre. J’en toucherai un mot au chevalier de Foulques de Montfort. Mon enquête avançait à grand pas.
J’ignorai seulement que je ne réussirais pas à desférer Arnaud île la Vigerie, alias Barthélémy Méhée, seigneur de Largoët, devant mon tribunal de l’Ombre avant seize longues années. Car le destin en avait décidé ainsi.
![]()
À mon retour au manoir de Braulen, charpentiers, tailleurs de pierres, maçons, menuisiers et autres compains des jurandes et des loges s’affairaient à redresser les murs, tailler chevilles et chevillettes, à dégauchir sommiers, madriers et solives des charpentes détruites par le feu pendant que des manouvriers dégageaient les gravats.
Marguerite m’attendait devant le porche du manoir, une pièce de veelin à la main, fort agitée, un maigre sourire sur les lèvres : « Messire mon mari, j’ai bonne nouvelle. Un chevaucheur vient de nous remettre ce message : notre fils Hugues sera libéré contre une modeste rançon de douze sols et six deniers, le jour de la vigile de saint Jean-Baptiste{49}, à tierce, si vous vous rendez en Angoumois dans un lieu qui vous sera précisé le moment venu. La missive porte le seing et le sceau de messire Franck de la Halle. N’est-il pas l’un des maréchaux de l’ost du comte de Derby ?
— Si fait, ma Mie ! Que Dieu et la Vierge Marie en soient louangés ! Quelle heureuse nouvelle ! Douze sols et six deniers ?
— Oui, la rançon est dérisoire. Le prix à bailler pour le messager, est-il écrit. Nous devons à messire de la Halle une intervention directe auprès des ravisseurs. En remerciement pour avoir été convié au grand tournoiement, l’an passé, souffla-t-elle en me tendant le pli.
— Humm… Mais ne serait-ce pas un piège ? Attirer le gros gibier en l’appâtant par le petit ? La pratique en est connue !
— Messire de la Halle est un ennemi, certes, mais il fait preuve d’esprit de chevalerie. Un grand seigneur. Il déclare n’avoir ordonné ni l’incendie de notre manoir ni l’enlèvement de notre fils Hugues.
« Une malheureuse initiative de l’une de ses brides, une demie compagnie d’archers gallois et de sergents anglais en quête de pillage, à qui on ne pouvait reprocher leurs actes de vandalisme car ils n’avaient pas perçu leur solde.
« Le convoi chargé de l’acheminer était tombé dans une embuscade tendue par des nobliaux bretons et une piétaille vêtue de sacs et de cordes. Ils étaient commandés par un capitaine, un certain Bertrand Du Guesclin, dont la bien triste et peu chevaleresque réputation n’était plus à faire. Édouard de Woodstock avait d’ailleurs mis sa tête à prix, mais ce brigand leur filait toujours entre les doigts.
— Ces soudoyers vont le payer chèrement ! Qu’ils soient gallois ou anglais, crachotai-je. Par le Sang-Dieu, je leur ferai payer de leur vie l’enlèvement de notre fils !
— Que le Ciel vous en garde, mon ami ! Je vous en conjure ! Nous risquerions de ne pas récupérer notre fils sain et vif.
— N’ayez crainte, ma Mie, j’agirai avec grande prudence et vous ramènerai celui qui, me semble-t-il, est redevenu votre fils… Vif et libre ! J’en fais le serment à la Sainte Vierge. »
Marguerite s’ococoula dans mes bras et daigna recevoir l’hommage d’une chaste poutoune. Sur le front. Puis, ô miracle, sur les lèvres.
Je suis un être de lumière
Qui, dans le sillon de mon erre,
Peut étancher ta soif d’eau vive,
Si m’amour, tu vois les rives.
Force vive des âmes pures
Qui brise tous les esprits impurs,
Vrai symbole de l’innocence,
Qui oublie la faiblesse des sens,
Méprise la lâcheté et la trahison.
Si tu veux donner à ta vie une raison,
Accepte trop d’amour et trop de tendresse
De celle qui t’en fait l’offrande et le don.
Tu peux toujours pardonner la maladresse
D’un cœur qui t’aime, s’il te paraît vraiment bon.
Accepte encore ce modeste présent,
Avant que ton âme s’envole dans le vent.
![]()
Le lieu était sordide. Un maigre feu crépitait dans l’âtre de la cheminée. L’atmosphère empestait. Des effluves de vin se mélangeaient à des relents d’oignon, à vous donner la nausée. Le sol en terre battue était dur, bosselé, inégal et craquelé par endroits.
Les sièges, des tabourets, quelques bancs sans dossier étaient disposés sans aucun ordre, de-ci de-là, bancals comme les tables. Comme le tavernier qui claudiquait d’une jambe sur l’autre. Sa mine renfrognée n’inspirait qu’une confiance limitée. Encore un qui n’aimait pas le métier qu’il exerçait.
Le regard humide des yeux globuleux qu’il posait furtivement sur ses convives témoignait du sens de l’accueil qu’il réservait dans son coupe-gorge. Le visage couperosé, la lippe arrogante et baveuse, les lobes des oreilles, qu’il avait grandes et écartées comme un chou-navet, pendaient lamentablement le long de ses bajoues sans avoir l’élégance de celles d’un chien des Pyrénées.
Ils étaient là, tous les douze. Huit archers gallois et quatre sergents aux armes écartelées de France et d’Angleterre. Ceux que j’avais pistés depuis le matin. Je savais qu’ils me mèneraient au camp que le prince de Galles, Édouard de Woodstock, avait dressé pas très loin. Sans que je pusse le localiser. Attablés devant une marmite tripode de soupe à l’oignon, bien fumante. Ils avaient rapproché deux tables, bout à bout, tant bien que mal.
L’un d’entre eux, le grand dégingandé, était assis sur le coin de l’une des tables. Il porta à haute voix une santé à leur roi Édouard et au prince de Galles. Il vida sa pinte cul sec. Le rouge délicat d’un vin de Loire dégoulinait autour de la commissure de ses lèvres, maculant les léopards d’Angleterre (ce n’était pas grave) et souillant les lys de France qu’il arborait sur sa cotte d’armes (c’était plus gênant). Le petit, le gros, le rouquin et le chauve levèrent leur godet.
Quatre autres roulaient les dés qu’ils avaient sortis de leur poche et jetaient quelques pièces de menue monnaie sur la table. Les enchères montaient. Ils surenchérissaient en s’administrant de fortes claques dans le dos avec des jappements de chien qui aboient dans un patois mâtiné d’anglais et de français : « Godam, Saint-George ! »
Ils étaient heureux, les Godons. Le vin et la cervoise coulaient à flot. Dans leur gosier aussi. Dans leur gosier surtout. Tant mieux. D’ici une heure ou deux, ils seraient bien mûrs et mon travail n’en serait que plus aisé.
Je me faufilai le plus discrètement possible entre les tables et les sièges inoccupés, et posai mes fesses dans le coin le plus reculé et le plus sombre de la taverne. Près de la porte d’entrée. À un endroit d’où je pouvais suivre leur beuverie tout en guettant les faits et gestes d’un autre convive sagement assis dans un angle opposé au mien.
Personne ne semblait avoir remarqué ma présence. Mon mantel était d’une couleur noire qui ne dénotait pas sur les murs crasseux et enfumés de la taverne. J’en délaçai la ceinture et posai le tout sur un tabouret, à portée de la main.
L’inconnu était vêtu d’un mantel et d’une capuche assez semblables aux miens, qu’il avait cependant gardés sur les épaules et sur le chef.
Il tranchait silencieusement quelques petits morceaux de lard que des mains larges et fortes posaient délicatement sur d’aussi petits tranchoirs de pain rassis, avant de les tremper dans la soupe à la pointe d’un coutelas, et de les engloutir voracement. Je l’observais sans en avoir l’air.
Il se tenait séant, le dos accolé à l’un des murs. Une chandelle posée sur la table, à sa dextre, ne l’éclairait pas suffisamment pour que je puisse cerner les traits de son visage.
Un bref instant, il me jeta un coup d’œil. Des yeux gris-bleu, presque transparents tant ils étaient clairs. Leur prunelle, autant que je pus en juger à cette distance, me glaça le dos. Un frisson me parcourut l’échine.
Celui-là, s’il faisait partie de la bande, serait coriace. Beaucoup plus dangereux que les douze autres là-bas. Était-ce un pèlerin ? Un capitaine anglais ? Un espion ? Un chevalier de la suite du prince de Galles, Édouard de Woodstock ? Un Godon certainement.
Le tavernier s’approcha de moi pour prendre ma commande. Je lui demandai s’il disposait de vin de Loire ou de Bordeaux, de lard et de soupe aux choux. Il fit une grimace et se pencha vers moi : dans le tumulte de cris et de grognements que soulevaient les Godons, il n’entendait rien et me pria de parler plus fort. Ce que je voulais justement éviter.
Il tendit vers moi son oreille senestre. Peut-être était-il sourd de la dextre ? Une superbe verrue était plantée sur sa joue. Un peu plus, et les trois poils noirs qui sortaient du poireau m’auraient caressé le visage.
J’approchai mes lèvres du lobe de son oreille. Il ne saisissait toujours pas ma commande. Normal, des sécrétions de miel en obstruaient le pavillon qu’il avait sale et velu.
Je dus hausser la voix. En bon français.
Un des sergents d’armes, à l’autre bout de la pièce, m’entendit.
Il était en plus grande mélancolie que les autres. Il se redressa, me lança à la figure : « Sale cochon de Français ! » avec un fort accent qui devait être du pays de Galles.
Le tavernier se dirigea vers lui. Je ne bougeai pas d’un pouce, les muscles tendus, prêt à desforer. J’évitai soigneusement de le regarder. Le moment n’était pas venu de lui régler son compte. Il récidiva : « Sale porc de Français », en faisant mine de saisir une épée dont il avait eu la malheureuse idée de poser le fourreau sur la table.
L’inconnu, en face, se leva prestement, renversant le banc sur lequel il était assis. Il dégrafa la fibule de son mantel et se redressa tel Goliath face à David. Un colosse d’une trentaine d’années. Un visage dur, burelé, les cheveux, sur son crâne, coiffés d’une tignasse blonde en hérisson, les tempes et la nuque rasées de près. Je le reconnus incontinent. Il aboya :
« Halt’s Maul, sonst poliere ich Dir die Fresse dass Dir semptliche Gesichtzüge entgleisen ! »
— Toi, l’étranger, tu n’es pas invité à la danse », cria dans un mauvais français, un des archers gallois, déchaîné.
— Donnerwetter ! »
D’un mouvement tournant, en moins de temps qu’il n’en faut pour le dire, le colosse jeta sa cape, découvrit un jupeau d’armer blanc dont la poitrine arborait les armes à la croix de sable caractéristique des chevaliers de l’Ordre de Sainte-Marie des Teutoniques.
C’était lui ! Ces yeux gris-bleu ! C’était bien lui : le chevalier Wilhem von Forstner ! Il avait brillamment jouté lors de notre grand tournoiement de Beynac et m’avait fait proposition de rejoindre la Prusse orientale pour mériter indulgence plénière lors d’un pèlerinage hivernal contre les païens de Lituanie !
Avant que je n’eusse le temps de me lever, il se saisit d’une morgenstern, une étoile du matin, d’une main, et d’une gigantesque hache d’armes, de l’autre. Il était ambidextre.
Le fléau d’armes, une massive boule d’acier hérissée de moult pointes acérées aussi dangereuses pour l’homme et les chevaux que les chausse-trappes tétraèdres, était relié au manche par une chaîne d’anneaux entrelacés.
Le tranchant de la hache, en forme de croissant de lune, brillait d’un éclat bleuté, signe d’un passage récent à la meule. Il était prolongé, de l’autre côté, par un pic de trois pouces qui devait traverser les mailles d’un haubert avec l’aisance de l’aiguillon d’un cordonnier.
Il se rua sur le rouquin qui s’apprêtait à dégainer, une main sur la garde de son épée, l’autre sur le fourreau. Il n’aurait jamais dû les poser sur la table. Une très mauvaise idée. Je remarquai les veines de ses doigts gonflés par le vin et la colère.
Un double sifflement. La hache sectionna le poignet tandis que l’étoile du matin bénissait le crâne d’un deuxième Godon, le plus petit. Son casque vola dans l’air et tomba à mes pieds. Des filaments rosâtres de sa cervelle m’éclaboussèrent les joues.
Les cruches, les pots de grès, tout vola à travers la taverne, éclaboussant les murs, souillant le sol.
« Verdammt nochmal ! Je t’avais pourtant dit de fermer ta gueule ! » hucha le Teuton.
Dans un deuxième assaut et dans un mouvement d’une amplitude incroyable, le chevalier teutonique balança l’aspersoir d’eau bénite sur la poitrine d’un troisième archer anglais, le projeta à dix pas, lui creva les poumons, et trancha de sa hache l’autre main du Godon, celle qui, toujours posée sur la table, avait saisi le fourreau. Les yeux du soldat lui sortirent de la tête. Ses doigts restaient convulsivement accrochés à son épée.
Le chevalier teutonique posa la morgenstern, se saisit du fourreau, replia une main énorme sur la garde de l’épée en écrasant les moignons sanguinolents qui s’y cramponnaient encore, bloqua de son pied le fourreau sur la table, la dégaina, la coinça entre deux lattes de la table, la brisa et lança ce qu’il en restait, le pommeau, la poignée et le moignon, la garde et un fragment de lame à la tête des autres Anglais.
« Teufel ! » Il dégaina une miséricorde pour trancher la bourse que le mauvais homme portait à la ceinture. Le chevalier était-il maladroit ? La lame du couteau glissa sur les lacets, ouvrit le ventre du soldat qu’il venait d’amputer des deux mains, avant de sectionner les cordons de la bourse.
Les tripes, les boyaux jaillirent de l’éventration dans un gargouillis sanguinolent et bulbeux. Le Teuton saisit la bourse au vol avant de la renverser sur la table :
« Ach, ach, ach ! Herr Stubenmeister, that is for you ! Ces hommes étaient mes invités ! » Il s’esbouffait à gueule bec pendant que les pièces de monnaie se répandaient et cliquetaient d’un son argenté et cuivré.
Quatre nouveaux sifflements de la hache, côté pic et côté tranchant. De vifs mouvements tourbillonnants du fléau d’armes, et le gros, le chauve et deux autres soldats godons de plus jonchaient le sol.
Sur le front des uns, une magnifique étoile d’un beau rouge écarlate, large d’un pouce. Sur le ventre des autres, des mailles disloquées, entrebâillées, laissaient s’échapper boyaux et viscères. Ils s’épanouissaient avec délice, enfin libérés de toute contrainte abdominale, tels des boudins fraîchement crevés.
Une chandelle s’était renversée et le maître des lieux, le Stubenmeister, se précipita pour éviter le pire. Le pire fut évité : la masure ne prit pas feu. Dommage.
Les survivants de cette Blitzkrieg, de cette attaque éclair, les cinq derniers archers gallois rescapés du massacre, n’insistèrent pas et déguerpirent à toutes jambes, abandonnant leur arc, leur carquois, leurs dés et les corps de leurs compains. Ils n’avaient pas eu le temps de bailler le prix de leur souper. Le Teuton s’en était chargé pour eux.
Tous les pichets étaient renversés. La cervoise, le vin rouge et léger de la Loire se mélangèrent au sang vermeil qui coulait des membres, des bouches et des crânes fendus. Ils se répandirent sur le sol en terre battue avant d’être engloutis avidement entre les craquelures.
Je venais de me lever, l’épée à la main. Mais le combat était terminé, faute de combattants. Le bon Goliath avait vaincu les méchants David.
![]()
Le chevalier teutonique, Wilhelm von Forstner, m’ouvrit les bras, le bec fendu d’un large sourire sur des dents carnassières, son jupeau d’armer blanc maculé du rose des cervelles descervelées et du vermillon du sang des Godons.
Nous nous donnâmes la colée, en un élan d’une spontanéité touchante.
« Herr Rittermeister, quelle heure de vous revoir ! Auriez-vous enfin décidé de faire ce Grand Voyage vers nos terres lointaines du Nord pour convertir, à notre façon, à la façon de l’Ordre des chevaliers de Sainte-Marie des Allemands, les païens de Lituanie, d’Estonie ? Et, sans attendre ma réponse :
« Que Dieu et Marie en soient loués ! Venez, quittons ces lieux. Ils puent l’ail et l’oignon ! grimaça le Teuton, en jetant un dernier regard sur les corps desfaciés et descharpis.
— Seriez-vous peu goûteux de leur fleur, messire von Forstner ? L’ail et l’oignon sont recommandés par tous nos mires, en Aquitaine. Ils occisent les mauvaises humeurs qui grouillent dans les boyaux, flattent le sang dans les veines-artères, parfument l’haleine d’une odeur forte et puissante qui chasserait les mouches à dix coudées ! Nos ennemis eux-mêmes en sont friands.
— Ach, oui, j’ai appris cela. Plus friands que des cuisses de grenouilles, même si elles sont poêlées à l’ail et au persil ! Nicht war ? Les Holzköpfe, les Têtes de bois, vous ont donné ce surnom. Le saviez-vous ? Die fressende Froschschenkels. Les bouffeurs de grenouilles !
— Non, je l’ignorais ; mais permettez-moi une précision : nous disons Têtes de bûche, et non Têtes de bois. Nous affublons les Anglais de ce sobriquet. Têtes de bûche et non Têtes de bois !
— Et pourquoi Têtes de bûches ? s’enquit le jovial chevalier teutonique.
— Parce que nous prenons grand plaisir à les fendre et à les pourfendre ! À la hache !
— Ach, je vois. L’humour français, natürlich ! Je comprends. Vous avez vu, je sais manier la hache et le morgenstern ! Pas seulement la lance épointée, en tournoi. Les armes d’hast aussi. Voulez-vous une démonstration ? me demanda-t-il, en tournant sur lui-même à la recherche de ce type de lance et en simulant de vastes et amples mouvements des bras et des mains.
— Non, messire Wilhelm, ce ne sera pas nécessaire, je crois. Vous fûtes magnifique, tourbillonnant et caployant de remarquable façon. Vous avez fait grand foison de ces ribauds. Une véritable guerre éclair.
— Ja, eine richtige Blitzkrieg ! Das war !
— Ce fut cependant, permettez-moi de vous le dire, une bien inopportune initiative de votre part, messire chevalier.
« Je suivais, depuis ce matin, ces soudoyers pour les captura vifs avant de les déciper ; car, voyez-vous, ils ont enlevé mon fils aîné, Hugues Brachet, avant de bouter le feu à notre manoir. L’un des chevaliers et l’un des écuyers de ma maison ont été gravement blessés pour avoir opposé vaine résistance à leur venue.
« Votre générosité, je vais la bailler cher : leurs compains seront à l’arme dès que ceux qui se sont enfuis les auront rejoints Ils lèveront le camp pour rejoindre le gros de la bataille et pourraient bien occire mon fils chéri ! m’emportai-je en mesurant peu à peu les conséquences de cette Blitzkrieg. »
Le Teuton ne dit rien. Il me darda de ses yeux gris-bleu, devenus plus bleus que gris, l’air chafouin. Puis il me passa le bras sur l’épaule et m’invita à lever le chef, plutôt que de regarder mes bottes, sur lesquelles il crût de bon ton de me faire compliment alors qu’une folle inquiétude me gagnait.
Quatre des cinq Godons qui avaient échappé à la furie du chevalier teutonique, jonchaient le sol, devant la taverne.
Le cinquième, la jambe ouverte jusqu’à l’os, se tordait de douleur, les mains sur la plaie.
J’étais fol d’inquiétude. Je vis mon fils égorgé par les coutiliers anglais. Notre fils, le jumeau de Jeanne. L’héritier des biens de mon épouse. Notre fils aîné en qui, avec moult maladresses, je limitais tant d’espoir.
Des remords me saisirent la gorge et un cri, un cri de désespérance s’en échappa. Après le décès de Louis, notre vie basculerait avec la mort d’un deuxième de nos enfants. Marguerite ne me le pardonnerait jamais. Moi non plus. Mais que pouvais-je faire à présent ? Tirer l’épée contre ce magnifique chevalier ? L’accabler de reproches ?
Je fus à deux doigts de desforer et de provoquer le Teuton en un combat singulier. Jusqu’à ce que la mort s’en suive pour l’un de nous deux.
Je levai les yeux. Ils étaient plus brillants que d’habitude. Deux cavaliers se tenaient droits sur les arçons, à trente pas, capés dans un gris mantel à la croix de sable, passé sur un haubert de triples mailles qui les moulait du camail jusqu’aux solerets. Immobiles, sur des roucins à l’arrêt. Le heaume d’une main, les brides de l’autre.
« Messire Bertrand, je sens grand désarroi en vous, noble et légitime inquiétude. N’ayez crainte. Votre petit Hugues, Hugues Brachet de Born ? est entre de bonnes mains. Puis-je vous présenter meine Sariantbrüder, mes frères-servants en notre Deutsche Ritterorden ?
« Ils ont investi le camp des ravisseurs de votre fils. Ils n’ont pas fait de quartier, les ravisseurs n’ont pas eu le temps de crier merci ! Peu importe. Ils ont achevé les blessés. Que Dieu et Vierge Marie le leur pardonnent », dit-il en se signant.
Aussitôt, les deux frères de l’Ordre en firent autant, le visage sans expression, aussi glacé que les lacs de leurs lointaines commanderies. Je doutais qu’ils parlent notre langue.
Wilhelm von Forstner reprit :
« D’avoir devancé vos moindres désirs, ne nous en veuillez point, messire Brachet. Je ne doute pas de la bravoure dont vous auriez fait preuve. Mais les circonstances nous étaient favorables. Mes frères et moi, avons fondu sur ce nid de frelons et avons embroché ces Holzköpfe comme des porcs. Ainsi que vous l’auriez fait vous-même. »
J’étais abasourdi :
« Pourquoi, Wilhelm ? Pourquoi m’avoir privé de le faire moi-même ? Et mon fils ? S’il lui arrive le moindre mal, onques ne vous le pardonnerais !
Verdammt nochmal ! Je vous l’ai déjà dit. Nous étions à l’affût. À bonne portée. Nous leur avons ravi votre fils ! Sans prendre le moindre risque. L’affaire était entendue avant que nous ne lancions l’assaut. Ils étaient betrunken. Comment dit-on en français ? Ils avaient trop bu ? » J’en restais pantois.
« Wilhelm, je ne sais comment vous remercier de m’avoir privé du plaisir de tailler en pièces ces brigands. Mais, tout de même, n’auriez-vous pu me laisser agir si vous aviez suivi mes voies ?
« Comment vais-je à présent remercier messire de la Halle d’avoir accepté l’échange de mon fils contre une modeste rançon de quelques sous ? osai-je lui demander.
— De cette façon, me dit-il, en décolant le chef du dernier survivant d’un superbe mouvement de taille de l’épée qu’il venait de desforer. Au moment où le malheureux prisonnier s’était redressé pour une dernière supplique. Trop tard. Sa supplique vola en l’air. Avec sa tête.
« Acier de Solingen, s’esbouffa le redoutable Teuton. Meilleure fabrique que celle de Tolède pour décoler le chef d’un Holzkopf !
— Une Tête de bûche, et non une Tête de bois ! Je vous l’ai déjà dit, messire Wilhelm ! » me surpris-je à rectifier. (Je faisais des progrès rapides en l’apprentissage de la langue germanique)
— Ach, bien sûr !
— Et comment vais-je m’acquitter maintenant de ce que je dois au maréchal de la Halle ?
— En plaçant sols et deniers avec le chef de son soudoyer dans le bissac de sa monture. Il comprendra que vous avez fait justice. Une bonne claque sur la croupe et son cheval rejoindra ses lignes. Glissez-y quelques louis et l’affaire sera définitivement enterrée », me conseilla-t-il en sifflant entre ses doigts.
Un troisième frère-servant s’approcha. Il tenait une monture par la bride et mon fils dans les bras. Ils me sourirent l’un et l’autre.
Je dus lutter de toutes mes forces pour ne pas éclater en quelques sanglots nerveux. Ça aurait fait désordre face à ces gens de guerre. Cette escarmouche m’avait exténué, brisé. Quand bien même je n’y avais pas participé.
« Comment puis-je vous remercier, mon ami, pour m’avoir de si belle façon privé de cette prouesse ?
— En nous rejoignant en Prusse ! Cet hiver ! À Marienbourg, bien sûr ! Au siège du Deutsche Ritterorden ! Vous y gagnerez indulgence plénière et grande gloire. Si vous n’êtes point occis… » s’ébroua-t-il.
À cette idée, je me remochinai tout de gob, l’esprit partagé entre une immense reconnaissance et une forte amertume à l’idée qu’il est des devoirs auxquels un gentilhomme ne peut se soustraire. Sans compter que des indulgences, je venais d’en recevoir une. À Roc-Amadour. Je n’étais pas prêt de l’oublier.
Je tergiversai, le temps de m’apazimer et de mettre de l’ordre dans mes pensées qui se bousculaient sous un chef, non point encore décervelé mais en proie à une forte agitation :
« Messire von Forstner, vous parlez bien notre langue française pour un Allemand ?
— Mieux encore que ne le pensez, messire Bertrand. Je fus instruit par les lecteurs royaux des universités de la Sorbonne, à Paris, et par ceux de l’université d’Oxford, en Angleterre. Après avoir suivi des études par les maîtres ès arts et sciences de notre université de Cologne. Il y a bien longtemps. Cinq ou six ans déjà. »
Ses yeux d’un bleu métallique plongeaient dans des souvenirs lointains que je ne crus pas opportun de violenter.
Le chevalier Wilhelm von Forstner m’avait devancé avec l’aide de trois frères-servants. Et de quelle magistrale façon. Pouvais-je me soustraire à ce nouveau devoir de chevalerie que je répugnais autant à envisager qu’une nouvelle audience près monseigneur Elie de Salignac. Dans les deux cas, la mort rôdait. Et j’avais envie de vivre pour mourir en paix, une fois ma mission accomplie.
Mon cœur balançait, lorsqu’il me glissa à l’oreille :
« Azimut 31.47°. Cela évoque-t-il quelque chose pour vous, messire Bertrand ? »
Je sursautai. Il chuchota :
« Venez donc en pèlerinage à Marienbourg. Il est plus éloigné que d’aucune des étapes que vous fréquentez sur les chemins de Saint-Jacques de Compostelle, certes, et moins confortable. Le froid, la glace, le brouillard, la dure vie monastique, le respect de la règle de saint Bernard… Mais pas nécessairement plus dangereux. Et certainement moins traître !
— Messire von Forstner, comment avez-vous pu être informe de ces choses ?
— Lorsque vous aurez rencontré le Hochmeister, le grand maître de notre Ordre, Winrich von Kniprode, élu par notre chapitre l’an dernier, et s’il lui plaît, si vous avez fait preuve de vaillance, vous en saurez plus sur le Livre Sacré, sur votre sœur Isabeau de Guirande – est-ce bien son nom ? – Sur le trésor du Temple et sur les hérétiques – Albi ? Albigeois ? – que n’en savez à ce jour.
« N’oubliez point que notre ordre a été fondé en Terre sainte, à l’époque des Grands pèlerinages de la Croix. Nous avons côtoyé chevaliers templiers et hospitaliers, jusqu’à la chute de Saint-Jean d’Acre.
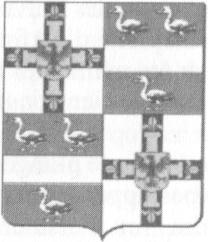
« Nous sommes, ce jour d’hui, sous la protection de l’empereur et du Saint-Père. Nous avons moult connaissances de faits anciens et des hommes. Et nos archives ! Pensez à nos archives ! Les archives que nous conservons religieusement en la librairie de notre siège comptent parmi les plus belles et les plus riches de l’Occident.
« Elles recèlent bien des secrets connus de rares initiés… Peu nombreux sont ceux qui ont accès à ces trésors. S’ils ne viennent point à nous. Pour nous aider à convertir ces maudits païens de Lituanie…
« Certains codex, certains parchemins rongés par les vers, l’humidité et la poussière, qui se languissent sur les étagères de notre somptueuse librairie ne devraient pas manquer de piquer votre curiosité. De répondre à bien des questions que vous vous posez… Depuis si longtemps !
« Votre duché d’Aquitaine est une pure merveille. Vos châteaux, vos forteresses ! Vos terres si riches ! On croirait que le Bon Dieu, en créant le monde, y a déversé ses plus beaux trésors… Mais le cercle est trop étroit pour satisfaire votre quête. Votre quête du Graal ! Et je pressens que vous n’avez pas encore eu réponse à toutes les questions qui vous rongent les sangs. »
Le chevalier Wilhem von Forstner me tendit mon fils Hugues.
Le pétiot pleurait. Il avait faim et soif.
Moi aussi.
Mais faim et soif d’autre chose.
« À Dieu, mon ami ! Je vous attends à Marienbourg, cet hiver. Avant que l’ours ne rentre en hivernage. Avant la Saint-Martin ! Vous recevrez nouvelle rémission de tous vos péchés ! Sans avoir à passer à confesse !
« Un frère vous portera le sauf alant et venant qui vaudra sportelle et indulgence… Ce sera grandiose : des chevaliers d’Italie, de Hollande, de Germanie se joindront à nous ! Quelle fête ! »
Le chevalier de l’Ordre de Saint-Marie des Teutoniques éperonna son destrier. Lui et ses frères-servants disparurent très vite dans le crépuscule.
Hugues s’endormit dans mes bras.
Avais-je vraiment d’autre choix ?
Ma décision fut prise incontinent.
Je partirais pour Marienbourg avant l’hiver.