À la nuit tombante, tous redescendirent en direction du Bourdais. Seuls Lazare et ses parents utilisèrent le traîneau, les autres préférant marcher. Émilie, flanquée d’Ovide et d’Ovila, s’obstinait à parler avec Rosée qui marchait devant eux. Le petit Émile la regardait et Émilie comprit qu’il faisait des efforts pour ne pas rire.
«Pourquoi est-ce que tu me regardes en riant, Ti-Ton?
— C’est à cause de votre couette, répondit-il en éclatant. Est toute raide!»
Émilie porta la main à son front et comprit que la mèche rebelle tenait droit dans les airs, bien raidie par l’eau d’érable dans laquelle elle s’était trempé les mains toute la journée. Gênée, elle essaya de la replacer, mais n’y réussit pas. Ti-Ton riait de plus en plus. Les autres enfants, qui avaient feint de ne rien voir, ne purent contenir leur hilarité facilitée par la fatigue. Même Ovide et Ovila cessèrent de se mordre les lèvres. Il n’y eut qu’Émilie qui ne desserra pas les dents. Elle accéléra le pas. Bientôt, seuls Ovila et Ovide purent la suivre. Elle ne leur adressa pas la parole. Elle les remercia quand ils l’invitèrent à la maison, disant qu’elle préférait rentrer immédiatement à l’école et leur refusa le privilège de la raccompagner.
Elle claqua la porte, se précipita à l’étage, prit son miroir et ragea.
«J’ai l’air d’une vraie folle. Je suis sûre qu’il doit encore rire de moi. Astheure il va falloir que je me lave la tête.»
Elle s’exécuta et dut attendre, avant d’aller dormir, que ses cheveux fussent à peu près secs. Elle détestait se laver la tête le soir, son épaisse chevelure mettant des heures à sécher.
Émilie termina ses classes le mercredi. Son père vint la chercher afin qu’elle puisse être dans sa famille pour les jours saints et Pâques. Elle lui parla des événements
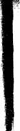
importants, raconta tonte l’histoire de Lazare, même si elle l’avait déjà décrite dans une lettre. Elle évita cependant de parler de l’histoire des commissaires et de la «couette sucrée».
Le congé de Pâques lui sembla interminable. Émilie avait hâte de rentrer «chez elle». Hâte de retrouver ses livres et ses cahiers. Hâte de mettre du bois dans son poêle pour la nuit. L’hiver avait maintenant évacué les lieux pour laisser entrer le printemps à pleines portes. Émilie demanda à son père de la conduire à Saint-Tite deux jours plus tôt que prévu.
«Est-ce que tu t’ennuierais dans ta propre maison, ma fille? lui demanda-t-il, l’air quelque peu assombri.
— C’est pas ça, pâpâ. C’est que j’ai hâte d’arriver, de laver mes fenêtres, de faire aérer l’école, de nettoyer mon chiffonnier, de préparer mes classes pour le mois de mai, de voir ce que j’vas faire pour que les enfants soient prêts quand l’inspecteur va venir... »
Plus elle parlait, plus elle décrivait tout le travail qui l’attendait, plus l’impatience la gagnait.
«Bon, bon, pas besoin de me faire un dessin. Si ça fait ton bonheur pis si le temps se remet au beau demain, on va atteler. Une chance pour toi que les chemins sont carrossables. Faudrait pas que la pluie se remette à tomber cette nuit. »
Emilie embrassa son père et monta boucler ses valises qu’elle avait discrètement commencé à remplir de vêtements plus saisonniers. Caleb regardait au plafond, l’oreille attentive, essayant, au son, d’imaginer ce qu’elle faisait.
«Est bien changée Émilie, lui dit Célina.
— Tu trouves? lui demanda Caleb sans conviction.
— D’abord est grande sans bon sens. Elle doit bien mesurer cinq pieds cinq, cinq pieds six astheure. On dirait qu’elle pousse encore. Ensuite, elle parle pus de la même manière. Elle trouve toujours un mot compliqué pour dire une affaire simple. Non, Émilie est bien changée. Je l’ai jamais vue mettre autant de temps pour se pomponner le matin.
— Ça doit être une habitude d’école. Après tout, il faut qu’elle donne le bon exemple sur la propreté.»
Célina réfléchit quelque temps à la remarque de son mari. Elle enchaîna enfin.
«Moi, je trouve que notre fille a l’air d’avoir un soupirant.
— Quossé que tu vas chercher là?...D’où c’est que tu veux que ça soupire?
— Voyons donc, Caleb, tu sais que les Pronovost ont plusieurs garçons.
— C’est des élèves à Émilie, sa mère.
— Sauf Ovide pis Edmond...
— C’est vrai qu’eux autres... Mais tu sais comme moi que notre fille sort pas le soir. Pis personne vient à l’école le soir non plus.
— Non, mais Émilie va chez les Pronovost... voir Lazare, bien entendu.»
Ils discutèrent ainsi à bâtons rompus sur l’éventualité d’une amourette entre leur fille et l’aîné des Pronovost. Célina n’appréciait pas l’hypothèse. Une institutrice ne devait pas entretenir de relations suivies avec un jeune homme. Elle ne voulait pas qu’Émilie soit la proie des ragots. Elle voulait encore moins qu’elle perde son emploi. Caleb essaya de la calmer, mais en son for intérieur, il nourrissait les mêmes craintes que sa femme.
Emilie vint leur tenir compagnie et s’étonna du silence qu’ils alimentaient de leurs regards et de leurs soupirs. Elle sentait vaguement qu’elle devait être au cœur de leurs préoccupations. Elle leur demanda enfin ce qui les tracassait et Caleb lui rapporta, en termes quelque peu retouchés, la conversation que lui et sa femme avaient eue. Émilie éclata de rire.
«Ovide Pronovost? Vous voulez rire! C’est un grand indépendant qui pense que toutes les filles veulent lui mettre la corde au cou. Non, Ovide Pronovost, c’est pas un gars à mon goût.»
Caleb et Célina trouvèrent qu’elle avait mis beaucoup trop d’empressement à se défendre.
7.
La classe était en émoi. Les commissaires avaient avisé Emilie que l’inspecteur ferait sa visite le trois juin. La journée fatidique était arrivée. Emilie avait écrit une note aux parents leur demandant d’endimancher leurs enfants. L’inspecteur ne faisait qu’une visite annuelle et Emilie, qui terminait sa première année d’enseignement, se devait de démontrer ses talents d’enseignante si elle voulait être réembauchée l’année suivante. La concurrence était forte et elle savait que quelques jeunes filles de Saint-Tite n’auraient pas dédaigné d’enseigner à l’école du Bourdais.
Les enfants avaient passé toute la veille à astiquer les locaux. Pour ne pas perdre de temps, Emilie leur avait posé en même temps questions de catéchisme, de grammaire, d’Histoire sainte, de calcul. Une grande révision entre l’époussetage et le balayage.
L’inspecteur arriva deux heures avant la fin de la journée. Les vêtements étaient un peu défraîchis, les visages moins propres, les mains plus graisseuses. Il demanda à Emilie son cahier d’appel. Puis, sans même s’occuper des enfants, il prit connaissance de toutes les notes et remarques qu’elle avait inscrites de sa main la plus appliquée.
Les enfants se tenaient droit. Émilie s’excusa auprès de l’inspecteur, descendit de sa tribune et alla rappeler à
Charlotte que c’était l’heure, Quand Charlotte revint en classe, l’inspecteur n’avait pas encore terminé sa lecture. Les enfants commençaient à s’agiter sur leurs chaises. Emilie essayait de les calmer en souriant d’un sourire un tantinet crispé.
La visite de l’inspecteur faisait habituellement trembler les enfants, surtout les premiers de classe qui étaient interrogés plus souvent qu’à leur tour, histoire de montrer le grand talent de l’institutrice — histoire aussi, sans doute, de ne pas humilier inutilement les autres. L’inspecteur referma le grand cahier et leva enfin les yeux. C’était la première fois que cet inspecteur venait à Saint-Tite, l’ancien ayant pris une retraite précoce pour des raisons de santé. Dès qu’il regarda les élèves, ceux-ci comprirent qu’il y avait des problèmes à l’horizon. L’inspecteur souffrait d’un fort strabisme. Il rappela aux enfants que sa tâche consistait à vérifier si les programmes scolaires avaient été bien respectés. Il les rassura en leur disant qu’il ne ferait écrire que sur l’ardoise, n’ayant pas le temps de faire les corrections. Les enfants s’efforcèrent de sourire quand ils comprirent que l’inspecteur trouvait sa dernière remarque drôle. Il demanda à Emilie de lui ouvrir le petit catéchisme.
«Qui peut me réciter les commandements de Dieu?» demanda-t-il.
Tous les élèves levèrent la main, prêts à répondre à une question aussi facile. L’inspecteur jeta un regard sur la classe et pointa en disant: «Toi!»
Trois élèves se levèrent en même temps. Émilie rougit. Les trois élèves, confondus, se rassirent aussitôt. L’inspecteur fronça les sourcils, prit un air sévère. «Toi», répéta- t-il. Cinq élèves avaient maintenant l’impression d’être visés. Ne voulant pas renouveler la bourde qu’ils venaient de faire — se lever et se rasseoir — ils dirent, à l’unisson: «moi?» L’inspecteur ferma les yeux, soupira, tourna la tête vers Emilie et la pria de nommer un élève. Émilie demanda à la grosse Marie de répondre. Celle-ci se leva et répondit correctement à la question. L’inspecteur émit un grognement de satisfaction. Les minutes s’écoulaient lentement, toutes plus lourdes les unes que les autres. La confusion devenait incroyable. L’inspecteur demanda enfin à Émilie de nommer les élèves au fur et à mesure, lui rappelant qu’une bonne institutrice faisait toujours un plan de classe indiquant le nom de chacun des élèves. Émilie se mordit les lèvres. Elle avait oublié ce détail. Après le catéchisme, l’inspecteur passa à l’Histoire sainte. Les enfants répondirent encore correctement. Émilie leur sourit. Elle évitait de nommer Lazare, celui-ci ayant été absent pendant plus de deux mois. Les questions de calcul étaient faciles. La grammaire ne posa pas de problème non plus. Vint enfin l’épellation. Émilie commençait à respirer, sachant que ses élèves étaient forts en épellation. L’inspecteur rejeta les livres et sortit de sa serviette une liste de mots qu’il avait lui-même préparée. Émilie se raidit à nouveau.
«Imbécillité. Qui peut épeler le mot: imbécillité?»
Trois élèves levèrent la main. Émilie nomma le premier.
«I-m-b-e (accent aigu)-c-i-l-i-t-e (accent aigu).
— Non! rétorqua l’inspecteur. Imbécillité?»
L’élève pris en faute se rassit, sans savoir où il s’était trompé. L’inspecteur redemanda à la ronde la réponse à sa question. Personne n’osa lever la main.
Émilie se passa une main sur le front.
«Mademoiselle Bordeleau, quel est votre meilleur élève en épellation?
— Rosée Pronovost, répondit Émilie.
— Rosée Pronovost, pouvez-vous m’épeler imbécillité?» dit-il en regardant à droite. Rosée se leva. Elle était à gauche. L’inspecteur mit quelques secondes avant de la repérer.
«Monsieur l’inspecteur, j’épellerais le mot comme on vient de l’épeler.
— Et vous êtes la meilleure? Et vous êtes incapable d’épeler imbécillité! Je vais vous dire comment on épelle ce mot-là... à moins que mademoiselle Bordeleau veuille le faire à ma place», enchaîna-t-il mielleusement. Émilie avala sa salive . Elle aurait dit «i-m-b-é-c-i-l-i-t-é» elle aussi, mais elle se devait de trouver la réponse. A tout hasard, elle dit à l’inspecteur qu’il y avait deux «1». L’inspecteur sourit. Elle soupira.
«Maintenant, je veux que quelqu’un épelle le mot «août», comme dans le mois d’août.»
Rosée leva la main. L’inspecteur l’ignora. Il précisa qu’il voulait qu’un petit réponde à cette question. Il leur demanda de se lever tous. Les petits obéirent. Aucun ne réussit à épeler correctement le mot. Ils oubliaient tous l’accent circonflexe.
Émilie commençait à désespérer. Les enfants s’énervaient, d’autant plus que la chaleur était intense pour un trois juin. Ils voulaient faire honneur à leur école et à leur institutrice, mais semblaient incapables d’épeler un seul mot correctement. L’inspecteur, lui, semblait s’amuser follement. Enfin, constatant que l’heure de la fin de la classe approchait, il proposa un dernier mot.
«Je veux le singulier du mot: épousailles.
— E (accent aigu) p-o-u-s-a-i-l-l-e, répondit Rosée, soulagée d’avoir enfin été à la hauteur de sa réputation.
— Non! rugit l’inspecteur.» Rosée blêmit. «Épousailles n’a pas de singulier! poursuivit-il. Allez-vous vous en souvenir? Épousailles n’a pas de singulier! Pensez-y. Je vous donne un truc pour que vous vous en souveniez. Il y a toujours deux personnes qui s’épousent. Répétez ça: Epousailles n’a pas de singulier.»
Les élèves répétèrent la phrase en y mettant tout le cœur qui leur restait. L’inspecteur se calma. Il leur sourit et les invita à quitter l’école après leur avoir donné congé de leçons. Les élèves ne se firent pas prier. Ils rangèrent leurs effets et sortirent presque en silence. Emilie les accompagna à la porte et les félicita. Rosée était en larmes. Émilie la consola en disant que finalement il n’y avait eu que cette partie de l’examen qui avait posé quelques problèmes.
Elle revint vers l’inspecteur. Celui-ci la regardait fixement. Émilie, mal à l’aise, se demandait lequel de ses yeux était le bon. Elle se racla la gorge avant de lui offrir une tasse de thé qu’il refusa avec exaspération, à cause de la chaleur. Elle lui apporta un verre d’eau.
«J’ai entendu parler de vous, dit-il en avalant sa dernière gorgée. Il paraît que vous n’avez pas froid aux yeux. Que vous êtes savante. Il faudrait passer un peu de votre savoir à vos élèves...»
Il la regarda, un sourcil levé, l’autre baissé, ce qui accentuait son strabisme.
«On ne peut pas dire qu’ils soient bien bien forts en épellation. »
Elle ne sut que répondre, partagée entre sa furie et sa déception.
«J’vas essayer de faire mieux l’année prochaine», osa- t-elle enfin.
L’inspecteur éclata de rire. Émilie se demandait ce qu’elle avait dit de drôle. Il lui demanda un autre verre d’eau et s’étouffa, tant il riait.
«Il faut rire, mademoiselle. Voyez-vous, je suis un vieux farceur. Quand des élèves ont toutes les bonnes réponses, je m’ennuie terriblement. Pour rompre cette monotonie, j’ai fait une liste de questions difficiles, simplement pour les fouetter un peu. Eux, et l’institutrice», ajouta-t-il en la regardant d’un air moqueur.
«Ma liste de mots, je ne la sors pas fréquemment. Uniquement quand l’institutrice fait bien son travail... On s’amuse comme on peut, voyez-vous.»
Emilie commençait à voir. Mais elle ne s’amusait pas vraiment.
«Est-ce que ça veut dire que vous allez me garder l’année prochaine?
— Evidemment! Vous êtes sans pareille! Saint-Tite peut se vanter d’avoir une bonne petite école de rang. Parlant de Saint-Tite, cela me fait penser qu’hier j’étais à Saint-Stanislas. Il y aura une école de libre l’année prochaine. Voulez-vous que je vous recommande?»
Émilie n’avait jamais pensé enseigner à Saint-Stanislas. La question la prit au dépourvu.
«J’vas y penser. Si je décidais d’y aller l’année prochaine, je vous le ferai savoir. J’apprécierais un bon mot.
— Songez-y. Votre famille serait contente de vous savoir à la maison...
— J’vas en parler avec eux autres.
— Faites cela. Bon! moi je dois vous quitter. Demain, on m’attend dans une école de Sainte-Thècle. Je préfère m’y rendre ce soir. Mes hommages, mademoiselle. Vous avez vraiment une belle vocation. »
L’inspecteur quitta l’école en ricanant, apparemment très fier de son après-midi. Émilie s’obligea à demeurer surla galerie à lui envoyer la main jusqu’à ce qu’elle perde la calèche de vue. Dès que le nuage de poussière disparut, elle entra dans l’école, épuisée.
8.
Emilie ne reçut pas de prime d’enseignement cette année-là, même si, l’apprit-elle, l’inspecteur l’avait chaudement recommandée. A la Saint-Jean-Baptiste, elle avait fini de remplir ses malles. Le grand ménage de l’école avait été fait par les enfants qui pouvaient se permettre de laisser la ferme. Emilie avait donc eu l’aide des petits, surtout les filles, les garçons devant érocher et désherber les rangs de semis. Tous les pupitres avaient été entassés dans un coin de la classe après avoir été bien lavés et cirés à la cire d’abeille. Le plancher avait été récuré à la brosse de crin et bien ciré lui aussi, même si l’acharnement qu’Emilie y avait mis n’avait pas donné les résultats souhaités. Elle avait encore une fois passé son poêle à la mine de plomb, tout en sachant que ce travail serait à refaire à la rentrée. Les fenêtres luisaient sous le chaud soleil de la fin juin. Emilie avait remercié ses élèves, les avait tous embrassés sur la joue et leur avait promis d’être à son poste au mois de septembre. Elle avait décidé qu’elle reviendrait.
Caleb devait venir la chercher «entre la Saint-Jean- Baptiste et le 30 juin, selon l’avancement des travaux de la ferme». Le 25 juin, elle entreprit le grand nettoyage de sa chambre, sortant même son matelas, seule, pour le faire aérer. Elle suspendit toutes les couvertures sur sa corde à linge et les battit énergiquement. Elle se promit de les laver dès qu’elle serait arrivée à Saint-Stanislas, évitant de le faire à Saint-Tite. Une pluie malvenue aurait pu les empêcher de sécher avant l’arrivée de son père. Elle avait déplacé tous les meubles de sa chambre afin de libérer l’espace nécessaire à l’installation de son poêle à bois.
Son attente dura quatre jours, au cours desquels elle fut souventes fois invitée à prendre un repas chez les Pronovost, mais aussi chez les parents de Charlotte.
La veille de son départ, Lazare Pronovost vint la trouver pour lui faire part de sa décision de mettre un terme à ses études. Émilie en fut chagrinée mais elle savait que Lazare ne pouvait faire d’études poussées et qu’il serait plus heureux en travaillant à la ferme avec son père et ses frères. Elle sourit lorsqu’il lui dit que le nombre d’élèves Pronovost serait le même, puisqu’Oscar commencerait ses classes à la rentrée.
Ovide vint rejoindre son frère à l’école, inquiet du qu’en dira-t-on, dit-il... Émilie leur offrit à tous les deux une bonne tasse de thé et accepta volontiers de jouer une ou deux parties de cartes. Une «veillée» à l’école étant interdite, ils se déplacèrent donc tous les trois et trouvèrent de nouveaux partenaires de jeu chez les Pronovost.
Monsieur Pronovost confirma à Émilie que Lazare quittait l’école. Il lui dit aussi qu’Ovila avait préféré faire une autre année.
«Celui-là, il aime pas mal moins ça que ses frères, le travail de la ferme.»
Fidèle à ses habitudes, Ovila était assis dans un coin de la cuisine à sculpter un bout de bois. Émilie lui sourit. Elle avoua aux parents qu’elle-même ne raffolait pas des travaux de la ferme, ce qui l’avait aidée à opter pour l’enseignement. Les parents Pronovost lui firent remarquer qu’elle aurait de la difficulté, dans un village comme le leur, à trouver un bon parti si elle ne voulait pas être femme de cultivateur. Émilie leur répondit en riant qu’elle n’était pas pressée de se marier; qu’elle aimait trop l’enseignement et qu’avec un peu de chance elle pourrait marier un instituteur... ou encore un inspecteur. A cette phrase, les enfants éclatèrent de rire. Émilie fit de même. Personne n’avait oublié la visite du nouvel inspecteur. Ce dernier s’était même fait un point d’honneur d’arrêter à l’école saluer Émilie lorsqu’il était repassé à Saint-Tite. Émilie s’en était quelque peu amusée, mais avait profité de l’occasion pour lui dire qu’elle préférait demeurer à Saint-Tite. L’inspecteur avait opiné sans raison et avait roucoulé quelques phrases. Cet homme de trente ans, à la redingote poussiéreuse, les cheveux déjà rares et saupoudrés de blanc avait essayé bien maladroitement de lui faire la cour. La seule promesse qu’il avait réussi à lui arracher était qu’elle lirait tous les livres qu’il lui avait prêtés. Il l’avait quittée en se retournant à trois reprises et chaque fois, Émilie s’était hâtée d’accrocher un sourire à ses lèvres et de lui faire un petit signe de la main auquel elle s’efforçait de donner une pimpante coquetterie.
Émilie quitta les Pronovost à huit heures. Elle savait qu’ils ne veillaient qu’exceptionnellement. Dosithée demanda à Ovide de la raccompagner. Celui-ci fut escorté d’Edmond et d’Ovila qui avait laissé tomber son couteau et son bout de bois, s’était passé à la hâte une main dans sa chevelure en bataille et avait boutonné son col.
Émilie regarda chacun des membres de la famille, dit un bon mot à ses élèves et, prise d’une émotion qu’elle tentait de cacher, avait osé embrasser les parents en les remerciant d’avoir été si avenants à son endroit. Hormis les trois fils, toute la famille s’était agglutinée sur les marches de la galerie pour la saluer, comme si tous avaient eu l’intuition qu’elle quitterait le rang le lendemain. Son père était arrivé à l’heure où s’éteignaient les lampes dans les étables pour laisser place à l’aube. Il avait attelé durant la nuit afin de ne pas perdre une journée complète en voyagement. Il aurait voulu venir chercher sa fille avec son élégant piano box, comme il l’avait fait à l’automne, mais il savait qu’il n’y aurait pas assez de place pour y loger les dix derniers mois qu’elle venait de vivre. Caleb la connaissait assez bien pour savoir que si elle était arrivée à Saint-Tite avec le strict nécessaire, elle en reviendrait avec des boîtes et des boîtes de souvenirs «absolument essentiels», ce en quoi il n’avait pas eu tort.
Il avait dû frapper à la porte de l’école pendant un bon cinq minutes avant qu’Emilie ne vienne lui ouvrir. Au premier coup d’œil, il devina qu’elle rapportait probablement dans son sac à main plusieurs mouchoirs souillés. Emilie était heureuse de le voir et lui sauta au cou. Caleb, quelque peu étonné par tant d’enthousiasme, retrouva rapidement sa contenance, lui tapota une fesse pour lui donner un air d’aller et la supplia de se hâter. Emilie tenta bien de se presser, mais elle brûla sa tranche de pain, renversa son pot de crème, cassa une assiette, défit l’ourlet de sa robe en descendant une boîte de l’étage, en échappa une seconde dont le contenu se répandit sur son plancher fraîchement ciré, s’assit finalement à son pupitre et éclata en sanglots. Caleb, que les larmes rendaient toujours aphone, lui offrit un mouchoir sec et sortit de l’école pour abreuver et nourrir sa jument. Il passa beaucoup plus de temps qu’il n’aurait voulu à placer et replacer les effets de sa fille dans la voiture.
Émilie s’était mouchée et remouchée, était remontée à l’étage s’assurer que tout était en ordre, avait marché de long en large dans sa classe et s’était finalement résignée à rejoindre son père maintenant assis sur le marchepied de la voiture, son chapeau bien enfoncé sur la tête.
«J’arrive, pâpâ. Deux p’tites secondes.»
Elle avait verrouillé la porte, fait le tour de son «domaine» une dernière fois et puis était montée aux côtés de son père. Il leur avait fallu arrêter chez les Pronovost porter la clé de l’école. Caleb, craignant que de longues effusions ne les retardent davantage, avait lui-même porté la clé de sa fille. Émilie en avait été soulagée, restant assise à regarder droit devant elle. Son père revint presque aussitôt et ordonna à la jument de se mettre en marche. C’est à ce moment qu’Émilie se retourna. Le temps d’un éclair, elle avait vu bouger un rideau que quelqu’un s’était hâté de replacer.
Caleb s’empressa de lui apprendre qu’il s’était permis d’accepter qu’elle enseigne durant l’été à des enfants de Saint-Stanislas connaissant des difficultés. Émilie s’en était réjouie. Caleb lui avait dit qu’il n’avait cédé qu’à la condition qu’elle soit libérée pour les moissons et les récoltes. Émilie avait tiqué — elle détestait moissons et récoltes — mais s’était pliée d’assez bon gré à cette exigence.
En apparence, l’été 1896 ressembla à tous les étés qu’elle avait connus. Une semaine après son retour, elle avait retrouvé les sons, les habitudes, les odeurs et la routine de la maison familiale. Elle avait repris son coin dans la chambre des filles, mais eut de la difficulté à dormir pendant les premières nuits, déshabituée d’entendre d’autres souffles faire écho au sien.
Elle avait aussi retrouvé ses amies auxquelles elle avait raconté l’année écoulée, en n’omettant que quelques détails. Seule Berthe, sa meilleure amie, eut droit à plus de confidences. Émilie apprit, la première, que Berthe songeait à entrer au couvent. D’abord surprise, elle crut comprendre que Berthe qui, à dix-sept ans, était l’aînée de treize frères et sœurs, cherchait peut-être au couvent un repos qu’elle ne semblait jamais pouvoir trouver à la maison, sa mère étant toujours alitée et dépassée par sa progéniture. L’été avait étiré puis raccourci ses journées sur des champs dont les couleurs s’apparentaient de plus en plus au jaune. Émilie reprenait vie à mesure que la terre semblait montrer quelques signes d’agonie. Vint enfin le temps où elle put reboucler ses malles biens bourrées de nouveaux vêtements qu’elle avait créés durant ses heures de liberté.
9.
L’école n’avait pas bougé, toujours enfouie à l’intersection du Bourdais et de la montée des Pointes. Emilie l’avait dépoussiérée de ses deux mois de répit avant de commencer sa seconde année d’enseignement, marquée par l’arrivée de plusieurs nouveaux élèves. Elle avait dû repenser l’organisation de son temps, les petits l’emportant maintenant en nombre sur les grands. Elle voisina un peu moins les Pronovost que l’année précédente, consciente que certaines personnes voyaient d’un œil à la limite d’être mauvais le fait qu’un commissaire, père de nombreux fils dont au moins un était en âge de se marier, s’attachât à une institutrice. Elle se permit toutefois d’accompagner Ovide à la noce d’un de ses amis. Elle refusa cependant de faire partie de la chorale de la paroisse, préférant au chant le calme et la solitude dont elle devenait particulièrement friande après ses harassantes journées. Elle avait assisté à l’ouverture d’une école commerciale à Saint-Tite, heureuse d’apprendre que quelques-uns de ses finissants avaient l’intention de la fréquenter dans l’espoir de se trouver une bonne situation.
Elle était retournée à Saint-Stanislas aux mêmes dates que l’année précédente, mais avait écourté son séjour des Fêtes afin d’assister à la fête des Rois chez les Pronovost. Son père n’avait pas prisé cette décision, mais Emilie avait tenu bon. Plusieurs familles du rang et du village avaient été conviées. Pour la seconde fois depuis son arrivée à Saint- Tite, Émilie avait dansé et veillé une bonne partie de la nuit. Les invités avaient bien ri de la voir couronnée reine. Les hommes durent se servir une seconde portion de gâteau avant qu’Ovila ne croquât le pois. On le couronna, mais il renonça à son titre. Ovide monta donc sur le trône et embrassa la reine sur ses deux joues fort rougies par la chaleur, le plaisir et la timidité.
L’hiver avait été moins rigoureux que celui de l’année précédente. Émilie, dont la chambre était maintenant munie d’un poêle, le trouva très supportable, s’habituant à fendre elle-même son bois. Elle avait écrit aux commissaires pour les remercier — même si le poêle promis pour septembre n’était arrivé qu’à la mi-décembre — et avait profité de l’occasion pour leur demander s’ils ne pouvaient pas organiser une corvée pour construire une rallonge à l’école afin d’y installer un «petit coin». L’état de santé de Charlotte lui avait donné le courage de faire cette requête. Cette dernière, en effet, avait dû s’absenter de l’école, ses malaises l’obligeant à s’aliter à de nombreuses reprises. La fréquence de ses visites au «petit coin» s’était accrue. Charlotte, âgée de sept ans, avait maintenant la responsabilité de ses reins. Ses parents lui avaient donné une léontine qu’elle mettait bien en vue sur son pupitre. L’appel lancé aux commissaires fut entendu. On lui promit que la corvée aurait lieu dès que le printemps gonflerait la terre de vie.
Le mois de mars avait été clément. Aussi est-ce sur une terre à nu qu’avril prit possession de sa miette de temps. Mais avril avait cédé, malgré quelques journées ensoleillées, à des attaques de froidure et de neige. La corvée fut reportée au mois de mai.
Les hommes arrivèrent le premier samedi de mai. Émilie s’empressa de les rejoindre. Il fut décidé qu’une partie de la galerie avant serait sacrifiée pour permettre l’érection d’un nouveau mur. Les travaux durèrent toute la journée. L’école vibra sous les attaques incessantes des marteaux. Emilie s’étonna de la rapidité avec laquelle les mains et les pieds s’étaient organisés pour ne pas se nuire. Chacun était à sa tâche. Elle fut surprise que les hommes installent une fenêtre. Elle trouva l’idée charmante et commença à choisir, parmi ses retailles de tissu, celles qu’elle transformerait en rideau. Les hommes revinrent le lendemain, même si c’était un dimanche, pour poser la porte et les gonds et chauler le tout. Emilie les remercia chaleureusement et consacra le reste de sa journée à coudre un rideau blanc sur lequel elle broda toutes les lettres de l’alphabet.
Le lendemain matin, elle ne put surprendre Charlotte, qui était encore une fois absente. Elle le demeura pendant deux semaines. Elle revint finalement, pâle, tirée et inquiète d’avoir accumulé un retard presque impossible à rattraper. Emilie l’invita à rester après la classe. Les parents de Charlotte vinrent la trouver pour discuter d’un dédommagement financier. Emilie ne voulut rien accepter. Charlotte passa donc une heure par jour à essayer d’apprendre ce qu’elle devait savoir pour les examens de fin d’année. Émilie et elle développèrent une relation peu commune, Émilie y trouvant son rôle de grande sœur, Charlotte découvrant celui de protégée. Les sept ans de Charlotte étaient imprégnés d’une maturité particulière. Depuis la crise d’épilepsie de Lazare, elle s’était transformée en bon ange, celui qui veille constamment sur tous ceux qui ont un petit malaise. Elle avait confié à Émilie qu’elle trouvait Lazare de son goût et que si celui-ci la trouvait aussi à son goût, elle le marierait quand elle serait grande. Malgré tout son sérieux, Charlotte était une ricaneuse qu’Émilie aimait entendre rire. Entre les minutes de travail intense, elles prenaient le temps de se détendre en se racontant des petites farces qu’elles trouvaient toujours très drôles.
Le mois de juin ramena la fièvre de la visite de l’inspecteur pour la classe et celle de l’approche du départ pour Émilie. Charlotte réussit aux examens et n’attendit plus que la rentrée.
Émilie se sépara de ses élèves, aux prises avec son chagrin et la joie qu’elle éprouvait de pouvoir se reposer un peu. Sa mère lui avait écrit qu’elle aurait encore des «élèves d’été» à Saint-Stanislas. Émilie ne s’en plaignit pas, ce travail lui donnant l’impression d’être utile douze mois par année.
Son père vint la chercher le soir même de la première journée des vacances. Encore une fois, elle quittait son école en sachant qu’elle y reviendrait. Pour une troisième année. Mais elle quittait maintenant plus que son école. Elle quittait un village auquel elle commençait à appartenir vraiment.
Saint-Stanislas lui parut s’éloigner d’elle à chaque tour de roue qui pourtant l’en approchait.
Chapitre deuxième
10.
Ovide conduisait son attelage avec prudence. Il rentrait du village et le vent frisquet de mars l’étouffait sans arrêt Bien couvert, il n’en continuait pas moins à grelotter. Q décida de poursuivre sur le rang d’été jusqu’à la montée des Pointes. Avec un peu de chance, les enfants seraient dehors pour la récréation et il pourrait voir Emilie. Dès qu’il fut en mesure de bien distinguer l’école qu’une accalmie de vent fit apparaître, il constata qu’Émilie n’avait pis laissé sortir les enfants cet après-midi-là. Il soupira, toussota, cracha et prit la direction de la maison. Il demanda à Edmond de dételer le cheval, ce qu’Edmond fit sans se faire prier. Ovide rentra à la maison, se dévêtit lentement, trop épuisé pour le faire avec hâte. Sa mère vint l’aider. Ovide ne dit pas un mot. Il monta à sa chambre et s’échoia sur son lit, secoué par une tempête de toussaillement;. Félicité le suivit, s’essuyant les mains sur un tablier légèrement gonflé par l’approche d’une nouvelle naissance. El e regarda son fils, lui ordonna de s’asseoir et lui versa in verre d’eau. Il but comme il le put, s’étouffa à deux reprises avant de recracher sa dernière gorgée. Félicité lui épongea le front d’un coin de serviette.
«J’aime pas ça, Ovide. Tu craches trop. C’est malin de cracher comme ça. J’vas demander à Edmond d’aller chercher le docteur. »
Ovide secoua une main comme s’il chassait une mouche. Ses poumons s’emplirent en émettant un sifflement.
«C’est pas nécessaire de faire venir le docteur. Je viens de le voir.
— Pis?» demanda la mère, un pli d’inquiétude imprimé sur le front.
Ovide toussa à s’époumonner avant de pouvoir répondre.
«Pis, ça a bien l’air d’être ce que je pensais.»
Félicité regarda son grand et beau fils. Son aîné. Il s’était retourné pour qu’elle ne puisse pas voir les larmes qu’il refoulait depuis son arrivée. S’il avait réussi à cacher les pleurs, il était incapable de dissimuler les hoquets qui secouaient son pauvre corps, assiégé tantôt par des accès de toux, tantôt par des sanglots.
«Sortez de la chambre, moman. J’aime mieux être tout seul. »
Félicité obtempéra. A contrecœur, elle laissa son fils à son chagrin. Impuissante.
Elle revint dans la cuisine et se contenta de hocher la tête quand Edmond lui demanda si Ovide allait mieux. Edmond se leva, marcha de long en large, puis donna un violent coup de poing sur le mur. Félicité sursauta, mais en même temps elle enviait son fils de pouvoir manifester ainsi la rage qu’il avait au cœur.
«Est-ce que c’est grave? lui demanda-t-il.
— J’sais pas. Ovide m’a pas donné de détails.»
Edmond enfila son manteau.
«Je m’en vas chercher le docteur.
— C’est de là qu’Ovide arrive, dit sa mère.
— J’y vas pareil. Si Ovide veut rien nous dire, on va en avoir le cœur net. »
Edmond sortit de la maison, réattela l’étalon et partit pour le village. Félicité remonta voir si Ovide avait réussi à se calmer. Il était couché sur le dos, un bras replié sur les yeux.
«Ovide, veux-tu quelque chose?»
Il se contenta de secouer la tête et de se retourner à nouveau. Félicité lui dit qu’elle allait immédiatement lui faire une mouche de moutarde et sortit précipitamment de la chambre avant qu’il essaie de l’en empêcher. Elle remonta quelques minutes plus tard pour lui mettre le cataplasme sur la poitrine. Ovide la remercia d’un signe de tête.
Les enfants rentrèrent de l’école. Télesphore, le petit dernier, était avec eux. Exceptionnellement, Rosée s’était absentée pour la journée. D’habitude, elle demeurait à la maison, n’étant plus retournée en classe depuis octobre. La grossesse tardive de sa mère avait nécessité sa présence quotidienne.
Edmond revint. Félicité se protégea d’un gros châle et alla le rejoindre au bâtiment. Elle le trouva affairé à ranger le mors et les guides.
«Pis?»
Edmond se retourna. Il regarda sa mère. Elle lui parut tellement fragile dans sa maternité qu’il lui demanda de s’asseoir. Félicité obéit.
«Pis...c’est...c’est la tuberculose.»
Félicité sentit un frisson la secouer des pieds à la tête, en faisant une longue pause au cœur. Elle garda la tête baissée. Edmond vint s’asseoir à côté d’elle, lui posa une main maladroite sur l’épaule, puis tenta gauchement de la rassurer et de la consoler en lui disant que durant la maladie de l’aîné, elle pourrait se fier à lui, le second, et qu’il ferait tout en son pouvoir pour aider la famille.
Dosithée était au lac Pierre-Paul avec ses frères Joseph- Denis et Claïre. Ils avaient enfin réussi à obtenir le contrat de coupe pour des dormants de chemins de fer, qu’ils attendaient depuis deux ans. Ils étaient affairés dans le bois lorsque Dosithée vit arriver Edmond.
«Edmond? Qu’ossé que tu fais ici? C’est pas ta mère, j’espère!» lui cria-t-il en déposant sa hache.
Edmond s’approchait à pas lents, comme s’il tentait de repousser l’instant où il aurait à parler à son père. Dosithée vint à sa rencontre, accélérant à chaque pas qu’il faisait.
«Parle Bonyeu! C’est-y ta mère?»
Claïre et Joseph-Denis arrêtèrent aussi de travailler et firent signe aux autres hommes du chantier d’en faire autant. L’écho cessa de résonner dans le bois.
«C’est pas moman. C’est Ovide.
— Ovide? Qu’ossé qu’il a Ovide?
— Ben, vous savez...son rhume qui traîne depuis le commencement de l’hiver... Ben...le docteur dit que c’est pas un rhume ordinaire...Ça a l’air que... Ben nous autres on pensait que c’était peut-être une pneumonie... Mais le docteur dit que ça a l’air d’être plus grave...»
Dosithée était suspendu aux lèvres de son fils. À chacune des phrases qu’Edmond bégayait, Dosithée donnait un coup de tête, comme s’il cherchait à deviner les paroles qui suivraient. Edmond s’était tu. Il n’avait pas pensé qu’il lui serait si difficile d’annoncer la nouvelle à son père. Il se racla la gorge pour donner place aux mots qu’il se devait de prononcer.
«Le docteur...le docteur dit que c’est...de la tuberculose. »
Il leva les yeux et regarda son père. Dosithée répéta silencieusement le diagnostic à deux ou trois reprises. Il se retourna enfin pour dire à ses frères qu’il allait chercher son bagage et qu’il rentrait à Saint-Tite. Ses frères l’accompagnèrent jusqu’au campement. Dosithée lança tout en vrac dans le sac de farine qui lui servait de valise.
«Claïre, je te confie ma hache. Veille à ce qu’elle rouille pas, pis rapporte-moi-la au printemps. Salue bien tout le monde. Moi, je file.»
Dosithée et Edmond firent le trajet en silence. Si le trajet n’était pas long, il n’en était pas moins épuisant, les chemins étant à peine existants. N’eussent été les traces qu’Edmond avait creusées à son arrivée, ils auraient mis encore plus de temps à sortir du bois touffu et étouffant. Dosithée regardait devant lui un point qui semblait toujours s’appuyer sur un horizon inaccessible.
Ils arrivèrent au Bourdais à la nuit tombée. Dosithée sauta du traîneau, laissant à son fils le soin de la bête et de l’attelage. Il se précipita dans la maison et se dirigea vers sa femme. Cette dernière lui tendit une joue qu’il s’empressa de caresser.
«Ovide est où?
— Dans la chambre des filles. Il empire depuis à matin. Le docteur est venu pis il nous a dit qu’Ovide faisait en plus une p’tite bronchite. On sait pas ce qui va arriver.»
Félicité se voulait rassurante, mais elle-même n’était pas tranquillisée. Elle savait que la nuit serait longue. Dosithée enleva manteau, bottes et tuque, puis monta l’escalier sur la pointe des pieds. Il s’assit au chevet de son fils qui se débattait contre une fièvre de plus en plus accablante. «Salut mon gars... Comment ça va?»
Ovide ouvrit les yeux et commença à trembler. Il parvint à dire à son père de s’éloigner de lui. Dosithée recula. Puis Ovide, que la fièvre réussissait presque à vaincre, recommença à s’agiter. Dosithée lui posa un linge humide et frais sur le front. Ovide l’arracha. Désemparé, Dosithée sortit de la chambre à reculons. Il revint dans la cuisine.
«As-tu l’impression qu’il faudrait faire venir le curé? demanda-t-il à sa femme en essayant de camoufler les vacillements de sa voix.
— Pas d’après le docteur. Si la fièvre peut tomber, il va être correct. »
Dosithée alla à sa chambre. Il décrocha le crucifix qui était suspendu à la tête du lit, le serra contre sa poitrine et le raccrocha au mur. Il revint dans la cuisine. Ce n’est qu’à ce moment-là qu’il se rendit compte que tous les enfants étaient assis autour de la table. Il les regarda, un peu étonné de ne pas avoir remarqué leur présence. Tous leurs regards étaient inquiets. Il leur sourit, puis leur demanda s’ils voulaient faire une prière. Télesphore répondit qu’ils venaient de terminer un chapelet. Rosée fusilla ce dernier du regard et proposa à son père de réciter un rosaire. Dosithée, conscient tout à coup de l’heure tardive, lui répondit qu’ils seraient probablement mieux de tous aller dormir. Tous les enfants montèrent, à l’exception de Rosée, Edmond et Ovila. Éva se dirigea vers le salon. C’est là que Félicité avait installé ses filles afin de libérer leur chambre pour Ovide.
«Comment est-ce qu’il est, Lazare, depuis les Fêtes? demanda Dosithée.
— Seulement deux crises», répondit Rosée.
Dosithée se retourna vers Ovila.
«Ovila, ton frère Ovide est trop malade pour qu’on puisse compter sur lui. Lazare, tu le sais, est pas capable de travailler régulièrement. Ça fait que c’est à ton tour de laisser l’école pis de prendre la relève. »
Ovila ne dit pas un mot. Il enfila son manteau et sortit prendre l’air. Quelque chose en lui venait de se rompre. Il ne voulait pas vraiment de la vie de la ferme. Dans quelques jours, il aurait dix-sept ans. Les études l’intéressaient plus ou moins mais elles lui évitaient de se fondre dans la routine des saisons.
Il marcha jusqu’à l’école. Une lumière luisait au second étage. Il se demanda s’il devait lui-même aviser Emilie qu’il ne viendrait plus ou s’il devait attendre que son père le fasse. Alors même qu’il débattait la question, il frappa à la porte. Émilie vint lui ouvrir. Elle était en robe de nuit, ses cheveux dénoués. Ovila, intimidé, lui demanda s’il la dérangeait. Elle lui dit qu’il la dérangeait en effet mais qu’il pouvait bien entrer quelques minutes. Il le fit et se dirigea automatiquement vers son pupitre. Émilie le suivit et s’assit au pupitre voisin.
«Mon frère Ovide est malade.
— Oui, j’ai su. Je me demandais pourquoi tu m’en avais pas parlé depuis une semaine.»
Ovila haussa les épaules. Il n’aurait jamais pu lui avouer ce qu’il avait pensé avant de connaître l’ampleur du mal de son frère. Son cœur était déchiré. Il s’était réjoui qu’Ovide fût malade, d’autant plus qu’Émilie n’était pas venue lui rendre visite. L’attitude de cette dernière lui avait confirmé ce que ses parents avaient maintenant accepté. Ovide n’intéressait pas vraiment Émilie. Elle ne voyait en lui qu’un bon voisin, rien de plus. Il la regarda et lui sourit tristement. Si seulement il avait eu l’âge d’Edmond ou même de Lazare, peut-être aurait-elle remarqué qu’il existait. Peut- être aurait-elle deviné que son «amourette» née trois ans plus tôt ne s’était jamais éteinte. Depuis trois ans, il s’obstinait aussi à poursuivre ses études, un peu pour avoir le loisir de la côtoyer quotidiennement. Il était le plus âgé de la classe. Il enviait Rosée d’avoir développé une relation amicale avec Emilie. Depuis qu’elle avait quitté l’école, Rosée pouvait, sans gêne, la visiter à n’importe quel moment.
«Ovila, es-tu venu pour me parler d’Ovide?»
Le son de la voix d’Émilie le força à redescendre de sa lune. Il lui donna les dernières nouvelles. La tuberculose... Elle grimaça.
«J’imagine que vous devez deviner le reste?»
Émilie abandonna le cours de ses pensées.
«Le reste...?
— C’est moi astheure qui vas rester à la maison pour remplacer les bras d’Ovide. On peut pas se fier à Lazare.»
Émilie n’avait absolument pas pensé au sort inéluctable qui attendait Ovila. Elle s’était tellement habituée à le voir dans la classe qu’elle n’avait pas vraiment voulu remarquer qu’il avait vieilli. Elle avait bien vu que son corps s’était allongé jusqu’à toucher la marque des six pieds, faisant de lui un garçon...un homme exceptionnellement grand. Elle avait bien entendu la transformation de sa voix d’enfant. Elle avait bien vu, au premier jour de chaque nouvelle année, que sa musculature s’était arrondie. Et elle s’en était réjouie. Il la regardait le regarder...
«Ça va faire un vide», parvint-elle à dire.
— Vous allez vous habituer. J’vas pas être loin. J’vas continuer de venir vous visiter, pis de venir vous chercher pour la messe. Pis j’vas bûcher le bois en cachette. Même si vous êtes... »
Il s’était interrompu. Il ne pouvait lui dire qu’elle n’avait en somme que quelques années de plus que lui. Qu’elle venait tout juste d’avoir dix-neuf ans et que, fin mars, lui même en aurait dix-sept.
«Même si...?» reprit Émilie.
— Même si vous êtes encore la maîtresse d’école...je veux dire que moi, finalement, euh...pas finalement comme...en tout cas, ce que je veux dire c’est que je suis pus votre élève. Il y a pus un seul commissaire qui va pouvoir chiâler parce que je fends votre bois. Ça sera pus contre les règlements. »
Émilie s’efforçait de masquer l’attendrissement qui l’avait envahie.
«Si tu veux, Ovila, quand on sera tout seuls, tu pourras m’appeler Émilie. Rosée le fait. Pis...si ma mémoire est bonne, il y a moins de différence d’âge entre nous deux qu’entre elle pis moi. »
Ovila la regardait, fasciné par ses yeux colorés au même pigment que sa chevelure. Elle avait dit nous deux. Le silence qui soudait leurs regards dura plusieurs minutes. Elle avait dit nous deux. Pour se donner une contenance, il commença à sortir ses effets et à les empiler sur le plancher. Elle avait dit nous deux.
«J’vas faire comme avec les bûches. J’vas faire des piles bien droites.»
Il leva les yeux pour voir sa réaction. Elle n’avait pas saisi qu’il se moquait d’elle. Elle le regardait, perdue dans ses pensées. Songeait-elle à nous deux? Il se releva et lui dit qu’il était temps qu’il parte et pensa l’aviser que son père était rentré du chantier. Il se pencha à nouveau pour ramasser ses effets. Émilie l’aida, à genoux à côté de lui, essayant désespérément de ne pas le regarder.
«Si tu me donnes deux minutes, j’vas m’habiller pour t’aider à transporter ça jusque chez vous.»
Ovila décida de tenter le tout pour le tout.
«Je pense que j’aimerais revenir chercher la balance demain.» Il se trouva effrontément présomptueux, aussi s’empressa-t-il d’ajouter qu’ainsi il aurait des nouvelles fraîches au sujet de son frère.
Émilie n’insista pas, se contentant de soulever les épaules pour bien lui faire comprendre qu’elle n’avait plus autorité sur lui. Elle l’accompagna jusqu’à la porte qu’elle entrouvrit.
«Ça va vraiment faire un grand vide...
— Juste de six pieds», essaya-t-il de blaguer.
Émilie émit un petit ricanement un peu rauque.
«Eh! bien, Ovila, tu me forces à faire ce que je fais toujours quand j’ai un élève qui part.»
Elle s’étira le cou et lui déposa un baiser sur la bouche. Habituellement, elle se contentait d’une joue. Ovila la laissa faire quelques secondes, puis recula, déposa ses effets, s’approcha d’elle sans dire un mot, ferma la porte d’un coup de pied, lui encadra le visage de ses deux mains et l’embrassa doucement. Il se rendit à peine compte qu’elle avait enlacé ses épaules de ses bras tant son âme l’avait quitté pour rejoindre la voie lactée.
11.
Émilie, confuse, avait tenté d’ignorer la présence d’Ovila. Il n’avait cessé d’essayer d’emprisonner son regard mais elle avait toujours fui. Elle avait terminé sa quatrième année d’enseignement avec un entrain mitigé. Le départ d’Ovila avait quelque peu assombri son printemps. Maintenant qu’elle avait fait l’erreur de lui montrer qu’elle nourrissait à son égard un sentiment privilégié, elle s’était empressée de réhabiter son personnage de «maîtresse d’école», laissant dormir bien profondément la femme qui avait réussi à s’échapper un soir d’hiver. Elle avait refoulé toute l’euphorie qui s’était emparée d’elle après son manque de retenue. Si elle avait d’abord réussi à se convaincre qu’elle n’avait rien fait de mal, un grand malaise l’avait rapidement poursuivie pour finalement céder la place à l’invincible culpabilité. Elle n’avait même pas su faire confiance à Ovila, redoutant au point d’en faire des cauchemars, qu’il ne racontât à tous qu’elle s’était littéralement jetée dans ses bras. Elle avait donc décidé de ne jamais plus faire allusion à la chose. Elle avait aussi décidé de ne lui adresser la parole que lorsqu’elle ne pouvait l’éviter. Malgré son attitude, Ovila avait tenu ses promesses. Il l’avait conduite à la messe et avait entré la dernière corde de bois dans la classe et dans sa chambre. Mais c’est en vain qu’il avait tenté d’engager la conversation. Elle lui opposait un mur de mutisme et d’incompréhension.
Elle avait vu arriver juin avec un soulagement à peine dissimulé. Encore quelques semaines et elle serait de retour dans son cocon familial. Encore quelques semaines et elle pourrait oublier cette fin d’année si peu digne d’éloges.
Elle était allée saluer les Pronovost, les remerciant encore de leur fidèle attention. Depuis Pâques, ils avaient repris leur allant, Ovide étant hors de danger. Elle était rentrée à l’école au moment où son frère arrivait. Elle s’était étonnée de ne pas voir son père. Son frère lui avait répondu qu’il était maintenant en âge de prendre la relève. Emilie lui avait souri, soudainement consciente que lui aussi avait vieilli. Ils avaient donc fait le trajet ensemble, faisant une halte chez Lucie. Emilie avait ensuite pris les commandes de l’attelage qu’elle avait mené furieusement jusqu’à la maison.
«Ma foi, on dirait que tu as le feu quelque part.
— J’ai le feu nulle part, avait-elle répondu avec acidité. J’ai juste hâte d’arriver. »
Rentrée à la maison, Émilie avait défait son bagage avec empressement pendant que sa mère lui racontait toutes ses misères des mois passés. Émilie l’avait écoutée avec compassion. Émilie attendit quelques minutes et annonça à sa mère qu’elle irait chez Berthe immédiatement la vaisselle du souper lavée, trop impatiente pour attendre un lendemain encore lointain. Célina soupira devant ce qu’elle interpréta comme de l’indifférence de la part de sa fille et ne passa aucun commentaire.
Émilie marcha rapidement le mille qui séparait sa maison de celle de Berthe. Berthe avait la chance d’habiter près des berges de la Batiscan. Émilie, depuis son départ de Saint-Stanislas, avait toujours entretenu une correspondance régulière avec sa meilleure amie, mais elle s’en était toujours tenue à ne raconter que des anecdotes. Elle avait nourri un certain scrupule à relater ses états d'âme, incertaine s’ils trouveraient un écho dans l'âme sensible de Berthe.
Berthe fut étonnée de la voir mais n’en éprouva pas moins un vif plaisir. Les politesses échangées avec la famille de Berthe, les deux amies s’esquivèrent pour trouver un peu de solitude et leur intimité.
«Qu’est-ce que tu as, Émilie? Tu as l’air tout à l’envers. »
Émilie réfléchit quelques instants avant de décider d’étaler sa honte à son amie. Berthe l’écouta attentivement. Elles étaient assises sur un tronc d’arbre mort depuis des années dont les branches baignaient dans la Batiscan.
Ton bel Ovila, est-ce qu’il t’a dit quelque chose après le soir où tu l’as embrassé?» demanda Berthe les yeux curieusement illuminés.
«Il a bien essayé, mais moi je l’ai toujours empêché de me parler.»
Berthe, à force de subtiles questions, réussit à comprendre le trouble d’Émilie. Que son amie fût amoureuse, elle n’en doutait pas. Que son amie ait quelque peu dépassé les bornes, elle le comprenait. Mais que son amie s’empêchât de s’avouer qu’elle avait droit à ses sentiments, elle le refusait. Berthe émit enfin une opinion. Elle ne blâmait pas Émilie. Elle la félicita même, en se moquant, d’avoir réussi à attendre si longtemps. Émilie demeura perplexe. Elle demanda à son amie si elle devait accepter de le revoir. Berthe lui répondit qu’elle n’avait qu’à écouter son cœur.
«Mais Berthe, tu y penses pas! C’est mon élève pis il est deux ans plus jeune que moi!
— C’est effrayant! Quand tu vas avoir quatre-vingts, lui va juste avoir soixante-dix-huit. Tu te rends compte, Émilie? Tu vas passer pour une vieille folle qui court après les jeunesses.»
Elles éclatèrent de rire.
«Tu vas faire une drôle de sœur, Berthe. Tu encourages les maîtresses d’école à sortir avec leurs élèves...
— Je fais rien de ça! Je te ferai remarquer qu’Ovila, c’est pus ton élève. Si tu avais fait montre de quelque chose avant, là j’aurais pas pu faire autrement que de dire que c’était un bien mauvais exemple. Pire même. Mais astheure, moi je trouve que la voie est libre. C’est sûr que les gens vont jaser, ça fait que moi...»
Elle s’était interrompue pour essayer d’imaginer ce qu’elle aurait fait à la place d’Émilie. Elle savait les commissaires très exigeants quant au comportement des institutrices. Dans certains cantons, les institutrices ne pouvaient même pas patiner en hiver au risque de perdre leur emploi. Elle savait aussi qu’il était presque impossible à Émilie de faire accepter le fait qu’elle fréquenterait le frère de certains de ses élèves. Aurait-on cru à son impartialité? Elle savait qu’Émilie ne pouvait pas recevoir dans son école...Son expression dut changer car Émilie put suivre le cours de ses pensées et enchaîner à sa place.
«Ça fait que toi, tu ferais comme moi. Tu dirais pas un mot à Ovila, tu lui donnerais l’impression qu’il s’est jamais rien passé, tu éviterais de le regarder, pis à chaque fois que tu le verrais se morfondre, tu aurais le cœur bien à l’étroit. »
Les deux amies demeurèrent silencieuses pendant un long moment. La noirceur avait envahi les rives de la Batiscan. Ni l’une ni l’autre n’avait trouvé de solution au dilemme d’Émilie. Elle reprirent lentement la direction de la maison de Berthe. Elle écoutèrent le chant des grillons et la respiration des animaux qui dormaient juste derrière les clôtures de perche. Quelque part, un coq se mit à chanter.
«En voilà un autre de mêlé», lança Berthe.
Émilie se mit à rire, puis à rire de plus belle, entraînant Berthe qui lui bourrela les côtes de coups de coude, l’exhortant à se calmer, ce que ni l’une ni l’autre ne purent faire. Elles en vinrent finalement à se rouler dans le foin, se tordant comme deux poissons fraîchement péchés, empêtrées dans leurs jupes, les cheveux mèchés de paille. Leur rigolade tourna vraiment au délire quand le coq chanta une deuxième fois.
«Si le coq chante une troisième fois, hoqueta Émilie, on va savoir que mon calvaire est commencé.
— Tu es complètement dinde, Émilie Bordeleau» hurla Berthe.
Le coq chanta une troisième fois. Les deux amies se calmèrent immédiatement. Émilie s’assit et enleva la paille qui lui coiffait la tête. Elle se leva brusquement. Berthe l’imita.
«Je voudrais pas être superstitieuse, Berthe, mais c’est pas un peu de mauvais augure?
— Voyons donc», répondit Berthe qui secouait énergiquement sa jupe. «Tu vas pas commencer à te faire du mauvais sang à cause d’une farce.» Mais Berthe elle-même ne semblait pas tellement rassurée.
Elles se quittèrent quelques minutes plus tard, après avoir convenu d’occuper leurs soirées d’été à faire une courtepointe.
«Tu la garderas pour toi, Émilie. Moi, je saurais pas quoi en faire. Vois-tu...j’vas rentrer au noviciat à la fin du mois d’août.» Berthe s’en voulait un peu d’annoncer une si grande nouvelle à un moment soudainement nuageux.
Émilie ne sut que répondre. Elle se contenta de donner une accolade à son amie, lui tapotant le dos comme si elle avait voulu la convaincre que tout irait bien.
Elle rentra chez elle marchant tantôt de front, tantôt à reculons. Sans en prendre conscience, elle avait greffé sa démarche sur ses pensées. Berthe entrait au couvent. C’était maintenant quelque chose de vrai. Comme Berthe serait heureuse. Puis à reculons. Mais qui va remplacer Berthe? Lorsqu’elle sera religieuse, nous ne pourrons plus jamais faire comme ce soir. Nous ébattre dans l’herbe comme de jeunes chiots. Puis de front. Ovila, c’est dans mon imagination. Il n’y a pas une seule femme qui peut dire qu’elle est devenue amoureuse de son mari quand il avait quatorze ans. Ovila est encore trop jeune pour connaître ce que je connais. Puis à reculons. Pourquoi n’a-t-il rien dit? Pourquoi s’est-il tenu à l’écart comme il l’a fait? Pourquoi n’a-t-il pas insisté? Puis de front. Je vais lui dire ce que je ressens. Ovila ne rira pas de moi. Ovila m’aime, j’en suis certaine. Puis à reculons. Est-ce qu’il m’aime? Je veux qu’il m’aime. Pourquoi le coq a-t-il chanté trois fois?
Berthe et Émilie travaillaient chez les Bordeleau. Elles avaient décidé qu’il serait trop compliqué de transporter leur matériel à tout bout de champ. Berthe préférait s’exiler du toit paternel. La maison de son amie était presque aussi remplie d’enfance que la sienne mais elle la trouvait plus calme. Et, avait-elle ajouté, la promenade qu’elle faisait lui permettait de se recueillir.
Leurs soirées étaient agréables. Émilie n’avait jamais osé aborder une discussion sur les raisons de la vocation de Berthe. Elle s’était tue, craignant de teinter son jugement d’une parcelle d’égoïsme. Berthe lui manquerait terriblement. Elle s’était tue aussi, incapable de dire qu’elle trouvait que le couvent ressemblait à une fuite. Berthe était extraordinaire avec sa mère, ses frères et ses sœurs. Émilie n’avait jamais réussi à vraiment comprendre pourquoi Berthe avait toujours semblé vouloir s’éloigner de la nichée dont la responsabilité lui avait incombé. Elles parlaient donc de tout et de rien en piquant chacune une aiguille dans la courtepointe kaléidoscopique. Le mois de juillet avait lui aussi filé à travers le chas du temps. Août s’était pointé sous un soleil éclatant. Leur travail avançait très rapidement, les amies ayant toutes deux une patience monastique doublée d’une célérité d’exécution remarquable.
Elles travaillaient dehors quand le temps était clément. La noirceur les assaillait maintenant plus tôt, mais elles avaient installé des lampes pour travailler encore quelques heures, sous les étoiles.
Caleb, ce soir-là, s’était assis avec elles, s’émerveillant autant de ce qu’elles accomplissaient que de la beauté de la voûte étoilée, espérant voir apparaître des aurores boréales.
«Qui c’est à votre avis qui monte la côte?»
Berthe et Émilie quittèrent leur ouvrage des yeux. Elles regardèrent en direction du chemin et virent la lueur d’un fanal. Puis elles entendirent des bruits de sabots.
«Mon Dieu, fit Berthe d’une voix étranglée, j’espère que c’est pas mon père qui vient me chercher parce que ma mère est malade. »
Toutes deux, elles piquèrent leurs aiguilles, déchaussèrent leurs majeurs du dé à coudre et déposèrent leur ouvrage. L’attelage s’arrêta devant la maison de Caleb. Ce dernier demanda aux filles de demeurer là où elles étaient et s’empara d’un fanal. Il se dirigea vers le chemin, Berthe et Émilie n’entendirent pas la conversation qui suivit.
«Ça doit pas être pour moi, parce que ton père m’aurait déjà appelée.»
Émilie ne répondit pas. Elle croyait plutôt le contraire. Caleb mettait peut-être le temps nécessaire à trouver les mots pour annoncer une mauvaise nouvelle.
«Émilie! Approche donc, cria Caleb, j’ai besoin de toi. »
Emilie regarda Berthe. Berthe ne broncha pas. Emilie
s’éloigna. Berthe s’assit sur le bord de la chaise, prête à bondir dès qu’on la réclamerait. Elle déglutit péniblement. Un malheur. Une malédiction. La fin de son rêve d’entrer au couvent.
«Berthe! Viens ici, Berthe!»
Le cri d’Emilie lui résonna aux oreilles comme un écho de brume. Elle franchit en un éclair la distance qui la séparait du chemin et s’immobilisa subitement. Emilie riait aux éclats et Caleb faisait les frais d’une conversation enjouée.
«Berthe, je te présente Ovila Pronovost!»
Berthe demeura bouche bée. Ovila Pronovost. Elle avait passé tellement d’heures à l’entendre décrire par Emilie qu’elle eut l’impression que son visage lui était familier. Elle s’illumina.
«Ha! ben! Ha! ben! » parvint-elle à dire. «De la grande visite de Saint-Tite. » Discrètement, elle écrasa le pied droit d’Émilie.
Caleb invita Ovila à faire reposer sa bête. Il l’invita avec d’autant plus d’empressement que l’attelage était tiré par le bel étalon à la crinière blonde. Il poussa même la politesse jusqu’à lui offrir de conduire lui-même l’attelage à l’abreuvoir. Il s’éloigna.
Ovila, empêtré mais heureux de l’accueil qui lui avait été réservé, suivit les filles. Berthe ne cessait de faire des clins d’œil et des grimaces à Émilie, que l’arrivée d’Ovila avait surprise. Émilie n’avait pu retrouver le comportement qu’elle avait adopté depuis ce fameux soir de mars. Ovila épousseta ses vêtements avant de s’asseoir. Caleb revint vers eux avec Célina qu’il était allé chercher. Les présentations faites, Caleb les invita tous dans la maison pour boire quelque chose. A l’intérieur, la haute taille d’Ovila devint rapidement un objet de curiosité.
Ils parlèrent à bâtons rompus pendant une bonne demi- heure. Ovila précisa qu’il se dirigeait vers Shawinigan et Trois-Rivières, pour essayer d’y trouver du travail. Émilie avait feint un vif intérêt même si, intérieurement, un effroi de perdre Ovila de vue lui avait glacé le cœur. N’ayant rien remarqué, Ovila avait enchaîné en disant qu’il voulait travailler dans les chantiers durant l’hiver.
«Des chantiers de bûcherons ou des chantiers de construction, j’ai pas de préférence.»
Emilie décida de changer de sujet et lui demanda s’il avait de la parenté à Saint-Stanislas. En fait, elle connaissait la réponse, mais elle savait que ses parents se passionnaient pour toutes les souches familiales de la Mauricie. Ils avaient donc été fascinés d’apprendre que, par sa mère, Ovila était un parent d’Isidore Bédard.
«Isidore doit vous attendre pour la nuit?» demanda Célina.
Ovila rougit un peu avant d’avouer qu’il n’était en fait pas attendu mais que sa mère l’avait assuré d’un bon accueil. Caleb jeta un furtif coup d’œil vers Émilie. Sa fille avait l’air absolument subjuguée par Ovila. Il décida donc de brusquer un tantinet les événements.
«Je vois pas pourquoi qu’à une heure de même, vous arriveriez chez Isidore comme un quêteux. Ici, on a de la place pour la visite. »
Célina le regarda, étonnée. Émilie ne dit pas un mot. Elle évita même de regarder Berthe qui s’était levée pour remplir le pot d’eau.
«Bon, astheure que c’est réglé, enchaîna Caleb, j’vas aller dételer votre bel animal. »
Il allait sortir, l’air guilleret, lorsqu’Émilie l’informa qu’elle et Ovila iraient conduire Berthe. Émilie connaissait bien son père. Elle savait qu’elle venait de lui imposer une attente torturante.
«Tu as le don, Émilie, de toujours fatiguer les bêtes après une trotte, répondit Caleb déçu. Mais amusez-vous, on va attendre.» Sans comprendre comment elle avait pu faire une telle erreur, Berthe se retrouva assise entre Emilie et Ovila. Elle passa tout le temps de la trotte à tourner la tête à gauche, à tourner la tête à droite, faisant mine de s’intéresser au plus haut point à leur discours farci de sous-entendus. Elle ne prit la parole qu’à une seule occasion, pour confirmer les dires d’Emilie quant à leur «passionnant été». Elle s’abstint de commentaires quand Émilie raconta toutes les fêtes auxquelles elles avaient assisté, sachant qu’Émilie n’avait assisté qu’à une fête: celle organisée par sa famille pour souligner le départ de François-Xavier Bordeleau pour le Klondike.
Ils arrivèrent chez Berthe. Ovila descendit et tendit la main à chacune des filles. Émilie raccompagna Berthe. Elles chuchotaient, Émilie étant visiblement au paroxysme de l’émoi.
«Tu me l’avais décrit, mais c’est quelque chose.
— Oui hein?» répondit Émilie fière comme elle ne l’avait jamais été.
Berthe parla rapidement de toutes les qualités d’Ovila. Émilie acquiesçait à chacune d’elles. Émilie lui demanda si elle viendrait le lendemain. Berthe promit de faire tout en son possible pour s’absenter de la maison.
Émilie remonta dans la calèche. Ovila, qui était assis, se contenta de lui tendre la main. Elle s’y agrippa joyeusement.
Ils remontèrent la côte Saint-Paul au pas. L’étalon apprécia ce répit. Ovila était muet. Maintenant qu’il était seul avec Émilie, il ne savait plus comment expliquer sa présence. Émilie vint à son secours en lui demandant s’il voulait vraiment travailler dans les chantiers. Il répondit par l’affirmative et lui expliqua que plusieurs compagnies de Trois-Rivières et de Shawinigan embauchaient des hommes. Prenant ensuite son courage à deux mains, il dit à Emilie qu’il préférait quitter Saint-Tite. Il trouvait insupportable de la voir et de ne pouvoir l’approcher.
«Ris de moi si tu veux, mais fallait que je vienne pour te dire que je t’aime.»
Émilie ne rit pas. Elle ne parla pas non plus. Ovila désespéra. S’enhardissant, il lui demanda si elle accepterait de correspondre avec lui durant son absence. Elle promit de le faire. Il demanda enfin s’il pouvait espérer qu’elle nourrisse à son égard un sentiment semblable au sien. Elle tarda à répondre. Il immobilisa la calèche. Émilie se taisait toujours. Ovila se tourna pour la regarder. Elle avait les yeux luisants. Il comprit qu’elle pleurait. De drôles de larmes de plaisir. Il s’empressa de l’enlacer pour la consoler. Elle éclata de rire et le laissa faire. Elle accepta d’être celle qui l’attendrait. Ovila se leva et se tapa la cuisse en poussant un cri de joie, puis il se rassit, remit la bête en marche, tenant les guides de sa main gauche et la main d’Émilie de sa main droite.
Caleb les attendait sur la galerie et ne passa aucun commentaire sur le fait qu’ils avaient mis près d’une demi- heure à franchir une distance qui habituellement demandait une dizaine de minutes. Il détela le cheval et commença à lui brosser la crinière. Émilie et Ovila demeurèrent assis avec Célina qui avait profité de leur absence pour faire monter tous les enfants, ranger les effets de couture d’Émilie et préparer une couche pour Ovila dans le salon.
«C’est un peu mieux que le lit du quêteux. Au moins on te fait pas coucher en arrière du poêle», dit Émilie pour justifier l’installation précaire.
Ovila les remercia de leur hospitalité, s’excusant encore une fois d’être arrivé sans prévenir. Émilie savait bien qu’il n’aurait jamais osé s’annoncer de crainte qu’elle ne lui dise qu’elle préférait ne pas le voir. Elle bâilla. Ovila se leva et les pria d’aller dormir, disant qu’il irait à l’étable voir si sa bête était installée.
Ovila entra dans l’étable et se frappa la tête sur une poutre. Il crispa les lèvres et aspira le juron qui y pendait. Caleb le remarqua et éclata de rire.
«C’est fait pour du monde un peu plus p’tit.
— Tout est fait pour du p’tit monde», répondit Ovila en se frottant le front.
Caleb brossait encore la crinière du cheval.
«Il doit bien avoir huit ans astheure. La première fois que je l’ai vu, c’était à l’automne 96. Maudit! que c’est une belle bête!»
Ovila opina. La bête avait neuf ans mais était fringante comme au premier jour de son arrivée. Caleb lui raconta combien il avait été impressionné par la finesse de ses pattes et la blondeur de sa crinière. Il parla encore et encore des mérites de l’étalon et en vint finalement au point qui l’intéressait. Une connaissance lui avait offert une pouliche «bien prête à se faire servir», mais il avait refusé de l’acheter ne trouvant pas nécessaire d’avoir un autre cheval. Sa vieille jument, bien que moins ardente, dépannait encore. Il avait trois chevaux pour les labours. Trois gros et forts chevaux, avait-il précisé. Mais si Ovila voulait bien lui accorder quelques heures, il pourrait, le lendemain, acquérir la pouliche et la mettre au pâturage avec son étalon. Ovila ne réfléchit qu’un instant, le temps de feindre qu’il était attendu à Shawinigan, puis accepta de prolonger son séjour à Saint-Stanislas. Caleb jubila.
Caleb partit immédiatement après avoir trait ses vaches. Il se rendit chez Elzéar Veillette. Il détestait Elzéar Veillette, d’abord parce que Veillette s’entêtait à toujours avoir raison, ce qui, selon Célina, était impensable, puisque c’était Caleb qui n’avait jamais tort, et ensuite parce que Veillette faisait l’élevage de chevaux. Un petit élevage, certes, mais avec quand même quelques belles bêtes. Caleb savait que l’étalon des Pronovost aurait fait blêmir Veillette.
Veillette fut surpris de le voir arriver. Caleb fonça droit au but. Il avait entendu dire qu’il avait une pouliche à vendre. Veillette répondit qu’il l’avait vendue la veille et que c’était certainement la plus belle pouliche qu’il ait jamais eue. Caleb lui demanda qui l’avait achetée. Quelqu’un de la parenté du curé qui, justement, devait atteler pour s’en retourner à Grand-Mère. Caleb demanda si «ces bonnes gens» habitaient au presbytère. Veillette confirma. Caleb le salua en le remerciant et partit à la hâte.
«Coudon, Bordeleau, me semblait que tu voulais pus en avoir des ch’vaux.
— C’est pas toi, Zéar, qui m’as dit qu’il y a rien que les fous qui changent pas d’idée?»
Sur ce, Caleb reprit le chemin du village. Il arriva au presbytère au moment où le curé saluait ses visiteurs. Caleb interrompit, aussi poliment que possible, le rituel du départ. Il demanda au curé s’il pouvait «parler affaires» avec sa charmante visite. Il avait été étonné de constater que les «visiteurs» étaient trois des nièces du curé. Caleb leur expliqua, mentant légèrement, qu’il y avait eu erreur. Qu’il avait promis à monsieur Veillette d’acheter la pouliche qu’elles venaient d’atteler. Les femmes, surprises, lui répondirent que le gentil monsieur Veillette n’avait jamais parlé d’un autre acheteur. Caleb prit le curé à témoin sur la légendaire distraction de Veillette. Le curé n’osa pas le contredire, mais il savait fort bien que Caleb, et non Veillette, était reconnu pour sa distraction. Caleb offrit aux dames de racheter la jument. Les femmes refusèrent catégoriquement. Caleb sourit d’un sourire crispé et mit un prix sur son offre. Les femmes ne bougèrent pas d’un iota. Il augmenta la somme. Les femmes ramollirent. Il ajouta encore quelques dollars. Elles acceptèrent mais à la condition qu’il les accompagne chez Veillette. Si ce dernier n’avait pas une autre bonne bête à leur vendre, elles ne feraient pas la transaction. Caleb accepta. Il attira le curé à l’écart et lui demanda s’il pouvait lui avancer les fonds. Il n’avait pas en poche la somme nécessaire. Le curé s’empourpra. Caleb essaya de l’apaiser en lui promettant un prompt remboursement et...une part généreuse à la quête du dimanche pour le mois à venir. Le curé, toujours en colère, accepta néanmoins de lui avancer la somme. Caleb le remercia plus que chaleureusement. Le curé, intrigué par toutes les tractations, lui demanda s’il pouvait l’accompagner chez Veillette. Caleb n’osa pas refuser.
Veillette ne fut pas surpris de voir revenir Caleb. Il fut plus étonné d’apprendre que les demoiselles voulaient une autre bête. Il n’avait plus de jument à leur offrir. Seulement des étalons. Les femmes hésitèrent puis acceptèrent une des bêtes à la robe presque noire que Caleb leur recommanda chaudement. Pendant que les demoiselles faisaient leurs adieux à leur oncle, Veillette s’approcha de Caleb qui attachait la pouliche derrière sa calèche.
«Qu’est-ce que tu lui veux à ma jument? demanda-t-il l’air méfiant.
— Rien pantoute. Je veux juste une belle pouliche pour le plaisir de mes yeux qui commencent à voir moins clair.
— Fais pas l’innocent, Bordeleau. Tu sais comme moi que c’est la plus belle pouliche du canton.
— Du canton...du canton, répéta Caleb feignant un scepticisme de bon aloi. Elle est belle... mais qu’ossé que tu penses que ça donne une belle pouliche de même quand on n’a pas d’étalon pour la servir.
— J’en ai des étalons moi! Pis des maudits beaux a part de ça.
— Tu as pas un étalon aussi beau que cette jument là. »
Tous les deux, ils firent une pause pour saluer les nièces du curé qui quittaient le chemin de Veillette.
«Mes étalons sont beaux, Caleb Bordeleau! Tu sais ça aussi bien que moi!
— Prends pas le mors aux dents, Zéar! Tes étalons sont beaux.
— Je te connais, Caleb Bordeleau. Tu mijoterais quelque chose que je serais pas surpris pour deux miettes.
— Voyons donc, Zéar! Tu sais bien que j’ai juste trois vieux ch’vaux.» Il lorgna du côté du curé.
«Tu vas m’excuser, Zéar, parce que je voudrais pas faire patienter monsieur le curé.»
Caleb tourna des talons et monta dans sa calèche. Le curé s’installa à ses côtés. Ils revinrent au village et Caleb ponctua le trajet de remerciements qu’il voulait tous plus sincères les uns que les autres. Si le curé avait d’abord été sceptique face à l’attitude de Caleb, tout lui semblait maintenant parfaitement normal jusqu’à ce que Caleb lui demande de garder secrets la transaction et le prix payé pour la pouliche. Le curé le regarda l’œil méfiant, mais promit.
Caleb revint chez lui et fut accueilli par Ovila et Émilie qui sortaient du poulailler, avec deux paniers remplis de gros œufs bruns.
«Vous en avez mis du temps! lui lança Émilie.
— Pas tant que ça. Juste le temps d’aller chercher ma pouliche chez Veillette.»
Emilie regarda son père avec étonnement. Quand il mentait, la sueur lui perlait toujours au nez. Elle remarqua qu’il avait le nez lustré bien qu’il s’efforçât de l’essuyer discrètement.
«Pis, mon garçon, lança-t-il à Ovila, est-ce qu’on envoie ces deux belles bêtes-là dans le clos?»
Caleb flatta sa pouliche, incapable de contenir sa joie à l’idée qu’elle était prête à l’accouplement. Ovila entra dans l’étable, faisant bien attention de ne pas se frapper la tête encore une fois, et en ressortit en tenant l’étalon par la bride. L’étalon aperçut la jument et frémit. Ovila le débrida.
Emilie se tint à l’écart. Elle préférait observer à distance. Elle avait à maintes reprises été témoin de l’accouplement entre un étalon et une jument, mais aujourd’hui elle y voyait un sens tout autre. L’étalon Pronovost et la pouliche Bordeleau... Célina sortit de la maison et se dirigea vers sa fille.
«C’est à qui cette pouliche-là?»
Emilie lui répondit que c’était la dernière acquisition de son père. Célina fît une moue mais ne put s’empêcher de commenter la fière allure de la bête.
«Est-ce que ça vient de chez Zéar Veillette?»
Émilie lui dit que oui. Célina éclata de rire. À sa connaissance, dit-elle, Caleb et Elzéar ne s’étaient pas adressé la parole depuis le dimanche de Pâques.
«Comme d’habitude, ça aura pris une femelle pour que ces deux-là se parlent.»
Célina avait en effet fréquenté Veillette jusquà ce que son cœur se tourne vers Caleb. Veillette en avait toujours voulu à Caleb, même après qu’il fut lui-même marié à une femme en santé qui lui avait donné dix-huit enfants, tous vivants. Célina, elle, avait trainé sa vie, sautillant d'une maladie à l’autre.
Les deux animaux se flairaient. Caleb s’était assis sur la clôture, décidé à ne rien manquer du spectacle. Célina l’avait finalement rejoint. Ovila s’était planté à côté d’Émilie. Ils étaient aussi intimidés l’un que l’autre.
«Tu peux pas savoir, Ovila, comment mon père a attendu toute sa vie d’avoir des beaux animaux. Un vrai p’tit gars qui a enfin son jouet préféré.»
Ovila se contenta de sourire, puis dit, pour combler le silence, qu’il n’avait jamais vu un cultivateur prendre le temps de regarder un accouplement.
Berthe arriva et rejoignit Émilie et Ovila au moment où la pouliche partait au galop, l’étalon à ses trousses. Les enfants Bordeleau étaient maintenant tous sortis de la maison.
«C’est à nous autres cette pouliche-là, Émilie?» demanda Napoléon.
Émilie acquiesça. Les enfants se groupèrent autour de leurs parents. La pouliche freina sa course et changea brusquement de direction. L’étalon en fit autant. Leur galop était impressionnant.
«Avez-vous vu ça? cria Caleb. On dirait des ch’vaux sauvages. »
La pouliche se retourna et se leva sur ses pattes postérieures. Elle commença à marteler l’étalon de ses sabots. L’étalon se défendit. Elle se calma enfin et l’étalon, renâclant, se plaça derrière elle. La pouliche trépignait. Enfin, l’étalon lui monta ses pattes sur le dos et la mordit au cou. Émilie frémit quand elle sentit la main d’Ovila exercer une toute petite pression sur sa nuque. Elle tourna la tête, le temps de se rendre compte qu’il la regardait intensément.
Elle concentra ensuite son attention sur les bêtes. Ovila en fit autant. Emilie sentit le regard de Berthe.
L’accouplement dura une heure. Caleb resta assis tout ce temps, sans bouger. Les animaux, fatigués, avaient choisi un coin ombragé pour refaire leurs forces. L’impressionnante érection de l’étalon s’était résorbée.
Ils se retirèrent tous. Ovila pénétra dans le clos pour tenter de récupérer son cheval. C’était sous-estimer la bête. Il n’y parvint pas, malgré le secours de Caleb. Ovila dut se résigner à prendre le repas du midi. Emilie feignit une grande déception à l’idée qu’il serait en retard à Shawinigan, mais elle avait depuis longtemps deviné qu’il n’avait aucun rendez-vous et qu’il espérait probablement arriver à Shawinigan dans la journée du lundi, ce qui lui laissait encore une journée et demie de jeu.
Les ébats amoureux reprirent de plus belle après le repas. Ovila n’osa pas essayer de séparer les bêtes. Caleb lui en aurait voulu, il en était certain. Berthe, qui n’était restée que quelques minutes durant l’avant-midi, revint au milieu de l’après-midi, sa mère lui ayant «donné congé». Émilie et Ovila s’en réjouirent. Ils préféraient le chaperonnage de Berthe à celui des parents ou des jeunes frères et sœurs. Tous les trois, ils décidèrent de marcher en direction de nulle part. Ils partirent donc, apportant des biscuits pour collationner. Ils se dirigèrent finalement vers le bois de Caleb. Ils avaient atteint la distance désirée, celle qui les cachait de la maison, lorsque Berthe se foula malencontreusement une cheville. Ovila la souleva et l’assit sur une grosse roche. Émilie demanda à voir la cheville blessée mais Berthe refusa.
«Continuez vous autres, dit-elle en grimaçant. Moi, j’vas rester ici. Vous me reprendrez en passant.»
Émilie et Ovila s’enfoncèrent dans le bois, elle derrière lui qui prenait un soin méticuleux à empêcher les branches de la fouetter au visage. Emilie souria.il, de la facilite avec laquelle il se frayait un passage à travers les sentiers encombrés de branches et de feuillages. Ovila est vraiment un homme des bois, pensa-t-elle. Elle avait l’impression qu’il était un arbre mobile tant il s’amalgamait avec cette nature échevelée. Elle trouva irrésistible cet homme aux épaules droites comme des piquets de clôtures, aux mains puissantes, aux pommettes saillantes et au nez aquilin qui, malgré le bleu des yeux, trahissait un mystérieux apport de sang indien.
Ils marchèrent ainsi pendant une heure, presque en silence. Emilie se taisait, savourant chacun des instants de ce plaisir que, la veille encore, elle avait décidé de s’interdire. Ovila, lui, était absorbé dans ses pensées. Il entendait l’essoufflement d’Emilie et ralentissait le pas, imperceptiblement. Il ne voulait surtout pas accroître la distance qui les séparait. Il voulait continuer de l’entendre respirer, sachant qu’il rêvait une douce folie. Sachant que son émoi était certainement impossible. Il feignit de se gratter un mollet et se pinça violemment. Non, il ne rêvait pas. Emilie, la belle Emilie, l’Emilie de ses rêves, était bien derrière lui. Seuls, sous la voûte du feuillage.
Ils revinrent sur leurs pas et trouvèrent Berthe, endormie comme une couleuvre sur la pierre chaude. Emilie lui secoua une épaule. Berthe bondit sur ses pieds.
«Ta cheville a l’air guérie», constata Emilie l’air moqueur.
Berthe, feignant d’être prise en flagrant délit, s’étonna rieusement des miracles qu’une prière bien enrobée de soleil pouvait faire. Ils reprirent le chemin de la maison après avoir grignoté leur collation.
L’étalon et la jument étaient toujours dans le clos. Caleb ne semblait pas avoir mis d’efforts trop soutenus pour les ramener au bâtiment.. Berthe salua ses amis et demanda à Emilie si elle avait l’intention de travailler à la courtepointe. Émilie répondit affirmativement. Berthe promit alors de revenir dès qu’elle en aurait fini avec le bain des enfants.
Ovila avait rejoint Caleb qui trayait ses vaches.
«J’ai décidé de faire ça un peu plus à bonne heure. J’espère que les vaches seront pas choquées ou mêlées. Je me suis dit que tant qu’à avoir de la visite, j’avais beau jeu de presser un peu les affaires pour qu’on prenne le temps de se payer une bonne partie de dames. Aimes-tu ça jouer aux dames?»
Caleb venait de lancer une question bien déguisée quant à la présence d’Ovila auprès d’Émilie et aussi, Ovila crut le comprendre, quant à ses intentions.
«Ma fille t’a-tu mordu la langue?»
Deuxième perche. Décidément, ce Caleb n’abandonnait pas facilement. Ovila inspira profondément. Il avait avantage, il le comprit, à jouer franc. Il répondit que depuis l’âge de quatorze ans, il avait toujours aimé Émilie. Il avoua que le but de sa visite était de connaître ses sentiments à elle. Il raconta combien elle avait toujours été indépendante, «à sa place». Il insista enfin sur le fait qu’il avait toujours espéré qu’Émilie devienne sa «blonde», mais que jamais il n’avait su ce qu’elle pensait de lui.
Caleb avait écouté religieusement. Ce jeune avait du cœur au ventre, décida-t-il. Le père avait compris à quel point sa fille, son indépendante de mule, avait su garder son élève à distance. Mais il avait deviné que cette distance avait fondu, la veille.
«C’est pas nécessaire de m’en dire plus. Je connais ma fille. À partir d’astheure, j’vas te faire confiance. Elle, j’y fais déjà confiance. rien qu’une affaire, mon jeune. Sa. réputation. J’imagine que tu as à cœur sa réputation. Que tu viennes ici en soupirant, c’est correct. Mais que tu commences à soupirer près des fenêtres de son école, ça se fait pas. Ça fait que j’espère que tu vas te trouver une jobbe à Shawinigan ou aux Trois-Rivières. Ça serait le mieux.»
Ovila sourit et ne put s’empêcher de se pencher pour arracher la main de Caleb aux trayons de la vache. Il la serra énergiquement.
«Je te connais pas, mon gars. Mais j’ai pour mon dire que ma fille a du flair. Emilie sent le monde. J’espère juste que tu me feras jamais regretter ma confiance.»
Le soleil se languissait tranquillement pendant que quelques-uns de ses rayons s’accrochaient aux perches des clôtures. Les Bordeleau avaient insisté pour qu’Ovila reporte son départ au lendemain. Ovila avait sincèrement hésité avant d’accepter. Emilie s’était abstenue d’intervenir dans la discussion, ses jeunes frères ayant fait le travail à sa place. Ils avaient attaqué les épaules d’Ovila comme si elles avaient été de fortes branches qui ne demandaient qu’à être grimpées. Berthe arriva sur le coup des sept heures. La présence d’Ovila ne la surprit pas.
Caleb et Ovila attaquèrent vaillamment une partie de dames pendant que les deux filles dépliaient leur ouvrage. Berthe chuchota qu’elles faisaient probablement le premier morceau du trousseau d’Emilie. Emilie haussa les épaules et feignit de trouver la remarque déplacée. Berthe lui fit un sourire moqueur. Célina s’excusa et dit qu’elle allait se mettre au lit immédiatement, ce qu’elle fit dès qu’elle eut installé la couche d’Ovila.
La pluie chantonnait sur le toit. Émilie ouvrit les yeux et tira la langue en réponse aux grimaces du temps. Elle entendait Caleb presser la famille. Elle regarda l’heure.
Six heures et, demie! Elle sauta du lit. Ils auraient à se dépêcher s’ils voulaient terminer la traite et se préparer pour la messe de neuf heures. Elle descendit dans la cuisine et chercha Ovila des yeux. Son père lui dit qu’il était à l'étable. Émilie comprit qu’il devait déjà avoir attelé son étalon, que la pluie avait ramené au bercail. Elle remonta à sa chambre, se vêtit à la hâte et sortit à la pluie battante. Elle ouvrit la porte du bâtiment. L’étalon était encore dans sa stalle.
«Ovila?
— Ici!»
Ovila trayait les vaches. Émilie éclata de rire. Elle qui avait eu la certitude qu’il était sur son départ, le trouva occupé dans des fonctions quotidiennes. Il lui expliqua que levé tôt et voyant que le mauvais temps retarderait son départ, il avait pensé donner un coup de main. Émilie le remercia et lui demanda s’il assisterait à la messe avec eux. Ovila répondit qu’il le ferait si le temps ne se dégageait pas.
Deux voitures venant de chez Caleb arrivèrent à l’église. La première, conduite par Caleb, transportait la famille habituelle. La seconde, dirigée par Ovila, Émilie et Berthe. Il n’y avait pas de paroissiens attardés devant l’église, la pluie ayant quelque peu précipité leurs dévotions. Caleb dirigea sa famille à leurs deux bancs. Ovila fermait la marche derrière Berthe et Émilie. Ils ne purent ignorer les quelques murmures qui naissaient à leur passage. Les deux filles retenaient un fou rire. Caleb passa à côté d’Elzéar Veillette et le salua de la tête. Veillette se tourna pour regarder Ovila. Émilie n’avait pas besoin de comprendre les chuchotements pour savoir ce qu’ils disaient. On s’interrogeait sur la présence d’Ovila; on se demandait qui il était. Les filles devaient le trouver beau et grand. Mais ce qu’Émilie souhaitait entendre, c’est qu’elle et Ovila formaient un beau couple.
La grand’messe fut chantée avec beaucoup de cœur à défaut de voix. Emilie chuchota à l’oreille d’Ovila que c’était Isidore Bédard, le cousin de sa mère, qui était le maître chantre. Ovila s’enfonça la tête dans les épaules, faisant un air qui voulait dire à Emilie qu’il s’en excusait. Émilie sourit.
Depuis les trois ans qu’elle allait à la messe du dimanche avec Ovila, elle ne s’était jamais assise dans le même banc que lui.
Un rayon de soleil illumina le seul vitrail de l’église situé au-dessus de l’autel. Émilie et Ovila furent incapables de s’en réjouir. Ils sortirent de l’église parmi les premiers. Ovila attendit sur le perron que le cousin de sa mère descende du jubé. Il demanda à Émilie de l’identifier, certain de ne pas le reconnaître. Émilie le lui pointa discrètement. Ovila se dirigea vers lui, lui tapota l’épaule, se présenta et Isidore Bédard lui serra chaleureusement la main. Il le présenta à la ronde, ce que Caleb n’apprécia pas, ayant préféré le faire lui-même. Mais il avait d’autres préoccupations. Il tenait Elzéar Veillette à l’œil, n’attendant que le moment où ce dernier apercevrait l’étalon d’Ovila. À cause de la pluie, tous les chevaux avaient été conduits aux abris. Caleb qui, habituellement, s’attardait inconsidérément sur le perron à parler avec ses concitoyens, semblait pressé de partir. En fait, il fut le premier à aller quérir son attelage et invita Ovila à le suivre «pour pas que tu perdes de temps astheure que le soleil est revenu». Ovila lui emboîta le pas sans se douter qu’il allait être au centre d’une jolie commotion. Il suivit Caleb qui dirigea sa jument — la vieille — juste au pied des marches du balcon. Elzéar Veillette avait le dos tourné. Caleb immobilisa la voiture et invita sa famille à monter. Ovila descendit de la sienne et assista Berthe et Émilie. C’est à ce moment qu’Elzéar Veillette se tourna.
Il vit l’étalon, ouvrit la bouche et la pipe lui tomba du bec, se brisant net sur le perron. «Ha ben, baptême! » chuchota-t-il de façon à ne pas être entendu du curé qui venait de les rejoindre. Il descendit les marches et s’approcha de la bête. Il en fit le tour. Ovila et Émilie le regardaient faire sans s’en formaliser. Ce cheval faisait toujours son petit effet. Caleb, par contre, ne quittait pas Veillette des yeux, riant sous cape. Veillette, son inspection terminée, se dirigea vers lui d’un pas décidé. Il fulminait.
«C’est ça, Bordeleau, ton ch’val de labours?
— Non...c’est le ch’val de la visite. Pis laisse-moi te dire, Zéar, qu’il s’est pas fait prier pour servir la belle pouliche que tu m’as vendue. Si ça t’intéresse, Zéar, dans quelques années tu viendras me voir. On discutera d’un bon prix pour que l’étalon que la pouliche va me donner serve tes juments.
— Elle va te donner une jument, Caleb. Elle vient d’une lignée de juments. » Il regarda encore une fois l’étalon et se retourna vers Caleb. « Caleb Bordeleau, tu es un maudit ratoureux! »
Veillette, enragé, rapailla sa marmaille et disparut en un éclair.
Ovila prit une bouchée, accepta une collation puis quitta la maison de ses hôtes. Émilie l’accompagna. Ils marchèrent lentement, lui, tenant la bride du cheval, elle, se dandinant à ses côtés. Il lui promit qu’il l’attendrait à l’école, mais elle le pria de n’en rien faire. Elle le verrait lorsqu’elle ferait sa visite de politesse. Ils convinrent de ne parler à personne de leur relation, espérant que la rumeur mettrait quelque temps à franchir les quinze milles qui séparaient leurs villages respectifs. Ils se quittèrent le cœur bourrelé de contradictions. Émilie resta sur le bord de la route à le regarder tant qu’elle put le voir.
Émilie et Berthe pleuraient à chaudes larmes. Elles se regardaient, se serraient l’une contre l’autre et éclataient en de nouveaux sanglots nés des profondeurs de leur enfance. Les parents de Berthe se tenaient à l’écart, respectant leur besoin d’intimité. Le curé, venu lui aussi à la gare assister au départ de Berthe, leur tenait compagnie. Émilie s’accrochait à Berthe. Elle lui répétait qu’elle avait compris sa vocation, mais qu’elle acceptait mal que Berthe lui ait caché que c’était le cloître qui l’intéressait. Émilie avait toujours imaginé Berthe dans l’enseignement. Elle avait toujours tenu pour acquis que la vocation de Berthe serait une espèce de prolongement de ce qu’elle quittait. Elle s’en voulait de ne pas avoir demandé à son amie le nom de la communauté qu’elle avait l’intention de joindre. Berthe, carmélite! Berthe, voilée! Berthe qu’elle ne pourrait plus jamais voir. Berthe qui, aujourd’hui, se désincarnait.
Berthe tentait vainement de la consoler. La rupture lui apparut plus que cruelle. Ses parents, elle le savait, étaient fiers d’elle mais elle savait aussi qu’ils la regardaient partir avec rien d’autre que du renoncement. Elle aurait dû consacrer deux journées entières à ses adieux, mais la peur des émotions qu’ils engendraient l’avait fait repousser ce moment jusqu’à la dernière minute.
Un long sifflement, suivi d’un tintement de cloche les lit tous sursauter. Emilie s’enfouit le visage dans le creux de l’épaule de Berthe. Berthe l’étreignit une dernière fois puis la repoussa pour s’élancer dans les bras des siens. Les larmes longuement contenues étaient maintenant toutes au rendez-vous. Même le curé en écrasa une qui venait de s’échapper de son œil gauche. Toute la famille de Berthe s’agenouilla et il les bénit. Emilie resta debout mais se signa. Berthe monta sur la première marche d’un des wagons, tenant une seule petite valise. Emilie se rapprocha, lui souffla un baiser, tourna le dos et s’éloigna avant que le train ne se mette en branle. Elle l’entendit siffler à deux reprises. Elle entendit aussi la locomotive cracher sa vapeur. Elle entendit le crissement des roues sur les rails clairsemés d’herbe. Puis les sons s’éloignèrent. Elle devina l’effort des roues motrices. Elle devina aussi à quelle distance le train devait être rendu. Elle courut jusqu’à la voiture que son père lui avait prêtée, y grimpa résolument et conduisit à l’aveuglette jusqu’à l’endroit de la rive où elle et Berthe avaient passé tant d’heures de leur enfance et de leur adolescence. Son irremplaçable Berthe. Elle l’avait certes un peu négligée depuis qu’elle habitait Saint-Tite, mais Berthe n’avait jamais douté de son amitié.
Emilie se coucha sur le tronc pourri, regardant le ciel que les nuages avaient épargné pour la journée. Elle prit conscience qu’elle ne connaissait de Berthe que ce que Berthe lui avait permis de connaître. Berthe, carmélite! Emilie sanglota à nouveau. Berthe à plat ventre devant toute la communauté si elle faisait quelque chose de répréhensible. Berthe qui avait choisi de ne pas avoir d’amoureux mais qui avait offert toute sa complicité aux amours récentes d’Emilie. Berthe, carmélite! Incapable de sortir de ses quatre murs. Incapable même de visiter Montréal qu’elle allait habiter. Une sœur cachée. Une femme qui ne séduirait plus avec son sourire à fossettes. Une ourse qui a décidé d’hiberner pour le restant de ses jours.
Emilie eut mal à son âme d’enfance pendant trois longues heures. Elle reprit finalement la direction de sa maison. Caleb et Célina devinèrent son chagrin. Émilie se priva de souper et s’isola. Son besoin fut respecté. Elle bourra énergiquement ses valises, y mettant d’abord la courtepointe qu’elles n’avaient terminée que deux jours plus tôt. Elle s’y fourra le nez et chercha une goutte de sang que Berthe avait laissée en se piquant au pouce. Elle ne la trouva pas. La rentrée scolaire s’était faite sans heurts. Emilie avait retrouvé sa petite école et se l’était enfilée sur l’âme comme elle enfilait une robe confortable. Elle avait essayé de reporter au lendemain de son retour sa classique visite chez les Pronovost mais elle en avait été incapable, l’impatience lui rongeant les os jusqu’à la moelle. Ovila et elle avaient joué de discrétion. Elle s’était même étonnée de la facilité avec laquelle ils avaient tous les deux mis en veilleuse le langage de leurs yeux. Félicité était gonflée par sa maternité au-delà de toute attente. Jamais elle n’avait porté un enfant si lourd et si encombrant. Elle accusait son âge de rendre la chose si difficile.
Émilie, comme à chaque année, avait accueilli ses nouveaux élèves avec empressement, convaincue que la première journée d’école était déterminante. Charlotte était revenue. Émilie lui trouva les traits tirés.
Le mois de septembre venait à peine de prendre son élan. Les élèves avaient quitté l’école un peu plus tôt, permission accordée en raison du temps magnifique. Émilie s’affairait à corriger les travaux rédigés en classe quand Ovila arriva, à bout de souffle. Il entra dans l’école en coup de vent, fit des yeux le tour de la classe pour s’assurer qu’Émilie était seule. Il s’avança alors vers elle sans dire un mot, lui prit la main et l’obligea à monter dans sa chambre. Émilie fronça les sourcils. Elle n’aimait pas cela. Si une personne, une seule personne, choisissait ce moment pour venir la visiter, elle en serait quitte pour refaire ses valises. Prenant les devants, elle monta à la hâte, se retourna uniquement quand elle fut rendue en haut, prête à faire des reproches à Ovila quand elle remarqua son visage défait.
«Qu’est-ce qui se passe?» parvint-elle à chuchoter devant le chagrin évident d’Ovila.
«C’est ma mère, Émilie. Mon père a demandé à Edmond d’aller chercher le docteur parce que la sage-femme vient pas à bout de sortir le bébé. Ma mère est tellement faible qu’on a peur que le cœur flanche. » Il n’en dit pas davantage, craignant de noyer ses paroles.
Émilie figea puis, se ressaisissant, se dirigea vers chacune des fenêtres afin de s’assurer qu’il n’y avait personne en vue. Elle revint vers Ovila, l’invita à s’asseoir sur le lit, lui prit doucement la tête qu’elle déposa sur sa poitrine.
Ovila ne resta à l’école que le temps d’étouffer une peine qui lui pesait au cœur. Émilie avait réussi à le calmer, le rassurant comme elle le put. Sa mère donnait naissance à son treizième enfant. Son corps y était habitué. Il ne devait pas s’inquiéter. Ovila s’en retourna le cœur allégé. Émilie, il le comprit, lui faisait le même effet que la potion que le médecin donnait à son frère Ovide pour calmer ses accès de toux. Émilie, elle, calmait ses accès de peur et de chagrin. Dosithée avait appris la grossesse de sa femme pendant qu’il était au lac Pierre-Paul. Il s’était promis de lui faire la surprise de mettre en chantier une maison plus grande. L’annonce de l’arrivée inopinée de ce nouvel enfant et la maladie d’Ovide qui s’était déclarée moins de deux mois plus tard l’avaient raffermi dans cette décision. Lorsqu’il était rentré du chantier et qu’il avait vu ses filles contraintes de dormir dans le salon, il s’était empressé, à l’insu de sa femme, d’aller discuter avec le père Mercure de l’achat d’une partie de sa terre. Le père Mercure avait durement négocié cette vente, sachant qu’il vendait afin de pouvoir vivre ses vieux jours au village, chez une de ses filles. Sa femme ne lui ayant pas donné de fils, il s’était retrouvé seul à la mort de cette dernière. Il avait déjà vendu quelques arpents à Dosithée, mais il avait nourri l’espoir, bien utopique, que ses petits-fils vieilliraient plus rapidement que lui-même. Il avait atteint l’âge où un homme cédait ses biens à ses héritiers alors que l’aîné de ses petits-fils n’avait que dix ans. Résigné, il avait cédé à Dosithée. Il l’avait fait sans remords, sachant que sa terre serait bien entretenue par les fils Pronovost.
L’acte de vente avait été dûment notarié. Le père Mercure avait cédé ses terres «d’en haut» à Dosithée et celles «d’en bas» à un autre acheteur qui voulait sa maison et les bâtiments. Dosithée avait amené Edmond avec lui, comme témoin, en lui faisant jurer de ne pas parler de la transaction à sa mère. En cachette, il avait fait porter les matériaux là où il avait l’intention de construire la maison. Ses fils, maintenant tous au courant de l’affaire, venaient, mine de rien, l’aider à monter la charpente quand le temps n’était pas assez clément pour travailler aux champs. Félicité, à qui il était habituellement impossible de cacher quoi que ce soit, n’avait rien vu. Sa grossesse difficile, la maladie d’Ovide et quatre arpents dont deux semi-boisés, lui avaient ménagé la surprise. Ne sortant plus de la maison, pas même pour assister à la messe, elle n’avait jamais vu le chantier. Dosithée, convaincu que cet enfant serait leur dernier — comme il l’avait d’ailleurs été à la naissance de Télesphore avait décidé d’offrir à sa femme la maison qu’elle avait toujours souhaitée mais qu’elle n’avait jamais osé demander. Une maison avec une grande cuisine, un salon et deux chambres à coucher au rez-de-chaussée et quatre chambres à l’étage, sans parler d’un immense placard de cèdre. Dans leur présente maison, c’est ce placard que Félicité avait sacrifié pour y installer Ovide et permettre aux filles de retourner dans leur chambre. Maintenant, Dosithée en convenait, la famille était trop à l’étroit. La nouvelle maison, il le savait, ne serait pas prête avant l’été suivant, ce qui donnerait à Félicité le temps de préparer le déménagement.
Félicité n’avait encore rien appris lorsqu’elle ressentit, en pleine nuit, les premières douleurs de l’accouchement. Elle attendit le matin avant d’avertir la sage-femme. Cette dernière était arrivée aussitôt prévenue. Félicité était dans sa chambre et s’étonnait du mal qu’elle ressentait. Ce mal était le plus aigu qu’elle eut enduré depuis ses trois premiers accouchements. Elle avait perdu trois enfants avant la naissance d’Ovide. Ces enfants morts-nés l’avaient inquiétée sérieusement quant à son avenir de mère. Dosithée l’avait encouragée, blâmant, sa petite taille pour tous les problèmes. L’arrivée d'Ovide avait réconcilié sa mère avec la vie, à tel point qu’elle avait par la suite donné naissance à un enfant chaque année ou presque.
La sage-femme venait de l’examiner. Félicité avait remarqué son froncement de sourcils.
«J’aime autant être bien franche avec vous, madame Pronovost, mais à moins que je me trompe, il y a quelque chose de pas correct. Le bébé m’a l’air trop haut pis le passage m’a l’air prêt. On va attendre un peu pour voir. »
Félicité prit son mal en patience. La sage-femme l’examina à nouveau et fronça encore les sourcils. Dosithée la demanda, trouvant anormal le temps que sa femme mettait à accoucher. La sage-femme lui expliqua que le bébé arrivait par les pieds. Qu’elle n’aimait pas du tout l’allure que prenait l’accouchement. Dosithée lui demanda de faire tout ce qu’elle pouvait.
De retour au chevet de Félicité, la sage-femme lui demanda de se coucher sur le ventre, épaules bien calées dans l’oreiller, tête tournée sur le côté, et de se tenir sur les genoux pliés, fesses en l’air. Connaissant toute l’expérience de la sage-femme, Félicité avait obéi, tenant quand même à préciser qu’elle n’avait jamais accouché dans cette position. La sage-femme lui expliqua qu’on lui avait déjà dit que si le bébé ne voulait pas se tourner, il fallait tourner la mère. Félicité, aux limites, de l’endurance, était demeurée dans son inconfortable position jusqu’à ce qu’elle sente glisser le bébé et en avise la sage-femme. Cette dernière avait soupiré et avait aidé Félicité à se recoucher sur le dos.
«Je dirais qu’astheure le p’tit va se montrer le pignon de la tête. »
Mais il n’en fut rien. Félicité demanda de l’eau tant elle transpirait. La sage-femme lui en donna. Dosithée frappa encore à la porte. Il s'inquiétait. Il demanda discrètement s’il devait aller chercher le médecin. La sage-femme lui répondit que oui. Dosithée demanda à Edmond d’aller le chercher. Ovila sortit pour aller voir Émilie et chercher réconfort. Il avait les oreilles emplies des halètements et des gémissements que la porte bien close ne réussissait pas à assourdir.
Le médecin était venu aussitôt que possible. Il assistait une autre femme quand Edmond l’avait rejoint. Dès qu’il avait pu se libérer, il était arrivé chez Dosithée et était entré à la hâte. Il avait discrètement interrogé la sage- femme, avec laquelle il était habitué de travailler.
«Le cordon, docteur. Au moins trois tours. Moi, j’ai réussi à en défaire juste un.»
Le médecin demanda à Félicité de patienter un peu, le temps qu’il l’examine. Félicité avait répondu faiblement qu’elle n’avait plus grand choix. Elle demanda l’heure. Le médecin sortit sa montre et lui dit qu’il était huit heures. Elle compta mentalement que le travail était commencé depuis vingt et une heures. Elle savait qu’un bébé n’avait pas autant de patience. Le médecin avait enlevé son veston et retroussé encore une fois ses manches de chemise blanche tachée du sang de sa dernière patiente. Il regarda la sage-femme en hochant la tête. Cette dernière lui indiqua la porte du menton. Il fit un signe d’assentiment. Il se leva, tapota la joue de Félicité pour l’encourager et lui dit qu’il la quittait pour quelques instants, le temps de prendre un bon verre d’eau. Il sortit de la chambre et se dirigea vers Dosithée.
«Monsieur Pronovost, est-ce que je pourrais vous parler? »
Ce dernier, agenouillé, la tête baissée, en prière, avait sursauté, s’était levé et avait invité le médecin à le suivre au salon. Le médecin expliqua au père déjà grisonnant que le mère souffrait terriblement, que son pouls était très bas et qu’il entendait à peine le battement du cœur du bébé. Il lui faudrait des forceps. Dosithée ne savait pas ce qu’étaient des forceps. Le médecin le lui expliqua, précisa qu’il ne les avait encore jamais utilisés, mais qu’aujourd’hui, il ne croyait plus avoir de choix. Se raclant la gorge, il demanda à Dosithée s’il devait essayer de sauver la mère ou l’enfant. Dosithée blêmit. Il avait déjà entendu raconter de ces histoires où un homme devait devenir Dieu et décider de la mort d’une personne. Il savait que l’Eglise demandait de sauver l’enfant. Il pleura, dos tourné.
«Sauvez ma femme, docteur.»
Le médecin n’avait pas réagi. Il s’était attendu à une autre réponse mais il comprenait Dosithée. Trop d’enfants, dans cette famille, avaient encore besoin de leur mère. Il mit la main sur l’épaule de Dosithée. Dosithée s’était affaissé dans une des chaises du salon, et avait prié Edmond d’aller chercher le curé. Edmond était parti à vive allure.
Le médecin était à nouveau au chevet de sa patiente. Il demanda à la sage-femme de tenir la tête de Félicité et de lui donner un peu d’alcool. Il espérait, ainsi, l’empêcher de voir les forceps qu’il s’apprêtait à sortit de sa trousse. Félicité eut vaguement conscience qu’elle buvait. Elle voulait en finir. Le médecin demanda ensuite à la sage- femme de l’aider à installer Félicité au pied du lit. Félicité n’offrit aucune résistance. Elle ne sentit même pas qu’elle avait deux oreillers sous les reins et que ses jambes ballottaient au pied du lit. Le médecin avait approché une chaise et une lampe. Il s’était signé avant d’introduire les forceps. La sage-femme avait aussi fait le signe de croix, impressionnée par ces «pinces à glaces» médicales. Félicité poussa un hurlement, ranimée par le feu que le médecin venait de lui entrer dans le ventre. Dosithée décida qu’il était temps qu’il soit aux côtés de sa femme et entra dans la chambre. Les enfants pleuraient, impressionnés par le cri qu’ils venaient d’entendre.
Dosithée s’agenouilla à côté du lit et prit la frêle main de Félicité dans les siennes. Le médecin, nerveux, avait retiré les forceps et décidé de donner une injection de morphine à la mère maintenant presque inanimée. Il n’aimait pas cette drogue, convaincu qu’une femme devait enfanter dans la douleur comme le disaient les Ecritures, mais il venait d’atteindre les limites de ses croyances. Il attendit que le médicament fasse effet puis réintroduisit les forceps, regardant leur lente progression à l’intérieur d’une chair blanchie d’avoir été étirée. Il avait repéré la tête du bébé et la tenait doucement mais fermement. Il priait tant il craignait de lui crever un œil ou de perforer la fontanelle. Il eut l’impression d’avoir suffisamment de prise et commença prudemment à tirer l’enfant . Il demanda à la sage-femme d’appuyer sur le ventre à toutes les trente secondes de façon à aider le bébé. Félicité n’avait plus de contractions. Dès que la sage-femme exerçait une pression, le médecin tirait l’enfant à lui. L’enfant mit vingt minutes à sortir de sa prison. Le médecin tenta, aussitôt qu’il le put, de dégager le cordon. A son grand étonnement, le bébé bougea et émit presque un son. Félicité ouvrit un œil puis le referma.
Dosithée observait maintenant le médecin de très près, étonné lui aussi que l’enfant fût vivant après s’être fait tirer avec des pinces. Le médecin dégagea complètement l’enfant, coupa le cordon à toute vitesse et frappa le nouveau-né sans hésitation. L’enfant, visiblement, ne pouvait respirer. Le médecin lui pinça les talons, lui tapa les fesses et le dos. L’enfant ne respirait toujours pas. Félicité, heureusement, n’avait plus conscience de ce qui se passait.
Le curé venait, d'arriver. Il frappa à la porte de la chambre et entra sans attendre de réponse. Il comprit la scène d’un coup d’œil, enfila son étole sans prendre le temps de la baiser et se dirigea vers le lit. Pendant que le médecin s’acharnait encore à faire respirer le bébé, le curé aspergea la petite chose violacée et inerte. Dans son énervement, il utilisa beaucoup trop d’eau. Le bébé réagit à cette douche froide et s’agita. Le médecin s’empressa de le poser sur une commode. Le bébé gémit doucement puis poussa un cri. Le médecin crut que le cœur allait lui sortir de la poitrine tant il était excité à l’idée d’avoir sauvé et la mère et l’enfant. Après son cri, le bébé retomba dans un état de totale inanition. Le médecin recommença à lui pincer les talons. Le bébé murmura mais ne cria plus.
Cependant, le curé administrait les derniers sacrements à la mère dont le teint cireux lui faisait craindre le pire. Le médecin n’avait pas encore eu le temps de s’occuper d’elle tant il était affairé avec le nouveau-né. Il le confia à la sage-femme et revint vers Félicité. Le curé s’éloigna pour lui dégager les abords du lit. Dosithée priait en silence, les yeux grands ouverts, craignant que la mort ne figeât les traits de sa femme. Il entendit de vagues gargouillis mais ne tourna pas la tête pour voir l’enfant. Il aurait bien le temps de le regarder.
Félicité n’avait pas repris conscience et n’avait pas expulsé le placenta. Le médecin fit un rapide examen et comprit qu’il était collé. Le curé avait quitté la chambre pour prier avec les enfants. Le médecin regarda Dosithée et soupira. Il tenterait l’impossible pour la sauver mais il avait rarement vu des mères survivre à tant de problèmes. Dosithée l’encouragea. Le médecin tenta une première fois d’extraire le placenta. Rien ne vint. Il prit le pouls de la mère et décida de la laisser reposer quelques minutes et de voir comment était le bébé. D’un signe de tête, la sage- femme lui fit comprendre qu’il n’y avait plus de bébé. Il revint, vers Felicité, suivi de la sage-femme qui avait couvert le petit corps sans vie.
«Vous allez pousser comme tantôt. Avec de la chance, ça, va sortir.»
À eux deux, ils réussirent. Ils tremblèrent d’épuisement et de tension. Dosithée, plus mort que vif, n’avait pas eu l’énergie d’avoir peur.
16.
Émilie s’était assise à la fenêtre, curieuse et inquiète. File vit accourir le médecin. Puis elle fut témoin du départ d’Edmond. Sa poitrine se serra quand elle l’aperçut revenir avec le curé.
La nuit cacha à Émilie les détails du drame qui se jouait chez les Pronovost. Elle distingua des silhouettes qui sortaient de la maison. Elle crut reconnaître la sage-femme. Puis le curé, en compagnie de Dosithée. Depuis combien de temps était-elle là à essayer de comprendre une histoire que personne ne pouvait lui raconter? Elle regarda l’heure. Minuit. Elle demeura rivée à sa fenêtre pendant encore quelques heures. Tant pis pour la fatigue du lendemain, les enfants n’auraient qu’à rester calmes. Après tout, le vendredi n’était pas une journée trop longue.
À trois heures, elle décida d’abandonner son poste d’observation et de dormir un peu. Elle n’avait pas encore vu sortir le médecin mais c’était probablement parce qu’il avait décidé de passer la nuit au chevet de la mère. C’était peut-être aussi qu’il voulait veiller sur l’enfant. Émilie eut peur. La visite du curé l’avait terrorisée. Qu’est-ce qui n’allait pas? Qui est-ce qui n’allait pas? La mère? L’enfant? Les deux? Elle se refusa à penser que quelque chose aurait pu tourner au malheur. Non! Madame Pronovost, quoique petite, était une femme solide. Une femme en santé. Rien de malheureux ne pouvait arriver à madame Pronovost. Si une femme comme madame Pronovost ne pouvait accoucher sans problèmes, alors aucune femme ne pouvait accoucher.
Émilie se dévêtit en pleurant, se glissa sous ses couvertures comme une somnambule et se frotta les pieds l’un contre l’autre comme elle le faisait toujours lorsqu’elle avait mal. Ce soir, elle avait mal à son corps qui lui criait qu’elle aussi était une femme qui aurait des nuits à vivre dans le déchirement de ses entrailles. Elle avait mal à son cœur d’aimante qui battait au rythme de l’angoisse qu’elle soupçonnait dans le cœur d’Ovila. Elle avait mal à son âme de petite fille apeurée de ce qu’elle pourrait apprendre au matin. Berthe...j’ai encore mal...Ses pieds s’agitèrent frénétiquement pendant quelque temps puis se calmèrent. Ses sanglots se muèrent lentement en un souffle saccadé qui caractérisa les quelques heures de sommeil qu’elle put s’accorder.
À l’aube, elle s’éveilla en sursaut. Elle courut à la fenêtre. La voiture du médecin était partie. La maison semblait calme. Trop calme, pensa-t-elle. Un calme de mort, qu’elle refusa d’envisager. Elle retourna s’étendre, prit le temps de prier comme elle ne l’avait pas fait depuis longtemps, appelant Berthe à son secours. Elle pria dans une espèce de demi-sommeil, mêlant les mots de sa prière à ceux de ses rêves. Elle s’éveilla enfin, les yeux bouffis de larmes et de veille. Elle s’aspergea le visage d’eau glacée, se vêtit rapidement et descendit chauffer l’eau de son thé. Elle décida de corriger les dernières copies de devoirs qu’elle avait mises de côté la veille à l’arrivée d’Ovila.
Elle n’avait pas réussi à corriger une seule copie, le nez trop souvent rivé à la fenêtre, lorsqu’elle vit Ovila se diriger vers l’école. Elle comprit, à sa démarche, qu’il avait les épaules lourdes d’affliction. Elle sortit de l’école et marcha lentement a sa rencontre. Il la vit mais n’accéléra pas le pas. Us marchèrent suivant tous deux une même cadence, soulevant les épaules ensemble, avançant un pied, puis l’autre, mus par une même mécanique. Emilie eut l’impression qu’ils n’arriveraient jamais à se rejoindre tant ils marchaient lentement. Elle aurait voulu courir mais les yeux et le dodelinement de la tête d’Ovila semblaient l’exhorter au calme. Ils se rencontrèrent enfin à mi-chemin de l’école et de la maison des Pronovost. Ils s’immobilisèrent, tous les deux prisonniers d’un long et insupportable face à face. Les yeux d’Émilie questionnaient ceux d’Ovila. Les yeux d’Ovila taisaient ce qu’Émilie y cherchait. Elle trouva enfin la force de parler.
«Veux-tu prendre un thé à l’école?
— Non, j’aimerais mieux qu’on marche dans la Montée. »
Émilie hésita, puis se rappela qu’elle s’était levée assez tôt. Elle disposait de quelques minutes. Ils marchèrent côte à côte jusqu’au haut de la colline, là où le chemin faisait un virage et leur cachait enfin la vue de l’école et des maisons voisines. Ovila s’arrêta net, prit Émilie par le bras, l’obligeant à s’immobiliser. Il l’attira vers lui puis, l’enserrant dans des bras soudainement faibles, il éclata en sanglots. Émilie frémit. Elle s’abstint de l’interroger, trop craintive à la perspective des réponses qu’elle pouvait obtenir. Le malheur d’Ovila la toucherait bien assez vite. Il resta accroché à ses épaules pendant un interminable moment, puis après s’être dégagé, il se moucha violemment avant de dire à Émilie que sa mère avait reçu les derniers sacrements et que le curé avait baptisé le bébé de justesse avant qu’il n’expire.
«Marie-Anne, Émilie. Une grosse fille qui a vécu un peu moins de dix minutes. Toute une vie hein...»
Il se tut, ayant l’impression d’avoir tout dit. Émilie osa enfin demander comment se portait la mère.
«Le docteur est parti de bonne heure à matin. Si môman passe la journée, elle sera probablement correcte.»
I1 interrompit sa phrase et sa pensée. Emilie avait compris. Une longue journée en perspective. Elle lui serra la main, s’excusa de devoir le bousculer mais lui expliqua qu’il était temps qu’elle retourne à l’école. Ovila se retourna, furieux.
«Ma mère agonise pis tu trouves rien de mieux à me dire que tu dois aller travailler? Bonyeu, t’as-tu une roche à place du cœur? Tu pourrais pas rester avec moi quand j’ai besoin que tu restes?»
Déchirée, Emilie tourna les talons et s’enfuit à la course. Ovila n’eut même pas le temps de l’arrêter. Elle l’entendit lui demander de l’attendre mais elle n’en fit rien.
«Tu es pas une femme, Emilie, tu es un cerveau sans cœur! »
La journée fut longue et triste. Aucun des enfants Pronovost ne s’était présenté en classe. Elle permit à ses élèves de quitter tôt. Elle ne tenait plus debout, drainée par son manque de sommeil et par sa peine. Elle rangea la classe méticuleusement, préférant nettement occuper ses mains plutôt que de permettre à son esprit de divaguer. Elle attendait Ovila, certaine qu’il avait vu les enfants quitter l’école. Il ne vint pas. Son absence lui fit craindre le pire.
Emilie trompa son attente jusqu’au coucher du soleil. N’y tenant plus, elle décida d’aller s’informer. Elle sortit de l’école et marcha résolument en direction de la maison des Pronovost. Mais elle s’arrêta. Et si elle arrivait pendant que la mère rendait son dernier souffle? Elle décida de frapper à la porte des Joseph-Denis. Ils devaient sûrement être au courant.
La mère de Joseph, madame Virginie, lui ouvrit, un tablier bleu épinglé sur son tablier blanc. En d’autres circonstances, Emilie aurait souri à cette manie qu’elle avait de protéger son tablier propre par un tablier sale. La mère Virginie l’invita à entrer et à s’asseoir. Emilie accepta en jetant un coup d’œil circulaire dans la cuisine. Elle n’était jamais entrée dans cette maison, mais elle avait entendu dire qu’elle était tenue de façon impeccable. Elle fut impressionnée par les lieux, et oublia même pour quelques instants l’objet de sa visite. Pas un grain de poussière. Pas une petite motte de boue à l’entrée de la porte arrière. Un plancher ciré comme un plancher de salon. Une table recouverte d’une nappe repassée et empesée. Elle coupa court à ses réflexions quand madame Pronovost lui demanda si elle avait eu les dernières nouvelles. Émilie lui avoua qu’elle n’en avait eu aucune depuis le matin. Elle s’arrêta quelques secondes, le temps de voir si elle avait sonné une alerte en disant qu’elle avait eu des nouvelles le matin. Ne discernant aucune réaction, elle demanda s’il y avait eu des développements. La mère Virginie lui sourit et lui annonça que sa belle-sœur se portait bien, compte tenu des circonstances évidemment, qu’elle avait mangé le midi et le soir et qu’il semblait bien que l’extrême-onction avait, encore une fois, fait des miracles. Émilie ferma les paupières et soupira. Un long soupir de soulagement. Elle se leva enfin, légère, ranimée, les remercia tous, les complimenta sur la maison et reprit le chemin de l’école.
Elle s’assit longtemps dans sa berceuse et attendit l’arrivée d’Ovila. Il devait probalement être retenu par ses corvées. Elle commença à s’inquiéter quand le soleil fut couché depuis assez longtemps pour avoir endormi les animaux. Elle alluma ses lampes et attendit encore. Elle attendit jusqu’à ce qu’elle vît s’éteindre toutes les lumières chez les Pronovost, sauf celles d’un bâtiment.
Les nuages voilèrent le soleil, jetant une ombre sur les visages déjà gris de Dosithée et de ses enfants. Plusieurs personnes avaient assisté à la cérémonie des Anges. On mettait en terre le petit cercueil blanc qu’Ovila avait fabriqué pendant la journée du vendredi et la nuit qui avait suivi. Félicité étant alitée, le curé avait proposé que le bébé ne soit exposé que le matin du samedi et enterré l’après-midi même. Émilie n’avait pas été avisée. Elle n’assista donc pas à l’enterrement, pensant qu’il aurait lieu le lundi.
Elle était au village à faire ses courses quand elle vit le corbillard revenir du cimetière. Elle vit ensuite la famille Pronovost retourner au Bourdais. Elle demeura figée à la fenêtre de la vitrine du magasin général, d’abord étonnée en comprenant la situation, puis chagrinée qu’Ovila n’ait pas eu besoin de sa présence, aussi discrète fût-elle.
17.
Un mois de novembre rempli de froidure avait succédé à un trompeur octobre qui avait fait croire que l’été pouvait ne pas avoir de fin. Madame Pronovost s’était remise de ses pénibles couches à la surprise non avouée du médecin et de la sage-femme. Elle avait accompagné son mari au cimetière visiter cet enfant qu’elle n’avait jamais vu. Marie- Anne dormait paisiblement à côté de ses trois frères. Félicité avait serré le bras de son mari en lui disant combien elle regrettait qu’ils aient eu à enterrer les trois premiers et le dernier de leurs enfants. Dosithée avait répondu qu’il n’avait jamais compris les intentions du Créateur, mais qu’il Lui était reconnaissant de lui avoir permis, à elle, de demeurer parmi eux. Il n’avait jamais raconté à Félicité tous les détails de l’accouchement, se contentant de lui expliquer que le médecin avait utilisé des pinces pour aller chercher le bébé et que le bébé, s’il avait pu, aurait survécu sans problèmes. Le médecin lui avait certifié que le bébé était mort de ne jamais avoir su respirer seul. Ce n’étaient pas les forceps qui l’avaient tué.
Dosithée avait voulu effacer de sa mémoire le dilemme posé par le médecin. Il ne l’avait jamais avoué à sa femme.
Il avait tenté de chasser, à grands coups de pipées et de réflexions, le son des gargouillis de l’enfant cherchant son souffle. Il avait essayé d’oublier qu’il ne s’était pas levé pour aller- le voir, croyant l'enfant en vie et en forme. Lui non plus n’avait jamais vu l’enfant de son vivant. Il le regrettait amèrement, troublé à l’idée qu’il aurait peut-être pu faire quelque chose, ne fût-ce que lui donner la bénédiction paternelle comme il l’avait fait pour ses trois premiers fils.
Félicité et lui avaient quitté le cimetière, chacun s’appuyant sur le bras de l’autre, jetant un dernier coup d’œil au minuscule renflement de terre qui protégeait Marie-Anne du froid et de la vie. En revenant à la maison, Dosithée s’était enfin décidé à parler de l’achat de la terre du père Mercure. Depuis l’accouchement, il n’avait pas voulu ajouter un seul clou à la structure de la nouvelle maison. Il avait conduit sa femme devant l’ossature décharnée et elle était demeurée impassible. Dosithée lui dit qu’il la terminerait dès qu’il le pourrait. Félicité s’était contentée de hocher la tête. Elle n’en croyait pas un mot. Dosithée non plus. Il avait fait son deuil de cette maison. La charpente tenait, solidement arrimée à la terre. Les murs du premier étage étaient complètement montés. Félicité pouvait deviner la porte principale, la porte latérale et les fenêtres. Tout s’était arrêté au plancher de l’étage, que le vent et la pluie avaient à plusieurs reprises balayé et nettoyé de toute sciure. Félicité, suivie de Dosithée, avait quand même fait le tour de la maison. Elle lui avait finalement souri et l’avait remercié d’avoir pensé à elle. Dosithée s’était contenté d’émettre un grognement.
Félicité n’avait plus reparlé de la maison, si ce n’est pour taquiner ses fils d’avoir si bien gardé le secret. Ces derniers, encore ébranlés par la peur qu’ils avaient eue de perdre leur mère et l’émoi qu’ils avaient ressenti d’enterrer une sœur, n’avaient pas commenté.
Le mois de décembre, malgré les réjouissances promises, n’avait pas réussi à faire pénétrer de rires dans les maisons du Bourdais. Emilie, assise dans sa chambre, surveillait, la cuisson <le créions qu'elle s’était presque obligée a faire mijoter. Kilt; n’avait envie de rien. Depuis la journée de l’enterrement, elle n’avait plus revu Ovila. Elle avait su, au hasard des conversations de ses frères, qu’il a vait quitté le village pour aller travailler à Shawinigan ou a quelque part dans ce bout-là». Elle avait attendu quelques semaines avant de visiter madame Pronovost et s’était réjouie de voir qu’elle se portait bien. Félicité lui avait confirmé le départ d’Ovila.
Émilie allait souvent à la poste, espérant toujours recevoir des nouvelles d’Ovila. Son espoir fut vain. Elle comprit qu’il ne lui avait probablement pas pardonné le fait qu’elle l’ait laissé à sa solitude ce fameux matin... Elle regrettait son entêtement à rentrer à l’école, mais elle savait aussi qu’elle n’avait pas eu de véritable choix. Depuis, elle avait passé de nombreuses soirées à s’essuyer les yeux, secouée par une peine qu’elle voulait sans fondements réels. Il aurait été si simple qu’elle et Ovila puissent reparler de cette journée. Ovila n’avait pas semblé du même avis. Elle écrivit à Berthe et lui raconta tous les malheurs qui avaient frappé la famille Pronovost. Elle avait terminé sa lettre en disant «qu’un de leurs fils, Ovila, avait tellement été ébranlé qu’il avait quitté le village sans en aviser personne». Elle était certaine que Berthe comprendrait. Elle n’avait pu relater dans les détails la scène qu’ils avaient eue, se contentant de dire que ce même fils, son ancien élève, était venu la voir pour chercher «réconfort et bonne parole» et lui demander de prier. Ne sachant trop comment décrire son attitude à elle, elle s’était contentée d’écrire qu’elle «n’avait pu lui accorder toute l’attention désirée, étant donné qu’elle devait être en classe pour l’arrivée des enfants».
Berthe avait compris le message d’Émilie et lui avait écrit une longue lettre pour la consoler. Elle avait fait allusion à l’«enfant prodigue» en termes tellement discrets qu’Émilie dut relire la lettre à plusieurs reprises pour comprendre que Berthe lui disait qu’il reviendrait sûrement et qu’ils pourraient tous les deux s’expliquer. Berthe, dans son silence, avait entendu les cris du cœur d’Emilie.
Emilie était allée dans sa famille pour le temps des Fêtes. Exceptionnellement, elle n’avait montré aucune envie de rentrer à Saint-Tite. Elle avait commencé l’année 1899 sans prendre conscience qu’elle était témoin de la fin d’un siècle. L’hiver avait encore une fois cédé le pas au printemps et Emilie avait espéré qu’Ovila revienne du chantier. Il ne revint pas. Elle avait centré toutes ses énergies sur son enseignement, préparant ses élèves à une fin d’année sans heurts pour la visite de l’inspecteur. Fidèle à ses habitudes, ce dernier était venu, poussiéreux, par une journée chaude et humide de juin. Il s’était efforcé d’arriver plus tôt de façon à pouvoir passer l’après-midi entier dans la classe d’Emilie. Elle avait compris qu’il en serait toujours ainsi et n’avait pas abandonné sa coquette gentillesse.
Le soleil tapait aussi dru que possible quand il était arrivé. Henri Douville avait commencé sa visite comme il le faisait toujours, soit en lisant tous les cahiers qu’Emilie mettait à sa disposition. Elle n’avait plus oublié de préparer un plan de la classe. Elle s’était même permis d’indiquer lesquels de ses élèves excellaient dans les différentes matières. Elle avait compris que l’inspecteur Douville ne tenait pas particulièrement à interroger les élèves qui connaissaient des difficultés. Henri Douville faisait son travail honnêtement. Il détestait ses pairs qui jugeaient trop sévèrement une institutrice en interrogeant les élèves au hasard. Henri Douville, lui, avait un jour décidé que l’école était faite pour apprendre et il connaissait les difficultés éprouvées par les enfants qui voulaient y être de façon assidue. Les parents, selon lui, ne les encourageaient pas suffisamment, n’ayant pas compris ce que lui, Douville, avait compris. L’instruction deviendrait une nécessité. A preuve, les frêres Saint -Gabriel avaient entrepris depuis quelques mois la construction d’un collège à Saint-Tite mêne. Henri Douville avait eu le privilège d’étudier dans un collège et il espérait que quelques-uns des élèves assis devant lui voudraient en faire autant. Aussi se gardait-il de décourager la moindre ambition.
Comme à chaque année, les élèves d’Émilie avait fort bien passé l’examen. Cette institutrice méritait vraiment beaucoup d’éloges et il ne se gênait pas pour la complimenter. Il aurait trouvé déplacé de lui dire qu’il aimait toujours la rencontrer. En revanche, il trouvait correct de le lui faire savoir par des attentions toutes particulières. Il l’avait chaudement recommandée à chaque année pour qu’elle obtienne la prime d’enseignement, mais sa candidature n’avait jamais été retenue.
Les enfants avaient quitté l’école depuis une quinzaine de minutes lorsqu’un orage éclata. Douville fut forcé d’attendre que le tonnerre se taise et que la pluie se calme. Émilie avait souri au «malheur» du pauvre inspecteur, l’avait candidement invité à partager son repas, ce qu’il avait accepté avec empressement. Émilie avait donc préparé une salade qu’elle avait servie avec des tranches de rôti de bœuf froid. Ils s’étaient installés dans ses locaux et Émilie s’apprêtait à afficher son air intéressé lorsque Douville lui demanda si elle avait déjà voyagé.
«De quel genre de voyage parlez-vous?»
Douville lui dit qu’il parlait de voyages importants, aux États-Unis ou même en Europe. Émilie durcit son regard. Douville la connaissait depuis près de cinq ans et il savait bien qu’elle n’avait franchi que la route reliant Saint-Tite à Saint-Stanislas avec, il était vrai, une courte excursion à Trois-Rivières pour ses examens du gouvernement.
«Vous savez ben, monsieur l’inspecteur, que j’ai jamais voyagé.»
Douville mastiqua lentement. Il avait demandé une serviette de table à Émilie et l’utilisait après chacune de ses bouchées. Émilie le regardait faire, consciente tout à coup qu’il avait de belles manières. Elle l’imita. Douville la complimenta sur le repas. Il lui dit ensuite qu’il avait plutôt voulu lui demander si les voyages l’intéressaient. Émilie s’illumina. Les voyages l’attiraient énormément. Elle aimerait bien voir du pays, en commençant par Montréal et Québec. Ensuite, elle parla du cousin de son père qui était parti pour le Klondike et d’un autre qui habitait à Keene, au New Hampshire, où, depuis 1892, il travaillait dans une usine de textile. L’inspecteur l’écoutait attentivement. Elle ajouta que si elle ne se mariait pas, elle mettrait de côté tout l’argent qu’elle pourrait afin de prendre un jour un grand bateau à New York et traverser l’Atlantique jusqu’en Europe. L’inspecteur était encore plus attentif.
«Pourquoi est-ce que vous me demandez ça?» dit-elle enfin.
Douville s’était levé de table et était allé à la fenêtre regarder la pluie qui tombait encore, tout en se curant les dents discrètement. Émilie avait ramassé les assiettes et commencé à les laver. Elle ne savait plus trop comment occuper ce visiteur dont la présence l’intimidait. Malgré de grands efforts, elle ne cessait d’entrechoquer les assiettes dans le plat à vaisselle.
Douville se rassit, non sans avoir jeté son cure-dents aux ordures. Émilie lui jeta un rapide coup d’œil et pensa que, sans son strabisme, il aurait été un fort bel homme. De profil, ses yeux ne se remarquaient pas. Elle l’examina une seconde fois. Ses cheveux étaient gris, certes, mais il avait les épaules solides quoiqu’un peu voûtées. Douville la laissa terminer la vaisselle seule, Émilie ayant refusé son aide.
La pluie tombait toujours a pleines fenêtres. La noirceur avait envahi l’ecole non pas tant à cause de l’heure — on approchait du solstice — mais à cause de la densité de l'écran d’eau et de nuages. Émilie enleva son tablier et revint s’asseoir à la table. Douville la regarda attentivement. Le silence se glissa entre eux. Émilie offrit de faire du thé. Douville la remercia en lui rappelant qu’il n’aimait pas boire de thé en été. Elle avait oublié ce détail.
Émilie se leva, le pria de l’excuser et descendit dans la classe. Elle marcha jusqu’à la salle de toilette. Elle y avait installé un miroir et une étagère sur laquelle elle rangeait un peu de poudre de riz, du khôl qu’elle avait fait venir de Montréal et qu’elle pouvait utiliser sans avoir l’air d’être maquillée, une brosse à cheveux, un peigne et une petite bouteille d’eau de toilette. Elle avait évidemment caché toutes ces choses de la vue de ses élèves en les rangeant dans une boîte bien fermée. Elle se regarda dans le miroir et décida de «se rafraîchir» un peu. Elle y mit une bonne dizaine de minutes puis rejoignit Douville à l’étage. Il semblait bien endormi dans la berceuse. Elle en fut déçue. Mais aussitôt qu’il entendit le froissement de ses jupes, il ouvrit les yeux.
«Je me détendais, dit-il. Vous savez que ces journées sont extrêmement éreintantes.
— J’en doute pas.»
Douville l’avait regardée attentivement, voyant bien que son regard était différent sans qu’il puisse en donner la raison. Il le lui fit remarquer.
«J’ai les yeux brillants? dit-elle feignant la surprise. Ça doit être la fatigue. »
Douville se leva d’un bond.
«Je m’excuse. Je vais partir. Vous auriez dû me faire savoir que vous étiez fatiguée. Voyons donc! Restez donc encore un peu. La pluie a pas cessé
— N’a pas... dit Douville.
— Quoi?
— Vous avez dit «a pas».
— J’ai dit ça moi?
— Oui. Vous devriez faire un peu plus attention. Vous avez un vocabulaire excellent mais vous mangez toutes vos syllabes. »
Émilie était estomaquée. Personne ne lui avait jamais dit quoi que ce fût en rapport avec son langage. Elle se demanda si elle devait le remercier ou lui dire carrément de se mêler de ce qui le regardait. Elle le remercia sèchement, ajoutant qu’elle essaierait de faire plus attention. Douville, comprenant qu’il l’avait piquée, s’excusa. Il avait, disait-il, été déformé au collège et vouait un culte «presque païen» à la langue de Molière. Émilie l’avait rassuré en disant qu’il avait bien fait de la reprendre — ce qu’elle n’était pas certaine de vraiment apprécier — et parla plus lentement, faisant attention à tous ses mots.
La pluie commença à faiblir. Douville se leva et retourna à la fenêtre.
«Bon, je crois que je vais pouvoir partir.»
Émilie acquiesça. Elle était à court de sujets de conversation. Douville descendit dans la classe ramasser ses papiers. Il la remercia une autre fois, en ajoutant qu’il ne lui était jamais arrivé de manger en aussi agréable compagnie. Émilie sourit à cette remarque et enchaîna qu’elle avait rarement mangé avec une personne qui avait d’aussi bonnes manières. Douville balaya cette remarque du revers de la main.
«Que voulez-vous, dit-il, j’ai passé ma vie en institution. J’ai été élevé par les religieuses puis par les Jésuites, à Montréal.
— Ah! fit Émilie, surprise de la soudaine confidence. Je pensais que vous étiez de la région.
— J’y suis depuis dix ans, à cause de mon travail, mais j’ai été élevé à Montréal.
— À Montréal! Vous êtes chanceux. J’ai justement une amie qui vit maintenant à Montréal...
— Vous croyez que j’ai de la chance d’avoir passé toute mon enfance dans un orphelinat?»
Émilie se mordit les lèvres. Elle avait cru qu’il avait pu recevoir une instruction privilégiée parce qu’il venait d’une famille aisée.
«Je suis désolée...
— Il n’y a pas de quoi. Je croyais que vous aviez compris...Vous savez, quand les bonnes gens vont à l’orphelinat pour adopter un enfant ou le prendre en élève, ils préfèrent quand même un enfant «parfait». Avec ma tête, je suis resté à l’orphelinat.»
Émilie le laissa parler. Elle ne savait trop comment soigner cette apparente blessure. Douville mit son chapeau et se dirigea vers la porte. Il se retourna vers elle.
«Je vous ai demandé si vous aimiez les voyages. Vous m’avez dit que oui. Voici. Je ne vous demande pas une réponse tout de suite. Mais si vous le voulez bien, je vous demanderais d’être ma femme. L’été prochain, nous pourrions aller en France, à Paris où il y aura une grande exposition internationale.
— Oui, je sais...s’entendit-elle répondre.
— Je sais que vous savez. Là n’est pas la question, ajouta-t-il sèchement. Je voudrais simplement que vous pensiez un peu à ma proposition. Si vous n’avez pas d’objections et si vos parents sont d’accord, j’irais vous visiter occasionnellement cet été. Nous pourrions faire meilleure connaissance. Je sais que je suis plus âgé que vous, mais nos goûts communs — la littérature, la langue française, les enfants — sont probablement suffisants pour nous aider à fonder une union durable. »
Émilie ne répondit rien. Elle préférait réfléchir. Douville était sorti de l’école sans ajouter un mot. Elle courut à la porte.
«Monsieur Douville! Si vous passez à Saint-Stanislas, vous savez où me trouver. » Émilie était rentrée pour la saison estivale. Elle avait encore une fois confié la clé de l’école aux Pronovost. Profitant de sa visite, elle leur avait demandé des nouvelles d’Ovila. Ils lui avaient dit qu’il était toujours à Shawinigan. Dosithée avait cru comprendre qu’il avait été dans un camp de bûcherons durant l’hiver, puis qu’il avait travaillé comme aide-cuisinier dans un camp de draveurs. Finalement, il avait été embauché sur le chantier de construction d’une centrale électrique.
«Vous savez, Ovila est pas écriveux, pis ce qu’il dit, c’est pas détaillé.»
Émilie les avait remerciés. Il était clair qu’ils n’approuvaient pas le départ de leur fils, encore moins maintenant qu’ils avaient besoin de lui sur la ferme. Ovila lui avait d’abord terriblement manqué, puis, peu à peu, sa peine s’était faite moins aiguë. Une amourette. Elle avait eu une amourette. Elle aurait bien souhaité autre chose, mais elle comprenait maintenant qu’Ovila n’avait pas eu pour elle des sentiments aussi profonds que les siens.
A Saint-Stanislas, elle avait rarement fait allusion à Ovila. Caleb lui avait demandé de ses nouvelles et Émilie l’avait vaguement renseigné. Caleb jugea qu’il n’avait pas intérêt à tourner le fer dans la plaie. Par contre, Émilie parla d’Henri Douville à maintes reprises. Caleb et Célina comprirent qu’il y avait un gendre à l’horizon. Caleb l’avait déjà rencontré à une réunion dont il avait oublié l’objet. Douville lui était apparu comme un homme cultivé. C’était peut-être ce genre d’homme qui plaisait à Émilie. Après tout, elle avait besoin d’un homme savant à ses côtés. Un cultivateur n’aurait probablement pas réussi à la satisfaire pleinement.
Douville, comme promis, était venu voir Émilie. Elle l’avait présenté à sa famille. Personne n’avait passé de commentaire sur son strabisme. Émilie, elle, ne le remarquait même plus. Ils firent de longues promenades dans le bois. Émilie ne put s’interdire de comparer son empêtre- ment à l’aisance d’Ovila.
Douville lui apportait toujours une petite surprise. Des mouchoirs brodés à ses initiales. Une boîte de fruits confits. Une bouteille de vrai parfum. Émilie trouvait qu’il lui faisait la cour avec beaucoup de dignité. Elle commença à se plaire en sa présence. Il lui apprenait tant de nouvelles choses. Elle châtia de plus en plus son langage. Ils passèrent de nombreuses soirées à veiller à la lueur d’un fanal, parlant de l’Europe et de Paris, que Douville avait hâte de visiter. Paris et son métropolitain. Paris et ses musées. Paris et son Histoire. Émilie s’imaginait à ses côtés, d’abord sur un pont de bateau, puis dans une cabine — petit détail auquel elle songeait comme à une fatalité — puis à Paris, dans des cathédrales et des musées. Elle ne réussissait pas très bien à imaginer le métropolitain. Un train sous terre...
L’été tirait à sa fin. Émilie regardait la nouvelle pouliche qui tétait sa mère. Elle avait, comme l’étalon, une belle crinière blonde. Caleb l’avait baptisée «La-Tite» en souvenir de ses origines. Émilie revivait la journée qu’elle et Ovila avaient eue, il y avait tout au plus un an de cela. Et Berthe était là. Qu’est-ce que Berthe penserait de son prochain mariage avec Henri? Ah! si seulement elle avait pu parler à Berthe. Lui dire combien elle appréciait la compagnie d’Henri, même s’il ne faisait rien naître en elle comme l’avait fait Ovila. Lui dire combien il était érudit, qu’il avait de bonnes manières. Lui dire qu’il n’avait jamais connu l’atmosphère d’une maison et qu’elle s’acharnerait à lui faire rattraper le temps perdu. Lui dire qu’il voulait beaucoup d’enfants même s’il commençait sa famille un peu tard. Lui décrire comment il parlait avec aisance d’une foule de sujets. Si seulement elle avait pu parler à Berthe. Berthe aurait compris.
L’arrivée de Douville interrompit ses pensées. Elle lui sourit et vint à sa rencontre. Il lui apportait un pot à fleurs en cristal taillé. Emilie n’avait jamais rien vu d’aussi beau. Douville mangea le repas du soir avec toute la famille, puis demanda à Caleb s’il pouvait lui parler. Emilie comprit. Caleb aussi. Les deux hommes allèrent dehors et revinrent quelques minutes plus tard. Caleb demanda à Émilie et à Célina de se joindre à eux, au salon. Il les informa que monsieur Douville avait mis ses gants blancs et lui avait demandé la main d’Émilie. Caleb lui avait répondu qu’il acceptait à la condition qu’Émilie fût d’accord. Caleb lui demanda son avis. Émilie rougit, regarda Douville et répondit qu’elle l’était, mais qu’elle préférait prendre l’année pour y penser. Elle rassura Douville en lui disant qu’elle aurait vingt ans en décembre et qu’elle avait l’intention de terminer son année à Saint-Tite. Elle ajouta que rien ne pressait, qu’ils pourraient fort bien se marier à la fin juin 1900. Elle se mit à rire nerveusement en ajoutant que cela simplifierait les calculs. En se mariant en 1900, ils sauraient toujours à quel anniversaire ils en seraient rendus. Douville soupira. Il fut convenu qu’ils se fianceraient à Noël.
Caleb avait connu Émilie et Ovila. Maintenant il voyait sa fille avec Douville et n’osait avouer qu’il avait un petit faible pour le premier de ses soupirants. Douville était un homme très bien, certes, mais sa fille n’était pas la même. Douville lui assurerait un bel avenir, mais Caleb n’était pas certain qu’Emilie avait ce qu’il fallait pour vivre avec un homme aussi raisonnable et aussi sage. Il entrevoyait déjà quelques flammèches. Henri ne connaissait pas la fougue de sa fille. Caleb s’inquiéta de savoir s’il y avait encore de cette fougue chez Emilie. Elle était devenue tellement posée, tellement «demoiselle». Elle parlait presque une autre langue que sa langue maternelle quand Douville était là. Lui, c’était certain, parlait «dans les termes», mais chez Émilie, cela faisait drôle à entendre. Caleb parla du mariage à Célina. Celle-ci ne semblait pas nourrir les mêmes appréhensions que son mari. Elle admirait Douville et rappela à Caleb qu’une femme devait admirer son mari si elle voulait être heureuse. Elle parla vaguement d’Ovila en disant qu’il semblait être un aventurier et qu’Emilie avait besoin d’un mari stable comme Henri. Caleb n’en était pas si certain. Il trouvait bien mystérieux ce départ précipité.
Emilie et Douville avaient convenu qu’il était préférable qu’il s’abstienne de la visiter à Saint-Tite. Ils se reverraient aux Fêtes. Par contre, il pouvait lui écrire autant qu’il le voulait, sur du papier officiel, bien entendu. A la suggestion d’Emilie, ils ne parleraient de leurs fiançailles à personne. Douville avait compris cette restriction. Une telle nouvelle aurait pu compromettre ses chances de se mériter une prime.
Henri et Emilie se quittèrent la veille du retour de celle-ci à Saint-Tite. Elle lui avait permis de l’embrasser, ce qu’il avait fait avec une pudeur tout à son honneur. Il aurait pu profiter de l’absence de chaperon pour mordre plus goulûment à ses lèvres. Il s’en était abstenu. Émilie lui en fut reconnaissante. Elle l’avait regardé partir. Dès qu’il lui avait tourné le dos, elle s’était essuyé la bouche et s’était mordu les lèvres à plusieurs reprises comme si elle voulait en vérifier la sensibilité. Elle n’avait rien senti. Rien ressenti. Mais il était tellement bon...tellement généreux. Et Paris...
19.
Emilie revint à l’école sans grand enthousiasme. Cette année d’enseignement s’annonçait un peu comme un purgatoire. Elle avait pris des nouvelles d’Ovila dont le départ remontait à presque un an. Madame Pronovost lui avait dit qu’il avait fait une courte visite durant l’été, le temps de guérir complètement une blessure qu’il s’était infligée au chantier. Emilie l’avait pressée de lui donner quelques détails, essayant de demeurer impassible lorsqu’elle apprit qu’il s’était entaillé le pied avec une pioche. Félicité avait précisé qu’il n’était resté que quelques jours, mais qu’il en avait profité pour aller faire un petit tour à l’école, en utilisant la clé qu’elle leur avait confiée. Émilie s’était excusée, puis les avait quittés pour aller ranger tous ses effets.
En mettant les pieds dans l’école, elle déposa ses valises, fit le tour de la classe des yeux pour voir si Ovila ne lui avait pas laissé quelque chose. Rien. Elle monta l’escalier, repoussa la trappe et pénétra de peine et de misère dans ses appartements, traînant ses lourdes valises. Ici non plus, il n’y avait pas de traces d’Ovila.
Elle consacra la soirée entière à laver la vaisselle, ranger ses vêtements et préparer son lit. Cela fait, elle descendit et s’assit à son pupitre. Elle regarda la classe. Elle savait que cette année, elle aurait trente et un élèves. Jamais encore elle n’avait dépassé les trente. Cela l’inquiétait un peu. Elle avait dû demander des pupitres supplémentaires aux commissaires qui lui avaient promis qu’elle les aurait pour la rentrée. Elle verrait monsieur Pronovost pour s’assurer qu’on viendrait bien les lui porter le lendemain, la rentrée étant fixée au surlendemain. Elle demeura à sa place, son regard fixant tout et rien dans sa classe. Tantôt elle regardait une des fenêtres qui était fêlée depuis le mois de mai. Tantôt elle fixait la planche à clous qui avait l’air abandonnée. Prenant conscience de l’heure, elle monta à sa chambre et s’assoupit rapidement. Elle rêva d’Henri. Ils étaient tous les deux dans une chaloupe sur une mer déchaînée.
Le matin la trouva presque en forme. Elle s’était vêtue et coiffée avant de se rendre chez les Pronovost s’assurer de la livraison des pupitres supplémentaires. Monsieur Pronovost se tapa le front. Il avait complètement oublié. Il demanda à Émilie si elle voulait l’accompagner jusqu’au village. Il y avait sûrement des pupitres qui étaient disponibles dans l’école du rang Sud. Émilie serra les dents. Elle aurait eu bien d’autres choses à faire. Néanmoins, elle accepta. Ils convinrent de partir aussitôt que Dosithée pourrait se libérer.
Il vint la chercher à la porte de l’école. Elle l’en remercia, lui assurant qu’elle aurait facilement pu marcher la courte distance entre l’école et sa maison. Ils avaient à peine roulé depuis cinq minutes qu’il virent la maison commencée un an plus tôt. Dosithée soupira.
«Je pense que ça aurait été une belle maison. Astheure, j’ai pus le cœur de la finir. Je voudrais pas me plaindre, mais depuis que j’ai commencé à acheter la terre du père Mercure, Lazare a recommencé ses crises, Ovide est attaqué aux poumons, j’ai failli perdre ma femme, j’ai enterré un quatrième enfant, pis Ovila est parti comme un coup de vent sans rien nous dire. Vous, sauriez-vous pourquoi Ovila est parti?» Emilie fui giflée par cette question. Elle n’avait pas compris le ressentiment des Pronovost face à leur fils. Maintenant, tout s’éclairait. À eux non plus, il n’avait rien dit.
«Comment voulez-vous que je le sache? Ovila...Ovila est un...euh...bien drôle de garçon. J’aurais quand même aimé avoir de ses nouvelles.
— On pensait qu’il vous écrirait.
— Ah oui? Pourquoi?» Elle n’était pas aussi étonnée de cette remarque qu’elle aurait voulu le faire croire.
«Ben, mam’selle, c’est un secret pour personne qu’Ovila vous a toujours trouvée de son goût. En tout cas, c’est pas un secret pour moi. »
Il garda le silence pendant quelques minutes. Émilie ne voulait surtout pas lui dire qu’il avait eu raison. Il enchaîna.
«Aussi bien vous l’avouer. Moi, j’avais espéré que vous... qu’un jour vous...en tout cas. J’avais pensé à Ovide, mais...Pis j’avais pensé qu’Edmond, mais...Lazare, lui, j’y avais pas pensé. Ovila, même si je savais qu’il était un peu plus jeune, je me disais que peut-être que...En tout cas... On peut pas dire que mes gars, c’est des marieux...»
Émilie n’avait pas parlé. Elle revivait les avances discrètes d’Ovide, les attentions particulières d’Edmond et enfin les déclarations d’Ovila. Elle ne sentit même pas qu’une larme sans fin lui baignait la joue. Dosithée ne le remarqua pas non plus.
«Ovila vous a rien dit cet été? demanda-t-elle finalement.
— Non, pas un mot. Il a passé ses soirées à l’hôtel Brunelle, pis ses journées à gosser son éternel p’tit bout de bois. J’avais espéré qu’il était revenu pour de bon, mais c’était pas ça. La terre, ça l’intéresse pas. Ça laisse pus grand relève pour le père. Il reste Emile, pis Oscar pis Télesphore, pis Edmond. Mais Edmond aime pas mal plus l’élevage des ch’vaux que la culture. On peut pas vivre rien que de ça sur la ferme.»
Emilie se demandait pourquoi elle avait droit à toutes ces confidences. Elle ne voulait pas commenter ce qu’il venait de dire. Elle le sentait terriblement triste. Sensible à sa tristesse à lui, elle n’avait pas senti la sienne reprendre sa place dans sa poitrine et ses poumons, lui coupant le souffle et empêchant son cœur de battre doucement.
Ils avaient réussi à trouver les pupitres manquants, les avaient montés dans la voiture et étaient de retour à l’école. Emilie se demandait encore pourquoi Ovila était venu s’y asseoir durant l’été. Dosithée la précéda, transportant le premier pupitre. Emilie le suivit avec une chaise. Ils firent les autres voyages en silence. Ils déposèrent le tout à l’arrière de la classe. Dosithée offrit à Emilie de l’aider à les placer. Elle le remercia, lui disant qu’elle préférait faire cela seule. Elle disposait de tout l’après-midi pour organiser la classe et écrire son mot de bienvenue sur l’ardoise. Dosithée la quitta après lui avoir gentiment pincé la joue. Elle lui sourit, se demandant s’il n’avait pas voulu lui faire comprendre qu’il n’était pas dupe et avait compris qu’il y avait eu quelque chose entre elle et Ovila. Elle monta à l’étage pour changer de vêtements. Elle descendit deux marches, puis s’assit dans l’escalier. Etait-il venu s’y asseoir lui aussi? Elle regarda sa classe, de haut. Elle fixa le pupitre d’Ovila. Elle l’imaginait en train d’écrire. Elle le revoyait le bras levé pour répondre à une question. Elle revivait ses moindres petits gestes, allant de la main qu’il se passait dans les cheveux pour les mettre en place quand il arrivait le matin, à son empressement à ouvrir ou à fermer une fenêtre.
Le cœur d’Emilie fui frappé par l’éclair. Elle se leva précipitamment, descendit les escaliers à la course, se dirigea vers le pupitre d’Ovila et l’ouvrit. Elle était là! Une lettre! Une lettre d’Ovila! Enfin! Troublée, elle se laissa choir sur la chaise. Elle tourna et retourna la lettre dans ses mains. Elle la sentit. Son cœur battait la chamade. Elle froissa la lettre et la défroissa. Elle défaillait. Elle respira enfin profondément et déchira l’enveloppe, adressée à EMILIE, avec un dessin d’oiseau.
Les grillons s’étaient donné le mot pour mettre en musique les pensées d’Émilie. Elle s’était couchée tôt, contrairement à ce qu’elle avait prévu. Elle s’était d’abord hâtée de placer sa classe puis elle s’était dévêtue lentement, valsant quelques pas en tenant la lettre près de son cœur. Elle avait voulu se coucher pour laisser voguer son imagination. Ovila était là tout près d’elle. Ovila lui parlait. Ovila lui racontait sa honte et son désespoir. Ovila lui demandait s’il lui avait manqué. Il implorait son pardon de l’avoir si lâchement laissée tomber. Puis il racontait le chantier de bûcherons. Et la drave. Et le chantier de cette centrale dont elle ne connaissait pas encore le nom mais qui, disait- il, produirait assez d’électricité pour éclairer une grande ville. Ovila lui avouait ensuite qu’il regrettait de lui avoir dit tant de bêtises. Il lui demandait si elle avait toujours les cheveux longs et si elle se faisait encore des tresses quand elle était fatiguée, comme elle le faisait avant. Il la suppliait de l’attendre encore un peu. Pas longtemps. Le temps qu’il puisse mettre de côté l’argent dont «ils» auraient besoin. Ovila...
Elle s’était tournée en boule, bien repliée sur elle-même pour sentir son corps qui venait d’avoir une attaque de sève. Elle se tenait l’échine courbée, le menton appuyé sur ses genoux, la lettre collée à la peau sous sa robe de nuit. Pas une seconde elle n’avait pensé à Henri. A la promesse presque formelle qu’elle lui avait faite. Elle rêvait d’Ovila.
De sa démarche nonchalante. De son regard bleu et clair. Elle se retourna, ouvrit les yeux et essaya d’imaginer les traits d’Ovila. Elle en fut presque incapable. Cela l’angoissa. Avait-elle pu l’oublier si rapidement? Et lui, se souvenait-il d’elle, l’imaginait-il comme elle le faisait en ce moment? Vivement son retour! Elle se leva, but un verre d’eau et se recoucha. Elle chercha le petit coin qu’elle avait réchauffé, se faisant croire qu’Ovila s’y était glissé.
Le matin la surprit alors qu’elle était endormie sur le dos, la robe de nuit levée jusqu’au menton. Pudeur instinctive: elle l’abaissa aussitôt. Elle se leva, langoureuse comme si elle avait vraiment passé la nuit avec son grand fou. Elle chantonna en faisant ses ablutions. Elle descendit dans sa classe et remercia le ciel de l’avoir emplie de soleil. Le parquet brillait, comme il le faisait toujours le matin de la rentrée. Son purgatoire était fini. Ovila arriverait dans quelques semaines. Elle accueillit ses élèves avec joie et commença en riant cette cinquième année d’enseignement.
20.