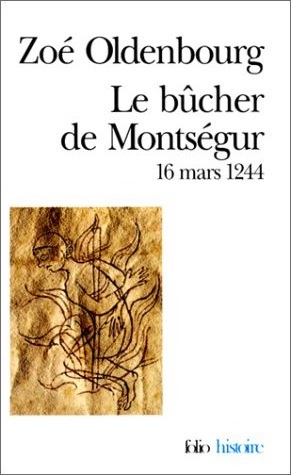
Zoé Oldenbourg
Le bûcher de Montségur
16 mars 1244
Gallimard
Cet ouvrage est originellement paru dans la collection "Trente journées qui ont fait la France".
© Éditions Gallimard, 1959.
Zoé Oldenbourg, née à Saint-Pétersbourg, est venue en France à l'âge de neuf ans. Elle a été peintre avant de devenir romancière et historienne. Elle a reçu le prix Femina en 1953 pour La pierre angulaire et a depuis été appelée à siéger dans le jury qui l'avait couronnée.
Son œuvre d'historienne et de romancière a été souvent inspirée par le Moyen Âge: "Argile et cendres", "La pierre angulaire", "Le bûcher de Montségur", "Les brûlés", "Les cités charnelles", "Les croisades" et "La joie des pauvres". Zoé Oldenbourg a aussi publié des livres de souvenirs: "Visages d'un autoportrait" et "Le procès du rêve". Elle sait également être un peintre du temps présent, comme l'a montré "La joie-souffrance" qui fait revivre la communauté des Russes exilés à Paris entre les deux guerres.
INTRODUCTION
Pendant que Philippe Auguste, le plus grand des rois qui ont régné avant Henri IV, "faisait la France" dans les plaines flamandes1, un certain nombre de ses vassaux, placés sous l'égide de l'Église catholique, la "faisaient" à leur manière, dans la terre languedocienne.
L'histoire nous apprend que le vainqueur de Bouvines savait, au besoin, se montrer dur et impitoyable, mais on peut être certain (le précédent de l'annexion de la Normandie en témoigne2) qu'il s'y serait pris autrement s'il en avait fait son affaire, et la honte des massacres, des incendies et des tortures, dont demeure flétrie à jamais la mémoire des croisés de l'Albigeois, n'aurait pas souillé les annales de l'histoire de France.
Cependant, si l'on écarte toute espèce de considérations d'ordre sentimental et moral, si l'on se borne à regarder les choses en réaliste, il y a lieu de reconnaître que la mainmise de la royauté française sur le Languedoc est un événement d'une importance capitale pour la France et dont celle-ci a tiré d'inappréciables avantages, en ce sens qu'il inaugure la transformation radicale de sa structure externe et interne, modèle son nouveau visage, lui donne une nouvelle armature.
L'annexion de la Normandie avait ouvert à la France les débouchés maritimes du Nord, la soumission du Languedoc lui apportait la clé du bassin méditerranéen, ce qui, en plus des bénéfices commerciaux incalculables, laissait prévoir pour l'avenir une nouvelle orientation de la politique française, en direction de l'Italie. D'autre part, le royaume, encore fortement empreint d'essence germanique, devenait exposé à des contacts de plus en plus étroits avec l'esprit occitan, héritier de l'esprit latin, de même que la province languedocienne, par la force des choses, dut subir l'implantation d'une féodalité cléricale et militaire franco-bourguignonne qui allait se substituer à un régime social mitigé, fondé sur l'interdépendance des villes et des châteaux. Ainsi se trouvait engagé ce processus de brassage de races et de civilisations d'où sortira la future grandeur de la France.
Mais il ne saurait être question d'oublier le prix dont fut payé ce résultat: les longues, les terribles années (trente-cinq ans) pendant lesquelles une population paisible, mais fermement résolue de vivre et de mourir dans la foi qui lui était chère, voyait déferler sur son pays, brandissant la croix d'une main, l'épée de l'autre, des hordes d'égorgeurs, de pillards, d'incendiaires. Ce long et déchirant martyre, qui s'achèvera dans les flammes du monstrueux bûcher allumé au pied d'une montagne désormais sacrée, le présent ouvrage va l'évoquer dans toute son horreur, et je tiens à dire l'admiration que m'inspire l'effort surhumain fourni par son auteur qui, faisant preuve d'une objectivité infinie, enclin plutôt à excuser qu'à condamner les atrocités commises au nom du Christ, a mené sans défaillance, jusqu'au bout, sa tâche écrasante.
G.W.
1 Voir dans la même collection Georges Duby, Le dimanche de Bouvines.
2 Ibid.
CHAPITRE I
PRÉLIMINAIRES DE LA CROISADE
I - LE POINT DE DÉPART
Le 10 mars 1208, Innocent III, pape de la chrétienté, lance solennellement un appel aux armes, et prêche à des peuples chrétiens une croisade contre un pays chrétien. Cette croisade est justifiée et nécessaire: les hérétiques qui peuplent ce pays sont "pires que les Sarrasins".
L'appel du pape arrive quatre ans après la prise de Constantinople par les armées croisées. L'ennemi à combattre est Raymond VI, comte de Toulouse, cousin du roi de France, beau-frère du roi d'Angleterre et du roi d'Aragon, lié par l'hommage à ces trois rois et à l'empereur d'Allemagne; duc de Narbonne, marquis de Provence, suzerain féodal dont l'autorité s'étend sur l'Agenais, le Quercy, le Rouergue, l'Albigeois, le Comminges, le Carcassès, le comté de Foix - bref, un des grands princes de la chrétienté occidentale; premier seigneur de toutes les terres de langue d'oc.
À une époque où la noblesse détenait en fait le pouvoir et où, des rois aux simples propriétaires fonciers, tous les nobles étaient militaires par définition, la guerre était une nécessité permanente, et les princes chrétiens ne manquaient jamais de raisons pour envahir les terres de leurs voisins. Mais le siècle précédent avait vu s'épanouir, puis décliner, l'immense élan des peuples d'Occident vers la Terre sainte: au XIIe siècle, le pèlerin guerrier (tout en poursuivant bien souvent des fins matérielles) avait la certitude de combattre pour Dieu. La noblesse, décimée sur les champs de bataille de Palestine, se résignait mal à l'inutilité des sacrifices qu'elle s'était imposée, et les guerres locales qu'elle était bien obligée de mener lui paraissaient petites et plates.
Lors de la 4e Croisade, Simon de Montfort, chevalier dont la passion pour la guerre ne laisse de doutes pour personne, refusera de porter les armes contre une ville chrétienne, et de se mettre au service du doge au lieu de celui du pape; si la majorité des croisés ne suit pas son exemple et, après la prise de Zara, ville catholique, se rue sur Constantinople, le scandale d'une croisade détournée de son vrai but laisse à la chevalerie franque un sentiment de désillusion, malgré l'attrait toujours vif des conquêtes et du pillage. La croisade est en train de devenir une voie sans issue; la Terre sainte, de plus en plus menacée cependant, n'attire que peu d'amateurs. Et pour bien des chevaliers et hommes d'armes, ce moyen de gagner le pardon de Dieu, tout en se couvrant de gloire sur les champs de bataille, était devenu une habitude, parfois une véritable passion, souvent une nécessité matérielle.
Que penser de cette croisade d'un genre nouveau que le cri d'alarme du pape impose à la chrétienté? Quand on se souvient du cosmopolitisme de la noblesse de cette époque où la chevalerie d'Angleterre parlait français, où les poètes espagnols et italiens écrivaient en langue d'oc, où les Minnesinger allemands se mettaient à l'école des troubadours; où l'inextricable complexité des liens féodaux et le chassé-croisé des mariages politiques avaient fini par créer des liens de vassalité et de parenté entre tous les grands seigneurs de la chrétienté occidentale, il paraît difficile à imaginer qu'une guerre sainte contre le comte de Toulouse ait pu devenir une réalité.
L'anathème jeté de Rome en ce jour de mars 1208 sur la terre occitane coupe en deux l'histoire de la chrétienté catholique. La sanctification d'une guerre faite à un peuple chrétien devait détruire à jamais l'autorité morale de l'Église et corrompre jusqu'au principe même de cette autorité. Ce que le pape pensait être une opération de police, accidentelle, et commandée par les circonstances, allait se transformer, sous le poids des événements, en un système d'oppression méthodique, et Rome allait devenir, pour des millions de chrétiens d'Occident, un objet de haine et de mépris.
Les circonstances qui ont amené Innocent III à sévir contre le comte de Toulouse justifient, à priori, l'appel du pape: les terres soumises, de près ou de loin, à l'autorité du comte, étaient gagnées par l'hérésie, et le 14 janvier 1208 le légat du pape, Frère Pierre de Castelnau, avait été assassiné à Saint-Gilles par un officier de Raymond VI.
Le meurtre d'un légat - ambassadeur plénipotentiaire du pape - était un crime capital, justifiant une déclaration de guerre. L'Église n'était pas, en principe, une puissance temporelle; elle ne pouvait répondre à cet affront sanglant que par des châtiments d'ordre spirituel. Ceux dont elle disposait étaient redoutables: devant l'excommunication et l'interdit les rois s'inclinaient et consentaient à bouleverser leurs alliances politiques et leur vie privée pour éviter les foudres de l'Église.
Excommunié pour le meurtre de Thomas Becket, en 1170, le roi Henri II d'Angleterre n'avait obtenu le pardon du pape qu'après une amende honorable et une humiliation publique; la France n'était pas encore près d'oublier les longs mois d'interdit qu'à cause du divorce illégal de Philippe Auguste elle avait dû subir en 1200. L'excommunication faisait de l'homme qui en était l'objet un mort civil et déliait ses proches et ses sujets de toute obligation envers lui; l'interdit paralysait la vie d'un pays, en excluant son peuple de toute participation aux sacrements et aux pratiques religieuses qui étaient, pour la majorité des chrétiens, aussi nécessaires que le pain quotidien.
On voit le pape intervenir dans l'élection de l'empereur et chercher à imposer son candidat malgré la volonté des princes allemands, jeter l'interdit sur l'Angleterre à cause de l'obstination du roi Jean à se choisir un archevêque selon son goût. Philippe Auguste se soumet, Jean s'humilie et rend sa couronne pour la reprendre des mains du légat. Le roi d'Aragon, prince catholique engagé dans une perpétuelle croisade contre les Maures, vient à Rome prêter serment au pape et tenir sa couronne de lui, tant il sait que l'amitié de Rome est une garantie de stabilité intérieure. Innocent III est un pape qui entend traiter tous les rois catholiques comme ses vassaux.
Mais lors de l'excommunication prononcée contre le comte de Toulouse, le pape savait que ses armes habituelles n'avaient aucun pouvoir, et qu'il était vain de condamner à l'interdit une terre qui, déjà presque ouvertement, se détachait de l'Église de Rome.
Le crime de Raymond VI était de gouverner un pays où le pouvoir de l'Église déclinait, et de ne rien faire pour remédier à cet état de choses. La croisade déclenchée contre une terre depuis mille ans chrétienne avait pour but avoué la destitution d'un souverain légitime, et par ce fait même trop enclin à prendre le parti de ses sujets. Pour sauver l'Église du péril qu'elle courait dans le Midi de la France, il fallait soumettre ce pays à une autorité étrangère qui eût le courage d'agir sans ménagements. Le programme de cette opération de grande envergure est déjà tout tracé dans la lettre qu'Innocent III envoie au roi de France avant l'assassinat du légat: "À toi de chasser le comte de Toulouse de la terre qu'il occupe et de l'enlever aux sectaires pour la donner à de bons catholiques qui puissent, sous ton heureuse domination, servir fidèlement le Seigneur3".
Les territoires soumis au comte de Toulouse étaient depuis près d'un siècle un foyer notoire d'hérésie. Dans tous les pays chrétiens, les foyers d'hérésie plus ou moins importants existaient en permanence depuis l'établissement même de l'Église. À l'époque des Croisades, non seulement les pays slaves, mais tout le Nord de l'Italie étaient le terrain de luttes incessantes entre catholiques et hérétiques. Dans le Midi de la France, les hérétiques, sans être en majorité, constituaient depuis longtemps une partie importante de la population. L'Église s'en désolait, excommuniait, luttait par tous les moyens, y compris le recours au bras séculier, mais ses efforts, dans ce pays du moins, se révélaient de plus en plus inefficaces; l'hérésie, ou plutôt les hérésies gagnaient du terrain un peu partout avec une rapidité croissante. Depuis plus de quatre ans, Innocent III se rendait compte que seule une grande expédition armée aurait quelques chances de triompher de l'hérésie.
Le meurtre de Pierre de Castelnau avait été un de ces assassinats politiques dont (avec plus de raison encore que de l'exécution du duc d'Enghien) on pourrait dire que c'était plus qu'un crime: une faute. Il y a d'ailleurs tout lieu de croire que le comte ne l'avait pas ordonné.
Légat du siège apostolique en Languedoc, Pierre de Castelnau, archidiacre de Maguelonne et moine de l'abbaye cistercienne de Fontfroide, luttait depuis longtemps contre l'opposition des pouvoirs publics à l'œuvre de l'Église.
Pour convertir les rebelles, Pierre de Castelnau s'était lancé dans une intense activité politique. Avec son compagnon Arnaud-Amaury, abbé de Citeaux, Pierre de Castelnau s'est d'abord attaqué aux prélats du Languedoc, suspects de favoriser (ou du moins de tolérer) l'hérésie: en 1205, il suspend de son office l'évêque de Béziers, puis l'évêque de Viviers; puis les légats font instruire le procès du primat d'Occitanie, Bérenger II, archevêque de Narbonne, qui ne se laisse pas intimider et entre en lutte ouverte contre les envoyés du pape.
Enfin, vers la fin de 1207, Pierre parvient à réunir une ligne de barons méridionaux, ligue destinée à poursuivre les hérétiques; sommé de s'associer à cette ligue, Raymond VI refuse. Comme le dit Pierre des Vaux de Cernay, l'homme de Dieu (Pierre de Castelnau) poussa les seigneurs de Provence à se révolter contre leur suzerain4. Bien plus, devant le mécontentement du comte, le légat lui tient tête, l'excommunie publiquement, jette l'interdit sur le comté et, après une scène des plus vives, finit par lancer au comte son anathème: "...qui vous dépossédera fera bien, qui vous frappera de mort sera béni". Néanmoins, l'excommunication fait son effet: le comte de Toulouse se soumet et fait de nouveau les promesses que l'on exige de lui.
Après une entrevue des plus orageuses avec le comte, à Saint-Gilles, Pierre de Castelnau et son compagnon l'évêque de Couserans quittent la ville. Le lendemain matin, au moment où les envoyés du pape se préparent à franchir le Rhône, un officier de la suite du comte se précipite sur le légat et le transperce de son épieu.
Le résumé de l'activité de Pierre de Castelnau prouve amplement que le légat n'était pas un personnage commode et qu'il ne craignait nullement de se faire des ennemis. Mais à un moment où les relations entre le comte de Toulouse et l'Église étaient déjà très tendues, le meurtre d'un ambassadeur du Saint-Siège devait être la goutte qui fit déborder la coupe. Innocent III, qui depuis longtemps songeait à une croisade contre un pays infecté d'hérésie, n'attendait qu'un fait concret, éclatant, propre à frapper les imaginations, propre à justifier une déclaration de guerre.
La papauté n'avait pas d'armée à sa solde. Les croisades, guerres assez populaires au siècle précédent, étaient, malgré la participation de rois et de princes, des guerres de volontaires avant tout: le pape ne pouvait pas forcer le roi de France à se croiser, et il ne parvint pas à l'y décider. Le succès de l'entreprise dépendait uniquement de la bonne volonté des grands et petits seigneurs qui consentiraient à y prendre part. Le pape fit donc envoyer des lettres à tous les évêques de France afin de déclencher une campagne de propagande en faveur de la nouvelle croisade.
Des missionnaires, forts de la robe blanche tachée de sang de Pierre de Castelnau, proclamèrent dans les églises de France la grande pitié d'un pays livré en pâture à l'hérésie. Le légat Arnaud-Amaury, dit Guillaume de Puylaurens, se voyant impuissant de ramener à Dieu les brebis égarées, "gagna la France, qui a toujours été le soldat de Dieu; il s'entendit avec le roi et les barons, tandis que des hommes du peuple, propres à cette mission, se mirent à prêcher au nom de l'autorité apostolique la guerre contre les hérétiques, avec des indulgences analogues à celles qu'on accorde habituellement aux croisés qui traversent les mers pour secourir la Terre sainte5".
"...Que celui qui ne se croisera pas ne boive plus jamais de vin, qu'il ne mange plus sur nappe ni soir ni matin, qu'il ne s'habille plus de chanvre ou de lin, et qu'à sa mort on l'enterre comme un chien6!" Ces paroles que l'auteur de la "Chanson de la Croisade" met dans la bouche d'Arnaud-Amaury au cours de son voyage à Rome n'ont pu être prononcées à Rome, puisque à cette époque le légat se trouvait en France. Mais elles reflètent sans doute assez fidèlement le ton des discours de ce farouche personnage. Le succès de la propagande fut tel que le roi de France, qui avait d'abord cherché à limiter un mouvement qui risquait de lui faire perdre une partie de ses soldats à un moment où il pouvait en avoir besoin, dut aussitôt renoncer à cette tentative.
Il venait des volontaires de Normandie et de Champagne, de l'Anjou et des Flandres, de Picardie et du Limousin; les paysans et les bourgeois se croisent en même temps que les chevaliers, et vont se ranger sous les drapeaux de leurs seigneurs et de leurs évêques. On ne peut évaluer exactement quelle fut l'importance de cette armée; les chiffres des historiens sont très imprécis. Il est certain que ce fut une armée grande pour l'époque, et que sa puissance impressionna les contemporains.
II - LES CROISÉS
Avant d'examiner en détail ce que fut cette hérésie qui provoqua la croisade albigeoise et de nous représenter ce qu'était le pays qui allait devenir le théâtre d'un des drames les plus cruels de notre histoire, il faut se rendre compte de ce qu'étaient les hommes qui ont eu le courage de porter la guerre dans un pays chrétien qui ne les attaquait pas et qui leur était proche par sa race et par sa langue.
Nous avons vu plus haut que les croisades étaient depuis longtemps entrées dans les mœurs de la noblesse occidentale. À part les quatre grandes croisades, il y avait eu, au cours de tout le XIIe siècle, d'innombrables expéditions armées conduites par de grands seigneurs à leurs propres frais, expéditions auxquelles participaient non seulement les vassaux de ces seigneurs mais nombre de volontaires de tout rang et de toutes conditions; beaucoup de ces corps expéditionnaires étaient conduits par des évêques. Dans leur majorité, les croisés étaient des Français, aussi bien du Midi que du Nord. L'Empire chrétien qui était en train de se fonder dans le Proche-Orient était un Empire franc; il avait sans cesse besoin de nouveaux renforts et les royaumes chrétiens de l'Occident payèrent pendant cent ans un lourd tribut en vies humaines à la Terre sainte. Les pèlerins-guerriers n'étaient pas tous animés d'un enthousiasme pur et désintéressé; une grande partie étaient des aventuriers et des ambitieux, mais l'approbation sans réserves que l'Église accordait aux pieuses entreprises qu'étaient les croisades entretenait, chez les hommes qui prenaient la croix, la certitude de servir Dieu et de sauver leur âme en faisant un métier qui, en d'autres circonstances, était entre tous nuisibles au salut: situation combien enviable pour un soldat. Les croisés de Terre sainte bénéficiaient des indulgences accordées par le pape, et celui qui avait participé à une croisade gagnait le pardon de ses péchés et avait en outre des chances de s'enrichir et de s'acquérir une bonne renommée.
Le principe de ces entreprises doublement profitables était séduisant, mais les défaites et l'effondrement progressif de l'Empire franc de Syrie et de Palestine décourageait les chercheurs d'aventures; le nouvel Empire latin de Constantinople semblait offrir des possibilités plus grandes, mais n'avait pas le même pouvoir d'attraction que le Saint-Sépulcre. Et cependant bon nombre de militaires, en France surtout, avaient besoin d'une croisade comme un musulman a besoin d'un pèlerinage à La Mecque. Il ne faut donc pas s'étonner si l'appel du pape rencontra un accueil favorable dans les provinces de la France du Nord.
Les indulgences promises pour cette croisade nouvelle étaient analogues à celles qui étaient accordées aux croisés de Terre sainte; or, l'effort à fournir était beaucoup moins grand. De plus, la croisade était un moyen commode de suspendre le paiement des dettes, de mettre ses biens à l'abri d'éventuelles contestations: les biens d'un croisé étaient déclarés inviolables pendant toute la durée du temps qu'il resterait en croisade.
Il est très probable, en effet, qu'une bonne partie de l'armée croisée se composait - tant parmi les chevaliers que parmi les bourgeois et les hommes du peuple - de pécheurs avides de gagner le pardon de Dieu et de gens perdus de dettes qui espéraient ainsi échapper aux persécutions de leurs créanciers; et surtout de gens qui, ayant déjà fait le vœu de se rendre en Terre Sainte, étaient heureux d'échapper à cette obligation en participant à une croisade moins longue et moins pénible. Si un grand nombre de croisés n'étaient guère que des professionnels de la guerre, toujours heureux de trouver une occasion honorable de se battre, il ne faut tout de même pas oublier que l'armée qui se préparait, s'organisait pour le départ dans les châteaux, les salles d'armes des communes, les champs clos pavoisés et les salles de gardes des palais princiers et épiscopaux était une armée d'hommes qui faisaient coudre une croix sur leurs vêtements de guerre. Le seul fait de prendre la croix était, même pour les plus tièdes, un symbole assez éloquent pour provoquer l'enthousiasme.
Or, comment l'anathème du pape a-t-il pu transformer, du jour au lendemain, le comte de Toulouse en un païen et un infidèle?
Le Languedoc n'était pas séparé de la France par des mers ni par des milliers de lieues; c'était, cependant, un pays étranger, sinon ennemi; les grands barons méridionaux, jaloux avant tout de leur indépendance, s'appuyaient tantôt sur le roi de France, tantôt sur le roi d'Angleterre, formaient des alliances avec le roi d'Aragon et l'empereur, le lien de vassalité qui reliait le comte de Toulouse au roi de France était assez ténu. Grand vassal de la couronne, le comte n'était même pas un allié pour le roi, mais un voisin peu sûr, toujours prêt à favoriser la politique du roi d'Angleterre (dont il était le beau-frère et qui était l'oncle de son fils unique) et celle de l'empereur. Les grands barons de langue d'oil, sans être tous de fidèles sujets du roi de France, étaient Français de tradition et de culture et ne songeaient pas à faire cause commune avec ceux qu'ils appelaient (non sans quelque dédain) les Provençaux.
Parmi les grands barons qui prirent la croix, les premiers se trouvaient être Eudes II duc de Bourgogne et Hervé IV comte de Nevers: ces seigneurs savaient pourquoi ils allaient se battre, l'hérésie avait déjà pénétré sur leurs terres, ils avaient donc des raisons de vouloir en arrêter l'expansion. Des chevaliers tels que Simon de Montfort ou Guy de Lévis étaient animés d'un zèle sincère pour ce qu'ils considéraient comme la cause de Dieu, ces combattants désintéressés, ces "soldats de Dieu" devaient être fort nombreux dans l'armée croisée qui se réunit à l'appel d'Innocent III; la noblesse franque avait depuis longtemps pris l'habitude de confondre ses propres intérêts avec ceux de Dieu.
La foi des croisés qui, pour la gloire de Dieu, n'hésitent pas à exterminer leurs semblables peut nous paraître surprenante et d'une qualité assez basse. Elle ne l'était peut-être pas toujours: la morale simplement humaine n'entrait pas en ligne de compte quand les intérêts de Dieu semblaient en jeu. Ces intérêts pouvaient avoir un caractère singulièrement terrestre, mais personne n'en était choqué, tant Dieu semblait proche des affaires des hommes. La foi, en France comme dans les autres terres chrétiennes (et peut-être davantage), était profonde et vivace et, par ce fait même, terriblement attachée à ses manifestations extérieures. Le sens du sacré qui imprégnait la vie sociale et la vie privée allait jusqu'à un symbolisme pris à la lettre qu'il nous serait facile de traiter de fétichisme. En examinant l'histoire de la guerre contre les albigeois, il ne faut pas oublier qu'outre les mobiles politiques, il y en eut d'autres, sentimentaux ou passionnels, sans lesquels cette guerre n'eût peut-être pas pu avoir lieu, ni du moins prendre le caractère particulièrement cruel qui allait la caractériser. Cette guerre ne fut pas seulement l'affaire de quelques fanatiques ou de quelques ambitieux, ni même la réaction de l'Église romaine contre l'hérésie; elle correspondait à l'expression profonde d'une certaine forme de la civilisation occidentale, d'une certaine conception de l'univers et de Dieu.
Nous avons parlé du côté en quelque sorte terrestre de la foi des hommes du XIIe et du XIIIe siècle, car il semble bien qu'à cette époque l'aspiration à enchâsser le surnaturel dans des formes de plus en plus concrètes, de plus en plus cohérentes ait atteint une vigueur ignorée jusque-là.
En chassant ou en monopolisant à son profit les antiques mythologies latines et celtiques, l'Église avait métamorphosé les saints en personnages de folklore et les dieux et demi-dieux en saints; et le chrétien vivait dans un monde où la vie des saints et les récits sacrés tenaient en grande partie la place que tiennent à notre époque le théâtre, le cinéma, les journaux illustrés et les contes de nourrice. La littérature profane et la littérature populaire, assez étrangères à la religion, faisaient encore figure de genres mineurs ou réservés à une élite peu nombreuse; l'élan créateur des peuples d'Occident, jeunes, avides de nouveauté, épris de poésie jusque dans les tâches les plus humbles, était presque tout entier canalisé par la vie religieuse, qui prenait bien souvent l'aspect d'un paganisme à peine christianisé.
On a pu dire que les cathédrales étaient la Bible du pauvre et plus que cela: le grand livre par lequel le fidèle entrait en contact avec l'histoire, les sciences, la morale, les mystères du passé et de l'avenir. Ce qui subsiste des cathédrales du XIIe siècle ne nous donne qu'une idée incomplète de leur magnificence; n'oublions pas que non seulement l'intérieur, mais l'extérieur en était peint et doré; que les statues et les tympans des grands portails étaient polychromes; que les nefs, surchargées de fresques, étaient de plus ornées de tapisseries, de tissus d'Orient, d'oriflammes de soie brodées d'or; que les autels, les châsses, les images miraculeuses représentaient des trésors d'un prix incalculable, tant par la quantité de matières précieuses que par la beauté du travail.
Le peuple était pauvre; la bourgeoisie déjà riche, mais égoïste, comme toute bourgeoisie; la noblesse, ostensiblement dépensière; les prélats souvent occupés à imiter les nobles dans leurs guerres comme dans leur faste. Si de ces terres sans cesse ravagées par les famines, les incendies, les guerres grandes et petites, les épidémies et le banditisme à toutes les échelles, des cathédrales d'une richesse aussi inouïe ont pu surgir, il faut croire que la foi des hommes de ce temps-là était d'une trempe toute particulière. Ce désir têtu d'incarner, de matérialiser le divin montre à la fois un amour profond de la matière et du monde créé et un mépris assez grand de la vie humaine. C'est la foi des adorateurs de reliques qui a construit les cathédrales.
Les hommes de la France du Nord n'étaient pas tous, tant s'en faut, des fervents de la papauté; en 1204, les évêques français tiennent tête aux légats qui veulent contraindre Philippe Auguste à la paix avec l'Angleterre; les barons ont sans cesse d'âpres luttes d'intérêts avec les abbés et les évêques et le peuple n'est jamais content de payer la dîme. Il n'en reste pas moins vrai que le peuple de France était, l'époque, profondément catholique et attaché à ses lieux de pèlerinage comme à un patrimoine national. Or, l'hérésie qui avait gagné les pays occitans avait caractère si farouchement opposé à toutes les manifestations de la vie de l'Église que les missionnaires envoyés par le légat Arnaud pour prêcher la croisade ne devaient avoir aucun mal à provoquer l'indignation des foules contre les "ennemis de Dieu".
Les récits dont le chroniqueur Pierre des Vaux de Cernay se fait l'écho devaient être l'objet de conversations et de commentaires dans toutes les villes de France, et ce n'était certainement pas les seuls ni les plus atroces. L'image de l'homme qui a souillé l'autel d'une église, celle des soldats du comte de Foix qui coupent en morceaux un chanoine et se servent des bras et des jambes d'un crucifix pour piler des épices devaient hanter la pensée des croyants les plus tièdes. Les hérétiques profanaient les calices et déclaraient que celui qui reçoit l'hostie absorbe un démon; ils blasphémaient contre les saints en les déclarant damnés. Les paroles du pape "Ils sont pires que les Sarrasins" correspondaient à la plus stricte vérité. Les auditeurs des envoyés de Rome n'étaient pas humanistes: l'image d'un crucifix mutilé les révoltait sans doute plus que celle d'un homme coupé en morceaux.
Le roi, qui raisonne en homme politique, n'a pas l'air de s'émouvoir outre mesure des progrès de l'hérésie; il est aussi peu favorable à la croisade qu'il peut décemment l'être et écrit à Innocent III qu'il ne se croisera que si le pape oblige le roi d'Angleterre à ne plus attaquer la France et s'il ordonne un impôt spécial pour l'entretien de la croisade. D'autre part, il doute de la légitimité de l'opération. En février 1209, au moment où dans toutes les provinces des milices se groupent, les dons affluent, les chefs organisent les préparatifs du grand départ, Innocent III écrit à Philippe Auguste: "C'est à toi que nous confions tout spécialement l'affaire de l'Église de Dieu. L'armée des fidèles qui se lèvent pour combattre l'hérésie doit avoir un chef à qui elle obéisse tout entière. Nous supplions Ta Sérénité Royale de choisir, par un acte de son pouvoir propre, un homme actif, prudent et loyal, qui conduise au bon combat, sous ta bannière, les champions de la cause sainte7". Le roi refusera non seulement sa présence et celle de son fils, mais aussi la responsabilité de désigner un mandataire qui pût agir en son nom. La croisade, pour laquelle le pape voulait se servir du roi de France comme de l'instrument légal et séculier de la justice de Dieu, resta ce qu'elle était en fait: une guerre menée par l'Église. Les barons qui prendront la croix seront les soldats de l'Église et le chef que l'armée des croisés se choisira sera le légat du pape, l'abbé de Cîteaux, Arnaud-Amaury.
Le tour du roi de France viendra plus tard.
Parmi les barons qui se croisèrent en 1209, on connaît les noms d'Eudes II duc de Bourgogne, d'Hervé IV comte de Nevers, déjà cités; de Gaucher de Châtillon comte de Saint-Pol, de Simon de Montfort, de Pierre de Courtenay, de Thibaud comte de Bar, de Guichard de Beaujeu, de Gauthier de Joigny, de Guillaume de Rocher sénéchal d'Anjou, de Guy de Lévis, etc. Mais les évêques sont, eux aussi, chefs de guerre: les archevêques de Reims, de Sens, de Rouen; les évêques d'Autun, de Clermont, de Nevers, de Bayeux, de Lisieux, de Chartres, ont pris la croix et amènent chacun un corps expéditionnaire composé tant de guerriers que de pèlerins ignorants dans l'art de la guerre mais ardent à servir la cause de Dieu.
Un an s'est écoulé depuis la mort de Pierre de Castelnau. Le Languedoc voit se préciser la menace suspendue sur lui.
Le comte de Toulouse, personnage qui pouvait inspirer quelque considération à ceux des croisés qui faisaient partie de sa caste, était discrédité par les bruits qui l'accusaient d'avoir pris part au meurtre du légat. Mais, comme ce crime n'eût peut-être pas suffi à provoquer la réprobation générale, les barons de France étant eux-mêmes sans cesse en guerre contre le clergé, les propagandistes se sont vus forcés de noircir le tableau. Pierre des Vaux de Cernay, fidèle interprète du clan extrémiste du parti croisé, rend le comte odieux à plaisir.
Ses mœurs sont exécrables: il ne respecte guère le sacrement du mariage; péché véniel: parmi les barons de l'époque, les maris fidèles sont plutôt rares. Le fait est qu'il s'est marié cinq fois et deux de ses épouses répudiées vivent encore; Il y a mieux: dans sa jeunesse, il avait séduit des concubines de son père; grief quelque peu tardif: le comte a cinquante-deux ans. Sa participation au meurtre de Pierre de Castelnau est notoire (bien que le pape lui-même n'ait osé avouer qu'une quasi-certitude). Pour prouver ses assertions, le chroniqueur raconte que Raymond VI a promené le meurtrier à travers ses domaines, l'a exhibé en disant à qui voulait l'entendre: "Vous voyez cet homme? C'est le seul qui m'aime véritablement et qui ait su faire ce que je désirais8..." Ces paroles sembleraient dictées par la plus amère ironie; mais Raymond VI ne pouvait se permettre de plaisanteries de ce genre. Politique prudent, toujours soucieux de ménager tous les partis, le comte de Toulouse, eût-il même ordonné le meurtre (ce qui est peu probable), ne pouvait que désavouer l'exécuteur. S'il ne l'a pas châtié, c'est par égard pour l'opinion Publique de son pays: le meurtrier de l'impopulaire légat était sans doute regardé comme un héros par les siens.
Le pape et les chefs de la croisade ne s'y trompaient pas; c'était le pays tout entier qui portait la responsabilité de ce crime et le comte ne devait être livré à l'exécration des foules qu'en tant que chef de ce pays. Sa faute était, il faut le dire, énorme aux yeux de tout homme fidèle à l'Église: il ne se contentait pas de l'indifférence, il semblait ouvertement encourager l'hérésie.
Là-dessus, les témoignages sont nombreux, quoique suspects, venant des ennemis du comte. Il s'entoure, dit-on, d'hérétiques et leur montre le plus grand respect, il songe même à faire élever son fils par leurs ministres. Son impiété est notoire: il ne se contente pas de persécuter systématiquement églises et couvents; en assistant à la messe, il fait parodier par son bouffon les gestes du prêtre. On le voit se prosterner devant les ministres hérétiques; un jour, dans un mouvement de colère, il s'écrie: "On voit bien que c'est le diable qui a créé le monde, rien n'y va comme je le voudrais!" Bref, l'Église (en la personne de Pierre des Vaux de Cernay, homme enclin à des violences de langage, mais reflétant sans doute assez bien l'état d'esprit de son milieu) traite le comte de "membre du diable, fils de perdition, criminel endurci, boutique à péchés9"; Innocent III lui-même n'est guère plus tendre: "tyran impie et cruel, homme pestilent et insensé10".
Mais c'est là justement que l'Église et les croisés se heurteront à une des plus grandes difficultés de leur entreprise: les choses sont beaucoup moins simples qu'ils ne voudraient le croire. Le tyran impie fait brusquement volte-face et rappelle à ses adversaires qu'il est toujours le seigneur d'une terre chrétienne. Après avoir tenté de faire intervenir en sa faveur le roi de France et l'empereur d'Allemagne (maladresse insigne: les deux monarques étant à couteaux tirés, aucun des deux ne pardonnera au comte sa démarche auprès de l'autre), Raymond VI se déclarera fils obéissant de l'Église et prêt à se soumettre à toutes les conditions que le pape voudra bien lui imposer.
La décision du comte de Toulouse a été sévèrement critiquée par les historiens qui y ont vu une preuve de lâcheté ou du moins de faiblesse. Mais Raymond VI n'était certainement pas de ceux qui disent: "tout est perdu, fors l'honneur", son honneur personnel semblait l'intéresser fort peu, il cherchait à limiter les dégâts. Il ne faut pas oublier que la majorité de ses sujets étaient catholiques, et que c'est par conséquent eux, autant que les hérétiques, que les malheurs de la guerre risquaient d'atteindre. À ses sujets catholiques, le comte devait cette preuve de sa bonne foi; à ses adversaires, il coupait l'herbe sous les pieds: s'il n'était plus l'ennemi à combattre, contre qui partaient-ils en guerre? L'ennemi sans visage qu'était l'Hérésie n'avait ni armée, ni quartier général, ni places fortes, ni pape, ni roi; la guerre, privée d'objectif précis, perdait la moitié de sa raison d'être.
Il était beaucoup trop tard pour arrêter l'élan de l'armée de Dieu. La soumission du comte ne désarma personne: elle exaspéra plutôt la haine de ses adversaires dont cette manœuvre affaiblissait la position sans servir le moins du monde les intérêts de l'Église. Et l'armée des soldats du Christ envahira un pays conscient de subir une injustice flagrante, et transformera une guerre religieuse en guerre nationale.
III - LA TERRE OCCITANE
Pendant que les croisés se préparaient à la guerre, Innocent III, tout en vouant le comte de Toulouse à toutes les malédictions divines et humaines, négociait avec lui. Le comte promettait une soumission totale. Il voulait seulement traiter des termes de sa capitulation avec un autre légat qu'Arnaud-Amaury, son ennemi juré. Le pape lui expédie Milon, notaire du Latran, accompagné du chanoine génois maître Thédise. Si le comte croit avoir affaire à des juges plus cléments, il se trompe: les deux hommes ne feront qu'obéir aux ordres de l'abbé de Cîteaux. "C'est l'abbé de Cîteaux qui continuera à tout faire... aurait dit Innocent III à Milon, tu ne seras que son instrument. Il est suspect au comte, toi tu ne l'es pas".
En fait, le pape veut jouer au plus fin, et opposer une fausse clémence à une fausse soumission. Voici ce qu'il écrit à ses mandataires (l'abbé de Cîteaux et les évêques de Riez et de Couserans): "On nous a demandé avec insistance quelle attitude les croisés devaient prendre à l'égard du comte de Toulouse. Suivons le conseil de l'apôtre qui a dit: "J'étais astucieux: je vous ai pris par la ruse..." Usez d'une sage dissimulation: laissez-le (le comte) d'abord de côté pour agir contre les rebelles. Il sera d'autant moins facile d'écraser ces satellites de l'Antéchrist qu'on les aura laissés se grouper pour la résistance commune. Rien de plus aisé, au contraire, d'en venir à bout, si le comte n'accourt pas à leur aide, et peut-être que la vue du désastre lui fera faire un retour en lui-même. S'il persiste dans ses mauvais desseins, on pourra lorsqu'il sera isolé et réduit à ses seules forces, terminer par lui et l'accabler sans grand effort".
C'est à Saint-Gilles, lieu de la mort de Pierre de Castelnau, que se déroulera, en juin 1209, la cérémonie de l'amende honorable. Il semble qu'avant d'abattre l'ennemi, l'Église, en la personne des légats, ait tenu à montrer au peuple ce que pèse la puissance des grands de ce monde face à la puissance de Dieu.
Trois archevêques et dix-neuf évêques seront rassemblés dans la grande église de Saint-Gilles, cette magnifique église qui, aujourd'hui encore, nous donne une idée de ce qu'étaient le faste et la piété des anciens comtes de Toulouse. Une foule de hauts dignitaires, de vassaux, de clercs se presse tant dans l'église que devant le parvis. Entre les deux grands lions qui gardent l'entrée de la porte centrale, des reliques du Christ et des saints sont disposés. Le comte, en costume de pénitent, la corde au cou, cierge en main, nu jusqu'à la ceinture, est amené sur le parvis et là, la main sur les châsses, il jure obéissance au pape et aux légats. Alors, Milon lui passe au cou son étole, l'absout et, lui frappant le dos d'une poignée de verges, le fait entrer dans l'église. La foule, qui entre à sa suite dans l'église, est si compacte qu'il ne peut plus en ressortir et on le fait passer par la crypte où se trouve enseveli le corps de Pierre de Castelnau. Les contemporains, qui voient des signes partout, regardent cette coïncidence comme un juste châtiment du crime présumé.
Avant cette cruelle cérémonie, le comte avait dû souscrire aux conditions suivantes: il devait faire amende honorable à tous les évêques et tous les abbés avec lesquels il était en conflit; se dépouiller de ses droits sur les évêchés et les établissements religieux; chasser les routiers ou troupes de mercenaires qui défendaient ses territoires; ne plus confier de charges publiques à des Juifs; ne plus protéger les hérétiques et les livrer aux croisés; tenir pour hérétiques toutes les personnes dénoncées comme telles par le clergé; s'en rapporter à la décision des légats pour toutes les plaintes déposées contre lui; observer et faire observer toutes les clauses des paix et trêves établies par les légats. Bref, par cet acte de soumission le comte acceptait une véritable dictature de l'Église sur ses terres. Il devait considérer les clauses de ce traité difficilement réalisables dans la pratique et se disait aussi sans doute que le temps travaillerait pour lui.
Aussitôt absous, Raymond VI prend une initiative inattendue: il demande lui-même à prendre la croix. Cette décision, de la part d'un prince qui a toujours fait son possible pour ménager les hérétiques, est quelque peu surprenante. "...Perfidie nouvelle! écrit Pierre des Vaux de Cernay. Cet homme ne prenait la croix que pour rendre sa personne et ses biens intangibles et dissimuler ses néfastes projets11". Ce qui semble l'évidence même. Mais Raymond VI pensait gagner, par-dessus la tête des légats dont il n'espérait plus rien, la confiance du pape. En effet, Innocent III lui écrira le 26 juillet: "Après avoir été un objet de scandale pour beaucoup te voilà devenu un modèle... Nous ne voulons que ton bien et ton honneur. Tu peux être assuré que nous ne supporterons pas qu'on te fasse tort si tu ne le mérites pas12". Langage diplomatique qui n'engage peut-être pas à grand-chose; mais Raymond VI jouera cette carte jusqu'au bout.
Le comte de Toulouse n'est pas seulement le principal personnage du drame qui va se jouer sur ses terres; sa personnalité est comme l'image des contradictions, des faiblesses, des vertus et des malheurs de son pays et sa conduite est beaucoup moins le résultat de ses propres impulsions, bonnes ou mauvaises, que le relief de la situation où se trouvait la terre occitane à l'époque du désastre. Son caractère privé s'efface devant le rôle qu'il avait à jouer et l'on ne peut même pas dire que la tâche ait été trop lourde pour ses épaules; il semble si bien s'identifier avec la cause de son peuple, qu'il finit par apparaître comme quelque chose de bien plus qu'un chef: un souverain véritablement légitime, dont la fonction est d'être le symbole de son peuple et l'esclave des intérêts de ses sujets. Avec ses faiblesses et ses défauts, il reste, face à des adversaires déshumanisés par la foi, le fanatisme, l'ambition ou simplement l'ignorance, humain jusqu'au bout. Raymond VI avait commis une faute trop lourde de conséquences pour qu'on pût la laisser impunie à une époque où l'on jugeait et condamnait les peuples sur la conduite de leurs princes: il a été un souverain tolérant.
La tolérance ne passait pas pour une vertu et, sans doute, Raymond VI ne s'est-il jamais vanté de la posséder. Ses aïeux, son père avaient brûlé des hérétiques, comme l'on fait les rois, leurs voisins. Mais, vers la fin du XIIe siècle, l'hérésie avait fait de tels progrès qu'ils eût fallu brûler des milliers de personnes et réduire à la mendicité des provinces entières si l'on voulait s'en tenir à la lettre de la loi. Le comte ne pouvait plus persécuter les hérétiques pour la bonne raison qu'ils formaient à présent une partie importante de ses sujets. Ce qui dans les autres pays était encore un scandale monstrueux devenait dans le Midi de la France une espèce de mal inévitable dont on prend son parti et qui finit à la longue par ne plus apparaître comme un mal. "...Pourquoi donc, demande Foulques, l'évêque de Toulouse, au chevalier Pons Adhémar, ne pas les (les hérétiques) disperser et les expulser de vos terres? - Nous ne le pouvons pas, répond le chevalier. Nous avons été élevés avec eux, nous avons parmi eux de nos parents et nous les voyons vivre honnêtement" (Guillaume de Puylaurens). Et l'historien ajoute: "Ainsi l'erreur, sous le voile hypocrite d'une vie honorable, dérobait la vérité à ces esprits peu clairvoyants13".
Tels étaient les faits. Mais il faudrait essayer de comprendre comment un pays, de longue et solide tradition catholique, a pu en arriver à cette acceptation tacite d'une religion qui avait pour but avoué la destruction totale de l'Église. Pour comprendre cela, il faudrait jeter un rapide coup d'œil sur l'histoire de la terre occitane au XIIe siècle, sur sa situation politique et sociale et, surtout, sur le climat spirituel et moral de ces provinces qui étaient à l'époque un des grands foyers de la civilisation occidentale.
Les territoires soumis à la suzeraineté des comtes de Toulouse étaient presque aussi vastes que les terres directement soumises à la couronne de France, mais le "pays de la langue occitane" - de la langue d'oc - n'est pas une grande puissance; c'est tout de même un pays indépendant. Théoriquement, le comte de Toulouse est vassal du roi de France. Il l'est beaucoup moins que le comte de Champagne ou même que le duc de Bourgogne; Paris est loin de Toulouse, la langue du Nord n'est pas celle du Midi, le pouvoir du roi de France dans le Midi est purement nominal. D'autre part, le comte tient une partie de ses domaines du roi d'Angleterre, suzerain tout aussi éloigné et aussi théorique. De grands vassaux du comte de Toulouse sont aussi vassaux du roi d'Aragon et ce roi détient, en plein Languedoc, Montpellier et les vicomtés de Carlat et de Millau. Arles est terre d'Empire. Une telle multiplicité de suzerains est en elle-même une garantie d'indépendance. Si l'empereur est loin, si le roi d'Angleterre est trop occupé par la défense de ses trop vastes domaines contre la puissance grandissante des rois de France, si le roi d'Aragon, qui ne demande pas mieux que d'agrandir ses domaines au-delà des Pyrénées, est pris par son combat permanent contre les Maures, si le roi de France cherche à étendre sa domination vers les frontières naturelles des terres qui entourent la sienne, le comte de Toulouse peut être tranquille. Ses suzerains, dans leur lutte pour les zones d'influence, sont pour lui des protecteurs virtuels et non des maîtres.
Mais ce tableau est encore trop simple: le comté de Toulouse subit tour à tour, au cours du XIIe siècle, les invasions des Anglais et celles des Aragonnais, qui ravagent le Toulousain et le Rouergue. Raymond V, le père de Raymond VI, passe sa vie à se défendre contre ses dangereux protecteurs; et, en 1181, il compte, dans les rangs des alliés de son adversaire le roi d'Aragon, ses principaux vassaux, les comtes de Montpellier, de Foix et de Comminges et le vicomte de Béziers. Il est le beau-frère de Louis VII dont il a épousé la sœur. Constance, et le roi vient, en effet, à son secours pour le protéger contre l'Anglais; il se comporte envers sa femme de telle façon qu'il est bientôt obligé de se brouiller avec le roi de France et de transférer son hommage au Plantagenet; mais le vieux roi d'Angleterre, Henri II, est en guerre contre son fils, Richard Cœur de Lion, et celui-ci, à la tête de son armée de routiers, envahit le Toulousain. Tout ceci montre que la politique de bascule a ses dangers; mais les comtes de Toulouse ne renonçaient pas à leur indépendance. Les rois de France, d'Angleterre et d'Aragon leur donnaient leurs sœurs en mariage et recherchaient leur alliance: sur leurs terres, les Raymond ne devaient obéissance à personne.
Mais ces mêmes comtes de Toulouse étaient presque aussi peu maîtres dans leur province que les rois de France ne le sont dans le comté de Toulouse. Les Trencavel, vicomtes de Béziers, ont un domaine qui comprend le Carcassès, l'Albigeois, le Razès, et leurs territoires, qui s'étendent du Tarn aux Pyrénées, sont terres vassales du roi d'Aragon. Pendant tout le XIIe siècle, les comtes de Toulouse lutteront sans succès contre la puissance grandissante des Trencavel. Les comtes de Foix, retranchés dans leurs montagnes, ne sont pas davantage soumis à l'autorité des comtes de Toulouse, avec lesquels ils ne s'allient que pour lutter contre les Trencavel. Les ligues de vassaux contre le comte se forment et se défont perpétuellement, au gré des intérêts de chaque participant.
Ces exemples donneraient une triste idée de la situation politique du Languedoc à la veille de la croisade, si l'on ne tenait pas compte du fait qu'il en allait à peu près de même pour tous les royaumes d'Occident, que les rois de France ont eu à lutter contre des ligues de vassaux. Qu'en Angleterre la lutte systématique des féodaux contre le pouvoir royal aboutit à la Grande Charte; que l'Allemagne et l'Italie sont le théâtre de guerres chroniques allant de la lutte pour l'Empire aux rivalités de clochers. Bref, à cette époque, où le lien moral qui liait l'homme à son seigneur et à son Église était une force réelle et indiscutée, la conduite de chacun semblait inspirée par le dicton populaire: "Charbonnier est maître en sa maison".
Ces hommes qui ne parlent jamais de liberté agissent le plus souvent comme s'ils n'avaient d'autre idéal et d'autre bien à défendre que leur liberté. On voit des villes se révolter contre leur seigneur légitime par peur de voir restreindre leur liberté de se gouverner elles-mêmes, les évêques tenir tête aux rois, voire aux papes, les seigneurs faire la guerre aux évêques, tous semblent mettre leur point d'honneur dans le refus de toute contrainte. Dans le Midi de la France, cet état d'esprit avait atteint son apogée, car le pays était de civilisation ancienne, riche, orgueilleux de son passé et avide de progrès.
Nous venons de voir que le comte de Toulouse n'est pas maître de ses vassaux; mieux que cela: sur ses propres terres qui lui sont par tradition fidèles, il ne peut lever une armée et est obligé de faire appel à des mercenaires. Bien souvent s'il veut faire appel à ses vassaux, il n'a même pas à qui s'adresser: alors que dans le Nord l'héritage d'un seigneur passait à sa mort au fils aîné, dans le Midi le fief était partagé entre tous les enfants et, après trois générations, un château pouvait appartenir à cinquante ou soixante "co-seigneurs", lesquels à leur tour, par mariage ou succession, pouvaient être aussi "co-seigneurs" d'autres châteaux; les grandes propriétés n'avaient pas de chef, mais tout au plus un gérant. Les frères et cousins ne s'accordant pas toujours entre eux, un fief, même important, ne constituait pas une unité militaire, comme c'était le cas en France.
Le comte n'est pas davantage maître dans les grandes villes qui sont des républiques autonomes, n'obéissant à leur suzerain que tant qu'il les laisse tranquilles. La prospérité des villes dans ce pays de passage et de commerce était plus grande, plus notoire que partout ailleurs. Les privilèges des bourgeois sont immenses. Tout habitant de la cité devient homme libre du jour où il s'y fixe et sa qualité de citoyen garantit si bien sa sécurité que nul autre pouvoir que les tribunaux de sa ville n'a droit de le juger, eût-il commis un délit à cent lieues des murs de sa cité.
La ville est gouvernée par des consuls, survivance du droit romain qui forme encore les bases de la juridiction locale. Les consuls ou capitouls sont élus parmi les bourgeois et les nobles de la cité et, ici, le bourgeois est l'égal du chevalier en droit et en fait; on voit là un relâchement de l'esprit de caste que la noblesse du Nord ne pardonnera ni aux nobles ni aux bourgeois du Midi. Le riche bourgeois est un grand seigneur, si sûr de ses droits qu'il tient tête au chevalier. Pour la défense de leurs libertés, les bourgeois ne reculent devant rien: ainsi en 1161, on voit les citoyens de Béziers tuer leur vicomte et rouer de coups leur évêque dans l'église de la Madeleine. Ce crime, il est vrai, donna lieu à des représailles terribles; mais l'esprit d'indépendance de ces petites républiques ne faisait que se forger et s'exaspérer dans leur lutte contre les abus de pouvoir des princes.
Au milieu de ce désordre organisé, l'Église, force supranationale, disciplinée en principe, obéissant à un chef unique, était condamnée, par la force des choses, à céder à la contagion. Elle était cruellement persécutée en tant que puissance temporelle; sa richesse excitait toutes les convoitises, son autorité semblait être une atteinte à l'indépendance de chacun: les évêques avaient le verbe haut et la poigne dure, ils se sentaient, de droit, maîtres du pays après Dieu et le pape. En fait, rien ne justifiait leur prétention, ils étaient, là comme partout ailleurs, et plus que partout ailleurs, de grands féodaux, disposant de vastes terres, de revenus considérables et souvent plus préoccupés par la défense de leurs intérêts temporels que par la direction spirituelle des habitants de leur diocèse. Ils avaient une excuse: il fallait hurler avec les loups, le patrimoine terrestre de l'Église était une garantie de sa liberté morale et ce patrimoine était durement menacé.
Indociles à la voix du pape, ils sont, de plus, extrêmement impopulaires dans leurs diocèses, le peuple ne les soutient pas contre les attaques des féodaux, il leur reproche leur luxe, leur indifférence pour les pauvres, leur passion pour les croisades. Les abbés, également princes sur leurs terres, grâce à la richesse de leurs couvents, ne sont guère mieux vus. Le bas clergé, négligé par ses supérieurs, tombe dans un tel discrédit que les évêques ont du mal à recruter de nouveaux cadres et ordonnent les premiers venus. De l'aveu de tous les écrivains catholiques de l'époque, l'Église, dans le Midi de la France, n'avait ni autorité ni prestige; elle était "morte".
Les peuples catholiques en étaient réduits ou bien à se contenter d'une Église qui eût induit en tentation les meilleurs, ou bien à chercher une autre issue à leurs aspirations spirituelles.
Ce pays, que rémunération des faits cités plus haut tendrait à faire apparaître comme une espèce d'enfer où régnent la discorde et l'anarchie, était en fait un pays où la vie était moins dure qu'ailleurs et même un pays uni. Seulement, son unité était intérieure plutôt qu'apparente, c'était l'unité d'une civilisation, le lien invisible que crée entre les fils d'une même terre une façon commune de penser et de sentir. Ce n'était pas seulement la richesse du bourgeois qui forçait le chevalier à le respecter, et à ces comtes de Toulouse éternellement absorbés par leurs disputes avec leurs évêques et leurs vassaux, le peuple témoignera toujours un amour et un respect sans condition.
En dépit de guerres périodiques qui n'occupaient d'ailleurs qu'un petit nombre de combattants, mais causaient toujours des dégâts dans les campagnes, le peuple ne passait pas pour pauvre. Des témoignages du temps (cf. Étienne, abbé de Sainte-Geneviève, futur évêque de Tournai)14 nous apprennent que les routes étaient peu sûres, infestées de Basques et d'Aragonnais, les campagnes incendiées, les maisons en ruines: les barons du Midi, dans leurs guerres, se servaient de routiers, faute d'armée régulière. Mais les villages situés le long des routes sont rares, la plupart sont des bourgs fortifiés ou dépendant d'une ville, le paysan est bien souvent bourgeois et cultive sa vigne sous les murs de sa cité. La terre était fertile et la prospérité des villes se reflétait sur la vie des paysans. Non seulement les bourgeois, mais beaucoup de paysans sont des hommes libres et dans une grande partie des fiefs, l'absence d'un seigneur unique fait que les serfs ne dépendent pratiquement de personne.
Le bourgeois est un privilégié: il est non seulement libre, mais protégé par sa communauté et le développement de plus en plus grand du commerce et de l'artisanat est en train d'élever le petit peuple lui-même à la dignité d'une classe forte et consciente de ses droits.
La puissance de la bourgeoisie joue un rôle prépondérant dans l'évolution du Languedoc. La terre des troubadours est la terre du grand commerce, la terre où l'importance sociale du bourgeois commence à éclipser celle du noble. Il est vrai que, par snobisme, ou par un reste de complexe d'infériorité, les bourgeois cherchent encore à acquérir des titres de noblesse, mais c'est pour eux un luxe gratuit; quand une bourgeoisie est traitée en égale par l'aristocratie, c'est qu'elle est, en fait, la plus forte.
Le Rhône et la Garonne sont de grandes artères par lesquelles circulent toutes les marchandises et matières premières, du Midi au Nord et du Nord au Midi. Marseille, Toulouse, Avignon, Narbonne sont de grands ports de commerce depuis l'antiquité. Les croisades, qui ont enrichi toutes les cités d'Occident, ont fait la fortune du Languedoc, terre de passage et clef de l'Orient; les partants venaient y acheter l'équipement nécessaire pour le voyage, les revenants y vendaient le butin rapporté; la noblesse du pays, aventureuse et vagabonde, a bien souvent été obligée de céder à vil prix sa terre et ses biens aux banquiers qui finançaient les expéditions en Terre sainte. À ces suzerains toujours à court d'argent les communes achèteront ensuite leurs libertés et privilèges, dont ils ne se laisseront plus dépouiller. Les bourgeois ne reconnaissent d'autres maîtres que leurs consuls, le comte de Toulouse n'a pas d'autorité légale dans sa propre ville et n'est obéi que tant qu'il respecte les lois de la commune.
Tout bourgeois a le droit de vendre, d'acheter, de troquer sans impôts ni taxes. Les mariages sont libres. Les ressortissants de pays étrangers jouissent des droits du citoyen, sans distinction de religion ou de race. La commune est le centre de la vie sociale; l'élection du consul est une grande fête publique, qui égale en faste les fêtes religieuses, avec processions et carillon des cloches de toutes les églises. La vie du citoyen, de la naissance à la mort, est liée à la vie de la cité; et la bénédiction nuptiale donnée par le prêtre n'égale pas en solennité le moment où les mariés, menés devant les consuls revêtus de leurs robes rouges bordées d'hermine, présentent leur offrande de fleurs et de branches de fruits. La vie publique de la commune, toute pénétrée cependant de l'esprit et des rites de la religion, est un grand facteur de laïcisation.
Cités de commerce, les villes méridionales étaient d'une opulence que celles du Nord pouvaient à juste titre leur envier: Paris ne pouvait se comparer à Toulouse, ni Troyes ou Rouen à Avignon. La magnificence des églises romanes du Midi que les siècles et les guerres ont épargnées peuvent nous aider à imaginer ce que devait être la beauté de ces villes de grand négoce, de grand artisanat, foyers de toutes les industries, de tous les arts, centres religieux et culturels de première importance. Les grandes villes possédaient des écoles de médecine, de philosophie, de mathématiques, d'astrologie; non seulement Toulouse, mais Narbonne, Avignon, Montpellier, Béziers, étaient, avant la création nominale des universités, des villes universitaires. À Toulouse, la philosophie d'Aristote était enseignée d'après les récentes découverts des philosophes arabes, alors qu'elle était encore interdite à Paris par les autorités ecclésiastiques, ce qui rehaussait considérablement le prestige de l'école de Toulouse.
Un contact permanent avec le monde musulman s'était établi de bonne heure grâce aux commerçants et médecins arabes venus soit d'Orient, soit d'au-delà des Pyrénées; l'infidèle ne pouvait plus être considéré comme un ennemi. Les Juifs, nombreux et puissants comme ils l'étaient dans tous les grands centres commerciaux, n'étaient pas tenus à l'écart de la vie publique par un préjugé religieux: leurs médecins et leurs professeurs jouissaient, dans les cités, de l'estime générale, ils avaient des écoles où ils donnaient des cours gratuits, parfois publics, et auxquels les étudiants catholiques ne trouvaient nullement inconvenant d'assister. On connaît les noms du docteur Abraham, de Beaucaire, du sage Siméon et du rabbin Jacob, à Saint-Gilles. L'influence des apocryphes judaïques et musulmans se répand dans le clergé et même dans le peuple. Bien plus, on voit des Juifs parmi les consuls et les magistrats de certaines villes.
Que ce fût un bien ou un mal, une chose est certaine: dans ce pays-là, la vie laïque prenait décidément le pas sur la vie religieuse et menaçait de l'étouffer.
La noblesse suivait le courant. Certains historiens nous la représentent vaine, futile, "dégénérée", d'autres voient en elle la plus belle incarnation de l'esprit chevaleresque et courtois de l'époque. Ce qui est sûr, c'est que c'était, dans sa majorité, une noblesse embourgeoisée, cultivée, plus civile que militaire, bien qu'à l'occasion la chevalerie occitane ne le cédât pas en bravoure à celle du Nord; bref, une noblesse qui commençait à oublier que sa destination première et sa traditionnelle raison d'être était le métier des armes. Ce qui ne l'empêchait pas d'être batailleuse: elle le devenait terriblement lorsque ses intérêts étaient en jeu.
Dans un pays morcelé et décentralisé, où il n'y avait plus de grande cause à défendre, chacun se battait pour son propre compte, les ennemis de la veille devenaient amis, et vice versa, avec la plus grande facilité, et à la longue les petites rivalités locales n'étaient plus prises au sérieux par les intéressés eux-mêmes. D'ailleurs, nobles et bourgeois, s'ils ne s'entendaient pas toujours entre eux, s'entendaient du moins pour empiéter systématiquement sur les droits de l'Église, puissance affaiblie, impopulaire, donc facile à attaquer. On voit les évêques se ruiner dans les guerres qu'ils ont à soutenir contre les grands et les petits barons. Ce genre de guerre n'a, pour les nobles, rien d'exaltant. Du reste, leur esprit est ailleurs.
Le temps est loin où l'Église presque seule fournissait ce que nous pourrions appeler la classe des intellectuels. À présent, le laïc a depuis plus d'un siècle conquis le droit à la parole écrite et la langue littéraire des pays chrétiens n'est plus le latin. La littérature commence à tenir une place de plus en plus grande dans la vie, non seulement des classes supérieures mais aussi des classes moyennes. Français du Nord, Allemands et Anglais sont grands lecteurs de romans, le théâtre profane fait son apparition (encore timide) à côté du théâtre religieux et la poésie et la musique sont des arts qui même pour la petite noblesse et la bourgeoisie sont devenus une nécessité quotidienne.
Fait curieux, le Midi de la France n'a pas laissé de littérature romanesque. Sa littérature poétique, en revanche, est la première de l'Europe tant par son ancienneté que par la qualité de son inspiration. Sa supériorité est universellement reconnue; elle est imitée jusque dans les pays de langue germanique et, pour les poètes français, italiens et catalans, la langue occitane est la langue littéraire par excellence. (N'oublions pas que Dante avait d'abord songé à écrire La Divine Comédie en langue d'oc).
S'il nous est impossible de penser à la noblesse du Midi sans évoquer aussitôt le nom des troubadours, c'est que cette noblesse était réellement et immodérément passionnée de poésie et cherchait à mettre en pratique, à sa façon, l'idéal littéraire de son temps. Autant dire qu'elle n'avait pas tout à fait les pieds sur la terre, mais à bien examiner les choses, elle était plus réaliste que ne l'était, par exemple, la noblesse du temps de Louis XIV qui regardait comme un honneur suprême le droit d'assister au lever du roi.
L'honneur, pour le gentilhomme méridional du XIIe siècle, se traduisait par un certain mépris des biens de ce monde, uni à une exaltation démesurée de sa propre personnalité. Qu'est cette adoration de la Dame, de l'Amante merveilleuse et inaccessible, sinon le désir de proclamer que si l'on rend un culte, ce n'est pas à la divinité de tout le monde, mais à un objet choisi par le libre consentement de votre volonté?
Des commentateurs sont allés jusqu'à prétendre que la Dame n'était que le symbole soit de l'Église cathare, soit de quelque révélation ésotérique, et il est vrai que les poèmes de certains troubadours ont des accents assez semblables à ceux des poètes mystiques arabes. Sans doute, il ne s'agit là que d'une réminiscence littéraire, car à l'époque personne n'a songé à prendre cette poésie pour autre chose qu'une poésie d'amour. Mais il n'en reste pas moins vrai que la poésie des troubadours semble avant tout chanter une méthode de perfectionnement moral et spirituel au moyen de l'amour, plutôt que l'amour même. Ces tourments, ces soupirs, ces longues attentes et ces morts par métaphore semblent à la fois passionnément sincères et un peu irréels. C'est sa propre beauté d'âme que le poète semble admirer à travers ses souffrances.
Cette société turbulente, égoïste, inquiète, à travers sa prodigalité extravagante (à ne citer que l'exemple de ce seigneur de Venous qui, par bravade, fait brûler vifs trente chevaux sous les yeux de ses invités), à travers son engouement pour les arts les plus inutiles en apparence et sa soif d'amours irréalisables, témoigne pour une certaine manière de vivre qui ne manque pas de noblesse. Sous une frivolité apparente se cache peut-être un désir de détachement, de refus de prendre au sérieux des choses qui n'en valent pas la peine. Le jour du danger venu et la première surprise passée, la noblesse occitane saura se battre et fera preuve d'un patriotisme intransigeant et parfois féroce; sa faiblesse en tant que puissance politique n'est nullement le signe d'un manque de vitalité.
Ce que nous savons, en tout cas, c'est que cette noblesse était non seulement indulgente envers l'hérésie, mais qu'elle en a même été le soutien le plus sûr et le plus notoire. C'est parce que la religion nouvelle avait conquis la seule classe de la population qui pût défendre la cause de l'Église par les armes que la croisade avait été jugée nécessaire.
La terre occitane, pays catholique en principe et en fait, était tout naturellement, sans heurts, sans révolte réelle, devenue terre d'hérésie. La nouvelle doctrine y était si bien acclimatée qu'il était déjà impossible de distinguer le bon grain de l'ivraie, il fallait ou ne pas agir du tout, ou se résigner à frapper au hasard. Dans cette guerre impitoyable qui durera plus de dix ans, les hérétiques sembleront n'être plus qu'un prétexte, les chefs de la croisade viseront à l'écrasement du pays tout entier.
Mais la croisade, loin de détruire l'hérésie, lui redonnera des forces nouvelles, il faudra un siècle pour en venir à bout et on n'y parviendra qu'au prix de l'étouffement progressif des forces vives du pays.
3 10 mars 1204.
4 Pierre des Vaux de Cernay, ch. III.
5 Guillaume de Puylaurens, ch. X.
6 "Chanson de la Croisade", ch. VI, 131-134.
7 Lettre d'Innocent III à Philippe Auguste, 9 février 1209.
8 Pierre des Vaux de Cernay, ch. LXIV.
9 Pierre des Vaux de Cernay, ch. IV.
10 Lettre d'Innocent III à Raymond VI, 20 mai 1207.
11 "Chanson de la Croisade", ch. VI, 131-134.
12 Lettre d'Innocent III à Raymond VI.
13 G. de P., ch. IX.
14 Lettres d'Étienne de Tournai, nouv. éd. par l'abbé Desilve, Valenciennes, Paris, 1893.
CHAPITRE II
L'HÉRÉSIE ET LES HÉRÉTIQUES
I - ORIGINES
L'existence des hérésies est inséparable de l'existence même de l'Église: là où il y a dogme, il y a hérésie; et depuis les origines, l'histoire de l'Église chrétienne est une longue suite de luttes contre diverses hérésies, luttes aussi âpres et aussi sanglantes que celles qui opposèrent les communautés chrétiennes aux non-chrétiens. Mais à partir du VIe siècle, l'Europe occidentale, mal remise du choc des grandes invasions et toujours menacée d'être envahie de nouveau, jouit d'une relative stabilité religieuse et l'autorité de l'Église est théoriquement respectée15.
Or, l'hérésie, ou plutôt les hérésies pullulaient partout. Les survivances de l'arianisme et du manichéisme vaincus resurgissaient sans cesse, tantôt sous forme de compromis tacite avec l'orthodoxie, tantôt sous forme d'opposition ouverte; de plus, les abus inévitables à l'existence d'une Église établie provoquaient sans cesse des protestations, des tendances réformatrices qui prenaient souvent le caractère d'hérésies, c'est-à-dire de divergences avec la doctrine officielle. Les hérésies apparaissaient dans les campagnes, où elles étaient peut-être une survivance à peine christianisée du mysticisme celtique; dans les couvents, où elles étaient le fruit de méditations de moines à l'esprit aventureux; dans les chaires de théologie; dans les villes, où elles prenaient le caractère de révoltes à tendance sociale.
Mais dans le Nord de l'Italie et dans le Midi de la France, Rome avait à faire face à une situation totalement différente: il ne s'agissait plus de manifestations d'indépendance locales et individuelles, mais d'une véritable religion rivale qui s'installait en plein cœur de la chrétienté et gagnait du terrain par son assurance d'être la seule vraie religion. Les moyens de persuasion traditionnels employés par l'Église contre ses fils égarés se heurtaient à un mur inébranlable: ces hérétiques-là n'étaient plus des catholiques dissidents, ils puisaient leur force dans la conscience d'appartenir à une religion qui n'a jamais rien eu à voir avec le catholicisme, à une religion plus ancienne que l'Église.
(Il ne faut pas, du reste, perdre de vue le fait qu'une bonne partie des hérétiques, tant Italiens qu'Occitans, se composait de vaudois et d'autres sectes à tendance réformatrice, que l'Église eût sans doute réussi, à la longue, à ramener dans son sein par une politique plus compréhensive. Mais comme ces mouvements de réforme un peu extrémistes ont fini par être confondus avec la grande hérésie, le catharisme, c'est de celui-ci que nous avons à parler avant tout).
La religion des cathares, ou des "purs" venait d'Orient. Les contemporains les traitaient de manichéens et d'ariens. En fait, la plupart des sectes hérétiques qui apparaissent en Europe occidentale à partir du XIe siècle sont traitées de "manichéennes". C'est une façon de parler, les hérétiques ne se réclament jamais de Manès, et il est certain que les diverses Églises de tendance manichéenne avouée qui s'étaient implantées en Espagne, en Afrique du Nord et même en France avaient depuis longtemps renoncé à cette redoutable filiation qui les vouait aux anathèmes et aux bûchers. Il n'y avait plus de manichéens, il n'y avait plus que des "chrétiens".
Des historiens modernes (F. Niel) sont allés jusqu'à dire que le catharisme n'était pas une hérésie, mais une religion qui n'avait plus rien de commun avec le christianisme. Il serait plus exact de dire qu'elle n'avait rien de commun avec le christianisme tel que dix siècles d'histoire de l'Église l'avaient formé. La religion cathare est une hérésie qui remonte au temps où les dogmes n'étaient pas encore cristallisés, où le monde antique confronté avec la foi nouvelle tâtonnait, cherchait, tentait par tous les moyens à sa portée de s'assimiler une doctrine étrangère, trop dynamique, trop vivante et dont les contradictions apparentes et réelles n'étaient pas faites pour rassurer des esprits avides de clarté.
Le gnosticisme, essai de synthèse entre la philosophie antique et le christianisme, niant la possibilité de la création par Dieu du mal et de la matière, fut de bonne heure condamné par les Pères de l'Église et ne devait jamais disparaître complètement; son esprit est toujours resté vivace dans les Églises d'Orient et son influence sur la tradition occidentale est plus grande qu'on ne le croit. Les gnostiques influencent la doctrine de Manès qui, héritier de la religion perse, croit à deux principes essentiels, le Bon et le Mauvais; Manès à son tour influence le gnosticisme; et, de ce fait, la grande tradition dualiste, qui pénètre, du reste, par des voies souterraines dans le christianisme orthodoxe, portera le nom de manichéisme.
Mais les manichéens proprement dits, après avoir été cruellement persécutés, après avoir essaimé des sectes puissantes à travers l'Europe et l'Asie et jusqu'en Chine, disparaissent, et le nom du Christ fait oublier celui de Manès. Les pauliciens, secte manichéenne qui tendait ouvertement à christianiser le manichéisme, étaient puissants en Arménie et en Asie Mineure; mais, vaincus par les Grecs en 872, ils durent se soumettre et beaucoup d'entre eux furent déportés dans la péninsule balkanique par l'ordre de l'empereur. C'est là que se formera le noyau de l'Église qui deviendra, plus tard, l'Église cathare.
Dès le VIIe siècle, un peuple venu d'Asie, les Bulgares, avait établi dans les Balkans un royaume au sud du Danube. C'est là que les pauliciens déportés exercent leur mission au moment où (au XIe siècle) les populations slaves de Bulgarie sont évangélisées à la fois par les Latins et par les Grecs. Et le catharisme, tel qu'il était connu dans le Midi de la France, apparaît au Xe siècle en Bulgarie sous le nom de bogomilisme.
Nous ne savons si le fondateur de cette religion s'appelait réellement Bogomil (Aimé de Dieu), si cette appellation était un simple surnom, ou si, suivant une tendance courante chez les Slaves, ce nom sert à désigner un personnage symbolique et collectif que, faute de renseignements précis, on a fini par prendre pour un homme ayant réellement existé. Les auteurs orthodoxes de l'époque parlent également d'un pope Jérémie. Les origines de la secte sont obscures, sa diffusion rapide, son dynamisme incontestable. Non seulement les bogomiles sont de plus en plus nombreux en Bulgarie en dépit des persécutions - car leurs tendances révolutionnaires inquiètent les classes dirigeantes, - mais ils envoient bientôt des missionnaires à travers tout le monde méditerranéen. La religion nouvelle gagne la Bosnie et la Serbie, où elle se maintient si bien qu'elle fait souvent figure de religion d'État et ne sera anéantie qu'au XVe siècle par l'invasion turque.
Au XIe siècle, les bogomiles ont répandu leur doctrine en Italie du Nord et dans le Midi de la France; nous ne savons quelles étaient, dans ces pays, les survivances manichéennes qui ont permis une assimilation aussi rapide du catharisme bulgare; mais la foi cathare a si bien gagné ces contrées, progressant à la manière du levain, que, dès le milieu du XIIe siècle, elle est devenue une religion semi-officielle (quoique persécutée), possédant dans le pays ses traditions, son histoire, son organisation hiérarchique. Le mouvement sort de plus en plus d'une clandestinité désormais inutile. En 1167, l'évêque bulgare Nikita ou Nicétas (appelé "pape" des cathares, ce qui est dû sans doute à une confusion avec le mot "pope", prêtre) arrive de Constantinople pour raffermir dans la vraie tradition les jeunes églises languedociennes et réunit un concile de ministres et évêques cathares à Saint-Félix de Caraman, près de Toulouse. Ce seul fait nous montre à quel point l'Église cathare tenait à proclamer elle aussi son universalité, son unité supranationale, face à l'Église de Rome. Ce n'était plus une secte, ni un mouvement d'opposition à l'Église établie, c'était une véritable Église.
Les pouvoirs publics, effrayés par l'ampleur de ce mouvement, tentent une manœuvre d'intimidation: le comte de Toulouse, Raymond V, songe même à une croisade où participeraient les rois de France et d'Angleterre, le pape Alexandre III envoie le cardinal-légat Pierre de Saint-Chrysogone à Toulouse, à la tête d'une importante délégation; se voyant impuissant à rechercher et à poursuivre les hérétiques, trop nombreux, le légat se contente de faire un exemple: il fait saisir et flageller publiquement un bourgeois de Toulouse connu par son amitié pour les hérétiques, Pierre Mauran, vieillard riche et vénéré de tous; exilé en Terre sainte pour trois ans, Pierre Mauran revient à Toulouse pour être triomphalement élu capitoul. La démarche des légats n'a fait qu'accroître la popularité de la foi nouvelle.
Il est facile d'expliquer le succès du catharisme par la carence des pouvoirs ecclésiastiques, par l'avidité des bourgeois et des nobles heureux d'un prétexte d'attaquer sans remords les biens de l'Église, par le goût des uns et des autres pour la nouveauté. Nous avons vu que le terrain était favorable à l'éclosion d'une religion nouvelle. Mais un terrain favorable n'explique pas grand-chose. Les raisons du succès extraordinaire de cette religion doivent être cherchées dans cette religion elle-même.
II - DOGME
Il ne s'agit pas ici d'examiner en détail les dogmes et la pensée de l'Église cathare; d'abord parce que même le peu de renseignements que nous possédons sur cette Église fournirait la matière de plusieurs volumes; ensuite, ces renseignements par eux-mêmes ne nous apprennent pas ce qu'était réellement cette religion disparue. Autant chercher à retrouver, d'après la forme des os d'un crâne, les traits d'un visage vivant. Quelques indications sommaires sont possibles et beaucoup de suppositions. Cette religion morte de mort violente a été, de plus, dénigrée, diffamée, discréditée d'une façon si systématique qu'à ceux-là mêmes qui n'avaient pas de préjugé défavorable à son égard, elle a fini par apparaître comme quelque chose d'un peu contraire au bon sens. C'est le cas de toutes les religions mortes et, d'ailleurs, la foi catholique des hommes du moyen âge nous est parfois tout aussi étrangère que celle des cathares.
Nous pouvons essayer, après un bref aperçu des dogmes essentiels, de tirer quelques conclusions de faits concrets parvenus jusqu'à nous et tâcher de nous faire une idée, si vague soit-elle, du climat spirituel où cette religion a pu se développer et mûrir.
Une question se pose tout d'abord: le catharisme comportait-il un enseignement ésotérique? Certaines indications, entre autres l'existence du château de Montségur et sa construction très particulière, le donneraient à penser. Mais si cette religion avait ses mystères et ses rites secrets, ils sont demeurés si bien cachés que même des parfaits convertis et passés dans les rangs de l'Inquisition, tel Raynier Sacchoni, n'en ont jamais soufflé mot. Certains points de la doctrine cathare, en particulier ce qui concerne leurs jeûnes et leurs fêtes, sont restés obscurs, pour la bonne raison que les inquisiteurs n'ont pas songé à interroger les hérétiques sur ce sujet. D'une littérature cathare abondante et variée ne subsistent plus que quelques documents échappés par hasard à la destruction16 et dont nous ne savons pas s'ils étaient des ouvrages importants et s'ils reflétaient fidèlement l'esprit de toute l'Église cathare. De plus, comme toute Église, cette Église-là comptait en son sein de nombreuses "hérésies" ou tendances divergentes; sans doute eut-elle aussi des sectes plus particulièrement ésotériques qui ont pu rester ignorées de la majorité des croyants.
Ce qui est certain, c'est que les cathares étaient de grands prédicateurs, et qu'ils ne faisaient nul mystère de leurs croyances. On les voit à plusieurs reprises soutenir des débats théologiques, prendre part à des réunions où leurs docteurs tiennent tête aux légats et aux évêques; et ces discussions publiques - du colloque de Lombers en 1176 à la campagne d'évangélisation menée de 1206 à 1208 par saint Dominique et ses compagnons - montrent que les cathares du Languedoc, en hommes de leur temps et de leur pays, étaient de grands orateurs, des raisonneurs passionnés et qu'ils ne cherchaient nullement à se retrancher derrière le prestige de mystères inaccessibles au profane. Bien au contraire, ils prétendaient fonder leur doctrine sur le bon sens, et reprochaient à l'Église catholique ses mystères qu'ils taxaient de superstition et de magie.
Mais il est également vrai que nous ne connaissons de cette doctrine que ce qui s'oppose aux enseignements de l'Église, c'est-à-dire, en quelque sorte, sa partie négative. (On peut dire aussi qu'étant donné le fait que le catharisme était en désaccord avec l'Église à peu près sur tout, le seul énoncé de ces oppositions peut donner une idée assez complète de sa position doctrinale. Ce n'est pas sûr: il est même plus que probable que toute la partie positive de cet enseignement nous échappe; et c'est elle, pourtant, qui a dû être la cause de son succès).
Nous connaissons donc de cette religion: 1°ses "erreurs", c'est-à-dire ses divergences avec l'Église catholique; 2°une partie de l'aspect extérieur de son organisation, de la vie et des mœurs de ses adhérents, de ses rites et de ses cérémonies. Et là nous nous trouvons à peu près dans la situation d'un homme étranger au christianisme à qui l'on décrirait la célébration de la messe sans lui en expliquer la signification spirituelle, émotionnelle et symbolique. Nous ne pouvons qu'y penser avec le respect dû à l'expression d'une profonde expérience mystique, et ne pas chercher à expliquer.
Les "erreurs" du catharisme sont nombreuses. Elles remontent à la tradition gnostique qui proclamait la séparation absolue de l'Esprit et de la matière. Manichéens, les cathares sont dualistes, et croient à l'existence de deux principes opposés, l'un bon et l'autre mauvais. Si certains théologiens cathares croient que les deux principes existaient dès le commencement, d'autres voient dans le principe mauvais une création secondaire, un ange déchu. Que l'origine du Mal soit placée dans le chaos, au-delà du temps, ou qu'elle soit le résultat du vouloir mauvais d'une des créatures d'un Dieu unique et bon, tous les cathares soutiennent que le Dieu bon n'est pas tout-puissant, que le Mal lui livre une guerre sans merci et lui dispute sans cesse une victoire que la consommation des temps finira tout de même par amener. Cette théorie n'était pas faite pour surprendre, à une époque où les hommes croyaient au Diable aussi fermement qu'à Dieu.
Ce qui, pour les chrétiens, est plus difficile à admettre, c'est l'assertion qui est comme la clef de voûte de tout l'enseignement cathare: le monde matériel n'a jamais été créé par Dieu; il est tout entier l'œuvre de Satan. Sans entrer dans les détails de cosmogonies extrêmement compliquées qui expliquent la chute de Satan et des mauvais anges et la création de la matière, nous pouvons dire que pour les cathares le monde sensible (y compris même, pour la plupart des sectes, le soleil et les astres) était un monde diabolique et une manifestation du mal.
Et l'homme? Il est, lui aussi, une création du Diable, en tant que créature de chair; mais l'esprit du mal, incapable de créer de la vie, aurait demandé à Dieu de l'aider, et d'insuffler une âme dans un corps fait d'argile; Dieu, par bonté, consent à venir en aide à ce créateur désespérément stérile, mais la parcelle d'Esprit divin insufflée dans la grossière enveloppe façonnée par Satan se refuse à y rester; après maintes ruses, le Démon réussit tout de même à la retenir prisonnière. Nos premiers parents, Adam et Ève, auraient été poussés par le Démon à l'union charnelle qui consomma leur enlisement définitif dans la matière. Selon la doctrine de certaines écoles, l'Esprit insufflé par Dieu se transmet par l'acte de la procréation aux descendants d'Adam, et, tel une flamme, se multiplie et se subdivise à l'infini. Mais l'interprétation plus généralement acceptée est celle-ci: le Démon, Lucifer ou Lucibel, aurait soit entraîné dans sa chute, soit fait descendre du ciel à l'aide de toutes sortes de séductions, une foule d'âmes créées par Dieu et vivant près de lui dans la béatitude. C'est de cet inépuisable réservoir d'anges déchus et prisonniers que proviennent les âmes humaines, appelées à une déchéance plus terrible encore par le revêtement d'un corps de chair. (Dans la cosmogonie cathare, le monde matériel n'est que l'aspect le plus bas de la réalité, le plus irrémédiablement éloigné de Dieu; il est toute une gradation d'autres mondes, où d'autres saluts sont possibles).
Le Démon, n'est autre que le Dieu de l'Ancien Testament, Sabaoth ou Jaldabaoth, grossier imitateur du Dieu bon, créateur d'un univers misérable où malgré tous ses efforts il ne parvient à rien créer de durable: les âmes des anges que leur faiblesse a fait descendre dans la matière restent absolument étrangères à cet univers et y vivent dans une souffrance sans nom, séparées de l'Esprit qui était en elles avant leur chute.
Ici encore, il y a des divergences entre les diverses sectes cathares, car certaines prétendent que le nombre de ces âmes perdues est limité, et qu'elles ne font que transmigrer indéfiniment d'un corps dans un autre, par une succession ininterrompue de naissances et de morts, ce qui se rapproche assez de la doctrine hindoue de la réincarnation et du karma. D'autres croient au contraire que chaque nouvelle naissance fait descendre, sinon du ciel du moins de la région intermédiaire entre le ciel et la terre, un de ces anges séduits par le Démon - d'où l'horreur bien connue des cathares pour la procréation, l'acte cruel entre tous qui attire par violence une âme céleste dans le monde de la matière. Quoi qu'il en soit, les cathares admettent généralement la doctrine de la métempsychose, telle que la professent les Hindous, avec la même rigueur mathématique des rétributions posthumes: l'homme qui mène une vie juste se réincarnera dans un corps plus apte à favoriser son progrès spirituel, le criminel, après sa mort, risque de renaître dans un corps chargé de tares et de vices héréditaires, ou même, dans les cas extrêmes, dans le corps d'un animal. Mais en dehors de ces perpétuelles et douloureuses renaissances, aucun espoir n'eût été permis aux âmes déchues, aucune possibilité de retrouver jamais leur vraie patrie, sans la descente d'un Messager du Dieu bon dans le monde de la matière.
Le Dieu bon est toute pureté et toute joie, mais s'il ignore le mal il sait que des âmes célestes sont séparées de lui et voudrait les ramener au ciel. Il ne peut rien faire pour les aider, un abîme les sépare de lui, il ne peut avoir aucun contact avec l'univers créé par le Prince du Mal, et il cherche parmi les êtres bienheureux qui l'entourent dans sa gloire un Médiateur qui pût rétablir le contact entre le ciel et les âmes déchues. Enfin Dieu envoie Jésus, qui est, selon les cathares, soit le plus parfait des anges, soit un des Fils de Dieu, le second, Satan ayant été le premier. Ce terme de Fils de Dieu n'implique pas l'égalité entre le Père et le Fils, Jésus est tout au plus une émanation, une Image de Dieu.
Jésus descend dans le monde impur de la matière, et ne répugne pas à ce contact immonde par pitié pour les âmes auxquelles il doit enseigner le chemin du retour dans leur patrie; mais la pureté ne peut avoir de contact réel avec l'impureté, Jésus n'aura donc que l'apparence d'un corps, il ne s'"incarne" pas, il s'"adombre". Il sera en quelque sorte une vision, s'il fait semblant de se soumettre aux lois terrestres, c'est pour mieux tromper la vigilance du Démon. Mais le Démon, ayant reconnu le Messager de Dieu, cherchera à le faire mourir, et les ennemis de Dieu, aveuglés par l'apparence, croiront que Jésus a réellement souffert et est mort sur la croix. En réalité, le corps non charnel de Jésus ne pouvait ni souffrir, ni mourir, ni ressusciter; il ne subira aucun outrage, et, après avoir enseigné à ses disciples le chemin du salut, il remonte au ciel. Sa mission est terminée, il a laissé sur la terre une Église qui possède en elle l'Esprit Saint, le Consolateur des âmes exilées.
Mais le Démon, qui est le prince de ce monde, a su si bien égarer les hommes, il a si bien détruit l'œuvre de Jésus, qu'une fausse Église s'est substituée à la vraie et a pris le nom de "chrétienne" alors qu'elle est en réalité l'Église du Diable, et enseigne exactement le contraire de la doctrine de Jésus, L'Église chrétienne authentique, celle qui possède le Saint-Esprit, est l'Église cathare.
L'Église de Rome est donc la Bête, la prostituée de Babylone; celui qui reste sous son obédience ne saurait être sauvé. Tout ce qui vient de cette Église est néfaste. Ses sacrements n'ont aucune valeur, bien plus, ce sont les pièges de Satan, car ils font croire aux hommes que des rites purement matériels, des gestes mécaniques peuvent apporter le salut. Ni l'eau du baptême ni le pain de l'hostie ne sauraient être des véhicules de l'Esprit, car ils sont matière impure. L'hostie ne peut être le corps du Christ, car, disent les prédicateurs cathares avec une ironie plutôt simpliste, si l'on réunissait toutes les hosties consacrées dans tous les pays depuis dix siècles, elles eussent formé un "corps" plus grand qu'une montagne.
La croix ne doit pas être un objet de vénération, bien au contraire: elle doit faire horreur, en tant qu'instrument de l'humiliation de Jésus; quand une poutre tombe et écrase le fils de la maison, on ne la met pas à la place d'honneur pour l'adorer et l'encenser. (Argument qui semble prouver que les cathares attachaient tout de même plus d'importance qu'on ne croit à la crucifixion, car pourquoi la croix ferait-elle horreur si Jésus n'avait pas, d'une façon ou d'une autre, réellement souffert?)
Si la croix est, par excellence, l'instrument du Diable, toutes les images, tous les objets que l'Église considère comme sacrés sont aussi l'œuvre du Malin, qui sous le nom de christianisme a instauré le règne du paganisme le plus abject: les images saintes sont autant d'idoles, les reliques encore bien moins que cela, des fragments d'os pourris, des bouts de bois ou de tissu ramassés n'importe où, et que d'habiles escrocs font passer pour des restes de corps bienheureux ou d'objets vénérés; ceux qui s'inclinent devant de tels objets adorent la matière, qui est œuvre du Démon. Du reste, les saints ont tous été des pécheurs, puisqu'ils ont servi l'Église du Diable, ils sont englobés dans la même condamnation que les justes de l'Ancien Testament, créatures et serviteurs du Dieu mauvais.
La Vierge n'a pas été la Mère de Jésus, puisque Jésus n'a jamais eu de corps; mais s'il a voulu, en apparence, naître d'elle, c'est qu'elle était, elle aussi, un être immatériel, un ange qui a pris les traits d'une femme. Elle n'est peut-être même qu'un symbole, le symbole de l'Église qui accueille en elle la parole de Dieu.
Ayant posé en principe la création du monde par l'esprit du mal, l'Église cathare ne pouvait que condamner d'emblée toutes les manifestations de la vie terrestre: tout ce qui n'est pas pur esprit est voué à la destruction totale et ne mérite ni amour ni respect. Si l'Église était la forme la plus visible du mal sur la terre, le pouvoir séculier était presque aussi coupable, puisqu'il fondait sa puissance sur la contrainte et souvent sur le meurtre (guerre et justice pénale). La famille est condamnable en tant que source d'attachements terrestres, et le mariage est de plus un crime contre l'Esprit, car il enlise l'homme dans la vie de la chair et risque de causer la perdition de nouvelles âmes en les précipitant dans la matière. Tout meurtre, fût-ce celui d'un animal, est un crime: celui qui tue enlève à une âme la chance de se réconcilier avec l'Esprit, et interrompt indûment le cours de sa pénitence: même logée dans le corps d'une bête, une âme a droit à des égards infinis car il lui reste peut-être une chance imprévisible de renaître dans une condition meilleure. Il ne faut donc jamais porter d'armes, pour ne pas risquer de tuer, même pour se défendre; il ne faut pas non plus manger de nourriture d'origine animale: celle-ci est essentiellement impure; même les laitages et les œufs, comme tout ce qui provient de la procréation, sont à éviter. Il ne faut jamais mentir, ni prononcer de serment; il ne faut pas posséder de biens terrestres. Mais même celui qui remplirait toutes ces conditions n'est pas sauvé pour autant: on ne peut être sauvé, c'est-à-dire réconcilié avec l'Esprit Saint, qu'en entrant dans l'Église cathare et en recevant l'imposition des mains d'un de ses ministres: là seulement l'homme renaît à nouveau, et peut espérer, après sa mort, entrer dans la béatitude divine, à moins que de nouveaux péchés ne le fassent tomber de nouveau dans les lacs du Démon.
Il n'y a pas d'enfer, puisque l'enfer n'est autre chose que la réincarnation dans un corps nouveau; mais une longue série d'existences mauvaises peut finir par ôter à une âme toute possibilité de salut. Il est aussi des âmes créées par le Démon, ce qui fait que certains êtres ne peuvent être sauvés; il est difficile de les distinguer des autres, mais on présume que les rois, empereurs, chefs de l'Église catholique font partie de ces hommes prédestinés à la damnation. Toutes les autres âmes doivent être sauvées et le supplice des réincarnations terrestres durera tant que toutes les âmes célestes n'auront pas trouvé la voie du salut. À la fin, le monde sensible disparaîtra, le soleil et les étoiles s'éteindront, le feu dévorera les eaux et les eaux éteindront le feu. Les âmes des démons périront dans le brasier et il n'y aura plus que joie éternelle en Dieu.
Ce résumé de la doctrine cathare tendrait à montrer que cette religion se séparait du christianisme traditionnel sur tant de points que l'on pourrait se demander comment des populations catholiques aient pu si facilement abandonner la foi de leurs pères pour une hérésie aussi manifeste.
Ici, deux remarques s'imposent: d'abord, le peuple, étant donné la carence de l'Église - dénoncée par les papes eux-mêmes - était souvent fort ignorant en matière d'orthodoxie religieuse. Ensuite, et c'est là un point sur lequel nous devons insister, les adversaires de la religion cathare avaient intérêt à souligner ses erreurs, et à leur accorder une importance qu'elles n'avaient peut-être pas aux yeux des cathares eux-mêmes, si bien que, sur beaucoup de points, il a pu s'agir de différences d'interprétation et d'expression plutôt que de véritables hérésies.
Il ne faut pas négliger le côté hétérodoxe de la religion cathare; mais il faut essayer de le remettre à sa vraie place. En examinant les faits, nous voyons que les erreurs les plus choquantes aux yeux des catholiques sont justement celles qui semblent découler logiquement de la doctrine orthodoxe de l'époque. C'est pourquoi elles étaient jugées si dangereuses.
En effet: le dualisme des cathares, que leurs ennemis ont exagéré à plaisir, n'était que le développement naturel de la croyance au Diable, dont l'importance était immense au moyen âge. Un manichéisme latent a toujours existé dans l'enseignement de l'Église. Le Diable est une réalité concrète, sa puissance est à tout moment attestée par les prédicateurs catholiques, qui ne manquent jamais de condamner comme œuvres du Diable toutes les manifestations de l'esprit profane, parfois les plus pures, telles la musique ou la danse. L'Église (du moins dans ses représentants les plus autorisés) était allée si loin dans ce sens que l'on ne voit pas ce que les cathares pouvaient encore y ajouter. La civilisation du moyen âge, civilisation de moines à son origine, n'avait que dégoût et mépris pour la matière; si elle ne la disait pas œuvre du Diable, elle agissait exactement comme si elle la croyait telle. Quand a-t-on vu, avant saint François d'Assise, un saint catholique chanter la beauté de la nature créée par Dieu? Quand voit-on les prêtres glorifier le mariage, s'extasier sur de petits enfants, vanter les joies terrestres? La plupart des fêtes et des coutumes religieuses où l'amour de la vie terrestre semble tenir une grande place sont des survivances, soit du paganisme, soit de la tradition hébraïque; l'apport purement chrétien à l'amour de la création est faible et purement théorique.
Telle n'est sans doute pas l'attitude de l'Église tout entière, mais celle de ses membres les plus purs, les plus vénérés, tel saint Bernard qui s'insurge non seulement contre la frivolité de la vie laïque, mais aussi contre la trop riche ornementation des églises: la beauté qui séduit les yeux ne sert qu'à détourner l'esprit de la méditation. À une époque où le besoin d'incarner, de matérialiser le sacré semble avoir été plus grand qu'à aucune autre, et où des villes et des régions entières se ruinaient pour édifier à la Vierge ou au saint local une maison à côté de laquelle les palais de rois étaient de pauvres masures, à cette époque même, tout catholique sincère estimait que le monde est irrémédiablement corrompu et qu'il n'y a d'autre voie de salut que le cloître. Entre un univers créé par le Diable et seulement toléré par Dieu, et un univers créé par Dieu mais entièrement corrompu, et dénaturé par le Diable, la différence n'est pas grande, du moins dans la pratique.
Les cathares condamnaient le mariage et la chair (à tel point qu'ils s'abstenaient de tout aliment provenant de la procréation). Nous allons voir que cette condamnation n'était pas absolue. Mais l'Église catholique elle-même avait à l'égard du mariage une attitude à peu près semblable: le mariage est interdit au prêtre, comme il l'est aux ministres cathares; il n'est toléré chez les fidèles que comme moyen de propagation de l'espèce et remède contre la concupiscence. Bien plus, à l'égard de la femme, l'attitude de l'Église catholique est bien plus dure que celles des cathares: quand on voit saint Pierre Damien vitupérer contre les concubines de clercs en les traitant d'"amorces de Satan, poison des âmes, voluptés de porcs gras, repaires d'esprits immondes", etc., on sent urne véritable horreur de la femme en tant que femme, éternel piège du Démon. Une condamnation à peine voilée et systématique de la chair et du mariage entraîne la négation implicite d'un monde où toute vie, à commencer par les herbes des champs, est soumise aux lois de la procréation. Quand les prêtres catholiques professaient, à l'encontre des cathares, qu'un homme peut être sauvé dans le mariage, ils ne le faisaient que par indulgence pour la faiblesse humaine. Or, nous allons le voir, il en était de même pour les cathares.
Si la vie, aux XIe et XIIe siècles, a connu un magnifique essor de l'art et de la civilisation, si elle semble avoir été, même parmi les pires misères, débordante d'intense et profonde joie de vivre (car les peuples étaient jeunes), on ne peut dire que la pensée consciente de l'Église ait été orientée dans ce sens. Comme le catharisme, le catholicisme était, de son propre aveu, une religion d'âmes, uniquement occupée à sauver des âmes. Si l'Église avait aussi un corps, matériel et trop matériel parfois, c'était sous la pression des circonstances et en contradiction avec sa propre doctrine.
Les dogmes catholiques qui choquaient le plus les cathares: ceux de la Trinité et de l'Incarnation, concernaient plutôt les théologiens et les philosophes que la masse des fidèles. Les cathares étaient, semble-t-il, réellement ariens, en ce sens qu'ils refusaient d'admettre l'égalité des trois personnes de la Trinité. Cependant, les mots du Credo: "et ex Patre natum ante omnia saecula", impliquent, malgré le consubstantialem, une certaine suprématie originelle du Père; pour les cathares aussi, Jésus était un Fils engendré avant tous les siècles, et nous ne savons si leurs adversaires ont exactement interprété leur pensée. Ce qui est certain, c'est que les cathares ont toujours manifesté une telle dévotion à la personne du Christ qu'aucun catholique ne pouvait aller plus loin; on peut douter de tout, sauf de leur "christianisme". En ce qui concerne l'Incarnation, la naissance miraculeuse de Jésus, la tradition apocryphe selon laquelle la virginité de Marie serait restée intacte après la Nativité, la Résurrection et l'Ascension n'étaient-elles pas propres à jeter le trouble dans les esprits? Les catholiques eux-mêmes semblaient reconnaître implicitement que le corps de Jésus était, d'une façon ou d'une autre, différent des corps humains.
En fait, ce qui était, dans la doctrine cathare, absolument inadmissible pour les catholiques, c'était la négation de l'Église catholique elle-même. Mais, et c'est là un point qui n'a peut-être pas été assez souligné, ce que cette religion apportait à ses fidèles, c'était le Christ et l'Évangile: le livre, le seul et le vrai livre, livre qui tenait lieu de croix et de calice, était l'Évangile, un évangile lu en langue vulgaire, accessible aux petits comme aux grands, rendu plus proche par d'incessantes prédications et controverses. De l'interprétation de l'Évangile par les cathares nous ne savons que ce qui en a transpercé dans les polémiques. Mais les prédicateurs qui s'adressaient à des fidèles n'en étaient plus au stade de la polémique. Leur religion rapprochait le Christ des fidèles parce qu'elle écartait le voile de dogmes, de traditions et de superstitions dont les siècles avaient fini par envelopper l'enseignement primitif. Il suffit de lire, par exemple, La Légende dorée, rédigée au XIIIe siècle mais rapportant des traditions orales ou écrites bien plus anciennes, pour se rendre compte à quel point la piété populaire avait souvent peu de rapport avec le christianisme.
L'Église était mal armée contre ce danger: elle décourageait les tentatives de traduction des livres saints. Le catholique le plus irréprochable devenait suspect d'hérésie s'il manifestait le désir de lire l'Évangile en langue vulgaire; et le latin était parfois ignoré par les prêtres eux-mêmes. La décadence de l'Église dans le Midi était telle que les prêtres n'enseignaient plus la religion; s'ils le faisaient, on ne les écoutait plus. L'Église avait enlevé la clef de la connaissance et pouvait d'autant moins lutter que l'adversaire la combattait au nom du Christ.
Bien plus, les cathares se réclamaient d'une tradition plus ancienne, donc plus pure et plus proche de l'enseignement des Apôtres que ne l'était celle de l'Église de Rome, et prétendaient être les seuls à avoir gardé l'Esprit Saint envoyé par le Christ à son Église; il semble bien qu'en partie, du moins, ils aient été dans le vrai: le rituel cathare, dont nous possédons actuellement deux textes datant du XIIIe siècle, montre (ainsi que le prouve Jean Guiraud dans son ouvrage sur l'Inquisition) que cette Église possédait sans doute des documents fort anciens, directement inspirés des traditions de l'Église primitive.
En effet, ainsi que le prouve Jean Guiraud en comparant les cérémonies de l'initiation et du baptême des catéchumènes de l'Église primitive et celles de l'initiation des cathares, il y a entre les deux traditions un parallélisme si constant qu'il ne saurait être fortuit. Le néophyte cathare, comme le catéchumène chrétien, devait être reçu par l'Église, après un temps de probation et après le suffrage des chefs de la communauté; tout comme l'admission dans l'Église cathare, le baptême, dans l'Église primitive, n'était accordé qu'aux adultes en pleine possession de leurs facultés et n'était souvent demandé par les croyants qu'à leur lit de mort. Le ministre qui reçoit le néophyte dans l'Église est appelé l'Ancien (senhor), traduction évidente de presbyter. L'acte de renonciation des catéchumènes à Satan est parallèle à celui de la renonciation des cathares à l'Église de Rome. À part l'onction par l'huile symbolisant le Saint-Esprit et l'immersion dans la piscine baptismale (sacrement trop liés à la matière et rejetés par les cathares qui ne gardent que l'imposition des mains), l'admission du catéchumène dans l'Église primitive est, en tous points, semblable à celle du postulant cathare dans sa nouvelle Église. Il en est de même pour la cérémonie de la confession du fidèle à l'Église et de la rémission des péchés par l'assemblée des cathares.
Certains inquisiteurs, en particulier Bernard Gui, au XIVe siècle, ont été frappés par ce qu'il y avait de chrétien dans les rites de l'Église hérétique et ont cru qu'il s'agissait en quelque sorte d'une "singerie" du baptême catholique; mieux renseignés qu'eux sur les coutumes de l'Église primitive, nous devons admettre que les cathares n'avaient fait que suivre une tradition plus ancienne que celle même de l'Église et qu'ils pouvaient prétendre avec quelque raison que c'était Rome qui était tombée dans l'"hérésie" en s'écartant de la pureté originelle de l'Église des Apôtres.
Le texte même du rituel, tel qu'il existe aujourd'hui, remonte certainement à une époque très ancienne (bien que les deux versions que l'on en possède, l'une en occitan, l'autre en latin, datent du XIIIe siècle). Ce texte a-t-il été apporté d'Orient et traduit par des missionnaires bulgares? Où, et dans quelles conditions s'est-il conservé et quelle en est l'origine exacte? Il est composé en grande partie de citations des Évangiles et des Épîtres, assez brièvement commentées, se référant sans cesse au Père, au Fils et au Saint-Esprit et à des épisodes de l'Évangile; il eût pu être approuvé par n'importe quel bon catholique et, en le lisant, on a l'impression de reconnaître la saveur et la vigueur du christianisme primitif, plutôt que les spéculations théologiques d'une secte à laquelle on attribue les doctrines les plus hétérodoxes.
Or, ce rituel, ce livre de prière et d'initiation, n'était pas destiné au vulgaire; il était l'expression la plus formelle, la plus sacrée de l'Église cathare, la traduction en paroles du sacrement suprême de cette Église. N'y trouvant rien qui impliqua, fût-ce de loin, le dualisme manichéen, la négation de l'Incarnation et de l'Eucharistie, la théorie de la métempsychose; y rencontrant même des affirmations contraires à la doctrine cathare sur le baptême de l'eau, nous devons conclure que ces textes sont très antérieurs au catharisme proprement dit. Mais le fait même que les cathares (qui ne manquaient ni de hardiesse ni de goût pour la spéculation théologique) n'aient rien voulu y modifier, montre que ce rituel exprimait bien leur doctrine telle qu'ils la concevaient et que les "erreurs" que leur reproche l'Église catholique n'étaient peut-être que des aspects secondaires de leur enseignement: une cosmogonie et une philosophie de l'univers et de la vie, plutôt qu'une véritable matière de foi.
Si l'on juge une religion à ses prières et à ses rites (ce qui est encore le meilleur moyen de juger de son essence véritable), le peu que nous savons de la religion cathare ne peut que nous forcer à nous incliner devant sa simplicité, sa sobriété, son élévation spirituelle. Ce "rituel" échappé à la destruction par miracle a infiniment plus de poids en lui-même que tout ce qui a été dit et écrit sur les cathares depuis des siècles, sur les affirmations de leurs adversaires.
III - ORGANISATION ET EXPANSION
La religion cathare cherchait à appliquer à la lettre les enseignements de sa doctrine. La voie du salut est étroite, et semble n'être réservée qu'à une minorité d'élus. Mais là, l'Église cathare rejoint d'une façon inattendue l'Église catholique, à la fois dans sa mansuétude pour les faibles et dans sa foi en la valeur absolue des sacrements: les cathares, tout comme les catholiques, posent, comme condition nécessaire du salut, un acte de caractère sacramentel - la réconciliation avec l'Esprit par l'imposition des mains donnée par des ministres du culte qui ont déjà reçu l'Esprit. Il ne s'agit pas là d'un geste symbolique; le rite du consolamentum a bien, pour les cathares, une vertu surnaturelle, il fait réellement descendre l'Esprit Saint sur la personne qui en est la bénéficiaire. Quel que soit l'état de sainteté de l'officiant, c'est bien l'acte matériel de l'imposition des mains qui confère l'Esprit Saint, et c'est cet acte qui est la clef et le centre de la vie de l'Église cathare.
Que les cathares admettent ou non le principe de la succession apostolique, ils soutiennent que l'Esprit ne peut être transmis que par des mains pures; mais ils posent comme postulat la pureté de leurs ministres, et les cas sont rares où le consolamentum est jugé sans valeur par suite de l'indignité de l'officiant. L'Esprit descend réellement sur l'homme qui le reçoit, et cet homme, dès lors, devient un "chrétien" et meurt à ce monde pour renaître à la vie de l'Esprit. Il doit se soumettre sans restrictions ni compromis à toutes les obligations imposées par la religion nouvelle, et ces obligations sont plus dures que celles d'un moine qui reçoit les ordres sacrés. Seule une infime minorité de croyants pouvait se résoudre à gagner son salut de cette façon-là. Mais l'Église cathare admet également le consolamentum à l'article de mort, et l'on voit donc un grand nombre de personnes recevoir le sacrement sans autres garanties de la pureté de leur foi que la conscience d'une mort prochaine. Le sacrement pouvait donc être accordé à des gens qui ne seraient pas, à priori, des élus et des purs, et là, la religion cathare semble encourir le reproche qu'elle fait au catholicisme: celui de faire du sacrement une opération mécanique, indépendante de l'état spirituel de celui qui la reçoit. Si le principe est essentiellement le même, du moins les cathares ont-ils su conférer à leur sacrement la majesté nécessaire, en faisant de lui un don précieux et unique qu'à moins du sacrifice total de sa vie à Dieu un homme ne peut obtenir qu'au moment où les souffrances l'ont déjà détaché du monde.
L'Esprit une fois descendu sur le croyant, celui-ci est déjà une créature nouvelle, à partir de ce moment la faute la plus légère devient un sacrilège qui risque de lui faire perdre l'Esprit dont il est "revêtu". En pratique, on a pu citer des cas de "parfaits" consolés plusieurs fois dans leur vie, à la suite soit de quelque faute, soit d'un affaiblissement de leur foi. Ceci semble prouver que ce sacrement n'avait pas le caractère inexorable qu'on lui prête habituellement.
Le consolamentum, qui correspondait à la fois aux sacrements du baptême, de l'eucharistie, de la confirmation, de l'ordre et de l'extrême-onction, était une cérémonie très simple. Il était précédé d'une longue période de probation ou d'initiation, et le postulant devait rester quelque temps - un an, parfois deux ans - dans une maison de parfaits où sa vocation était longuement éprouvée; c'était une sorte de période de noviciat, et il arrivait qu'à la fin de cette épreuve préparatoire le postulant se voyait refuser l'accès au consolamentum, si ses maîtres n'étaient pas sûrs de sa persévérance. S'il était jugé digne, il était présenté à la communauté qui devait l'élire, et se préparait au jour de sa consécration par de longs jeûnes, des veilles et une incessante prière.
Le jour venu, le postulant était introduit dans la salle commune où se réunissaient les fidèles - les cathares n'avaient pas de temples, et officiaient dans des maisons de particuliers, mais dans les villes, ils avaient leurs maisons à eux, spécialement consacrées au culte, à l'enseignement et aux soins des malades; dans ces maisons ils vivaient en communauté, chaque parfait devant faire abandon de ses biens à l'Église. Les grandes villes comptaient en général plusieurs de ces "maisons des hérétiques".
La salle où les fidèles se réunissaient pour la prière ne contenait aucun signe extérieur du culte. Les murs devaient en être nus, généralement peints à la chaux, le mobilier aussi simple que possible: quelques bancs, une table recouverte d'une nappe d'une blancheur immaculée, sur laquelle est posé le Livre, c'est-à-dire l'Évangile. Des essuie-mains, blancs également, sont aussi disposés sur cette table qui sert d'autel, et sur une autre table où sur un coffre se dressent une aiguière et une cuvette pour le lavement des mains. Seul ornement de cette salle austère, d'innombrables cierges blancs sont allumés, pour symboliser les flammes du Saint-Esprit descendu sur les apôtres le jour de la Pentecôte. En présence d'une assistance composée de croyants fidèles, le nouveau postulant est mené vers la table devant laquelle se tiennent les ministres du culte chargés de le recevoir, diacres ou simples parfaits, vêtus de leurs longues robes noires, symbole de leur séparation du monde. Le parfait qui officie et ses deux assistants se lavent les mains, afin de pouvoir toucher le texte sacré. La cérémonie commence.
L'officiant explique au postulant les dogmes de la religion qu'il va embrasser et les obligations auxquelles il devra se soumettre. Ensuite, il récite le Pater, en commentant chaque phrase, que le postulant devra répéter après lui. Ensuite, le futur parfait doit abjurer solennellement la foi catholique dans laquelle il avait été élevé, et demande, en se prosternant trois fois, le droit d'être reçu dans la vraie Église. Il doit "se rendre à Dieu et à l'Évangile". Il promet de ne plus manger désormais de viande, ni d'œufs, ni d'aucune nourriture d'origine animale, de s'abstenir à jamais de tout commerce charnel, de ne plus jamais mentir ni prononcer de serment, et de ne pas renoncer à sa foi par crainte de la mort par le feu, par l'eau ou de toute autre mort. Ensuite, il fait publiquement l'aveu de ses fautes et demande le pardon de l'assistance. Une fois absous, il doit renouveler solennellement les engagements qu'il vient de prendre. Là seulement, il est prêt à recevoir l'Esprit.
Le sacrement s'accomplit au moment où l'officiant place le texte sur la tête du postulant et où lui et ses assistants imposent les mains sur le futur parfait en priant Dieu de le recevoir et de lui envoyer l'Esprit Saint. Cet instant fait de l'homme une créature nouvelle, il est "né de l'Esprit".
L'assistance récite à haute voix le Pater, l'officiant lit ensuite les dix-sept premiers versets de l'Évangile de Jean: "Au commencement était le Verbe..." Puis il récite de nouveau le Pater.
Le nouvel élu reçoit le baiser de paix de l'officiant d'abord, de ses assistants ensuite. Il transmet ce baiser de paix à la personne de l'assistance qui se tient le plus près de lui, et cette salutation fraternelle, tel un flambeau qui passe de main en main, fait le tour de toute l'assistance jusqu'au dernier des fidèles présents. Si le postulant est une femme, le baiser de paix est remplacé par un geste plus symbolique: l'assistante touche l'épaule de la nouvelle parfaite avec l'Évangile et lui touche le coude avec le coude.
Le nouveau "consolé" portera désormais l'habit noir de ses frères, il sera un "revêtu", il ne devra plus quitter cet insigne visible de sa nouvelle dignité; plus tard, lorsque les persécutions obligeront les parfaits à la prudence, la vêture sera remplacée par un cordon que les hommes porteront autour du cou, les femmes autour de la ceinture, sous leurs vêtements. Mais l'importance même accordée à cette "vêture" (les "revêtus" sera le nom sous lequel on désignera le plus souvent les hérétiques parfaits) montre le caractère sacramentel et sacerdotal du consolamentum. Le consolé entrait en religion dans tous les sens du terme admis par les catholiques. Il abandonnait tous ses biens à la communauté, et commençait, à l'exemple du Christ et des apôtres, une vie errante, consacrée à la prière, la prédication et les œuvres de charité.
Le diacre ou l'évêque local désignait au nouveau parfait un camarade, choisi parmi les autres parfaits, et qui allait devenir son socius (ou sa socia s'il s'agissait d'une femme), le compagnon dont il ne devra plus se séparer et qui partagera désormais ses travaux et ses peines.
On a pu dire avec raison que l'Église cathare proprement dite se composait de ceux qui avaient eu part au sacrement; que c'était, en somme, une Église uniquement composée de prêtres. Notre postulant, qui a reçu le terrible privilège d'être admis parmi les parfaits, est à présent un "chrétien" séparé des autres; partout où il ira, les simples croyants devront l'"adorer", ou plutôt lui témoigner leur respect, en s'agenouillant ou en s'inclinant trois fois devant lui avec les paroles rituelles: "Priez Dieu pour qu'il fasse de moi un bon chrétien et qu'il me conduise à une bonne fin". Le parfait priera Dieu, mais ne répondra pas: "Priez pour moi, pécheur". L'égalité théorique qui existe entre tous les chrétiens orthodoxes, du pape au dernier des criminels, semble être absente de cette religion réaliste. D'après leur propre doctrine, les parfaits constituent en quelque sorte l'échelon supérieur de l'humanité, l'Esprit qui leur a été conféré par le sacrement n'habite pas, et ne peut habiter les âmes des non-consolés. (Il faut évidemment prendre le mot "parfait" dans son sens étymologique de "parachevé", "complet": l'homme étant corps, âme et esprit, les parfaits étaient les hommes qui, par la vertu du sacrement, étaient parvenus à retrouver leur "esprit", la partie divine d'eux-mêmes dont la chute originelle les avait privés). Nous nous trouvons devant le fait paradoxal d'une Église puissante, qui gagne sans cesse du terrain, qui compte parmi ses adhérents une bonne partie de la noblesse du pays, de la bourgeoisie, des artisans, qui a soumis à son influence des châteaux, des bourgs, des régions entières, et qui passe pour ne compter que quelques centaines, tout au plus quelques milliers de membres effectifs.
Nous reviendrons sur cette question des croyants et du rôle qu'ils jouaient dans cette Église qui, à priori, semblait leur accorder si peu d'importance. Il est certain qu'ici quelque chose nous échappe, car malgré cette distinction en apparence capitale entre le parfait et le simple croyant, nous verrons que la conduite de ces derniers est exactement celle qu'auraient eue de bons catholiques à l'égard de l'Église de Rome, et l'attitude des parfaits à l'égard des croyants ne diffère pas de l'attitude des prêtres soucieux de leurs devoirs envers leurs paroissiens. Dans le Languedoc, chaque province avait son évêque cathare, chaque ville ou localité importante son diacre: on n'institue pas des évêques et des diacres pour une poignée d'élus. Les évêques cathares se considéraient comme les pasteurs spirituels de grandes communautés, et montraient probablement plus de sollicitude envers leurs frères non encore initiés que ne le faisaient les évêques catholiques à l'égard de leurs fidèles, pour cette simple raison qu'une religion qui doit lutter pour son existence tient beaucoup plus compte de ses adhérents qu'une religion établie. Les croyants étaient loin de ressembler à un troupeau sans pasteurs, et ne devaient nullement se considérer comme privés de tout contact avec les choses spirituelles.
Mais il n'en reste pas moins vrai que ce sont les parfaits qui forment le noyau, l'âme vivante de l'Église cathare. Nous savons ce qu'ils ont été: des confesseurs, dans le sens où l'entend l'Église. Ces hommes triés sur le volet, choisis et ordonnés avec tant de circonspection que même dans une Église déjà prospère ils ne seront jamais qu'une infime minorité, ont forcé l'admiration de leurs pires ennemis. D'après le nombre des hérétiques brûlés pendant les années de croisade (on ne brûlait généralement que les parfaits), on peut juger qu'ils ont dû être plusieurs milliers dans le Midi de la France, en comptant ceux qui ont pu réussir à se cacher jusqu'au bout, ceux qui sont passés en Italie, ceux qui ont dû tomber victimes du hasard des massacres de la guerre. Or, dans toute l'histoire de la croisade et des années qui l'ont suivie, les historiens n'ont enregistré que trois cas d'abjuration de parfaits: encore le premier, le converti in extremis échappé par miracle au feu, n'était-il qu'un néophyte, non encore "consolé", le second, Pons Roger, converti par saint Dominique, n'est présumé avoir été un parfait qu'à cause de la rigueur de la pénitence imposée à lui par le saint. Le troisième est Guilhem de Solier, qui, en 1229, abjura pour ne pas être livré au bûcher, et acheta sa vie au prix de la dénonciation de ses frères. Si l'on songe à ce qu'est la mort par le feu, on est saisi d'étonnement quand on constate que sur des centaines d'hommes et de femmes menacés de cette mort, il ne se soit trouvé qu'un seul traître.
Mais les parfaits ne sont pas admirés pour leur courage, qui, avant la croisade, n'a pas encore donné sa pleine mesure. Leurs adversaires sont unanimes à reconnaître la pureté de leurs mœurs, et le pape et saint Dominique leur rendront un hommage éclatant le jour où ils décideront de lutter contre eux "avec leurs propres armes", et où le saint catholique s'en ira prêcher pieds nus et vivre d'aumônes, pour suivre le bon exemple donné par les prédicateurs hérétiques.
Les parfaits ne sont pas seulement les hommes austères qui gagnent l'admiration par leur mépris des biens de ce monde: le peuple leur a donné le surnom de "bons hommes", expression qui dans le langage actuel a perdu son vrai sens; c'étaient les hommes bons. Cette seule appellation semble apporter un démenti à ceux qui dépeignent le catharisme comme une religion triste, indifférente aux misères d'un monde qu'elle méprise. Ces maigres hommes vêtus de noir, avec leurs cheveux longs et leur visage pâle, ont frappé les imaginations moins par l'austérité de leurs mœurs que par leur bonté. Une austérité revêche et triste n'eût attiré personne. Ces hommes ou femmes qui s'en allaient, deux par deux, visiter villages, châteaux et faubourgs, provoquaient, partout où ils passaient, une vénération sans bornes; et le comte de Toulouse n'a fait qu'exprimer les sentiments répandus depuis longtemps dans le peuple le jour où, montrant un parfait mal vêtu et mutilé, il a dit: "J'aimerais mieux être cet homme-là que roi ou empereur17".
L'autorité morale de ces hommes est telle que l'Église n'ose que très timidement élever sa voix pour les accuser d'hypocrisie. Tout au plus les accuse-t-on de trop afficher leur ascétisme. Les bons hommes sont, en effet, des jeûneurs intraitables: ils ne se contentent pas de ne toucher à aucune nourriture "impure", d'observer trois carêmes par an durant lesquels ils jeûnent trois jours par semaine au pain et à l'eau, mais ils préféreront mourir plutôt que d'absorber fût-ce une miette d'un aliment défendu par leur religion. La pratique du jeûne, de tout temps répandue dans toutes les religions, mais beaucoup plus développée en Orient qu'en Occident, semble jouer dans la vie des parfaits un rôle tout particulier: en tout cas, pour le peuple comme pour l'Église, ils sont avant tout des hommes qui jeûnent. Kosma le Prêtre18 décrit déjà les bogomiles comme des gens au visage pâle, émacié, marqué par les privations.
Tels des yogis ou des fakirs, certains parfaits avaient une telle passion pour le jeûne poussé à l'extrême qu'on a pu les accuser de vouloir mettre fin à leurs jours: c'est ainsi que s'explique la légende de l'endura, ou mort volontaire par la grève de la faim (dont en fait on ne cite qu'un seul cas précis, au XIVe siècle, à l'époque où la religion cathare agonisante avait déjà perdu son vrai caractère). En réalité, les parfaits, qui avaient pour le meurtre une horreur si démesurée qu'on en a vu (tels ces hérétiques pendus en 1052 à Goslar, en Allemagne) qui ont préféré mourir plutôt que de tuer un poulet, ne pouvaient en aucune façon encourager le suicide: ces contempteurs de la vie terrestre avaient pour cette même vie un respect total, et ne permettaient pas à la volonté humaine, toujours mauvaise et arbitraire, d'intervenir par la violence dans le destin d'une âme en quête de son salut. Ces gens ne recherchaient pas le martyre, et leur courage devant la mort venait moins de leur indifférence à la vie que de l'ardeur de leur foi.
Les parfaits se distinguaient également par leur langage doux et grave et leur habitude de prier constamment et de parler sans cesse de Dieu; le même Kosma y voit une ruse habile et un trait d'orgueil: ils n'élèvent jamais la voix, ne disent jamais de paroles malsonnantes, ils n'ouvrent la bouche que pour des paroles pieuses, et prient en public en toutes occasions comme les hypocrites que dénonce le Seigneur. Ce sont des loups revêtus de peaux d'agneaux. C'est par leur piété indiscrète qu'ils séduisent les ignorants.
Il se peut que la pratique de la prière, chez les parfaits, ait obéi à des règles et des techniques particulières, probablement de tradition orientale. En tout cas, l'exemple souvent cité du parfait visité par Berbeguera, femme du seigneur de Puylaurens, qui restait sur sa chaise "immobile comme un tronc d'arbre, insensible à tout ce qui l'entourait"19, ferait penser à quelque saint homme hindou en extase. Mais il est évident qu'on ne conquiert pas les cœurs en restant assis immobile sur une chaise. Les parfaits étaient surtout réputés pour leurs œuvres de charité.
Pauvres eux-mêmes, ils disposaient des dons des fidèles pour secourir les malheureux; et quand ils n'avaient rien à donner, ils étaient là, apportant le réconfort de leur parole et de leur amitié, ne dédaignant pas la compagnie des plus déshérités. Ils étaient souvent médecins, ce qui semble paradoxal de la part d'hommes ayant un tel mépris du corps. Habile moyen de propagande, soit; mais on ne devient pas un bon médecin sans accorder quelque attention et quelque amour au corps que l'on soigne; la charité s'adresse au corps plutôt qu'à l'âme. Les procès de l'Inquisition citent le témoignage du chevalier Guilhem Dumier, qui, soigné avec dévouement par un médecin parfait, s'en vit abandonné le jour où il refusa d'abjurer la foi catholique. Le fait ne devait pas être très courant: des médecins qui auraient eu l'habitude d'agir ainsi eussent vite fait de perdre leur clientèle, et leurs futurs convertis du même coup.
Il en va de même pour le témoignage de la femme de Guillaume Viguier qui, bien que son mari veuille la convertir au catharisme "à coups de bâton20" (moyen de persuasion assez peu efficace), s'y refuse parce que les bons hommes lui ont dit que l'enfant dont elle était enceinte était un démon. Le mari et la femme devaient être assez ignorants et le "bon homme" ne péchait pas par excès de tact; mais il est évident que ce cas est une de ces exceptions qui confirment la règle: des prédicateurs qui tiendraient toujours un pareil langage à leurs paroissiennes ne se seraient pas acquis une réputation de bonté.
On reconnaît en général que la charité des parfaits ne s'adressait pas aux seuls adeptes de leur secte, et que c'était elle, au contraire, qui attirait les malheureux auxquels les ministres cathares venaient en aide. On peut tromper les grands et les savants, non le petit peuple: il n'accorde son amour ni à l'austérité ni à de belles paroles, mais à une bonté et une compassion qui viennent du fond du cœur.
Tous les témoignages s'accordent pour affirmer que c'est par leur exemple que les parfaits ont gagné les cœurs de leurs fidèles; du secret de leur vie spirituelle, du rayonnement de leur personnalité, rien ne nous reste que ce témoignage éclatant, mais imprécis, qu'est l'extraordinaire succès de leur apostolat.
Les causes secondaires qui ont favorisé l'expansion du mouvement cathare sont si nombreuses et si évidentes que leur seule énumération donnerait presque à croire que la nouvelle religion n'avait même pas besoin d'apôtres aussi admirables pour détourner les peuples du Midi de l'Église de Rome.
Son côté le plus spectaculaire, le plus révoltant pour le monde chrétien - le rejet absolu des dogmes de l'Église et même de ses symboles les plus sacrés, - a bouleversé jusqu'à l'horreur les pays où l'Église était forte et l'hérésie rare. Dans le Midi de la France les progrès de l'hérésie vont de pair avec la décadence de plus en plus grande de l'Église, et il est difficile de dire lequel des deux phénomènes détermine l'autre; ce que l'on sait des chefs de l'Église du Midi à l'époque de la croisade montre que de tels évêques eussent fait douter de la sainteté de l'Église les catholiques les plus fervents.
Voici ce que nous apprend Innocent III sur le clergé languedocien, et en particulier sur son chef, Bérenger II, archevêque de Narbonne: "Des aveugles, des chiens muets qui ne savent plus aboyer, des simoniaques qui vendent la justice, absolvent le riche et condamnent le pauvre. Ils n'observent même pas les lois de l'Église: ils cumulent les bénéfices et confient les sacerdoces et les dignités ecclésiastiques à des prêtres indignes, à des enfants illettrés. De là l'insolence des hérétiques, de là le mépris des seigneurs et du peuple pour Dieu et pour son Église. Les prélats sont dans cette région la fable des laïques. Mais la cause de tout le mal est dans l'archevêque de Narbonne: cet homme ne connaît d'autre Dieu que l'argent, il n'a qu'une bourse à la place du cœur. Depuis dix ans qu'il est en fonctions il n'a pas visité une seule fois sa province, pas même son propre diocèse. Il s'est fait donner cinq cents sous d'or pour consacrer l'évêque de Maguelonne, et lorsque nous lui avons demandé de lever des subsides pour le salut des chrétiens d'Orient, il a refusé de nous obéir. Quand une église vient à vaquer, il s'abstient de nommer un titulaire afin de profiter des revenus. Il a réduit de moitié le nombre des chanoines de Narbonne pour s'approprier les prébendes, et retient de même sous sa main les archidiaconés vacants. Dans son diocèse on voit les moines et les chanoines réguliers jeter le froc, prendre femme, vivre d'usure, se faire avocats, jongleurs ou médecins21". Ce tableau est si éloquent qu'il semble difficile d'y ajouter grand-chose; mais l'enquête menée par le pape révèle encore que l'archevêque a pour baile un chef de routiers aragonnais, c'est-à-dire un bandit des grands chemins. Le pape fulminera en vain contre Bérenger: cet intraitable vieillard, plus zélé pour la défense de ses intérêts que pour les affaires de son diocèse, tiendra tête aux légats pendant des années et ne se laissera déposer qu'en 1210, quand la croisade aura triomphé par la force des armes.
L'évêque de Toulouse, Raymond de Rabastens, issu d'un milieu hérétique, passe sa vie à guerroyer contre ses vassaux, et pour se procurer des ressources met en gage les terres du domaine épiscopal. Lorsqu'en 1206 il est enfin déposé pour simonie, Foulques de Marseille, abbé de Thoronet, son successeur, ne trouve dans la caisse de l'évêché que quatre-vingt-seize sous toulousains, et n'a même pas d'escorte pour mener ses mules à l'abreuvoir (l'autorité de l'évêque est si peu respectée qu'il n'ose pas envoyer ses mules à l'abreuvoir communal sans escorte armée). Il est littéralement traqué par les créanciers de son prédécesseur qui viennent le déranger jusque dans le chapitre. L'évêché de Toulouse, dit Guillaume de Puylaurens, "était mort".
Les conciles tenus dans le Languedoc à cette époque ordonnent aux abbés et évêques de porter la tonsure et le vêtement de leur ordre, leur défendent de porter des fourrures de luxe, de jouer aux jeux de hasard, de jurer, d'introduire à leur table histrions et musiciens; d'entendre matines dans leur lit, de causer de frivolités pendant l'office, et d'excommunier à tort et à travers. Il leur est recommandé de convoquer leur synode au moins une fois par an, de ne pas recevoir d'argent pour conférer les ordres, et de ne pas se faire payer pour célébrer des mariages illicites et casser des testaments légaux.
Quelle pouvait être l'attitude des laïques en face de prélats qui négligeaient leurs devoirs à ce point? On le sait: aucune personne respectable ne voulait plus destiner ses enfants à la prêtrise, et, d'après le témoignage de Guillaume de Puylaurens, "les fonctions ecclésiastiques inspiraient aux laïques un tel dédain qu'elles donnaient lieu à une forme de jurement, comme on le fait pour les Juifs. De même qu'on dit: "J'aimerais mieux être Juif", on disait: "J'aimerais mieux être chapelain que faire ceci ou cela". Les clercs, lorsqu'ils se montraient en public, cachaient leurs petites tonsures en ramenant vers le front les cheveux de derrière la tête. Rarement les chevaliers destinaient leurs enfants au sacerdoce: ils ne présentaient que les fils de leurs gens aux églises dont ils percevaient les dîmes. Les évêques tonsuraient ceux qu'ils pouvaient, selon le temps22..." Le bas clergé, recruté au hasard, négligé par les évêques, méprisé par le peuple, vivait dans des conditions si misérables que, d'après le témoignage d'Innocent III cité plus haut, les prêtres désertaient en masse le sacerdoce pour des métiers plus riches en possibilités.
Ce lamentable état de choses provoque les protestations indignées non seulement du pape mais aussi des abbés et évêques étrangers, en particulier de ceux qui sont de tradition cistercienne, tels Jean de Salisbury. Geoffroi de Vigeois ne ménage pas ses critiques au clergé régulier, il dit que les moines portent l'habit laïque, mangent de la viande, se disputent: "Je connais un monastère où régnent quatre abbés".
Quant à l'attitude des laïques, elle est plus sévère encore; les troubadours écrivent des sirventès pleines de colère et de railleries contre le luxe, la débauche, la vénalité des prélats. Leurs écuries, disent-ils, sont meilleures que celles des comtes, ils ne mangent que des poissons rares et des sauces aux épices coûteuses et offrent à leurs maîtresses des bijoux de prix. Ce sont des hypocrites qui s'indignent de choses aussi innocentes que la beauté des parures féminines et n'ont nul souci de charité ni de justice. Ils aiment le riche et oppriment le pauvre. Les attaques les plus violentes contre les mœurs de l'Église sont devenues un des lieux communs de la littérature satirique, et ceci dans les milieux ecclésiastiques eux-mêmes.
Beaucoup d'édifices religieux sont abandonnés, faute de prêtres desservants; dans certaines églises le peuple se réunit pour y organiser des danses et chanter des chansons profanes. Cet état de choses va d'ailleurs de pair avec l'importance grandissante de l'Église cathare et souvent les paroissiens qui abandonnent leur église vont écouter les sermons des bons hommes. Mais il faut tenir compte aussi d'un certain esprit d'indifférence religieuse qui avait fini par gagner le peuple, par suite de la négligence des clercs. Quant aux classes supérieures, quand elles n'étaient pas hérétiques, elles faisaient preuve d'une tolérance si grande qu'en cette époque de foi, elle ne pouvait que faire scandale. S'il y a eu dans cette société des catholiques sincères - ce qui est plus que certain, - leur catholicisme n'était pas celui du pape ni des légats ni celui de la masse des croyants des autres pays. Enfin, la noblesse surtout devait compter beaucoup de sceptiques ou d'indifférents qui, le plus sincèrement du monde, proclamaient que l'Empire de Rome et le pape ne sont rien à côté d'un baiser de leur dame.
Certes, il faut toujours se garder de prendre trop à la lettre les invectives des papes et des moines et les indignations des poètes satiriques: une Église qui pouvait encore se permettre un langage pareil et tolérer sans s'en émouvoir de telles attaques était une Église forte. Les diocèses du Languedoc n'étaient pas tous desservis par des évêques tels que Bérenger de Narbonne, les églises n'étaient pas toutes abandonnées et l'on peut soupçonner des chroniqueurs catholiques comme Guillaume de Puylaurens d'avoir un peu noirci le tableau pour montrer à quel point la croisade était nécessaire. On voit souvent un régime qui a triomphé par la force exagérer les tares de celui qui l'a précédé, et cela en toute bonne foi. Même à l'époque de la Croisade, le Midi de la France n'a pas dû manquer de paroisses paisibles desservies par de braves curés et les personnes qui assistaient à la messe dans les grandes cathédrales d'Albi et de Toulouse ne devaient pas être toutes remplies de mépris pour l'Église. Il n'en reste pas moins vrai que beaucoup de catholiques n'ont pas eu trop de mal à se détacher d'une Église affaiblie et discréditée.
Les faits cités plus haut montrent aussi que les populations touchées par l'apostolat des missionnaires cathares ne devaient pas posséder une instruction religieuse suffisante pour lutter contre les arguments de ces redoutables logiciens. On voit parmi les convertis des bourgeois, des nobles, parfois de grands seigneurs, des prêtres, des moines, des artisans, on n'y voit guère d'abbés, d'évêques, de théologiens, de docteurs de l'Église23. (Ceux-là, il est vrai, n'avaient guère d'intérêt à se convertir à l'hérésie, mais les conversions sont loin d'être toujours déterminées par l'intérêt). L'hérésie a triomphé autant grâce à l'ignorance religieuse d'une société laïcisée que grâce à la force de sa doctrine. Pour tout dire, cette hérésie manifeste pouvait apparaître à bien des catholiques sincères comme l'expression de l'orthodoxie la plus pure.
Enfin, quoi que l'on ait pu dire sur le caractère inhumain et aristocratique de cette religion d'élus, ses ministres étaient infiniment plus proches de leurs fidèles que ne l'étaient les pasteurs catholiques. Pauvres, ils se mêlaient à la vie du peuple et partageaient ses travaux; ils ne dédaignaient pas de s'asseoir devant un métier à tisser, ni d'aider les moissonneurs à ramasser le blé; ils redonnaient du courage aux plus pauvres par l'exemple d'une vie plus dure que celle du dernier des paysans. Ils représentaient pour leurs fidèles une force réelle, celle qui n'a pas besoin de pompe ni de cérémonies pour s'imposer. Ils étaient, comme ils le disaient eux-mêmes, l'Église d'Amour, ils ne faisaient violence à personne. Et leur Église devenait puissante et prospère dans le pays, parce que ceux qui se convertissaient à leur religion avaient le sentiment d'appartenir à une communauté plus riche de vie intérieure, plus vivante et plus unie que ne l'était l'Église catholique.
Nous savons peu de chose sur les "croyants" cathares; pas même leur nombre approximatif. Nous savons que la population de certains bourgs, de certains châteaux se composait entièrement d'hérétiques, que dans certaines régions, comme la vallée de l'Ariège, ils étaient nettement en majorité, que dans certaines corporations, ils étaient plus nombreux que dans d'autres - ainsi le mot de "tisserands" était-il un sobriquet populaire servant à désigner les hérétiques - mais tous comptes faits, cette masse croyante nous apparaît aujourd'hui comme quelque chose de beaucoup plus imprécis, de plus flottant, de plus désorganisé qu'elle ne l'était en réalité. La trace de l'organisation de cette Église ne trouve place dans aucun document officiel: la suite des événements montrera que ces gens n'avaient nul intérêt à se faire enregistrer officiellement comme hérétiques.
Cette organisation existait. D'abord, les provinces avaient chacune leur évêque, assisté d'un "fils majeur" et d'un "fils mineur"; avant de mourir l'évêque ordonnait son fils majeur pour lui succéder, le fils mineur devenait fils majeur, et l'assemblée des parfaits de la région élisait un nouveau fils mineur. Chaque localité importante avait son diacre, assisté d'un nombre plus ou moins grand de parfaits et de parfaites. On sait qu'ils ne furent jamais nombreux. Toute la partie administrative et financière de l'organisation de cette Église reposait sur les épaules de croyants qui vivaient encore dans le monde, depuis les riches commerçants auxquels étaient confiés les fonds nécessaires pour l'entretien des maisons communes, jusqu'aux hommes et femmes du peuple qui servaient de messagers, d'agents de liaison ou de guides. Partout où les bons hommes s'arrêtaient pour prêcher, ils trouvaient asile dans la maison d'un croyant fidèle, connu pour l'honnêteté de sa vie ou par son zèle pour sa religion. Quand on lit dans les procès verbaux de l'Inquisition que la maison d'un tel ou d'une telle avait reçu des parfaits, on peut supposer que les croyants jugés dignes de cet honneur n'étaient pas choisis au hasard et qu'ils constituaient déjà une certaine aristocratie dans la masse des fidèles.
Enfin, dans les maisons de la communauté vivait toujours un certain nombre de personnes désireuses de recevoir l'Esprit et dont la vie était consacrée à l'étude de l'enseignement de l'Église et à la prière; ceux-là, jeunes gens confiés aux parfaits par leurs parents souvent depuis la plus tendre enfance, ou convertis de tout âge, bien que non encore "consolés", n'entraient plus dans la catégorie des simples croyants. Il y avait aussi les croyants qui, tout en vivant dans le monde, observaient déjà une partie des règles imposées aux parfaits: la chasteté, le jeûne, la prière. Il y avait également - et c'était la majorité - ceux qui vivaient comme tout le monde et se contentaient d'assister au culte et de vénérer les bons hommes.
Ceux-là n'étaient, en théorie, soumis qu'à l'obligation de faire leur melioramentum ou vénération devant les bons hommes, cérémonie très simple qui consistait à s'incliner trois fois devant le parfait et de lui dire: "Priez Dieu pour qu'il fasse de moi un bon chrétien et qu'il m'accorde une bonne mort". Le parfait bénissait le croyant et disait: "Que Dieu fasse de toi un bon chrétien et qu'il te mène à une bonne mort". Le croyant n'avait pas d'autre obligation religieuse et pouvait même, par prudence, continuer à fréquenter les églises catholiques. Les croyants étaient des gens qui n'allaient plus à l'église, ou n'y allaient que par crainte ou par coutume. Et comme nous avons pu le voir, dans bien des paroisses ils n'avaient même pas besoin de le faire.
Ceux qui avaient une foi sincère, s'ils n'avaient pas de part au sacrement, faisaient régulièrement - en général une fois par mois - leur aparelhamentum ou mise au point: ils devaient faire publiquement l'aveu de leurs péchés et demander le pardon de Dieu. Ce n'était pas une véritable confession publique, mais une espèce d'acte de contrition rédigé en termes assez généraux pour comprendre tous les péchés, surtout ceux de paresse et de négligence à accomplir la volonté de Dieu. Le parfait officiant remet aux croyants leurs péchés et leur impose une pénitence faite de jeûnes et de prières. Les cathares prient beaucoup, mais leur prière consiste surtout à répéter le Pater en langue occitane (avec les mots "pain suprasubstantiel" pour "pain quotidien") et à méditer sur les commentaires de l'oraison dominicale. Il existe des prières cathares24, mais la vraie, la grande, la seule prière, celle qui est le centre du culte et la nourriture quotidienne du parfait comme du croyant, est toujours le Pater.
On voit donc que la vie du croyant cathare, malgré la non-participation aux sacrements, était une vie religieuse réelle, plus intense même, plus profonde que ne pouvait l'être la vie religieuse de la majorité des catholiques, grâce au simple fait que l'Église cathare était, sinon persécutée, du moins illégale et encore à moitié clandestine. Il est vrai que dans beaucoup de régions, elle ne l'était même plus; à l'époque de la Croisade, un grand nombre de personnes avait déjà dû se convertir au catharisme pour faire comme tout le monde et par intérêt. Mais la nouvelle Église gardait encore tout son caractère d'Église persécutée. L'homme qui se faisait hérétique par conviction pouvait retremper sa foi dans le souvenir de bûchers encore récents. À la fin du xiie siècle, la communauté cathare dispose de biens importants: non seulement les parfaits - hommes de milieux aisés pour la plupart - lui font abandon de leurs biens, mais beaucoup de croyants lèguent à leur lit de mort toute leur fortune à l'Église nouvelle; beaucoup de croyants riches et puissants font des donations aux bons hommes, et pas seulement des dons en argent, mais des terres, des maisons, des châteaux. Malgré la règle de pauvreté absolue qu'ils se sont imposée et dont ils ne dérogent pas, les parfaits acceptent tous les dons, qu'ils font administrer dans l'intérêt de leur Église. On les accuse même déjà de rapacité et d'avarice (leurs ennemis le font, du moins, leurs amis pas encore). C'est qu'en dehors des secours d'urgence aux pauvres, les communautés cathares doivent entretenir leurs "maisons", qui sont à la fois écoles, monastères et hôpitaux; ils fondent en outre des communautés ouvrières, en particulier de grands ateliers de tissage qui sont en même temps des centres d'éducation de la jeunesse et des maisons de préparation au noviciat. De plus, un très grand nombre de femmes nobles abandonnent leurs maisons et leurs biens à la communauté et fondent ainsi de véritables couvents où elles élèvent les filles de croyants nécessiteux et les filles de nobles qui veulent consacrer leurs enfants au service de Dieu. Dans les montagnes de l'Ariège se forment des ermitages où des veuves, des jeunes filles désireuses de garder une virginité perpétuelle et même des femmes mariées, qui se sont séparées de leurs maris pour mieux servir Dieu, se réunissent et vivent dans des grottes ou de petites cabanes isolées, s'abandonnant à la méditation et à la prière; et ces communautés de recluses acquièrent dans le pays une grande réputation de sainteté.
On a souvent remarqué l'importance du rôle joué par les femmes dans les communautés cathares. Ceci n'a rien de surprenant. D'abord, c'est là un fait constaté lors de l'apparition de toute religion nouvelle, un grand prédicateur déchaîne infailliblement une vague d'enthousiasme collectif - nous dirions presque hystérique - auquel les femmes sont plus sujettes que les hommes. Non seulement tout propagandiste zélé d'une nouvelle secte religieuse, mais même tout prêtre possédant une personnalité marquante, se voit aussitôt entouré d'un groupe de femmes exaltées et dévouées prêtes à accueillir tous ses discours comme paroles d'Évangile. N'oublions pas que, dans ce même Languedoc hérétique, ce sont les femmes, plus que les hommes, que la prédication de saint Dominique a touchées. Il en a été de même pour les parfaits cathares: les femmes ont, en général, été plus ardentes que les hommes dans leur acceptation de la nouvelle foi et ont souvent entraîné leurs maris, plus tièdes ou plus prudents.
De plus, dans le Midi de la France, la femme jouissait d'une indépendance morale plus grande que dans les pays du Nord. Si le respect de la femme était, depuis plus d'un siècle, un des lieux communs de la littérature, c'est que la femme avait su depuis longtemps se faire respecter. C'est du pays occitan que la tradition de l'amour courtois s'est répandue à travers toute l'Europe, et si les seigneurs du Midi n'étaient pas toujours chevaleresques dans leurs actes, ils l'étaient du moins en paroles. On se souvient de la fameuse phrase adressée par frère Étienne de Minia, compagnon de saint Dominique, à Esclarmonde, sœur du comte de Foix: "Allez filer votre quenouille, Madame, il ne vous sied pas de prendre la parole sur de telles matières25!" On imagine sans mal l'étonnement, le mépris indigné de cette très grande dame, souveraine sur ses terres, âgée, veuve, six fois mère, et parfaite vénérée de tous les croyants, remise ainsi à sa place par cette grossière apostrophe. Il fallait assurément être un étranger et un rustre pour se permettre un langage pareil. Les dames du Languedoc (pas plus que celles de France, d'ailleurs) ne tenaient nullement à être renvoyées à leurs quenouilles, elles étaient souvent plus cultivées que leurs maris. Il en était ainsi dans la société laïque; dans la société religieuse catholique elles étaient mineures par définition.
La religion cathare, en niant la réalité des sexes comme elle niait la réalité de toute vie chamelle, proclamait implicitement l'égalité de l'homme et de la femme. Il est vrai que le catholicisme ne la niait pas non plus, mais il restait, dans la pratique, une religion résolument anti-féministe. Le catharisme l'était infiniment moins: les femmes qui avaient reçu l'Esprit avaient, comme les hommes, le pouvoir de le transmettre par l'imposition des mains, bien qu'en général elles ne le fissent que dans les cas extrêmes, et beaucoup moins souvent que les hommes. On ne voit pas de femmes parmi les évêques et les diacres cathares; la part active de l'apostolat est réservée aux hommes, plus aptes à supporter les dangers et les fatigues d'une vie vagabonde. Les parfaites jouissent néanmoins d'une grande considération, et certaines sont considérées comme les véritables mères de leurs communautés.
Les femmes sont moins nombreuses que les hommes, parmi les parfaits; mais à peine moins. En parlant des hérétiques revêtus capturés par les croisés, les historiens de l'époque ne nous disent pas les chiffres exacts, mais il ne semble pas qu'il y ait eu une prédominance écrasante du côté des hommes. Ces "bonnes chrétiennes" exercent surtout leur apostolat auprès des femmes croyantes; comme nous l'avons vu, elles s'occupent beaucoup de l'éducation des filles, elles sont souvent aussi gardes-malades ou médecins, car les femmes, à cette époque, préfèrent être soignées par des femmes. Enfin, plus souvent que les parfaits, elles s'adonnent à la vie contemplative.
Les femmes simplement croyantes semblent en revanche avoir été plus nombreuses que les hommes, et en tout cas plus hardies. De la grande dame entourée de poètes et d'admirateurs à la veuve qui consacre sa vie aux prières et aux œuvres de bienfaisance, en passant par la femme du peuple qui sert les bons hommes à table et parcourt le pays en portant leurs messages, les femmes croyantes se font en général remarquer plus que les hommes, et ceci pour une raison assez évidente: les hommes, même croyants dans le fond du cœur, ont des obligations professionnelles, sociales, militaires, auxquelles ils ne peuvent renoncer. Dans une société où une grande partie des relations humaines reposait sur l'usage du serment, les hommes ne pouvaient professer trop ouvertement une religion qui défend le serment. Les femmes, plus libres sur ce point, pouvaient se consacrer à leur activité religieuse sans faillir à leurs autres obligations.
De plus, même avant la croisade, la simple prudence pouvait engager les hommes à ne pas faire trop parade de leurs convictions: si le comte et la majorité des grands féodaux du pays étaient favorables à l'hérésie, cela pouvait ne pas durer et l'Église de Rome était toujours puissante, et détenait une partie des fonctions administratives du pays. C'est pourquoi on voit souvent les hérétiques reçus dans les maisons des femmes (telles Blanche de Laurac, Guillelmine de Tonneins, Fabrissa de Mazeroles, Ferranda, Serrona, Na Baiona, etc.). Les pères, frères, maris sont ainsi couverts devant la loi, l'hérésie n'étant que tolérée, non reconnue officiellement. Ainsi verra-t-on plus tard le comte de Foix, protecteur des hérétiques, mari et frère de parfaites, rejeter toute responsabilité au sujet des agissements de sa sœur Esclarmonde, hérétique notoire: "Si ma sœur fut mauvaise femme et pécheresse, je ne dois point périr à cause de son péché...26" Ce qui ne veut pas dire que les hommes, à l'occasion, manifestaient moins de zèle pour leur foi que les femmes.
IV - ASPECTS SOCIAUX ET MORAUX DU CATHARISME
Ce qui a été dit au sujet de la moralité ou plutôt de l'immoralité des croyants cathares est assez important pour que l'on s'y arrête plus longuement, car la plupart des adversaires de la religion cathare l'ont précisément attaquée sur ce terrain. La valeur profonde d'une religion étant jugée par ses effets sur le comportement de ses fidèles, ceux qui avaient à lutter contre le catharisme ne pouvaient pas proclamer que cette hérésie rendait ses adhérents charitables et vertueux. C'est pourquoi ils parlent sans cesse de l'hypocrisie des parfaits et des mauvaises mœurs de leurs croyants.
Pour ce qui est des parfaits, leur attitude devant la mort les lave à jamais de tout soupçon d'hypocrisie; et pourtant leur austérité a paru si étrange aux contemporains catholiques qu'ils ont été maintes fois accusés de vices secrets et honteux, et notamment d'homosexualité (accusation qui s'explique par le fait que les parfaits, hommes ou femmes, vivaient deux par deux et ne se séparaient jamais de leur socius ou socia). Même en admettant la pureté des mœurs des parfaits, les polémistes catholiques la trouvent peu naturelle, et attribuent à ces ascètes des sentiments d'aigreur et d'envie à l'égard de ceux qui n'ont pas renoncé aux joies du monde; ce qui donnerait à croire que la majorité des prêtres et des moines de ce temps-là étaient très loin de pratiquer la chasteté et la pauvreté, car s'il en était autrement les vertus des ministres cathares n'eussent étonné personne.
Or, dans une société où même les clercs ne donnaient pas, tant s'en faut, l'exemple des vertus (ainsi qu'en témoignent les écrits des papes, abbés, évêques, sans parler de la littérature profane), peut-on croire que les laïcs pratiquaient une morale plus austère? Ce qu'on a dit de l'immoralité de certains croyants cathares devait s'appliquer tout aussi bien aux catholiques de leur temps, et la vie privée des grands seigneurs (on ne connaît guère celle des simples particuliers) montre que la licence des mœurs était générale; la société médiévale (celle du Midi en particulier) était aussi peu hypocrite que possible, et la vanité, la cupidité et la luxure n'étaient pas des vices qu'on fût tenu de dissimuler.
D'autre part, le reproche (souvent adressé aux parfaits) de fréquenter des gens peu recommandables rappelle trop celui que les pharisiens faisaient à Jésus pour qu'il puisse être vraiment pris au sérieux. De plus, dans leur zèle apostolique, ils devaient - comme le font les missionnaires chrétiens dans les pays où la religion officielle est fortement organisée - s'intéresser tout particulièrement aux déclassés, aux parias de toute espèce, gens de moralité incertaine, et que leur prédication n'arrivait sans doute pas toujours à amender. Et, la charité des parfaits étant bien connue, nombreux devaient être les parasites qui, sous prétexte de conversion, cherchaient près d'eux un refuge contre la misère. Mais ce n'est pas à ses éléments les plus faibles et les moins désintéressés que se juge une communauté.
Or, pour ce qui est des vrais croyants, de ceux qui se dévouaient corps et âme à leur Église, qui assistaient aux consolamenta, et recevaient chez eux les ministres de la secte, le principal grief relevé contre eux semble être le fait qu'ils vivaient avec des "concubines", et que certains avaient des bâtards. En effet, on cite souvent des croyants assistant à une cérémonie hérétique en compagnie de leurs concubines (amasia: maîtresse), "Willelmus Raimundi de Roqua et Amauda, amasia ejus; Petrus Aura et Boneta, amasia uxor ejus; Raimunda, amasia Othonis de Massabrac, etc.27". Or, pour l'Église catholique, toute femme non mariée à l'église était automatiquement une concubine; et les croyants cathares pouvaient avoir des raisons pour ne pas se marier dans une Église dont ils méprisaient les rites, tel justement le jeune Othon de Massabrac, chevalier de la garnison de Montségur, de famille cathare depuis trois ou quatre générations et proscrit comme tel à l'époque de l'Inquisition. Dans tous les cas, le fait de ne pas se marier à l'église n'est pas en soi une preuve de mauvaises mœurs, et à la fin du siècle dernier on a vu des femmes fort austères revendiquer avec fierté le droit au mariage civil. On sait qu'en général les adeptes des religions nouvelles ont plutôt tendance au puritanisme qu'au relâchement des mœurs.
D'autre part, les Inquisiteurs sont unanimes à constater que pour les hérétiques le mariage est un état satanique: "...Ils déclarent que connaître charnellement sa femme n'est pas une moindre faute qu'un commerce incestueux avec sa mère, sa fille ou sa sœur". (Bernard Gui28). Est-il certain que les parfaits, dans leurs sermons, aient cherché à répandre dans le peuple des vérités aussi dangereuses? Et de telles déclarations pouvaient-elles encourager les fidèles à commettre l'inceste avec leurs mères ou leurs filles? Il est plus que probable que des propos comme en cite B. Gui (s'ils sont authentiques) ne s'adressaient qu'aux initiés, c'est-à-dire aux parfaits eux-mêmes et à ceux qui aspiraient à l'initiation, hommes pour lesquels le mariage, et un mariage béni par Dieu, eût été un scandale aussi grand que le mariage d'un moine ou d'un prêtre pour les catholiques. L'Église catholique elle-même a admis de tout temps que pour un moine, les plus coupables faiblesses, pourvu qu'elles fussent passagères et suivies de repentir, sont moins graves qu'une consécration officielle et sacrilège du péché par le mariage. C'est dans ce sens-là qu'ils faut comprendre le rigorisme des parfaits.
On a reproché aux bons hommes de condamner la procréation en termes souvent violents et de déclarer une femme enceinte en état de péché et d'impureté; mais (comme le prouve la cérémonie des relevailles) l'Église catholique, elle aussi, admettait l'impureté essentielle de la procréation et de l'enfantement. Cependant, pour l'Église catholique, l'enfant était une grâce de Dieu et non une malédiction, car sa théologie admettait l'inexplicable mystère de l'amour de Dieu pour une matière même corrompue. Mais cette sagesse, qui avait sa source dans le judaïsme antique et peut-être dans certaines traditions païennes, l'Église elle-même avait bien du mal à la faire entrer dans un système de valeurs cohérent; le moyen âge, époque rationaliste et éprise de logique, semblait nier la possibilité d'une quatrième dimension, même chez Dieu.
Le reproche d'immoralité adressé aux croyants est d'autant plus singulier que, pour beaucoup d'entre eux (des femmes surtout), le mariage était un symbole de réconciliation avec l'Église: Covinens de Fanjeaux, convertie par saint Dominique, "abandonna leurs erreurs et se maria". "Bernarda vécut trois ans dans l'hérésie, mais ensuite elle se maria et eut deux enfants29..." On ne nous dit pas que ces jeunes filles menaient une mauvaise vie avant leur mariage, mais simplement qu'elles gardaient leur virginité. Il en est de même pour la jeune hérétique champenoise brûlée à Reims en 1175 30, convaincue de catharisme pour le seul fait qu'elle voulait à tout prix rester vierge. C'est donc par leur pureté, plutôt que par leur libertinage, que les cathares sincèrement croyants se faisaient remarquer.
Ce n'était là, dira-t-on, qu'une élite; et les autres? Il est probable, en effet, qu'un certain nombre de personnes, ardentes dans leur foi mais trop faibles pour résister aux tentations, aient abandonné l'état conjugal pour renoncer au monde, et soient ensuite tombées dans des fautes qui ont provoqué le scandale et jeté le discrédit sur leur communauté. Même si les parfaits ne se détournaient pas de ces brebis égarées, ils ne pouvaient avoir intérêt à favoriser l'immoralité, puisque c'est justement la licence des mœurs qu'ils dénonçaient le plus violemment chez les catholiques.
(Le cas de la jeune Rémoise est d'ailleurs assez caractéristique du point de vue de la mentalité des adversaires des cathares: Rodolphe, abbé de Coggeshall en Angleterre, raconte que l'archevêque de Reims se promenait un jour avec ses clercs aux environs de la ville et qu'un de ses clercs, Gervais Tilbury, apercevant une jeune fille qui marchait seule dans les vignes, vint à elle et se mit lui tenir des propos galants ("bien qu'il fût chanoine"); propos fort explicites, il faut le croire, puisque la jeune fille, "avec modestie et sérieusement, osant à peine le regarder", répond qu'elle ne peut se donner à lui, car "si je perdais ma virginité, mon corps se corromprait aussitôt et je serais vouée sans remède à l'éternelle damnation". À ce langage, le jeune clerc reconnaît une hérétique et la dénonce comme telle à l'archevêque qui survient avec sa suite. La jeune fille (ainsi que la femme qui l'a instruite) est condamnée au bûcher et meurt avec un courage qui provoque l'admiration des assistants. On ne sait ce qu'il faut admirer davantage dans cette histoire, l'héroïsme de cette martyre anonyme ou l'inconscience des juges et du chroniqueur qui trouvent tout naturel qu'un clerc cherche à séduire une jeune fille et se serve de sa propre impudence comme d'un argument contre sa victime. À qui donc pouvait jeter la pierre une Église où une telle décadence de mœurs était possible?)
La majorité des simples croyants ne semble donc pas avoir vécu plus mal que les catholiques. Bien mieux, à voir les listes des familles nobles (ces listes-là sont les seules qui client subsisté) qui adhéraient ouvertement au catharisme, il n'apparaît nullement que cette religion ait cherche en quoi que ce soit à nuire à la vie familiale en condamnant le mariage et la procréation; c'est au contraire sur de grandes familles, et sur des traditions transmises de père en fils, que reposait en grande partie l'édifice social de l'Église cathare. Cette liste fait surgir l'image d'un milieu où les liens de famille étaient puissants et respectés. Les croyants les plus zélés - forcés par les persécutions à se "convertir" - reconnaissent tous avoir été élevés dans la foi par leurs mères, grand-mères, oncles, tantes, etc.; ils marient leurs fils aux filles d'autres croyants, ils se font "consoler" chez leurs frères, ou leurs beaux-parents. Telles grandes dames, comme Blanche de Laurac, faisaient figure de véritables chefs de clan, avec leurs innombrables fils, filles, petits-fils, gendres, belles-filles, petites-filles, tous élevés dans une même ferveur pour la foi cathare. Les seigneurs de Niort, de Saint-Michel, de Festes, de Fanjeaux, de Mirepoix, de Castelbon, de Castelverdun, de Cabaret, de Miraval, etc., étaient notoirement hérétiques, et les dépositions des témoins citent sans cesse les divers membres des familles de ces seigneurs, à tous les degrés de parenté, ce qui fait penser que dans ce milieu (comme dans tout milieu féodal) le sens de la solidarité familiale était très fort. L'action dissolvante de la religion cathare ne semble pas s'être exercée sur ces familles, qui comptent cependant parmi les plus solidement acquises à l'hérésie, et ceci depuis des générations. Il serait donc absurde de prétendre que cette religion ait été un danger pour la société comme facteur de désagrégation de la famille.
Il est vrai que certaines femmes très pieuses se retiraient dans des couvents du vivant de leurs maris; en général, elles le faisaient dans un âge avancé, quand leurs enfants étaient déjà grands et mariés; le plus souvent, elles attendaient de devenir veuves, comme Blanche de Laurac, ou Esclarmonde de Foix, qui toutes deux avaient eu de nombreux enfants.
Un autre reproche (moins fréquent), que les catholiques ont pu faire aux cathares, est celui de pousser leurs fidèles à l'anarchie par leur mépris pour les pouvoirs publics, leur refus de la violence et de l'usage du serment. Ce reproche-là semble à première vue plus fondé que le précédent. Les cathares prêchaient, en effet, que l'autorité temporelle avait été établie non par Dieu, mais par Satan. Cependant, ni les cathares du Languedoc ni les vaudois (dont la morale était proche de celle des cathares) n'ont manifesté de tendances révolutionnaires, comme l'ont fait les bogomiles. Si les vaudois insistaient sur l'obligation de pauvreté pour leurs croyants, ce n'était nullement le cas des cathares dont les adeptes les plus zélés se trouvaient justement parmi les classes aisées de la population. En tout cas, les cathares ne poussaient pas leurs fidèles à une révolte ouverte contre les pouvoirs publics, estimant avec logique que dans un univers gouverné par le prince de ce monde aucune organisation sociale ne saurait être satisfaisante.
Cependant, les croyants, tout en vivant dans le monde, professaient une religion qui niait tous les principes sur lesquels était basée la société où ils vivaient. N'était-ce pas inévitable que leur sens de la discipline, des obligations envers leurs seigneurs ou envers les lois, en ait été ébranlé? Les croyants sincères, fussent-ils d'excellents citoyens, devaient, semble-t-il, s'acquitter de leurs devoirs civiques avec la conscience de remplir une tâche inutile et tout à fait secondaire. Mais l'Église catholique n'enseignait-elle pas elle-même à ses fidèles que la patrie céleste est d'un prix plus grand que la patrie terrestre? Accusait-on l'Église catholique de semer l'anarchie par de tels propos?
On relève contre les croyants diverses accusations, maintes fois répétées, et si Pierre des Vaux de Cernay est un témoin extrêmement partial, il ne doit pas se tromper tout à fait en prétendant que les croyants (credentes) s'adonnaient "à l'usure, aux rapines, aux homicides, parjures et toutes sortes de perversités". Il parle, évidemment, des seigneurs et chevaliers cathares. Il ne faut pas oublier que ces mêmes reproches étaient adressés à la noblesse de pays nullement suspects d'hérésie; et l'hostilité permanente entre le clerc et le noble nous donnerait la plus sinistre idée de la chevalerie catholique si nous n'avions, pour la juger, que les écrits des gens d'Église: quelques soldats du Christ mis à part, les chevaliers apparaissent comme des hommes livrés aux pires instincts, pleins de brutalité, assoiffés de luxe et d'honneurs, ne trouvant leur plaisir que dans les guerres et les rapines. La littérature laïque, de son côté, ignore ou méprise les clercs; les évêques (quand ils ne fracassent pas les crânes des Sarrasins comme Turpin) y sont, au mieux, des figurants décoratifs; et dans les pays les plus profondément catholiques, nobles et ecclésiastiques semblent vivre dans des mondes à part, rivaux et plutôt hostiles. Or, la noblesse du Midi de la France, sans être pire que celle des autres pays, ajoutait à ses nombreux défauts celui de mépriser ouvertement la religion catholique; comment s'étonner qu'elle ait encouru, de la part de gens d'Église, des reproches dont les clercs étaient déjà si prodigues envers les nobles catholiques?
Les barons du Nord ne respectaient pas toujours leurs serments et saisissaient la moindre occasion pour se révolter contre des suzerains qu'ils avaient juré sur l'Évangile de servir fidèlement. Ceux du Midi, quand ils étaient croyants cathares, donc adeptes d'une religion qui tenait tout serment pour illicite, devaient considérer les serments qu'ils étaient obligés de prêter comme de simples formalités, vides de toute valeur morale (ou du moins étaient-ils plus libres de le faire quand cela servait leurs intérêts). Peut-être ont-ils été plus souvent "parjures" que les hommes du Nord? Mais, d'autre part, leur religion condamnait toute espèce de mensonge, ce qui impliquait l'obligation de garder dans sa conduite une certaine droiture. La religion ne devait pousser à se parjurer que des gens qui l'eussent fait de toute façon. Cependant, même les plus honnêtes étaient souvent obligés d'entretenir des rapports avec l'Église catholique qui détenait une grande partie des fonctions officielles et administratives du pays, il y avait donc là forcément un encouragement à l'hypocrisie. Il est juste de dire que beaucoup de petits seigneurs avaient franchement et complètement rompu tout lien avec l'Église établie: dans le Toulousain, dans l'Ariège, le Carcassès, des villages, parfois des régions entières, avaient depuis longtemps abandonné le culte catholique; tous les habitants y recevaient le consolamentum à leur lit de mort, les parfaits célébraient leur culte dans les églises abandonnées, et l'on cite l'exemple du château de Termes où (avant l'arrivée des croisés) aucun service religieux n'avait été célébré depuis plus de vingt-cinq ans. Les seigneurs faidits (ceux qui abandonnèrent leurs terres à l'arrivée des croisés) étaient des croyants trop intransigeants pour simuler une soumission à l'Église; ils étaient nombreux. Il est logique de supposer que des hommes capables de sacrifier à leur foi leurs biens et leur sécurité n'étaient pas des gens adonnés à l'usure, aux rapines et à la débauche.
Les bourgeois des villes du Midi semblent avoir été des gens combatifs; les chevaliers, riches ou pauvres, quand ils ne passaient pas leur temps à la cour et aux fêtes, ne restaient pas les trois quarts de l'année à cultiver leur jardin, car la gestion de leurs domaines exigeait une lutte armée permanente contre les voisins, les bandits, voire des vassaux ou des bailes insoumis. Pas plus que l'Église catholique, l'Église cathare n'avait pas transformé les loups en agneaux; mais sans doute proclamait-elle avec plus de violence son horreur du meurtre: le croyant cathare ne pouvait jamais avoir la conscience de se battre pour une cause sainte. Il en fut du moins ainsi dans les premières années de la croisade.
Les cathares avaient la plus haute idée de la valeur et la dignité de la vie: ainsi, ils n'admettaient pas que le Dieu de l'Ancien Testament ait pu être bon, puisqu'il avait noyé tous les peuples de la terre lors du Déluge, fait périr le Pharaon et son armée, les habitants de Sodome, etc.; qu'il approuvait les meurtres et ordonnait aux Israélites de massacrer les populations de Canaan. Pour les catholiques, la mort des méchants ne semblait poser aucun problème; la morale des cathares était plus exigeante et plus nuancée. En se basant sur l'Évangile, ils condamnaient absolument la peine de mort et même toute peine afflictive et prétendaient que les criminels ne devaient pas être punis, mais soumis à un traitement qui pût les rendre meilleurs. Sans doute leur était-il facile de parler ainsi puisque la justice était entre les mains de leurs adversaires. Il n'en est pas moins troublant de constater que des doctrines aussi humaines étaient dénoncées par l'Église comme scandaleuses. Il est également compréhensible qu'elles aient pu séduire beaucoup de personnes, en un siècle qui apparaît, de ce fait, moins cruel et primaire que les observateurs superficiels ne le croient d'habitude.
Ceux qui écoutaient les sermons des parfaits devaient avoir une conscience de la solidarité humaine que n'avaient pas les chevaliers qui croyaient gagner le paradis en pourfendant des Sarrasins; il n'était pas immoral de proclamer que le meurtre d'un Sarrasin est un crime aussi grand que le meurtre d'un père ou d'un frère; ce n'était pas immoral, c'était peut-être imprudent. Nous verrons par la suite que la guerre forcera les parfaits à se départir de leur intransigeance et à permettre à leurs fidèles de se battre, sans doute même à les y encourager. Mais il n'est pas impossible que leur pacifisme n'ait été une des causes de la mollesse relative de la résistance des Occitans au début de la guerre.
V - LUTTE CONTRE "BABYLONE"
Ces quelques considérations nous montrent que la doctrine cathare pouvait présenter certains dangers du point de vue social, bien que l'examen objectif de la situation soit pratiquement impossible faute de données concrètes. Mais ce qui est certain, c'est que, dans le Languedoc, les pouvoirs publics, aussi bien que les princes et les barons, que les consuls et les grands bourgeois, ont été d'une manière générale favorables à l'hérésie. En fait, le caractère anarchique de cette religion inquiétait si peu les grands seigneurs et les consuls qu'ils y adhéraient eux-mêmes ou y faisaient adhérer leurs femmes et leurs sœurs. Si la religion cathare était combative, ce n'était pas contre les pouvoirs temporels, mais contre l'Église.
L'Église était, comme nous l'avons indiqué plus haut, la rivale et souvent l'ennemie de la noblesse, et ceci depuis des siècles. Si, au moyen des croisades, l'Église avait su mobiliser en partie à son profit l'ardeur guerrière et conquérante de la chevalerie, la noblesse non croisée était, dans tous les pays, à l'affût des biens de l'Église qu'elle convoitait par le droit du plus fort; l'Église, de son côté, enrichie de siècle en siècle par les donations, les testaments, les impôts de plus en plus nombreux qu'elle prélevait sur les villes et les campagnes, s'était en grande partie sécularisée. Elle gérait d'immenses domaines et entretenait des milices pour les défendre (on a vu que certains évêques, tel Bérenger de Narbonne, allaient jusqu'à faire ramasser leurs impôts par des capitaines de routiers; si ces cas étaient rares, ce seul détail indique que l'Église ne plaisantait pas sur le non-payement des dîmes). Par ces impôts, prélevés sur des populations déjà pauvres, l'Église faisait concurrence aux seigneurs; par ses richesses en terres et en châteaux elle irritait leur ambition, les hommes de guerre n'ayant souvent que mépris pour les tonsurés. Partout où ils le pouvaient les seigneurs entraient en procès ou même en guerre contre les évêchés ou abbayes. Les prélats (à la fin du XIIe siècle) commençaient à abuser des excommunications, qui restaient toujours un grave ennui d'ordre administratif mais ne provoquaient plus la terreur, et qui, bien souvent, demeuraient sans effet pour avoir été fulminées sans discernement.
Si dans des pays où nul ne cherchait à mettre en doute la doctrine de l'Église, il existait un antagonisme chronique entre la noblesse et l'Église, dans des pays où l'hérésie était puissante, cet antagonisme prenait l'aspect d'une guerre ouverte. Faut-il croire que c'est par intérêt et pour s'emparer des biens de l'Église que tels grands seigneurs étaient devenus hérétiques? Il est certain que les hauts barons du Languedoc et, en premier lieu le comte de Toulouse, étaient grands spoliateurs de biens d'Église. (Raymond VI reconnaît lui-même, en 1209, s'être livré à des actes de violence contre des moines et des abbés, avoir emprisonné l'évêque de Vaison, déposé l'évêque de Carpentras, confisqué des châteaux et des bourgs aux évêques de Vaison, de Cavaillon, de Rodez, aux abbés de Saint-Gilles, de Saint-Pons, de Saint-Thibéry, de Gaillac, de Clarac, etc.; ce qui prouve tout autant la rapacité du comte que l'extrême richesse des évêchés et des abbayes31). La noblesse, tout autant que le peuple, reprochait à l'Église sa richesse excessive et hors de proportion avec les services qu'elle rendait.
Les comtes de Toulouse et de Foix, les vicomtes de Béziers confisquaient les biens d'Église pour s'enrichir; d'autre part, ils faisaient des donations importantes à des églises et des abbayes. Cette façon d'agir semble dictée plutôt par des questions d'intérêts locaux et de relations personnelles que par une politique bien définie. Mais ce que l'apparition du catharisme (et plus tard du valdisme) avait provoqué ou plutôt révélé dans le Languedoc, c'était une haine profonde et active de l'Église catholique, haine qui trouvait un écho dans toutes les couches de la population.
Il serait faux de croire que la propagande des parfaits ait provoqué cette haine, qui devait être déjà assez forte puisque les attaques les plus violentes contre l'Église ont pu être favorablement accueillies par un grand nombre de catholiques. Bien plus, on a pu voir dans le caractère anticlérical de la prédication des cathares une des grandes raisons de leur succès, et cette explication (qui constitue en elle-même le plus terrible jugement qu'on puisse porter contre l'Église,) a été proposée par certains historiens catholiques, donc nullement suspects d'anticléricalisme. Mais si l'Église était, dans le Languedoc, impopulaire et incapable de remplir sa tâche, il faut dire que la propagande de ses adversaires fournissait parfois des armes aux passions les plus basses et provoquait des désordres et des scandales.
Telles confiscations de terres d'Église par de grands ou petits seigneurs pouvaient, somme toute, n'être qu'une réaction légitime contre les trop vastes appétits de certains prélats. Mais pour les pauvres gens qui poussaient un soupir de soulagement à l'idée de ne plus payer la dîme et les multiples redevances exigées pour les sacrements, l'abandon de l'ancienne foi ne pouvait être une question de sous; ceux qui se détournaient d'une Église en laquelle ils avaient cru, même vaguement et de mauvaise grâce, étaient poussés par une propagande souvent indiscrète à des actes odieux que les parfaits n'eussent sans doute pas approuvés, mais dont ils portent en partie la responsabilité. La foi nouvelle, après avoir pris racine dans le pays, y avait suscité un véritable fanatisme, qui n'était sans doute pas le fait de la majorité des croyants (puisqu'en général catholiques et hérétiques s'entendaient fort bien entre eux), mais qui ne saurait pas non plus être attribué aux seuls bandits des grands chemins.
Pierre des Vaux de Cernay cite le cas d'un nommé Hugues Faure, qui profana de la façon la plus grossière l'autel d'une église, le cas d'hérétiques de Béziers attaquant un prêtre et lui arrachant le calice pour le souiller32; les registres de l'Inquisition rapportent le cas d'un B. de Quiders urinant sur la tonsure d'un prêtre33; de tels faits devaient être rares, car les adversaires des hérétiques auraient eu intérêt à les signaler et n'en citent en fait que très peu. Mais le même Pierre des Vaux de Cernay nous raconte comment le comte de Foix, en litige avec les moines de Saint-Antonin, seigneurs de la ville de Pamiers, y envoie deux de ses chevaliers pour venger l'affront fait à une noble parfaite expulsée de la ville par les moines; ces chevaliers coupent un chanoine en morceaux, arrachant les yeux à un autre; après quoi, le comte lui-même fait irruption dans le monastère, fait la fête dans les locaux du couvent et y met le feu. Il en fait autant dans les locaux du couvent de Sainte-Marie après avoir assiégé les moines et les avoir réduits à se rendre par la faim et pillé l'église. Dans une autre église, il fait arracher bras et jambes à un crucifix et ses soldats s'en servent pour piler des épices; un de ses écuyers perce un crucifix de coups de lance en lui criant de se racheter34.
S'agit-il seulement de calomnies? C'est possible, mais si le catholique Raymond VI a pu être accusé d'avoir brûlé une église avec les personnes qui s'y trouvaient, de la part du comte de Foix de telles violences n'ont pas de quoi surprendre; dans ce cas, une telle conduite montre moins de brutalité que de véritable passion anticléricale; de tels actes sont inspirés par la haine la plus vive de l'Église catholique. Et si, plus tard, Raymond-Roger de Foix protestera devant le pape de son orthodoxie, il ne le fera sans doute que pour obéir à un mot d'ordre des siens; cet infatigable lutteur, cet ennemi redoutable des croisés devait être le représentant le plus marquant d'une certaine noblesse cathare, ardemment croyante, combative et fanatique.
Si des seigneurs comme le comte de Foix avaient le pouvoir de faire beaucoup de mal à l'Église, des croyants moins puissants mais aussi zélés ne brûlaient pas les couvents, ne les confisquaient pas pour y installer des parfaits, mais maltraitaient les prêtres et saccageaient églises et cimetières. À ceux-là, se joignaient sans doute un grand nombre de soldats vagabonds ou simplement d'énergumènes toujours heureux d'un prétexte de faire des dégâts; se prétendant hérétiques, ils pouvaient le faire sans encourir le blâme public. Les autorités, favorables à l'hérésie, ne réprimaient pas ce genre de délits; le peuple, fanatisé ou simplement hostile aux clercs, les approuvait. Les témoignages des contemporains sont formels: non seulement des régions entières étaient acquises à l'hérésie, mais dans celles qui passaient pour catholiques, il n'y eut pas de mouvements de révolte contre les sacrilèges commis par des hérétiques faux ou vrais.
La haine toute spéciale que les cathares professaient pour la croix (instrument du supplice de Dieu) et pour la messe (sacrilège suprême, puisqu'elle prenait pour le corps de Dieu une parcelle de vile matière destinée à se corrompre dans les entrailles des fidèles) les entraînait à des attaques violentes contre les dogmes les plus sacrés de l'Église catholique; et le seul fait que ces attaques ne semblaient plus révolter personne prouve à quel point l'Église était, dans ce pays, unanimement méprisée. Les villes restées catholiques n'ont pas cherche à défendre leur foi par des croisades locales et des massacres, ce qui est tout à leur honneur, mais montre surtout que dans le Languedoc c'était l'Église cathare qui était en fait la plus forte. Parmi les évêques et les abbés beaucoup étaient de familles hérétiques et montraient de l'indulgence pour l'hérésie. Curés et chanoines fraternisaient avec les croyants, même avec des parfaits, soit par opportunisme soit par sympathie pour une doctrine dont ils reconnaissaient la force morale. Et cependant, pour les cathares, l'Église était l'ennemie par excellence, Babylone et prostituée, siège de Satan et lieu de damnation, et ils ne pouvaient en aucune façon tolérer ce qu'ils appelaient ses superstitions et ses erreurs grossières.
Tous les témoignages concordent sur ce point: dans un pays catholique, où une importante partie des pouvoirs, des terres, des richesses était aux mains de l'Église, où tous les actes de la vie privée et publique étaient contrôlés et sanctionnés par l'Église, le peuple était soit indifférent, soit hostile à la religion catholique, et une nouvelle Église y était installée, favorisée, tolérée par tous, faisant déjà partie intégrante de la vie du pays, gagnant du terrain sans guerre civile, sans désordres spectaculaires; et cette Église avait pour but avoué la destruction de l'Église établie. Celle-ci, seule visée, seule menacée par ce puissant mouvement à la fois populaire et mystique, perdait peu à peu tout contact avec la vie profonde du pays et se cantonnait toujours davantage dans son rôle de caste sociale, préoccupée avant tout par la défense de ses intérêts.
À la veille des événements qui ont amené sur le Languedoc la catastrophe qui allait lui coûter son indépendance, l'Église ne représentait ni la justice, ni l'ordre, ni la paix, ni la charité, ni Dieu; elle représentait la papauté. La situation véritablement tragique où elle se trouvait placée allait l'amener à la plus effrayante confusion de valeurs et lui faire subordonner toute idée de morale à la défense de ses intérêts temporels.
Les historiens catholiques (aussi bien ceux du XIIIe siècle que ceux du XXe) ont tous insisté sur le fait que l'hérésie représentait un grave danger pour les pays qu'elle avait "infectés". Ce qui est parfaitement vrai et confirmé par les événements: ce danger n'était autre que la croisade elle-même. Ce danger était la menace d'une réaction violente de l'Église contre le péril qu'elle courait; car il ne faut pas oublier que, malgré ses nombreux abus de pouvoir, l'Église faisait partie intégrante de la société, qu'elle en était un des rouages principaux, de mauvaise qualité peut-être mais pratiquement irremplaçable. Même en confisquant ses richesses, princes et consuls se servaient d'elle et ne songeaient nullement à la supprimer; et, en même temps le sentiment populaire, alimenté par la foi cathare, la minait, la harcelait, la privait de plus en plus de sa raison d'être. Il serait faux de dire que l'esprit de tyrannie, d'intolérance, de sectarisme était uniquement du côté des catholiques: deux partis en lutte ouverte se contaminent mutuellement et progressivement. Les parfaits certains d'entre eux - n'en étaient qu'aux violences verbales; mais ils étaient déjà assez influents pour attirer à eux des fanatiques.
Peut-on imaginer, pour un instant, quelque pape animé de sentiments évangéliques qui eût, par une bulle, destitué et dépossédé abbés et évêques, les eût forcés à distribuer aux pauvres les biens de l'Église, à vivre d'aumônes et à prêcher sur les routes? À part ce remède radical qui eût entraîné les plus terribles désordres s'il avait pu être appliqué, par quel moyen pouvait-on réformer une Église dont le mal intérieur venait de sa puissance temporelle? La force des cathares venait en partie de leur relative pauvreté et leur irresponsabilité à l'égard des affaires publiques; et l'Église catholique était un administrateur, parfois dur et intéressé, mais expérimenté, contraint de faire face à des difficultés pratiques dont ses adversaires ne soupçonnaient même pas l'existence.
Le plus grand reproche que l'on puisse faire aux cathares est celui qu'à juste titre on a fait à leurs ennemis: celui d'intolérance religieuse. Ils n'ont pas traduit leurs adversaires en justice ni allumé de bûchers (ils n'en avaient ni les moyens ni le désir), mais ils ont dénigré et tourné en dérision une foi qui méritait en elle-même leur respect, et souvent sans discernement et de façon abusive. Sans doute, la faute en incombe-t-elle à la mauvaise conduite des prélats et des prêtres, à la dureté de l'administration ecclésiastique, au tempérament fougueux des gens du Midi; même aux temps du paganisme, les Pères de l'Église blâmaient parfois ceux qui insultaient le culte païen et profanaient les images des dieux.
Les cathares formaient, dans le Languedoc, une Église semi-officielle, une société qui n'était plus ni secrète ni clandestine, et comptait parmi ses adeptes de hauts barons et des gens du peuple. Leur Église n'était pas la seule Église hérétique de ce pays. En voulant renseigner ses lecteurs sur le Languedoc avant la croisade, Pierre des Vaux de Cernay reconnaît que certains des hérétiques du Midi, les vaudois, étaient "mauvais, mais beaucoup moins mauvais que les autres" et que "sur beaucoup de points, ils croient comme nous35". Les vaudois, moins nombreux que les cathares, gagnaient en général la faveur du petit peuple (bien qu'une des sœurs du comte de Foix ait été vaudoise). Leur prédication - ainsi que l'indique le témoignage cité ci-dessus - tendait à séduire des personnes révoltées par les abus de l'Église, mais restées fidèles au catholicisme. Elle était beaucoup moins révolutionnaire que celle des cathares, quant au dogme, mais professait une égale aversion de l'Église, de son organisation et de ses rites.
La secte des vaudois était d'origine récente: son fondateur, Pierre Valdo, commença sa prédication vers 1160, à Lyon; c'est pourquoi leur mouvement fut souvent désigné sous le nom de "Pauvres de Lyon" ou "Léonistes". Pierre Valdo, riche marchand de Lyon, était un homme pieux qui, désirant mieux connaître les saintes Écritures, en fit faire une traduction par un de ses amis, Étienne d'Anse; puis, Étienne étant mort dans un accident, Pierre Valdo en fut si bouleversé qu'il décida de se consacrer au service de Dieu: il vendit ses biens pour donner le produit de la vente aux pauvres, et ne vécut plus que pour la charité et pour la prédication; d'autres personnes l'imitèrent et une société pieuse se fonda ainsi, groupant des laies dont le but était de pratiquer la pauvreté absolue à l'exemple des apôtres et de prêcher la parole de Dieu au peuple.
Valdo eut de nombreux disciples qu'il envoya prêcher dans les bourgs et les villages des environs de Lyon, sur les places pupliques et jusque dans les églises. L'archevêque de Lyon, Jean de Bellesmains, s'inquiéta des progrès de ce mouvement populaire; c'était, en effet, un scandale que de voir de simples laïcs, peu instruits, idiotae et illiterati, et n'ayant reçu le mandat d'aucune autorité ecclésiastique, prendre sur eux de commenter à leur guise les saintes Écritures. À cette époque, le mouvement avait déjà gagné beaucoup d'adeptes. Lorsque, en 1180, l'archevêque interdit à Pierre Valdo et à ses disciples de prêcher, ceux-ci répondirent qu'il vaut mieux obéir à Dieu qu'aux hommes et rappelèrent l'exemple de saint Pierre devant le sanhédrin. Ils continuèrent à prêcher et en appelèrent au pape, Lucius III, qui confirma la condamnation prononcée par Jean de Bellesmains. Trois ans plus tard, les Pauvre de Lyon sont déjà mentionnés comme hérétiques à côté des cathares, dans la constitution Ad Abolendam promulguée par ce pape à Vérone36.
De catholiques réfractaires aux autorités, les disciples de Pierre Valdo se trouvaient donc mués en hérétiques, et, de ce fait, leur "hérésie" ne fit que croître: peu à peu ils passèrent à la révolte ouverte contre les institutions de l'Église, puis contre son principe même. "Les hérétiques, écrit Bernard de Fontcaude dans son traité contre les vaudois, sont ceux qui adhèrent à une ancienne hérésie ou en fabriquent une nouvelle. Tels sont ceux qui déclarent qu'on ne doit obéissance ni aux prêtres ni à l'Église romaine quod dictu horribile est! mais uniquement à Dieu". La position des vaudois est ici clairement définie: ce sont des hommes qui ont fabriqué une hérésie nouvelle (contrairement aux cathares, assimilés aux manichéens) et leur hérésie consiste à ne pas obéir à l'Église romaine, mais uniquement à Dieu.
Les vaudois condamnaient l'Église en se basant sur ce principe que, les chefs de l'Église, étant corrompus, ne pouvaient être les véhicules de la grâce; rejetant le principe du sacerdoce, ils rejetaient également les autres sacrements, y compris le baptême et l'eucharistie. Ils en vinrent à nier tout le culte catholique, en même temps qu'une grande partie des dogmes: pas plus qu'à la présence réelle du Christ dans le sacrifice de la messe, ils ne croyaient à la communion des saints, ni au purgatoire; on ne devait prier que Jésus, seul Médiateur à l'exclusion des saints, et il ne fallait pas prier pour les morts, l'homme étant, dès l'instant où il quitte la terre, soit sauvé, soit damné. (Or, le culte des saints et les prières pour les morts tenaient au moyen âge une place immense, difficilement imaginable aujourd'hui37). Les vaudois se refusaient donc à célébrer les fêtes religieuses; toutefois, ils observaient les dimanches, les fêtes de la Vierge, celles des apôtres et des évangélistes.
Leur religion était donc une religion chrétienne, en partie orthodoxe, mais très simplifiée. Tout comme les catholiques, ils croyaient à l'inspiration divine de l'Ancien Testament; ils croyaient aux dogmes de la Trinité, de l'Incarnation, à la réalité de la Passion et de la Résurrection du Christ, à l'enfer, au jugement dernier; bref, à tous les articles du Credo qu'ils acceptaient suivant l'interprétation traditionnelle de l'Église (bien qu'ils ne récitassent pas le Credo, comme ils ne récitaient aucune prière adoptée par l'Église, à l'exception du Pater). Ils déclaraient que l'Église catholique était tombée dans l'hérésie par la faute du pape Sylvestre qui aurait été le fondateur de l'Église romaine, et que tout ce que l'Église avait promulgué et établi depuis le IVe siècle était faux et sans valeur.
L'hérésie des vaudois, malgré leur négation de certains dogmes fondamentaux tel celui de l'eucharistie, consiste ainsi presque uniquement dans le rejet absolu de l'Église romaine. Ce sont des réformateurs trop zélés plutôt que des hérétiques, ils ne semblent pas avoir inventé de doctrines nouvelles; bien qu'ils aient eu leurs professions de foi, leurs prières et leur littérature apologétique, leur pensée n'était ni aussi cohérente ni aussi constructive que celle des cathares. Leur succès fut grand surtout auprès des classes laborieuses qu'ils séduisaient par leur prédication de la pauvreté, leur amour du travail, et leur piété qui paraissait à bien des catholiques plus authentiquement chrétienne que celle de certains prêtres. Bien qu'ils fussent, depuis 1184, officiellement catalogués comme hérétiques, ils s'attiraient, même au début du XIIIe siècle, les sympathies de personnes catholiques qui voyaient en eux les "pauvres de Dieu", leur faisaient volontiers l'aumône et les laissaient chanter dans les églises38. Cependant, les papes dénonçaient les vaudois comme des hérétiques dangereux, aussi détestables que les cathares.
Le fait est que, dans le Languedoc du moins, ces deux mouvements hérétiques qui se ressemblaient si peu et s'affrontaient à l'occasion dans d'ardentes polémiques furent souvent si bien confondus qu'il est difficile de déterminer à quels hérétiques les autorités avaient affaire, dans telle ou telle localité (du moins en ce qui concerne les simples croyants). Cette confusion venait de ce que 1°les deux hérésies étant également hostiles à l'Église, celle-ci les mettait sur le même plan; 2°les vaudois, dont l'origine était récente, ont eu tendance à calquer leur organisation et leurs mœurs sur celles des cathares.
Tout comme ces derniers, les vaudois avaient leurs parfaits et leurs croyants; les parfaits étaient élevés à cette dignité par une cérémonie également appelée consolamentum, et qui consistait en l'imposition des mains, et était suivie de l'abandon des biens à la communauté, du vœu de pauvreté et de chasteté; sans avoir leurs évêques, les communautés de vaudois étaient dirigées par des supérieurs, des diacres et des prêtres, et leur organisation rappelait celle des ordres religieux. Elles avaient leurs maisons, qui ressemblaient à des couvents, où les parfaits vaudois pratiquaient le jeûne et s'adonnaient à l'étude et à la prière; leurs abstinences n'étaient pas aussi rigoureuses que celles des cathares ni fondées sur des bases dogmatiques; cependant, tout comme les cathares, les vaudois passaient pour de grands ascètes.
Ils consacraient leur vie à la prédication et surtout à l'interprétation des Écritures, qu'ils mettaient à la portée du peuple en faisant circuler un grand nombre de Bibles traduites en langue vulgaire. Bien qu'on eût reproché à certains d'entre eux leur ignorance, ils étaient avides d'instruire le peuple, et tout comme les cathares ils avaient leurs écoles, où ils expliquaient aux enfants les Évangiles et les Épîtres39.
Les parfaites vaudoises prêchaient également, le droit à la prédication étant reconnu à tout chrétien, en cela les vaudois étaient plus révolutionnaires que les cathares; chez ces derniers, en effet, les femmes semblent n'avoir exercé que très rarement l'office de la prédication.
Comme chez les cathares, leur principale et presque unique oraison était le Pater, qu'ils récitaient un certain nombre de fois (parfois trente à quarante fois), plusieurs fois par jour; à la différence des cathares, pour lesquels la confession n'était pratiquée que sous forme d'absolution publique des péchés par l'assemblée de l'Église, les vaudois pouvaient se confesser à un de leurs frères, et être absous.
Comme les cathares, enfin, les vaudois étaient très sévères pour l'Église romaine (qu'ils appelaient Babylone) et ne manquaient aucune occasion de flétrir ses "superstitions" et ses abus. En cela, du moins, ils faisaient cause commune avec les hérétiques, dont on les distinguait cependant dans le pays en leur donnant le sobriquet d'ensabatés (ensabatatz). Et il est fort probable que dans le Languedoc, où les cathares dominaient (les vaudois étaient surtout nombreux dans les Alpes et en Lombardie), les communautés vaudoises avaient fini par se laisser pénétrer par les idées et les coutumes des communautés cathares.
Dans le peuple des campagnes et parmi les artisans, il y eut sans doute beaucoup de vaudois; il y en avait moins dans les classes dirigeantes: à titre d'exemple, sur la liste des deux cent vingt-deux personnalités hérétiques dressée à Béziers en 1209, une dizaine de noms seulement sont accompagnés de la mention val (valdenses). Et si leurs adversaires eux-mêmes reconnaissent qu'ils étaient "beaucoup moins mauvais" que les autres, il ne semble pas que, lors des persécutions, une différence ait jamais été faite entre les cathares et les vaudois. L'Église cathare, la plus forte et la plus organisée, avait fini par couvrir de son ombre la petite Église vaudoise du Languedoc, et la guerre allait cimenter leur union dans le martyre commun.
À l'époque de la croisade, il semble bien qu'une grande partie de la population du Languedoc ait été hérétique ou du moins ouvertement sympathisante à l'hérésie. Encore n'est-ce pas sûr: elle n'était peut-être que tolérante; il n'était pas nécessaire d'être un adepte de la religion cathare pour se battre contre les croisés, ils suffisait d'être un honnête homme. Cette guerre de religion ne fut pas une guerre civile.
Notre dessein n'est pas de discuter de la valeur en soi de la religion cathare, mais uniquement de présenter une situation concrète: les faits, tel que nous les connaissons, montrent les progrès d'une religion jeune, forte de sa position de mouvement semi-clandestin, habile à s'implanter dans une société dont elle peut librement dénoncer les tares, n'y étant pas associée, face à une religion établie, sûre de ses privilèges, corrompue et discréditée par les compromis auxquels la défense de ses intérêts l'a depuis trop longtemps habituée.
L'Église de Rome ne pouvait pas plus s'empêcher de frapper l'hérésie aussi durement qu'elle l'a fait, qu'un homme dont les vêtements sont en flammes ne peut s'empêcher d'éteindre le feu par tous les moyens à sa portée. Il est vrai que même dans ce cas-là tous les moyens ne sont pas légitimes. Mais nous allons voir que l'Église, devenue au cours des siècles et sous la pression des circonstances une puissance totalitaire, donc oppressive, avait déjà tendance à ne considérer comme légitime que ce qui servait ses intérêts temporels.
15 Le schisme qui entraîna en 1054 la séparation définitive de l'Église de Byzance de celle de Rome ne fut que la constatation d'un état de fait: malgré l'identité des dogmes, les deux Églises, politiquement et historiquement séparées, n'avaient plus aucune raison de dépendre l'une de l'autre. Pour l'Occident, Rome était à présent le seul juge en matière de vérité religieuse; ce qui équivaut à dire qu'elle détenait le monopole de la vérité.
16 Interrogatio Johannis ou Cène secrète, document publié dans la Coll. Doat, vol. XXXVI, fos 27 et suiv. et Liber de duobus principiis (Un traité manichéen du XIIIe siècle, "Liber de duobus principiis", publ. par le P. Dondaine, Instituto Storico Dominicano, S. Sabina, Roraa, 1939).
17 Pierre des Vaux de Cernay, ch. IV.
18 Prêtre bulgare du xe siècle, auteur d'un Traité contre les Bogomiles (édité par le P. Joseph Gafort, Theologia antibogomilistica cosmae presbiteri. Rome, 1942).
19 Douais, Les Albigeois, p. 10.
20 Bibl. de Toulouse, ras. 609, f° 239.
21 Innocent III, Épître, t. VII, p. 79.
22 Guillaume de Puylaurens. Prologue.
23 Cependant, un des prédicateurs cathares les plus renommés en Languedoc à l'époque de la croisade était Guillaume, qui fut doyen du chapitre de Nevers (connu sous le nom de Théodoric).
24 V. infra, appendice III.
25 Guillaume de Puylaurens, ch. VIII.
26 "Chanson de la Croisade", CXLV, 3292-3293.
27 Doat, t. XXIV, pp. 59-60.
28 Bernard Gui, Practica Inquisitionis, p. 130.
29 Bibl. de Toulouse, ms. 609. Doat, T. XXII, p. 15.
30 Dom Bouquet, "Chronicon" de Rodolphe, abbé de Coggeshall, t. XVIII, p. 59.
31 Dom Vaissette, "Histoire du Languedoc", éd. Molinier, t. VI, p. 227.
32 Pierre des Vaux de Cernay, ch. 4.
33 Bibl. de Toulouse, ms. 609, f° 130.
34 Pierre des Vaux de Cernay, ch. 46.
35 Pierre des Vaux de Cernay, ch. II.
36 Mansi Concil, t. XXII, col. 477.
37 Il ne faut pas oublier que l'administration des sacrements (baptême, mariage, extrême-onction) et surtout les messes pour les morts, constituaient une des grandes sources des revenus de l'Église.
38 Douais, t. II, p. 109.
39 Bernard Gui, Practica Inquisitionis, t. I, p. 63.
CHAPITRE III
L'ÉGLISE DEVANT L'HÉRÉSIE
I - AVANT INNOCENT III
Il ne faut pas s'étonner si la réaction de l'Église catholique en face de la religion cathare a été celle d'une intolérance absolue et sans compromis. Le christianisme romain ne détenait pas le monopole de l'intolérance. Une religion forte, devenue religion d'État, opprime en toute bonne foi parce que toute contradiction lui paraît un sacrilège et une offense à Dieu. Une Église ne peut pas plus se débarrasser de ses fanatiques qu'un homme ne peut s'amputer lui-même d'un bras ou d'une jambe. Sans le fanatisme, peu de religions eussent réussi à survivre, du moins en Occident.
Saint François d'Assise a été l'ami de saint Dominique et saint Dominique l'ami de Simon de Montfort. Ce qui était enjeu - la vie même de l'Église - justifiait le fanatisme, et il faut se garder de prendre trop à la légère les sentiments qui ont poussé à la violence.
Dans le Midi de la France, l'Église cathare n'était un danger ni pour la moralité publique, ni pour la vie sociale, ni pour les autorités civiles; elle était un danger pour l'Église catholique. Nous avons pu voir qu'au XIIe siècle l'Église était un véritable État dans l'État, une puissance organisée, souvent despotique, et contre laquelle les rois eux-mêmes menaient une lutte incessante, plus ou moins ouverte, et rarement couronnée de succès. Elle n'en était pas moins une partie organique de la société médiévale. Mais la décadence progressive de l'Église dans les pays de langue d'oc au cours du XIIe siècle, liée au développement du catharisme, avait fini par créer un état de choses jusqu'alors impensable et inadmissible aux yeux de tout catholique sincère: au cœur même de la chrétienté, un pays de vieille tradition chrétienne, prospère, relativement puissant, centre de grand commerce, foyer d'une civilisation universellement admirée, était en train de devenir un pays qui non seulement pouvait se passer de l'Église catholique, mais semblait ouvertement rejeter son autorité au profit d'une religion nouvelle.
Or, ce qui était menacé par cette nouvelle religion, ce n'étaient pas seulement les intérêts matériels de l'Église, sa hiérarchie, ses privilèges, mais aussi sa vie spirituelle, péniblement conquise, mûrie au long des siècles, consacrée par les prières de milliers de saints connus et inconnus; une vie mystique tout entière basée sur le sacrifice quotidien de la messe, sur la présence permanente et réelle du Christ dans son Église. Elle avait assimilé et transfiguré les civilisations anciennes, elle avait protégé les pauvres et construit les cathédrales, créé les écoles, inventé ou redécouvert les sciences, produit des œuvres d'art d'une splendeur incomparable, mis Dieu à la portée des plus humbles et parfois abaissé les forts. Sa tradition reposait sur des bases qu'on ne pouvait plus ébranler sans mettre en péril tout l'édifice de la civilisation médiévale, et la croix et l'hostie n'étaient pas de simples accessoires, mais le cœur même de la foi chrétienne.
Une Église nouvelle qui niait non seulement les traditions les plus sacrées, mais jusqu'aux dogmes essentiels de l'Église catholique, ne pouvait en rester au stade d'une co-existence paisible, à une époque où l'homme n'admettait pas que la vérité pût avoir deux faces. Tolérer l'hérésie, c'était admettre implicitement que l'hostie n'est pas le vrai corps de Jésus, que les saints de l'Église ont été des menteurs et que les croix des églises et des cimetières ne sont guère mieux que des perchoirs à corbeaux. Il est des choses que l'on n'a pas le droit de tolérer: on n'appellerait pas tolérant un homme qui laisserait publiquement insulter sa mère.
L'indignation de l'Église catholique était donc légitime; d'autant plus légitime que ses adversaires étaient des hommes nourris de sa tradition, élevés sur un sol chrétien; qu'ils se servaient, pour l'attaquer, d'armes qu'elle avait elle-même mises à leur portée: qui d'autre que l'Église avait inspiré aux convertis hérétiques ces exigences de pureté et de charité chrétiennes au nom desquelles ils la condamnaient? L'Église de Rome, toute "Église du Diable" qu'elle fût, avait seule rendu possible l'expansion de la foi cathare; ses adversaires l'attaquaient au nom du Christ que depuis des siècles elle avait su faire aimer.
L'emploi de la force n'était pas scandaleux en soi: il faisait partie des compromis inévitables que toute Église établie est amenée à faire avec les pouvoirs temporels; il y avait dans tous les pays chrétiens une justice d'Église qui punissait les délits commis par les clercs, les délits de mœurs et aussi les crimes de sorcellerie et de commerce avec le diable.
Encore l'Église n'assimilait-elle pas a priori l'hérétique au sorcier, et se montrait parfois plus compréhensive que les pouvoirs publics. Ainsi saint Bernard, parlant des hérétiques massacrés à Cologne, écrit au pape: "Le peuple de Cologne a dépassé la mesure. Si nous approuvons son zèle nous n'approuvons nullement ce qu'il a fait, car la foi est œuvre de persuasion, on ne l'impose pas40". Au XIe siècle Wazon, évêque de Liège, proteste contre les cruautés commises par les Français qui, dans leur haine farouche de l'hérésie, s'étaient mis à massacrer toutes les personnes ayant le teint pâle: la réputation d'ascétisme des parfaits était aussi ancienne qu'universellement répandue.
L'Église d'avant l'Inquisition n'était pas plus intolérante que la société laïque; sans doute peut-on l'accuser d'avoir créé elle-même cet esprit d'intolérance dont elle réprouvait parfois les excès; cependant il serait vain de prétendre séparer la conscience de l'Église de celle des peuples chrétiens. Le catholicisme était autre chose qu'une administration internationale représentée par une armée de fonctionnaires soumis à l'archevêque de Rome.
L'Église disposait de pouvoirs trop grands pour ne pas céder à la tentation d'en abuser; mais le plus souvent elle se contentait de maintenir l'ordre public dans les domaines qui étaient de sa compétence, d'une façon plus ou moins brutale suivant les cas. Il n'est pas plus immoral de brûler un homme pour sorcellerie que d'en pendre un autre pour vol d'un jambon. Si l'Église assumait des fonctions de justice pénale, c'est qu'une grande partie des fonctions administratives était entre ses mains; elle n'avait pas eu à usurper ces fonctions: elle les avait assumées à une époque où personne d'autre n'était capable de s'en charger.
Les personnes qui professaient des opinions religieuses manifestement contraires aux enseignements de l'Église, et qui refusaient de renoncer à leurs erreurs, étaient donc passibles de la mort par le feu, de par les lois en vigueur. Mais l'arme véritable de l'Église dans la lutte contre les hérésies était, en principe, la persuasion. Une persuasion qui prenait le plus souvent le caractère de l'intimidation pure et simple: l'hérétique supposé risquait l'excommunication, avec toutes ses conséquences: retranché de l'Église l'excommunié était pratiquement mis au ban de la société. Dans un pays comme la France du Nord, où peuple et clergé étaient également fanatiques, le siège apostolique devait plutôt songer à freiner le zèle de ses évêques qu'à envoyer des missionnaires. Dans le Midi de la France, foyer notoire d'hérésie, les papes organisent des campagnes de prédication, et tentent de réformer les mœurs de l'Église.
Ces dernières tentatives n'ont guère de résultats, si l'on s'en remet au témoignage d'Innocent III sur le clergé occitan. La prédication n'a guère plus de succès.
Saint Bernard lui-même s'était pourtant fait l'apôtre de la foi catholique et était venu prêcher dans le Midi en 1145, en compagnie du légat Albéric, évêque d'Ostie, et de Geoffroy, évêque de Chartres. Son témoignage est formel: l'hérésie triomphe. "Les basiliques sont sans fidèles, les fidèles sans prêtres, les prêtres sans honneur. Il n'y a plus que des chrétiens sans Christ. Les sacrements sont vilipendés, les fêtes ne sont plus solennisées. Les hommes meurent dans leur péché. On prive les enfants de la vie du Christ en leur refusant la grâce du baptême41". Ceci se passait soixante ans avant la croisade. Même en supposant que saint Bernard, dans sa pieuse consternation, ait exagéré l'étendue du désastre, ce qu'il dit prouve assez la décadence de l'Église dans les régions qu'il a visitées.
Dans la cathédrale d'Albi, le jour de son arrivée, saint Bernard prêche devant trente personnes. Il est vrai que le troisième jour l'immense église est déjà trop petite pour contenir la foule des auditeurs enthousiasmés par la prédication du saint; mais cet enthousiasme n'était sans doute qu'un feu de paille, et la prédication de saint Bernard resta sans effet.
La croisade de prédication envoyée par le pape Alexandre III en 1179 (malgré l'abjuration forcée et la spectaculaire condamnation de Pierre Mauran, dit "saint Jean l'Évangéliste") eut encore moins de succès: quelques hérétiques impressionnés se soumirent en apparence, mais après le départ des légats, le peuple, ému par cette intrusion brutale d'une puissance étrangère dans les affaires du pays, manifesta plus ouvertement son respect pour l'hérésie. L'année suivante le pape commence à songer à faire appel au bras séculier: au concile œcuménique de Latran (1179) il déclare: "Bien que l'Église, comme le dit saint Léon, se contente d'un jugement sacerdotal et n'emploie pas les exécutions sanglantes, elle doit pourtant recourir aux lois séculières et demander l'aide des princes, afin que la crainte d'un supplice temporel oblige les hommes à employer le remède spirituel. Donc, comme les hérétiques, que les uns nomment cathares, les autres patarins et les autres publicains, ont fait de grands progrès dans la Gascogne, l'Albigeois, le pays de Toulouse et ailleurs, qu'ils y enseignent publiquement leurs erreurs et tâchent de pervertir les simples, nous les déclarons anathèmes, avec leurs protecteurs et recéleurs42..."
Ceci est déjà un aveu d'impuissance: le pape constate que l'Église ne peut plus lutter contre l'hérésie par ses propres moyens. Dans le Midi de la France comme dans le Nord de l'Italie, Rome ordonne aux pouvoir tant ecclésiastiques que séculiers de mener une véritable campagne de répression policière contre les hérétiques. Le pape Lucius III, à la suite du concile de Vérone, enjoint aux évêques de faire visiter leurs diocèses pour rechercher les hérétiques, et prescrit aux seigneurs et aux consuls d'aider les évêques dans cette tâche sous peine d'excommunication et d'interdit. Le légat du pape, Henri, abbé de Clairvaux (plus tard évêque d'Albono), ne se contente pas d'organiser des conciles pour réformer les mœurs du clergé, il dépose l'archevêque de Narbonne, et parvient même à réunir un certain nombre de chevaliers catholiques du pays, qui viennent mettre le siège devant Lavaur, un des principaux foyers de l'hérésie en Languedoc (1181).
La tactique des grands féodaux du Languedoc à l'égard de Rome ne varie guère: elle consiste à promettre et à ne pas tenir les promesses. C'était, de leur part, la seule attitude possible. Si Raymond V, poussé par des considérations d'ordre politique, tentait encore de prendre ouvertement le parti de l'Église, son fils, constatant l'importance de l'élément hérétique dans le pays, fera son possible pour vivre en paix entre les deux religions rivales.
Raymond VI succède à son père en 1194. Quatre ans plus tard, Lothario Conti, cardinal-diacre, âgé de trente-huit ans seulement, mais issu de la haute noblesse romaine, et aussi populaire dans sa ville qu'estimé des milieux ecclésiastiques de Rome, est élu pape sous le nom d'Innocent III. L'admiration qu'inspirent ses capacités et son caractère est telle que malgré son âge, malgré l'éloignement des affaires où l'avait tenu son prédécesseur Célestin III (de la famille des Orsini, ennemie traditionnelle des Conti), malgré le fait qu'il n'a même pas encore été ordonné prêtre, la décision des cardinaux est presque unanime et le lendemain même de la mort de Célestin III le jeune cardinal-diacre se voit promu au rang de chef de la chrétienté.
Il assumera ce rôle avec une sincérité implacable: pendant les dix-huit ans de son pontificat il se conduira en véritable remplaçant de Dieu sur la terre dictant sa volonté aux rois et aux peuples sans égard pour les intérêts particuliers, sans hésitations devant les difficultés pratiques auxquelles ses ordres pouvaient se heurter. Homme d'action et théoricien, il pose comme postulat la suprématie absolue de l'Église, et se voit appelé à diriger les rois pour les forcer à servir les intérêts de Dieu.
Si Innocent III a su soumettre Philippe Auguste et Jean sans Terre, obtenir l'hommage direct du roi d'Aragon, lancer la chevalerie allemande contre les païens du Nord et la chevalerie franque contre les Sarrasins (croisade qui aboutira malgré lui à la prise de Constantinople, ce dont il profitera pour essayer d'étendre son empire sur l'Église grecque), s'il réussit à imposer partout ses légats comme des ministres chargés de diriger la politiques des princes, il est bien évident qu'il ne pouvait, encore moins que ses prédécesseurs, tolérer le scandale qu'était un pays où l'Église était publiquement bafouée par le peuple et les pouvoirs publics.
Cependant, Innocent III, le principal responsable de la croisade contre l'hérésie, n'était pas un fanatique. Ses lettres pastorales nous le montrent circonspect, soucieux d'agir avec justice et modération. Devant les cas d'hérésie que lui signalent l'évêque d'Auxerre ou l'archevêque de Sens, il doute, hésite, demande des preuves, des enquêtes et finit, dans l'incertitude, par conclure à l'innocence des accusés.
Quand il envoie ses légats en Languedoc, Innocent III, cherchant à s'attaquer aux causes plutôt qu'aux effets du désastre, commence par s'en prendre aux évêques du pays et aux pouvoirs publics. Il estime que c'est le mauvais exemple donné par le clergé qui autorise "l'insolence des hérétiques". Mais ce pape qui se flatte de réduire à merci les rois est mal obéi par ses propres subordonnés: l'autorité de l'Église est une arme à double tranchant. Il est vrai, Guillaume de Roquessels, évêque de Béziers, Nicolas, évêque de Viviers; Raymond de Rabastens, évêque de Toulouse; Bérenger, archevêque de Narbonne, sont déclarés suspendus de leurs fonctions par les légats. Mesure révolutionnaire et nullement propre à attirer au pape la sympathie du haut clergé; l'archevêque de Narbonne et l'évêque de Béziers refuseront d'obéir, allégueront l'incompétence des légats, feront traîner leurs procès en longueur; Bérenger ne sera déposé qu'en pleine croisade et Guillaume de Roquessels mourra assassiné, en 1205, avant la fin de l'instruction de son procès. Raymond de Rabastens, qui avait de si scandaleuse façon ruiné le domaine épiscopal de Toulouse, résistera pendant des mois. Mais la tentative de réforme engagée par le pape commence à prendre l'aspect d'une lutte entre deux clans rivaux: le clergé local et les ordres réguliers plus directement soumis au pape, en particulier les moines cisterciens. Ce sont eux qui, jusqu'au bout, mèneront le jeu.
Le pape n'a plus à compter sur l'appui des évêques, il doit donner carte blanche aux légats et les laisser agir selon leurs possibilités. Si auprès des prélats les légats se heurtent à une mauvaise volonté plus ou moins déguisée, auprès des pouvoirs publics les envoyés du pape ne rencontrent qu'hostilité et dérobades.
Seigneurs et consuls protestent de leur fidélité à l'Église et refusent de poursuivre les hérétiques. Le comte de Toulouse, déjà excommunié par Célestin III pour avoir persécuté des moines, a fait sa paix avec l'Église et, pardonné par le nouveau pape, continue à protéger les cathares, à dépouiller les abbayes et à transformer les couvents en forteresses. Le légat Pierre de Castelnau obtient de nouveau des engagements, des promesses formelles, aussi peu tenues que les précédentes. Un modus vivendi s'était établi dans le pays entre l'Église et l'hérésie, et les chefs cathares, théoriquement passibles des peines les plus sévères, ne craignaient pas de paraître en public à côté des évêques et d'entamer avec eux des controverses théologiques.
C'est sur la campagne de prédication que vont porter les efforts d'Innocent III au cours des premières dix années de son pontificat, surtout entre 1203 et 1208. Avec son assurance d'homme certain de posséder la vérité, il espère fermement ramener les égarés en dissipant l'ignorance où les avait tenus l'incapacité de leurs chefs spirituels. Tout comme ses prédécesseurs, Grégoire VII et Alexandre III, il cherchera à convertir ceux des présumés hérétiques qui lui paraissent s'écarter moins de l'orthodoxie que les autres. Ainsi, en 1201, donne-t-il aux Humiliés, précurseurs de saint François d'Assise, injustement accusés d'hérésie, des règles où l'on voit l'influence des pratiques vaudoises. En 1208, il prend sous sa protection Durand de Huesca, vaudois converti auquel il permet de fonder un ordre qui rappelle, pas son organisation, les communautés hérétiques; et ces "pauvres catholiques" dont le clergé continuera à se méfier seront encouragés par le pape, qui verra dans leur mouvement le germe d'une réforme profonde de l'Église par la prédication laïque ou semi-laïque.
Mais avec les hérétiques déclarés, cette politique conciliante n'était pas de mise. Le pape peut encore admettre que l'on condamne l'Église militante, non le dogme. Il est d'ailleurs presque aussi sévère envers les vaudois qu'envers les cathares.
Il envoie donc des prédicateurs. Ce sont, en premier lieu, les légats eux-mêmes. Ce sont des hommes à la foi éprouvée, moines cisterciens, membres de l'ordre réformé par saint Bernard; cet ordre représentait, dans l'Église, le parti de l'austérité, de la réforme des mœurs et de la discipline, le parti de l'intransigeance, la force agissante de l'Église. Les légats agissent, comme nous l'avons vu, mais ils cherchent aussi à convaincre: dans ce pays qui échappe à l'Église, les ministres plénipotentiaires du pape sont réduits au rôle de prédicateurs, et de prédicateurs mal écoutés.
Ils procèdent d'abord par la menace, mais depuis longtemps les menaces n'agissent plus. Ils se lancent alors dans la bagarre et, forcés de reconnaître ainsi le droit à l'existence de leurs adversaires honnis, les convient à des conférences pour discuter avec eux d'égaux à égaux.
Nous avons déjà évoqué la figure de Pierre de Castelnau, archidiacre de Maguelonne, moine à l'abbaye cistercienne de Fontfroide. Il avait pour compagnon Frère Raoul, de Fontfroide également. Enfin, pour donner plus d'autorité à leur mission, le pape leur a adjoint pour chef et compagnon l'abbé de Cîteaux lui-même, général de l'ordre et, de ce fait, une des premières personnalités de l'Église. Arnaud-Amaury, cousin des vicomtes de Narbonne, d'abord abbé de Grandselve, un des grands monastères cisterciens du Languedoc, était un homme du pays, et d'autant plus zélé à combattre l'hérésie qu'il la connaissait de près.
Comment un ordre raffermi par saint Bernard dans les pures traditions de l'austérité, de l'obéissance et de la prière a-t-il pu se choisir pour chef ce batailleur né, cet homme des mesures extrêmes, ce passionné aussi éloigné de la charité chrétienne qu'on peut l'être? S'il n'avait pas les vertus évangéliques capables de ramener à l'Église les brebis égarées, du moins sut-il organiser une grande campagne de prédication. Mais quel que fût leur zèle apostolique, que pouvaient ces moines déjà d'avance suspects au peuple, là où saint Bernard lui-même avait échoué?
Les légats mettent donc en jeu leur autorité personnelle. Les débats qu'ils organisent ont un succès considérable; pour exciter encore davantage l'intérêt des auditeurs, ils décident de faire choisir dans chaque ville où ils vont prêcher un jury composé d'arbitres chargé de décider de la valeur des arguments des deux partis. De détenteurs officiels de la vérité absolue, ils descendent au rang des modestes prédicateurs, obligés de convaincre et de prouver par des raisonnements l'excellence de leur doctrine. Le jury, composé moitié de catholiques, moitié d'hérétiques, a (en principe) le droit de leur donner tort et de donner la palme à leurs adversaires. Ils prétendent triompher par la seule vérité de l'orthodoxie.
En 1204, Pierre de Castelnau et Frère Raoul tiennent une de ces grandes conférences publiques à Carcassonne, en présence du très catholique Pierre II d'Aragon. Treize catholiques et treize cathares sont pris pour arbitres. Bernard de Simorre, évêque cathare de Carcassonne, prêche ouvertement et expose la doctrine de son Église. Si la présence du roi semble avoir fait pencher la balance en faveur des légats, il n'y eut pas de conversions. Ni Pierre de Castelnau ni Arnaud-Amaury ne devaient se faire beaucoup d'illusions: leur propagande attirait une foule de curieux, les gens du Midi étant grands amateurs de joutes oratoires, mais leurs discours ne parvenaient à convaincre que les catholiques; pour les hérétiques, ils restaient lettre morte.
Ces conférences n'exaspéraient même pas les passions populaires: il ne semble pas qu'elles aient donné prétexte à des bagarres entre partisans des deux religions. Les catholiques de ce pays-là manquaient décidément d'esprit combatif. Bien plus: les missionnaires du pape, entourés d'une brillante escorte, avec leurs superbes montures, leurs riches attelages portant leurs bagages et leurs provisions, faisaient un fâcheux contraste avec l'austère simplicité des ministres cathares. "Voyez, disait-on, les ministres à cheval d'un Dieu qui n'allait qu'à pied, les missionnaires riches d'un Dieu pauvre, les envoyés comblés d'honneurs d'un Dieu humble et méprisé43".
Cette mission d'avance condamnée à l'échec allait recevoir un secours inattendu en la personne de religieux espagnols qui, brûlant d'un zèle apostolique, revenaient de Rome, où le pape venait de leur refuser la permission de se rendre en Russie méridionale pour évangéliser les païens coumans. Sans doute, Innocent III pensait-il que ces aspirants missionnaires seraient mieux employés dans le Languedoc. En août 1205, les légats rencontrent à Montpellier l'évêque d'Osma, don Diego de Acebes, accompagné du sous-prieur de son chapitre, Dominique de Guzman. Le vieil évêque et son encore jeune compagnon (Dominique avait 35 ans à l'époque) offrent aux légats leur concours dans la lutte contre l'hérésie. Ils font mieux, ils leur donnent des conseils pratiques. Le conseil venait peut-être un peu tard, mais il était excellent en soi: les missionnaires espagnols conseillent aux légats et à leurs envoyés de descendre de cheval, de renoncer à leur escorte, de ne plus se faire recevoir et loger avec les honneurs dus à leur rang, mais d'aller à pied, de vivre d'aumônes, de ne garder comme signe de leur dignité que leur habit de moine, comme provisions de route que leur livre d'Heures et les ouvrages indispensables à la controverse.
Ceux qui avaient déjà vu l'abbé de Cîteaux entouré des honneurs dus à un prince de l'Église ont pu être étonnés de le voir changer de costume et l'accuser, non sans raison, d'être un "loup déguisé en agneau", car les missionnaires cathares n'avaient attendu les conseils de personne pour pratiquer la pauvreté. De la part du légat et des douze abbés qu'il avait ramenés en 1207 après réunion du chapitre de l'ordre, une telle attitude n'était réellement qu'un habile moyen de propagande: on verra plus tard qu'Arnaud-Amaury n'avait pas le moindre penchant pour l'humilité ni la pauvreté. Il n'en était pas de même pour les religieux espagnols.
Canonisé treize ans après sa mort, Dominique de Guzman jouissait déjà de son vivant d'une réputation de sainteté. Les renseignements que nous possédons sur sa vie nous ont été transmis par des disciples enthousiastes, donc enclins à exagérer les mérites de leur héros; mais il est certain que, dès sa jeunesse, Dominique avait dû impressionner ses frères et ses supérieurs par l'ardeur de sa foi et la vigueur de son intelligence. Avec son futur évêque, Diego de Acebes, il prend une part active à la réforme de l'office canonial dans son diocèse; en 1201, il est nommé prieur et chef du chapitre.
Nous avons vu qu'il rêvait de convertir à Dieu les âmes des païens, et que, seul, l'ordre formel du pape l'avait détourné de cette entreprise pour faire de lui le missionnaire des hérétiques. Certes, l'Église ne manquait pas de prédicateurs ardents, mais l'action de Dominique fut la seule à conduire à des résultats pratiques. Comme le dit Guillaume de Puylaurens: "Il a fallu que l'hérésie se manifestât dans notre temps et dans notre pays, afin d'y faire naître l'ordre vénéré des dominicains, qui a porté des fruits si abondants et si utiles, moins encore chez nous que dans l'univers entier44".
II - SAINT DOMINIQUE, SON APOSTOLAT ET SON ÉCHEC
Ce grand mouvement de réforme religieuse, auquel les événements devaient donner un caractère sinistre en l'associant à l'Inquisition, prit naissance sur les routes pierreuses du Languedoc, où deux hommes marchant pieds nus dans la poussière, sous un brûlant soleil d'été, allèrent un jour mendier le droit d'être écoutés en même temps que leur pain quotidien.
L'évêque d'Osma, âgé et fatigué, devait, un an après, rentrer en Espagne pour y mourir. Il accompagna pourtant Dominique dans la plupart de ses voyages et prit part aux conférences contradictoires de Servian, de Béziers, de Carcassonne, de Verfeil, de Montréal, de Fanjeaux, de Pamiers. Entre ces conférences publiques auxquelles étaient invités les chefs de l'Église cathare, Dominique parcourt inlassablement le pays, visite villages, bourgs et châteaux, donnant l'exemple d'une vie plus austère que celle des parfaits.
Il n'est pas toujours bien reçu, loin de là. "Les adversaires de la vérité, dit Jourdain de Saxe, se moquaient de lui, lui jetaient de la boue et de vilaines choses et lui attachaient de la paille derrière le dos". De tels traitements n'ont pas de quoi troubler une âme aussi ardente que celle de Dominique. Le même Jourdain rapporte la réponse que le saint fit à des hérétiques qui lui avaient demandé: "Que ferais-tu si nous nous saisissions de toi? - Je vous supplierais, répondit-il, de ne pas me mettre à mort du coup, mais de m'arracher les membres un à un, pour prolonger mon martyre; je voudrais n'être plus qu'un tronc sans membres, avoir les yeux arrachés, rouler dans mon sang, afin de conquérir une plus belle couronne de martyre45!"
La démesure tout espagnole de ce discours a dû décourager ses adversaires, qui, s'ils persistaient à voir en Dominique un envoyé du diable, pouvaient se rendre compte qu'ils n'avaient aucun pouvoir sur ce forcené. Il traversait en chantant les villages où hommes et femmes le poursuivaient de menaces et de quolibets; fatigué, il s'endormait sur le bord du chemin.
Mais même ses apologistes les plus fervents parlent davantage de ses miracles (peu convaincants) que du nombre des conversions qu'il a obtenues.
L'énumération des conférences contradictoires est en elle-même assez édifiante: saint Dominique et l'évêque d'Osma prêchèrent à Montpellier - sans succès. Ils prêchèrent à Servian, où les ministres cathares Baudoin et Thierry, voyant leur attitude humble et leurs pieds ensanglantés, consentirent à discuter avec eux; après huit jours de débats, les deux missionnaires catholiques se retirent sans avoir obtenu d'autre résultat que des marques de respect des catholiques locaux. À Béziers, les deux Espagnols prêchent, avec les légats, pendant quinze jours et discutent avec les parfaits sans obtenir d'autre résultat que la conversion de quelques croyants.
À Carcassonne, ils prêchent pendant huit jours sans rien obtenir. À Montréal, ils rencontrent Guilhabert de Castres, le plus grand prédicateur cathare de l'époque, fils majeur de l'évêque cathare de Toulouse, ainsi que les diacres Benoît de Termes et Pons Jordan et un grand nombre de parfaits. Le cathare Arnaud Hot soutint publiquement (selon Guillaume de Puylaurens) que "...l'Église romaine, défendue par l'évêque d'Osma, n'était ni sainte ni épouse du Christ; mais épouse du diable et doctrine des démons. C'était la Babylone que Jean appelait, dans l'Apocalypse, la mère des fornications et des abominations, ivre du sang des saints et des martyrs de Jésus-Christ. Son ordination n'était ni sainte, ni bonne, ni établie par le Seigneur Jésus-Christ. Jamais le Christ ni ses apôtres n'avaient ordonné ni posé la règle de la messe telle qu'elle est aujourd'hui". L'évêque d'Osma offre de prouver le contraire en s'appuyant sur le Nouveau Testament.
("Ô douleur! s'exclame l'historien, chez des chrétiens les statuts de l'Église et de la foi catholique étaient tombés dans un tel avilissement que des juges laïques avaient à se prononcer sur de pareils blasphèmes46!" Constatation pertinente s'il en fut. Mais les juges qui devaient se prononcer sur ce débat se trouvèrent d'avis si contraires qu'ils se séparèrent sans avoir rien décidé).
À Verfeil, qui avait déjà mal accueilli saint Bernard, les envoyés du pape discutent avec les cathares Pons Jordan et Arnaud Arifat, les deux parties semblent avoir du mal à se comprendre, soit pour des raisons de difficultés linguistiques (certains cathares ne parlent pas le latin), soit par suite du manque de clarté dans les discours des orateurs: l'évêque d'Osma se retire, indigné, s'imaginant que les hérétiques se représentent Dieu comme un homme assis dans le ciel et dont les jambes sont si longues qu'elles occupent la distance entre le ciel et la terre! "Que Dieu vous maudisse, dit-il, grossiers hérétiques en qui je croyais vainement trouver quelque finesse d'intelligence47".
La dernière conférence eut lieu à Pamiers, sous le haut patronage du comte de Foix qui prête pour les débats son château du Castela. L'évêque d'Osma et Dominique y sont secondés par Foulques, le nouvel évêque de Toulouse et Navarre, nouvel évêque de Couserans. Les vaudois sont aussi nombreux à Pamiers que les cathares, les deux sectes délèguent leurs orateurs; la sœur du comte, Esclarmonde, parfaite elle-même et grande protectrice des hérétiques, prend part aux débats. Ici, la mission catholique a plus de succès qu'ailleurs, puisque le vaudois Durand de Huesca fait pénitence avec un certain nombre de ses amis. Mais, en général, le succès est plus que médiocre.
La mission se disloque. L'évêque d'Osma retourne en Espagne, le légat Raoul part également, Arnaud-Amaury est rappelé en France par les affaires de son ordre, Pierre de Castelnau (d'ailleurs très impopulaire dans le pays) est trop occupé par ses démêlés avec les féodaux pour se consacrer à la prédication. Dominique seul poursuit inlassablement sa tâche, prêchant sur les routes et dans les villages, été comme hiver, ne vivant que de pain et d'eau, dormant sur la terre nue, émerveillant le peuple par son endurance et par l'autorité enflammée de ses discours.
Quand on songe qu'il a commencé sa prédication en 1205 et qu'en juin 1209 l'armée croisée envahissait le pays, on peut regretter que cet authentique apôtre de l'Église ait disposé d'aussi peu de temps pour mener à bien une œuvre qui eût pu donner des résultats durables. Et pourtant - un Dominicain du temps de saint Louis, Étienne de Salagnac, attribue au fondateur de son ordre des paroles cruelles qui semblent montrer que la patience chrétienne n'était pas du nombre des vertus de saint Dominique: "Depuis plusieurs années, aurait-il dit à la foule réunie à Prouille, je vous ai fait entendre des paroles de paix. J'ai prêché, j'ai supplié, j'ai pleuré. Mais, comme on dit vulgairement en Espagne: Là où ne vaut la bénédiction vaudra le bâton. Voici que nous exciterons contre vous les princes et les prélats; et ceux-ci, hélas! convoqueront nations et peuples, et un grand nombre périra par le glaive. Les tours seront détruites, les murailles renversées, et vous serez réduits en servitude. C'est ainsi que prévaudra la force, là où la douceur a échoué". Or, que sont "plusieurs années" dans une œuvre d'évangélisation? Saint Dominique semble abandonner la tâche avant de l'avoir commencée.
Ce n'est pas de tels missionnaires que l'Église catholique avait besoin. Elle avait trop à se faire pardonner pour se permettre de menacer, si elle voulait reconquérir les cœurs des fidèles. Une parole comme celle que nous venons de citer risquait d'aliéner à jamais à saint Dominique la confiance de ceux que l'exemple de sa charité ou de son courage avait pu convertir. Les ministres cathares ne menaçaient pas de faire périr par le glaive ceux qui résistaient à leur prédication.
Étant donné ce que nous savons de la forte personnalité de saint Dominique, de son énergie, de sa foi, de son abnégation totale à son œuvre, nous pourrions être, à priori, étonnés du petit nombre de conversions qu'il réussit à obtenir, et ceci dans un pays chrétien, où les vérités qu'il prêchait devaient tout de même être proches du cœur de ses auditeurs. Si bref qu'ait été son apostolat, il semble que son influence personnelle eût pu lui attirer un grand nombre de prosélytes, et on cite à peine quelques noms: les jeunes recluses de Fanjeaux, Pons Roger; quelques femmes et enfants dont on ne sait rien. Il eût sans doute mieux réussi auprès des Coumans.
Mais ce fait paradoxal s'explique par la situation équivoque où il se trouvait: représentant d'une Église toujours prête à brandir le "bâton", il ne pouvait que décourager la confiance, et il fallait un courage presque surhumain pour se convertir librement à une religion qui prétendait s'imposer par la contrainte: au moment même où saint Dominique s'exposait avec allégresse aux railleries et aux injures de ses adversaires, le pape continuait à écrire au roi de France pour l'engager à l'action armée contre l'hérésie, les légats usaient de tous leurs moyens de pression sur le comte pour le décider à persécuter les hérétiques, et l'Église, tout en acceptant les débats théologiques avec les ministres cathares, ne renonçait pas à une législation qui, si elle eût été mise en vigueur, eût envoyé ces mêmes ministres au bûcher et ruiné et exilé leurs fidèles. Dans ces conditions-là, la prédication la plus sincère, la plus ardente ne pouvait qu'apparaître comme une odieuse hypocrisie.
L'Église était obligée de lutter, mais les forces en présence n'étaient pas égales: sainte, catholique et apostolique, forte de sa tradition séculaire de sagesse et d'autorité, l'Église romaine, dans le Midi de la France, commençait à prendre l'aspect d'une force policière et de plus étrangère, que l'on méprise, dont on se moque, que l'on espère tromper par une soumission simulée, bref, elle était devenue quelque chose de si pauvre qu'il y avait bien là de quoi faire verser des larmes de sang à tous ses fidèles. Ses efforts pour regagner le terrain perdu allaient la faire descendre plus bas encore, par suite de quel enchaînement implacable d'erreurs, de compromis, d'ambitions personnelles, de fidélités mal comprises, d'involontaires ou conscients abus de pouvoir? Le mal était si ancien qu'il serait cruel d'en faire peser la responsabilité sur Innocent III ou sur ses ministres trop zélés.
Si un saint comme Dominique a pu souffrir du scandale qu'était à ses yeux l'hérésie au point d'oublier que le bâton n'est pas une arme digne du Christ, comment s'étonner que des hommes moins forts se soient crus autorisés à défendre leur Église par les armes? Et si l'état des choses était tel que même un saint ne pouvait que jouer le rôle ingrat d'un policier déguisé, comment s'étonner de la légitime résistance des peuples du Midi à la prédication catholique?
Saint Dominique réussit cependant à faire au moins un converti de marque: ce Pons Roger, de Tréville en Lauraguais, auquel il impose les pénitences suivantes: pendant trois dimanches le pénitent marchera le dos nu, suivit d'un prêtre qui le frappera de verges, depuis l'entrée de son village jusqu'à l'église; il portera l'habit religieux, avec deux petites croix cousues des deux côtés de la poitrine; toute sa vie, sauf à Pâques, à la Pentecôte et à Noël, il ne mangera ni chair, ni œufs, ni fromage; trois jours par semaine il s'abstiendra aussi de poisson, d'huile et de vin. Il observera trois carêmes par an, il entendra la messe tous les jours, il gardera une chasteté perpétuelle; une fois par mois il devra montrer sa lettre de pénitence, au curé de Tréville. En cas de désobéissance, il sera excommunié comme hérétique et parjure48.
À part ce cas de conversion authentique - le seul dont le souvenir ait été conservé - le résultat de l'œuvre de saint Dominique, en ces années qui précèdent la croisade, se réduit à la fondation du monastère de Prouille; cette fondation sera la préfiguration et le point de départ de l'ordre des Frères prêcheurs, qui prendra presque aussitôt une telle place dans la vie de l'Église.
Un soir de l'année 1206, saint Dominique était entré dans l'église de Fanjeaux pour y prier, après une prédication en plein air. Là, plusieurs jeunes filles vinrent tomber à ses pieds, lui déclarant qu'elles avaient été élevées par des parfaites dans la foi hérétique, et que les discours du saint homme les avaient fait douter de la vérité de leur religion. "Priez le Seigneur, dirent-elles, pour qu'il nous révèle la foi dans laquelle nous vivrons, nous mourrons et nous serons sauvées. - Soyez courageuses, répondit le saint, le Seigneur Dieu, qui ne veut la perte de personne, va vous montrer le maître que vous avez servi jusqu'à maintenant". L'une d'elles raconta plus tard qu'aussitôt le démon leur est apparu sous la forme d'un chat hideux49.
Que cette étrange vision soit due au pouvoir de suggestion de saint Dominique ou à l'exaltation des jeunes filles, il est difficile de prendre très au sérieux une conversion de ce genre. Peut-être la prédication du saint inspirait-elle plus de haine et d'horreur pour l'hérésie que d'amour pour les vérités de l'Église? En tout cas, les jeunes converties craignent que leur foi nouvelle ne faiblisse, et saint Dominique décide de créer pour elles un lieu de refuge où elles puissent vivre à l'abri des tentations.
Le couvent ne tarde pas à recevoir des dons: en 1207 l'archevêque de Narbonne accorde à la nouvelle fondation l'église de Saint-Martin de Limoux. Plus tard, les succès de la croisade enrichiront ce couvent des dépouilles des seigneurs hérétiques.
Nous aurons à revenir sur l'activité de saint Dominique pendant la croisade, et sur la fondation de l'ordre des Frères prêcheurs. Laissons-le dans ce Languedoc "infecté" par l'hérésie, où il poursuit sa mission d'autant plus difficile qu'il a pour adversaires des prédicateurs aussi ascétiques, aussi intrépides, aussi fermes dans leur foi qu'il l'est lui-même, et de plus connus et vénérés dans tout le pays. Il est à croire que les parfaits devaient, à son exemple, présenter sa foi et sa charité comme une tactique hypocrite, inspirée par le démon. Mais les campagnes d'évangélisation, si elles ne convertissaient guère d'hérétiques, servaient au moins à exciter le zèle d'une partie de la population catholique.
À Toulouse, depuis 1206, un homme prodigieusement actif et ardent était en train d'organiser, dans la ville même et les terres environnantes, un véritable mouvement de résistance catholique contre l'hérésie.
Foulques de Marseille, évêque de Toulouse, élu à la place du peu recommandable Raymond de Rabastens, aura, quatre-vingts ans après sa mort, le privilège glorieux de figurer dans le paradis de Dante sous l'aspect d'une âme pleine de liesse dont l'éclat, fulgurant comme celui du rire, frappe la vue tel un rubis exposé en plein soleil. Ce bienheureux est situé par le poète dans le ciel de Vénus, car il brûla d'amour plus que jamais ne fit Didon... "aussi longtemps que cela convint à la couleur de ses cheveux50". Ce bourgeois de Marseille, né à Gênes, riche commerçant devenu troubadour par vocation, avait joui, comme poète, d'un renom considérable et avait chanté dans ses vers les grandes dames qu'il avait aimées. Parvenu à l'âge des cheveux gris il oublia l'ardeur de ses passions pour une piété plus ardente encore et en 1195 fit profession à l'abbaye du Thoronet; dix ans après il est désigné pour l'épiscopat de Toulouse. Son zèle et son énergie sont connus de tous; de plus, Provençal, il n'a pas d'attaches dans le pays toulousain et ne sera pas enclin aux complaisances ni aux compromis; enfin, c'est un homme qui connaît le monde, un beau parleur, un écrivain réputé qui continue à enflammer son public par ses sirventès et ses chansons pieuses comme autrefois il le charmait par ses poèmes d'amour.
Arrivé en 1206 dans un évêché ruiné et pour ainsi dire inexistant, Foulques parviendra non seulement à payer les dettes, à rétablir l'ordre dans les affaires (il n'était pas pour rien issu d'une famille de marchands), il réussira à s'acquérir, dans sa ville, une réelle popularité personnelle, du moins parmi les catholiques. L'historien Guillaume de Puylaurens, qui fut notaire à l'évêché de Toulouse dès 1241, et fut de 1242 à 1247 chapelain des comtes de Toulouse, parle de l'évêque, mort depuis quarante ans au moins à l'époque où il rédige sa chronique, avec une vénération admirative: Foulques avait dû laisser un bon souvenir dans les milieux ecclésiastiques du Toulousain. (Il n'est que juste de rappeler cela, car ceux à qui il laissait un mauvais souvenir devaient être légion).
En fait, l'inquiétante figure de l'évêque-troubadour qui, parvenu à l'âge de quatre-vingts ans, mourra en écrivant un cantique sur la venue de l'aurore céleste, inspire plus d'étonnement que de respect. Nous le verrons agir avec une énergie qui est plutôt celle d'un chef de parti extrémiste que celle d'un évêque. Guillaume de Puylaurens le loue d'apporter aux citoyens de Toulouse "non une mauvaise paix mais une bonne guerre". Son éloquence de tribun incitait à une action réelle et concrète, et c'est à Foulques que revient le douteux honneur d'avoir été un des seuls à réussir dans la tentative de soulever les populations catholiques contre leurs frères hérétiques. Encore ne s'agit-il là que d'un assez petit nombre de militants fanatisés, et pour le peuple Foulques restera, comme le diront un jour les bourgeois de la Bessède, "l'évêque des diables".
À part les légats et leurs missionnaires, à part les évêques de nouveau style et récemment intronisés, tels que Foulques de Marseille et Navarre, évêque de Couserans, à part les évêques du Comminges, de Cahors, d'Albi, de Béziers et plusieurs autres dont la fidélité à l'Église ne faisait pas de doute, mais dont les efforts dans la lutte contre l'hérésie restaient tout platoniques, sur quel appui l'Église pouvait-elle compter dans les provinces occitanes?
Une partie de la noblesse devait être catholique: le légat Pierre de Castelnau avait réussi à former une ligue de barons destinée à combattre l'hérésie; il faut croire pourtant que ces barons n'agissaient ainsi que pour déplaire au comte de Toulouse, car on ne les verra pas prendre la croix. Les croisés du Midi venaient surtout de Provence, terre peu touchée par l'hérésie, ou du Quercy et d'Auvergne. Les évêques de Cahors et d'Agen réussiront à grouper quelques corps armés de pèlerins qui participeront à la croisade. Mais il semble que dans toute la région comprise entre Montpellier, les Pyrénées, jusqu'au Comminges au Sud et Agen au Nord, l'Église n'ait eu que des partisans isolés, et en tout cas peu actifs, plus conscients de leur solidarité envers leurs concitoyens hérétiques que de leurs obligations envers l'Église - du moins quand ces obligations allaient jusqu'à expulser et persécuter les hérétiques. D'ailleurs, ces derniers étaient assez forts pour se défendre. Le comte, l'eût-il voulu, ne possédait pas le pouvoir de provoquer une guerre civile.
L'Église, malgré la vigueur combative de ses éléments sains, malgré le fanatisme de certains de ses chefs, malgré les efforts de persuasion et d'intimidation tentés par le pape et malgré la puissance administrative et financière qu'elle possédait encore dans le pays, se voyait incapable de freiner les progrès de la religion nouvelle qui commençait à paralyser toute volonté de résistance chez la population restée catholique. Le pape et les légats ne voyaient plus d'autre moyen de lutter que la force armée. C'est à ce moment que le meurtre de Pierre de Castelnau donna le signal de la levée de boucliers. L'Église abandonnait sa tâche à la force du glaive.
40 Ép. CCCLXV.
41 Ép. CCXLI, Migne, P.L., t. 182, col. 434.
42 Cf. l'appendice IV.
43 B. Jordanis de Saxonia, Opéra, Fribourg, 1891.
44 Guillaume de Puylaurens, ch. X.
45 Jourdain de Saxe, Op. cit., p. 549.
46 Guillaume de Puylaurens, ch. IX.
47 Guillaume de Puylaurens, ch. VIII.
48 Balme et Lelaidier. Cartulaire de saint Dominique, t. I, pp. 186-188.
49 Humbert de Romans, L'Enquête de Toulouse pour la canonisation de saint Dominique, ch. XIII.
50 Dante, Paradis, chant IX.
CHAPITRE IV
LA CAMPAGNE DE 1209
En juin 1209 Raymond VI est flagellé à Saint-Gilles et fait sa réconciliation solennelle avec l'Église. L'armée des pèlerins-guerriers qui se sont levés à l'appel du pape a terminé ses préparatifs, se rassemble à Lyon et le départ est fixé pour la Saint-Jean (24 juin). Ayant perdu tout espoir d'éviter la guerre le comte joue sa dernière carte: il prend lui-même la croix.
La guerre, déclarée en fait au lendemain de la mort de Pierre de Castelnau, va entrer dans sa phase active: l'armée croisée est prête au combat et ne peut plus tarder à se mettre en marche. Les croisés prennent la croix pour quarante jours de campagne effective, les chefs de l'armée n'ont donc pas de temps à perdre.
Leurs adversaires, au cours de l'hiver 1208-1209, semblent ne pas trop croire à la réalité du danger et n'ont pas organisé de système de défense; bien au contraire, ils s'entendent mal entre eux, hésitent jusqu'au dernier moment sur l'attitude à prendre, espèrent toujours désarmer le pape et ses représentants par des promesses de soumission. Selon la "Chanson de la Croisade"51, le comte de Toulouse aurait vainement supplié son neveu, le vicomte de Béziers, "de ne pas lui faire la guerre, de ne pas lui mouvoir querelle, et que tous deux soient à la défense", et le vicomte aurait répondu "non par oui, mais par non"; les deux barons se seraient séparés en mauvais termes, fait qui n'a rien d'étonnant si l'on songe que les maisons de Béziers et de Toulouse étaient en état de désaccord et de rivalité permanente depuis des générations.
Les historiens qui n'ont pas manqué de déplorer cette absence d'union entre les dirigeants du pays devant le danger semblent oublier combien la situation de ces hommes était équivoque et difficile: en juin 1209, ils ne pouvaient prévoir la tournure que prendraient les événements; ils étaient attaqués, non par une puissance étrangère, mais par des soldats de Dieu; la guerre leur était déclarée par le chef de leur propre Église, leurs adversaires avaient des alliés puissants et nombreux sur leur territoire même. D'autre part, les rois d'Occident, leurs suzerains directs ou indirects, s'en tenaient à une attitude de neutralité plutôt énigmatique, et, s'ils ne faisaient rien pour seconder la croisade, ils ne semblaient pas non plus s'y opposer.
Il faut donc penser que l'attitude des barons méridionaux était le résultat d'une sorte de prudence élémentaire: bouger le moins possible, plier sous l'orage, afin de s'en tirer avec le minimum de dégâts. Le comte de Toulouse, qui semble avoir le mieux compris le danger que présentait une lutte ouverte contre l'Église, passe dans le camp de ses propres ennemis, et met ainsi ses domaines - foyer notoire d'hérésie - sous la protection de la loi qui déclare intangibles les biens des croisés. Les plus puissants de ses vassaux ne vont pas aussi loin dans la voie de la soumission et se préparent à la résistance. Ils s'y préparent en fait assez mal, non par manque de courage ni de moyens, sans doute, mais parce qu'une guerre déclarée à l'hérésie était encore quelque chose de trop imprécis, de trop incertain pour qu'il fût possible de compter sur la loyauté absolue de leurs vassaux, lesquels n'avaient déjà que trop tendance à désobéir et à se révolter au moindre prétexte.
L'armée croisée entra donc dans un pays qui ne voulait pas la guerre, n'y était pas préparé, et espérait jusqu'au dernier moment l'éviter en retirant à l'adversaire tout prétexte de se battre.
I - LA GUERRE MÉDIÉVALE
Mais les croisés étaient bien décidés à se battre.
Or, qu'était la guerre à cette époque qui ignorait les bombardements, les canons, et le service militaire obligatoire? Avant d'entreprendre de décrire ce que fut cette guerre-là, il faut essayer de nous faire une idée de ce qu'étaient les dangers qu'une guerre faisait courir à un pays, à son armée, à son peuple, à son économie et à l'ensemble de sa vie sociale. Si nos aïeux ne possédaient pas les moyens techniques de destruction dont nous disposons, ce serait leur faire injure que de croire que la guerre était moins cruelle à cette époque-là qu'elle ne l'est aujourd'hui, et qu'ils ne disposaient pas, pour terroriser leurs adversaires, d'armes plus efficaces encore que les nôtres.
Il est vrai que les batailles en rase campagne étaient infiniment moins meurtrières qu'elles ne le sont de nos jours, même si l'on tient compte de l'infériorité numérique des populations de ce temps-là, comparées à celles de notre époque. Une armée de vingt mille hommes était déjà une très grande armée; celle de la Ire Croisade en Albigeois ne devait sans doute pas compter beaucoup plus de combattants, probablement moins. L'imprécision dont témoignent la plupart des historiens de l'époque quant au nombre des effectifs militaires de telle ou telle armée vient du fait qu'ils évaluent le plus souvent une armée par le nombre des chevaliers; or, un chevalier constituait une unité militaire fort variable, et pouvait avoir avec lui aussi bien trente hommes que quatre. Chaque chevalier est accompagné d'une petite équipe de combattants à cheval et à pied, qui sont souvent ses parents ou ses amis, et en tout cas des vassaux d'une fidélité éprouvée. Écuyers ou sergents, ces hommes agissent dans la bataille de concert avec leur chef, et si la notion de discipline militaire est assez faible au XIIIe siècle, celle de la camaraderie de combat entre le chevalier et ses compagnons garde encore, surtout chez la noblesse du Nord, une valeur presque mystique; et bien des hommes totalement indifférents à la cause qu'ils défendent accompliront des prodiges de bravoure pour soutenir la réputation du seigneur dont ils sont les hommes-liges. La chevalerie est donc le corps d'élite de toute armée, dont la puissance est, de ce fait, évaluée autant par le nombre que par la qualité de ses chevaliers.
La guerre médiévale est une guerre ostensiblement aristocratique: le combattant qui compte est le chevalier, personnage qui est bien forcé de payer de sa personne, mais est, à cause de cela même, moins exposé au danger que les autres; son armure le protège si bien que flèches et même coups de lance et d'épée peuvent pleuvoir sur lui sans le blesser: ainsi le chroniqueur-poète Ambroise décrit-il le roi Richard revenant d'une bataille si couvert de flèches qu'il ressemble à un hérisson. Or, si légères que fussent ces flèches, une seule pouvait tuer un homme non pourvu d'une cotte de mailles, et la cotte de mailles était une pièce chère, relativement rare, réservée l'élite des combattants. Le haubert du chevalier recouvrait tout le corps, la cotte de l'écuyer n'arrivait pas au genou, le simple sergent d'armes portait une broigne, tunique faite de plaques de cuir, solide, bien entendu, mais qui ne résistait pas au tranchant de l'épée. Le valet de pied ne pouvait porter qu'un écu long de 1,5 m; l'équipement défensif du fantassin était assez sommaire. Peu meurtriers pour les chevaliers et même pour leurs hommes à cheval, les combats le sont pour le gros de l'armée, pour le combattant anonyme, le valet, le sergent, dont les cadavres recouvrent les champs de bataille et les alentours des villes assiégées.
À côtés des unités régulières, bataillons ou petites compagnies dont les chevaliers ont personnellement la charge, l'armée médiévale compte les troupes auxiliaires sur lesquelles repose le côté technique de la guerre; ce sont, tout d'abord, des professionnels, spécialisés dans les divers métiers militaires, archers, arbalétriers, sapeurs, mineurs, préposés aux machines, dont les plus qualifiés font leur métier aussi honnêtement que n'importe quel autre, servant ceux qui les paient avec une fidélité exemplaire.
Plus bas dans la hiérarchie militaire, mais élément de première importance dans la conduite des opérations, aussi bien dans les batailles rangées qu'au cours des sièges, les routiers (compagnies de mercenaires qui forment le gros des piétons de l'armée) sont l'arme la plus terrible dont puissent disposer les chefs militaires de l'époque, l'arme reconnue comme inhumaine, mise hors la loi et pratiquement employée par tout le monde. Si pour la chevalerie la guerre est avant tout une occasion de se couvrir de gloire ou de défendre des causes plus ou moins nobles, pour le peuple la guerre est la terreur du routier. Il est impossible de parler de la guerre au moyen âge sans s'arrêter un instant sur la grande misère et l'horreur sans nom qu'évoque la seule pensée de cet être sans Dieu, sans loi, sans droits, sans pitié et sans peur qu'est le routier. Craint à l'égal d'un chien enragé, il est traité comme tel non seulement par ses adversaires, mais souvent aussi par ceux qui se servent de lui. Son seul nom sert d'explication naturelle à toutes les cruautés, à tous les sacrilèges, il semble être sur terre l'image vivante de l'enfer.
Ces grandes compagnies n'avaient pas encore l'importance qu'elles allaient prendre pendant la guerre de Cent Ans; elles étaient déjà un fléau public, et un des principaux griefs adressés par le pape à Raymond VI portait sur le fait que le comte faisait appel aux routiers pour ses guerres privées. Raymond VI et ses vassaux manquaient de soldats: les routiers formaient une bonne partie des effectifs de leurs armées; les routiers, bandits d'autant plus redoutables qu'ils étaient soldats de profession, exerçaient un chantage perpétuel sur les barons qui les employaient, car s'ils n'étaient pas payés, ils menaçaient de piller les terres de ces mêmes barons. En cas de guerre ils pillaient le pays conquis, disputant le butin à l'armée régulière, et les victoires se terminaient souvent par des bagarres entre la chevalerie et les ribauds. Nous verrons que l'armée croisée, toute armée de Dieu qu'elle était, se servait elle-même de ces troupes de routiers dont on défendait l'emploi au comte de Toulouse.
Les chefs et les contingents les mieux entraînés de ces troupes se composaient en général d'hommes étrangers aux pays où ils faisaient la guerre, et en France les routiers les plus fréquemment employés étaient des Basques, des Aragonais et des Brabançons; mais à une époque où les guerres, les incendies et les famines lançaient sans cesse sur les grand routes des garçons décidés à se procurer leur subsistance par tous les moyens, les compagnies vagabondes recrutaient dans leurs rangs une bonne partie des têtes brûlées, des révoltés, des chercheurs d'aventure des pays par lesquels elles passaient.
Ces bandes d'hommes mal armés, souvent déguenillés, pieds nus, sans ordre, sans discipline, n'obéissant qu'à leurs propres chefs, présentaient, du point de vue militaire, deux avantages immenses: d'abord, ils étaient réputés pour leur mépris absolu de la mort; ces gens qui n'avaient rien à perdre se précipitaient au-devant du danger avec une frénésie que rien, n'arrêtait. Ils formaient des bataillons de choc, d'autant plus faciles à utiliser que personne n'éprouvait de scrupule à les sacrifier. Mais, surtout, ils inspiraient une terreur sans bornes à la population civile: ces hommes qui ne respectaient pas Dieu organisaient des orgies dans les églises et mutilaient des images saintes, et ne se contentaient pas de piller et de violer; ils massacraient et torturaient par pur plaisir, jouaient à rôtir à petit feu les enfants et à couper les hommes en morceaux.
En plus des chevaliers et de leurs milices, en plus des techniciens et des mercenaires de toutes catégories, l'armée comprenait un important personnel de non-combattants. Elle traînait avec elle de grands chargements de bagages: les caisses d'armes et; d'armures, les tentes, les cuisines, les outils nécessaires à l'établissement de fortifications, et à la construction des machines; l'armée avait ses femmes, blanchisseuses, ravaudeuses, filles de joie. De plus, les combattants les plus fortunés emmenaient parfois avec eux leurs épouses et même leurs enfants. Enfin, le passage d'une grande armée attirait une foule de vagabonds, mendiants, curieux, voleurs alléchés par l'appât du pillage, colporteurs, jongleurs, bref, une masse de civils dont l'armée n'avait nul besoin, mais qui espéraient vivre d'elle et en fait devenaient une charge supplémentaire pour le pays envahi.
Telle était à peu près la composition d'une armée en campagne. Pour peu qu'elle fut importante, sa seule présence dans un pays constituait déjà un facteur de désordre, car elle paralysait la circulation sur les routes, semait la panique, et, pour se procurer la nourriture et le fourrage, rançonnait les terres environnantes.
La guerre était en général une guerre de sièges plutôt que de batailles rangées; là, l'artillerie jouait un rôle prépondérant. Les tours et les murailles des villes étaient bombardées à coups de boulets lancés par des pierrières, ou par des trébuchets dont la portée pouvait atteindre quatre cents mètres et qui projetaient des boulets pesant jusqu'à quarante kilos; montés sur des échafaudages de bois ou des tours roulantes, ou chattes, ces engins de tir parvenaient souvent à ébrécher des murailles de plusieurs mètres d'épaisseur, sans parler des dégâts qu'ils causaient dans la ville assiégée quand l'assaillant parvenait à construire des tours de bois assez hautes pour dominer les murailles; sous le couvert des tirs d'artillerie, l'assaillant comblait les fossés; les mineurs creusaient des galeries souterraines et ébranlaient le fondements des tours; l'assaut était généralement donné à l'échelle, et réussissait rarement; la prise d'une place forte nécessitait d'abord la démolition des murailles. Or, cette démolition demandait un travail long et dangereux, et dans cette opération les assiégés avaient en général l'avantage, et parvenaient à incendier les tours roulantes et à décimer par leur tir des adversaires qui, eux, n'étaient pas à l'abri de murailles. En fait, la guerre de sièges était le plus souvent une guerre d'usure.
L'apparition de l'ennemi faisait fuir les gens des campagnes vers les châteaux et les villes fortifiées; villes et châteaux, qui risquaient déjà d'être assiégés, donc privés de leurs moyens normaux de ravitaillement, voyaient leur population augmentée d'un grand nombre de bouches inutiles, sans compter les bêtes. Le siège amenait donc la famine et les épidémies. D'autre part, une armée qui avançait en territoire ennemi ravageait les campagnes, pillait ou brûlait les récoltes, abattait les arbres fruitiers, quand leurs adversaires ne s'en chargeaient pas les premiers dans l'intention d'affamer l'agresseur. Les uns et les autres polluaient l'eau des puits, et les maladies, la disette faisaient plus de victimes que les armes, même dans une armée assiégeante. Il était très rare de voir une armée considérable se maintenir longtemps en territoire ennemi.
Le peuple, qui ne faisait pas la guerre, en souffrait plus que ceux qui la faisaient, par la famine surtout, et aussi par les exploits des routiers. Le Midi, habitué de longue date aux guerres et aux guérillas féodales, était devenu un pays de citadins, la plupart des bourgs et des villages étaient fortifiés et les fermes étaient des dépendances des châteaux; à la moindre alerte, le paysan courait se mettre à l'abri. Nous savons que les comtes de Toulouse, de Foix, les vicomtes de Béziers étaient perpétuellement en état de guerre; ces règlements de comptes entre voisins ne semblaient pas désorganiser profondément la vie du pays, qui s'en accommodait comme d'un mal inévitable. Les routiers dont on faisait de tels griefs au comte de Toulouse ne devaient être ni si nombreux ni si; redoutables, puisque plus tard ce même comte apparaîtra aux populations comme le symbole même de l'ordre et de la paix.
À cause de cela peut-être, la menace d'une croisade n'avait pas troublé outre mesure un peuple qui croyait savoir se défendre. Peut-être les Occitans s'attendaient-ils à une expédition militaire comme ils en avaient vu des dizaines, et envisageaient-ils de se défendre par les moyens ordinaires, ou de se soumettre, le cas échéant, pour la durée d'une guerre qui ne manquerait pas d'être brève.
Mais, au début de juillet 1209, lorsque la nouvelle de l'avance des croisés se répandit dans le pays, lorsque les premiers groupes de fugitifs commencèrent à remonter vers les villes, quand du haut de leurs tours de guet les sentinelles des châteaux dominant la vallée du Rhône purent voir se dérouler sur des kilomètres et des kilomètres le mouvant et interminable ruban composé de milliers d'hommes à cheval et à pied, lorsqu'ils virent le Rhône encombré par les files de barques portant les bagages et les provisions de l'armée, les populations des terres menacées par la croisade furent impressionnées par l'importance de l'armée ennemie, dont la "Chanson de la Croisade" dit qu'on n'en avait jamais vu de pareille dans le pays.
Témoignage de vaincu, sans doute; il devait cependant correspondre à la réalité. Les descriptions du chroniqueur donnent à penser que la vue de la multitude armée qui descendait la vallée du Rhône avait stupéfait les contemporains comme quelque chose de monstrueux. Quelle que pût être l'issue de la guerre, la seule présence d'une telle quantité de soldats étrangers dans le pays prenait déjà des allures de catastrophe nationale.
Cette armée, de loin, paraissait plus redoutable encore qu'elle ne l'était, car, en plus des bandes de gens sans aveu qui accompagnaient toute formation militaire en campagne, l' "ost" croisée était suivie, entourée, encombrée d'une foule de pèlerins civils partis avec l'intention de gagner les indulgences promises à tout homme qui prendrait la croix, et désireux, dans leur sainte simplicité, de participer à une œuvre pie en aidant à exterminer les hérétiques. La tradition du pèlerinage des croisés civils, solidement établie par un siècle d'expéditions en Terre Sainte, lançait vers la terre hérétique ces singuliers "pèlerins" qui partaient, non pour se recueillir devant des reliques vénérées, mais pour contempler des bûchers et prendre part à des massacres. Ces civils, qui n'étaient pas une force combattante, mais plutôt une gêne pour l'armée, pouvaient cependant contribuer à donner aux troupes croisées l'aspect formidable d'un flot d'envahisseurs déferlant sur le pays.
II - BÉZIERS
Conduits par le légat Milon, les croisés avançaient rapidement: partis au début de juillet de Lyon, le 12 ils étaient déjà à Montélimar; à Valence le comte de Toulouse les avait rejoints, la croix sur la poitrine, et avait pris sa place parmi les hauts barons chefs de la croisade. Avant le 20, les croisés s'arrêtent à Montpellier, ville amie, catholique par tradition, et terre du roi d'Aragon; ce sera leur dernière halte avant le commencement des hostilités. Dans le même temps une autre armée croisée, moins importante, pénétrait dans le Languedoc par le Quercy, commandée par l'archevêque de Bordeaux accompagnés des évêques de Limoges, de Bazas, de Cahors et d'Agen, du comte d'Auvergne et du vicomte de Turenne; cette armée prit la ville de Casseneuil où plusieurs hérétiques furent pris et brûlés.
Si Raymond VI n'est plus un ennemi de la foi, les croisés ne se sont pas dérangés pour rien, et les légats ont déjà désigné le premier adversaire à abattre, le premier en titre des "fauteurs d'hérésie" du Languedoc. Les domaines du vicomte de Béziers sont de longue date considérés comme terres hérétiques par excellence, et le jeune vicomte ne possède ni l'audace ni la duplicité de son oncle et suzerain le comte de Toulouse.
En ce mois de juillet 1209 Raymond-Roger Trencavel, vicomte de Béziers et de Carcassonne, se trouvait face à une armée "comme on n'en avait jamais vu", qui comptait dans ses rangs le duc de Bourgogne, le comte de Nevers, une multitude de hauts barons et d'évêques, son propre suzerain le comte de Toulouse, et toute l'autorité de l'Église par-dessus le marché. Son autre suzerain, le roi d'Aragon, ne semblait pas décidé à le soutenir: roi catholique, il ne pouvait s'opposer officiellement à une entreprise conduite par l'Église. Devenu, par la force des circonstances, le champion déclaré de l'hérésie, le vicomte, voyant l'ennemi à ses portes, essaiera d'abord de négocier. Le vicomte se rend à Montpellier pour essayer de plaider sa cause auprès des légats: étant donné son âge, il ne doit pas être tenu responsable des faits qui ont eu lieu pendant sa minorité, lui-même n'a jamais cessé d'être catholique et est bien décidé à se soumettre à l'Église; langage purement conventionnel par lequel le vicomte, comme le faisaient toujours les barons du Midi, tente de couvrir de son nom les peuples des provinces dont il a la charge. Les légats refusent de l'entendre. Condamné à l'insoumission, le vicomte n'a plus qu'à présenter sa défense.
Or, le temps lui est étrangement mesuré: une forte armée, qui avait, en deux semaines, fait le chemin entre Lyon et Montpellier, n'est plus qu'à une quinzaine de lieues de Béziers, la première grande cité des domaines Trencavel; la route est ouverte, le vicomte ne dispose pas de forces qui puissent lui permettre d'arrêter ou même de freiner l'avance des croisés. Il se rend de Montpellier à Béziers, mais ne peut songer à s'y enfermer: cette ville, la première menacée, va être assiégée, et le vicomte, en tant que chef militaire du pays, ne peut courir le risque de se trouver coupé du reste de ses terres. Il promet donc aux consuls biterrois de leur envoyer des renforts, et va préparer lui-même la défense de Carcassonne, sa capitale. Il emmène avec lui quelques hérétiques et les Juifs de la ville.
Les bourgeois de Béziers, restés "marris et dolents" par le départ du vicomte, se préparent en hâte à la défense; ils ne disposent pour cela que de deux ou trois jours, l'armée ennemie est déjà en marche, par la voie romaine qui mène droit de Montpellier à Béziers; la garnison, aidée par la population civile, fait approfondir les fossés qui entourent les murs de la cité. Les murs sont solides, la ville ne manque pas de vivres et peut envisager sans crainte un siège assez long. Du reste, l'immensité même (encore exagérée par l'imagination populaire) de l'armée croisée rassure ses adversaires: une telle multitude de soldats peut être bientôt obligée de lever le siège, faute de ravitaillement.
Le 21 juillet l'armée croisée arrive devant Béziers et dispose ses tentes le long de la rive gauche de l'Orb; le deuxième suzerain de la ville, l'évêque de Béziers, va à son tour tenter de négocier avant le commencement des hostilités. Cet évêque (de nomination récente puisque son prédécesseur Guillaume de Roquessels a été assassiné en 1205), Renaud de Montpeyroux, revient du camp des croisés avec les propositions suivantes: Béziers sera épargnée si les catholiques de la ville consentent à livrer aux légats les hérétiques dont il a lui-même dressé la liste. Cette liste a été conservée; elle donne 222 noms, parmi lesquels, certains portent la mention val (valdensis). Ces 222 personnes (ou familles) sont de toute évidence soit des parfaits soit des chefs laïques de la secte, notables ou riches bourgeois.
L'évêque, qui tient conseil dans la cathédrale, s'adresse, bien entendu, aux catholiques; les hérétiques, à Béziers, sont nombreux et puissants, l'évêque ne croit donc pas qu'il soit possible de les forcer à livrer leurs chefs; il propose aux catholiques de quitter la ville en abandonnant les hérétiques, pour avoir la vie sauve.
Sait-on si ces mots cachent une menace précise, ou si l'évêque voulait parler simplement des dangers auxquels s'expose la population de toute ville qui soutient un long siège et des excès qu'entraîne toute prise d'assaut? Dans tous les cas, les consuls de Béziers rejettent le marché avec indignation et déclarent qu'"ils préfèrent être noyés dans la mer salée" plutôt que de livrer ou d'abandonner leurs concitoyens. Ils disent "que personne n'aura du leur un denier vaillant, pour qu'ils changent leur seigneurie contre une autre"52. Leur réponse est donc un acte de loyalisme envers leur vicomte et les libertés de leur ville. Béziers, qui avait déjà payé cher son amour de l'indépendance, n'entend pas se laisser imposer la volonté de l'envahisseur.
L'attitude des Biterrois montre aux croisés qu'ils n'ont pas à compter sur la population catholique du pays; en toutes circonstances, et envers et contre tous, les cités occitanes feront passer leurs intérêts nationaux avant tous les autres; et dès le premier jour cette guerre religieuse prendra ce caractère de résistance nationale qu'elle gardera jusqu'au bout. Pour ce pays, l'Église, même représentée par ses propres évêques, était déjà une puissance étrangère.
Renaud de Montpeyroux se retire donc, emmenant avec lui quelques catholiques plus zélés ou plus craintifs que les autres; ils ne devaient pas être nombreux, puisqu'on sait que des prêtres sont restés dans la ville.
Sous les ordres de l'abbé de Cîteaux l'armée croisée commence à investir la ville, s'installe sur les sables de l'Orb et procède aux préparatifs de l'assaut. Du sort de Béziers dépend le succès de la croisade, car si les forces des croisés sont immobilisées par un long siège, elles risquent d'épuiser rapidement leurs provisions de vivres et de laisser à Raymond-Roger et à ses amis le temps d'organiser leur défense. Or, cette armée si puissante est un colosse aux pieds d'argile, l'amitié ne règne pas entre ses chefs (le duc de Bourgogne et le comte de Nevers s'entendent fort mal entre eux), les troupes de routiers et de pèlerins risquent de se débander en quête de pillage, et du reste les chevaliers eux-mêmes ne sont là, en principe, que pour quarante jours. Il fallait frapper vite, et devant la ville imposante qu'était Béziers, avec ses fortes murailles, ses fossés, ses portes bien défendues, les hautes tours de sa cathédrale et de ses églises et celles de son château et des grands hôtels de bourgeois, les chefs croisés devaient se demander si le siège entrepris ne serait pas une simple démonstration de force, vouée à un échec plutôt humiliant. Il faut croire qu'ils étaient exaspérés outre mesure par l'attitude des bourgeois qui avaient l'air de se soucier si peu de leurs menaces: l'espoir d'épouvanter l'adversaire par une avance foudroyante semblait perdu, tout comme celui de pouvoir s'appuyer sur les catholiques du Midi.
Le 22 juillet, jour de la fête de sainte Marie-Madeleine, une tranquillité relative semble régner dans les deux camps: les assiégeants ne sont pas encore prêts pour l'assaut; les assiégés, bien à l'abri derrière leurs murailles, contemplent sans trop de frayeur, peut-être même avec quelque ironie, l'immense étalage de tentes, de bivouacs, les masses d'hommes, de chevaux, de chariots qui s'étendent le long de l'Orb et autour des murs de la ville; Béziers, domine de haut la vallée et peut facilement repousser un assaut, et ceux des croisés qui ont disposé leurs campements le plus près des murs de la ville ne paraissent pas bien redoutables: ce sont les troupes de "pèlerins" et les ribauds, qui, dangereux dans le corps à corps, font piètre figure quand on les regarde du haut des remparts. Il faut croire en tout cas que la vue de ces bandes de fantassins, désorganisées et dépenaillées, avait provoqué le mépris plutôt que la peur, autrement on ne pourrait s'expliquer l'étrange événement dont, par la suite, Arnaud-Amaury et les chroniqueurs catholiques devaient parler comme d'une faveur de la Providence divine.
Cette journée, qui devait être décisive pour l'histoire de cette guerre, et qui allait être l'une des plus tragiques de toute la croisade, commençait dans une atmosphère de presque insouciance; assiégeants et assiégés devaient croire les dangers et les travaux réservés aux jours, aux semaines à venir. La garnison organisait les dispositifs de défense; les chefs croisés avec leur chevalerie tenaient un conseil de guerre et se concertaient sur les préparatifs de l'assaut, qui vraisemblablement ne devait avoir lieu que le lendemain ou le surlendemain. Les soldats s'installaient pour déjeuner.
Pendant ce temps, une partie de la garnison - ou même des civils que l'exaltation du danger avait transformés en soldats d'occasion - effectue une sortie de reconnaissance par la porte qui donne sur le vieux pont et qui domine l'Orb dont elle est séparée par une pente escarpée. Guillaume de Tudèle ne peut contenir son indignation en parlant de l'imprudence de ces gens. Il décrit en détail la scène, qu'il doit tenir d'un témoin oculaire. Ce qu'il en dit montre qu'il ne s'agissait pas d'une véritable opération militaire, mais d'une simple parade destinée à narguer l'ennemi et à le tourner en dérision.
"Ô la mauvaise étrenne qu'il fit aux habitants de la ville, celui qui leur donna le conseil de sortir en plein jour! s'écrie le chroniqueur. Car sachez ce que faisait cette gent chétive, cette gent plus ignare et folle que baleine: avec les bannières de grosse toile blanche qu'ils portaient, ils allaient en avant, criant à perdre haleine, et pensant faire aux ennemis un épouvantail, comme on fait aux oiseaux dans un champ d'avoine, en huant, en braillant, en agitant leurs enseignes le matin, dès qu'il faisait clair53!"
Imprudence folle, dit l'auteur, qui vient de parler (pour la rime) d'une armée comparable à celle de Ménélas à qui Pâris enleva Hélène, et où "il n'y avait baron de France qui n'y fit sa quarantaine". L'armée ne comptait certes pas dans ses rangs tous les barons de France, et les bourgeois sortis de la ville n'avaient devant eux que des gens pratiquement désarmés, les autres campant à une certaine distance de la ville. Les deux camps devaient prévoir tout au plus quelques escarmouches inoffensives, des échanges de railleries et de défis, préliminaires fréquents des combats sérieux à une époque où la guerre excitait en chaque combattant le goût de la parade et du spectacle. Toujours est-il que les Biterrois sortis de la ville s'approchent assez près du campement des pèlerins, et qu'un "croisé français" s'étant avancé sur le pont pour répondre à leurs insultes, ils le tuent et le jettent dans l'Orb. Parmi les fantassins, toujours rapides à se mettre en marche, l'agitation grandit, et la parade commence à tourner en bagarre.
C'est alors qu'intervient, selon Guillaume de Tudèle, le roi des ribauds, qui devient ainsi le principal artisan de la victoire; le roi des ribauds est le chef des mercenaires français, personnage non négligeable puisqu'il commande les éléments les plus féroces et les plus intrépides de l'armée. Comprenant les avantages de la situation, il crie le signal de l'attaque, et les routiers se précipitent en avant, bousculant les agresseurs et les forçant à remonter la pente, vers les portes de la ville. "Ils sont, dit la "Chanson", plus de quinze mille, tous sans chaussures, tous en chemises et en braies, armés seulement d'une masse d'armes". Quinze mille est sans doute un chiffre trop fort, mais le détachement des Biterrois est de toute façon le moins nombreux et ne peut se sauver que par la fuite. La foule hurlante et forcenée des routiers escalade la côte en courant et atteint la porte de la ville en même temps que la garnison qui se replie.
Là, que s'est-il passé? Guillaume de Tudèle écrit que les routiers "se mettent en marche tout autour de la ville pour abattre les murs, ils se jettent dans les fossés et se mettent les uns à travailler du pic, les autres à briser, à enfoncer les portes54..." exploit qu'il est difficile d'attribuer à des hommes à demi nus, armés de gourdins. Il est plus vraisemblable de supposer qu'une partie des routiers a pe pénétrer dans la ville en même temps que les bourgeois qui se retiraient et s'est de cette façon emparée d'une des portes, pendant que le gros de l'armée se lançait à son tour à l'assaut avec des instruments de combat mieux appropriés à la situation. La bagarre fut, en effet, assez vive pour attirer l'attention des chefs, qui, comprenant qu'ils n'ont pas de temps à perdre, firent sonner l'appel aux armes. Avant que la garnison ait eu le temps de se ressaisir, elle vit toute l'armée au pied des murs et des bandes de routiers courant dans les rues et semant la terreur dans la ville.
Ainsi débordée, et d'ailleurs peu nombreuse, la garnison, commandée par Bernard de Servian, défend les murs où les croisés ont déjà accroché leurs échelles. Les combats sur les murs et autour des murs ne durent que quelques heures. La ville est pour ainsi dire envahie avant d'être prise, car pendant que les soldats se battent encore sur les remparts une panique folle règne dans les rues, et les routiers y font déjà la loi, rendant inutile la résistance des soldats débordés par un assaillant très supérieur en nombre et exalté par l'aubaine inespérée, "miraculeuse", qu'est cet assaut brusqué.
L'extrême brutalité de l'attaque transforme en quelques instants une ville relativement paisible en une ville perdue. "Les prêtres et clercs vont se vêtir de leurs ornements, font sonner les cloches comme s'ils allaient chanter la messe des morts pour ensevelir les corps des trépassés; mais ils ne peuvent empêcher qu'avant la messe dite les truands n'entrent dans les églises55..." Pour tous, catholiques et hérétiques, les églises sont les derniers refuges. Ceux qui ont eu le temps de quitter leurs maisons, où les routiers ont fait irruption, se précipitent, le long de rues étroites et encombrées, vers les églises de la ville, vers la cathédrale Saint-Nazaire, vers la grande église de la Madeleine et l'église de Saint-Jude, espérant y trouver un abri jusqu'à la fin de l'assaut. Les ribauds "sont déjà entrés dans les maisons, ils prennent celles qu'ils veulent, ils en ont large choix et chacun s'empare librement de ce qui lui plaît. Les ribauds sont ardents au pillage, ils n'ont pas peur de la mort; ils tuent, ils égorgent tout ce qu'ils rencontrent56..."
Les cris de guerre des chevaliers et de la garnison qui résiste encore, les cris des blessés et des mourants, les hurlements de triomphe des ribauds, les hurlements d'horreur de leurs victimes, le glas funèbre de toutes les cloches de la ville, le bruit de ferraille des armes devaient former ensemble une clameur assez effrayante pour ôter tout sang-froid aux vainqueurs comme aux vaincus. Les portes des églises furent forcées, et toutes les personnes qui s'y trouvaient, prises au piège, furent massacrées pêle-mêle, les femmes, les malades, les enfants au berceau, les prêtres tenant le calice, brandissant le crucifix... Pierre des Vaux de Cernay affirme que dans la seule église de la Madeleine, sept mille personnes ont été massacrées; ce chiffre est sans doute trop fort, l'église ne pouvait contenir tant de monde, mais il importe peu: quel que fût le nombre des victimes tous les témoins affirment que le massacre fut général, et qu'il ne fut fait d'exception pour personne; et s'il y eut de rares rescapés, ils ne durent la vie sauve qu'à la fuite ou à des hasards absolument indépendants de la volonté des vainqueurs.
En quelques heures, la riche ville de Béziers n'était plus qu'une ville de cadavres sanglants et défigurés; ses maisons, ses rues, ses églises sont devenues les repaires des bandits, qui, piétinant dans le sang, se partagent et se disputent l'incalculable butin que constitue l'héritage de tant de morts.
"Tuez-les tous! Dieu reconnaîtra les siens". La phrase fameuse et trop fameuse attribuée à Arnaud-Amaury par l'Allemand Césaire d'Heisterbach est bien plus un commentaire de l'événement qu'un mot historique. Elle pourrait servir de devise à toute guerre idéologique ou prétendue telle. Qu'Arnaud ait réellement eu assez d'esprit pour inventer cette phrase, ou qu'il ne l'ait jamais prononcée, la consigne des croisées, lors de la prise de Béziers, semble bien avoir été: "Tuez-les tous", avec ou sans le souci de ce que Dieu ferait des âmes des victimes.
Guillaume de Tudèle est formel sur ce point: "Les barons de France, clercs, laïques, princes et marquis, entre eux sont convenus qu'en tout château devant lequel ils se présenteraient et qui ne voudrait point se rendre avant d'être pris, les habitants fussent livrés à l'épée et tués, pensant qu'après cela ils ne trouveraient personne qui tînt contre eux à cause de la peur que l'on aurait après avoir vu ce qui advint57". Si les "barons de France" avaient vraiment pris cette décision, le calcul était bon.
Arnaud-Amaury, dans sa lettre au pape, se félicite de cette victoire inattendue et miraculeuse, et annonce triomphalement que, "sans égard pour le sexe et pour l'âge, presque vingt mille de ces gens furent passés au fil de l'épée".
Il importerait tout de même de savoir si les intentions des croisés étaient bien telles que le croit Guillaume de Tudèle, et, dans ce cas, si l'événement n'a pas dépassé leur volonté. D'habitude, après un siège, lorsqu'il était question de passer les habitants "au fil de l'épée", il s'agissait de la population mâle, les femmes et enfants ne subissaient la loi de la guerre que par contrecoup, dans la fureur de la mêlée, rarement par décision des chefs. Si féroce qu'il fût, Arnaud-Amaury ne pouvait donner l'ordre de massacrer des prêtres. D'autre part, les routiers dont la "Chanson" dit, de façon pittoresque, qu'ils "n'ont pas peur de la mort: ils tuent tout ce qu'ils rencontrent", ont été les premiers à pénétrer dans la ville, et leur passion pour le meurtre est chose connue: ils ont été les principaux auteurs du massacre et ils n'avaient ni les moyens ni l'envie d'aller demander conseil au chef de la croisade. À ces hommes-là point n'était besoin de dire: "Tuez-les tous!" et ils se moquaient bien de la distinction entre catholiques et hérétiques.
Les historiens favorables à la croisade seront donc tentés de rejeter la responsabilité du massacre de Béziers sur ces bandes de pillards, ces "Basques et Aragonais" et autres professionnels du crime, hommes sans Dieu par définition et n'ayant donc rien de commun avec les croisés proprement dits. Mais d'abord, pourquoi l'"armée du Christ", comme l'appellent les chroniqueurs, se servait-elle de ces diaboliques auxiliaires? Ensuite, nous verrons que dans Béziers dévastée, lorsque viendra l'heure du partage du butin, les chevaliers se précipiteront sur ces mêmes "truands" et les délogeront de la place à coups de bâton; les ribauds ne s'étaient pas emparés de la ville tout seuls, ils n'y étaient pas seuls, ils étaient beaucoup moins bien armés et peut-être moins nombreux que les croisés français qui ont forcé les enceintes et escaladé les murs, car parmi ces hardis combattants aucun ne devait vouloir être le dernier à pénétrer dans la ville.
Il est évidemment plus facile de chasser à coups de bâton des soldats ivres et repus que d'arrêter un massacre, mais les croisés avaient mieux que des bâtons, et si leurs chefs leur en avaient donné l'ordre, rien ne les empêchait de mettre à la raison les routiers. Il est même difficile de croire qu'ils n'eussent pas eux-mêmes participé au carnage, car en présence d'une catastrophe de cette envergure on imagine mal que des soldats vainqueurs aient pu rester les bras croisés et ne pas être entraînés par la folie du meurtre, fussent-ils par ailleurs de braves gens.
Il ne faut pas oublier non plus la présence, dans l'"armée de Dieu", des pèlerins, gens du peuple excités par une propagande violente et vivant dans une naïve et superstitieuse horreur de l'hérétique; frères de ceux qui, un siècle plus tôt, croyaient voir Jérusalem dans toute ville étrangère, ces âmes simples pouvaient voir dans Béziers le repaire du Diable. Et si la chevalerie française (selon toute vraisemblance et selon les allégations des chroniqueurs) s'est plus ou moins contentée de laisser faire les routiers et la populace, c'est qu'elle savait que de cette façon le travail serait fait mieux et plus vite. Si elle n'a rien fait pour arrêter le massacre, c'est qu'elle l'a voulu total.
"Après cela", dit la "Chanson" - après cet incroyable déchaînement de la joie de tuer, car pour tuer tous les habitants d'une grande ville, même les routiers, même les fanatiques les plus féroces ont dû y mettre une bonne volonté exceptionnelle, - "après cela les goujats se répandent par les maisons, qu'ils trouvent pleines et regorgeant de richesses. Mais peu s'en faut que, voyant cela, les Français n'étouffent de rage: ils chassent les ribauds à coups de bâton, comme des mâtins58". Rien de plus cruel que ce détachement avec lequel le chroniqueur constate la dureté du soldat, qui ne s'émeut pas du massacre et "étouffe de rage" dès qu'il voit d'autres que lui s'emparer du butin. Ces croisés-là ne s'attardent pas à chanter des Te Deum comme après le sac de Jérusalem, ni encore moins à s'épouvanter de la vue des milliers de cadavres de vieillards, de jeunes filles, de bébés, de matrones, d'adolescents... La grande affaire est de sauver le butin. L'armée en a besoin pour continuer la guerre, et d'ailleurs l'occasion de s'enrichir est belle, et ce qui n'est pas permis au ribaud l'est au chevalier. Les soldats de fortune sont dépossédés de leurs biens nouvellement acquis et dans leur compréhensible indignation mettent le feu à la ville. La vue des incendies provoque la panique parmi les pillards, les croisés abandonnent la place et ses richesses, une bonne partie de la ville brûle, ensevelissant sous ses décombres les cadavres de ses habitants. "...Brûlée aussi fut la cathédrale bâtie par maître Gervais, de l'ardeur de la flamme elle éclata, se fendit par le milieu et tomba en deux pans...59"
Comme épilogue de cette terrible journée, le chroniqueur ajoute: "Les croisés sont restés trois jours dans les prés verdoyants et le quatrième ils partent tous, sergents et chevaliers, par la pleine campagne, où rien ne les arrête, enseignes levées et déployées au vent60". Il ajoute que sans les misérables truands (qui ont mis le feu à la ville) les croisés eussent tous été riches pour le restant de leurs jours avec le butin qui se trouvait dans Béziers. Cette allusion aux richesses gagnées ou perdues revient très fréquemment dans la "Chanson": le droit au butin était le privilège naturel du soldat, et le désintéressement n'était pas une vertu pour le chevalier.
On ne saurait trop insister sur les causes et les conséquences du sac de Béziers. Il ne faut pas s'arrêter sur les chiffres (plus ou moins grands suivant les historiens) et ranger cette cruelle histoire parmi les atrocités inévitables propres à toute guerre. Ce que nous savons de la cruauté des mœurs guerrières de ce temps-là - et de tous les temps, du reste - pourrait faire supposer, à priori, qu'une soldatesque déchaînée pouvait facilement se livrer à des exploits de ce genre; mais les faits nous montrent qu'il n'en est pas ainsi: les massacres comme celui de Béziers sont extrêmement rares, car il faut croire que même la cruauté humaine a des limites. Parmi les pires atrocités de l'histoire de tous les siècles, ces massacres-là sont des exceptions, et c'est à une "guerre sainte", conduite par le chef d'un des premiers ordres monastiques de la chrétienté romaine, que revient l'honneur d'une de ces exceptions monstrueuses aux règles de la guerre. C'est là un fait dont il faut se garder de minimiser la signification.
Pierre des Vaux de Cernay, apologiste de la croisade, trouve parfaitement juste ce châtiment collectif infligé à une ville hérétique, dont les habitants, du reste, avaient tué leur vicomte quarante-deux ans aupavarant (jour pour jour!). Il n'ajoute pas qu'ils en avaient été punis par le massacre de la population mâle de la ville, l'année suivante. Il se réjouit de cette miraculeuse coïncidence qui montre que ce châtiment avait bien été voulu par Dieu, d'autant plus que le jour fatal était justement la fête de sainte Madeleine dont les bourgeois de Béziers s'étaient permis de mal parler: et c'est dans cette même église de la Madeleine qu'on a massacré sept mille personnes61! Cet homme qui se fait une si singulière idée de Dieu ne devait pas être le seul à raisonner de cette façon-là; mais il semble voir dans le malheur qui a fondu sur Béziers une espèce de catastrophe d'ordre cosmique plutôt qu'une œuvre humaine. Il n'eût pas parlé autrement d'un tremblement de terre. Peut-être le vent de folie qui avait soufflé sur les agresseurs par cette chaude journée de juillet était-il dû en effet à une exaltation collective qui a dépassé les volontés personnelles des chefs les plus implacables...
Ces soldats qui arrivaient dans le pays occitan avec leurs forces toutes fraîches n'avaient même pas l'excuse d'être exaspérés par les souffrances d'un long siège. Leur colère était, pour ainsi dire, "pure", et plus que la rage des ribauds que l'on a lâchés comme on lâche des chiens, il faudrait rendre responsable du massacre la haine de l'hérétique, qui devait être, ce jour-là, autre chose qu'un prétexte à l'ambition et à la soif de pillage.
C'est donc bien dans une atmosphère de haine féroce que cette guerre commence, d'une haine telle que l'adversaire n'est même pas traité en être humain, mais en animal nuisible dont il faut se débarrasser et qui ne peut être utile que par les dépouilles qu'il laisse après sa mort; il est certain que les croisés ont dû regretter amèrement les richesses brûlées dans la ville. S'ils n'oseront pas faire subir le même sort à Carcassonne, c'est par crainte de perdre le butin. Une haine pareille dépasse notre imagination et nous sommes tentés d'expliquer la conduite des croisés par l'insensibilité du soldat, par la cruauté des mœurs de l'époque, par l'ambition militaire des chefs; par le mépris du guerrier pour le bourgeois, par l'antipathie éprouvée par les Français du Nord pour ceux du Midi... Il y avait certainement tout cela, il y avait surtout un enthousiasme religieux chauffé à blanc, et le désir d'arracher à Dieu "le grand pardon" par n'importe quel moyen.
Par ce coup de massue, l'armée croisée paralysait la volonté de résistance du pays. Elle s'enlevait également tout espoir de s'attirer la sympathie des catholiques du Midi. Cette croisade qui voulait s'imposer par la peur ne pouvait rencontrer d'autre complicité que celle de la peur. À peine sortis de Béziers, les croisés rencontrent à Capestang une députation de Narbonne, conduite par l'archevêque Bérenger et le vicomte Aimery. Les bourgeois de Narbonne promettent pleine et entière soumission à l'Église et prennent des mesures sévères contre leurs hérétiques.
De Capestang à Carcassonne, l'armée poursuit sa marche triomphale: en six jours les croisés sont déjà sous les murs de Carcassonne, et les seigneurs du pays viennent leur livrer leurs châteaux et protester de leur soumission; d'autres abandonnent leurs demeures et fuient dans la montagne ou dans les bois avec leur famille et leurs vassaux. En quelques jours les croisés ont conquis de cette façon une centaine de châteaux sans coup férir.
III - CARCASSONNE
Raymond-Roger Trencavel est décidé à se défendre. Carcassonne est une place plus forte que Béziers et passe pour imprenable. La cité telle que nous la voyons maintenant, reconstruite par Philippe le Bel et restaurée par Viollet le Duc, donne une idée de ce qu'elle était au début du XIIIe siècle. Dominant la vallée de l'Aude, entourée d'une enceinte de murs solides et flanquée de trente tours, cette impressionnante forteresse ne laissait guère aux croisés l'espoir de voir se répéter le "miracle" de Béziers: la présence du vicomte, entouré de ses meilleures troupes, est une garantie de sécurité relative pour la ville. Mais les bourgs - le Bourg au Nord, le Castellar au Sud - qui flanquent la cité proprement dite ne sont pas suffisamment fortifiés; de plus, les habitants des environs ont cherché refuge dans la ville à l'approche des croisés et y ont amené leur bétail; et un grand nombre de vassaux du vicomte ont rejoint leur seigneur à Carcassonne.
Même en comptant les bourgs, l'espace occupé par la cité de Carcassonne nous semble aujourd'hui étrangement exigu; déjà en temps de paix les citadins se contentaient d'un espace vital très réduit, et si les salles des palais étaient vastes, les maisons étaient entassées les unes sur les autres, les pièces petites et les familles nombreuses des gens de condition modeste ou moyenne logeaient dans une seule pièce. En temps de guerre la ville devenait une véritable fourmilière, et en août 1209 la ville de Carcassonne devait loger plusieurs dizaines de milliers de personnes (plus les chevaux et le bétail) sur quelque 9000, ou, avec les bourgs 15000 mètres carrés.
Les croisés arrivent devant Carcassonne le 1 août, exaltés par un succès aussi foudroyant qu'imprévu; le 3 août ils se lancent à l'assaut du Bourg, au chant de Veni Sancte Spiritus; ce bourg, le plus faible des deux, ne résiste pas à l'attaque malgré l'héroïsme du vicomte, et ses défenseurs et sa population sont forcés de l'abandonner et de se retirer dans la cité. Le Castellar, mieux fortifié, repousse l'assaut, et les assaillants mettent en marche les machines. Les mineurs parviennent à saper et à faire tomber un pan de la muraille du Castellar dont les croisés s'emparent le 8 août, mais ils se retirent pour la nuit et le vicomte reprend le bourg et massacre la garnison laissée sur place.
Pour la première fois, de véritables opérations militaires sont engagées, et les croisés ont affaire à forte partie. Le jeune vicomte est un vaillant guerrier et est entouré par l'élite des chevaliers du pays. Mais l'été chaud et sec fit bientôt surgir l'allié habituel des armées assiégeantes: la soif. Si la ville ne manquait pas de vivres, elle commençait à manquer d'eau. La ville et les fossés commençaient à s'encombrer des charognes dont la décomposition rapide, par ces chaudes journées d'août, répandait par toute la cité une odeur pestilentielle et des nuées de mouches noires.
Raymond-Roger se voit donc contraint d'entrer en pourparlers avec l'ennemi. Selon G. de Tudèle, il fait appel à la médiation du roi d'Aragon, son suzerain. Pierre II tente en effet d'intercéder, et, avec le comte de Toulouse, son beau-frère, va trouver l'abbé de Cîteaux, et plaide la cause du jeune Trencavel, qui, dit-il, est innocent des crimes de ses sujets. Arnaud-Amaury, lassé depuis longtemps de l'éternelle équivoque qui tend à faire absoudre tous les crimes des "sujets" par la prétendue innocence des chefs, répond par un ultimatum insultant: puisque le vicomte est lui-même innocent on lui accorde la vie sauve et la permission de sortir "lui treizième" (avec douze chevaliers de son choix) en laissant tous les habitants de la ville à la merci du vainqueur. Pierre II rentre dans la cité assiégée et transmet cette proposition au vicomte; celui-ci répond qu'il aimerait mieux être écorché vif. Le roi d'Aragon se retire, ulcéré par le peu de cas que les croisés ont fait de son intervention, et le siège continue. La situation des assiégés devient de plus en plus difficile.
"...L'évêque, les prieurs, les moines, les abbés s'écrient: "Au pardon! que tardez-vous?" Le vicomte et les siens sont montés sur le mur: ils lancent avec des arbalètes des carreaux empennés, et de part et d'autre il périt beaucoup de monde. N'eût été l'affluence du peuple qui s'était réfugié là, d'une année ils n'eussent point été pris et forcés, car les tours étaient hautes et les murs pourvus de créneaux. Mais (les croisés) leur ont coupé l'eau, et les puits sont desséchés par la grande chaleur et par le fort été. Par la puanteur des hommes qui sont tombés malades et du nombreux bétail qui a été écorché dans la ville, et qu'on y avait rassemblé de tout le pays, par les grands cris que poussent de toutes parts femmes et petits enfants dont ils sont encombrés... Les mouches, par la suite de la chaleur, les ont tant tourmentés que de leur vie ils ne s'étaient trouvés en telle détresse62".
Ici se place un événement très controversé, et même resté inexpliqué, et c'est pourtant, dans un sens, l'événement capital de cette première croisade. Selon G. de Puylaurens, "le vicomte Roger, frappé de terreur, proposa les conditions de la paix, que les citoyens sortent en braies, abandonnant la cité, le vicomte lui-même restant en otage jusqu'à ce que fussent accomplis les pactes". Guillaume de Tudèle, par contre, prétend que le vicomte serait venu dans le camp des croisées sur l'invitation d'un "riche homme de l'ost" (ce qui n'est pas encore en contradiction avec la version de G. de Puylaurens), mais qu'une fois arrivé devant le légat il aurait été retenu par force. C'et ce qui ressort, du moins, de la narration quelque peu confuse et réticente du chroniqueur. Il ne parle d'aucun traité, ni de négociations; il insiste sur le fait que le "riche homme" (non nommé, mais désigné comme parent du vicomte) donne à plusieurs reprises des garanties de sécurité. Puis le vicomte (qui amène avec lui cent chevaliers) va se placer sous le pavillon du comte de Nevers où se tient le parlement. À partir de ce moment il n'est pour ainsi dire plus question dé lui, sauf pour dire qu'il "s'était livré en otage de son plein gré; et il agit bien en fou...63" L'abus de confiance n'est pas explicitement formulé, mais suggéré de façon très nette.
Est-il vraisemblable que le vicomte, chef militaire du pays, aimé de ses sujets et jouissant malgré sa jeunesse d'une incontestable autorité morale, ait consenti à se livrer de son plein gré comme otage et de décapiter ainsi le mouvement de résistance à l'envahisseur? Le peu de précisions que nous possédons sur cet événement ferait croire que la bonne foi du vicomte a été surprise et qu'il n'y eut ni négociations régulières ni traité approuvé par les deux parties. Il est probable que le vicomte avait refusé les conditions qu'on lui proposait et qu'on ne l'a pas laissé retourner dans la ville.
Le vicomte fait prisonnier, la cité restait sans chef et dut capituler. À l'encontre de ce qui s'est passé à Béziers, les habitants purent sortir sains et saufs. Comment? Par une porte dérobée et par un souterrain, en profitant de l'inattention des croisés, selon l'Anonyme; ce qui paraît peu vraisemblable: la chose aurait été possible pour une garnison, mais non pour la multitude de civils, de femmes, d'enfants, de malades, qui se trouvaient enfermés dans la cité. Selon G. de Tudèle, "ils sortirent nus, en grande hâte, en chemise et en braies, sans autre vêtement. Ils (les croisés) ne leur laissèrent de rien autre que la valeur d'un bouton". La condition de la reddition de la ville devait donc être: la vie sauve pour tous les habitants et abandon de toutes les richesses, ce qui explique les mots "la valeur d'un bouton". Or, la ville comptait un grand nombre d'hérétiques déclarés et il a semblé étrange que les chefs croisés, dont le but était d'exterminer les hérétiques, n'eussent pas profité d'une si belle occasion de se saisir de ceux de Carcassonne.
Certains historiens en ont conclu que Raymond-Roger avait acheté la vie des habitants de sa ville au prix de sa liberté. Il est plus vraisemblable de supposer que la capitulation a été décidée par les défenseurs restés dans la cité. Les croisés n'avaient pas à extorquer au vicomte le sacrifice de sa personne: de toute façon, leur premier objectif était d'épargner la ville, et la promesse de la vie sauve aux habitants était le seul moyen d'y parvenir.
Les habitants partis (il semble qu'ils aient évacué la ville avant l'entrée des troupes ennemies), les croisés s'y installent, en bon ordre, soucieux avant tout d'éviter la ruée de la piétaille et des ribauds qui risquerait de compromettre le profit que leur aura rapporté l'opération. La prise de Carcassonne se solde par un immense butin; l'armée en avait grand besoin.
Les croisés trouvent d'abord des réserves de vivres abondantes, puisque le siège n'avait pas duré longtemps (15 jours). Ils trouvent aussi des objets de valeur, or, argent, tant en monnaies qu'en joaillerie et orfèvrerie, vêtements, tissus, armes; en plus, des chevaux et mulets "dont il y a grande abondance" (ce qui ferait croire que la situation des assiégés n'était pas si désespérée que cela, et qu'il y eut bien trahison à l'égard du vicomte: le manque d'eau devait être très relatif, puisque beaucoup de chevaux et de mulets sont restés vivants). Bref, il y a tant de denrées utilisables et monnayables que l'armée n'a plus à craindre de se trouver à court de ressources. De plus, elle est maîtresse d'une place forte importante, presque intacte, où elle peut établir ses quartiers.
Cette fois-ci, les chefs procèdent à un triage méthodique du butin, en font l'inventaire et en confient la garde à des chevaliers armés, chargés de le protéger contre les convoitises des soldats. De droit, ces biens appartiennent à l'œuvre de Dieu et le pillage individuel est interdit. Arnaud-Amaury déclare, dans son discours: "Nous allons donner ces biens à un riche baron qui maintiendra le pays à la satisfaction de Dieu64". Bien des croisés venus dans l'espoir de s'enrichir durent être déçus, et même les chevaliers chargés de garder le trésor furent plus tard convaincus d'avoir détourné cinq mille livres.
La prise de Carcassonne est donc, pour la croisade, un succès incontestable. "Vous voyez, dit l'abbé de Cîteaux, quels miracles fait pour vous le roi du ciel, car rien ne peut vous résister65". Mais la grande chance des croisés est peut-être moins d'avoir pris la ville intacte que de s'être emparés de la personne de Raymond-Roger.
Nous avons déjà vu qu'il avait été fait prisonnier dans des circonstances pour le moins troublantes. Si la ville a capitulé, lui, le maître et le premier défenseur et responsable, est tenu à l'écart, tout se passe comme s'il n'existait plus. Il est traité non comme un homme qui a rendu une place, mais comme un butin de guerre. Il est enfermé dans un cachot, mis aux fers, et quand on songe qu'il s'agit du premier seigneur du Languedoc après le comte de Toulouse, un tel traitement ne s'explique que par le fait qu'il ne s'est pas livré de son plein gré.
Si un tel acte de déloyauté n'étonne pas de la part d'Arnaud-Amaury, homme sans scrupules et fort capable, en tant qu'ecclésiastique, de mépriser les droits d'un grand baron, est-il vraisemblable que les chefs laïques de la croisade aient pu traiter de cette façon un de leurs pairs? S'il en était ainsi, il faudrait croire 1°que les barons de la France du Nord tenaient en piètre estime la noblesse du Midi, 2°que l'enjeu était trop considérable et que, trop engagés dans la voie du crime, ils ne pouvaient plus reculer et ont dû passer outre à leurs scrupules (s'ils en avaient). Enfin, par fanatisme, ils pouvaient se dire que Raymond-Roger, en tant qu'hérétique, avait perdu le droit aux égards dus à son rang.
Le vicomte de Béziers était-il hérétique? G. de Tudèle le décrit de la manière suivante: "Aussi loin que s'étend le monde, il n'y a meilleur chevalier, ni plus preux ni plus large, plus courtois ni plus aimable... Lui-même fut catholique: j'en prends à témoin nombre de clercs et de chanoines... Mais par suite de sa grande jeunesse, il était familier avec tous et ceux de son pays, dont il était le seigneur, n'avaient de lui ni défiance ni crainte66". L'auteur de la "Chanson" n'a pas d'amitié particulière pour le vicomte et se fait ici l'écho d'une opinion universellement répandue; Raymond-Roger était extrêmement populaire. Mais le poète écrivait à une époque où l'on ne pouvait écrire librement, il ne faut donc pas le prendre à la lettre quand il se porte garant de l'orthodoxie de tel personnage dont il veut dire du bien. D'ailleurs, parmi les innombrables personnages de la "Chanson de la Croisade", on ne rencontre pas un seul hérétique. En fait, Raymond-Roger était issu d'une famille depuis longtemps favorable à l'hérésie; son père, Roger II, honorait à tel point les cathares qu'il avait confié à Bertrand de Saissac, hérétique déclaré, la tutelle de son fils; sa mère, Adélaïde, sœur du comte de Toulouse, avait défendu la place hérétique de Lavaur contre les croisés du légat Henri d'Albano; sa tante, Béatrice de Béziers, qui avait épousé le comte de Toulouse, s'était retirée dans un couvent de parfaites. Élevé dans un milieu où l'Église cathare était tenue en grand honneur, le jeune Raymond-Roger était probablement aussi hérétique que pouvait l'être un seigneur de son rang: c'est-à-dire, catholique par obligation et par coutume et cathare de cœur. Le fait devait être assez connu et les cathares vénéreront toujours le vicomte comme un martyr de leur foi. Cela explique en partie l'inadmissible manque d'égards dont il a été victime de la part de ses pairs, les barons de France.
En s'emparant du seigneur légitime du pays qu'ils veulent conquérir, les croisés ont donc atteint un des buts tracés par le programme du pape: ils peuvent donner à une terre infectée d'hérésie un maître catholique qui se chargera, par la force, de faire triompher la vraie religion. Dans Carcassonne occupée, légats, évêques et barons tiennent conseil pour choisir celui qui tiendra la terre, non en vertu de l'hommage féodal comme le veut la coutume séculaire, mais en vertu de l'autorité (révolutionnaire, il faut le dire) du chef spirituel de la chrétienté.
Or, la situation des barons consultés par Arnaud-Amaury est loin d'être simple: si dévoués qu'ils soient au pape et à la cause de l'Église (peut-être le sont-ils), ils savent bien que le pape n'est pas la seule autorité en matière de droit civil, ni même la plus compétente. Du reste, le vicomte de Béziers n'avait jamais fait publiquement profession d'hérésie. Quels que soient les mobiles qui font agir les grands barons que sont le duc de Bourgogne, le comte de Nevers et le comte de Saint-Pol, il leur est difficile d'appuyer de leur autorité une entreprise qui viole, au profit de l'Église, le droit féodal.
C'est à eux, pourtant, que le légat offre d'abord, de la part du pape, la suzeraineté des terres enlevées à la maison des Trencavel. D'après la "Chanson", les légats se seraient adressés en premier lieu à Eudes de Bourgogne, puis à Hervé, comte de Nevers, puis au comte de Saint-Pol; ils ne pouvaient faire moins, sans manquer d'égards à ces puissants personnages. Les trois barons refusent, l'un après l'autre. Le chroniqueur leur prête même de nobles paroles: ils ne se seraient pas croisés dans le but de s'emparer du bien d'autrui, ils ont assez des terres à eux. "Il n'est personne, dit G. de Tudèle, qui ne croie se déshonorer en acceptant cette terre67".
Il y a du faux et du vrai dans cette interprétation de l'attitude des barons de France. On a pu dire qu'Eudes II, qui était arrivé le dernier au rendez-vous des croisés à Lyon pour s'être attardé à piller des convois de marchands (qui ne rentrèrent dans leurs biens que grâce à l'intervention du roi de France), ne devait pas dédaigner si fort les biens d'autrui. On oublie que, pour un féodal, le marchand n'est pas "autrui"; et tel seigneur qui se faisait gloire de dépouiller bourgeois et moines pouvait très bien considérer comme sacrés les biens d'un noble. Pour être hérétique, vaincu et prisonnier, Raymond-Roger n'en était pas moins le seigneur légitime des terres en question.
Donc, les barons peuvent fort bien craindre le "déshonneur". Mais si même leur cupidité passait par-dessus cette crainte, ils n'ont pas grand intérêt à accepter l'offre des légats. D'abord, les terres du vicomte dépendaient, par lien d'hommage, du roi d'Aragon et du comte de Toulouse, lui-même vassal du roi de France. S'ils ne craignent guère Raymond VI, ils savent que l'offre qui leur est faite empiète sur les droits du roi d'Aragon. D'autre part, comme le leur fait dire la "Chanson", ils ont "assez de terres à eux", donc ils ne peuvent se permettre de se priver d'une bonne partie de leur chevalerie et de leurs troupes pour tenir des terres ennemies aussi grandes que leurs propres domaines. Ils ne veulent pas non plus accepter le titre sans accepter les charges, pour voir ensuite leurs bannières renversées et leurs garnisons massacrées. Ce qui leur est offert n'est pas, malgré l'incroyable rapidité de leurs premiers succès, une terre conquise, mais une terre à conquérir.
Donc, par prudence ou par honnêteté, les trois grands barons refusent le titre de vicomte de Béziers et de Carcassonne. Ces féodaux n'avaient sans doute pas pris la croix par ambition politique: aucun d'eux ne cherchera à revendiquer un droit quelconque sur les terres conquises, ni en 1209 ni plus tard. Le choix d'Arnaud-Amaury se portera sur un candidat moins riche en terres, donc plus intéressé par cette occasion d'en acquérir de nouvelles, et plus susceptible d'obéir aux ordres du chef spirituel de la croisade.
Une commission composée de deux évêques et de quatre chevaliers désigne Simon de Montfort, comte de Leicester en Angleterre. Ce seigneur, vassal direct du roi de France, tient entre Paris et Dreux un fief important qui s'étend entre la vallée de Chevreuse et la vallée de la Seine et compte de nombreux châtelains d'Ile-de-France parmi ses vassaux. À côté du duc de Bourgogne ou du comte de Nevers ce n'est, bien entendu, qu'un assez petit seigneur, mais il est loin d'être un homme sans fortune. Ce n'est pas non plus un inconnu: de vieille et bonne noblesse, il s'est déjà distingué en 1194 dans les armées de Philippe Auguste, puis en 1199 lors de la 4e Croisade: il a été de ceux qui ont refusé de se mettre à la solde des Vénitiens et s'est acquis un solide renom en Terre Sainte où il s'est battu pendant un an.
Âgé de cinquante ans environ (peut-être de quarante-cinq) c'est un guerrier éprouvé, et connu pour la sûreté de son jugement et ses qualités militaires. De plus, pendant le siège de Carcassonne il s'est distingué (d'après Pierre des Vaux de Cernay) par une action héroïque: lors de l'assaut contre le Castellar, au moment où les croisés battaient en retraite, Simon, seul avec un écuyer, s'était précipité dans le fossé, sous la grêle de pierres et de flèches qui tombaient des murs, pour ramener un blessé68. Un tel geste, de la part d'un capitaine déjà chargé d'ans et de renommée, suffisait à prouver aux légats que cet homme-là avait bien les qualités d'un chef.
Simon de Montfort, lui aussi, commence par refuser l'offre qui lui est faite. À la fin, il n'accepte qu'après avoir fait jurer aux chefs de la croisade de le soutenir si jamais il avait besoin de leur aide. Précaution sage et nécessaire: Simon voyait les barons charger sur ses épaules un fardeau qu'ils trouvaient trop lourd pour eux, et craignait de les voir se dérober à leurs responsabilités une fois le nouveau chef dûment reconnu. En déclinant ce titre dont personne ne semblait vouloir, Simon de Montfort ne devait pas jouer la comédie, l'honneur était à la fois douteux et périlleux.
Enfin, tenté ou non par la perspective de jouer un grand rôle, Simon accepte de se dévouer à la cause de l'Église et de devenir, de ce fait, vicomte de Béziers et de Carcassonne. "Élu" vicomte par les chefs d'une armée étrangère victorieuse, il n'est, malgré l'approbation des légats puis celle du pape, que le représentant de la raison du plus fort, et ce n'est que par la force qu'il peut espérer se maintenir. Or, la formidable armée qui a semé la terreur dans les régions envahies n'y est qu'un hôte de passage, et va bientôt plier ses tentes. Les légats voient approcher la fin de la quarantaine, et les quarante jours passés, aucune obligation ne retient plus ces volontaires qui seront libres de retourner dans leur pays le jour où il leur plaira. L'ennemi, pour terrorisé qu'il soit, sait fort bien que ces barons, ces chevaliers, ces pèlerins guerriers et civils n'ont nullement l'intention de passer leur vie dans le Languedoc, et que l'armée croisée se réduira bientôt à des garnisons insignifiantes.
Simon de Montfort se hâte donc de consolider sa position: il commence par distribuer largement des dons à ceux des éléments du pays sur lesquels il croit pouvoir compter: les confréries religieuses, et en particulier les moines de Cîteaux; puis il lève, par décret, un cens de trois deniers par feu, dont il fait hommage au pape. Il s'avance dans ses nouveaux domaines en triomphateur; après la chute de Béziers et de Carcassonne, villes et châteaux ouvrent leurs portes et font fête aux vainqueurs. Fanjeaux, Limoux, Alzonne, Montréal, Lombers sont occupés et les croisés y laissent des garnisons. Castres livre ses hérétiques. Fort de son nouveau titre Simon de Montfort s'empresse de recevoir les hommages des châtelains, des vicomtes, des consuls; toute la région comprise entre Béziers, Limoux et Castres lui est officiellement soumise, il a à peine le temps de recevoir les innombrables protestations de fidélité, seules les ailes lui manquent pour se déplacer plus vite d'un château à un autre. Triomphe précaire, mais auquel, en bon féodal, il attache une importante considérable: il veut s'assurer, dans une aussi faible mesure que ce soit, de la fidélité de ses nouveaux sujets.
Cependant, l'armée se disloque: le comte de Toulouse s'est retiré, une fois sa quarantaine terminée, après avoir assuré le nouveau vicomte de ses bons sentiments et avoir même proposé son fils en mariage à une fille de Simon. Le comte de Nevers, qui s'entend si mal avec le duc de Bourgogne qu'on "craignait chaque jour qu'ils ne s'entretuassent"69, est furieux de se trouver sous les ordres de Simon, lequel avait pris la croix sous les bannières du duc de Bourgogne. Ses quarante jours terminés, Hervé IV de Nevers abandonne la croisade.
Le duc de Bourgogne reste encore quelque temps; découragé par l'échec du siège de Cabaret il se retirera à son tour. Grands et petits seigneurs, milices conduites par les évêques, pèlerins pillards, routiers quittent le pays, séparément ou par groupes, en un reflux rapide et ininterrompu; les indulgences gagnées tant bien que mal, l'enthousiasme dissipé. Et une armée qui eût pu triompher en quelques mois de la résistance d'un pays mal préparé à la guerre s'évanouit en fumée, ne songeant même pas à profiter d'un succès reconnu par tous pour "miraculeux". "...Les montagnes sont sauvages, les passages étroits, et ils ne veulent pas être occis dans le pays70". Peut-être la plupart des croisés se sont-ils simplement rendu compte que l'hérétique n'était pas discernable du catholique à la couleur de sa peau, et que cette guerre sainte n'était pas plus exaltante que toute autre guerre. Et il suffisait de quarante jours pour gagner le pardon promis.
En septembre 1209 Simon de Montfort n'a plus avec lui que vingt-six chevaliers. C'était peu pour dominer un pays dont une partie n'a été conquise que par la terreur qu'inspire la présence d'une armée réputée invincible, et dont la plus grande partie reste encore à conquérir. On serait presque tenté d'absoudre Simon des crimes qu'il a pu commettre par la suite, tant la situation dans laquelle il se trouvait placé - pas tout à fait par sa faute - semble désespérée. Seule une peur ineffaçable, incontrôlable, plus forte que la raison et l'instinct de conservation, la peur inspirée aux populations du Midi par les premiers exploits des croisés, peut expliquer le fait qu'avec une poignée d'hommes et des renforts intermittents et capricieux, Simon de Montfort ait pu se maintenir et même triompher dans un pays qui lui était farouchement hostile. Et où il était condamné à ne régner que par la peur.
51 Op. cit., ch. IX, 193-202.
52 "Chanson de la Croisade", ch. XVII, 395-400.
53 Op. cit., ch. XVIII, 430-440.
54 Op. cit., ch. XIX, 450-455.
55 Op. cit., ch. XX, 467-471.
56 Op. cit., id., 471-476.
57 Op. cit., ch. XXI, 481-489.
58 Id., 500-505.
59 Op. cit., ch. XXII, 523-526.
60 Op. cit., ch. XXIII, 532-536.
61 Pierre des Vaux de Cernay, op. cit., ch. XVI.
62 "Chanson de la Croisade", ch. XXX, 685-702.
63 Op. cit., ch. XXXII, 742-743.
64 Op. cit., ch. XXXIII, 774-776.
65 Id., 769-770.
66 Op. cit., ch. XV, 343-352.
67 Op. cit., ch. XXXIV, 796.
68 Pierre des Vaux de Cernay, ch. XVII.
69 Pierre des Vaux de Cernay, Op. cit., ch. XXI.
70 "Chanson de la Croisade", ch. XXXVI, 826-828.
CHAPITRE V
SIMON DE MONTFORT
I. UN CHEF DE GUERRE
En deux mois de campagne, les croisés ont remporté un succès tel qu'ils ne peuvent eux-mêmes l'expliquer que par une intervention divine. Mais le but véritable de l'expédition - l'extermination de l'hérésie - n'a pas été atteint; mieux que cela: à part le fameux "tuez-les tous", ils semblent n'avoir encore trouvé aucun moyen pratique d'atteindre ce but. Ils ont presque abouti au résultat contraire. Si l'on excepte quelques cas isolés d'hérétiques livrés par leurs compatriotes, à Narbonne, à Castres, les croisés n'ont pas encore véritablement affronté l'ennemi qu'ils cherchaient à combattre.
La terreur qu'ils inspirent dresse entre eux et la population des régions envahies un mur impénétrable, les ministres cathares les plus connus se cachent dans des abris sûrs, les parfaits changent leurs vêtements noirs contre des habits de bourgeois ou d'artisans, les seigneurs du pays protestent de leur fidélité à la foi catholique ou se retirent dans les montagnes, et l'hérésie devient plus difficile à combattre qu'elle ne l'était un an auparavant. Pour n'avoir pas fait la distinction entre catholiques et hérétiques à Béziers, les croisés se voient forcés à traiter tout le pays comme hérétique.
Forcée de renoncer à tout espoir de conquérir par la persuasion, l'Église ne disposait plus, en fait de forces armées, que d'un chef militaire jouissant d'un titre usurpé, et entouré d'une poignée de soldats. À combien de combattants effectifs pouvait correspondre le nombre de "environ trente" chevaliers que cite P. des Vaux de Cernay? Plusieurs centaines d'hommes, peut-être. Guère plus. Simon dispose de quelques mercenaires, peu nombreux, car il a du mal à les payer. Les villes conquises, les chevaliers soumis lui fournissaient des contingents d'hommes poussés par la peur ou l'intérêt, jamais très sûrs. Il ne pouvait, en fait, compter que sur sa petite équipe de Français.
Cette équipe, les faits vont le montrer, était sûre, dévouée corps et âme à son chef, composée de chevaliers de grande valeur. Certains sont des parents ou des voisins de Simon, tels Guy de Lévis, Bouchard de Marly, les trois frères Amaury, Guillaume et Robert de Poissy; d'autres sont des Normands, qui, étant tous de même nationalité, forment également une équipe homogène; Pierre de Cissey, Roger des Essarts, Roger des Andelys, Simon le Saxon; des Champenois: Alain de Roucy, Raoul d'Acy, Gobert d'Essigny; enfin, des chevaliers d'autres provinces du Nord de la France ou d'Angleterre, Robert de Picquigny, Guillaume de Contres, Lambert de Croissy, Hugues de Lacy, Gauthier Langton; plus tard, Simon de Montfort va également compter un auxiliaire précieux en la personne de son frère Guy qui quittera la Terre Sainte pour le rejoindre. La plupart de ces barons s'illustreront dans les campagnes de la croisade aux côtés de leur chef, beaucoup y trouveront la mort. C'est sur eux, tout autant que sur Simon de Montfort lui-même, que reposera la défense des intérêts de l'Église dans le Languedoc; ils sont moins des subordonnés que des collaborateurs actifs et avisés, et, comme les chroniqueurs nous le montrent à maintes reprises, Simon ne décide rien sans tenir un conseil et consulter ses barons. Par son unité, sa discipline librement consentie, cette équipe constituait, malgré sa faiblesse numérique, une force redoutable; dans la fortune comme dans les revers, ces hommes formeront jusqu'au bout un seul bloc, et montreront un courage à toute épreuve.
Ils ont, en effet, grand besoin de courage: ils ont contre eux, d'abord, tout le pays qu'ils ont à soumettre directement et dont Simon est, en principe le vicomte: le Razès et l'Albigeois comptent de nombreuses places fortes qui lui résistent et qui semblent imprenables. Au Sud, dans les monts de l'Ariège, le comte de Foix, Raymond-Roger, vaillant capitaine et grand protecteur des hérétiques, a encore toutes ses forces intactes. À l'Ouest s'étendent les domaines du comte de Toulouse, ex-croisé, inattaquable en droit, mais allié peu sûr, prêt à se changer en ennemi à la première occasion. Les seuls et véritables alliés de Simon, les légats, ne représentent pas une puissance militaire; le clergé local, encouragé par le succès de la croisade, relève la tête, mais lui non plus ne peut guère aider le nouveau vicomte qu'en lui apportant une aide financière; et encore les prélats ont-ils tendance à voir en lui, avant tout, un défenseur de leurs intérêts et de leurs bénéfices. Le roi d'Aragon ne voit pas d'un bon œil ce nouveau vassal, dont malgré l'insistance de ce dernier il différera longtemps de recevoir l'hommage.
Il est bien vrai que Simon de Montfort avait pour lui la complicité d'une partie de la noblesse du pays qui lui avait prêté serment et, surtout, la menace toujours présente de nouvelles croisades. Sa situation n'en était pas moins incertaine et précaire et ses forces ridiculement insuffisantes pour l'ampleur de la tâche qu'il avait à accomplir. Et pourtant, les haines qu'il aura inspirées suffisent à prouver le rôle de tout premier plan qu'il devait jouer dans la conquête du pays; pendant des années la cause de l'Église dans le Languedoc s'est identifiée avec la personne et l'activité de Simon de Montfort.
Quel était cet homme auquel la papauté, par l'intermédiaire de ses légats, avait confié la défense de l'Église dans le Midi de la France? Les jugements portés sur lui par les historiens de son temps varient suivant les convictions personnelles de ces historiens, le héros sans peur et sans reproche de Pierre des Vaux de Cernay devient un tyran féroce et sanguinaire pour le continuateur de Guillaume de Tudcle, tandis que ce dernier décrit Simon comme "un riche baron preux et vaillant, hardi et belliqueux, sage et expérimenté, bon chevalier et large, preux et avenant, doux et franc71..." et Guillaume de Puylaurens loue la conduite de Simon au cours des premières années de la guerre, pour l'accuser ensuite de rapacité et d'ambition; tous sont unanimes à reconnaître sa bravoure et surtout l'immense prestige, fait à la fois de crainte et d'admiration, dont il jouissait même auprès de ses ennemis. Cet homme valait à lui seul une armée. Vivant il était entré dans la légende, Judas Macchabée ou fléau de Dieu; il avait su, avec des forces insignifiantes, se grandir jusqu'au rôle d'un de ces tyrans dont le seul nom fait courber les têtes. Ce n'est pas là un mince mérite pour un chef de guerre.
Les contemporains nous le représentent comme un chevalier magnifique, de haute taille, doué d'une force herculéenne, "merveilleusement exercé dans les armes"; son panégyriste, Pierre des Vaux de Cernay, vante d'une façon quelque peu conventionnelle l'élégance et la beauté de sa stature, ainsi que son amabilité, sa douceur, sa modestie, sa chasteté, sa prudence, son ardeur à l'action... "infatigable, pour achever, et tout dévoué au service de Dieu72".
Ce qui frappe surtout, quand on lit l'histoire des campagnes qu'il mena pendant près de dix ans, c'est sa faculté de se trouver partout en même temps, l'extrême rapidité de ses décisions; l'audace calculée de ses attaques; ce soldat paie de sa personne presque au-delà des limites du raisonnable, comme on l'a vu lors du siège de Carcassonne, et comme on le verra plus tard lors du passage de la Garonne près de Muret, lorsqu'il retraversera le fleuve en crue pour ne pas abandonner une partie de son infanterie, restera là plusieurs jours et ne rejoindra le gros de l'armée que lorsque le dernier des fantassins aura gagné l'autre rive de la Garonne.
Maint autre passage, aussi bien de l'Hystoria73 que de la "Chanson", montre le chef de la croisade comme un homme animé d'une véritable passion pour le métier de la guerre et très dévoué à ses soldats.
Les historiens parlent de ses mœurs austères, de sa grande piété. Piété intéressée, si l'on veut, puisqu'il doit tout à l'Église et n'attend du secours que d'elle. Piété sincère, car cet homme de guerre est assez redouté pour n'avoir nul besoin d'afficher une piété factice. Il se considère en toute bonne foi comme un soldat du Christ; il le croit même si bien que, lorsqu'il subit des revers, il accuse Dieu d'ingratitude ou de négligence. Le récit fait par P. des Vaux de Cernay de la dernière messe jamais entendue par son héros semble tiré de quelque pieuse chanson de geste; s'il est véridique, il est assez émouvant. Des messagers pressent le comte (Montfort) de courir à l'assaut, il ne se détourne pas, il dit: "Souffre que j'assiste aux divins mystères et que je voie d'abord le sacrement, gage de notre rédemption"; et comme un nouveau messager le presse encore, disant: "Hâtez-vous, le combat s'échauffe, les nôtres ne peuvent plus longtemps en soutenir l'effort", le comte répond: "Je ne sortirai pas avant d'avoir contemplé mon Rédempteur". Puis, devant le calice levé, il tend les bras et récite le Nunc dimittis et ajoute: "Allons, et s'il le faut, mourons pour celui qui a daigné mourir pour nous74". Cette scène a pu être inventée après coup par un narrateur qui savait que Simon allait, en effet, mourir quelques intants plus tard. Elle n'a rien d'invraisemblable - pour un soldat la veille de chaque bataille est une préparation à la mort. On peut dire que la piété d'un homme tel que Simon de Montfort peut plutôt paraître comme un outrage à la religion; il est difficile de nier la force de cette piété.
Ceci dit, il faut admettre que les soldats du Christ pouvaient difficilement se choisir un chef moins digne du nom de chrétien.
En 1210, après la prise de Bram, qui lui a résisté trois jours, Simon de Montfort se saisit de la garnison - plus de cent hommes en tout - et leur fait arracher les yeux et couper le nez et la lèvre supérieure; un seul garde un œil: Simon le charge de conduire ses compagnons aveuglés à Cabaret, afin de semer la terreur parmi les défenseurs de ce château.
On a pu dire que le même traitement avait été infligé à deux chevaliers français et qu'un occupant étranger, étant toujours numériquement le plus faible, est tenu d'user de représailles féroces pour se faire respecter. Simon de Montfort n'a pas inventé les lois de la guerre, les mutilations de prisonniers étaient un moyen sûr d'épouvanter l'adversaire. Les morts ne bougent plus et sont vite oubliés; la vue d'un homme aux yeux arrachés et au nez coupé peut glacer de peur les plus braves. On coupait aussi aux prisonniers les mains, les pieds, les oreilles... Ces traitements étaient le plus souvent infligés à des routiers, que personne ne pensait à venger et qui pouvaient tout de même servir d'épouvantails. Dans cette guerre-ci, une des plus cruelles du moyen âge, il y eut dans les deux camps des chevaliers écorchés vifs, coupés en morceaux, mutilés; la foi, le patriotisme ou la vengeance rendant toute les cruautés légitimes. Depuis le jour de la prise de Béziers, il semble qu'un climat de mésestime totale de l'adversaire se soit établi entre les deux parties en présence. Cette guerre menée par des chevaliers n'était pas une guerre chevaleresque, mais une lutte à mort.
Simon de Montfort, qui n'était pas le responsable du massacre de Béziers, a été laissé presque seul dans un pays ennemi qui se souvenait trop bien des exploits récents de l'armée croisée; et cet héritage de haine et de peur qu'on lui laissait en même temps que son titre de vicomte, il a su s'en rendre digne. Et pourtant, étant donné ses indiscutables qualités de chef et l'admiration que sa bravoure inspirait même à ses pires ennemis, il eût peut-être pu trouver un moyen de se faire haïr moins qu'il ne l'a fait. La chevalerie occitane n'était pas essentiellement différente de celles des autres pays. Pour populaire qu'il fût, Raymond-Roger Trencavel avait bon nombre de vassaux mécontents, les petits féodaux étant gens faciles à mécontenter. Ceux qui avaient prêté serment à Simon en août 1209 pouvaient devenir ses fidèles alliés, si le nouveau maître avait su montrer plus de tact. Dans les premières années de la guerre, la brutalité de Simon a sans doute fait plus de patriotes que n'en ont fait le courage et les malheurs du jeune vicomte.
Simon de Montfort ne pouvait évidemment pas être "large": il manquait d'argent. Il eût pu, du moins, être courtois, et il semble qu'avec ses nouveaux vassaux - peu commodes, assurément - il ait manqué de patience. Ainsi, après la défection de Guillaume Cat, chevalier de Montréal, l'entend-on s'écrier: "Je ne veux plus avoir affaire avec les hommes de cette maudite race provençale75!" Il est vrai qu'à ce moment-là, il est dans le pays depuis plusieurs années et est poussé à bout par les incessantes "trahisons" et dérobades de ceux qu'il considère comme ses vassaux. Mais dès le début, il semble s'être posé en maître légitime et indiscuté d'une terre sur laquelle il n'avait aucun droit légal; il a distribué largement à ses chevaliers, aux abbayes, aux ordres monastiques, les biens des seigneurs "faidits", c'est-à-dire de ceux qui ont préféré partir en abandonnant leurs châteaux plutôt que de pactiser avec l'envahisseur. Au lieu de montrer des égards particuliers à ceux des seigneurs occitans qui s'étaient ralliés à lui - et ils étaient nombreux - il a dû (sa phrase sur la maudite race provençale en fait foi) les traiter en inférieurs et les blesser maintes fois dans leur fierté.
Quand il voudra faire le législateur, il essaiera, par les statuts de Pamiers, d'implanter en Languedoc les lois et coutumes de France, sans penser à ce que la chose avait de vexant pour un peuple passionnément attaché à ses traditions et enclin à voir dans la moindre infraction à ses coutumes une brimade intolérable. On peut faire la guerre sans traiter les adversaires en peuple colonisé.
Mais plus que par ses nombreuses maladresses, par l'étroitesse d'esprit propre à un professionnel de la guerre et par son ambition qui finira par lui faire prendre la croisade pour une guerre de conquête dont il doit tirer seul le profit, c'est par sa cruauté que Simon de Montfort compromettra à jamais la cause de la croisade, si tant est qu'elle pouvait être compromise davantage.
Cruauté forcée, nécessaire, calculée. Cruauté qui a tout de même étonné les contemporains et scandalisé jusqu'au fanatique Pierre des Vaux de Cernay, qui, en parlant des cent prisonniers de Bram, croit devoir excuser le "noble comte" en disant qu'il n'agissait pas ainsi par plaisir, mais par nécessité: ses ennemis "devaient boire le calice qu'ils avaient préparé aux autres76". Si le principe est le même, il est clair qu'il y a une différence terrible entre le fait de mutiler deux hommes et celui d'en mutiler cent. Pour agir de la sorte, il fallait que cet homme ait été naturellement profondément cruel.
À Biron, Martin d'Algais, deux fois traître à Simon, est exposé sur un pilori, recouvert d'un drap noir, abreuvé d'insultes, solennellement dépouillé du titre de chevalier, pour être ensuite attaché à la queue d'un cheval, traîné par les rangs de l'armée, et ce qui reste encore de lui est finalement pendu à un gibet. Il est vrai que Martin d'Algais était un Navarrais et un chef de routiers, donc un personnage qui, dans la hiérarchie militaire, méritait moins d'égards qu'un chevalier du pays. Les détails du supplice qui lui est infligé n'en donnent pas moins une assez sinistre idée de l'homme qui a pris plaisir à ordonner cette macabre cérémonie.
Dans les guerres qu'il mènera ensuite pour défendre sa foi, Simon présidera à trois grandes exécutions de parfaits; à Minerve, on le verra même visiter les condamnés dans leur prison pour les exhorter à se convertir. Si, par ses victoires, il a rendu les bûchers possibles, la véritable responsabilité des autodafés d'hérétiques incombe aux légats. Le chef des croisés dut cependant partager "la joie intense" que, d'après le témoignage de P. des Vaux de Cernay, les soldats du Christ éprouvaient devant ce terrible spectacle.
Pillage, massacres, incendies, destruction systématique des récoltes, des vignes, du bétail, cette tactique de guerre, vieille comme le monde, fut appliquée par Simon de Montfort à une vaste échelle dans un pays qu'en principe il considérait comme son domaine. Il semble n'avoir réussi à se maintenir dans le Languedoc si longtemps que pour causer de plus grands ravages et pour détruire plus complètement la vie économique du pays. Tous comptes faits, le crime principal de Simon de Montfort fut peut-être d'avoir été un trop bon soldat et de n'avoir été que cela: en tant que chef de guerre, il a fait tout ce qu'on pouvait attendre de lui, dépassé toutes les espérances de ses chefs spirituels et rendu pratiquement possible l'extermination de l'hérésie par l'affaiblissement des forces physiques et morales du pays.
Il ne nous est pas possible, dans le cadre de cet ouvrage, de raconter en détail l'histoire des campagnes de Simon de Montfort; il faut nous contenter d'en suivre les principales étapes, parallèlement avec l'activité de ses alliés et de ses adversaires. Pendant qu'il faisait, avec une énergie digne d'un meilleur emploi, son métier de soldat et de conquérant, le pape cherchait à contrôler les événements et envoyait de nouveaux appels à la croisade, les légats manœuvraient pour trouver le moyen d'étendre leur domination sur le pays tout entier, et le comte de Toulouse et les grands barons du Midi préparaient leur plan de défense.
Comme nous l'avons vu, les premiers mois de la croisade, tout en apportant au parti de l'Église un succès inespéré, lui ont fait mesurer la difficulté de la tâche. Le résultat pratique le plus appréciable de cette campagne était la suppression de Raymond-Roger Trencavel et l'accession d'un baron catholique au titre de vicomte de Béziers. Mais le possesseur légitime de ces terres vivait encore; il ne fallait pas le laisser vivre longtemps. Le 10 novembre 1209, après trois mois de captivité Raymond-Roger meurt d'une dysenterie. Qu'il ait été empoisonné ou qu'il ait succombé par suite de la rigueur de l'emprisonnement et du manque de soins, on ne peut en aucune façon qualifier sa mort de naturelle: ses geôliers avaient fait leur possible pour abréger sa vie, et ils y étaient parvenus en un délai singulièrement court. Le vicomte était un homme de vingt-quatre ans, plein de force et d'énergie au moment où il fut jeté en prison.
Il laissait un fils âgé de deux ans; dix jours après la mort de son mari, la veuve, Agnès de Montpellier, conclut avec Simon un accord par lequel elle renonce à ses droits et à ceux de son fils moyennant 25000 sous de Melgueil et 3000 livres de rente annuelle. Le vicomté de Béziers n'a donc plus d'autre maître légitime que Montfort. Mais le roi Pierre II d'Aragon ne confirme pas le nouveau vassal dans ses droits et semble peu pressé de recevoir son hommage. De nombreux vassaux du vicomte, consternés par la nouvelle de sa mort, se révoltent, et se mettent à attaquer les châteaux où Simon n'avait laissé que de faibles garnisons. Un des seigneurs qui s'étaient ralliés à l'occupant, Giraud de Pépieux, pour venger la mort de son oncle tué par un chevalier français, enlève par surprise le château de Puisserguier où Simon avait laissé deux chevaliers et cinquante hommes; et quand Montfort marche sur le château avec le vicomte de Narbonne et sa milice de bourgeois, ces derniers refusent d'attaquer et s'en vont. À Castres, les bourgeois se révoltent et s'emparent de la garnison. En quelques mois, Simon perd plus de quarante châteaux, ses hommes sont découragés, ses caisses vides. Le comte de Foix, qui s'en était tenu au début à une attitude de neutralité, reprend aux croisés le château de Preixan et tente de prendre Fanjeaux.
Pendant ce temps, le pape confirme solennellement Simon de Montfort dans toutes ses possessions et lui fait don des biens conquis sur les hérétiques.
Pour Simon de Montfort, la tâche est claire: il s'agit de soumettre les places fortes qui commandent les routes principales, obtenir l'hommage des grands vassaux de la vicomté, ne pas laisser l'adversaire regrouper ses forces. Au début de 1210 il reçoit des renforts: en mars sa femme Alice de Montmorency lui amène quelques centaines de soldats. Il peut reprendre des châteaux, pendre des "traîtres", punir d'une manière plus cruelle encore la garnison de Bram, marcher sur Minerve, une des plus grandes forteresses du pays et capitale du Minervois. Il est assez habile pour profiter de la vieille hostilité qui oppose le vicomte de Minerve, Guillaume, aux habitants du pays narbonnais, et s'assure l'alliance de ces derniers.
Arrivé devant Minerve en plein été (juin 1210), il parvient à réduire les défenseurs par la faim et la soif, et négocie la capitulation de la place avec Guillaume; là, détail significatif, ce sont les légats, Thédise et Arnaud-Amaury, qui surviennent au milieu des débats, et semblent reprocher à Simon de se montrer trop conciliant: sans doute, avec son bon sens de soldat, Simon pense-t-il qu'avant d'entreprendre une répression méthodique de l'hérésie dans le pays il faut y être bien installé; en tout cas, dans l'affaire de Minerve, il semble avoir plutôt cherche à freiner le zèle des légats. Or, dans Minerve, un grand nombre de parfaits et de parfaites s'étaient réfugiés, Arnaud-Amaury ne l'ignore pas et craint qu'une maladresse de Simon ne prive l'Église d'une aussi belle capture. Dans cette négociation, l'abbé de Cîteaux, gêné de se montrer plus sévère que son impitoyable compagnon, car "s'il désirait la mort des ennemis du Christ, il n'osait pas les condamner à mort, étant moine et prêtre" a recours à une ruse qui fait rompre la trêve. Minerve se rend à merci, la vie sauve moyennant la soumission à l'Église. Les hérétiques, bien entendu, devaient choisir entre l'abjuration et la mort.
À ce sujet Pierre des Vaux de Cernay rapporte le propos d'un des meilleurs capitaines de Simon, Robert de Mauvoisin: ce bon chevalier ne pouvait admettre qu'un tel choix fût proposé à des parfaits, qui auraient ainsi le moyen d'échapper à la mort par une abjuration simulée; il avait pris la croix pour "perdre" les hérétiques, non pour leur faire grâce. L'abbé de Cîteaux le rassure: "Ne craignez rien, je crois que très peu se convertiront77". L'abbé des Vaux de Cernay, oncle de l'historien, et Simon de Montfort lui-même tentent cependant de convertir les condamnés. N'en obtenant rien "il les fit extraire du château, et un grand feu ayant été préparé, cent quarante et plus de ceux des hérétiques parfaits y furent jetés ensemble. Ni fut-il besoin, pour bien dire, que les nôtres les y portassent, car, obstinés dans leur méchanceté, tous se précipitaient de gaieté de cœur dans les flammes. Trois femmes, pourtant furent épargnées, lesquelles furent, par la noble dame mère de Bouchard de Marly, enlevées du bûcher et réconciliées à la sainte Église romaine78".
Minerve vit donc le premier grand bûcher d'hérétiques. Pourtant, dans cette guerre menée contre l'hérésie, les hérétiques eux-mêmes ne semblent jouer aucun rôle; on apprend seulement que tel château en contient un grand nombre; s'il est pris ils sont brûlés. Il ne s'agit évidemment que des parfaits, c'est-à-dire d'hommes et de femmes qui ont déjà solennellement abjuré la foi catholique et qui inspirent aux croisés une sorte d'horreur sacrée; ces exécutions en masse, voulues et approuvées par l'Église, sont cependant des actes de justice sommaire, sans procédure ni jugement, et imputables à la présence d'une armée fanatique et victorieuse.
Il nous est difficile d'imaginer la force des croyances et des superstitions de ces gens-là, et de comprendre à quel point l'esprit du mal qui habitait les ennemis de l'Église était réel à leurs yeux. Ceux qui s'étaient donnés corps et âme à la foi hérétique n'étaient plus des êtres humains, mais des créatures de l'enfer; et c'est ce qui explique les légendes grossières sur les orgies et les abominations auxquelles les cathares se seraient livrés. L'imagination du vulgaire, allant plus loin que l'Église, enlaidissait et défigurait à plaisir ces réprouvés, ne pouvant s'expliquer leurs égarements que par quelque dépravation surhumaine. De là la "joie" des pèlerins devant les bûchers: ils ne croient pas punir des criminels, ils croient voir une puissance diabolique réduite à néant par le feu purificateur.
Les parfaits sont peu nombreux; les simples croyants sont légion; et finalement, pour les croisés, tout homme qui protège les parfaits, et même tout homme qui n'est pas leur allié à eux, est un hérétique en puissance. Et ceux-là sont catholiques en apparence, se soumettent, jurent fidélité à l'Église, attaquent et massacrent les soldats du Christ où et quand ils le peuvent, se retirent dans leurs nids d'aigle d'où ils menacent sans cesse les détachements de croisés, se révoltent dans les villes et les bourgs contre l'autorité de l'occupant, bref ce ne sont pas les hérétiques qu'il faut combattre, mais tout un pays fauteur d'hérésie.
L'été 1210 amènera de nouveaux contingents de croisés. Le puissant château de Termes tombera après un long siège où prendront part les évêques de Beauvais et de Chartres, le comte de Ponthieu, Guillaume, archidiacre de Paris, réputé pour ses talents d'ingénieur, et de nombreux pèlerins de France et d'Allemagne. Le siège est dur. "Si quelqu'un voulait accéder au château, dit Pierre des Vaux de Cernay, il lui fallait d'abord se précipiter dans l'abîme, puis, pour ainsi dire, ramper vers le ciel79". Raymond, seigneur de Termes, est un vaillant guerrier, sa garnison est forte et effectue des sorties nombreuses, meurtrières pour les assaillants. Dans le camp des croisés les vivres manquent, Simon de Montfort lui-même n'a parfois "rien à se mettre sous la dent". L'été est torride, les nouveaux croisés parlent de repartir avant même la fin de leur quarantaine. Et quand la soif forcera les assiégés à négocier, l'évêque de Beauvais et le comte de Ponthieu lèvent le camp, seul l'évêque de Chartres, ému par les supplications de la comtesse Alice, femme de Montfort, consent à rester encore quelques jours. Des pluies torrentielles remplissent les citernes du château, qui reprend sa défense, au moment où l'armée croisée est réduite de plus de la moitié; et seule une épidémie survenue par suite de la pollution des eaux force Raymond de Termes à abandonner le château avec ses hommes, pendant la nuit. Capturé, il sera jeté dans un cachot où il mourra quelques années plus tard.
Le siège avait duré plus de trois mois. Simon est de nouveau maître de la situation, son prestige est accru, ses effectifs en hommes de nouveau très faibles: comme on le voit, les renforts de pèlerins que lui envoie la propagande du pape ne sont ni très réguliers ni très sûrs. Selon P. des Vaux de Cernay, Dieu a voulu que de nombreux pécheurs pussent travailler à leur salut en participant à l'œuvre de la croisade, et c'est pourquoi il a permis que cette guerre durât tant d'années; mais ces pécheurs étaient vraiment beaucoup plus soucieux de leur salut que des intérêts de la croisade. Ils vont et viennent à leur guise, et c'est à Simon d'adapter ses plans de campagne au bon vouloir de ces chasseurs d'indulgences.
Ces pieux personnages (tel l'évêque de Beauvais, Philippe de Dreux, futur héros de Bouvines, qui se sert dans les combats d'une masse d'armes, ne voulant pas, par scrupule d'ecclésiastique, manier l'épée ni la lance) remplissent leurs devoirs religieux à leur manière, mais ne s'inquiètent pas de savoir par quel moyen l'hérésie peut être efficacement combattue; peut-être ne demanderaient-ils pas mieux que d'avoir encore longtemps des hérétiques sous la main pour pouvoir gagner de nouvelles indulgences. Mais les autorités de l'Église, et en particulier les légats, plus réalistes et plus lucides, savent que ce n'est pas seulement par des faits d'armes, mais par l'extension de l'emprise politique des catholiques sur le pays que l'on peut venir à bout de l'hérésie.
Or, le premier seigneur du Languedoc est toujours le comte de Toulouse, et c'est sur ses terres et sur celles de ses puissants vassaux les comtes de Foix et de Comminges que se trouvent à présent les grands foyers de l'hérésie. La tactique de la terreur, inaugurée à Béziers, a eu pour résultat de forcer les parfaits et leurs partisans les plus dévoués à se réfugier dans des provinces qui n'étaient pas directement exposées, et si les territoires du vicomte de Béziers abritaient encore, en 1210 et plus tard, de nombreux parfaits (puisque 140 ont été pris à Minerve et 400 le seront à Lavaur) les pays non encore touchés par la guerre devenaient les centres d'une résistance cathare d'autant plus active que les cruautés commises par les croisés exaltaient encore davantage dans le peuple la sympathie pour l'Église persécutée.
Pour frapper l'hérésie, il fallait donc, d'abord et surtout, abattre le comte de Toulouse.
II - LE COMTE DE TOULOUSE
Dès septembre 1209, les légats Milon et Hugues évêque de Riez, adressent à Innocent III un réquisitoire contre Raymond VI, lequel, disent-ils, n'a respecté aucun des engagements qu'il avait pris envers l'Église lors de sa réconciliation à Saint-Gilles. Or, ces engagements, en particulier ceux qui concernent l'indemnisation des abbayes spoliées et la destruction de fortifications, étaient difficiles à tenir. Le comte part lui-même plaider sa cause, et après être passé par Paris, où il fait confirmer la suzeraineté du roi sur ses domaines et où il est traité avec honneur, il arrive à Rome en janvier 1210 et obtient une audience du pape.
Milon (qui peu après mourra subitement à Montpellier) écrit au pape, au sujet du comte: "Défiez-vous de cette langue habile à distiller le mensonge et l'outrage". Le comte, en effet, proteste auprès d'Innocent III de la pureté de sa foi catholique, et accuse les légats de s'acharner contre lui par ressentiment personnel. "Raymond, comte de Toulouse (écrit le pape aux archevêques de Narbonne et d'Arles et à l'évêque d'Agen), s'est présenté devant nous, nous a porté ses plaintes contre les légats, qui l'ont fort maltraité quoiqu'il eût déjà rempli la plupart des obligations auxquelles maître Milon, notre notaire, de bonne mémoire, l'avait assujetti..." Il est probable que le pape dut traiter le comte avec certains ménagements, car le même P. des Vaux de Cernay écrit: "Le seigneur pape pensait que, tourné au désespoir, le dit comte attaquerait plus cruellement et plus ouvertement l'Église80..."
Le pape cherchait sans doute, soit par l'intérêt, soit par la crainte, à attirer Raymond VI dans le camp des alliés de l'Église. Il n'est pas improbable qu'il n'ait également éprouvé pour ce grand seigneur brillant et cultivé quelque sympathie personnelle. Mais il n'était certainement pas homme à orienter sa politique sur ses sympathies ou antipathies. Dans ses lettres aussi bien aux évêques qu'à l'abbé de Cîteaux il présente son indulgence relative à l'égard du comte comme une ruse destinée à assoupir la méfiance de l'adversaire. Comme il avait jadis envoyé Milon, il envoie maître Thédise pour servir d'adjoint à Arnaud-Amaury, et écrit à ce dernier: "Il (Thédise) sera comme un hameçon que vous emploieriez pour prendre le poisson dans l'eau, auquel il est nécessaire, par un prudent artifice, de cacher le fer qu'il a en horreur..." (le fer étant l'abbé de Cîteaux lui-même81).
Arnaud-Amaury ne se tiendra pas pour battu, loin de là; puisque le pape lui recommande de permettre au comte de se justifier canoniquement et de le condamner au cas où il s'y refuserait, il faut ne pas laisser à Raymond VI la possibilité de se justifier. "Maître Thédise était un homme avisé et prudent, très zélé pour l'affaire de Dieu. Il désirait ardemment trouver un moyen légal de ne pas admettre le comte à prouver son innocence. Car il voyait bien que si on autorisait le comte à se disculper et qu'il pût y parvenir en usant de ruse ou en alléguant des faussetés, toute l'œuvre de l'Église en ce pays serait ruinée82". On ne peut mieux dire. Cet aveu formel de mauvaise foi montre quel danger le comte représentait aux yeux des légats.
Raymond VI est donc appelé à se justifier devant un concile réuni à Saint-Gilles, sous un délai de trois mois. Il doit prouver qu'il n'est pas coupable d'hérésie, et qu'il n'a pas participé au meurtre de Pierre de Castelnau. Or, comme les deux choses ne devaient pas être difficiles à prouver, on refusa de l'entendre sous prétexte qu'il n'a pas tenu ses engagements sur d'autres points moins importants (à savoir, qu'il n'a pas chassé les hérétiques de ses terres, qu'il n'a pas licencié ses routiers, ni aboli les péages dont on lui faisait grief), et que, se trouvant parjure sur des questions secondaires, il ne saurait être cru sur les principales. Le prétexte ne tenait pas très bien debout et du reste il importait peu. Le comte, cependant, montrait beaucoup de bonne volonté, protestait de son entière soumission et ne demandait qu'à être jugé dans les formes; juridiquement, le droit était si bien de son côté que le pape lui-même doit, d'assez mauvaise grâce, le reconnaître, quand il écrit à Philippe-Auguste: "Nous savons que le comte ne s'est pas justifié, mais nous ignorons si c'est par sa faute..."
Raymond essaie encore de traîner, de s'entendre avec Simon de Montfort; à la fin de janvier 1211 il rencontre le nouveau vicomte à Narbonne, en présence du roi d'Aragon et de l'évêque d'Uzès. Pierre II tente de jouer le rôle du médiateur, accepte enfin, des mains de Simon, l'hommage qu'il avait si longtemps différé; plus tard même il conclura un accord de mariage entre son fils Jacques, âgé de quatre ans, et la fille de Montfort, Amicie, et confiera à Simon la garde de l'enfant. En même temps il donne sa sœur Sancie en mariage au fils du comte de Toulouse, Raymond (son autre sœur, Éléonore, étant déjà l'épouse de Raymond VI, le jeune Raymond devenait! le beau-frère de son père).
Pierre II tente d'amadouer Simon de Montfort, espérant peut-être lui faire comprendre que son intérêt, en tant que vicomte de Béziers, serait de vivre en bonne intelligence avec ses voisins. Il montre en même temps son attachement à la maison de Toulouse, pensant mettre ainsi Raymond VI à l'abri des foudres de l'Église: l'affaire albigeoise est loin d'être l'unique préoccupation du pape, et le roi d'Aragon est, en Espagne, le grand champion de la chrétienté contre les Maures.
Les négociations se poursuivent. Le comte n'entend pas renoncer à son attitude de fils obéissant de l'Église. Les légats ne peuvent indéfiniment l'empêcher de prouver son innocence; et ils sont pressés: il leur faut, avant l'arrivée de nouveaux renforts de croisés, forcer la main à cet adversaire qui commence à faire figure de juste persécuté.
Ils y parviendront: à Arles, où se tient un concile (ce concile n'est mentionné que par Guillaume de Tudèle), Raymond VI se voit remettre, de la part des légats, une sorte d'ultimatum qui lui signifie les conditions qu'il doit remplir pour obtenir le pardon des crimes dont il se proclame innocent. Ces conditions sont telles que certains historiens ont pu les tenir pour une invention romanesque du chroniqueur. Celui-ci, d'ailleurs, raconte que Raymond VI et le roi d'Aragon ont dû attendre dehors, dans le froid, "en plein vent", la communication de la charte élaborée par les légats. Un tel manque de respect à l'égard d'aussi puissants seigneurs est-il vraisemblable? Mais Arnaud-Amaury a très bien pu chercher à exaspérer l'adversaire par tous les moyens. Ce qu'on sait du caractère de cet homme le montre violent et très peu enclin à respecter les autorités laïques.
Le comte se fait lire à haute voix le document, puis dit au roi: "Venez ça, sire roi, et écoutez cette charte et l'étrange commandement auquel les légats me mandent d'obéir". Le roi dit: "Voilà qui a besoin d'être amélioré, par le Père tout-puissant83". C'était le moins qu'on pouvait dire. Cette charte ordonnait au comte, bien entendu, de chasser les routiers, de ne plus protéger les Juifs et les hérétiques, de livrer ces derniers "dans le délai d'un an"; et, en outre, le comte et ses barons et chevaliers ne doivent pas manger "plus de deux sortes de viandes", ils ne doivent pas vêtir "d'étoffes de prix, mais de grossières capes brunes", ils doivent détruire entièrement leurs châteaux et leurs forteresses, ne plus habiter en ville, mais seulement à la campagne, "comme les vilains"; ils ne devront opposer aucune résistance aux croisés si ces derniers les attaquent, et de plus le comte devra passer la mer et rester en Terre Sainte aussi longtemps que cela plaira aux légats. Les conditions de ce traité sont telles qu'on pourrait presque suspecter le comte de les avoir inventées lui-même pour justifier sa rupture avec les légats - s'il avait eu intérêt à cette rupture; mais il est évident qu'il cherchait au contraire à l'éviter par tous les moyens.
Pierre des Vaux de Cernay ne parle pas de cette charte, mais prétend que le comte qui, "comme les Sarrasins, croyait au vol et au chant des oiseaux et autres présages84", serait parti brusquement, troublé par un présage de mauvais augure, ce qui cadre fort mal avec le caractère du personnage. Le panégyriste de la croisade ne veut pas rejeter sur les légats la responsabilité de ce départ brusqué, qui pourtant ne s'explique que par une provocation de leur part.
Donc, après avoir lu la charte, le comte, "sans saluer les légats", part pour Toulouse, la charte à la main, et la fait lire partout "pour que la connaissent clairement chevaliers, bourgeois et prêtres qui chantent la messe". C'est la déclaration de guerre. Les légats excommunient le comte et livrent (par décret) ses domaines au premier occupant (6 février 1211). Ils rejettent sur lui la faute de la rupture des négociations, et le 17 avril le pape confirme la sentence d'excommunication.
Or, le comte, malgré son mouvement d'humeur et malgré la publicité qu'il donne à l'outrage dont il a été victime, n'a toujours aucune envie de se battre; c'est, décidément, un souverain pacifique, et après tout il est difficile de le blâmer d'avoir voulu à tout prix éviter à son peuple les malheurs de la guerre. Jusqu'au dernier moment il essaiera d'arranger les choses; son inlassable bonne volonté a dû exaspérer les légats plus que ne l'eût fait une politique agressive.
Simon de Montfort continue sa conquête méthodique des domaines des Trencavel. L'imprenable château de Cabaret se rend avant d'avoir été assiégé. Maître de Cabaret, Simon marche sur Lavaur avec un nouveau et important renfort de croisés; cette place, ville fortifiée portant le nom de château, est prise après un siège long et pénible. Lavaur est défendu par Aimery de Montréal, frère de la châtelaine. Guiraude de Laurac est la fille de la célèbre parfaite Blanche de Laurac, et une des plus nobles dames du pays, une personne très respectable, une de ces veuves "croyantes" qui consacrent leur vie à la prière et aux bonnes œuvres; elle est plus connue encore par sa charité que par son zèle pour l'Église cathare.
Lavaur se défendit héroïquement, pendant plus de deux mois, et fut pris d'assaut, ses murailles démantelées par le tir des machines et le travail des sapeurs; Aimery de Montréal, qui s'était au début rallié à Montfort, fut pendu comme traître, avec 80 de ses chevaliers; le gibet dressé en hâte s'étant écroulé, une partie de ces malheureux furent simplement égorgés. Ces seigneurs soumis par la force, et qui profitaient de la première occasion pour secouer le joug de l'envahisseur, excitaient la haine toute particulière de Simon, qui ne semblait guère voir de différence entre le serment de fidélité que lui prêtaient ses petits vassaux de Chanteloup ou de Grosrouvre et une soumission extorquée par la peur à des vaincus. Aimery de Montréal, premier seigneur du Lauraguais, s'était par deux fois rallié à Simon. Comme nous l'avons dit plus haut, les croisés n'étaient pas, pour les gens du Midi, des adversaires qu'ils pussent estimer, et les chevaliers occitans ne se soumettaient, le plus souvent, que dans l'intention de mieux prendre leur revanche. Mais Simon de Montfort avait sa façon à lui de comprendre la loyauté. "Jamais dans la chrétienté si haut baron ne fut pendu avec tant d'autres chevaliers à ses côtés85".
Dans la ville de Lavaur se trouvaient quatre cents parfaits, hommes et femmes; c'est du moins ce que l'on peut supposer, étant donné le fait que quatre cents personnes y furent brûlées comme hérétiques, après l'entrée des croisés dans la ville. Ce nombre est surprenant; pourtant, il paraît témoigner surtout de la bonté et du courage de Guiraude, la châtelaine de Lavaur, qui n'avait pas craint de faire de sa forteresse le lieu de refuge des bons hommes. Cette grande dame devait payer cher son dévouement: au mépris de toutes les lois de la guerre et de la chevalerie, elle fut livrée à la brutalité des soldats qui la traînèrent hors du château pour la jeter dans un puits, où elle fut lapidée et finalement enfouie sous les pierres. "Ce fut deuil et péché, car sachez que jamais personne ne la quitta sans avoir fait un bon repas86".
Les quatre cents hérétiques furent conduits dans le pré devant le château, où le zèle des pèlerins avait rapidement amassé un gigantesque bûcher. Ces quatre cents personnes furent brûlées cum ingenti gaudio, et montrant un courage que leurs bourreaux attribuèrent à un incroyable endurcissement dans le crime. Ce fut le plus grand bûcher de toute la croisade. Après Lavaur (mai 1211), et après la prise des Cassés, le mois suivant, où soixante hérétiques furent brûlés, les parfaits trouvèrent d'autres refuges que les châteaux forts pour échapper aux persécutions.
Il est à noter que ces hommes, qui montaient au bûcher avec une sérénité qui eût ébranlé la foi d'adversaires moins fanatiques, ne recherchaient nullement le martyre, et faisaient leur possible pour échapper à la mort; on ne les voit pas, comme saint Dominique souhaitait le faire, supplier leurs bourreaux de les torturer et de les mutiler, ce n'étaient pas des exaltés avides de conquérir des "couronnes", mais des lutteurs qui tenaient à la vie pour pouvoir continuer leur apostolat. Ce n'est que tombés au pouvoir de l'ennemi, et sommés de choisir entre l'abjuration et la mort, qu'ils tenaient jusqu'au bout la promesse faite le jour de leur admission dans l'Église des purs. Par ailleurs, on les verra au contraire merveilleusement habiles à se cacher, à dépister les poursuites, ce qui semble prouver que c'est à tort qu'on les a accusés de rechercher le suicide: la croisade leur en fournissait une magnifique occasion, et ils n'en ont jamais profité.
Les quelques centaines d'hommes et de femmes brûlés vifs à Minerve, Lavaur et Cassés (environ six cents) étaient parmi les chefs, les forces agissantes de l'Église cathare. Leurs noms ne sont cités nulle part. On sait que certaines des personnalités qui avaient soutenu les controverses contre saint Dominique et ses amis, tels Sicard Cellerier, Guilhabert de Castres, Benoît de Termes, Pierre Isam, Raymond Aiguilher et d'autres survécurent aux dix premières années de la croisade. S'il y eut des évêques parmi les brûlés de Minerve et de Lavaur, aucun document ne le rapporte. Il est probable que les chefs principaux de cette Église déjà puissamment organisée aient cherche d'autres lieux de refuge que des châteaux forts, places stratégiques toujours visées par l'ennemi et où ils pouvaient trop facilement se trouver pris au piège.
On comprend donc pourquoi les légats estimaient que, si le comte de Toulouse est autorisé à se disculper, "toute l'œuvre de l'Église en ce pays serait ruinée"; pourquoi Milon écrivait au pape: "Si le comte obtenait de vous la restitution de ses châteaux... tout ce qu'on a fait pour la paix du Languedoc serait annulé. Et alors il aurait mieux valu ne pas commencer l'entreprise que de l'abandonner de cette façon". Ils savaient que l'Église ennemie, galvanisée par le danger, plus combative que jamais, avait transporté ses quartiers en pays toulousain, que le sang de ses martyrs et l'impopularité grandissante des croisés lui redonnaient un prestige nouveau, peut-être jamais encore atteint jusque-là.
De l'activité de l'Église cathare durant ces années terribles nous avons peu de témoignages. Pourtant, les registres de l'Inquisition rapportent des aveux de personnes qui ont assisté à des réunions, à des consolamenta, à des repas présidés par des parfaits, en 1211, en 1215... jusque dans les environs de Fanjeaux qui était le grand centre de la prédication de saint Dominique. Les chroniqueurs de l'époque ne nous racontent pas (et pour cause) de quelle façon les évêques cathares assuraient leur liaison avec leurs diocèses, ce qu'ils prêchaient, comment ils luttaient contre l'Église qui les persécutait. Les aveux arrachés par les inquisiteurs ne nous donnent qu'une idée très vague de leur activité: on les a vus, on les a entendus, on les a parfois aidés. C'est tout. Bien qu'ils eussent, probablement, encouragé leurs fidèles à se défendre, aucune parole incendiaire ou simplement patriotique ne leur est attribuée; de leur éloquence pourtant célèbre rien ne transparaît dans les comptes rendus des procès. Ou bien leurs auditeurs ont su se taire, ou bien les juges n'ont pas jugé bon d'en parler.
On ne voit jamais un parfait jouer un rôle tant soit peu spectaculaire dans les innombrables mouvements de révolte qui surgissaient sans cesse à travers tout le pays. Il n'y aura pas parmi eux de Jeanne d'Arc ni de Savonarole, ces combattants si redoutés par l'Église catholique semblent appliquer à la lettre les paroles d'Isaïe: "Il ne criera pas, n'élèvera point la voix, et ne la fera pas entendre dans les rues... il ne brisera point le roseau cassé..."
De ces hommes qui jouissaient d'un si grand prestige, dont l'ascendant sur les âmes devait être énorme, aucun n'a cherché à se mettre en avant, à brandir la bannière de son Église contre une Église haïe de tous, à entraîner les foules vers quelque contre-croisade vengeresse. On ne peut qu'être surpris par la force d'âme de ces pacifiques entre les pacifiques, qui dans une tentation si terrible ont su rester fidèles à la pureté de leur vocation. Ce n'est certainement pas par peur ni par manque d'énergie qu'ils ont choisi de ne jouer dans le drame sanglant que fut la croisade d'autre rôle que celui de martyrs. Leur force, ils le savaient, n'était pas de ce monde.
Ennemis de la violence, ils ne pouvaient lutter qu'avec des armes spirituelles, bien différentes de celles d'une Église où le spirituel et le temporel étaient si intimement mêlés l'un à l'autre que les meilleurs ne parvenaient plus à les distinguer. La lutte était trop inégale, et à l'heure où un Arnaud-Amaury pouvait se prendre pour une force spirituelle et où saint Dominique, abandonnant la bénédiction pour le bâton, se transformait en pourvoyeur de bûchers, l'Église cathare devenait dans le Midi de la France la seule véritable Église; et les bons hommes, vénérés à l'égal de saints, pouvaient être assurés de la complicité de tout le pays.
Ainsi, en ces années de tourmente, Guilhabert de Castres, fils majeur de l'évêque de Toulouse, puis évêque lui-même, ne cessera de parcourir ses diocèses, de prêcher, d'ordonner de nouveaux parfaits. Des prédicateurs moins connus devaient avoir plus de facilité encore à se déplacer et à exercer leur apostolat. Ils n'étaient jamais trahis. Les chevaliers du pays se faisaient un honneur de les escorter et de les protéger, les bourgeois les cachaient dans leurs maisons, artisans et femmes du peuple se dévouaient pour porter leurs messages et assurer la liaison entre les fidèles.
La croisade ne pouvait triompher que par une conquête totale des terres "hérétiques", et les légats connaissaient trop bien leurs adversaires pour se faire des illusions là-dessus. "Pour la paix du Languedoc", il fallait la guerre à outrance, et ces pacificateurs repousseront toutes les tentatives du comte de Toulouse, qui, même après son excommunication, continuera à leur proposer des arrangements à l'amiable. Simon de Montfort pénètre en juin 1211 sur les terres du Toulousain et c'est le bûcher des Cassés qui inaugurera cette nouvelle étape de la guerre sainte. Telle était l'inextricable situation où l'Église s'était engagée, que chaque victoire devenait une défaite morale qui lui aliénait de plus en plus les cœurs de ceux qu'elle voulait ramener à sa foi.
Le comte s'est retranché dans Toulouse. La grande cité, cœur du pays, foyer de toutes les résistances, est depuis longtemps l'objectif visé par les légats: ce n'est pas pour rien que Raymond VI, dans les offres de paix qu'il vient de leur faire, a proposé de remettre entre leurs mains tous ses États, sauf la cité de Toulouse. Maître de Toulouse, il reste toujours le maître du pays qui, même provisoirement occupé par l'ennemi, finirait par se regrouper autour de sa capitale intacte et de son souverain légitime. Simon de Montfort marchera donc sur Toulouse.
La croisade possède un allié terrible dans la place. L'évêque Foulques est non seulement un partisan farouche des mesures les plus radicales; c'est un ambitieux qui cherche à occuper dans la ville et dans tout l'évêché cette première place dont le comte excommunié s'est rendu indigne. Durant toute la croisade, on le verra agir comme si Toulouse lui appartenait en propre et comme s'il se considérait comme le maître des corps aussi bien que des âmes des Toulousains. Son fanatisme est notoire; il a, du reste, hautement encouragé la mission de saint Dominique, et déjà, depuis 1209, il a créé dans son diocèse un foyer de prédication catholique et s'est signalé par son zèle pour la recherche et le châtiment des hérétiques.
La grande cité, où les hérétiques étaient si vénérés que l'on voyait des chevaliers descendre de cheval, en pleine rue, en rencontrant un évêque cathare (comme le fit, en 1203, Olivier de Cuc devant l'évêque Gaucelm), comptait également beaucoup de catholiques: tout comme les grandes villes italiennes de l'époque, Toulouse était sans cesse en proie à des luttes intestines, sans gravité réelle du reste, mais où les clans rivaux s'affrontaient et se défiaient, les uns prenant parti pour le comte, les autres pour les consuls, les autres pour l'évêque. Toulouse jouait dans la vie de son pays le rôle que Paris devait jouer dans la vie de la France quelques siècles plus tard; plus qu'une ville, un monde, un symbole, un centre de rayonnement, la tête et le cœur de la province. Toutes les tendances, tous les mouvements y étaient représentés, tous y jouissaient du droit de cité dans une liberté souvent orageuse, mais réelle. Foulques de Marseille, le jour où il y fut nommé évêque, eut quelque mal à se faire accepter de ses nouveaux paroissiens. Mais, homme éloquent et énergique, il eut vite fait de grouper autour de lui la population catholique de la cité et, cinq ans après sa nomination, il était, dans Toulouse, une véritable puissance, non en vertu de son mandat d'évêque, mais par son influence personnelle.
"L'évêque Foulques (dit Guillaume de Puylaurens) qui avait grandement à cœur d'empêcher que tous les habitants de Toulouse fussent exclus de toute participation aux indulgences accordées aux étrangers (c'est-à-dire aux croisés), résolut de les attacher à la cause de l'Église par une pieuse institution87..." Cette pieuse institution n'est autre chose qu'une confrérie de catholiques militants chargés d'une activité ouvertement terroriste: les membres de cette confrérie, surnommée la Confrérie blanche (ils portaient une croix blanche sur leur poitrine), sévissaient contre les usuriers (les Juifs) et les hérétiques de la ville et détruisaient leurs maisons "après les avoir pillées". Les victimes de ces attentats se défendirent et "crénelèrent leurs demeures", et dès lors, dit l'historien, "la division régna dans la ville". Il se forma une autre confrérie, destinée à lutter contre la Confrérie blanche et qui s'appela de ce fait Confrérie noire. "Chaque jour, on se rencontrait les armes à la main, bannières déployées, et même avec de la cavalerie. Par le moyen de l'évêque, son serviteur, le Seigneur était venu pour mettre entre eux, non une mauvaise paix, mais un bon glaive88".
Cet évêque, qui avait déjà réussi à lever, parmi les membres de sa Confrérie, une milice de cinq cents Toulousains qu'il avait envoyés se battre avec les croisés devant Lavaur malgré l'opposition formelle du comte, était, à sa façon, populaire. Ses hommes allaient au combat en chantant de pieux "sirventès" composés par lui pour l'occasion. Sa Confrérie de fanatiques créait dans la capitale un véritable climat de guerre civile. Or, l'évêque était, dès le début, un ennemi déclaré du comte dont il réprouvait la tolérance pour les hérétiques. Depuis que le comte était de nouveau excommunié, il poussait ouvertement les citadins à la révolte contre leur seigneur. De toute évidence, l'évêque se considérait, en droit, maître de la ville.
Le comte, attaqué sur ses terres, menacé d'un siège, n'a nul besoin de cet ennemi dans la place. Le jour où Foulques poussera l'insolence jusqu'à l'inviter à faire une promenade hors de Toulouse parce que la présence d'un excommunié dans la ville l'empêche de procéder à des ordinations, le comte fera dire à son évêque "de vider au plus vite Toulouse et tout le territoire de sa domination". Foulques commence par faire parade de son intrépidité: "Ce n'est pas, dit-il, le comte de Toulouse qui m'a fait évêque, ni est-ce par lui que j'ai été colloqué en cette ville, ni pour lui; l'humilité ecclésiastique m'a élu et je n'y suis venu par la violence d'un prince; je n'en sortirai donc à cause de lui. Qu'il vienne, s'il ose: je suis prêt à recevoir le couteau pour gagner la majesté bienheureuse par le calice de la passion. Oui, vienne le tyran avec ses soldats et ses armes, il me trouvera seul et désarmé: j'attends le prix et je ne crains point ce que l'homme peut me faire89".
Le chef de la Confrérie blanche n'était à coup sûr ni seul ni désarmé; et Raymond VI ne se souciait nullement de prendre à son compte le meurtre d'un évêque. Le discours de Foulques était donc une bravade gratuite et l'homme avait le sens de l'attitude théâtrale. Au bout de quelques jours, lassé d'attendre un martyre ou du moins une provocation qui ne venait pas et sentant probablement que sa popularité ne pouvait contrebalancer celle du comte, il quitta la ville et se rendit au camp des croisés.
Or, Toulouse, comme nous l'avons vu, n'était pas une ville hérétique; les catholiques y étaient nombreux et influents. L'année précédente, les consuls avaient accompagné le comte à Rome pour obtenir du pape la levée de l'interdit jeté sur leur ville. Les Toulousains tiennent à faire la paix avec leur évêque; Foulques leur répond par un ultimatum: qu'ils refusent obéissance à leur seigneur excommunié et le chassent de la ville, sinon Toulouse est mise au ban de l'Église. Cette proposition est repoussée avec indignation et Foulques ordonne au clergé de quitter la ville, pieds nus, en emportant le Saint Sacrement. L'interdit est jeté à nouveau sur la capitale et Toulouse devient la cité hérétique promise au glaive des croisés.
Simon de Montfort vient mettre le siège devant Toulouse, avec des renforts de croisés, parmi lesquels se trouvent le comte de Bar, le comte de Châlons et un grand nombre de croisés allemands. La guerre contre Toulouse avait bien commencé: Montfort a déjà pris quelques châteaux dans les environs de la capitale, brûlé les soixante hérétiques des Cassés, obtenu la capitulation du propre frère du comte, Baudouin, qui, après une belle résistance, est passé à l'ennemi par rancune contre son aîné; et avec les troupes fraîches que lui amène le comte de Bar, il se croit assez fort pour assiéger Toulouse. Il comprend bien vite son erreur et lève le camp après douze jours de siège; la quarantaine des croisés tire à sa fin et l'armée manque de vivres.
Cet échec, très prévisible et tout à fait excusable du point de vue stratégique, n'en entraîne pas moins pour Simon une grosse perte de prestige: l'homme qui, jusqu'ici, a triomphé partout, a dû reculer devant Toulouse; la chevalerie occitane et les milices bourgeoises commencent à se dire que l'ennemi n'est pas invincible. Un vent de courage et d'espoir souffle sur le pays. Désormais, Simon ne pourra plus se contenter d'assiéger les châteaux l'un après l'autre, il sera attaqué lui-même de tous les côtés, "trahi" à tout moment par ses nouveaux vassaux, à la fois assiégeant et assiégé, attaquant et fuyant, dans une suite ininterrompue de chevauchées qui l'entraîne de Pamiers à Cahors et d'Agenais en Albigeois; parfois repoussé, jamais battu.
L'échec devant Toulouse pousse d'abord les croisés vers le comté de Foix où ils s'empressent de semer la terreur, brûlent Auterive, saccagent les châteaux, incendient les bourgs, déracinent les vignes. Ayant échoué devant Foix, ils remontent vers Cahors dont l'évêque réclame Simon pour suzerain à la place du comte excommunié. Après avoir reçu la soumission de Cahors, Simon apprend que le comte de Foix a fait prisonnier deux de ses meilleurs compagnons, Lambert de Thury (ou de Croissy) et Gauthier Langton; il revient en hâte vers Pamiers et apprend que les gens de Puylaurens ont rappelé leur ancien seigneur et assiègent dans le donjon la garnison qu'il y a laissée. Il repart donc vers Puylaurens, puis finalement se retire dans Carcassonne.
Pendant ce temps, le comte de Toulouse a regroupé ses forces et, avec le comte de Foix et un renfort de deux mille Basques envoyé par le roi d'Angleterre, passe à l'attaque et s'apprête à son tour à assiéger l'adversaire. Simon, à qui ses propres succès ont fait mesurer les risques de la situation d'assiégé, se jette dans Castelnaudary, "le plus faible château", mal protégé et, de plus, récemment brûlé par le comte: un système de fortifications trop parfait empêche bien les assaillants de pénétrer dans une place, il empêche aussi les assiégés d'en sortir. Assiégé dans Castelnaudary par une armée très supérieure en nombre à la sienne, Simon en sortira, y reviendra, enverra des émissaires chercher des secours, donnera des combats en rase campagne, mettra en déroute les troupes du comte de Foix (malgré l'héroïsme de ce comte et, de son fils Roger-Bernard); et les assaillants, découragés par sa résistance, finiront pair se retirer.
Mais cette défense, pour méritoire qu'elle soit, n'est pas un triomphe: ceux à qui Simon avait demandé des renforts n'ont pas répondu à son appel, les Narbonnais n'ont voulu marcher que sous la conduite de leur vicomte, Aimery, qui a refusé; Guillaume Cat, chevalier de Montréal, chargé de ramener des renforts, recrute en effet des hommes, mais c'est pour attaquer les troupes des croisés; Martin d'Algais, qui commande les routiers, fuit en pleine campagne, emmenant ses troupes, et s'excuse ensuite en rejetant la faute de cet abandon sur l'indiscipline de ses soldats. Il devient évident que Montfort ne peut compter que sur son équipe française et les renforts venus de l'étranger. D'autre part, les comtes de Foix et de Toulouse présentent l'affaire de Castelnaudary comme une victoire; tous les châteaux pris par les croisés leur ouvrant leurs portes, massacrent les garnisons, font fête aux libérateurs. Les armées des comtes, moins organisées et moins homogènes que la garde d'élite de Simon, mais supérieures en nombre et sûres de l'appui de la population, talonnent l'adversaire, le poursuivent, reculent, jamais victorieuses et jamais battues.
Puis, au printemps 1212, avec l'arrivée de nouveaux contingents de croisés du Nord, la situation change et Simon de Montfort reprend l'avantage; et, à partir de Pâques, il commence à enlever les châteaux qui lui ont été pris, l'un après l'autre.
Mais malgré l'importance de ces troupes de pèlerins parmi lesquels on voit l'archevêque de Rouen, l'évêque de Laon, l'archidiacre de Paris, Guillaume; des Allemands de Saxe, de Westphalie, de Frise, avec les comtes de Berg, de Juliers, Englebert, prévôt de la cathédrale de Cologne et Léopold IV d'Autriche, la croisade commence de plus en plus à prendre l'allure d'une guerre de conquête au bénéfice de Simon de Montfort. Avec ses troupes temporaires, Simon entreprend la conquête de l'Agenais (terre du roi d'Angleterre que Raymond VI tient en dot de sa quatrième femme Jeanne Plantagenet), assiège Penne d'Agenais qui capitule après un siège d'un mois, le 25 juillet; prend Marmande, marche sur Moissac qui résiste énergiquement, puis capitule à son tour. La campagne d'été terminée, les croisés de Montfort, après avoir ravagé les environs de Toulouse, se retirent à Pamiers pour les quartiers d'hiver.
Pour Simon, comme pour les légats, une nouvelle étape est franchie: comme les années précédentes, le talent militaire du chef de la croisade, et les troupes de pèlerins guerriers que les pays du Nord lui envoient périodiquement ont réussi à triompher des résistances locales. Mais cette fois-ci, les résultats acquis sont d'une importance telle que Simon peut se croire le maître du Languedoc tout entier: plus d'adversaires sur le terrain. Les comtes de Foix et de Toulouse se sont retirés à la cour du roi d'Aragon, où ils préparent leur revanche; bourgeois et seigneurs ont de nouveau prêté serment au vainqueur - à part les faidits dont les biens viennent fort heureusement récompenser le dévouement des chevaliers français, - les évêques du pays sont peu à peu remplacés par de fidèles exécutants des ordres du pape; Toulouse n'est pas encore réduite, mais Simon espère bien en venir à bout au printemps prochain. Et il songe déjà à organiser sa conquête.
Les statuts de Pamiers montrent que Montfort se considère d'ores et déjà seigneur légitime du Languedoc. Il convoque à Pamiers une assemblée, sorte d'États généraux où sont conviés évêques, nobles et bourgeois, en principe seulement car, en fait, ce sont les évêques qui dominent et de loin. Par contre, les légats sont absents. Ceci montre que Simon de Montfort cherche à s'assurer l'appui de l'Église du pays, mais tient plutôt à se libérer de la tutelle des légats qui tendent trop à lui rappeler que toute l'affaire a été entreprise pour le compte de l'Église et à des fins "spirituelles". Simon s'est déjà à moitié brouillé avec l'abbé de Cîteaux, lequel, élu archevêque de Narbonne, s'est fait également accorder le titre de duc et a reçu l'hommage direct du vicomte Aimery.
Par les "statuts" élaborés à Pamiers, Simon accorde à l'Église des avantages matériels considérables: protection des biens et des privilèges, confirmation des dîmes et des redevances, libération de certains impôts (taille), justice d'Église pour tous les clercs, etc. Par contre - et c'est là une mesure explicable par l'irritation que devait lui causer l'abbé de Cîteaux, - il n'accorde aux prélats aucune part dans le gouvernement du pays. C'est à lui seul, et à son équipe de chevaliers français, que reviendra en fait le pouvoir.
Substitués aux seigneurs du pays, hérétiques ou simplement dépossédés, les compagnons de Simon de Montfort sont appelés à devenir l'aristocratie, la classe dirigeante; des fiefs importants leur sont distribués, et en revanche ils s'engagent à servir le comte (Montfort) dans toutes ses guerres, à ne pas quitter le pays sans son congé, à ne pas prolonger leurs absences au-delà du délai fixé, à n'amener à l'ost, pendant vingt ans, que des chevaliers français; les veuves ou héritières possédant château ne pourront (pendant six ans) se marier sans la permission du comte, sauf avec des Français. Enfin, les héritiers hériteront "selon la coutume et l'usage de France autour de Paris". Simon envisage donc une véritable entreprise de colonisation du pays conquis, ou du moins l'élimination progressive de la noblesse locale et son remplacement par une noblesse venue de France. Sa rancune contre la chevalerie occitane est tenace et d'ailleurs justifiée. En militaire, il vise surtout à l'élimination de la classe qui, dans le pays, détient le pouvoir militaire.
Il ne semble pas se préoccuper outre mesure des hérétiques, et n'institue aucune organisation spéciale chargée de les poursuivre. Cette tâche, selon lui, incombe à l'Église. Du reste, ce croisé ne semble plus voir dans l'hérésie qu'un prétexte pour dépouiller les seigneurs qui lui sont hostiles ou dont il convoite les biens. Cependant, jusqu'au bout il proclamera - en toute bonne foi sans doute - qu'il combat pour la cause du Christ.
Enfin, les statuts de Pamiers prévoient une série de mesures destinées à améliorer la condition du petit peuple, et à le protéger contre l'arbitraire des seigneurs; mesures généreuses, mais quelque peu démagogiques parce que difficilement applicables dans un pays en guerre: la promesse d'impôts moins lourds et d'une justice plus équitable était une faible compensation pour les dommages subits par les campagnes, les taxes de guerre et le renforcement de l'impôt ecclésiastique. Dans tous les cas, Simon prend au sérieux son rôle de législateur, et dans un pays hostile, à moitié conquis et où il se maintient à grand-peine, il semble déjà s'installer pour des siècles.
En fait, le comte de Toulouse est toujours le maître légal du pays, et en septembre 1212 le pape avait déjà écrit à ses légats pour demander pourquoi le comte n'a pas été admis à se justifier, si son crime a bien été prouvé, et s'il est bien établi qu'on a le droit de le dépouiller en faveur d'un autre. Il est à supposer que cette lettre est moins une preuve de l'esprit d'équité d'Innocent III que le résultat de la diplomatie du comte de Toulouse, qui, par l'intermédiaire du roi d'Aragon, tente de déconsidérer la croisade aux yeux du pape lui-même.
Après trois ans de guerre, des succès militaires certains, et l'anéantissement apparent de la résistance armée dans les pays hérétiques, le pape semble soudain se désintéresser d'une affaire si bien commencée, déclare la croisade terminée du moins provisoirement, et reproche aux légats et surtout à Simon de Montfort leur zèle exagéré et d'ailleurs inutile: "Des renards détruisaient dans la Province (le Languedoc) la vigne du Seigneur. On les a capturés... Aujourd'hui il s'agit de parer à un danger plus redoutable90..."
En fait, le grand adversaire de la croisade n'est plus Raymond-Roger Trencavel ni même le comte de Toulouse; c'est Pierre II d'Aragon, le chef de la croisade contre les Maures, le tout récent vainqueur de Las Navas de Tolosa91, le champion de la chrétienté contre l'Islam.
Pour devenir maîtres du Languedoc, Montfort et les légats ont encore une étape décisive à franchir: le moins que l'on puisse dire, c'est qu'ils sont loin d'être sûrs de triompher. Battu par le très catholique Pierre II, Simon n'eût plus été qu'un aventurier et un usurpateur, et le pape lui-même, quelle que fût sa haine pour l'hérésie, eût sans doute été obligé de s'incliner devant le fait accompli et de laisser au roi d'Aragon le soin de persécuter les hérétiques dans des États qu'il eût pris ainsi sous sa protection.
D'ailleurs, en janvier 1213, Pierre II ne souhaitait nullement en venir à l'action armée, il croyait que son prestige suffirait pour en imposer au pape et à Montfort. Couvert de gloire après sa brillante victoire sur les Maures, ce vaillant guerrier estimait, non sans raison, que le pape lui devait une considération toute particulière; et au moment où il intervenait en faveur de son beau-frère le comte de Toulouse, il ne s'attendait sans doute pas à voir Innocent III lui écrire, cinq mois plus tard: "Plût à Dieu que ta sagesse et ta piété se fussent accrues en proportion (de ta renommée)! Tu as mal agi envers toi-même comme envers nous92..."
Le roi d'Aragon, suzerain direct des vicomtes Trencavel, des comtes de Foix et de Comminges pour une partie de leurs terres, considérait depuis longtemps la croisade comme une entreprise qui le lésait dans ses droits. Au siècle précédent les comtes de Toulouse ont dû maintes fois défendre leur indépendance contre les prétentions de l'Aragonais: même en pleine croisade, des vassaux du vicomte de Béziers, tout en cherchant l'appui de Pierre II, avaient hésité à lui livrer les places fortes qu'il demandait et avaient préféré se soumettre à Montfort. Mais les cruautés et l'humeur tyrannique du nouveau venu eurent vite fait de tourner les sympathies des seigneurs et des bourgeois occitans vers leur puissant voisin d'au-delà des Pyrénées.
Quelles que fussent ses prétentions, le roi d'Aragon ne pouvait qu'apparaître comme un sauveur s'il parvenait à chasser les Français. "Les peuples de Carcassonne, de Béziers et de Toulouse, écrira plus tard le roi Jacques I, vinrent trouver mon père (Pierre II) et lui dirent qu'il pouvait devenir le seigneur de ces pays, si seulement il voulait les conquérir93..." En effet, déjà en 1211 les consuls de Toulouse avaient adressé au roi un appel, sous forme d'une lettre où ils se plaignaient des méfaits des croisés, et suppliaient ce prince d'intervenir pour défendre un pays si proche du sien: "Lorsque le mur du voisin brûle, il y va du tout94..." Pierre II est catholique, et a même persécuté et brûlé des hérétiques sur ses terres. Mais barons, consuls et bourgeois prétendent tous être d'excellents catholiques et jurent qu'il n'y a plus d'hérétiques dans leur pays.
Le comte de Toulouse, d'accord avec ses vassaux les comtes de Foix et de Comminges, avait décidé de jouer sa dernière carte: l'alliance du roi les mettait tous sous la dépendance directe de l'Aragon; du moins pouvait-elle leur permettre de chasser l'envahisseur étranger.
En attendant, Pierre II prenait fait et cause pour le Languedoc opprimé et ravagé; et même si son désir d'aider ses beaux-frères n'était pas désintéressé, il ne faut pas oublier que ce roi féodal se sentait grandement atteint dans son honneur par les vexations que l'on faisait subir à ses vassaux; et que la solidarité familiale et nationale pouvait le pousser à défendre l'héritage de ses sœurs et une terre dont il parlait la langue et admirait les poètes.
Ses ambassadeurs, avec l'évêque de Ségovie à leur tête, avaient entrepris de prouver au pape que l'hérésie était vaincue et que les légats, de concert avec Simon de Montfort, attaquaient à présent des terres qui n'avaient jamais été suspectes d'hérésie, et utilisaient la croisade dans des buts de conquête et pour leurs intérêts personnels et que, de plus, en s'attaquant à des vassaux du roi d'Aragon, ils empêchaient ce dernier de poursuivre la croisade qu'il avait entreprise contre les Maures et qui avait déjà donné de si bons résultats. D'ailleurs, préoccupé par sa guerre contre les infidèles, le roi espérait, en arrêtant la croisade contre les hérétiques, attirer en Espagne le flot de croisés qui se déversait chaque année sur le Midi de la France, et dont il avait pu apprécier la force combative.
Le pape, d'abord influencé par les émissaires du roi, avait écrit à Simon de Montfort une lettre des plus sévères: "L'illustre roi d'Aragon nous fait remontrer... que non content de t'être élevé contre les hérétiques, tu as porté les armes des croisés contre des populations catholiques; que tu as répandu le sang des innocents et envahi à leur préjudice les terres des comtes de Foix et de Comminges et de Gaston de Béam, ses vassaux, quoique les peuples de ces terres ne fussent nullement suspects d'hérésie... Ne voulant donc pas le (le roi) priver dans ses droits ni le détourner de ses louables desseins, nous t'ordonnons de restituer à lui et à ses vassaux toutes les seigneuries que tu as envahies sur eux, de crainte qu'en les retenant injustement on ne dise que tu as travaillé pour ton propre avantage, et non pour la cause de la foi95..." Les indulgences octroyées aux pèlerins qui prennent la croix contre les hérétiques sont annulées et "transportées aux guerres contre les païens ou au secours de la Terre Sainte".
Pendant que le pape écrivait ses lettres, les légats tenaient un concile à Lavaur, où le roi, invité à présenter la défense du comte de Toulouse, se voit lui-même menacé d'excommunication par Arnaud-Amaury. Pour la cause de l'Église dans le Languedoc il importe à tout prix de ne laisser aucune possibilité au comte de rentrer dans ses droits, en principe ni en fait; les légats préfèrent courir le risque - pourtant terrible - d'une guerre contre le roi d'Aragon.
À lire leurs lettres, les comptes rendus des conciles et la chronique de P. des Vaux de Cernay, il semble que la vie même de l'Église dans le Midi dépend de l'élimination du comte de Toulouse. C'est que, mieux informés de la situation que le pape et que le roi d'Aragon, ils savent que cet homme en apparence pacifique, conciliant, prêt à toutes les soumissions, est bien, pour l'Église, le "lion rugissant" dont ils parlent dans leurs lettres; leur acharnement ne s'explique que par la connaissance qu'ils ont du caractère du comte, et ils l'ont mieux jugé que ne l'ont fait la plupart des historiens des siècles suivants. Ce "protecteur des hérétiques" était fermement décidé à le rester jusqu'au bout, contre vents et marées: qu'il ait agi ainsi par sympathie personnelle, ou plus vraisemblablement par esprit de justice, Raymond VI représentait pour les hérétiques une garantie de sécurité, un appui sûr. Là-dessus il ne fléchira jamais. Ce "faible" semble n'avoir été qu'un diplomate souple, réaliste, extrêmement tenace et difficile à intimider. Raymond VI comprenait peut-être mieux que personne que l'Église était une puissance pratiquement invincible, contre laquelle on ne pouvait lutter que par une soumission aussi spectaculaire que possible. Il ne renoncera à cette attitude de soumission que le jour où ses peuples catholiques verront dans sa cause la cause de Dieu et du bon droit.
III - LE ROI D'ARAGON
Ayant entraîné le roi d'Aragon dans une entreprise qui, au grand scandale de l'opinion publique, faisait du très catholique Pierre II le protecteur de l'hérésie, le comte de Toulouse pouvait espérer, non sans raison, que la guerre qu'on lui faisait changerait enfin de visage; une "guerre sainte", menée contre une hérésie dont les belligérants eux-mêmes semblaient ne plus se soucier, deviendrait une pure et simple guerre de conquête, menée par un aventurier sans scrupules sur une terre chrétienne et entretenue par quelques prélats ambitieux.
Le pape a pu un instant balancer. Détrompé par les légats qui n'ont pas craint, il faut le croire, de noircir le tableau pour se justifier, Innocent III fait volte-face, morigène l'orgueilleux roi d'Aragon comme un enfant indiscipliné, et ajoute (lettre du 21 mai 1213): "Tels sont les ordres auxquels Ta Sérénité est invitée à se conformer exactement, faute de quoi... nous serions obligés de te menacer de l'indignation divine et de prendre contre toi des mesures qui te causeraient un grave et irréparable détriment".
Pierre II, offensé, peut-être outré de l'ingratitude d'un pape qu'il a toujours si fidèlement servi (et d'autant plus mécontent qu'Innocent III a refusé de donner suite au procès de divorce qu'il avait engagé contre sa femme, Marie de Montpellier), ne tient aucun compte de cette menace. Il a déjà commencé ses préparatifs de guerre, sachant bien que Montfort ne peut être réduit que par la force. À Toulouse, où il concentre ses troupes, il reçoit la lettre du pape, promet pour la forme d'obéir, mais ne songe pas à abandonner ses alliés.
Les forces du roi d'Aragon, unies à celles des barons occitans, sont très supérieures à celles de Montfort et, dans sa sagesse d'homme de guerre, Pierre II doit se dire qu'en fin de compte, c'est toujours le vainqueur qui a raison. "Il a mandé, dit la "Chanson", toute la gent de sa terre, si bien qu'il a rassemblé grande et belle compagnie. À tous, il a déclaré qu'il veut aller à Toulouse combattre la croisade qui dévaste et détruit toute la contrée. Le comte de Toulouse lui a demandé merci, que sa terre ne soit ni brûlée ni ravagée, car il n'a tort ni faute envers personne au monde96".
Pierre II retourne donc à Barcelone où il lève une armée de mille chevaliers; les meilleurs guerriers d'Aragon et de Catalogne participeront à cette campagne. Il faut croire que le roi, qui est un "glorieux" (comme on dirait au XVIIe siècle), voit dans cette guerre autre chose qu'une occasion de mettre la main sur le Languedoc; c'est la gloire de la chevalerie occitane humiliée par les Français du Nord que le roi et ses chevaliers vont défendre, la liberté de leurs frères et la cause de "Parage" - "courtoisie" en langue d'oc. Ce mot, dont le sens, comme celui de tant d'autres, s'est singulièrement affaibli et rétréci avec les siècles, évoquait à l'époque les plus hautes valeurs morales de la société laïque: le plus grand éloge que l'amant le plus exalté pût faire de sa dame était de dire qu'elle est "courtoise"; et les chevaliers que le continuateur de Guillaume de Tudèle fait parler, dans sa "Chanson", invoquent sans cesse "Parage" à l'égal d'une divinité.
Les chansons des troubadours rendent compte de cet état d'esprit. Qu'il l'ait voulu ou non, c'est bien pour l'existence d'une civilisation, d'une tradition nationale que le roi luttait. "...Alors, dames et amants pourront recouvrer la joie qu'ils ont perdue", chante Raymond de Miraval en faisant des vœux pour la victoire de Pierre II. On se demande ce que viennent faire les dames et leurs amants dans cette sanglante aventure et il est évident qu'il s'agit là de bien autre chose que de familles séparées et de chevaliers condamnés à l'exil: c'est tout un mode de vie qui est menacé de destruction, un mode de vie où l'amour courtois, avec ses fastes, ses raffinements, sa mystique audacieuse et son héroïque démesure, servait de symbole aux aspirations d'une société avide de liberté spirituelle.
Selon G. de Puylaurens97, Simon de Montfort aurait, la veille de la bataille de Muret, intercepté une lettre du roi d'Aragon à une noble Toulousaine, lettre dans laquelle le roi affirmait qu'il n'était venu chasser les Français que pour l'amour d'elle. Si cette lettre n'était pas - comme le croit Moline de Saint-Yon dans son Histoire des comtes de Toulouse - adressée par Pierre II à une de ses sœurs (le roi, en bon féodal, prenait à cœur les intérêts de sa famille et n'en faisait nul mystère), un détail de ce genre ne constituerait pas uniquement une preuve de la frivolité du roi d'Aragon: selon les lois de la tradition courtoise, c'était un honneur pour un chevalier que de pouvoir faire à la dame de ses pensées l'hommage d'une grande action accomplie en son nom. Et, en supposant même que les intentions secrètes de Pierre II n'aient pas été purement chevaleresques, ce qui nous intéresse, c'est l'atmosphère dans laquelle se déroulaient les préparatifs de cette campagne; et il est certain que, tant dans l'entourage du roi d'Aragon que dans le camp de ses alliés, les combattants avaient conscience de lutter pour une belle cause, pour "Parage", pour la civilisation (bien que le mot soit anachronique) contre la barbarie des gens du Nord. Il faut avouer que Simon de Montfort ne donnait pas à ses adversaires une bien flatteuse idée des qualités morales de la chevalerie française; mais, ce qui est significatif, c'était l'Église catholique qui se trouvait à présent dans le camp des barbares.
Quand, effrayés par l'importance de l'armée qui se préparait à marcher sur eux, les évêques qui accompagnent Montfort tenteront de négocier, le roi refusera de les recevoir, déclarant que des prélats escortés d'une armée n'ont nul besoin de sauf-conduits: il ne pouvait leur faire sentir plus clairement le mépris que lui inspirait cette guerre qui prétendait sans cesse profiter de son équivoque "sainteté". Il n'avait pas engagé tous ses biens et amené devant Toulouse la fleur de sa chevalerie pour s'entendre dire qu'en combattant Simon de Montfort, il combat le Christ en personne.
C'était pourtant ce que croyaient, ou voulaient croire, ses adversaires. Montfort lui-même est intimidé, car en ce moment - septembre 1213 - il ne dispose, en plus de sa vieille garde, que d'assez faibles renforts amenés par les évêques d'Orléans et d'Auxerre; et l'armée coalisée compte plus de 2000 chevaliers, plus environ 50000 fantassins recrutés surtout dans le Languedoc, routiers et milices de citadins, en particulier des Toulousains et des Montalbanais.
Entré à Toulouse en triomphateur, acclamé, fêté, Pierre II se prépare à marcher sur Montfort et va planter ses bannières devant Muret, "château noble, mais d'ailleurs assez faible et qui, malgré ses minces fortifications, était défendu par 30 chevaliers et quelques gens de pied de Montfort" (P. des Vaux de Cernay). Le siège commence le 30 août: Montfort, informé, accourt, à la tête de ses troupes. En route, sentant la gravité de l'heure, il s'arrête à l'abbaye cistercienne de Bolbonne et consacre son épée à Dieu: "Ô bon Seigneur! Ô bénin Jésus! Tu m'as choisi, bien qu'indigne, pour conduire ta guerre. En ce jour, je prends mes armes sur ton autel, afin que, combattant pour toi, j'en reçoive justice en cette cause98". Manifestation de piété bien opportune: à défaut de confiance en sa force numérique, son armée avait besoin de l'exaltation que donne la certitude de se battre pour Dieu.
Mais, comme nous l'avons vu, les évêques (ceux d'Orléans et d'Auxerre et Foulques, l'évêque fugitif de Toulouse, à présent compagnon inséparable des croisés) n'espèrent guère de miracle et tentent de fléchir le roi, après avoir solennellement re-excommunié leurs adversaires (parmi lesquels le roi d'Aragon n'est pas nommément cité). C'est Montfort qui coupe court aux pourparlers, sachant qu'ils n'aboutiront à rien.
Le 12 septembre, la bataille est livrée. Simon sait que son armée ne peut courir le risque d'être encerclée et, refoulé dans le château de Muret, il lui faut tenter de diviser les adversaires par une attaque foudroyante. "...Si nous ne pouvons pas les éloigner des tentes, nous n'avons qu'à fuir tout droit99", dit-il à son conseil de guerre.
Or, les alliés avaient solidement établi leur camp sur les hauteurs qui dominent la plaine, à trois kilomètres environ du château situé sur le bord de la Garonne. Raymond VI, qui connaissait l'ennemi, proposa d'attendre l'attaque dans le camp, de la repousser d'abord par un tir d'arbalétriers, pour contre-attaquer ensuite et encercler l'adversaire dans le château, où il ne manquerait pas de capituler rapidement; le conseil était bon, mais il ne fut pas suivi. Le comte de Toulouse jouait de malchance: dans cette guerre où il était le principal intéressé et la principale victime, pour une fois qu'il avait la possibilité de prendre sa revanche, il n'avait pas droit à la parole. Les familiers du roi (en particulier Michel de Luezia) tournèrent son plan en dérision et l'accusèrent de lâcheté. Ulcéré, Raymond VI se retire sous sa tente.
En abandonnant son camp fortifié et en perdant ainsi le contrôle des opérations, Pierre II comble donc les vœux de Simon de Montfort. Le roi-chevalier veut une belle bataille où son armée puisse se mesurer en vaillance avec l'invincible chevalerie française qui jusque-là, croit-il, n'a pas rencontré d'adversaire à sa taille. C'est en rase campagne qu'il veut l'écraser; et lorsque Simon attaque, les troupes du comte de Foix se lancent les premières à sa rencontre, mais doivent bientôt plier sous l'impétuosité de la charge des Français. Pierre II avec ses Aragonais se jette à son tour dans le combat.
Simon, qui ne dispose que de 900 chevaliers contre 2000, manœuvre avec une grande rapidité, de façon à ne pas laisser à l'armée ennemie le temps de se regrouper, et à garder, de cette façon, l'avantage numérique dans chacune de ses attaques: il concentre tous ses efforts sur les troupes aragonaises et les deux corps d'armée se lancent l'un contre l'autre dans un choc terrible. "On entendait, dira plus tard le jeune Raymond VII, comme une forêt d'arbres qui s'abattent sous des coups de hache100". C'est une mêlée inextricable, où lances, écus volent en éclats, où les chevaux s'abattent, piétinant les cavaliers, les épées taillent, coupent, résonnent sur l'acier des casques, où les massues fracassent les têtes, le tonnerre des armes couvre les cris de guerre. Ce ne fut pourtant pas une grande bataille, mais plutôt un engagement très vif entre deux avant-gardes relativement peu nombreuses. Le malheur voulut qu'à la tête de l'une d'elles se trouvât justement le roi.
Le but de Simon de Montfort était d'atteindre le roi à tout prix: deux de ses chevaliers, Alain de Roucy et Florent de Ville, ont fait le serment solennel de tuer le roi ou de mourir. Or, Pierre II, faisant preuve de plus de bravoure que d'habileté, s'est lancé à corps perdu dans la mêlée; il a même, avant le combat, changé d'armures avec un de ses chevaliers: c'est en simple chevalier et avec la seule force de ses armes que Pierre II voulait affronter Simon de Montfort.
Pierre II a trente-neuf ans; il est grand de taille, d'une force herculéenne et passe pour le plus vaillant chevalier de son pays. Alain de Roucy, étant parvenu à se frayer un passage jusqu'au chevalier porteur de l'armure royale, le renverse du premier coup et s'écrie: "Ce n'est pas le roi! Le roi est meilleur chevalier". Voyant cela, Pierre II crie: "Le roi, le voici!" et s'élance au secours de son compagnon101. Alain de Roucy et Florent de Ville, avec leurs hommes, l'entourent de tous côtés, ne le lâchent plus, et bientôt autour du roi s'engage un combat si acharné que Pierre II est tué et que toute sa maynade (chevaliers de la maison d'Aragon) se fait tuer sur place plutôt que de reculer et d'abandonner le corps du roi.
La nouvelle de la mort du roi répand la panique dans les autres corps d'armée; surpris par une attaque de flanc de Montfort, les chevaliers catalans prennent la fuite; l'armée du comte de Toulouse n'a pas encore eu l'occasion d'intervenir et, se voyant débordée par le flot des Aragonais et des Catalans qui reculent en désordre, elle ne peut songer à attaquer et fuit également.
Pendant que la cavalerie est ainsi mise en déroute, la piétaille, composé de milices toulousaines, tente l'assaut du château de Muret; à ce moment-là, une partie de la cavalerie française, abandonnant la poursuite des vaincus, revient vers le château et tombe en masse sur les fantassins (ils étaient près de 40000), les taille en pièces et les refoule vers la Garonne; l'eau est profonde en cet endroit et le courant rapide, une grande partie des fuyards se noie. Par le carnage et la noyade 15000 à 20000 hommes périssent, soit la moitié de l'infanterie.
La victoire de Montfort est donc totale. C'est mieux qu'une victoire: c'est l'élimination, du moins provisoire, de l'Aragon en tant que puissance politique. La mort de Pierre II laisse sur le trône un enfant en bas âge, retenu en otage par le vainqueur.
Simon, la bataille terminée, fait chercher le corps du roi, qu'il a grand-peine à retrouver, son infanterie ayant déjà complètement dépouillé les cadavres. L'ayant fait reconnaître, il lui rend un dernier hommage, puis se déchausse et, abandonnant aux pauvres son cheval et ses armes, va à l'église pour remercier Dieu. Il est non seulement débarrassé de son plus puissant adversaire, en quelques heures d'échauffourée d'où son armée se tire avec assez peu de pertes, mais il a abattu un des grands rois de la chrétienté sans que personne puisse lui imputer à crime cette mort si opportune: la bataille de Muret faisait l'effet d'un jugement de Dieu.
Les évêques et les clercs - parmi lesquels se trouvait saint Dominique - rassemblés dans l'église de Muret avaient, dans le fracas de la bataille, prié ardemment pour la victoire; voyant leurs prières si bien exaucées, ils allaient, à présent, répandre par toute la chrétienté la grande nouvelle: les forces hérétiques balayées "comme le vent balaie la poussière à la surface du sol" (G. de Puylaurens); un roi catholique, qui a osé prendre la défense des ennemis de la foi, tué avec toute sa chevalerie, une armée immense anéantie en quelques heures par une poignée de croisés dont (miracle) les pertes se chiffrent à quelques sergents et un chevalier! (Exagération manifeste: le combat, d'après tous les témoignages, avait été chaud et Pierre II et sa maynade n'avaient pas dû se laisser égorger comme des agneaux; d'autre part, les troupes du comte de Foix et les Aragonais étant les seuls à s'être battus, les forces qui se sont affrontées étaient sensiblement égales; le génie stratégique de Simon, et surtout son courage quelque peu cruel d'ordonner le meurtre du roi, avaient empêche le reste de l'armée d'intervenir à temps et les deux tiers des troupes coalisées avaient quitté le champ de bataille sans avoir combattu).
Ce qui est certain, c'est que la mort du roi d'Aragon frappa de désolation tout le Languedoc; ce libérateur hier encore tant acclamé, qui venait de traverser le pays à la tête de sa superbe chevalerie toute étincelante de l'éclat de ses armes, toute prête au combat, s'est révélé un appui si fragile que Montfort, dès le premier choc, a pu l'anéantir.
Les princes alliés, désemparés, s'accusant mutuellement de trahison, se retirent sans chercher à rassembler leurs forces pour prendre leur revanche; les Espagnols repassent les monts, les comtes de Foix et de Comminges rentrent dans leurs terres, le comte de Toulouse et son fils quittent leur pays et se réfugient en Provence. La victoire de Muret a livré à Montfort et à l'Église un pays non pas encore vaincu, mais démoralisé par l'effondrement trop brutal d'un grand espoir.
Tous comptes faits, c'est la ville de Toulouse qui aura, dans cette affaire, payé le plus lourd tribut en vies humaines - et de loin. L'attaque forcenée de la chevalerie française contre l'infanterie toulousaine a été une tuerie plutôt qu'une bataille et, si les Français avaient à venger deux des leurs (Pierre de Cissey et Roger des Essarts, vieux compagnons de Montfort, amenés prisonniers à Toulouse et cruellement torturés avant d'être achevés), Toulouse, "où il n'y a guère de maison qui ne pleurât quelqu'un", n'oubliera pas les massacrés et les noyés de Muret. Au lendemain de sa victoire, Simon ne marchera pas sur la capitale. Il semble bien que la ville immense, même désolée, désemparée, abandonnée par ses défenseurs, représente pour le vainqueur sinon un danger, du moins une source d'ennuis qu'il ne se sent pas encore de taille à affronter.
Les évêques y entreront, Foulques en tête; ils essaient de négocier la soumission de la ville; les consuls font traîner les pourparlers en longueur, discutent sur le nombre des otages et finissent par refuser de se soumettre. Montfort, cependant, passe le Rhône, poursuivant la conquête et la soumission méthodique des domaines du comte et attendant que, les autres provinces domptées, Toulouse lui tombe entre les mains comme un fruit mûr.
Au cours des dix-huit mois qui suivirent la spectaculaire défaite des forces méridionales, Simon de Montfort put croire que la guerre était pratiquement terminée; les résistances qu'il allait rencontrer devaient être rares et assez rapidement matées. Il se heurte, cependant, à une hostilité sourde et systématique qui ne devait pas lui laisser beaucoup d'illusions: Narbonne lui ferme ses portes, Montpellier en fait autant, Nîmes ne le reçoit que sous la menace de représailles; en Provence, où il poursuit son plan d'occupation progressive des domaines du comte de Toulouse, la noblesse du pays se soumet d'assez mauvaise grâce; Narbonne se soulève et Simon, à l'aide de croisés amenés par son beau-père Guillaume des Barres, parvient à repousser l'attaque des révoltés, mais non à emporter la place, car le cardinal-légat Pierre de Bénévent s'entremet et obtient une trêve.
À Moissac, les bourgeois se révoltent et Raymond VI vient assiéger la ville, tenue par une garnison française; mais le comte se retire à l'approche de Montfort. Remontant dans le Rouergue, l'Agenais, puis le Périgord, Simon procède au démantèlement des châteaux qui lui ont résisté, enlève, après trois semaines de siège, le château de Casseneuil, puis le château de Montfort, celui de Capdenac; puis Séverac, place forte inexpugnable, citadelle d'une des plus vieilles familles du Rouergue; le comte de Rodez prête serment au vainqueur de Muret, sans enthousiasme et alléguant qu'une partie de ses domaines dépend du roi d'Angleterre.
Ayant, du Périgord à la Provence, obtenu l'hommage de la plus grande partie des vassaux directs et indirects du comte de Toulouse, Simon de Montfort eût égalé en puissance les plus grands barons de la chrétienté, si tous les serments de fidélité qu'il avait reçus avaient été pris au sérieux par ceux qui les prêtaient. À lire l'histoire de ses campagnes on eût pu la croire embellie par quelque panégyriste peu soucieux de la vérité; et pourtant les auteurs de la "Chanson" (qui n'étaient pas de ses amis), les lettres des légats, du pape, du roi de France, tous les témoignages concordent pour attester ce fait peu croyable à priori: depuis 1209 Simon de Montfort n'a pas subi un seul échec réel, et est allé pendant cinq ans de victoire en victoire avec une constance presque lassante. On imagine l'exaspération résignée de ses adversaires devant l'invariable bonne fortune de cet homme, qui, protégé par Dieu ou par le diable, semblait décidément doué de quelque pouvoir surhumain.
La haine qu'il inspirait - et dont bénéficiaient du même coup tous les Français - grandissait sans que sa puissance en parût diminuée; les massacres de garnisons étaient réprimés avec une cruauté telle qu'ils devenaient rares, mais en laissant les occupants faire la loi chez eux, les gens du Midi devaient se dire qu'ils ne perdaient rien pour attendre. Ce que pouvait être la violence des passions que cette guerre avait déchaînées, seuls quelques indices, quelques faits rapportés un peu au hasard par les chroniqueurs le suggèrent; les actes officiels enregistrent pacifications et soumissions, les vainqueurs cherchent déjà à régler les conflits par voie diplomatique, et à se partager un pays où ils ne se maintiennent qu'à titre d'occupants provisoires. Le poète de la "Chanson" attribue à Philippe Auguste des mots qu'il n'a peut-être pas prononcés, mais qui expriment fortement les désirs des populations du Midi en ces années noires: "Seigneurs, j'ai encore espérance qu'avant qu'il ne tarde guère, le comte de Montfort et son frère le comte Guy mourront à la peine..."
En attendant, c'est la papauté, en la personne du nouveau légat Pierre de Bénévent, qui entend organiser la conquête; et, devant les prétentions croissantes de Montfort et la haine implacable qu'il inspire partout, essaie de se désolidariser dans la mesure du possible de cet encombrant auxiliaire. D'un autre côté, ce sont les évêques du pays qui sont les plus grands partisans de Simon, car sa présence leur assure la sécurité et des avantages matériels que le comte n'eût jamais songé à leur accorder, et les légats doivent user de ménagements envers le seul homme capable de défendre par les armes les droits de l'Église. C'est Robert de Courçon, cardinal-légat de France, qui confirme Montfort dans la possession des pays qu'il a conquis: l'Albigeois, l'Agenais, le Rouergue et le Quercy, terres relevant indirectement de la suzeraineté de Philippe Auguste. Il est à noter que le roi lui-même semble tout ignorer de cette affaire: au lendemain de Bouvines, il a bien d'autres préoccupations, et ne se prononcera que le jour où la situation de Simon lui paraîtra assez solidement établie.
Pierre de Bénévent, de son côté, entreprend de soumettre à l'Église les possesseurs légitimes des terres que Montfort s'est octroyées par le droit de conquête: Raymond-Roger, comte de Foix, Bernard, comte de Comminges, Aimery, vicomte de Narbonne, Sanche comte de Roussillon, les consuls de Toulouse, enfin le comte de Toulouse lui-même viennent faire leur soumission totale au légat et à l'Église, promettent de combattre l'hérésie sur leurs terres, de faire pénitence, de ne pas attaquer les terres conquises par les croisés (Narbonne, avril 1214). Le comte de Toulouse consent à abandonner ses domaines et à abdiquer en faveur de son fils. Abdication de pure forme, le jeune Raymond étant entièrement dévoué à son père et prêt à lui obéir en tout.
Le comte multiplie les témoignages de son obéissance et de sa soumission dans l'espoir d'ôter à l'Église tout prétexte de le déposséder. Et pendant que Montfort s'installe en maître dans le Languedoc, Raymond se proclame toujours seigneur légitime de ces provinces, qu'il met à la disposition du pape: "En sorte que tous mes domaines soient soumis à la miséricorde et au pouvoir absolu du souverain pontife de l'Église romaine..." Ni lui ni le comte de Foix ne se départent de cette tactique, habile sinon efficace: traiter Montfort en usurpateur tout en reconnaissant la souveraineté de l'Église.
Le cardinal-légat accepte cette soumission, ce qui, après tout, constitue une négation implicite des prétentions de Montfort. Cette acceptation semble même une telle atteinte aux droits du vainqueur de Muret que ses partisans, dont P. des Vaux de Cernay se fait l'écho, n'expliquent l'attitude de Pierre de Bénévent que comme une pieuse fraude destinée à endormir les soupçons du comte. "O legati fraus pia! O pietas fraudulenta102!" s'exclame l'historien, sans nulle ironie. Ce singulier catholique fait preuve à maintes reprises d'une assez savoureuse amoralité. Si les chefs de l'Église n'avaient guère plus de scrupules (leur conduite le montre assez) ils avaient peut-être des craintes d'une autre nature, et pouvaient penser qu'un Simon de Montfort risquait, par ses excès, de nuire à la cause de l'Église, et, par son ambition, de restreindre sa puissance temporelle.
En décembre 1213, Simon avait arrangé le mariage de son fils aîné, Amaury, avec Béatrix, fille unique d'André de Bourgogne, héritière du Dauphiné; ses visées politiques et dynastiques deviennent de plus en plus évidentes.
Et tandis que ses adversaires se plaignent de lui en cour de Rome, et proclament (souvent contre toute évidence) que ni eux ni leurs terres n'ont jamais été suspects d'hérésie, Montfort, et les évêques du pays qui le soutiennent, voient l'hérésie (ou, à défaut d'hérésie, les routiers) partout où ils veulent établir leur domination.
Le concile de Montpellier (janvier 1215), présidé par Pierre de Bénévent, réglera (provisoirement) la situation, dans l'attente du concile œcuménique qui doit être tenu à Rome, la même année. En présence des archevêques de Narbonne, d'Auche d'Embrun, d'Arles et d'Aix, de vingt-huit évêques et de nombreux abbés et clercs, le légat propose de désigner celui "à qui mieux et plus utilement, pour l'honneur de Dieu et de notre sainte mère l'Église, pour la paix de ces contrées, la ruine et l'extermination de l'hérétique vilenie, il convient de concéder et assigner Toulouse que le comte Raymond a possédée, aussi bien que les autres terres dont l'armée des croisés s'est emparée103". Les prélats consultés désignent, d'une seule voix, Simon de Montfort; cette unanimité ne surprend que Pierre des Vaux de Cernay enclin à voir partout le doigt de Dieu. Or, l'homme à qui il "convenait" de tenir Toulouse et toutes les autres terres était si unanimement détesté qu'il ne pouvait assister en personne au concile: les habitants de Montpellier (ville catholique et en principe neutre) lui en avaient interdit l'accès, et il fut si bien accueilli, le jour où il tenta d'y entrer avec le légat, qu'il dut se sauver en hâte par une autre porte.
La décision du concile dépossédait le comte de Toulouse et son fils, mais ne conférait à Simon que le titre assez vague de "seigneur et chef unique" (dominas et monarcha), une espèce de lieutenant de la papauté, chargé de faire la police dans les États conquis. Il voulait davantage. Cependant, le comte de Toulouse, appuyé par son beau-frère, par l'oncle de son fils, Jean sans Terre, attendait la réunion du concile œcuménique pour faire valoir ses droits.
Épisode significatif de la guerre sourde et inlassable qui était menée dans le pays, derrière le dos des prélats occupés à légiférer et de Simon occupé à affermir les bases de sa domination: en février 1214 Baudouin de Toulouse, ce frère de Raymond VI qui s'était rallié à Montfort, est victime d'un complot, ou plutôt d'un coup de main dont tous les acteurs semblent avoir participé à l'affaire avec une égale certitude d'accomplir leur devoir de patriotes. Et cependant Baudouin fut capturé et livré par des seigneurs qui avaient fait en bonne et due forme leur soumission à Montfort. Baudouin de Toulouse avait reçu de Simon les terres du Quercy, venait en prendre possession, et s'était arrêté au château de l'Olme, près de Cahors. Le châtelain le livre à Ratier de Castelnau après avoir fait massacrer son escorte; il est emmené à Montauban, où il attendra le jugement de son frère, qui, prévenu, accourt aussitôt accompagné du comte de Foix.
Le "comte" Baudouin, ce traître à la cause de son pays, avait été élevé à la cour du roi de France, et était en fait plus Français que Toulousain, ce qui explique sa conduite sans l'excuser; né en France, à une époque où son père s'entendait fort mal avec son épouse Constance de France (dont il devait ensuite se séparer), Baudouin ne vint à Toulouse qu'en 1194, après la mort de Raymond V, et son frère le reçut de telle façon que le jeune homme fut obligé de retourner à Paris chercher des lettres prouvant qu'il était bien le fils du comte de Toulouse! Les deux frères, séparés d'ailleurs par une grande différence d'âge, s'entendaient assez mal, Baudouin était traité en parent pauvre et devait se sentir plutôt dépaysé à la cour de son frère. Il était cependant un vaillant chevalier, et avait brillamment défendu contre Montfort le château de Montferrand. Mais, passé du côté de l'ennemi, il devait rester fidèle jusqu'au bout à ses nouveaux maîtres.
Quoi qu'il en soit, pour ce frère aussi malheureux qu'indigne Raymond VI ne montre aucune pitié: arrivé à Montauban, il tient un conseil de guerre où assistent le comte de Foix et le chevalier catalan Bernard de Portella, et condamne sans hésiter le traître à la pendaison. Comme Baudouin, bon catholique, demande à recevoir les sacrements avant de mourir, son frère lui fera répondre qu'un homme qui a si bien combattu pour sa foi n'a guère besoin d'absolution. Il peut cependant se confesser, mais non recevoir la communion, et, conduit dans un pré devant le château, est pendu sous les yeux de son frère à un noyer, par le comte de Foix lui-même, assisté dans son office de bourreau par Bernard de Portella, qui en exécutant le traître veut venger la mort du roi d'Aragon.
Cette cruelle histoire montre que Raymond VI, qui deux mois plus tard offrira avec tant d'humilité sa personne et ses biens à l'Église, n'était nullement disposé à renoncer à la lutte, et ne faisait qu'attendre son heure, frappant partout où il pouvait frapper. En faisant froidement exécuter son frère pour satisfaire la haine patriotique de ses vassaux, il semble obéir au même instinct politique qui lui fera, devant le pape, protester de son dévouement à l'Église. Cet homme déconcertant sut se faire aimer parce qu'il est toujours resté le premier serviteur plutôt que le maître de son pays.
Le châtiment de Baudouin provoqua dans le Languedoc une explosion de joie, et inspira des chants de triomphe aux troubadours.
Cependant, Simon de Montfort, désigné par le concile de Montpellier pour tenir "Toulouse et les autres terres que le comte a possédées", n'ose pas encore se présenter dans Toulouse. Toulouse, la clef du Languedoc, fait encore mine d'ignorer le nouveau suzerain. Simon n'y entrera qu'accompagné d'un personnage dont le rang et la qualité peuvent légitimer, en quelque sorte, une soumission qu'on eût refusée à Montfort.
Philippe Auguste, depuis Bouvines, n'a plus à craindre les "deux lions", Jean sans Terre et l'Empereur, qui menaçaient ses provinces du Nord, et se décide enfin à s'intéresser à ce qui se passe dans le Midi. Les domaines du comte de Toulouse, où sa puissance a toujours été purement nominale, font partie des terres dépendantes de la couronne de France. Le jour où il croit le conflit réglé par la victoire de Montfort, il s'inquiète de savoir si l'Église n'a pas dépassé ses droits en attribuant à un de ses vassaux une terre dont il est le suzerain. Il se garde bien d'y paraître en personne, pour n'être pas amené à appuyer de son autorité une entreprise dont il ignore encore les avantages et les difficultés à venir. Il envoie, ou plutôt laisse partir, son fils qui depuis longtemps manifestait le pieux désir de participer à la croisade.
Le prince Louis fera, dans un pays théoriquement pacifié, un "pèlerinage" et non une expédition militaire. Il amène avec lui de nombreux chevaliers, en particulier les comtes de Saint-Pol, de Ponthieu, de Sées et d'Alençon et son armée, même si elle ne vient pas dans des intentions délibérément belliqueuses, est destinée à impressionner ceux des barons occitans qui pourraient vouloir s'opposer à l'autorité royale. Pour le moment, personne ne songe à s'y opposer: auprès de Montfort le diable même eût paru un bon maître, à plus forte raison le "doux et débonnaire" Louis. Il ne semble pas que le prince, lors de cette croisade pacifique, ait été mal accueilli; on l'attendait plutôt comme arbitre.
Le légat s'empresse de faire savoir à Louis qu'il "ne devait ni ne pouvait porter aucune atteinte104" à ce qui avait été réglé par les conciles, étant donné le fait que les forces de l'Église avaient triomphé seules, et sans le moindre secours (maintes fois sollicité cependant) du roi de France. En fait, Louis, très pieux, n'entreprends rien contre les décisions de l'Église, mais dans les différends qui surviennent donne plutôt raison à Montfort.
Ainsi, dans la querelle qui oppose Arnaud-Amaury, archevêque de Narbonne, à Simon de Montfort, le prince soutient ce dernier et ordonne la démolition des murailles de Narbonne, que l'archevêque, d'accord avec les consuls, voudrait conserver. De même, Louis ordonne de faire abattre les murailles de Toulouse qui, bien que relevant provisoirement de l'autorité de l'Église, devait se préparer à recevoir son nouveau maître. Le pape, apprenant que le fils du roi de France, à la tête d'une armée, arrivait en inspection sur des terres conquises par l'Église, s'était empressé de confirmer à Simon de Montfort "la garde" de ces terres, de peur que ce dernier, se désolidarisant de l'autorité de Rome, ne se fit octroyer le titre de comte par son suzerain légitime.
Enfin, en mai 1215, le prince Louis, le légat et Montfort entrent dans Toulouse d'où le comte était parti, n'ayant nulle envie d'orner le triomphe du vainqueur. Il fut établi que les fossés de la ville seraient comblés, les tours et les murs et les retranchements rasés jusqu'aux fondements; "que nul défenseur ne puisse s'y défendre avec aucune armure". Désarmée par avance et devenue ville ouverte au sens propre du mot, Toulouse n'avait plus qu'à laisser entrer le vainqueur et Montfort s'y installa aussitôt et conserva les fortifications du château narbonnais dont il fit sa résidence. Le prince Louis se retira, sa quarantaine finie, emportant comme trophée de cette pieuse expédition une moitié de la mâchoire de saint Vincent, qu'on vénérait à Castres: pour remercier le prince de sa bienveillance, Simon s'était chargé d'obtenir des religieux de Castres cette précieuse relique, qui lui fut cédée "en considération de l'utilité et de l'avancement qu'il avait procuré dans l'affaire de Jésus-Christ". (Il en garda l'autre moitié pour lui-même et en fit don à l'église de Laon).
71 Op. cit., XXXV, 800-802.
72 Pierre des Vaux de Cernay, op. cit., ch. XIX.
73... Un jour, raconte P. de Vaux de Cernay (Simon est, à ce moment-là, assiégé dans Castelnaudary), notre comte sortant du château s'avançait pour avarier la susdite machine; et comme les ennemis l'avaient entourée de fossés et de barrières, tellement que nos gens ne pouvaient y arriver, ce preux guerrier, ci veux-je dire le comte de Montfort, voulait, tout à cheval, franchir un très large fossé et très profond afin d'aborder hardiment cette canaille. Mais, voyant quelques-uns des nôtres, le péril inévitable où il allait se jeter s'il faisait ainsi, ils saisirent son cheval par la bride et le retinrent pour l'empêcher de s'exposer... Op. cit., ch. LVI.
74 Pierre des Vaux de Cernay, op. cit., ch. LXXXVI.
75 Guillaume de Puylaurens, ch. XIX.
76 Pierre des Vaux de Cernay, op. cit., ch. XXXIV.
77 Pierre des Vaux de Cernay, op. cit., ch. XXXVII.
78 Ibid.
79 Pierre des Vaux de Cernay, op. cit., ch. XXXX.
80 Pierre des Vaux de Cernay, op. cit., ch. XXXIII.
81 Lettre d'Innocent III à l'abbé de Cîteaux.
82 Pierre des Vaux de Cernay, op. cit., ch. XXXIX.
83 "Chanson de la Croisade", ch. LIX, 1360-1366.
84 Pierre des Vaux de Cernay, op. cit., ch. XXXXVII.
85 "Chanson de la Croisade", ch. LXVIII, 1552-1553.
86 Id, 1560-1561.
87 Guillaume de Puylaurens, ch. XI.
88 Guillaume de Puylaurens, ch. XI.
89 Pierre des Vaux de Cernay, ch. LI.
90 "Chanson de la Croisade", ch. LIX, 1360-1366.
91 16 juillet 1212.
92 Lettre d'Innocent III au roi d'Aragon, 21 mai 1213.
93 Cronica o commentari del rey en Jac me (Nouv. éd. de Barcelone).
94 Lettre des consuls de Toulouse, Pierre des Vaux de Cernay, op. cit. Appendice n° 4.
95 Lettre d'Innocent III à Simon de Montfort, 15 janvier 1213.
96 Op. cit., ch. CXXXI, 2756-2765.
97 Guillaume de Puylaurens, ch. XXI.
98 Pierre des Vaux de Cernay, op. cit., ch. LXXXI.
99 "Chanson de la Croisade", ch. CXXXIX, 3046-3047.
100 Guillaume de Puylaurens, ch. XXII.
101 Cf. l'édition originale de l'"Histoire du Languedoc" de Dom Vaissette, t. III, p. 252, et la note d'A. Molinier dans l'édition de 1879, t. VI, p. 427.
102 Pierre des Vaux de Cernay, op. cit., ch. LXXVIII.
103 Pierre des Vaux de Cernay, op. cit., ch. LXXXI.
104 Pierre des Vaux de Cernay, op. cit., ch. LXXXII.
CHAPITRE VI
CONSÉCRATION ET ÉCHEC DE LA CROISADE
I - LE CONCILE DE LATRAN
En novembre 1215, le pape réunit enfin son concile œcuménique, le 4e Concile de Latran. Cette véritable conférence internationale, solennellement préparée depuis plus de deux ans, à laquelle prendront part deux patriarches (de Constantinople et de Jérusalem), 71 archevêques, 410 évêques, 800 abbés, où sont représentées les Églises du Nord et du Midi, d'Orient et d'Occident, où assisteront des ambassadeurs et des délégués des rois et des grandes cités, n'a pas pour but principal de régler la question albigeoise; cette question sera, dans l'esprit du pape, un des points secondaires et d'ordre pour ainsi dire administratif, qu'il faudra examiner à la fin, une fois que le concile aura promulgué les résolutions qui sont le véritable objet de cette impressionnante réunion de dignitaires de l'Église.
Cependant, le problème de l'hérésie et des moyens pour la combattre était d'une actualité brûlante. Et c'est pour défendre l'Église contre ce péril, dont les événements du Languedoc avaient permis de mesurer la gravité, que le concile établit sa définition de la foi catholique et de l'orthodoxie. Les hérétiques, cathares et vaudois, tant ceux du Languedoc que ceux des Balkans et d'Italie (et des autres pays où ils sont moins puissants), sont condamnés sans restrictions, déclarés anathèmes et les sanctions à prendre contre eux sont une fois de plus définies, confirmées; et l'Église impose aux puissances séculières le devoir de combattre l'hérésie, sous peine d'excommunication.
Les chefs temporels qui failliront à ce devoir seront déclarés déchus de leurs droits par le pape, qui sera libre d'attribuer leurs domaines à tout seigneur catholique qui voudra les prendre. Le concile ne pouvait, de façon plus catégorique, approuver l'œuvre de la croisade, ni définir d'une façon plus explicite l'attitude théocratique de l'Église. Si le pape ne possédait pas le pouvoir effectif de déposséder les rois, il s'attribuait, par la décision du concile, le droit légal de le faire, proclamant la suprématie absolue de l'autorité de l'Église sur le droit séculier.
Inauguré le 11 novembre 1215 par les discours du pape, du patriarche de Jérusalem et de l'évêque d'Agde, Thédise (l'ancien légat du Languedoc), le concile se présentait, dès le début, comme une justification implicite de l'œuvre de Simon de Montfort. Ce ne fut que le 30 novembre que la question du règlement définitif de l'affaire du Languedoc fut officiellement traitée. Comme ce règlement était d'une grande importance politique et d'un intérêt vital pour le clergé occitan et pour les barons dépossédés, il devint l'objet d'une intense activité diplomatique qui s'était poursuivie parallèlement aux débats du concile. Comme le dit P. des Vaux de Cernay "...quelques-uns de ceux que assistèrent au concile, même parmi les prélats, étant ennemis de l'affaire de la foi, travaillèrent pour le rétablissement des comtes (de Toulouse et de Foix) dans leurs domaines105..." Les décisions du concile, dont nous avons déjà parlé, semblaient approuver sans réserves le principe de la croisade, qui venait (croyait-on) de se terminer. Mais le comte de Toulouse ne se tenait pas encore pour battu. Il bénéficiait de l'appui du roi d'Angleterre (récemment réconcilié avec le pape), à défaut de celui du roi de France; à vrai dire, c'est là un assez faible atout, le pape tenant plus à l'alliance de Philippe Auguste qu'à celle du faible et capricieux Jean sans Terre, et ses sympathies anglaises font plutôt du tort à Raymond VI. Mais du moins aura-t-il, parmi les prélats anglais, un défenseur zélé en la personne de l'abbé de Beaulieu (près de Southampton). Il peut compter aussi sur l'appui de l'ancien légat, Arnaud-Amaury, à présent archevêque de Narbonne et primat du Languedoc, qui peut lui être d'autant plus utile qu'il fut un des grands chefs de la croisade. Enfin, il compte aussi sur son influence personnelle et sur la force juridique de ses arguments. D'ailleurs, le comte insiste sur le fait qu'il est déjà allé, dans la voie de la soumission, plus loin qu'on ne le lui demandait: puisque sa personne, bien à tort, paraît si suspecte aux représentants du pape, il a abdiqué, il a remis toutes ses terres à son fils, lequel, étant donné son âge, ne saurait porter ombrage à âme qui vive; il ne demande qu'à le faire élever dans les sentiments les plus catholiques; lui-même veut bien se retirer en Terre Sainte ou n'importe où. Raymond VI a fait venir d'Angleterre ce fils, assez grand pour assister aux débats, assez jeune pour attendrir l'assemblée par sa grâce d'adolescent. Il n'est pas impossible de supposer que le pape lui-même ait pu être touché par la vue de ce jeune prince, neveu et petit-fils de rois, qu'il fallait immoler à la raison d'État. Les témoignages de sympathie que (d'après la "Chanson") il prodigua au jeune homme ne devaient pas être purement hypocrites.
Innocent III (son attitude envers Raymond VI et ses revirements successifs dans l'affaire du roi d'Aragon semblent l'indiquer) devait être, jusqu'à un certain point, un homme impulsif et influençable. Il est peu probable, pourtant, qu'il ait pu réellement soutenir le comte de Toulouse, comme le laisseraient croire le récit du continuateur de Guillaume de Tudèle, et même Pierre des Vaux de Cernay, qui l'en blâme discrètement.
L'auteur de la "Chanson", qui est hostile à la croisade et qui, du reste, semble bien informé sur les débats qui ont précédé la décision finale du concile, a tout intérêt à mettre dans la bouche du pape (et d'un pape déjà mort à l'époque où il écrit) des paroles qui condamnent Simon de Montfort. En réalité, les hésitations d'Innocent III, qu'elles aient été d'ordre sentimental ou diplomatique, ne pouvaient être qu'un trompe-l'œil destiné à atténuer sa responsabilité dans une affaire où, il le savait bien, le droit commun était lésé au profit de la dictature de l'Église. Ayant, par la voix du concile, fait ériger en loi le principe, il ne pouvait en condamner sincèrement l'application pratique.
Cependant, le récit que nous présente la "Chanson" de ces débats doit, dans ses lignes générales sinon dans le détail, correspondre à la vérité: l'événement qu'il rapporte est d'une importance si grande pour tous les intéressés, tant de personnes des deux partis y avaient assisté, une telle publicité a dû lui être donnée dans les deux camps, que l'auteur a pu, tout au plus, arranger un peu les discours dans le sens qu'il estimait favorable à sa thèse. Quand il décrit le pape ému, troublé par les débats et sortant pour se délasser dans son jardin où il est suivi et harcelé par les évêques occitans, qui parlent tous ensemble et accusent Innocent de trop favoriser les comtes, l'épisode ne sent nullement la chanson de geste et paraît pris sur le vif. Et il est certain que l'attitude du pape a pu prêter à équivoque.
Simon de Montfort n'était pas venu en personne, jugeant sa présence plus utile dans le Languedoc, et avait envoyé au concile son frère Guy; il savait d'ailleurs qu'il ne manquait pas de bons avocats, tout le haut clergé du Languedoc lui était acquis, l'assemblée du concile étant composé de prélats, la cause du comte devait être considérée comme perdue d'avance, la solidarité ecclésiastique ne pouvant manquer de jouer en faveur d'un parti soutenu par des évêques.
Le comte de Toulouse, s'estimant sans doute un trop grand personnage pour plaider lui-même, laisse au comte de Foix la tâche de défendre sa cause: Raymond-Roger, aussi bon orateur que vaillant soldat, se montre, en tout cas, beaucoup plus combatif que son suzerain. Mais tous, aussi bien le comte de Foix que les comtes de Toulouse et le comte de Béarn, proclament hautement qu'ils n'ont jamais toléré ni encouragé l'hérésie. "...Je puis jurer avec sincérité, dit Raymond-Roger, que je n'aimais jamais les hérétiques, que je repousse leur société, et que mon cœur ne s'accorde point avec le leur. Puisque la sainte Église trouve en moi un fils obéissant, je suis venu en ta cour (celle du pape) pour être loyalement jugé, moi et le puissant comte, mon seigneur et son fils également qui est beau, bon, tout jeune et n'a fait tort à âme qui vive... Le comte mon seigneur, de qui relèvent de si grandes terres s'est mis à ta discrétion, te livrant la Provence, Toulouse et Montauban, dont les habitants furent ensuite livrés au pire ennemi, au plus cruel, à Simon de Montfort, qui les enchaîne, les pend, les extermine sans merci106..."
Or, le comte de Foix altère les faits, au moins sur un point, puisque sa sœur et sa femme étaient devenues parfaites dans des couvents cathares, que son autre sœur était vaudoise, et que le pays de l'Ariège était connu comme un des plus "hérétiques". C'est ce que lui fera remarquer Foulques, l'évêque de Toulouse, sans d'ailleurs que le comte en soit le moins du monde troublé. Foulques, pour provoquer l'indignation de l'assistance, parlera des "...pèlerins dont le comte a tué et mis en pièces un si grand nombre que le champ de Montgey en est encore couvert, que la France les pleure encore et que tu (le comte?) en restes déshonoré! Là dehors, devant la porte, tels sont les plaintes et les cris des aveugles, des proscrits, des mutilés, qui ne peuvent plus marcher sans qu'on les guide, que celui qui les a tués, estropiés, mutilés, ne mérite plus de tenir terre!" (Foulques fait allusion au massacre, par le comte de Foix, d'un contingent de croisés allemands, près de Montgey).
Raymond-Roger proteste avec véhémence, replaçant ainsi la querelle sur son véritable terrain: jamais, dit-il, il n'a attaqué de "bon pèlerin... cheminant pieusement vers quelque saint lieu. Mais quant à ces voleurs, ces traîtres sans honneur et sans foi, portant cette croix qui nous a écrasés, il est vrai qu'aucun n'a été pris par les miens et par moi, qu'il n'ait perdu les yeux, les pieds, les mains ou les doigts"107. C'est évidemment, une assez grande hardiesse que d'attaquer ainsi le principe même de la croisade, et le comte semble refuser de croire que le pape "droiturier" qu'il implore a promis la rémission de leurs péchés à ces mêmes "voleurs et traîtres". Son cri est beau; il semble authentique, car l'accusation de cruauté portée contre Raymond-Roger fait assez de bruit dans ce débat. Le comte, d'ailleurs, contre-attaque vigoureusement, et c'est l'évêque de Toulouse lui-même qu'il prend à partie, l'accusant d'être le principal responsable de tout le mal qui a été fait dans le Languedoc: "Quant à l'évêque qui montre tant de véhémences, je vous dis qu'en sa personne, Dieu et nous sommes trahis... Quand il a été élu évêque de Toulouse, un tel incendie embrasa toute la terre que jamais il n'y aura assez d'eau pour l'éteindre. À plus de cinq cent mille, grands et petits, il y a fait perdre la vie, le corps et l'âme. Par la foi que je vous dois, à ses actes, à ses paroles, à son maintien, il semble être plutôt l'Antéchrist qu'un légat de Rome!"
Le comte essaie de présenter la croisade comme une entreprise de banditisme où le pape n'est pour rien, et le pape lui-même se croit tenu de rappeler que ses disciples doivent marcher... "illuminés, portant le feu, l'eau, le pardon et la lumière, et douce pénitence et franche humilité...", en ajoutant: "Qu'ils portent la croix et le glaive". Il rappelle aussi que des catholiques ont péri dans cette guerre qui ne devait frapper que les hérétiques. Il laisse parler les autres avocats de la défense, en particulier Renaud, l'archidiacre de Lyon (cet homme sera plus tard excommunié pour hérésie) qui déclare que l'Église devrait protéger le comte Raymond: "Le comte Raymond a pris la croix tout d'abord, a défendu l'Église et exécuté ses ordres; et si l'Église l'accuse, elle qui devrait le protéger, elle en aura la faute, et son crédit baissera..." L'archevêque de Narbonne supplie également le pape de ne pas se laisser influencer par les ennemis du comte. De la part de l'homme qui a, pendant des années, pourchassé sans merci Raymond VI, une telle attitude est surprenante, mais s'explique fort bien par sa haine contre Montfort. On peut se demander si le pape accordait encore quelque crédit à la voix de cet ancien légat qui faisait passer les intérêts de l'archevêché de Narbonne avant ceux de l'Église.
Dans ce débat au cours duquel les comtes de Toulouse et leurs vassaux doivent être dépossédés de leurs droits pour hérésie (ou du moins pour complaisance à l'hérésie), il n'est nullement question de l'hérésie elle-même: tous la repoussent d'un même cœur, et le comte de Foix traite sa sœur (la vénérable et vénérée Esclarmonde) de "mauvaise femme et pécheresse"; tous sont des catholiques irréprochables, confiants en la justice du pape. La situation de ce dernier est donc, de ce fait, assez scabreuse malgré tout. C'est ce qui explique pourquoi il feint de se faire forcer la main pour accorder à Simon de Montfort l'investiture exigée par ses partisans, et prétend ne céder qu'à la voix de la majorité des représentants de l'Église. Cependant, est-il probable qu'il ait pu prononcer les paroles suivantes: "Que Simon tienne la terre et la gouverne! Barons, puisque je ne puis la lui enlever, qu'il la garde bien, s'il peut, et ne se la laisse pas rogner, car jamais, de mon vouloir, il ne sera prêché pour venir à son secours.108" Or, les successeurs d'innocent (lui-même mourra l'année suivante) prêcheront sans arrêt des croisades pour aider Montfort, puis son fils. Le pape devait être le premier à savoir que l'hérésie, loin d'être détruite, s'était attiré la sympathie, secrète ou déclarée, de bien des personnes qui l'eussent peut-être condamnée avant 1209. Pour faire triompher la cause de l'Église il ne pouvait compter que sur la force armée, donc sur Simon de Montfort. À côté du péril que représentait à ses yeux l'hérésie, l'injustice faite au comte de Toulouse était bien peu de chose; pour ce théoricien de la théocratie, seul ce qui servait la cause de l'Église pouvait être juste.
Donc, le concile établit que: "Raymond, comte de Toulouse, qui a été trouvé coupable en ces deux articles et que plusieurs indices certains prouvent depuis longtemps ne pouvoir gouverner le pays dans la foi, soit exclu pour jamais d'y exercer sa domination, dont il n'a que trop fait sentir le poids; et qu'il demeure dans un lieu convenable, hors du pays, pour y faire un digne pénitence de ses péchés; cependant, qu'il reçoive tous les ans 400 marcs d'argent pour son entretien, tant qu'il obéira humblement. Que tous les domaines que les croisés ont conquis sur les hérétiques, leurs croyants, leurs facteurs et recéleurs, avec la ville de Montauban et celle de Toulouse, qui est la plus gâtée par l'hérésie, soient donnés au comte de Montfort, homme courageux et catholique, qui a travaillé plus que tout autre dans cette affaire, pour les tenir de ceux de qui il doit les tenir de droit. Le reste du pays qui n'a pas été conquis par les croisés sera mis suivant le mandement de l'Église à la garde de gens capables de maintenir et de défendre les intérêts de la paix et de la foi, afin de pourvoir le fils unique du comte de Toulouse, après qu'il sera parvenu à un âge légitime, s'il se montre tel qu'il mérite d'obtenir le tout, ou seulement une portion, ainsi qu'il sera plus convenable109".
Ce décret est suffisamment éloquent: jamais vainqueur n'imposa ses conditions à un vaincu avec une aussi hautaine assurance. Par une supercherie dont les membres du concile ne semblent même pas conscients, une victoire militaire due en partie au hasard, en partie aux mérites d'un bon chef de guerre, devient la victoire de la vérité chrétienne sur l'erreur; la voie avait été préparée par les victoires des croisés en Terre Sainte, guerres inhumaines parce que l'infidèle n'avait pas droit au nom d'homme. Encore l'Islam pouvait-il inspirer les respect instinctif dû au prestige d'une grande puissance.
Sur une terre chrétienne, l'Église devenait semblable à un juge qui se fût mis à rouer un prévenu de coups de bâton lui interdisant de se défendre parce que la personne du juge est sacrée. Il est assez surprenant de constater que dans cette vénérable assemblée composée de prélats de tous les pays catholiques il se fût trouvé si peu de personnes capables de comprendre ce que cette attitude avait d'odieux; de se rendre compte qu'un tel juge se place, moralement, beaucoup plus bas que le prévenu (ce dernier fût-il coupable), et ne mérite rien d'autre que de se voir rendre ses coups de bâton. Pour expliquer une telle attitude, il faudrait présumer que l'hérésie était à ce moment-là beaucoup plus puissante et plus répandue encore que les documents parvenus jusqu'à nous ne le donneraient à penser.
Le concile de Latran consacre et érige en loi la défaite morale de l'Église. Le pape n'avait pas ignoré les cruautés commises par les croisés: l'abbé de Cîteaux, au lendemain de Béziers, lui avait écrit avec une terrible franchise: "Sans égard pour l'âge et le sexe, presque vingt mille de ces gens furent passés au fil de l'épée", et le pape n'avait eu d'autre réaction que de féliciter son légat. Les plaintes des comtes, des consuls, du roi d'Aragon, les comptes rendus des victoires de Montfort, des bûchers, des massacres, de la destruction des terres et des récoltes, tout ceci avait passé par la chancellerie du Saint-Siège, ni le pape ni les cardinaux ne pouvaient l'ignorer; les évêques avaient entendu en plein concile les accusations portées par les barons occitans contre les croisés, accusations que personne n'avait cherché à démentir. L'évêque de Toulouse a pu s'attendrir sur les "pèlerins" massacrés, mais tout le monde savait que ces pèlerins avaient attaqué les premiers.
Aucune décision du concile ne flétrit les cruautés des soldats de Dieu, aucune ne les proscrit dans l'avenir. Au contraire: Simon de Montfort, "homme courageux et catholique", est récompensé pour avoir "travaillé plus que tout autre dans cette affaire", et tous savaient de quelle façon il y avait travaillé. Les scrupules du pape ne venaient pas, semble-t-il, de l'horreur devant le sang versé, mais de la répugnance à maltraiter un personnage qui pouvait avoir un certain poids sur le plan politique. Après tout, le jeune Raymond était bien moins innocent que les nouveau-nés massacrés à Béziers.
Après la décision du concile, il serait injuste de blâmer le fanatisme d'un Foulques ou d'un Arnaud-Amaury, la brutalité d'un Simon de Montfort: le pape, et l'Église par la voix de ses prélats, les avaient lavés de leurs crimes.
Le comte de Toulouse n'a plus qu'à se retirer dans le lieu d'exil "hors du pays" qui lui aura été assigné. Innocent III lui adresse quelques condoléances de politesse, et se montre plein de sollicitude pour le jeune Raymond, auquel il conseille de servir Dieu en toutes choses, et même (si l'on en croit la "Chanson") lui fait espérer qu'il reconquerra un jour les terres qu'il a perdues. Invention du chroniqueur, ou simples paroles de consolation adressées par un homme âgé à un enfant? Dans tous les cas, instruit par l'expérience, le jeune comte ne s'en remettra plus à la justice du pape pour défendre ses droits.
Simon de Montfort, après avoir appris la décision du concile qui l'institue maître des terres qu'il a conquises, n'a plus qu'à recevoir l'investiture du roi de France pour devenir comte de Toulouse.
Fait significatif: son premier acte d'autorité de souverain (presque) légitime sera dirigé contre l'archevêque de Narbonne, son ex-allié et le principal artisan de son élévation. En tant que possesseur des domaines du comte de Toulouse, Simon avait en fait droit au titre de duc de Narbonne, porté par les comtes. Le légat s'était attribué ce titre dès 1212; et l'hostilité entre les deux hommes n'avait cessé de s'envenimer. Tous deux avaient fait appel à Rome, et le pape avait tranché l'affaire en faveur de l'archevêque (2 juillet 1215). On sait que, venu au concile, Arnaud avait tout fait pour desservir la cause de Montfort. Ce dernier ne le lui pardonnera pas. Il peut sans doute encore moins pardonner l'arrogance de l'homme qui se vante partout de l'avoir "comblé d'honneurs", car il estime, non sans quelque raison, devoir sa fortune à lui-même.
Ce sont à présent deux ennemis qui s'affrontent, en un conflit qui a dû remplir de joie le cœur des Occitans; mais l'archevêque n'est pas de taille à lutter contre Montfort. Entré en maître à Narbonne, Arnaud oblige le vicomte Aimery à lui prêter hommage, et donne l'ordre de relever les murailles que Simon, avec l'approbation du prince Louis, avait fait abattre. Aux protestations de son rival, l'archevêque fait répondre: "Si le comte de Montfort entreprend d'usurper le duché de Narbonne, et s'il met quelque obstacle au rétablissement des murs de la ville, je l'excommunie, lui, ses fauteurs, et tous ceux qui lui prêteront secours et conseils". Comment comprendre le revirement total de ce prélat? Ce vieillard irascible défendra sa ville de Narbonne aussi ardemment qu'il avait défendu l'Église contre l'hérésie, et, le jour où Simon, de force, voudra pénétrer dans la cité, il courra avec ses soldats pour l'en empêcher, se fera bousculer par les chevaliers de Montfort, et se précipitera ensuite dans la cathédrale pour lancer une sentence solennelle d'excommunication contre le chef de la croisade, et jettera l'interdit sur toutes les églises de la ville violée par l'usurpateur.
Simon, de son côté, ne se laissera pas intimider, et fera célébrer la messe dans la chapelle du château, en en faisant sonneries cloches à toute volée. La situation de l'archevêque était-elle donc si compromise que Simon de Montfort pouvait se permettre de braver ouvertement le chef spirituel du pays dont il n'était que le souverain temporel? En tout cas, cet épisode nous montre le conquérant vieillissant comme un homme emporté et vaniteux à l'excès, ivre de sa propre puissance au point de frapper aveuglément tout ce qui lui résiste.
Ayant ainsi affirmé sa domination sur Narbonne, Simon se rend à Toulouse (7 mars 1216). Il se fait prêter serment par les consuls, ainsi qu'à son fils et héritier, Amaury; il achève de mettre la cité hors d'état de nuire en abattant les murailles qui restaient encore debout, en faisant démolir ou abaisser les tours des hôtels bourgeois, et enlever les chaînes des carrefours. Puis il fait renforcer le château Narbonnais, sa résidence personnelle, et l'isole de la ville par un large fossé qu'il fait remplir d'eau. Toutes ces précautions montrent que dans cette ville qu'il considère comme sienne de droit, il se sait, plus qu'ailleurs, en pays ennemi.
Puis il entreprend enfin son voyage à Paris, où, couvert de lauriers et fort de l'appui du Saint-Siège, il n'a plus qu'à recevoir l'investiture solennelle des mains du roi de France. Sans doute, après tant d'années de guerre, ce bref séjour dans sa terre natale où il allait être accueilli en héros national fut-il un baume pour son cœur; il devait avoir perdu l'habitude de se voir admiré et acclamé. Pierre des Vaux de Cernay, qui exagère sans doute quelque peu, doit tout de même se baser sur des faits exacts quand il écrit: "Quels honneurs lui furent rendus en France, nous ne pourrions l'écrire et on ne pourrait le croire, si on l'entendait; dans toutes les villes, châteaux ou villages où il entrait, le clergé et le peuple venaient à sa rencontre en procession; la dévotion du peuple était si pieuse et si religieuse qu'il se disait heureux, celui qui pouvait toucher la frange de son manteau110". Le peuple, entraîné par son clergé, devait voir en lui un nouveau saint Georges, exterminateur du dragon de l'hérésie.
Le roi, "après une conversation joyeuse et pleine de familiarité" (P. des Vaux de Cernay), lui accorde l'investiture. Dans le mandement daté de Melun, le 10 avril 1216, il est annoncé ce qui suit: "Nous avons reçu pour notre homme lige notre cher et féal Simon, comte de Montfort, pour le duché de Narbonne, le comté de Toulouse, les vicomtés de Béziers et de Carcassonne, savoir: pour les fiefs et terres que Raymond, autrefois comte de Toulouse, tenait de nous, et qui ont été acquis sur les hérétiques et les ennemis de l'Église de Jésus-Christ".
Ainsi le roi se soumettait docilement à la décision de l'Église; il est à croire que cette mainmise d'un de ses vassaux sur des terres où jusqu'alors son influence avait été à peu près nulle n'était pas pour lui déplaire. Triomphant, adulé, devenu par la décision souveraine du pape et du roi un des premiers barons du royaume de France, Simon de Montfort allait revenir dans ses nouveaux domaines pour constater qu'il n'y était maître que là où il pouvait paraître armé de pied en cap à la tête de ses troupes, et pas un pouce plus loin.
II - LA GUERRE DE LIBÉRATION
En avril 1216, le vieux comte de Toulouse et son fils débarquent à Marseille. La Provence, d'après le décret du concile de Latran, faisait partie de l'héritage futur du jeune Raymond; mais son père, qui l'accompagnait au lieu de rester en un lieu hors du pays assigné par sa pénitence, ne songeait évidemment pas à le laisser se contenter du "reste du pays qui n'a pas été conquis par les croisés". La sentence du concile donnait le signal de la révolte générale.
À Marseille, les comtes sont reçus avec enthousiasme; la nouvelle de leur arrivée se répand dans tout le pays. Avignon leur envoie des messagers, et, dès qu'ils se présentent devant la ville, une délégation de seigneurs et de bourgeois les reçoit à genoux, et leur offre la ville. "Sire comte de Saint-Gilles, dit (d'après la "Chanson") le chef de cette délégation, vous et votre bien-aimé fils, de notre lignée, acceptez cet honorable gage: tout Avignon se met en votre seigneurie; chacun vous livre sa personne et ses biens, les clefs de la ville, les jardins et les portes, etc". Le comte félicite les Avignonnais de leur accueil et leur promet "l'estime de toute la chrétienté et de votre pays, car vous restaurez les preux, et Joie et Parage111".
Le père et le fils entrent dans la ville. "Il n'y a vieillard ni jouvenceau qui n'accoure tout joyeux à travers les rues. Il se tient pour fortuné, celui qui peut courir le mieux! Les uns crient: "Toulouse!" en l'honneur du père et du fils, et les autres: "Joie! Désormais Dieu sera avec nous!" D'un cœur résolu, et les yeux mouillés de larmes, tous viennent s'agenouiller devant le comte, et tous ensemble disent: "Christ, Seigneur glorieux, donnez-nous le pouvoir et "la force de leur rendre à tous deux leur héritage!" Si grande est la presse et la procession qu'il faut recourir aux menaces, aux verges, au bâton!" Avignon n'avait eu à souffrir ni des ravages de la guerre ni de la tyrannie des Français. L'élan d'enthousiasme qui jette la ville aux pieds de son seigneur exilé et dépouillé est une des manifestations du patriotisme ardent que la guerre avait déchaîné dans toute la province méridionale.
La plus grande partie de la Provence témoigne du même enthousiasme et du même désir de libérer les terres opprimées. Raymond VI reçoit les hommages des villes et des châtelains et rassemble ses troupes dans Avignon. Là se tient un conseil de guerre: le vieux comte décide de se rendre en Aragon pour y recruter des troupes et attaquer l'ennemi dans le Sud et libérer Toulouse, tandis que son fils ira assiéger la ville de Beaucaire tenue par une garnison de Montfort.
Ce sera désormais la guerre sans merci; sans tentatives de conciliation, sans appels au pape ni aux légats, une guerre de libération pure et simple, nouvelle "guerre sainte", menée au nom de Merci et Parage, au nom de Toulouse et de Jésus-Christ. Pour être allé jusqu'au bout dans son attitude de soumission et de confiance en la justice du pape, le comte dépossédé revenait dans son pays auréolé de son prestige de victime immolée à la tyrannie de l'Église; pour les peuples du Languedoc, catholiques ou hérétiques, l'Église est à présent un ennemi aussi détesté que Montfort lui-même. Le comte, vaincu, humilié, bafoué, n'a qu'à paraître pour être porté en triomphe, au milieu de cris d'enthousiasme et de larmes de joie. Il ne se risque pas encore dans la bagarre lui-même et se réserve pour Toulouse. C'est son fils, le vrai comte (puisque le père a abdiqué en sa faveur), qui va commencer la reconquête.
Le jeune Raymond marche avec ses troupes d'Avignonnais sur Beaucaire, dont les habitants l'appellent et offrent de lui livrer la garnison française. Entré dans la ville en libérateur, le jeune comte ne réussit pas à prendre la garnison, commandée par le maréchal Lambert de Croissy (ou de Limoux, du nom des domaines octroyés à lui en Languedoc). La garnison s'est retirée dans le château, où elle se trouve assiégée. Guy de Montfort, frère de Simon, et Amaury de Montfort accourent devant Beaucaire pour libérer les assiégés et envoient des courriers à Simon, qui est sur son voyage de retour de France. Le 6 juin, Montfort se présente en personne devant la ville.
Il tente un assaut, qui échoue. La ville, ravitaillée par son port, ne risque pas de manquer de vivres, ni d'eau. Elle reçoit sans cesse, par le Rhône, des renforts d'Avignon, de Marseille et des autres villes de la Provence. "Les croisés assiégèrent ainsi en quelque sorte toutes les villes qui avaient envoyé des renforts, c'est-à-dire la Provence presque entière112". Simon de Montfort ne dispose que de ses troupes personnelles, et de mercenaires et de chevaliers besogneux venus avec lui de France dans l'espoir de s'enrichir. Pour assiéger Beaucaire, il faut construire des machines et fortifier le camp, la main-d'œuvre manque. La garnison enfermée dans le château est dans une situation désespérée et Lambert de Limoux fait hisser le drapeau noir pour montrer à son chef qu'il ne peut plus tenir longtemps.
Tous les assauts de Montfort sont repoussés. "Il y avait peu d'hommes à pied du pays, et ceux-ci étaient tièdes et peu utiles à l'armée du Christ, les adversaires au contraire étaient très courageux et hardis113". Les Français faits prisonniers sont pendus ou mutilés, et leurs pieds coupés servent de projectiles aux assaillants assiégés. La garnison, affamée et décimée, tient toujours, mais tous les efforts des croisés pour pénétrer dans la ville restent vains. Pendant trois mois, Simon de Montfort immobilisera ainsi son armée et usera ses forces et la patience de ses capitaines, dans des assauts qui échouent sans cesse à la joie croissante de ses adversaires. Ce soldat, dont la grande et principale vertu est de ne jamais abandonner ses hommes dans le danger, ne peut se permettre de lever le siège condamné à l'échec, et Lambert, à toute extrémité, fait de nouveau hisser le drapeau noir.
Apprenant que le vieux comte a repassé les Pyrénées à la tête d'une armée et s'avance vers Toulouse, Simon se décide à négocier. Il demande la vie sauve pour ses hommes, moyennant quoi il lèvera le siège. Raymond accepte ces conditions; il n'y était nullement forcé, ayant de toute façon l'avantage. La garnison qui avait si vaillamment tenu capitule le 24 août et est rendue intacte à Montfort.
Ayant à grand-peine sauvé son honneur et considérablement compromis son prestige, l'invincible Simon de Montfort est obligé de battre en retraite, mis en échec par un garçon de dix-neuf ans sans expérience du métier des armes. Il descend vers les Pyrénées, à la rencontre du vieux comte qui, d'ailleurs, se garde bien de l'attendre et repasse en Espagne: il connaît trop son adversaire et ne veut pas compromettre ses chances par une défaite, au moment où le succès de son fils vient de redonner l'espoir aux pays conquis. Et Simon se rabat sur Toulouse, dont il sait l'inébranlable fidélité à ses comtes et par laquelle il pense les atteindre plus sûrement.
Ce nouveau suzerain légitime veut faire payer à sa ville ce qu'il considère comme une trahison: il parle de la détruire entièrement. Projet irréalisable autant que monstrueux, mais dans une certaine mesure explicable; par expérience et par intuition, Simon sait ce qu'est la puissance d'une grand ville et le rôle immense qu'elle peut jouer dans la résistance d'un pays. Toulouse debout, les comtes ne seront jamais battus, la vie du pays étant orientée, centralisée sur sa capitale.
Effrayés par l'approche de Montfort, les Toulousains s'empressent d'envoyer une délégation et protestent de leur fidélité. Mais devant l'attitude franchement hostile du nouveau comte et les excès auxquels se livrent les soldats qu'il a envoyés en avant-garde, les bourgeois se révoltent. Simon pénètre l'arme à la main dans une ville sans fortifications, et fait mettre le feu à trois quartiers de Toulouse: Saint-Remésy, Joux-Aiguës et la place Saint-Étienne. Mais les bourgeois, "opposant la force à la force et ayant jeté des poutres et des tonneaux en travers sur les places à l'encontre des assaillants, repoussèrent toutes les attaques et, travaillant toute la nuit, les combattirent sans relâche en même temps que l'incendie114". La première entrée du comte investi dans sa capitale ne pouvait s'effectuer sous des auspices plus sinistres.
Toulouse reçoit le maître qui lui est imposé par une telle explosion de colère que la chevalerie française, repoussée, tenue en échec, au cours de combats de rues acharnés, est contrainte de se réfugier dans la cathédrale. Les bourgeois courent aux barricades, brandissent des armes improvisées, "hache émoulue, fauchard ou pilon, arc à main ou arbalète115..." Et tandis que l'incendie fait rage, Simon parcourt la ville à cheval, tente de rassembler ses troupes, lance, rue Droite, "une charge furieuse que fait trembler la terre", essaie de forcer la Porte Cerdane pour pénétrer dans le bourg. L'attaque repoussée, il se retire dans le château Narbonnais, sa demeure qu'il avait eu la sage précaution de faire si bien fortifier quelques mois auparavant.
L'émeute est victorieuse; mais Montfort dispose encore, dans le pays, de forces suffisantes pour venger cet échec. Les bourgeois n'ont ni armée régulière ni forteresses et ne peuvent compter sur aucun secours rapide. L'évêque Foulques s'entremet pour rétablir la paix entre le nouveau comte et les révoltés.
L'auteur de la "Chanson" présente ici la conduite de l'évêque sous un jour particulièrement odieux: Foulques, dans un discours plein d'onction et de douceur, proteste de son dévouement total à ses ouailles et leur garantit, sous serment et sous la caution de l'Église, l'inviolabilité de leurs personnes et de leurs biens et le pardon de Montfort et, une fois les bourgeois désarmés et livrés à Simon, encourage ce dernier à les traiter avec la plus grande dureté; bref l'évêque agit avec une perfidie consciente et délibérée et l'on a pu se demander si l'auteur, dont la haine pour Foulques n'est que trop évidente, n'a pas noirci les couleurs. Cependant, ce que l'on sait de la conduite de ce redoutable évêque pendant la croisade et de la haine que toute sa vie il inspira aux Toulousains ferait croire que le chroniqueur exagère à peine; Foulques éprouvait un ressentiment personnel contre une ville qui avait osé se montrer rebelle à son influence.
Les consuls entrent en pourparlers et Simon se rend à la maison communale pour signer le pacte; mais à peine les bourgeois sont-ils désarmés, que les troupes françaises occupent les maisons les mieux fortifiées, arrêtent les notables, Simon fait confisquer leurs biens et les expulse de la ville: "De la ville sortent les bannis, la fleur des habitants, chevaliers, bourgeois et changeurs (banquiers); ils sont escortés par une troupe furieuse et armée qui les frappe et les menace, les injurie, les insulte et les fait aller au pas de course116..." S'étant ainsi débarrassé des bourgeois les plus riches et les plus influents, Simon fait publier dans la région un édit qui ordonne à toute personne sachant manier le pic et la pelle de se rendre à Toulouse, afin de commencer la démolition de la ville. "Alors, vous auriez vu abattre maisons et tours, murs, salles et créneaux! On démolit les demeures et les ouvroirs, les galeries, les chambres ornées de peintures, les portails, les voûtes, les hauts piliers. De toutes parts, sont si grands la rumeur, la poussière, le fracas, la fatigue, l'agitation, que tout est confondu et qu'il semble que ce soit un tremblement de terre, un roulement de tonnerre ou de tambours". La douleur des Toulousains est à son comble: "Par la ville s'élèvent le cri, le deuil, les pleurs de maris, des dames, des enfants, des fils, des pères, des mères, des sœurs, des oncles, des frères et de tant de personnes considérables qui pleuraient. "Eh Dieu, se disaient-ils l'un à l'autre, quels maîtres cruels! Seigneur, comme vous nous avez livrés aux mains de brigands! Ou donnez-nous la mort ou rendez-nous à nos seigneurs légitimes117!..""
D'ailleurs, Simon ne cherche pas à détruire toute la ville, mis seulement les quartiers les mieux fortifiés; cependant, malgré les conseils de quelques-uns de ses amis et même de son frère, il est décidé à se montrer impitoyable; ne pouvant rien espérer des Toulousains, il ne songe plus qu'à profiter de son avantage pour piller la ville, car il a grand besoin d'argent. Il annonce qu'il accordera son pardon pour la somme de trente mille marcs d'argent. Somme si énorme que Guillaume de Puylaurens croit que Montfort l'a exigée, poussé par des conseillers perfides qui souhaitaient le soulèvement de la ville et le retour des comtes. Il ne faut pas chercher si loin: les habitants de Toulouse ne pouvaient être exaspérés davantage, Simon n'avait donc rien à perdre; il compte sur ses soldats pour saigner la ville à blanc, et croit n'avoir plus rien à craindre de bourgeois désarmés et privés de leurs chefs.
Il quitte Toulouse dont les habitants sont "...dolents, marris, affligés et tristes, pleurant et souffrant, les yeux pleins de larmes brûlantes... car on ne leur laisse ni farine, ni froment, ni ciclaton, ni pourpre, ni aucun bon vêtement118...", il se rend en Bigorre, traiter une nouvelle opération financière et politique en même temps: il veut obtenir pour son deuxième fils, Guy, la main de Pétronille, fille de Bernard de Comminges et héritière du Bigorre par sa mère; Pétronille, déjà mariée en secondes noces à Nuno Sanche, fils du comte de Roussillon, est séparée de son mari et donnée au jeune Guy, qui l'épouse à Tarbes et devient possesseur du comté de Bigorre (7 novembre 1216). Après ce mariage célébré en hâte et un échec devant le château de Lourdes qu'il ne parvient pas à enlever, Simon, à court d'argent de nouveau, repasse par Toulouse pour exiger de nouveaux impôts, présentés sous forme d'une amende sur les absents, c'est-à-dire sur les personnes qu'il avait lui-même expulsées.
Ne pouvant encore entreprendre une campagne contre les comtes de Toulouse, qui se préparent à une nouvelle offensive dans une Provence encore épargnée par la guerre et toute dévouée à leur cause, Montfort tente de réduire à l'obéissance Raymond-Roger de Foix, son ennemi le plus acharné; il assiège le château de Montgaillard ou Montgrenier tenu par le fils du vaillant guerrier. Le château capitule le 25 mars. Il semble que tout soit à recommencer, il doit de nouveau assiéger les places fortes du pays, château par château; il prend en mai Pierrepertuse, dans le Termenès, puis se rend à Saint-Gilles, dont les habitants, révoltés, ont chassé leur abbé et lui refusent l'entrée de la ville.
Le vent a tourné, définitivement: Simon n'est plus le chef des croisés, mais un homme qui cherche à défendre sa conquête; Innocent III est mort, le 15 juillet 1216; Honorius III, son successeur, n'a pas encore eu le temps de s'adapter au revirement de la situation dans le Languedoc; le nouveau légat, Bertrand, cardinal-prêtre des Saints Jean et Paul, rencontre partout une hostilité telle que les villes lui ferment ses portes; les comtes de Toulouse sont maîtres de la Provence et le jeune Raymond qui se fait appeler "le jeune comte de Toulouse, fils du seigneur Raymond par la grâce de Dieu, duc de Narbonne, comte de Toulouse et marquis de Provence", rejette sans équivoque les décisions du concile de Latran et l'autorité du roi de France.
L'échec de Simon de Montfort devant Beaucaire avait cependant provoqué la vigoureuse réaction des pouvoirs ecclésiastiques, et l'année 1217 amènera en Languedoc un nouveau contingent de croisés, le concile ayant accordé une fois pour toutes les indulgences semblables à celles dont bénéficient les croisés de Terre Sainte à toute personne qui prendrait la croix contre les hérétiques dans quelque pays que ce fût. Avec ces nouveaux contingents amenés par l'archevêque de Bourges et l'évêque de Clermont, Simon enlève les châteaux de Vauvert et de Bemis, passe le Rhône à Viviers; s'il ne peut entreprendre la conquête de la Provence, du moins veut-il intimider l'adversaire. L'arrivée de nouveaux croisés, le secours militaire que leur prêtent les évêques du pays avec leurs milices produisent un certain effet: Adhémar de Poitiers, comte de Valentinois, se soumet et offre même son fils en mariage à une des filles de Simon. Mais ce dernier n'a plus de temps à perdre en Provence, on le rappelle en hâte à Toulouse.
"Les citoyens de Toulouse, dit Pierre des Vaux de Cernay, ou pour mieux dire la cité de fourberie (dolosa), agités d'un instinct diabolique, apostats de Dieu et de l'Église119", ont reçu dans leurs murs le comte Raymond lui-même, à la tête d'une armée d'Aragonais et de faidits. Or, toute la famille de Simon se trouve dans le château Narbonnais: sa femme, la femme de son frère, celles de ses fils et les petits-enfants des deux frères Montfort.
La citadelle était tenue par la garnison de Montfort, mais l'armée du comte s'était approchée de la ville et, profitant du brouillard, avait passé la Garonne au gué des moulins du Bazacle et pénétré dans Toulouse le 13 septembre 1217. Le comte est accueilli en triomphe. "...Quand ceux de la ville ont reconnu les enseignes (du comte), ils viennent vers le comte comme s'il était ressuscité. Et quand il entre dans Toulouse par les poternes, tous les habitants accourent, grands et petits, dames et barons, hommes et femmes, s'agenouillant devant lui et lui baisant les vêtements, les pieds, les jambes, les bras, les doigts. Il est accueilli avec des larmes de joie, car c'est le bonheur qui revient, riche de fleurs et de fruits120!"
Ce n'était pas encore le bonheur, mais c'était la possibilité de lutter: Raymond VI avait rassemblé tous ses vassaux, les comtes de Foix et de Comminges, les seigneurs bannis de Toulouse, ceux de Gascogne, du Quercy, de l'Albigeois, les chevaliers faidits qui se cachaient dans les bois, qui vivaient exilés en Espagne et pour qui ce retour à Toulouse était le symbole de la libération. "...Et quand ils voient la ville, nul n'est si insensible qu'il n'ait les yeux mouillés de l'eau du cœur et chacun se dit en lui-même: Vierge impératrice, rendez-moi le lieu où je fus élevé! Il me vaut mieux y vivre et y mourir que d'aller par le monde dans la détresse et la honte121!"
Tous les Français qui n'ont pas eu le temps de se retrancher dans le château sont massacrés; mais la citadelle elle-même, bien fortifiée, peut tenir longtemps. Cependant, les efforts tentés par Guy de Montfort pour la dégager échouent.
C'est pourquoi Simon de Montfort arrive en toute hâte avec ses troupes, décidé à lancer un assaut contre la cité rebelle; il est accueilli par une telle grêle de flèches et de carreaux d'arbalète que sa cavalerie recule en désordre; son frère et son deuxième fils sont blessés. Les Toulousains contre-attaquent et les Français, contraints de battre en retraite, doivent se résigner à commencer le siège de la ville.
Si les croisés étaient jusqu'alors parvenus à réduire par la famine et les tirs d'artillerie des châteaux et même des villes telles que Lavaur et Carcassonne, une ville comme Toulouse, de dimensions considérables et située sur le bord d'un fleuve, était pratiquement impossible à isoler; il eût fallu pour cela une armée beaucoup plus importante que ne l'avait été celle de la croisade de 1209. La ville n'avait plus de murailles, mais les Toulousains n'avaient pas perdu leur temps et le comte, à peine entré dans la cité, avait donné l'ordre de creuser des fossés, de construire des barricades de pieux et de poutres, des barbacanes de bois; et malgré leur apparente fragilité, ces fortifications improvisées, bien défendues, pouvaient tenir, à moins d'une supériorité numérique écrasante du côté des assiégeants. Or, non seulement les effectifs militaires des assiégés étaient supérieurs à ceux de Montfort, mais la population civile s'était, du vieillard à l'adolescent, de la châtelaine à la petite servante, transformée en une milice de combattants et d'auxiliaires de l'armée. "Onques en aucune ville on ne vit si riches ouvriers, car là travaillaient des comtes et tous les chevaliers, des bourgeois, des bourgeoises, des marchands, les hommes et les femmes, les courtois monnayeurs, les garçons et les filles, les sergents et les trotteurs, chacun porte ou pic ou pelle... chacun a le cœur à la besogne. La nuit tous sont au guet; les lumières et les flambeaux sont placés par les rues, tambours, timbres et clairons font tapage. Les filles et les femmes témoignent de la joie générale par des ballades et des danses chantées sur un air joyeux122". Et pendant ce siège, la plus grande partie des murailles abattues se relèveront, sous les yeux d'un adversaire impuissant.
La lutte était inégale: Simon de Montfort, en quittant la Provence, avait défendu sous peine de mort, au courrier qui avait apporté la lettre de sa femme, de parler du soulèvement de Toulouse et de la présence du comte dans la cité; mais la nouvelle s'était déjà répandue par le pays. Les troupes de Provençaux qu'il voulait emmener avec lui l'abandonnent; l'archevêque d'Auch, à l'appel de Guy de Montfort, avait rassemblé des troupes et celles-ci se débandent en route et refusent de marcher sur la capitale. Les soldats et les chevaliers français, les seuls sur lesquels Simon puisse compter, sont immobilisés dans les garnisons des villes qui ont été confiées à leur garde.
Montfort lance un appel aux puissances catholiques: Foulques quitte de nouveau Toulouse et se rend en France, à la demande du cardinal-légat, pour prêcher une croisade contre sa ville, rebelle et repaire d'hérétiques; la comtesse Alice, femme de Montfort, va elle-même implorer le roi de France; elle compte sur ses relations personnelles (son frère est le connétable de l'armée royale), plus peut-être que sur l'appui du roi, qui semble ne s'intéresser qu'aux causes déjà gagnées. Et les échecs de Montfort suivent de trop près son investiture pour que le roi ait intérêt à soutenir un vassal si peu maître de ses domaines.
C'est le pape, encore une fois, qui tentera de sauver la situation. Honorius III lance une nouvelle campagne de propagande contre l'hérésie et cherche à attirer sur le Languedoc une nouvelle croisade. Alors que le sort du premier pays chrétien qui s'était montré infidèle à l'Église semblait définitivement réglé, tout est à recommencer et dans des conditions beaucoup plus difficiles qu'en 1208. L'enthousiasme des croisés du Nord est dissipé depuis longtemps, et l'Église n'a plus pour adversaires quelques hérétiques ennemis de la violence, donc passifs, et des barons toujours prêts à lui jurer fidélité, mais tout un peuple qui rejette ouvertement et consciemment son autorité.
Toulouse continue à se fortifier et à se ravitailler, par terre et par eau, sous les yeux d'un assiégeant trop faible, qui n'a plus que la ressource de se retrancher lui-même dans un camp fortifié et d'attendre des renforts. Les combats qui se poursuivent durant tout l'hiver ne sont guère que de brèves escarmouches et les deux camps rivalisent de cruauté envers les prisonniers: dans Toulouse, la haine des Français est telle que les malheureux qui se sont laissés prendre vivants sont promenés en triomphe par les rues de la ville, puis ont les yeux arrachés, la langue coupée, tandis que d'autres sont dépecés tout vifs, brûlés, traînés à la queue des chevaux. Et dans le camp de Montfort, la haine commence à céder le pas au découragement.
Les vrais combats reprennent au printemps. Tous les assauts de Simon de Montfort sont repoussés avec tant de vigueur que ses chevaliers (selon la "Chanson") montrent franchement leur exaspération. L'auteur n'a (probablement) pas pu assister aux discussions de Simon avec ses lieutenants, et les discours qu'il met dans la bouche d'un Gervais de Champigny ou d'un Alain de Roucy sont sans doute imaginaires; rien ne nous dit cependant que l'historien n'a pas pu s'inspirer de bruits qui couraient réellement dans le camp français. On pourrait le soupçonner de prudence ou d'opportunisme quand on le voit attribuer des propos pleins de modération à Guy de Lévis ou à Guy de Montfort dont les fils, à l'époque où il écrivait, étaient solidement installés dans le Languedoc; ce ne serait pas le cas pour Foucaut de Berzy, chevalier brigand exécuté en 1221 par Raymond VII. Dans les longs conciliabules que tiennent avec leur chef les chevaliers français, on sent ces derniers poussés à bout, presque affolés, tentés de rejeter la responsabilité de leurs échecs sur Simon; ils lui resteront cependant fidèles jusqu'au bout, autant par dévouement personnel que par cette union que crée entre eux et lui la haine dont ils sont entourés. "Orgueil et dureté se sont emparés de vous, dit Alain de Roucy à son chef. Vous aimez ce qui est triste et ce qui est lâche123..."
Les renforts de croisés du Nord arrivent enfin; un contingent de Flamands, conduits par Michel de Hames et Amaury de Craon. Au cours de combats acharnés, Montfort parvient à s'emparer du faubourg Saint-Cyprien, sur la rive gauche du fleuve, et attaqué les ponts qui ouvrent l'accès de la ville; les Français ne parviennent pas à y prendre pied et battent en retraite.
Le siège dure depuis huit mois. À la Pentecôte, le jeune comte arrive avec de nouveaux renforts et entre dans la ville sous le nez des assiégeants. La population le reçoit dans des transports d'allégresse, on se presse pour le voir, on le regarde "comme la fleur de rosier". "Le fils de la Vierge, pour les réconforter (les Toulousains), leur transmit une joie avec un rameau d'olivier, une claire étoile, l'étoile du matin sur la montagne. Cette clarté, c'était le vaillant jeune comte, l'héritier légitime, qui franchit la porte avec la croix et l'acier124". L'auteur se fait ici l'écho de la tendresse fervente du peuple pour le jeune héros de Beaucaire, et ces lignes à elles seules peuvent nous faire mesurer l'abîme qui séparait les deux camps: les uns savaient pourquoi et pour qui ils se battaient, les autres ne faisaient qu'essayer de retenir un bien à peine conquis et qui leur glissait déjà entre les mains; leur combativité et leur colère (amplement soulignées par le chroniqueur) vient de l'humiliation d'être tenus en échec par des gens qu'ils estiment inférieurs à eux, "des bourgeois désarmés".
Pendant que Simon, qui, malgré l'arrivée d'une importante troupe de croisés commandés par le comte de Soissons, parvient à peine à se parer contre les attaques des assiégés, le cardinal-légat Bertrand lui reproche son manque d'ardeur: "Or, le comte (Montfort) était atteint de langueur et d'ennui, amoindri par tant de coûts et tout épuisé; pas plus qu'il ne supportait patiemment l'aiguillon dont le légat le poignait chaque jour pour autant qu'il était paresseux et relâché: d'où vient, comme on le disait, qu'il priait le Seigneur de lui donner la paix en le guérissant par la mort de tant de souffrances125".
Le légat pouvait à bon droit s'acharner contre le vieux guerrier: celui qui avait tant de fois vaincu et attribué ses victoires à la protection divine devenait, par ses échecs, suspect de quelque faute qui lui eût valu le châtiment de Dieu. L'homme courageux et catholique que l'Église avait honoré au point de lui livrer une terre plus grande que les domaines du roi de France, qui bénéficiait de l'aide de soldats que l'Église lui faisait envoyer depuis des années, se révélait incapable de forcer une ville mal fortifiée et défendue par des hommes qu'il avait tant de fois battus!
En juin, neuvième mois de ce siège désastreux, Montfort décide de construire une "chatte" géante, tour roulante qui pourrait être peu à peu rapprochée des fortifications ennemies et du haut de laquelle ses soldats pourraient dominer les quartiers des assiégés et les écraser par un tir serré. Les Toulousains endommagent la machine par le tir de leurs pierriers, puis, lorsqu'elle est réparée et prête à se mettre en mouvement, font une sortie à l'aube et attaquent le camp français de deux côtés. Simon entend la messe quand on vient lui dire que les Toulousains sont déjà dans le camp, que les Français se replient. Ses dévotions terminées, il court au combat et parvient à repousser l'adversaire jusqu'au fossé.
Guy de Montfort, occupé à protéger les machines, est blessé par une flèche tirée de la ville. Simon, qui se précipite vers lui en se lamentant, est frappé à la tête d'une pierre, lancée par un pierrier manié (dit la "Chanson") par des dames et des demoiselles. "Une pierre vint tout droit où il fallait et frappa le comte Simon sur son heaume d'acier, de sorte que les yeux, la cervelle, les dents, le front et la mâchoire lui volèrent en éclats et qu'il tomba par terre, mort, sanglant et noir126".
Cette mort instantanée et brutale, en plein combat, sous les yeux des deux camps, est saluée dans le camp toulousain par une explosion de joie: "Les cors, les trompes, les carillons, les volées et les sonneries de cloches, les tambours, les timbales et les petits clairons font retentir la ville et le pavé127". À cet immense cri de soulagement répond la consternation du camp français. La mort du chef démoralise une armée déjà découragée par les échecs subis pendant le siège, et le fils de Montfort, après s'être fait accorder par le légat les anciens titres de son père, et avoir fait une tentative pour incendier la ville, se retire dans le château Narbonnais et, un mois après la mort de son père, lève le siège.
Toulouse a triomphé, et Amaury, rentré à Carcassonne où il fait enterrer son père en grande pompe, verra le jeune comte reconquérir peu à peu sur lui tous les domaines que Simon avait tenus, malgré les appels du pape et l'intervention du roi de France en la personne de son fils. Il y faudra sept ans de guerre, mais le coup de grâce a déjà été porté à l'envahisseur, qui, de moins en moins combatif, abandonne villes et places fortes les unes après les autres pour se trouver un beau jour sans soldats et sans argent pour son voyage de retour.
Simon de Montfort disparu, la croisade se trouvait décapitée. D'ailleurs, malgré les efforts du pape et des légats, cette guerre avait depuis longtemps cessé d'être une croisade. Amaury luttait pour son héritage et, comme tous les fils de dictateurs, n'inspirait ni crainte à ses ennemis ni confiance à ceux qui devaient le soutenir. En dépossédant le comte de Toulouse par la décision du concile, l'Église semblait avoir oublié que Simon de Montfort n'était pas immortel, et que cet homme qui pouvait en effet, "tenir" le pays, était le seul à pouvoir le faire. Par sa mort, le pape se trouvait dans la situation plutôt absurde de quelqu'un qui confie une tâche écrasante à un homme manifestement incapable de la remplir. Aussi se détournera-t-il bientôt du malheureux Amaury pour disposer de ses droits en faveur d'un allié plus puissant et investi d'un prestige qui en imposait à tous les pays d'Occident. C'est le roi de France qui parachèvera l'œuvre de Simon de Montfort.
"Tout droit à Carcassonne, ils le portent pour l'ensevelir, pour célébrer le service au moûtier Saint-Nazaire. Et on lit sur l'épitaphe, celui qui sait lire, qu'il est saint, qu'il est martyr, qu'il doit ressusciter, avoir part à l'héritage et fleurir dans la félicité sans égale, porter la couronne et siéger dans le royaume. Et moi j'ai ouï dire qu'il doit en être ainsi: si, pour tuer des hommes et répandre le sang, pour perdre des âmes, pour consentir à des meurtres, pour croire des conseils pervers, pour allumer des incendies, pour détruire les barons, pour honnir Parage, pour prendre des terres par violence, pour faire triompher orgueil, pour attiser le mal et éteindre le bien, pour tuer des femmes, égorger des enfants, on peut en ce monde conquérir Jésus-Christ, il doit porter couronne et resplendir dans le ciel128!"
Quel que puisse être le sort réservé pour l'éternité à l'âme de Simon de Montfort, ceux qui admirent Napoléon, César, Alexandre et leurs semblables ne sauront, en toute justice, refuser leur admiration à ce grand soldat; les autres sont libres de constater qu'il fut, somme toute, un être assez médiocre, choisi pour une besogne cruelle dont il s'est acquitté du mieux qu'il a pu. La responsabilité morale de ses actes lui incombe bien moins qu'à ceux qui avaient pouvoir de les bénir et de les absoudre au nom de Jésus-Christ.
105 Pierre des Vaux de Cernay, op. cit., ch. LXXXIII.
106 "Chanson de la Croisade", ch. CXLIV.
107 Op. cit., ch. CXLV, 3265-3274.
108 Op. cit., ch. CL, 3547-3553.
109 Décret du concile, promulgué le 14 décembre 1215.
110 Pierre des Vaux de Cernay, op. cit., ch. LXXX1II.
111 Op. cit., ch. CIII.
112 Pierre des Vaux de Cernay, op. cit., ch. LXXXIII.
113 Id.
114 Guillaume de Puylaurens, ch. XXIX.
115 "Chanson de la Croisade", ch. CLXXII, 5112-5113.
116 Op. cit., ch. CLXXVIII, 5532-5537.
117 Op. cit., id., 5542-5548.
118 Op. cit., ch. CLXXIX, 5640-5647.
119 Op. cit., ch. LXXXTV.
120 "Chanson de la Croisade", ch. CLXXXII, 5861-5868.
121 Id., 5852-5858.
122 Op. cit., ch. CLXXXIII, 5952-5963.
123 Op. cit., ch. CLXXXIX, 6486-6488.
124 Op. cit., ch. CC, 7913-7917.
125 Guillaume de Puylaurens, ch. XXX.
126 Op. cit., ch. CCV, 8452-8456.
127 Op. cit., id., 8479-8484.
128 Op. cit., ch. CCVIII, 8681-8693.
CHAPITRE VII
LE ROI DE FRANCE
I - VICTOIRE DE RAYMOND VII
La mort de Simon de Montfort fut accueillie dans le Languedoc avec des transports de joie; cette joie, faisant tache d'huile, se répandait dans le pays, redonnant des forces nouvelles à ceux qui depuis si longtemps se désespéraient de voir cet homme impitoyable triompher partout. Cette mort semblait être la fin d'un long cauchemar, le miracle tant attendu.
Montfort
Es mort
Es mort
Es mort!
Viva Tolosa
Ciotat gloriosa
Et poderosa!
Tornan lo paratge et l'onor!
Montfort
Es mort!
Es mort!
Es mort!
clame une chanson populaire du temps. Le Parage et l'honneur reviennent. Le tyran - car les peuples du Midi veulent espérer que tout le mal dont ils étaient accablés venait de Montfort - n'est plus qu'un cadavre couché dans un somptueux caveau de Carcassonne. Ses amis en font un martyr et le comparent à Judas Macchabée et à saint Étienne; par sa mort l'œuvre de la croisade est ruinée, il a beau avoir laissé dans le pays des parents et des compagnons d'armes courageux et encore redoutables, en perdant leur chef, ils ont perdu leur confiance en eux-mêmes.
Amaury de Montfort appelle à son aide le roi de France et le pape prêche une nouvelle croisade et presse Philippe Auguste d'envoyer une armée dans le Languedoc. Pendant ce temps, Raymond VII reconquiert l'Agenais et le Rouergue et remporte, devant Baziège, une victoire en rase campagne sur les troupes françaises.
Le prince Louis fait une seconde fois son apparition dans le Midi de la France: cette fois-ci, son père n'a pas fait de difficultés pour le laisser se croiser. Il amène 20 évêques, 30 comtes, 600 chevaliers et 10000 archers, armée redoutable qui eût dû, semble-t-il, effrayer des populations déjà épuisées par dix ans de guerre. Il fait sa jonction avec les troupes d'Amaury de Montfort devant Marmande et prend la ville, où un massacre terrible a lieu. Si la garnison et son chef Centulle, comte d'Astarac, sont épargnés (car on pense les échanger contre des prisonniers français), les vainqueurs s'acharnent sur la population civile: "...on court vers la ville avec des armes tranchantes, et alors commencent le massacre et l'effroyable boucherie. Les barons, les dames, les petits enfants, les hommes, les femmes, dépouillés et nus, sont passés au fil de l'épée. Les chairs, le sang, les cervelles, les troncs, les membres, les corps ouverts et pourfendus, les foies, les cœurs, mis en morceaux, brisés, gisent par les places comme s'il en avait plu. Du sang répandu, la terre, le sol, la rive sont rougis. Il ne reste homme ni femme jeune ou vieux: aucune créature n'échappe à moins de s'être tenue cachée. La ville est détruite, le feu l'embrase129".
L'auteur de la "Chanson" estime que la majorité de la population de la ville fut massacrée. Guillaume Le Breton reconnaît, de son côté, qu'on a tué à Marmande "tous les bourgeois avec les femmes et les petits enfants, tous les habitants jusqu'au nombre de 5000130".
On a pu voir dans ce massacre, exécuté de sang-froid (puisqu'il fut précédé d'une longue délibération au sujet du sort de la garnison), un effet de la colère d'Amaury, désireux de venger son père. C'était, plus probablement, une répétition consciente du massacre de Béziers qui, en terrorisant les populations, avait donné de si heureux résultats. Il est assez singulier de voir évêques et barons discuter sur le "déshonneur" qu'ils s'attireraient en mettant à mort des soldats, et lâcher ensuite leurs troupes sur des bourgeois sans défense, des femmes et des enfants. Il semble que (pour les chevaliers du Nord plus que pour ceux du Midi) les bourgeois aient été des êtres de race inférieure et dont le massacre tirait à peine à conséquence. Le pieux prince Louis ne fit rien pour empêcher cette odieuse manœuvre d'intimidation. Mais, de leur côté, les peuples du Languedoc, aguerris par dix ans de croisades, se gardèrent bien d'y répondre, comme ils le firent après Béziers, par des capitulations en masse. Le pays était depuis longtemps habitué à la terreur.
Lorsque après ce sanglant exploit, l'armée royale marche sur Toulouse, elle trouva une ville fortifiée et organisée pour la défense. Raymond VII s'y était enfermé avec mille chevaliers. Devant le danger, il fit un appel au peuple et fit exposer sous la voûte de la cathédrale les reliques de saint Exupère131; pour la troisième fois le peuple de Toulouse se préparait au siège dans l'enthousiasme.
Le siège, commencé le 16 juin 1219, est levé le 1 août; la grande armée du prince Louis, après avoir complètement investi et isolé la ville et donné de vigoureux assauts, constate que les assiégés ne sont nullement décidés à capituler. Venu dans le pays pour y semer la crainte due au prestige de la puissance royale, le prince comprend qu'il a affaire à forte partie et préfère, comme l'ont fait les troupes des croisés des premières années de la guerre, laisser Amaury de Montfort se maintenir dans le pays à ses risques et périls. Sa quarantaine à peine terminée, Louis lève le siège, en abandonnant ses machines de guerre.
Ce brusque départ surprit les contemporains, qui l'ont attribué à une trahison des chevaliers français, ou à une entente secrète entre le prince et Raymond VII, ou encore à un calcul perfide de Louis qui, convoitant le pays de Toulouse pour lui-même, n'avait pas intérêt à le reconquérir au profit d'Amaury. Dans tous les cas, c'était la couronne de France qui subissait, par ce nouveau triomphe de Toulouse, un échec éclatant. La gloire du jeune comte ne cesse de grandir, et c'est à présent la noblesse du Midi qui fait la chasse aux barons du Nord installés sur ses terres, les dépossède de leurs domaines, leur retire les titres qu'ils avaient usurpés.
Ces barons, que Simon de Montfort avait placés dans les châteaux et places fortes conquis par lui pour s'assurer de leur fidélité, n'étaient pas, il faut le croire, de zélés serviteurs de la foi, car le catholique Guillaume de Puylaurens les dépeint ainsi: "Au demeurant, on ne doit ni ne peut raconter à quelles infamies ils se livraient (les serviteurs de Dieu); la plupart avaient des concubines et les entretenaient publiquement; ils enlevaient de vive force les femmes d'autrui et commettaient impudemment ces méfaits et mille autres de ce genre. Or, ce n'était pas, bien sûr, dans l'esprit qui les avait amenés qu'ils agissaient ainsi, la fin ne répondait pas au commencement132". Deux chevaliers, les frères Foucaut et Jean de Berzy (que, d'après la "Chanson", Amaury et le prince Louis tenaient pour si précieux qu'ils avaient épargné la garnison de Marmande pour pouvoir les libérer), étaient de véritables bandits, connus à la fois pour leur avarice et leur cruauté: Guillaume de Puylaurens affirme qu'ils mettaient à mort tous les prisonniers qui ne pouvaient leur payer cent sous d'or (somme exorbitante) et avaient une fois forcé un père à pendre son propre fils. Faits prisonniers par Raymond VII, ils furent décapités.
La garnison française de Lavaur est massacrée; Guy, le frère d'Amaury, est blessé et meurt prisonnier, et malgré les efforts du pape qui somme les comtes (le jeune Raymond et le comte de Foix) de se soumettre, les Français ne subissent plus que des revers. Alain de Roucy, le meurtrier du roi d'Aragon, est tué dans le château de Montréal qu'il tenait de Montfort. Les renforts amenés à Amaury par les évêques de Clermont et de Limoges et l'archevêque de Bourges n'empêchent pas Raymond VII de se soumettre entièrement l'Agenais et le Quercy. Amaury ne tient plus que dans le Sud où Narbonne et Carcassonne lui restent encore fidèles.
Le roi de France, malgré les demandes réitérées du pape, refuse de s'occuper de cette affaire. L'échec de son fils l'a découragé, comme il a découragé les grands barons français, et l'exemple de Simon de Montfort donnait à réfléchir à tous ceux qui pouvaient être poussés vers le Languedoc par un désir de conquêtes. Le jeune comte triomphait et redevenait, dans l'esprit de tous, le cousin, le neveu et le pair de la plupart des potentats - couronnés ou non - de l'Occident. Il fait, auprès du roi de France, des démarches en vue d'obtenir sa réconciliation avec l'Église, et lui offre son serment de vassal pour une terre que le roi avait, cinq ans plus tôt, accordée aux Montfort.
On ne sait ce que Philippe Auguste eût finalement décidé au sujet de ce vassal dépossédé par l'Église; Amaury de Montfort, voyant la partie perdue, lui avait offert ses domaines et le roi avait décliné cette offre: il préférait sans doute laisser les deux rivaux s'épuiser dans une guerre dont il n'aurait pas à faire les frais.
En août 1222, le vieux comte de Toulouse mourait à l'âge de soixante-six ans. Cet homme qui fut, sinon la cause, du moins le prétexte de la croisade, cet homme calomnié, humilié, traqué, spolié, haï par l'Église, vénéré de ses sujets, revenu en triomphe après la défaite la plus totale et accueilli comme un sauveur par son pays au moment où il ne possédait plus rien, ce souverain légitime dépouillé par l'Église et le roi et rétabli dans ses droits par la volonté du peuple, a pu croire, en mourant, que sa cause avait triomphé. Son fils, auquel il avait eu l'habileté de céder sa place, du moins officiellement, était déjà le chef du pays et pouvait continuer son œuvre; l'élimination d'Amaury de Montfort n'était plus qu'une question de temps; le Languedoc retrouvait, avec sa liberté, une union nationale qu'il n'avait jamais connue avant la croisade, et les comtes de Toulouse s'étaient acquis une popularité dont autrefois ils n'avaient jamais rêvé.
Cependant, le comte mourait excommunié, et malgré son désir et ses prières, il fut privé, à son lit de mort, des derniers sacrements. Son testament, ainsi que tous les témoignages (produits lors de l'enquête ordonnée par son fils) attestent qu'il est mort dans la foi catholique; il était affilié à l'ordre des Chevaliers de l'Hôpital, et avait exprimé le vœu d'être enterré dans l'hôpital de Saint-Jean-de-Jérusalem, édifice appartenant à cet ordre.
Si sa mort fut assombrie par la douleur d'être privé des secours de la religion. Son corps, après sa mort, devait subir jusqu'au bout des humiliations réservées aux excommuniés: privé de sépulture en terre consacrée, le cadavre resta pendant des années enfermé dans un cercueil abandonné dans le jardin près du cimetière, et son fils devait pendant vingt-cinq ans implorer vainement le Saint-Siège et multiplier les enquêtes et les démarches sans obtenir satisfaction. Le corps, mal gardé, fut mangé par les rats, les ossements dispersés, le crâne fut ensuite tiré du cercueil et conservé par les Hospitaliers.
Après la mort de son père, le jeune comte (il a déjà vingt-six ans) continue la reconquête méthodique du pays. Les Français ne sont même plus les tyrans détestés de naguère, mais des étrangers indésirables qu'il faut chasser du pays au plus tôt. Les deux partis sont excédés par cette guerre qui ne leur apparaît plus comme une nécessité vitale. En mai 1223, une trêve est conclue entre le jeune comte et Amaury de Montfort, trêve devant servir de préliminaire à une conférence de paix qui siégera à Saint-Flour. Et si, à Saint-Flour, les deux adversaires ne parviennent pas à un accord, on constate néanmoins une détente, et Raymond VII manifeste même tant de bonne volonté à l'égard d'Amaury qu'il s'engage à épouser la sœur de ce dernier après avoir répudié Sancie d'Aragon.
Guillaume de Puylaurens133 raconte que durant cette trêve, le comte s'était livré à une plaisanterie d'un goût douteux en faisant croire, un jour qu'il se trouvait à Carcassonne chez Amaury de Montfort, qu'on l'avait fait arrêter; sa suite, épouvantée, s'enfuit et les deux comtes en rient ensemble. On nous dit que Raymond VII "aimait rire"; était-ce aussi le cas d'Amaury? La guerre dans laquelle leurs deux pères avaient usé leurs forces et laissé leur vie pouvait-elle déjà être un sujet de plaisanteries pour ces garçons de vingt-cinq ans? Raymond triomphait sans haine, Amaury se défendait sans désespoir, ils se connaissaient depuis l'adolescence et, vivant depuis près de quinze ans dans une atmosphère de sang, de cruauté, de trahison et de vengeance, ils devaient être las de haïr; et ils ne devaient pas être les seuls.
La trêve n'aboutit pas à une paix, les deux parties en appelèrent au roi de France et un concile se réunit à Sens. Mais Philippe Auguste, déjà gravement malade, devait mourir avant d'avoir pu s'y rendre, le 14 juillet 1223; et son fils, préoccupé par les tâches urgentes que lui imposait son accession au trône paternel, ne put rien décider et se contenta de faire envoyer à Amaury un subside de dix mille marcs d'argent. La guerre reprit.
La situation d'Amaury devient si critique que malgré l'aide que lui procure le vieil archevêque de Narbonne, Arnaud-Amaury (qui a oublié sa haine contre Montfort et a même engagé une partie des biens de son église pour permettre au jeune comte de Montfort de payer ses troupes), il ne peut retenir auprès de lui que vingt chevaliers, pour la plupart vieux compagnons d'armes de son père. Il a beau offrir en gage ses domaines de France, personne ne veut plus lui prêter d'argent, et pourtant il ne pense plus qu'à organiser son départ.
Trop heureux d'être enfin débarrassés de lui, les comtes de Toulouse et de Foix signent avec Amaury un accord (le 14 janvier 1224). Ils promettent de respecter les personnes et les biens de ceux qui, pendant la guerre, avaient pactisé avec Montfort, de ne pas toucher aux garnisons qu'Amaury laissait dans Narbonne, Agde, Penne d'Albigeois, Valzergues et Termes; Carcassonne, Minerve et Penne d'Agenais restent (en principe) à Montfort. Amaury de Montfort quitte Carcassonne en emportant les corps de son père et de son frère; il est tellement à court d'argent qu'il doit, en route, laisser en gage son oncle Guy et d'autres chevaliers à des marchands d'Amiens, pour la somme de quatre mille livres. Aussitôt après son départ, Carcassonne est reprise par les comtes et rendue au jeune Raymond Trencavel, fils du vicomte Raymond-Roger. Le jeune prince rentre en possession de ses domaines aux acclamations du peuple, et, quinze ans après le massacre de Béziers, les terres occitanes retrouvent leurs anciens seigneurs (ou du moins leurs fils) et les peuples peuvent se croire un instant revenus au temps de leur indépendance d'autrefois.
II - LA CROISADE DU ROI LOUIS
Il n'en était rien. Cette indépendance n'était plus qu'une ombre. Juridiquement elle était mise en question à la fois par l'Église et par la royauté capétienne. Pratiquement elle était à la merci d'une nouvelle guerre qu'un pays épuisé, saigné à blanc, ne pouvait plus soutenir.
Pour réparer ses pertes le Languedoc aurait eu besoin de vingt, de trente ans de paix. Il ne lui fut laissé qu'un répit de trois ans à peine. Et ce n'était même pas un répit, car la perspective d'une nouvelle croisade était suspendue au-dessus de sa tête en permanence et, dès le début de 1225 (même pas un an après le départ d'Amaury), le pape Honorius III presse énergiquement le roi de France pour l'engager à se croiser. Les négociations qui ont lieu entre le roi et le pape font traîner en longueur les préparatifs de la croisade, mais ne sont plus guère que des marchandages par lesquels les deux alliés cherchent à délimiter leurs zones d'influence et où chacun veut obtenir de l'autre des promesses et des garanties pour l'avenir. Mais tous deux savent que l'œuvre si bien commencé doit être menée à bonne fin, et rapidement, avant que l'adversaire ait eu le temps de reprendre des forces.
Aux appels du pape le roi répond en posant des conditions: il demande des indulgences plénières pour ses croisés, exige l'excommunication pour tous ceux qui attaqueraient ses domaines en son absence, et même pour tous ceux qui refuseraient de le suivre ou de le soutenir financièrement; il demande à l'Église des subsides de soixante mille livres par an, pour une période de dix ans; le pape devra nommer légat l'archevêque de Bourges et, enfin, déposséder solennellement et définitivement les comtes de Toulouse et les Trencavel, et confirmer le roi dans la possession de leurs domaines.
Le pape hésite, se disant sans doute que le roi ne songe qu'à agrandir ses domaines aux frais de l'Église; un comte de Toulouse affaibli, d'ailleurs excommunié et sans cesse menacé à la fois par le roi et par l'Église, pourrait peut-être mieux faire le jeu de la papauté qu'un roi de France trop puissant: ce en quoi le pape ne se trompait pas; et si, pour l'Église, un roi de France tel que saint Louis devait être une chance inespérée, son petit-fils Philippe le Bel fera voir, à Anagni, qu'une France trop forte et trop centralisée ne se soucie pas de rester éternellement le "soldat de Dieu". Ce danger-là, si Honorius III le prévoyait, était moins imminent que celui de l'hérésie renaissante. Préoccupé d'ailleurs par le sort de la Terre Sainte, et ne voulant pas risquer d'immobiliser dans le Languedoc toute la chevalerie française disponible, le pape ne perd pas de vue le but véritable de la croisade albigeoise: il tente de forcer le comte Raymond à persécuter lui-même les hérétiques, en faisant peser sur lui la menace d'une nouvelle invasion française.
Le roi de son côté, voyant le pape disposé à traiter avec Raymond, déclare qu'en ce cas cette affaire d'hérésie ne le concerne plus. Le comte, reconnaissant, cherche à prouver sa bonne volonté au Saint-Siège et jure au concile de Montpellier (août 1224) de poursuivre les hérétiques, de chasser les routiers et de dédommager les églises spoliées ainsi que le comte de Montfort, si toutefois celui-ci s'engage à renoncer à ses prétentions.
Peu satisfait sans doute par les promesses de Raymond, et craignant de mécontenter le roi de France, le pape fait traîner les négociations, et finit par convoquer un concile, qui se tiendra à Bourges, et où les arguments des deux prétendants au comté de Toulouse seront entendus par une assemblée de représentants de l'Église; le 30 novembre 1225, quatorze archevêques, cent treize évêques et cent cinquante abbés de toutes les provinces de la France du Nord et du Midi se réunissent à Bourges; il est clair qu'un jury composé de prélats ne pouvait donner raison à Raymond VII, excommunié et suspect de favoriser l'hérésie; sa cause était donc perdue d'avance.
Présidé par le nouveau cardinal-légat, Romain de Saint-Ange, le concile se contenta de recueillir les dossiers des deux parties, et de renvoyer le comte de Toulouse en remettant la décision à une date ultérieure. Comme au temps où les légats refusaient d'entendre les justifications de Raymond VI, les prélats du concile de Bourges ne cherchaient qu'un moyen légal de condamner le comte sans l'entendre; il ne fallait pas lui permettre de donner publiquement les garanties que l'Église exigeait de lui, et qu'il était tout prêt à fournir. Les évêques doutaient de sa bonne foi, et le roi ne voulait pas risquer de perdre, avec les droits d'Amaury, ses propres droits sur le Languedoc.
Ce fut donc en l'absence des intéressés que fut prononcée la sentence d'excommunication (réitérée) contre Raymond VII, le comte de Foix et le vicomte de Béziers (28 janvier 1226). En même temps, Amaury de Montfort vendait au roi ses droits et titres; et, d'accord avec l'Église, le roi devenait enfin maître légitime du Languedoc, à l'exclusion des véritables suzerains.
Cette fois, il ne s'agit plus d'une croisade prêchée sur les parvis des églises et du haut des chaires des cathédrales; ce n'est une croisade que de nom, c'est le roi de France qui part en guerre pour conquérir une province, après une série de démarches diplomatiques plus ou moins laborieuses destinées à fournil un prétexte légal à cette conquête. Il est bien évident que tout ce trafic d'hommages reçus, offerts, refusés, vendus, acceptés, n'avait aucune valeur en soi et, même sanctionné par l'Église, n'avait d'autre justification que le droit du plus fort. Ce n'est pas sa haine pour l'hérésie qui pousse le roi à exiger le concours de l'Église, teint financier que moral, et à ne se croiser que le jour où il aura arraché à la papauté la reconnaissance formelle de ses droits à la possession entière et sans réserves des terres du Midi. Il se sert de l'Église comme l'Église se sert de lui.
Pour cette guerre de conquête Louis VIII entend bénéficier de tous les avantages accordés par l'Église aux soldats de Dieu et des subsides de l'Église. Avec d'aussi puissants atouts le roi réussit à lever une armée considérable. Malgré son importance numérique, la valeur de ses chevaliers et la magnificence de son équipement, nous verrons que cette armée n'était ni très unie, ni animée d'un enthousiasme exagéré. L'affaire du Languedoc, devenue entreprise personnelle du roi, n'exaltait sans doute ni les fanatiques ni les grands ambitieux; pour obliger ses barons à se croiser, le roi est forcé d'imposer de lourdes pénalités à ceux qui se refuseraient à partir. Les clercs eux-mêmes sont mécontents, car on les oblige à verser pour la croisade le dixième de leurs revenus, qu'on leur prend d'office.
Le roi a pris la croix en janvier 1226, et en juin son armée se met en marche. Elle semble avoir été plus forte, numériquement, que celle qui descendit le Rhône en 1209 et marche sur Béziers. Elle était probablement moins redoutable. Mais son approche jeta les populations du Midi dans une consternation telle que le comte de Toulouse, bien que décidé à se défendre, dut se rendre compte que la partie était d'ores et déjà perdue.
Louis VIII, l'auteur de la boucherie de Marmande, ne pouvait inspirer aux Méridionaux ni confiance ni respect. Tout pieux et bénin qu'il fût, il devait jouir dans le pays d'une grande réputation de férocité car, à la nouvelle de son prochain départ, dès le printemps 1226, de nombreux seigneurs du Midi s'empressèrent de faire acte de soumission au roi: c'est le cas d'Héracle de Mondaur, de Pierre Bermond de Sauve (gendre de feu Raymond VI) qui vont jusqu'à se rendre directement à Paris; de Pons de Thézan, Bérenger de Puisserguier, Pons et Frotard d'Olargues, Pierre-Raymond de Comeilhan, Bernard-Othon de Laurac, Raymond de Roquefeuil, Pierre de Villeneuve, Guillaume Méchin, etc. Or, ces seigneurs appartenaient à la noblesse fidèle aux comtes de Toulouse; on voit leurs noms dans les listes de ceux qui accompagnèrent Raymond VI au concile de Latran, qui plus tard se révoltèrent contre l'autorité française sous Raymond VII; Bernard-Othon de Laurac (ou de Niort) était hérétique et devait, quelques années plus tard, subir maintes persécutions pour sa foi, et c'est pourtant lui qui écrira (ou fera écrire) à Louis VIII: "Nous sommes avides de nous placer sous l'ombre de vos ailes et sous votre sage domination". Il faudrait être assez naïf pour croire à la sincérité de ces protestations de loyalisme.
Les villes, apprenant que l'armée du roi s'est mise en marche, envoient des députations et protestent de leur fidélité au roi. Béziers d'abord, puis Nîmes, Puylaurens, Castres; puis, pendant le siège d'Avignon, Carcassonne, Albi, Saint-Gifles, Marseille, Beaucaire, Narbonne, Termes, Arles, Tarascon et Orange. Cette liste est assez éloquente en elle-même: la terreur seule pouvait provoquer cette grêle de soumissions spontanées; ces villes où les Français étaient haïs, et qui étaient farouchement jalouses de leur indépendance ne pouvaient avoir la moindre envie de se placer à l'ombre des ailes du roi. Elles se souvenaient de Béziers et de Marmande.
Le comte de Toulouse, loin de se soumettre, rassemble ses vassaux les plus fidèles et en premier lieu Roger-Bernard de Foix et Raymond Trencavel, et appelle à son aide son cousin germain Henri III d'Angleterre, et Hugues X de Lusignan comte de La Marche, au fils duquel il projette de marier sa fille unique. Ce dernier n'ose marcher contre le roi de France, et Henri III, menacé d'excommunication par le pape, se contente d'ébaucher un projet d'alliance. En fait, Raymond VII ne peut guère compter que sur Toulouse et sur une armée assez faible par suite de la défection d'un grand nombre de barons. Il compte aussi sur le temps qui lui ramènera ses sujets, le premier moment de terreur passé.
L'armée royale s'arrête devant Avignon qui, après avoir protesté de son obéissance, lui refuse le passage; le 10 juin, le roi, "pour venger l'injure faite à l'armée du Christ", prête le serment de ne pas bouger de place avant d'avoir pris la ville et fait dresser les machines de guerre. Le premier effroi passé, Avignon est décidée à tenir. De plus, ville d'Empire, elle n'entend pas se laisser faire la loi par le roi de France. Les murs de la ville sont solides et défendus par une milice nombreuse et une forte garnison de routiers. Avignon se défendit si énergiquement que pendant deux mois on put hésiter sur l'issue de la guerre. Mais pendant que ses soldats étaient exposés à la faim, aux épidémies, aux flèches et aux boulets des assiégés et aux attaques des armées du comte de Toulouse qui harcelaient les arrières de l'armée royale, le roi recevait les députations des seigneurs et des villes du Midi que la présence des croisés et la crainte de nouveaux massacres incitaient à la soumission. Les prélats, en particulier Foulques et le nouvel archevêque de Narbonne, Pierre-Amiel, négociaient ces capitulations anticipées, promettant de la part du roi paix et clémence.
À Carcassonne, les consuls et le peuple, terrorisés, chassent le vicomte Raymond et le comte de Foix. Le comte de Provence vient devant Avignon assiégée solliciter la protection du roi. Narbonne, où le parti catholique fut toujours puissant; Castres, Albi se rendent avant l'approche de l'armée royale. Et cependant Avignon tenait bon et ses défenseurs allaient même jusqu'à attaquer le camp du roi. Dans l'armée croisée le mécontentement grandissait, et des barons tels que le comte de Champagne et le duc de Bretagne manifestaient leur désir de rentrer dans leurs pays.
Thibaut de Champagne quitta le roi bien avant la fin du siège, sa quarantaine terminée. Mais la ville, bloquée, commençait à souffrir de la famine, et le légat Romain de Saint-Ange négocia la capitulation. Après trois mois de siège, Avignon se rendit et dut accepter les conditions du vainqueur; livraison d'otages, destruction des remparts et des maisons fortifiées, lourdes contributions financières. Jamais encore cette grande cité libre, vassale de l'empereur et réputée imprenable, n'avait subi de traitement pareil.
Frédéric II devait d'ailleurs protester (assez inutilement) auprès du pape contre cette violation de ses droits. Le roi n'en tint pas compte et laissa dans là ville une garnison française. La capitulation d'Avignon fut un coup de chance pour l'armée royale: quelques jours après, une crue de la Durance noyait l'emplacement du camp croisé.
Une chance d'autant plus grande que les cités de l'Albigeois et du Carcassès, qui s'étaient contentées d'une soumission toute théorique tant que le roi était immobilisé devant Avignon, lui ouvrirent leurs portes, et acceptèrent sans discuter toutes ses conditions: la chute d'Avignon, une des plus grandes villes des Gaules, impressionna le pays presque autant que l'eût fait la chute de Toulouse.
Le roi occupe Beaucaire, puis toutes les grandes villes qui jalonnent la route vers Toulouse, de Béziers à Puylaurens, sans coup férir. Devant Toulouse, il s'arrête. La capitale du Languedoc n'avait envoyé aucun message, aucune députation, et le comte avec ses troupes, très inférieures en nombre à celle du roi, talonne l'armée royale, lui livre une guerre d'embuscades et d'escarmouches, tombant sur les traînards et les éclaireurs; et ces mêmes seigneurs qui, quelques mois plus tôt, avaient fait envoyer au roi des lettres où ils le saluaient comme un sauveur, "arrosant ses pieds de larmes et avec des prières larmoyantes" (lettre de Sicard de Puylaurens), loin de lui prêter hommage, se retirent dans les montagnes et se préparent à la défense.
Le roi rétablit dans leurs fiefs les anciens compagnons de Montfort, et Guy de Montfort, auquel il donne (ou rend) Castres; laisse des sénéchaux dans toutes les villes qu'il a occupées; et, des Pyrénées au Quercy, du Rhône à la Garonne, reçoit les clefs des villes soumises d'avance, et traîne une armée démoralisée, décimée par les maladies, mais tirant sa force de l'immense détresse d'un pays épuisé par quinze ans de guerre. En octobre 1226, l'armée royale n'avait ni la force ni l'envie d'entreprendre le siège de Toulouse: les chroniqueurs du temps sont unanimes à constater son découragement, sa fatigue, ses pertes nombreuses tant par la maladie que par la guerre; le roi, malade lui-même, mourra en route quelques jours après avoir quitté le Languedoc.
Si chaque ville avait résisté comme l'avait fait Avignon, la croisade royale eût tourné au désastre total. Mais le roi et le légat avaient bien calculé leur coup: ils attaquaient un blessé à peine convalescent et encore incapable de se tenir debout; Avignon n'avait pas souffert de la guerre au temps de Simon de Montfort. Encore les demi-vainqueurs se retiraient-ils épuisés eux-mêmes, la force de la résistance passive du pays étant encore assez grande pour rendre la campagne pénible et semée d'embûches. Le retour des croisés qui ramèneront, cousu dans une peau de bœuf, le cadavre du pieux roi, n'aura rien d'un retour triomphal.
Mort à trente-sept ans, Louis VIII laissait le trône à un enfant de onze ans, et la régence à une veuve obligée de faire face à la révolte des grands vassaux. Pour le malheur du Languedoc, cette veuve se trouvait être Blanche de Castille, femme douée de plus d'énergie et d'ambition que n'en eurent jamais son mari ni son fils. Si les Méridionaux ont pu se réjouir de la mort de Louis, ils allaient vite comprendre qu'ils étaient tombés de Charybde en Scylla; et les troubadours, plus tard, regretteront le "bon roi Louis134".
L'armée, que le roi a laissée en Languedoc pour garder les territoires conquis, est plus importante que celle dont disposait Simon de Montfort en septembre 1209. Sa situation est moins précaire: lieutenant du roi, le sénéchal Humbert de Beaujeu ne dépend pas du bon plaisir des croisés de passage; le roi de France est tenu de lui envoyer des secours. Cependant, dès l'hiver 1226-1227, les comtes de Toulouse et de Foix reprennent Auterive, La Bessède et Limoux; la noblesse méridionale se regroupe, le peuple se soulève contre les Français; Humbert de Beaujeu demande des renforts de France, car, s'il est solidement établi à Carcassonne (qui, ayant pendant quinze ans servi de quartier général aux Montfort, était tout naturellement devenue celui de l'armée royale), les villes et les châteaux environnants sont revenus à leurs anciens seigneurs.
La régente, aux prises avec la coalition des grands vassaux - les comtes de La Marche, de Champagne, de Boulogne, de Bretagne, - a besoin d'argent, et songe à utiliser pour sa guerre féodale le décime accordé par l'Église pour la croisade en Albigeois; les prélats refusent de payer, malgré la colère du légat, Romain de Saint-Ange, qui prend ici parti pour la reine contre l'Église. Et, comme les évêques en appellent au pape, Blanche de Castille n'obtient l'argent qu'en envoyant des renforts à Humbert de Beaujeu. Et si, par des promesses ou des menaces, elle parvient à triompher rapidement de la ligue des vassaux, l'affaire du Languedoc est pour elle une source de graves difficultés; cette province dont son mari avait commencé la conquête, et que la couronne de France ne pouvait plus lâcher sans perdre la face, ne semblait pouvoir être réduite que par des expéditions armées importantes, renouvelées chaque année; avec la menace permanente que constituait l'Angleterre, la reine ne pouvait se permettre d'immobiliser ses forces dans le Midi. Et le pape la pressait sans cesse de reprendre la guerre sainte contre l'hérésie.
Blanche de Castille ne songe pas à profiter de son état de femme et de veuve pour se dérober à ses responsabilités: malgré les menaces qui pèsent sur elle dans le Nord, elle parvient à entretenir dans le Languedoc des troupes suffisantes pour harceler et affaiblir l'adversaire, sinon pour l'écraser. Avec les renforts envoyés au printemps 1227, Humbert de Beaujeu reprendra le château de La Bessède, dont il fera massacrer la garnison, et ravagera les campagnes dans la région du Tarn. L'année suivante, il avancera dans le comté de Foix (où Guy de Montfort sera tué devant Varilles) et, s'il perdra Castelsarrasin, il reprendra le château de Montech. Puis, avec de nouveaux renforts amenés par les archevêques d'Auch, de Narbonne, de Bordeaux et de Bourges, il marchera sur Toulouse, toujours imprenable. Le plan des Français n'est plus de remporter des victoires militaires, mais de ruiner le pays afin de le rendre peu à peu incapable de se défendre.
C'est ce que montre d'une façon très explicite Guillaume de Puylaurens, en décrivant les ravages que fait l'armé d'Humbert de Beaujeu devant Toulouse: conduits et animés par Foulques (l'évêque transfuge qui, ne pouvant rentrer dans sa ville, est rempli de sainte colère contre ses diocésains), les croisés se livrent à une destruction systématique des environs de la ville. En été 1227, les Français installent leur camp à l'est de Toulouse, et de là, jour après jour, ils organisent des expéditions contre les vignobles, les champs de blé, les vergers et, se transformant en cultivateurs à rebours, fauchent les champs, arrachent les vignes, démolissent les fermes et les maisons fortifiées.
"...Dès l'aurore, dit l'historien, les croisés entendaient la messe, déjeunaient sobrement et se mettaient en marche, précédés d'une avant-garde d'archers... Ils commençaient le dégât par les vignes les plus rapprochées de la ville, à l'heure où les habitants étaient à peine éveillés; ils se retiraient ensuite dans la direction du camp, suivis pas à pas par les troupes de bataille, tout en continuant leur œuvre de destruction. Ils agirent de même chaque jour, pendant trois mois environ, jusqu'à ce que la dévastation fût à peu près complète135".
L'historien, grand admirateur de Foulques, ajoute: "Je me souviens que le pieux évêque disait, en voyant revenir ces ravageurs qui semblaient des gens en fuite: "C'est en fuyant ainsi que nous triomphons de 'nos ennemis d'une merveilleuse manière'. En effet, on invitait de cette façon les Toulousains à se convertir et à s'humilier, en leur enlevant ce qui faisait leur orgueil. C'est ainsi qu'à l'égard d'un malade on agit sagement en éloignant de sa main ce qui pourrait lui nuire s'il en prenait trop. Le pieux évêque agissait comme un père qui ne châtie ses enfants que par affection".
Remarque assez cynique, si l'on pense que ce qui faisait l'"orgueil" des Toulousains, et ce dont ils risquaient de "prendre trop", était tout bonnement leur pain quotidien.
Le comte, occupé par la guerre, désireux de reconquérir sur les Français les places fortes et les points stratégiques, ne disposait pas de forces suffisantes pour s'opposer à cette dévastation de ses domaines. Ce ne sont pas des troupes de vagabonds, mais une armée puissante et bien organisée qui se livre avec méthode à cette guerre sans combat où les adversaires sont les blés, les ceps de vigne et le bétail.
Et cependant, la lutte a retrouvé son âpreté de naguère et, en réponse au massacre de la garnison de La Bessède, les comtes mutilent atrocement les prisonniers (non chevaliers) capturés dans une bataille près de Montech et les lâchent dans la forêt, yeux crevés et mains coupées. Humbert de Beaujeu et les croisés et évêques qui l'accompagnent savent donc que le pays ne se soumettra jamais de bon gré à l'autorité royale; et ces terres ne comprendront "leur véritable intérêt", comme dit Guillaume de Puylaurens, que le jour où leur peuple cessera d'exister en tant que nation.
Le jour approche où le comte de Toulouse commencera à comprendre la nécessité d'un répit, fût-ce au prix d'une capitulation. D'un répit qui pût permettre au pays de panser ses blessures et de préparer sa revanche. Mais si, en consentant à des pourparlers en vue d'un traité de paix avec le roi, Raymond VII espérait procurer à son peuple une chance de retrouver pour quelque temps le repos et un minimum de prospérité, il sous-estimait l'intelligence et surtout le manque de scrupule de ses adversaires. La paix qu'il allait signer devait se révéler plus cruelle qu'une guerre; et sans avoir été vraiment vaincu, il allait se voir imposer des conditions qu'aucun monarque n'imposa jamais à son ennemi, même après la plus écrasante des victoires.
Si la lecture des clauses de ce traité nous stupéfie encore et si nous sommes tentés d'en chercher l'explication dans la rudesse des mœurs de l'époque, nous ne devons pas oublier que les contemporains en ont également été stupéfaits, et que ce triomphe non déguisé de la cause du plus fort était absolument contraire aux lois féodales. On peut se demander par quel étrange malentendu le comte, qui semble n'avoir manqué ni de bon sens ni de courage, a pu signer ce traité; il faut chercher l'explication de ce fait dans l'extrême misère où le peuple était réduit par la guerre.
La croisade royale n'avait fait qu'exaspérer la haine, et que pouvait-on attendre de bon d'un suzerain qui mettait tout son effort à ravager les terres et à déraciner les arbres? En 1229, le comte résiste encore, mais ses plus fidèles vassaux, tels les frères de Termes et Centulle d'Astarac, déposent les armes par crainte de voir leurs domaines subir le sort des environs de Toulouse. La capitale est menacée de famine. Les défaites infligées à des soldats ennemis, qui ne se battent pas sur leur propre sol et sont libres de retourner chez eux quand ils le veulent, paraissent dérisoires à côté des ravages que les combats font subir au pays depuis vingt ans.
Les Français ont perdu, en trois ans, le roi, l'archevêque de Reims, le comte de Namur, le comte de Saint-Pol, Bouchard de Marly, Guy de Montfort, pour ne compter que les chefs. Les pertes en hommes d'armes sont évaluées à vingt mille rien que pour la campagne de 1226, et bien que les historiens du temps n'aient pas pu dresser de statistiques exactes et aient sans doute exagéré les chiffres, il semble bien que les pertes de l'armée française aient été très lourdes. Et la reine et le légat (dont l'énergie ne pouvait cependant pas être mise en doute) se voyaient reprocher par le pape leur lenteur à sévir contre l'hérésie.
Le pape Grégoire IX, élu à la place d'Honorius III mort en 1227, n'est autre qu'Ugolin, cardinal-archevêque d'Ostie, grand ami de saint Dominique; ce vieillard, parent d'Innocent III, était doué d'un tempérament plus intransigeant et plus dominateur encore que celui de son cousin et prédécesseur. Et la régente, quelles que fussent son ambition politique et son zèle pour la foi, devait sans doute ressentir de l'amertume devant les exigences et les menaces dont l'accablait ce pape au moment où elle avait déjà tant de peine à faire respecter en France les droits de son fils mineur.
Bref, ce fut du côté français que vinrent les propositions de paix adressées à Raymond VII, par l'intermédiaire d'Élie Guérin, abbé de Grandselve. Les hérétiques, bien entendu, allaient faire les frais de cette paix, et là-dessus ni le comte ni ses amis ne pouvaient se faire d'illusions. Mais ils ne prévoyaient pas un traité de paix qui serait une annexion pure et simple de leur pays, un traité dont chacune des clauses à elle seule, constate Guillaume de Puylaurens, étonné, eût suffi pour la rançon du comte s'il avait été fait prisonnier. Cet ecclésiastique raisonnait encore en féodal, et jugeait selon des notions de droit que les tendances totalitaires des grandes monarchies et de l'Église allaient rendre de plus en plus fragiles. "C'est à Dieu et non aux hommes qu'il faut attribuer ce traité136", conclut le chroniqueur, avec plus de mélancolie sans doute qu'il ne veut l'avouer.
129 Op. cit., ch. CCXII, 9306-9321.
130 Guillaume Le Breton, Bouquet, XVII, 11 d.
131 Évêque de Toulouse qui protégea la ville contre les Vandales au Ve siècle.
132 Guillaume de Puylaurens, ch. XXXIII.
133 Guillaume de Puylaurens, ch. XXXIV.
134 Cf. Dom Vaissette, op. cit. Le chap. 65 du 1. XXIII: Poètes provençaux, dans le t. VI de l'éd. 1879. p. 556-559.
135 Guillaume de Puylaurens, ch. XXXVIII.
136 Guillaume de Puylaurens, ch. XXXIX.
CHAPITRE VIII
DERNIÈRES ANNÉES DE L'INDÉPENDANCE OCCITANE
I - CONSÉQUENCES DE LA GUERRE
Avant d'examiner les causes et les conséquences de ce désastreux traité, il faudrait essayer de comprendre ce que fut la vie du Languedoc dans ces années troublées, mais riches d'espérance qui suivirent la mort de Simon de Montfort.
Les cors et les trompes, les carillons et les cloches qui saluèrent à Toulouse la mort du conquérant retentirent dans des dizaines de villes, des centaines de châteaux qui, repris par les comtes, reconquis par leurs anciens propriétaires, saluaient leur liberté retrouvée.
Le poète de la "Chanson", qui arrête brutalement son récit au milieu des préparatifs du siège de Toulouse par le prince Louis, ne nous raconte pas l'épopée de ces années tragiques au cours desquelles le Midi ne sembla relever la tête que pour être mieux abattu. Mais il est le seul à nous avoir donné une image de ce que put être cette atmosphère de joie fiévreuse, de ferveur, de haine, d'angoisse et d'espoir dans laquelle les populations du Languedoc ont vécu les heures de leur incertaine libération.
Lui seul nous montre Toulouse se préparant à repousser Montfort et travaillant aux barricades tandis qu'à la lueur des flambeaux et des torches, tambours, timbres et clairons résonnent dans les rues et sur les remparts, et les filles et les femmes dansent sur les places en chantant des ballades. Le poète traduit et partage la tendresse exaltée du peuple pour ses comtes, le vieux et le jeune, et montre le peuple baisant à genoux les vêtements de Raymond VI et pleurant de joie, pour courir ensuite se saisir d'armes improvisées et se précipiter à la chasse aux Français, traqués dans les rues et égorgés. Il décrit l'acharnement terrible et presque joyeux des combats, et l'incessant flux et reflux de soldats triomphants ou repoussés, sur les remparts et les ponts, dans les fossés et dans les faubourgs. Il montre le saisissant tableau des armures brillantes, des heaumes et écus peints, vernis, étincelants au soleil, mêlés, au milieu du fracas des armes, à des pieds, des bras, des jambes coupés, des cervelles éclatées, jonchant le sol dans des ruisseaux de sang.
Témoin de ces jours terribles, il éprouve à les décrire une joie et un orgueil qui sont ceux d'un peuple tout entier, et il serait difficile de nier l'authenticité de ce témoignage, qui n'est partial que pour être trop véridique, et qui montre ce qu'est la liberté pour un peuple menacé de la perdre. Les premières années après la mort de Simon de Montfort, le pays dut vivre les mêmes heures, dans la même ivresse, dans le sang, la misère, les incendies et les feux de joie, les fêtes et les règlements de comptes.
Si les chefs du pays savaient quel danger représentaient encore les prétentions du roi et les anathèmes de l'Église, le peuple, débarrassé de ses oppresseurs, put croire que les mauvais jours étaient passés. Mais les comtes et les seigneurs légitimes rétablis dans leurs droits n'apportaient avec eux que "parage et honneur", et rien d'autre. La Provence et l'Aragon leur avaient fourni des renforts considérables en armes et en hommes, mais c'était encore le peuple du Languedoc qui avait eu à supporter les plus gros frais de la guerre.
Les bourgeois de Toulouse avaient donné sans compter de leurs biens et payé de leurs personnes, avec l'idée qu'il vaut mieux mourir que vivre dans la honte. Mais, après avoir triomphé de Montfort et du prince Louis, la capitale, une des premières villes d'Europe, se retrouvait avec ses maisons en ruines, ses coffres vides, son commerce ruiné, sa population mâle décimée - ce n'était pas pour rien que le pierrier qui lança le boulet qui tua Simon de Montfort était manié par des femmes. Une grande partie des milices toulousaines avait péri à Muret; nous ne savons quel fut le nombre des bourgeois tués dans les combats des rues lors de la révolte de Toulouse, mais il dut être grand puisque la chevalerie croisée avait lutté pendant deux jours contre un peuple mal armé dans une ville non fortifiée. Pendant les huit mois de siège, les milices qui formaient l'infanterie, l'artillerie et les services auxiliaires ont dû, comme dans tous les combats du moyen âge, subir des pertes infiniment plus lourdes que les chevaliers, protégés par leurs armures. Mais, les combattants mis à part, la population civile avait dû être sévèrement éprouvée par la faim, le froid, et les maladies par suite de la démolition de quartiers entiers, de l'impôt monstrueux prélevé par Montfort, et des privations exigées par le siège. Le comte Raymond y avait ensuite amené sa chevalerie et des troupes de mercenaires, et pendant le siège, ravitaillée du dehors, l'armée devait cependant vivre aux frais des Toulousains. Si la guerre enrichit certains commerces elle en paralyse d'autres, et pendant les années de croisade Toulouse (comme les autres grandes villes du Midi) avait cessé d'être le grand centre industriel et commercial qu'elle était avant 1209; fermée aux grandes foires, vidée de ses stocks de marchandises, elle avait besoin de plus d'une année de paix pour réparer ses pertes.
Si Narbonne avait été pratiquement épargnée, Carcassonne, dont tous les biens avaient été réquisitionnés par les croisés en 1209, avait retrouvé assez rapidement un semblant de prospérité, car Montfort qui s'y était installé avait intérêt à y encourager le commerce, et cette ville dut compter parmi ses bourgeois un grand nombre de profiteurs de guerre. Béziers, dévastée et brûlée, s'était relevée presque aussitôt, repeuplée sans doute par des personnes restées sans abri et des parasites de l'armée croisée, joints aux bourgeois qui avaient quitté la ville avant le désastre et étaient venus retrouver ce qui restait de leurs foyers; mais c'était désormais une ville ruinée, qui ne pouvait songer à reconquérir sa puissance et sa prospérité d'autrefois. Des villes comme Limoux, Castres, Pamiers avaient été données en fief à des compagnons de Montfort, qui ne s'étaient pas privés d'en exploiter les ressources au profit de la croisade et à leur propre profit. Les villes d'Agenais et du Quercy avaient souffert moins que les autres, et cependant Moissac avait subi un siège, Marmande avait été pillée et ses habitants massacrés, Montauban, fidèle aux comtes de Toulouse, avait pris une part active à la guerre et perdu bon nombre de ses soldats à la bataille de Muret. Même lorsqu'elles n'avaient pas subi les désastres de la guerre, les grandes cités du Midi, accablées de lourdes taxes par les évêques et les croisés, privées par la guerre d'une partie de leur activité commerciale, étaient considérablement appauvries.
Les grands châteaux, tels que Lavaur, Fanjeaux, Termes, Minerve, etc, qui étaient des centres d'une intense vie mondaine, spirituelle et intellectuelle, avaient souffert plus que les villes, et, pris d'assaut, dépeuplés, démantelés ou durement tenus par l'occupant, portaient le deuil de leurs défenseurs tués, dont les familles dispersées se regroupaient après la libération, comptant les morts et les disparus. Les bûchers de Minerve et de Lavaur, le puits où dame Guiraude avait été enfouie sous les pierres, le gibet d'Aimery de Montréal et de ses quatre-vingts chevaliers, les cent mutilés de Bram, et tant d'autres souvenirs tragiques qui ne sont pas parvenus jusqu'à nous, mais devaient vivre dans la mémoire des contemporains, invitaient à la vengeance et à la haine plus qu'à la joie.
Le comte de Foix parle (dans la "Chanson de la Croisade") de tous les croisés "traîtres sans honneur et sans foi" qu'il avait eu la chance de tuer ou de mutiler: "De ceux que j'ai tués ou détruits il m'en vient joie au cœur; de ceux qui me sont échappés ou ont fui, il m'en vient mal137". Tel était le sentiment populaire. Peu de temps avant la prise de Lavaur un contingent de croisés allemands désarmés (ou en tout cas pris par surprise)138 avait été massacré par le comte de Foix et son fils: le croisé n'était pas un adversaire, mais une bête malfaisante qu'il fallait détruire par tous les moyens. Et si Baudouin de Toulouse n'avait été que pendu, les prisonniers de moindre rang, même chevaliers, étaient torturés et écartelés sur les places publiques sous les clameurs de joie de la foule. Raymond VII, à plusieurs reprises, se montra chevaleresque envers les vaincus. À Puylaurens, il laissa la vie sauve à la garnison et traita avec respect la veuve du bandit Foucaut de Berzy; lorsque Guy, le fils de Montfort, mourut prisonnier, le comte renvoya le corps à Amaury avec les honneurs militaires. Mais ni le peuple, ni les chevaliers faidits, ni même le comte de Foix n'avaient de ces scrupules, la croisade avait allumé dans le pays une haine implacable des Français, et une haine qui n'était pas près de s'éteindre.
Si la chevalerie occitane avait payé un lourd tribut à la guerre, ses pertes, comme nous l'avons vu, n'étaient rien à côté de celles des combattants à pied, bourgeois ou soldats de profession (sans parler des routiers dont la mort n'était un malheur pour personne, mais qui étaient un puissant instrument de combat), et de celles de la population civile. Car aux vingt mille (ou plus) civils massacrés à Béziers, aux cinq ou six mille de Marmande, il faut ajouter les innombrables victimes des hasards des sièges et des razzias; les armées, dont les routiers faisaient toujours partie, et dont les éléments réguliers étaient eux-mêmes composés de professionnels de la guerre et de fortes têtes, n'étaient jamais tendres pour les civils. La haine et le mépris du soldat pour le civil, qui s'étaient donné libre cours lors des grands massacres, ont dû se manifester dans mainte autre occasion; haïs, traqués, risquant leur vie dans chaque ruelle déserte, dans chaque sente isolée, les soldats croisés ne pouvaient guère se conduire en protecteurs de la veuve et de l'orphelin.
Si Napoléon Peyrat exagère à coup sûr lorsqu'il parle d'un million d'Occitans tués au cours des quinze années de guerre, il est certain que le pays avait dû subir des pertes en vies humaines dont aucune chronique ni aucun document ne rendent compte, et très supérieures aux chiffres qui ressortent du seul examen des textes. À cette époque où il n'y avait ni recensement régulier ni statistiques. Si les morts des chevaliers sont signalées, les foules de morts anonymes n'apparaissent çà et là que sous forme de cervelles jaillies ou de poumons arrachés traînant dans la boue. Les petites gens, même dans le malheur, n'ont pas d'histoire.
Ses villes appauvries, son commerce ruiné, sa population décimée, le Languedoc libéré était, de plus, menacé par le fléau permanent du moyen âge: la famine. Ses terres, fertiles dans le Toulousain et l'Albigeois, pauvres dans les régions montagneuses, avaient été, des années durant, ravagées avec moins de méthode sans doute que lors de la campagne d'Humbert de Beaujeu en 1228, mais avec autant d'acharnement. Simon de Montfort avait, de 1211 à 1217, ravagé chaque année les vallées de l'Ariégeois espérant ainsi réduire le comte de Foix, et l'on se demande de quoi pouvaient avoir vécu, ces années-là, ces régions déjà pauvres. Dans le Toulousain, dans le Carcassès des vignes furent arrachées, des récoltes brûlées à plusieurs reprises; et l'on peut se rendre compte de ce que représentaient les vignes pour la population semi-bourgeoise, semi-agricole du Midi quand on voit les habitants de Moissac capituler en 1212 "parce que le temps des vendanges était venu". Les vignes peuvent être replantées et les blés repoussent, mais tant d'hommes avaient été tués, ou lancés par la misère sur les routes, devenus mendiants, voleurs des grands chemins ou soldats vagabonds; tant d'autres, épuisés par la faim et les maladies, ne pouvaient fournir le travail nécessaire pour une revalorisation des terres saccagées; il y eût fallu des années. Et, même au paysan le plus attaché à sa terre, la menace permanente d'une armée ennemie fait tomber la cognée des mains, de découragement.
Sans doute, si omniprésent qu'ait été Simon de Montfort, tous les champs et tous les vignobles du Languedoc n'avaient-ils pas été touchés par la guerre, et les peuples du Midi étaient, depuis des siècles, habitués à des désastres de ce genre, quoique à une moins vaste échelle. Il n'en reste pas moins vrai que la dévastation de la campagne toulousaine semble avoir produit le même effet de terreur que le sac d'une grande ville.
Cependant, si l'on se reporte encore une fois à l'auteur de la "Chanson", la politique des chefs était plutôt orientée vers les dépenses que vers l'économie. Dès le début de la reconquête, les Avignonnais disent à Raymond VI: "Ne craignez pas de donner ni de dépenser..." et les comtes et leurs amis devisent "d'armes, d'amours et de dons"139. Le comte promet à maintes reprises d'enrichir ceux qui l'ont soutenu, et Montfort lui-même se dépite de voir ses adversaires "si fiers, si braves, si peu regardants à la dépense". Montfort, dont l'esprit pratique n'était pas la moindre qualité, n'était guère dépensier, et se montrait surtout généreux sur le compte des pays conquis. Pour le comte de Toulouse, la grande gloire était de "donner" et il pouvait tout au plus reprendre sur les Français les domaines qu'ils avaient occupés et les rendre à leurs propriétaires, et encore ces domaines ne devaient-ils être récupérés qu'en assez triste état, et reconquis par la force des armes. Pour pouvoir donner largement il lui eût fallu rançonner ses propres terres, déjà si appauvries; et si grand que fût l'esprit de sacrifice des grandes cités de Provence, leur élan de patriotisme ne pouvait être de longue durée.
Il est évident que l'entretien de ses seigneurs légitimes constituait pour le peuple une charge moins lourde que celui d'une armée occupante; ils avaient intérêt à ménager le pays. Mais il ne faut pas croire que Raymond VII et son entourage de chevaliers allaient, après leurs premières victoires, adopter le genre de vie prescrit à la noblesse languedocienne par cette fameuse charte du concile d'Arles qui avait provoqué la révolte de Raymond VI; qu'ils ne se vêtiraient que de "chapes noires et mauvaises", et n'habiteraient plus "dans les villes, mais seulement à la campagne". L'étalage de richesses était lié aux notions d'honneur et de liberté; le retour de Parage devait être signalé par des fêtes, et si le peuple se contentait de danser en chantant des ballades et de faire sonner les cloches, les chevaliers organisaient des festins et offraient à leurs dames et à leurs amis bijoux et chevaux de race. L'évêque Foulques est loué par Guillaume de Puylaurens pour la façon magnifique dont il traita les prélats convoqués au concile de Toulouse "bien qu'il n'eût pas recueilli de gros bénéfices cet été"140. Et si les évêques, sur leurs diocèses ruinés, parvenaient à prélever assez de vivres pour éblouir leurs hôtes étrangers, les seigneurs ne pouvaient faire moins pour leurs alliés, et amis, car il y allait de leur prestige.
Les troubadours chantent le retour du printemps et de la liberté, et la gloire du comte Raymond. Des mariages princiers sont célébrés. Par des alliances, des dons mutuels, des liens de vasselage renouvelés et renforcés, la noblesse méridionale se regroupe après les années de dispersion qu'elle avait vécues pendant la conquête française. Une grande partie de la chevalerie avait été contrainte à s'exiler ou à fuir dans les montagnes, les seigneurs français établis à leur place avaient épousé des veuves et des héritières occitanes. Le vieux Bernard de Comminges, du haut des murs de Toulouse, avait visé et blessé son gendre Guy de Montfort que sa fille Pétronille avait été contrainte d'épouser: la politique des mariages préconisée par Montfort n'avait guère porté de bons fruits. La plupart de ces gendres et beaux-frères indésirables avaient été tués ou chassés du pays. La restauration de Parage et des traditions courtoises était le premier souci de cette société aristocratique et fière, pour laquelle la croisade avait été un déshonneur personnel en même temps qu'un affront national.
Dans cette guerre, le patriotisme de caste allait de pair avec le patriotisme tout court. Les bourgeois luttaient pour leurs privilèges, les chevaliers pour leur honneur et leurs terres, le peuple pour sa liberté, tous pour leur "langage", pour l'indépendance nationale. La noblesse, forte du prestige des victoires militaires et de sa position de classe dirigeante, avait réparé ses pertes plus rapidement que les classes moyennes et le petit peuple; d'ailleurs, elle continuait à se battre et avait sans cesse besoin d'argent pour la guerre. Mais, en fait, le pays résistait depuis longtemps au-delà de ses forces.
II - LE CATHARISME, RELIGION NATIONALE
L'Église qui, du temps des victoires de Montfort, avait bénéficié de la protection du vainqueur et s'était enrichie de multiples dons, en particulier des biens des hérétiques dépossédés, se trouvait à présent dans une situation plus critique qu'avant 1209, car les comtes et les chevaliers faidits cherchaient non seulement à lui reprendre les biens confisqués, mais encore à s'emparer de ceux que Raymond VI avait été forcé de rendre à l'Église. Encouragé par ses succès militaires, Raymond VII avait même repris le comté de Melgueil devenu fief direct de la papauté et tenu par l'évêque de Maguelonne. Les évêques intronisés pendant la croisade avaient dû fuir leurs villes; Guy des Vaux de Cernay, évêque de Carcassonne, était rentré mourir en France et avait été remplacé par son prédécesseur destitué (et partant populaire) Bernard-Raymond de Roquefort; Foulques, l'évêque de Toulouse excommuniée, n'ose reparaître dans cette ville qui le rend responsable de tous ses malheurs; l'évêque Thédise d'Agde, ex-légat et un des principaux artisans de la croisade, les évêques de Nîmes et de Maguelonne, avaient dû se réfugier dans la catholique Montpellier, avec le primat d'Occitanie, le vieil archevêque de Narbonne, Arnaud-Amaury. Là, à l'abri des émeutes populaires, ils menaient une intense campagne diplomatique, à coups d'excommunications et d'appels au pape, essayant tantôt de se concilier les comtes, tantôt d'attirer sur eux les foudres royales et pontificales.
L'ancien abbé de Cîteaux, après avoir soutenu Amaury de Montfort, jouait à présent la carte nationale, et semblait enfin comprendre le danger que la menace française représentait pour son pays, et peut-être pour l'indépendance politique de l'Église occitane: après avoir constaté que le roi ne voulait se charger de la croisade qu'à condition de s'annexer les provinces du Midi, Arnaud-Amaury s'était définitivement tourné vers Raymond VII et avait tenté de le faire reconnaître par l'Église comme seigneur légitime de ses terres. Fait curieux, l'ancien chef de la croisade fut à peu près le seul, parmi les évêques occitans, à avoir (peut-être) songé à autre chose qu'à l'extermination de l'hérésie et aux intérêts immédiats et matériels de l'Église. Mais ce prélat belliqueux et turbulent devait mourir en 1225, après avoir légué à l'abbaye de Fontfroide ses livres, ses armes et son cheval de bataille. En sa personne, le parti de l'indépendance perdait un allié sinon influent du moins énergique. Arnaud-Amaury fut remplacé par Pierre-Amiel, partisan déclaré de la croisade et de la royauté. Le clergé occitan représentait à présent un parti politique d'autant plus agressif qu'il était impopulaire, d'autant plus dangereux que chacun de ses échecs était ressenti à Rome comme une défaite de l'Église.
Que l'Église fût, dans le Languedoc, excessivement impopulaire, le fait n'a rien de surprenant: en approuvant ouvertement et violemment la croisade, évêques et abbés n'avaient pu que s'aliéner la confiance des catholiques eux-mêmes. Les troubadours unissent dans leurs malédictions les Français et les clercs, Francès et clergia, et la "Chanson" prête à maintes reprises aux seigneurs occitans des propos tels que: "Nous n'aurions jamais été vaincus, sans l'Église..." L'Église, pour ceux-là mêmes qui invoquaient les saints et vénéraient les reliques, était l'ennemi par définition. Faut-il en conclure qu'elle n'avait pas de partisans dans le pays?
Toute grande cité avait son évêque, lequel était un puissant seigneur, souvent co-suzerain de la ville, parfois suzerain unique. Béziers, Toulouse, prêtaient hommage à la fois au comte (ou au vicomte) et à l'évêque, et les prétentions d'un Arnaud-Amaury, en tant qu'archevêque, au duché de Narbonne, étaient contestables, mais non extravagantes. Même dans le cas - comme à Toulouse avant l'avènement de Foulques - où l'autorité de l'évêque était pratiquement inexistante, l'évêché disposait d'un vaste appareil administratif, judiciaire, fiscal, qui employait un grand nombre de personnes, des clercs pour la plupart, qui travaillaient pour lui et en vivaient. Avant la croisade, à l'époque où l'Église était affaiblie et déconsidérée, le Languedoc comptait beaucoup d'abbayes puissantes et prospères; la réforme cistercienne avait créé un renouveau de foi catholique, et le troubadour Foulques de Marseille, loin de se faire cathare, s'était fait moine à Fontfroide. Les couvents n'étaient pas tous pourris ou désertés en masse, les abbayes comme celles de Grandselve ou de Fontfroide étaient les centres d'une intense vie religieuse et les moines qui y vivaient dans le jeûne et la prière pouvaient rivaliser d'austérité avec les parfaits. Le nombre et la grande richesse de ces abbayes montrent que, malgré les lamentations des papes et des évêques, l'Église dans le Languedoc était loin d'être réduite à néant; la haine même qu'elle suscitait témoigne de sa relative puissance, et quand elle n'aurait eu d'autres partisans que les clercs eux-mêmes, ces clercs constituaient déjà, au sein du pays, une minorité numériquement assez faible, mais non négligeable.
Le seul fait qu'ils menaient une vie plutôt aisée et étaient, en tout cas, presque toujours à l'abri du besoin, leur conférait déjà une sorte de supériorité. Lettrés, ils étaient des auxiliaires souvent indispensables dans la plupart des actes de la vie civile. Secrétaires, comptables, traducteurs, notaires, parfois savants, ingénieurs, architectes, économistes, juristes, etc., ils formaient, même en un pays qui se sécularisait à vue d'œil, une élite intellectuelle dont on ne pouvait se passer.
Il est certain que, dans le malheur qui avait fondu sur leur patrie, beaucoup de clercs durent opter pour la cause nationale, mais c'était là un choix dangereux; hommes d'Église, ils ne pouvaient rompre ouvertement avec l'Église. Si, avant la croisade, on cite des curés, et même des abbés favorables à l'hérésie (ou tout au moins très peu fanatiques), si, plus tard, on verra des couvents abriter des hérétiques et des religieux assister aux sermons des parfaits, ces sentiments de tolérance ne pouvaient être ceux de la majorité ni, en tout cas, ceux des éléments combatifs du clergé.
De plus, abbés et évêques - si l'on excepte ceux qui avaient été imposés pendant la croisade - avaient dans le pays des parents, des amis, sans compter les personnes qui leur étaient liées par des relations d'intérêt: les commerçants dont ils étaient les meilleurs clients, les chefs d'entreprises qui travaillaient pour eux, etc. Nul doute que parmi tous ces gens, ils n'aient compté des partisans fidèles. Le parti de l'Église pouvait enfin compter sur le dévouement de ceux qui, pendant la croisade, s'étaient trop ouvertement rangés du côté de l'occupant, ceux qui avaient noué avec les Français des liens de famille ou d'amitié, et aussi des catholiques sincères ou fanatisés du genre de ceux qui, à Toulouse, avaient formé la Confrérie blanche de l'évêque Foulques. Nous allons voir qu'un mouvement puissant, né de la croisade et devenu en peu d'années une organisation internationale de réaction catholique, gagnait l'Église et aspirait à gagner les masses.
Dans un pays où la haine de l'occupant étranger semble avoir été à peu près générale, ces éléments ne pouvaient être qu'en minorité; mais la violence même des passions déchaînées par la guerre devait exaspérer leur désir de revanche. Il ne faut pas oublier que le patriotisme méridional était chose relativement récente, et que cinquante ans plus tôt les bourgeois de Toulouse eux-mêmes appelaient les rois de France et d'Angleterre pour les protéger contre leur comte.
Donc, malgré l'union nationale qui s'était faite dans le pays après la mort de Simon et le départ d'Amaury, le Languedoc ne pouvait jouir de la paix intérieure tant que l'Église continuait à menacer de ses foudres les suzerains légitimes qui avaient reconquis leurs territoires. La paix avec l'Église était nécessaire à Raymond VII, autant pour la tranquillité du pays que pour des raisons de politique extérieure. On ne sait s'il eût marchandé ou non sur le sort des hérétiques, car l'Église ne lui permit jamais de fournir des preuves de sa bonne volonté. Il ne devait être absous que pieds et poings liés.
À lire les historiens contemporains de la guerre du Languedoc, on pourrait se demander pour quelle raison l'Église mettait un tel acharnement à accabler un pays déjà épuisé et qui ne luttait, somme toute, que pour son indépendance. Car, dans les textes, il n'est pour ainsi dire pas question de l'hérésie, et cet adversaire dont on déplore de temps à autre les progrès est si anonyme, si insaisissable qu'on pourrait le prendre plutôt pour quelque mystérieuse épidémie que pour un vaste mouvement religieux et national. Les auteurs catholiques constatent que l'hérésie existe toujours, qu'elle se répand, que les autorités refusent de lutter contre elle; les auteurs languedociens n'en parlent pas du tout.
Rien de plus caractéristique à cet égard que la "Chanson de la Croisade": le poète de la liberté occitane ne mentionne les hérétiques que pour dire que le comte de Foix, le comte de Toulouse, etc., ne les ont jamais aimés ni fréquentés. Les accusations d'hérésie portées contre eux et leurs peuples sont calomnie pure et imagination de leurs ennemis. Les princes et les chevaliers qui luttent pour la libération de leur pays sont aussi bons chrétiens que les autres (et même meilleurs); ils invoquent sans cesse Dieu, Jésus-Christ et la Vierge; si ces chevaliers crient plus souvent "Toulouse!" que "Dieu avec nous!", les croisés de leur côté crient: "Montfort!" Et avec une égale conviction les deux camps disent qu'ils ne sauraient être vaincus puisqu'ils ont Jésus-Christ avec eux. Si les barons qui parlent de rétablir "Parage et Merci" ne ménagent pas leurs reproches à l'Église, on a plutôt l'impression d'entendre des catholiques fermes dans leur foi, mais scandalisés par la tyrannie politique du pape, que des hommes qui luttent pour une autre religion. Leurs adversaires se proposent bien d'exterminer "les hérétiques et les ensabatés" (c'est-à-dire les cathares et les vaudois); aucun des personnages du camp occitan ne se croit hérétique ni ensabaté. Pour les uns comme pour les autres, l'hérésie semble n'être qu'un prétexte.
Il en était certainement ainsi dans le feu du combat, et le poète-chroniqueur parle surtout des batailles et des sièges; son récit, aussi bien que les chansons des troubadours parvenues jusqu'à nous, a été rédigé et, en tout cas, recopié à une époque où sur le seul soupçon d'hérésie on risquait la prison perpétuelle, l'exil ou la ruine. S'il y eut, à l'époque, une littérature profane ouvertement favorable à l'hérésie, elle a été détruite pour des raisons compréhensibles. Si les siècles nous avaient transmis l'œuvre de quelque Pierre des Vaux de Cernay cathare, racontant les faits et gestes de ses chefs spirituels, les miracles de Dieu en leur faveur, et la grandeur de leur œuvre, sans doute la croisade nous fût-elle apparue sous un jour bien différent. L'histoire n'existe que par le document et, eût-on l'imagination d'un Napoléon Peyrat, on ne peut opposer aux figures parfois terribles, mais bien vivantes de Montfort, de Dominique, d'Innocent III, de Foulques, d'Arnaud-Amaury, etc., que quelques noms et des ombres.
Et cependant, pour abattre ces grands inconnus, il n'avait pas suffi de quinze ans de guerre et de terreur, et dans un pays affaibli et ruiné, ils représentaient encore pour l'Église un danger tel que le pape ne cessait de lancer des appels à la chrétienté, de harceler le roi de France, d'accabler les chefs du Languedoc de ses malédictions, bref, d'agir comme si le salut de l'Église avait dépendu de l'écrasement de l'hérésie albigeoise. Mais ce n'est évidemment pas uniquement pour favoriser les visées du roi de France, son plus fidèle allié, que le pape a cru nécessaire de détruire le Languedoc en tant que pays indépendant. Il l'a fait parce que l'hérésie, malgré la croisade ou grâce à elle, y faisait des progrès tels qu'un souverain autochtone, fut-il bon catholique, ne pouvait plus lutter contre sa diffusion, et qu'elle risquait d'aliéner définitivement à l'Église le pays tout entier.
Aliéné, il l'était déjà moralement. Il eût fallu à ce peuple beaucoup de force d'âme et une patience héroïque pour persévérer dans la foi d'une Église qui se présentait sous les traits d'un conquérant étranger et haï - surtout quand une autre Église existait déjà dans le pays et, persécutée, devenait par la force des choses l'Église nationale.
On dit communément que le moyen âge a été une époque de foi. Des généralisations de ce genre sont souvent abusives, et il serait plus exact de dire que les témoignages que la civilisation du moyen âge nous a laissés sont, le plus souvent, imprégnés d'un esprit profondément religieux. Comme toute culture, celle du moyen âge était née de sa religion; au XIIe siècle elle s'en affranchissait déjà, et la littérature et la poésie profanes font preuve d'une indifférence religieuse quasi totale. La politique des rois, des princes (parfois des prélats) obéissait aux lois éternelles dont Machiavel devait devenir le théoricien, et qui n'avait rien à voir avec la foi. Le peuple vénérait les saints comme autrefois il avait vénéré les divinités du soleil, du vent et de la pluie. L'Église était souvent détestée et raillée jusque dans les pays où les gens se signaient d'horreur au seul nom d'hérésie. Le moyen âge fut cependant une grande époque de foi, car il n'y existait aucune valeur, aucun système de valeurs qui pût être dignement opposé à la religion; toutes les aspirations, toutes les expériences véritablement profondes se confondaient dans la foi comme les fleuves dans la mer. Et si l'idéal chevaleresque et le mouvement social des communes étaient, en fait, étrangers à la religion, peu d'hommes songeaient à se passer d'une Église.
S'il y eut des sociétés sceptiques ou agnostiques - il semble que dans le Languedoc, ouvert à tous les courants intellectuels et affranchi en partie de la domination de l'Église, il y ait eu plus d'incroyants qu'ailleurs, - le scepticisme était rarement une raison de vivre, encore moins de mourir. Les malheurs de la croisade avaient créé dans le pays un élan de patriotisme ardent, mais ces hommes qui allaient mourir pour leur patrie criaient: "Jésus-Christ avec nous!" En accusant l'Église de leurs maux, ils ne pouvaient que s'associer de cœur à cette autre Église qui depuis si longtemps leur répétait que Rome était l'incarnation même de Satan.
Là, une équivoque subsiste qui ne nous permettra jamais de déterminer jusqu'à quel point le Languedoc, après la mort de Simon de Montfort, était réellement gagné au catharisme (et au valdisme, qui, d'après les témoignages, gagna en ces années-là beaucoup d'auditeurs). Quand les partisans du comte de Toulouse, voire l'auteur de la "Chanson" lui-même et les troubadours, parlent de Dieu et de Jésus-Christ, il est très probable qu'ils en parlent en cathares, et que leur Dieu à eux est le Dieu Bon de la foi manichéenne. Mais nous n'en savons rien. D'autre part, ces gens vont à l'église, vénèrent les reliques et la croix, et nous ne savons pas s'ils le font par tolérance et par coutume, ou par conviction profonde.
Devant la catastrophe qui s'était abattue sur le pays, il est probable que les parfaits cathares aient en quelque sorte pactisé avec les éléments catholiques qui leurs étaient favorables, et qu'ils aient toléré une espèce de foi nationale et patriotique qui s'accommodait aussi bien de la vénération du culte cathare que des manifestations traditionnelles de la foi catholique. Le pays avait ses saints à lui, ses sanctuaires à lui, voire ses évêques catholiques à lui141. Les cathares, qui honoraient la mémoire des évangélistes et des apôtres, pouvaient, par égard envers la faiblesse humaine, autoriser leurs fidèles à invoquer ces saints.
Bien que nous n'ayons aucun renseignement précis sur ce sujet, il est légitime de supposer que le catharisme des années 1220-1230 ait eu bien souvent ce caractère mitigé qui tendait à le rapprocher en apparence du catholicisme. Une phrase du rituel cathare (rédigé, il est vrai, vers la fin du XIIIe siècle) semblerait l'indiquer, car elle dit: "Cependant, que personne ne pense que par ce baptême (le consolamentum) vous deviez mépriser l'autre baptême ni tout ce que vous avez pu faire ou dire de chrétien ou de bon jusqu'à maintenant142". Or, ces paroles sont adressées au postulant déjà jugé digne de recevoir la vêture. Ceux qui ne prétendaient pas à cette dignité pouvaient donc être de bons croyants cathares, tout en restant attachés aux pratiques catholiques. Pour être croyant il suffisait de haïr Rome et les Français.
Il serait téméraire d'affirmer que le Languedoc tout entier soit devenu cathare; il est, en revanche, plus que probable que ceux qui cherchaient sincèrement Dieu (et en cette époque de détresse ils devaient être nombreux) se tournaient vers l'Église cathare et non vers l'Église catholique.
Quand le pape, les évêques, le roi parlent de chasser les hérétiques, ils est bien entendu que ce terme ne désigne pas toutes les personnes qui adhèrent a une secte hétérodoxe. Les croyants, même jugés et condamnés pour fait d'hérésie, ne seront jamais des hérétiques; ce mot, dans le langage de l'époque, équivaut au titre de parfait, plus particulièrement de parfait cathare. Il est si bien compris dans ce sens que les inquisiteurs appellent "hérésiarques" les évêques cathares, pour les distinguer des simples parfaits. Si sur la grande masse des croyants nous ne savons à peu près rien - les personnes interrogées par l'Inquisition étaient, à titres divers, des membres actifs de la secte, donc une minorité, - nous sommes mieux renseignés sur les parfaits.
Mais ces renseignements sont extrêmement secs et monotones. Ils se réduisent à peu près à ceci: en telle année, en tel endroit, le diacre ou le parfait un tel a prêché devant telles personnes, ou accordé le consolamentum à telles autres. Il a été reçu dans la maison de tel croyant, a reçu des dons de tel autre. Des noms, des lieux, des dates. Encore les registres de l'Inquisition ne nous sont-ils pas tous parvenus, un grand nombre ayant été détruits à l'époque par les intéressés eux-mêmes, d'autres s'étant dégradés ou perdus dans les bibliothèques et les archives. Mais même incomplets ces documents donnent déjà une idée impressionnante de l'activité de l'Église cathare tant pendant la croisade que dans les années qui suivirent.
D'abord, nous pouvons constater que, malgré la guerre qui ravageait le pays, malgré les bûchers de Minerve et de Lavaur, les diverses églises cathares avaient continué leur activité et se trouvaient en 1225 aussi organisées qu'avant la croisade. En cette année le Languedoc comptait quatre églises ou plutôt diocèses, celui d'Albi, celui de Toulouse, celui de Carcassonne et celui d'Agen; et en 1225, au concile de Pieusse, fut créé un nouveau diocèse, celui du Razès, dont Benoît de Termes fut élu évêque. Les circonstances de la création de cet évêché montrent à quel point l'Église cathare faisait déjà partie organique de la vie du pays: les habitants du Razès, en effet, se plaignaient des difficultés occasionnées par le fait qu'une partie de leur province relevait de l'évêché de Toulouse, l'autre de l'évêché de Carcassonne; le concile résolut de donner satisfaction aux demandes de ces fidèles, et il fut décidé que l'évêque de Carcassonne choisirait parmi ses diacres le nouvel évêque, qui serait consacré par l'évêque de Toulouse. On imaginerait difficilement une situation semblable si l'Église cathare se fût composée d'hommes contraints à se cacher et tremblant d'être accusés d'hérésie.
Après la mort de Simon de Montfort, l'hérésie avait reparu au grand jour, et en 1225, année du concile de Pieusse, elle se préoccupe de questions hiérarchiques et administratives tout comme une Église officiellement reconnue. En 1223 le légat Conrad de Porto, en convoquant les prélats français au concile de Sens, écrit que les cathares de Bulgarie, de Croatie, de Dalmatie et de Hongrie viennent d'élire un nouveau pape, et que l'émissaire de ce pape hérétique, Barthélémy Cartès, est arrivé en Albigeois où il ordonne des évêques et attire des foules de fidèles. L'existence d'un "pape" bulgare est fort improbable, mais il est significatif de voir les cathares du Languedoc renouer leurs liens avec la plus ancienne et la plus vénérée des Églises manichéennes, et y puiser des forces nouvelles. Eux aussi avaient besoin de se sentir membres d'une fraternité universelle. Vers cette époque, craignant le retour des persécutions, beaucoup d'hérétiques commencèrent à s'assurer des lieux de refuge dans des provinces moins éprouvées où leurs églises jouissaient d'une paix relative: en Lombardie ou même en Orient. D'autre part, certains indices montrent que les cathares d'Orient n'oubliaient pas leurs frères persécutés.
Si les pouvoirs publics semblent ignorer l'Église cathare, s'ils nient même son existence, ils le font dans des buts politiques faciles à comprendre; s'ils ne font rien pour lutter contre elle, alors que leurs intérêts vitaux et l'indépendance même du pays sont enjeu, c'est que l'hérésie est beaucoup trop puissante et trop populaire, et que le triomphe de la cause nationale est aussi son triomphe.
Selon certains historiens catholiques, les cathares avaient eu l'habileté de confondre leur cause avec celle de la nation; il n'y fallait pas beaucoup d'habileté, et l'on se demande ce qu'ils eussent pu faire d'autre, à moins d'aller se livrer en masse aux croisés et de déclarer que leur religion méritait d'être détruite. Leur cause s'est confondue avec celle de la résistance, parce que le peuple avait choisi de les défendre au lieu de les exterminer. Il ne semble pas que la rancune populaire ait jamais fait payer à ces "bons hommes" le crime d'avoir attiré la guerre sur le pays; du moins les documents connus ne nous apprennent-ils aucun fait de ce genre.
Quinze ans durant le Languedoc s'épuisa dans une lutte à mort. Des deux côtés cruautés, trahisons, lâchetés, vengeances et injustices ne manquèrent pas; pas un nom de parfait ne fut jamais, de près ou de loin, associé à de ces actes qui rendent horrible la guerre la plus légitime. Les pires ennemis des hérétiques ne leur ont reproche rien d'autre que leur refus de se convertir. On comprend que pour des populations en détresse ces hommes traqués, inébranlables et pacifiques, soient apparus comme les seuls pères et consolateurs, la seule force morale devant laquelle on pût s'incliner.
En pleine croisade, les diacres cathares et les parfaits continuaient d'exercer leur ministère. Le diocèse de Toulouse eut même deux évêques: en 1215, alors que Gaucelm exerçait déjà cette fonction, Bernard de la Mothe fut élevé à la dignité épiscopale, sans doute parce que l'Église menacée avait besoin d'un plus grand nombre de pasteurs. Le diacre Guillaume Salomon tenait des assemblées clandestines à Toulouse alors que Montfort était maître de la ville; le diacre Bofils prêchait en 1215 à Saint-Félix; le diacre Mercier en 1210 voyait assister à ses sermons toute la noblesse du Mirepoix, etc. Cependant, c'est surtout à partir de 1220 que l'activité des ministres cathares devient plus intense, ou du moins plus facile à contrôler: les témoignages sur leurs réunions et les diverses étapes de leur ministère sont beaucoup plus nombreux. N'étant plus obligés de se cacher ils vont dans des maisons de croyants sans craindre de les compromettre, prêchent publiquement, ordonnent de nouveaux parfaits, consolent des mourants, président des repas liturgiques; si leur activité était encore semi-clandestine, elle n'était plus secrète. De grands seigneurs recevaient le consolamentum à leur lit de mort, et de riches bourgeois léguaient, en mourant, des sommes importantes à leur Église.
Dans les années de la reconquête du Languedoc par Raymond, on retrouve la trace d'une cinquantaine de diacres; les diacres, inférieurs aux évêques et revêtus de pouvoirs dont la nature exacte est difficile à déterminer faute de données précises, étaient les chefs des communautés, et le nombre de cinquante diacres fait supposer l'existence de plusieurs centaines au moins d'hérétiques revêtus, hommes et femmes. Les grands bûchers de 1210-1211 en avaient fait périr environ six cents (encore n'est-ce pas certain: il a pu y avoir parmi ces brûlés des croyants qui s'étaient fait "consoler" à la dernière heure plutôt que d'abjurer, tel ce G. de Cadro "brûlé (combustus) à Minerve par le comte de Montfort"143). Mais l'Église cathare avait dû se relever assez rapidement de ce coup terrible, puisqu'elle a gardé son organisation et sa hiérarchie, et un nombre considérable de parfaits.
Ce millier (à peine) d'apôtres ne pouvait être dangereux que par son ascendant sur les populations, et cet ascendant était énorme, si l'on en juge par le fait que dans un pays où ils étaient connus de tous l'Inquisition n'ait pu en venir à bout qu'après des dizaines d'années d'impitoyable terreur policière. Par la rigueur des mesures qui allaient être prises contre ceux qui les protégeaient, on peut voir à quel point le peuple leur était dévoué.
Ils étaient partout. Nous avons vu qu'ils organisaient des réunions jusque dans Toulouse soumise à Montfort; après la reconquête du pays par ses seigneurs légitimes - presque tous croyants eux-mêmes - rien ne pouvait plus freiner la diffusion de leur mouvement; il ne semble pas qu'ils aient joui de la même liberté qu'avant la croisade; les comtes avaient beau être favorables à l'hérésie (Roger Bernard de Foix l'était ouvertement, Raymond VII avec discrétion), le danger même qu'ils attiraient sur leur patrie forçait les parfaits à la prudence. À cette époque furent fondés des ateliers de tissage qui étaient en réalité des sortes de séminaires cathares, tel celui de Cordes, dirigé par Sicard de Figueiras, et visité par toute la noblesse de la région. Guilhabert de Castres (qui, de fils majeur, fut promu évêque de Toulouse vers 1223) tenait une maison et un hospice à Fanjeaux, près de Prouille où se trouvait le premier couvent dominicain. Or, le pape protégeait ouvertement le nouvel ordre des Frères prêcheurs dont l'illustre fondateur était mort en 1221. L'infatigable évêque cathare passait sa vie en tournées pastorales; il dirigeait les communautés de Fanjeaux, de Laurac, de Castelnaudary, de Montségur, de Mirepoix, sans compter Toulouse qui s'honorait de l'avoir pour évêque. À cette époque, il devait avoir près de soixante ans, puisque trente ans plus tôt il dirigeait déjà la maison de Fanjeaux, et qu'il devait mourir une vingtaine d'années plus tard. En 1207 il avait tenu tête à saint Dominique et aux légats lors de la conférence contradictoire de Montréal; de 1220 à 1240 on trouve des traces de son passage dans la plupart des villes et châteaux du Toulousain, du Carcassès, du comté de Foix. Il se trouvait dans Castelnaudary pendant le siège que la ville eut à soutenir contre Amaury de Montfort en 1222; plus tard, lorsque les cathares seront de nouveau en butte aux persécutions, c'est lui qui demandera à Raymond de Péreille, seigneur de Montségur, de mettre son château à la disposition de leur Église et d'y organiser le quartier général de la résistance cathare. La date et les circonstances de sa mort nous demeurent inconnues.
Il est un peu déconcertant de constater que sur cet homme qui semble avoir été une des grandes personnalités de la France du XIIIe siècle (ainsi que sur les autres chefs du mouvement, tels Bernard de Simorre, Sicard Cellerier, évêque d'Albi, Pierre Isarn, évêque de Carcassonne brûlé en 1226, Bernard de La Mothe, Bertrand Marty successeur de Guilhabert, et tant d'autres), l'histoire nous apprenne si peu de chose, alors que nous n'ignorons rien de la correspondance d'Innocent III ou des colères et des élans de piété de Simon de Montfort. L'histoire des faits et gestes de ces apôtres persécutés eût peut-être été aussi féconde en inspiration et en enseignement que celle d'un saint François d'Assise; ils étaient, eux aussi, des messagers de l'amour de Dieu. Il n'est pas indifférent de penser que ces flambeaux-là ont été éteints à jamais, leurs visages effacés, leur exemple perdu pour ceux que, dans les siècles suivants, il eût pu aider à vivre.
Si rien ne peut réparer ce crime contre l'Esprit, du moins devons-nous, en avouant notre ignorance, reconnaître que quelque chose de grand a été détruit. L'histoire du moyen âge telle que nous la connaissons serait fausse sans cette grande place demeurée vide.
Devant la puissance grandissante de l'hérésie, l'Église du Languedoc ne semblait plus posséder de moyens d'intimidation suffisants; et si les évêques eux-mêmes avaient été obligés de se réfugier à Montpellier, que pouvaient les simples clercs et les curés? Malgré les offres réitérées du comte de Toulouse qui promettait d'expulser les hérétiques, le clergé ne pouvait se sentir en sûreté que sous l'autorité du roi de France; eût-il le plus fort désir de chasser les hérétiques, le comte n'eût pu le faire qu'à l'aide d'une armée étrangère, ce qu'il ne souhaitait évidemment pas.
Mais si, pendant les années de libération, l'Église était pratiquement impuissante, elle ne restait pas inactive. L'ordre des Frères prêcheurs, créé par saint Dominique et reconnu le 11 février 1218 par Honorius III, avait dès avant la croisade pris racine dans le pays toulousain sous le patronage de Foulques, alors qu'il n'était pas encore un ordre monastique indépendant, mais simplement une communauté de religieux plus particulièrement destinée à lutter contre l'hérésie.
Nous avons vu quels ont été les débuts de l'activité de saint Dominique dans le Languedoc. La fondation du monastère de Prouille à quelques kilomètres du grand centre cathare de Fanjeaux ne manquait pas de hardiesse à l'époque où les hérétiques étaient les maîtres de la région. Trois ans plus tard la croisade renversait la situation, et les ennemis de saint Dominique étaient persécutés eux-mêmes et privés de leurs terres; Simon de Montfort, qui vénérait le chanoine d'Osma, attribuait au nouveau monastère une partie des domaines confisqués sur les seigneurs de Laurac, maîtres de Fanjeaux. Les mêmes seigneurs devaient reprendre leurs terres après la victoire de Raymond VII. Mais les moines de Prouille jouissaient déjà de la protection toute spéciale de la papauté, et leurs frères avaient essaimé des communautés non seulement dans le Languedoc, mais à travers toute l'Europe.
Saint Dominique a été, incontestablement, un des chefs de la lutte contre l'hérésie dans le Languedoc, peut-être même le vrai grand chef spirituel; pendant la croisade, les légats étaient trop pris par la guerre et la diplomatie pour avoir le temps de s'occuper des hérétiques; parmi les évêques, le seul qui ait fait preuve d'énergie dans la lutte contre l'hérésie a été Foulques de Toulouse, et il a été, dès le début, aidé et peut-être inspiré par saint Dominique. Un historien éminent comme Jean Guiraud suggère même que ce dernier ne fut pas étranger à la création de la Confrérie blanche de Toulouse; l'évêque et le chanoine de Prouille étaient animés du même zèle pour la foi et du même esprit combatif.
Pendant dix ans, saint Dominique avait exercé dans le Languedoc un apostolat que les progrès de la croisade rendaient à la fois équivoque et moralement pénible; il est à supposer que les Frères prêcheurs se recrutaient parmi les plus fanatiques des catholiques et non parmi les hérétiques convertis. En tout cas, après avoir laissé Prouille sous la direction des Frères Claret et Noël, Dominique s'installa à Toulouse même, où il devint le plus fidèle auxiliaire de l'évêque. En juillet 1214, Foulques établit un acte par lequel, "pour extirper l'hérésie et éliminer le vice, enseigner la règle de la foi... nous établissons prêcheurs dans notre diocèse frère Dominique et ses compagnons144".
Dominique faisait partie de la suite de l'évêque forcé à l'exil, et nous l'avons vu, à Muret, se distinguer par l'ardeur avec laquelle il priait pour la victoire des croisés, invoquant Dieu avec des clameurs et des supplications. Le fougueux prédicateur, que sa mère dans un rêve prophétique avait vu sous la forme d'un chien aboyant (contre les ennemis de Dieu), ne pouvait rester inactif dans l'attente du triomphe des armées du Christ; il continuait son œuvre de prédication, et formait les cadres de son ordre futur; il groupait autour de lui des hommes ardents et intrépides, dévoués corps et âme à l'œuvre de prédication et d'extermination de l'hérésie.
Protégé par l'évêque de Toulouse qui lui confiait tout spécialement l'office de la prédication, il était, en outre, investi par le légat Arnaud du pouvoir d'inquisition, c'est-à-dire qu'il était reconnu pour une autorité compétente en matière d'orthodoxie; il lui appartenait de "convaincre" les hérétiques, et aussi de déclarer absous et réconciliés ceux qui se convertissaient; de leur imposer des pénitences et de leur délivrer des certificats prouvant leur retour dans le sein de l'Église. Si nous ne possédons qu'un seul de ces certificats (il y en eut peut-être davantage...), nous possédons des témoignages de diverses personnes converties pendant la croisade, en 1211, en 1214, en particulier dans la région de Fanjeaux. Ses biographes145 signalent un autre fait qui montre que saint Dominique était en rapports directs avec la justice ecclésiastique et qu'il procédait à l'interrogatoire de personnes inculpées d'hérésie; en effet, plusieurs hérétiques qui avaient, malgré les objurgations du saint, persisté dans leurs erreurs, devaient être livrés au bras séculier et, Dominique ayant regardé l'un d'eux, comprit qu'il pouvait être ramené à Dieu et intervint pour lui épargner le bûcher; et cet hérétique endurci devait réellement se convertir vingt ans plus tard146. Cet acte de clémence de saint Dominique nous fait supposer qu'il eût pu, s'il l'avait voulu, sauver du bûcher les autres condamnés, en espérant qu'ils se convertiraient un jour, dans cinq, dix ou vingt ans. Étant donné son caractère intrépide, il semble peu probable qu'il ait refusé d'intervenir en faveur de ces malheureux par crainte du légat ou par peur d'affaiblir l'autorité de l'Église. Pour excuser un homme qui a le pouvoir de sauver son prochain d'une mort atroce, et n'use pas de ce pouvoir dans toute la mesure du possible, on peut invoquer soit la lâcheté, soit une grande dureté de cœur, soit un fanatisme poussé à l'extrême; s'il est difficile d'excuser un tel homme, il est encore plus difficile de l'admirer.
Ce fut en lui, pourtant, que devait s'incarner la résistance catholique à l'hérésie, et son esprit devait dominer l'ordre des Frères prêcheurs qu'il avait créé et qui allait faire en quelques années des progrès foudroyants. À sa mort, en 1221, son ordre compte de nombreux couvents et jouit de la plus grande faveur du Saint-Siège. Nous aurons maintes fois l'occasion de revenir sur cet ordre, sur l'esprit qui l'animait et l'histoire de son développement. Un fait est certain: il est né de la croisade, et devait rester longtemps imprégné du souvenir de ces années sanglantes; il n'avait pas été créé pour apporter l'apaisement des esprits, et ne prêchait ni la charité ni le pardon.
La croisade du roi Louis avait plongé le Languedoc renaissant et encore meurtri dans un désespoir dont seules peuvent rendre compte les innombrables défections, les capitulations en masse, qui, en quelques mois, livrèrent à l'armée royale plus de la moitié du pays. Ce désespoir dut être de courte durée, la résistance se réorganisa rapidement, la mort du roi permit de nouveau tous les espoirs et les Français installés dans la place ne s'y maintenaient qu'à grand-peine, grâce aux renforts envoyés de France. Mais le légiste qu'était Romain de Saint-Ange avait eu le temps, au cours de la brève campagne de 1226, de réorganiser la conquête royale sur le modèle des statuts de Pamiers, en renforçant encore les mesures prises contre les hérétiques. Là où les Français ne sont pas les maîtres, ces nouvelles lois sont lettre morte; mais la chasse aux hérétiques a recommencé depuis 1226: l'évêque cathare de Carcassonne, Pierre Isam, est brûlé à Caunes et le diacre Gérard de La Mothe brûlé après la prise de La Bessède. La croisade a recommencé; et si le pays est plus décidé à résister qu'en 1209, il est trop épuisé pour tenir longtemps.
Grâce à la croisade, le Languedoc est devenu plus "hérétique" que jamais; du moins, la guerre l'avait-elle réduit à un état de faiblesse assez grand pour que la véritable répression de l'hérésie fût enfin possible. Le roi, ou plutôt la régente, songeait sans doute avant tout à s'annexer une province avec le concours de l'Église. Pour l'Église, l'hérésie représentait un tel danger qu'elle se souciait peu de l'incalculable dommage matériel et moral que cette annexion pouvait causer au pays. Le malheur des temps avait voulu que, suivant les douloureuses paroles de Dante au sujet de Foulques, les bergers fussent transformés en loups.
Et il semble bien que pour le Languedoc, l'Inquisition ait été un malheur plus grand encore que l'annexion royale.
III - LE TRAITÉ DE MEAUX
Après vingt ans de guerre, le Languedoc fut réuni à la France de la façon la plus traditionnelle, en apparence la plus légale du monde: par le mariage de l'héritière du comté de Toulouse avec un frère du roi de France. Si, au lieu d'une fille, Raymond VII avait eu un fils, la conquête française eût pu être encore longtemps contestée et la maison de Toulouse eût peut-être, avec le temps, réussi à recouvrer une partie de son indépendance. La maison de Saint-Gilles était trop populaire dans le pays, le droit d'héritage trop universellement reconnu comme sacré pour que la spoliation pure et simple des comtes de Toulouse fût possible; l'aventure de Simon de Montfort l'avait bien prouvé.
Raymond VII n'avait qu'une fille et la comtesse Sancie, depuis neuf ans, n'avait pas donné d'autre enfant à son époux. Si, en 1223, le comte songeait déjà à répudier l'infante d'Aragon pour épouser la sœur d'Amaury de Montfort, c'est qu'il savait sans doute que sa femme ne lui donnerait plus d'héritier. L'Église ne voulait pas consentir à un divorce qui eût favorisé les visées dynastiques de Raymond. (Les mariages princiers, à l'époque, se faisaient et se défaisaient au gré des intérêts politiques, mais l'Église seule avait le pouvoir de les annuler et n'approuvait que les répudiations qui pouvaient servir sa cause, ou qui, du moins, ne la gênaient pas).
La petite princesse Jeanne était donc destinée d'avance à devenir l'instrument de la conquête royale. Son père, soucieux de se donner un gendre qui pût devenir un allié, l'avait promise au fils d'Hugues de Lusignan, comte de La Marche, le plus puissant seigneur du Poitou et adversaire déclaré du roi de France. Sous les instances et les menaces de Louis VIII, le comte de La Marche dut, en 1225, renvoyer à son père l'enfant déjà confiée à sa garde.
Ce fut donc sur les bases d'une alliance matrimoniale que la régente conçut le traité de paix qu'elle fit proposer au comte par l'intermédiaire de l'abbé de Grandselve. C'est au deuxième fils de Blanche, Alphonse de Poitiers, que sera destinée la petite comtesse de Toulouse; en 1229, les deux enfants ont neuf ans chacun.
Pour rendre ce mariage possible, il faut une dispense du pape: Raymond VII est parent à la fois de Louis VIII (sa grand-mère paternelle, Constance, était la sœur de Louis VII) et de Blanche de Castille (sa mère, Jeanne d'Angleterre, était la sœur d'Éléonore, la mère de Blanche; toutes deux étaient filles d'Éléonore d'Aquitaine). Cette parenté assez étroite, si elle constituait, en principe, un obstacle canonique au mariage, semblait être, à première vue, une garantie pour l'avenir: le règlement de la question du Languedoc prenait presque l'aspect d'une affaire de famille; en sollicitant pour son fils la main de la princesse Jeanne, Blanche de Castille avait l'air de traiter Raymond en parent plutôt qu'en ennemi.
Cependant, les conditions proposées par la reine et transmises à Raymond VII par les bons offices de l'abbé de Grandselve étaient exceptionnellement dures, si l'on songe qu'outre ce mariage forcé qui apportait le Languedoc en dot à la couronne de France, on demandait au comte des garanties et des indemnités qui mettaient d'ores et déjà la province sous la dépendance de la royauté.
C'est à Baziège, vers la fin de l'année 1228, que Raymond rencontra Élie Guérin, abbé de Grandselve, qui lui transmit des propositions de paix; en tout cas, un acte daté du 10 décembre et signé par le comte déclare accepter la médiation de l'abbé et promet de "ratifier tout ce qui sera fait par lui et avec lui en la présence de notre cher cousin Thibaut, comte de Champagne". La lettre ajoute que la décision a été approuvée par les barons et les consuls de Toulouse. La personnalité dont le comte demandait la médiation et, en quelque sorte, l'arbitrage était, en effet, un parent à la fois de la reine et de Raymond VII, par sa grand-mère Marie de France, fille, elle aussi, d'Éléonore d'Aquitaine. Thibaut de Champagne, vassal plutôt récalcitrant de la couronne de France (bien qu'on le prétendit amoureux de la reine), était du nombre de ces grands féodaux qui hésitaient sans cesse entre l'obéissance au roi et des velléités d'indépendance. Cet homme versatile, mais brillant et cultivé, épris de courtoisie et de littérature, poète lui-même, était connu pour ses tendances libérales et même anticléricales. (On trouve dans ses chansons des vers qui flétrissent ouvertement la conduite de l'Église qui a "laissé les sermons pour guerroyer et tuer les gens". "Notre chef (le pape) fait souffrir tous les membres147!") Ce comte avait donc toutes les raisons d'éprouver de la sympathie pour Raymond VII, et déjà, en 1226, il n'avait participé à la croisade qu'à contrecœur. Mais, sans doute à cause de cela même, il n'était pas très bien en cour auprès de Blanche de Castille. Dans tous les cas, sa médiation semble n'avoir servi strictement à rien, sinon peut-être à donner à Raymond VII de faux espoirs.
Si Thibaut de Champagne n'obtint pas grand-chose, comme on va le voir, la reine devait cependant être très pressée de conclure la paix avec le comte, car déjà en janvier 1229, malgré les rigueurs de l'hiver et les difficultés du voyage, l'abbé de Grandselve revenait à Toulouse, porteur du projet de traité élaboré par la régente et le légat.
Par ce projet, le roi de France (en la personne de sa mère) reconnaissait pour siens sans réserves et sans discussions l'ancien domaine des Trencavel, c'est-à-dire: le Razès, le Carcassès et l'Albigeois; plus la ville de Cahors et les terres relevant du comte de Toulouse en Provence (au-delà du Rhône). Le roi "laisse" au comte l'évêché de Toulouse et lui "cède" ceux d'Agen et de Rodez (l'Agenais et le Rouergue méridional) et encore sur ces terres Raymond VII doit-il faire démanteler trente places fortes dont vingt-cinq sont nommément désignées (parmi elles des villes importantes comme Montauban, Moissac, Agen, Lavaur et Fanjeaux) et les cinq non nommées sont laissées à la discrétion du roi. Les biens des personnes "dépossédées" par la reconquête (c'est-à-dire des croisés de Montfort) doivent être restitués. Le comte doit livrer au roi neuf forteresses (dont les deux Penne, d'Agenais et d'Albigeois) pour une durée de dix ans.
De plus, le comte doit "livrer" sa fille, qui sera donnée en mariage à un frère du roi (non désigné) et qui deviendra l'unique héritière des domaines de Toulouse, à l'exclusion des autres enfants que son père pourrait avoir plus tard (sauf le cas où elle mourrait avant lui et qu'il ait des fils légitimes à cette date).
À ce prix-là seulement il pouvait être réconcilié avec l'Église, condition préliminaire du traité car, est-il ajouté, "si l'Église ne nous pardonne pas... le roi ne sera pas tenu d'observer cette paix, et si le roi ne l'observe pas nous n'y serons pas non plus obligé".
Dans ce projet de traité, publié par les hérauts dans les villes du Midi, il est à peine fait mention des hérétiques; l'obligation de les poursuivre est sans doute sous-entendue par le fait même de la réconciliation avec l'Église, mais il n'est pas explicitement parlé des mesures à prendre contre eux et qui semblent laissées à l'initiative du comte.
Si dur qu'il fût, ce traité ne fut pas jugé absolument inacceptable par les barons et les consuls que Raymond VII convoqua au Capitole de Toulouse pour leur soumettre les propositions royales. Il y fut décidé en tout cas que le comte se rendrait à Paris, accompagné d'une délégation de barons et de dignitaires des principales villes, pour essayer de négocier, sur les bases de ce projet, une paix plus avantageuse. L'abbé de Grandselve rapporta la réponse du comte à la reine, qui décida de convoquer, pour la fin mars, une conférence à Meaux (ville en quelque sorte neutre, puisqu'elle relevait du comté de Champagne) afin de fixer les conditions définitives de la paix.
Le traité n'était pas encore signé. Le fait même que c'était l'adversaire qui demandait à négocier et y mettait un empressement peu commun faisait sans doute croire aux barons du Midi que ce projet n'était qu'une manœuvre d'un partenaire décidé à marchander et commençant à dessein par des prétentions exorbitantes, pour se laisser la liberté d'en rabattre ensuite. Étant donné la terrible situation économique du pays, il eût été imprudent de repousser des offres de paix; il est donc certain que le comte se rendit à Meaux dans l'intention de négocier et de discuter, mais non de capituler sans conditions.
On peut se demander quelles considérations ont pu forcer Raymond VII à signer un traité beaucoup plus dur que celui qui lui avait été proposé et que ses conseillers et vassaux n'avaient déjà accepté que sous réserve. Si même un contemporain bien informé, et nullement suspect de fanatisme antifrançais tel que Guillaume de Puylaurens, ne comprend pas, nous le comprenons encore moins. La logique de l'histoire veut que le vainqueur écrase le vaincu jusqu'aux limites du possible, et il faut croire que le Languedoc, malgré d'appréciable succès militaires, se trouvait dans un état de misère dont les témoignages parvenus jusqu'à nous ne donnent qu'une faible idée. Il n'en reste pas moins vrai que ce fut un traité scandaleux, et plus cruel si possible que la dépossession pure et simple de Raymond VII par le concile de Latran.
Le comte de Toulouse arrivait en France à la tête d'une grande délégation, composée de représentants de la noblesse, de la bourgeoisie et du clergé languedociens.
Parmi ces personnalités se trouvaient vingt notables toulousains, consuls ou barons; entre autres, Bernard VI comte de Comminges, Hugues d'Alfaro, beau-frère (naturel) du comte, Raymond Mauran, le fils de ce Pierre Mauran qui fut flagellé et exilé en 1173, Guy de Cavaillon, Hugues de Roaix, Bernard de Villeneuve, etc. Le comte de Foix, Roger Bernard, n'accompagnait pas son suzerain: sans doute son penchant pour l'hérésie était-il trop notoire, et il pouvait craindre de faire échouer les négociations en se présentant en personne. Privée de l'homme qui était, plus que le comte de Toulouse lui-même, l'âme de la résistance du Languedoc, la délégation était en revanche bien représentée du côté du clergé: l'énergique Pierre Amiel, nouvel archevêque de Narbonne, le vieil évêque de Toulouse, les évêques de Carcassonne et de Maguelonne, les abbés de la Grasse, de Fontfroide, de Belleperche et naturellement l'abbé de Grandselve accompagnaient le comte bien décidés à défendre devant le concile de Meaux les droits de l'Église. Le cortège comprenait en outre les nouveaux seigneurs de l'Albigeois, les anciens compagnons de Montfort (ou les héritiers de ceux qui étaient morts entre-temps), Guy de Lévis le "maréchal", Philippe de Montfort, Jean de Bruyère, les fils de Lambert de Croissy, etc., qui tous venaient recevoir du roi l'investiture qui les confirmait dans leurs nouvelles possessions.
À Meaux, la reine avait fait réunir un grand concile, où étaient convoqués les évêques et abbés du Nord aussi bien que du Midi. L'assemblée était présidée par l'archevêque de Sens, assisté par les archevêques de Bourges et de Narbonne; mais le chef véritable de la délégation ecclésiastique était le cardinal-légat Romain de Saint-Ange, en sa qualité de légat des Gaules; il avait à ses côtés les légats d'Angleterre et de Pologne. À la tête des représentants de la couronne se trouvaient le connétable Mathieu de Montmorency et Mathieu de Marly (tous deux parents des Montfort), et le comte Thibaut de Champagne, le médiateur officiel de la paix qui allait être conclue.
Le comte de Champagne mis à part, Raymond VII se voyait donc, en arrivant à Meaux, dans une assemblée composée soit de ses pires ennemis, soit de puissances de l'Église qui ne pouvaient songer à discuter avec lui comme avec un égal, mais au mieux à le traiter en criminel repentant. Il était venu pour traiter avec le roi de France et se trouvait en quelque sorte traduit devant un tribunal ecclésiastique. Mais il est vrai que les pouvoirs laïques étaient représentés par une régente qui valait à elle seule dix évêques.
Le zèle de Blanche de Castille pour la foi catholique est trop connu pour que l'on ait besoin d'insister là-dessus. Cette reine, loin d'imiter son aïeule Éléonore d'Aquitaine, de présider des cours d'amour et de mener une vie mondaine et brillante, consacrait à la prière et à l'étude le temps libre que lui laissaient ses devoirs de mère de famille: elle eut onze enfants, et si la légende qui veut qu'elle les ait allaités elle-même est fausse (on sait que saint Louis eut plusieurs nourrices) il n'en reste pas moins vrai qu'elle s'occupa personnellement de leur éducation, et garda sur eux toute sa vie une influence profonde. Très autoritaire, elle resta, même après la majorité de son fils, la véritable régente du royaume. C'est donc à elle plutôt qu'au cardinal-légat qu'il faut attribuer la responsabilité du traité de Meaux; mais elle était poussée elle-même par une autorité supérieure qu'elle servait avec un dévouement aveugle, encore qu'intéressé. Par un concours de circonstance exceptionnellement favorable, sa piété se trouvait être, dans l'affaire du Languedoc, au service de ses intérêts.
Sans doute était-ce un malheur pour Raymond VII d'avoir, en cette affaire qui décidait du sort de son pays, à traiter avec une femme. Un homme, fut-il Philippe Auguste lui-même, eût peut-être rougi de se rendre coupable d'un tel abus de pouvoir; il eût pu être retenu par le respect des traditions féodales, par la crainte du blâme public, par la nécessité de ménager l'adversaire dans l'espoir de s'en faire un allié. Dans l'attitude de Blanche, on croit sentir la dureté de la femme restée veuve avec des enfants sur les bras et obligée de "se défendre". Femme, elle est, de par la faiblesse de son sexe, en dehors des conventions tacites qui régissent les rapports des hommes entre eux. En politique, elle a la hardiesse (souvent heureuse) des amateurs, qui osent beaucoup par ignorance et par mépris des règles, plutôt que par calcul. Femme encore, elle se laisse dominer par ses sentiments et, farouchement catholique, elle ne voit aucun mal à écouter, dans une affaire d'État, les conseils des prêtres plutôt que ceux des laïcs. Son attachement au légat Romain de Saint-Ange prouve à quel point elle était acquise corps et âme au parti de l'Église.
Il importe assez peu de savoir s'il y eut entre eux ou non ces relations coupables que les contemporains leur ont attribuées (le légat était encore jeune et l'affection que lui témoignait la reine était trop évidente). Fière et dévote, onze fois mère, et accablée par les soucis d'une tâche écrasante, la régente avait-elle encore du temps et du cœur à gaspiller dans une intrigue amoureuse? La rumeur publique l'accusa comme elle devait accuser plus tard Anne d'Autriche, cette autre régente obligée de s'appuyer sur un prêtre pour régner. Ce qui importe, et ce qui est certain, c'est que l'influence de Romain de Saint-Ange fut très grande, et qu'en toutes circonstances la reine approuva son légat et lui laissa les mains libres.
Le programme de répression méthodique de l'hérésie, qui transformait le traité de Meaux en une véritable mainmise policière de l'Église sur le Languedoc, a été élaboré sous la direction du légat; mais la reine, elle aussi, professait une telle horreur de l'hérésie que, plus tard, saint Louis, son fils et fidèle disciple, devait conseiller à ses amis de plonger leur épée dans le ventre de quiconque tiendrait devant eux des propos entachés d'hérésie ou d'incrédulité. Elle ne pouvait qu'approuver sans réserve toutes les mesures que le légat devait prendre contre les ennemis de l'Église.
Il y avait, dans la base des négociations proposées à Raymond VII, un malentendu volontaire: d'un côté il était le chef d'un pays belligérant décidé à conclure la paix; de l'autre, il était un excommunié sans droits ni titres, qui avait commis le crime de disputer au roi des terres qui appartenaient à ce dernier de par la décision de l'Église. La mission de l'abbé de Grandselve s'adressait au comte de Toulouse; arrivé à Meaux, Raymond VII n'était plus que l'excommunié auquel on faisait trop d'honneur en recevant sa soumission inconditionnée. Les négociations préalables n'avaient donc été qu'un simulacre destiné à attirer le comte dans le piège.
Arrivé à Meaux, il n'avait plus d'autre alternative que d'accepter les conditions de ses juges, ou bien de rompre les négociations. Du reste, il n'est pas du tout certain qu'en cas de rupture ouverte le comte eût été libre de repartir et de recommencer la guerre: après la signature du traité de paix, il fut retenu prisonnier au Louvre; rien ne dit que, s'il avait refusé de signer, il eût été traité avec plus de ménagements.
Or, les modifications apportées par le légat aux préliminaires du traité étaient assez considérables.
D'abord, Toulouse devait être de nouveau privée de ses murailles, dont 500 toises (près de 1 km) devaient être rasées, et le château Narbonnais, résidence des comtes, devait être livré au roi de France; ensuite, les indemnités à verser pour dommages de guerre aux églises et aux abbayes (même à celles de Cîteaux et de Clairvaux qui, n'étant pas en Languedoc, n'avaient subi aucun dommage) s'élevaient à des sommes énormes ainsi que l'entretien de la garde du château Narbonnais pour le compte du roi (20000 marcs en tout, payables en quatre ans); ensuite, le traité prévoit la création d'une école de théologie à Toulouse, pour l'entretien de laquelle le comte doit également payer la somme de 4000 marcs, et qui sera dirigée par des maîtres imposés par le roi et l'Église; enfin, le comte s'engage formellement à combattre les hérétiques, à les faire rechercher par ses baillis, à payer 2 marcs d'argent à quiconque aura fait prendre un hérétique, à faire confisquer les biens des excommuniés qui n'auront pas fait leur paix avec l'Église dans le délai d'un an; à ne plus confier de charges publiques aux Juifs et aux personnes suspectes d'hérésie; à combattre tous ceux qui refuseront de se soumettre à ce traité, en particulier le comte de Foix.
L'héritière et l'héritage du comte passent, comme convenu, aux mains du roi de France; le roi hérite même au cas où son frère (l'époux de l'héritière de Toulouse) mourrait sans enfant et où le comte aurait d'autres enfants légitimes. Ce qui est contraire à la coutume et peu logique, puisque pour s'assurer la possession du comté de Toulouse le roi a tout de même besoin du prétexte légal qu'est ce projet de mariage. Il faut croire que Raymond VII, lui aussi, comptait sur la puissance du droit d'héritage: il n'avait que trente-deux ans, et avait amplement le temps de se remarier et de déjouer ainsi les plans trop ambitieux de la régente.
Plusieurs historiens, à commencer par dom Vaissette, lui ont fait grief de ce traité. Nous ignorons quelles pressions furent exercées sur ce prince; mais il est évident qu'à ses yeux, comme à ceux de ses contemporains, ce fut une "paix forcée"148, donc provisoire, et pouvant être dénoncée dès que les circonstances deviendraient plus favorables. Le précédent du concile de Latran était encore dans tous les esprits. Les vaincus ont de tout temps pratiqué la politique du chiffon de papier, le respect des traités n'est sacré que pour le vainqueur.
Les conditions du traité ayant été arrêtées par le synode de Meaux, il ne restait plus qu'à les faire confirmer solennellement par le jeune roi et la régente; la cérémonie devait avoir lieu le jeudi saint, qui tombait le 12 avril. Là seulement, le comte allait être enfin absous et réconcilié à l'Église, sur le parvis de Notre-Dame de Paris, en présence de la reine, des barons, des légats et des évêques, du parlement et du peuple de Paris.
Ce jour qui célébrait la paix entre le roi de France et un grand vassal du Midi devait être signalé par une pompe digne de l'événement. Cet acte de diplomatie devait en même temps être un grand spectacle, avec tribunes, gradins disposés autour du parvis de la cathédrale toute neuve encore, étincelante d'ors et de couleurs vives, et avec laquelle les vêtements somptueux des barons, des dames, des prélats, les bannières, les dais, les tapis, les armures des gardes royaux, les chevaux magnifiquement harnachés pouvaient rivaliser de splendeur. La reine et son fils, le jeune Louis IX, assis sur leurs trônes, avaient les prélats à leur droite, les barons à leur gauche; devant le roi était dressé un pupitre où était posé l'Évangile sur lequel le comte allait jurer d'observer le traité de paix.
À vrai dire, le comte doit apparaître dans cette cérémonie non comme un prince qui vient signer un traité, mais comme un vaincu mené en triomphe derrière le char du vainqueur. Quatorze ans plus tôt un traitement beaucoup plus indigne était infligé à Ferrand, comte de Flandres, traîné dans Paris sur une charrette, les fers aux mains et aux pieds, sous les quolibets de la foule; et le peuple, toujours heureux de l'humiliation d'un grand seigneur, voyait dans le comte de Toulouse un ennemi juré du roi de France justement puni de sa perfidie. Mais Raymond VII n'avait pas été vaincu dans une bataille ni fait prisonnier, et n'était coupable d'aucun manquement à la foi jurée; il était venu de lui-même pour conclure une paix plus avantageuse pour la France que pour son propre pays. S'il fallait à tout prix le présenter comme un vaincu auquel on ne fait grâce que par pure bonté, c'était (indépendamment du rôle joué dans l'affaire par l'Église) parce que la royauté capétienne était en train de devenir assez forte pour se croire de droit divin.
Devant le roi et la régente, et l'assemblée des prélats et des barons, le tabellion royal lit à haute voix le texte du traité, lequel est rédigé au nom du comte de Toulouse qui est, du reste, le seul à s'engager à quoi que ce soit, le roi et l'Église ne lui promettant absolument rien, sinon la libération du peuple de Toulouse des engagements pris envers le roi et les Montfort, engagements qui, de toute façon, n'avaient plus aucune valeur réelle. Le comte par le présent traité déclare: "Que tout l'univers sache qu'ayant soutenu la guerre pendant longtemps contre la sainte Église romaine et notre très cher seigneur Louis, roi des Français, et que, désirant de tout notre cœur être réconcilié à l'unité de la sainte Église romaine, et de demeurer dans la fidélité et le service du seigneur roi de France, nous avons fait nos efforts soit par nous-même, soit par des personnes interposées, pour parvenir à la paix. Que, moyennant la grâce divine, elle a été conclue entre l'Église romaine et le roi des Français d'une part, et nous de l'autre, ainsi qu'il suit149".
Il y a quelque chose de curieux dans ce traité où l'Église descend officiellement au rang de puissance belligérante assimilable au roi des Français; et jamais l'équivoque mélange des pouvoirs spirituel et temporel ne fut poussé plus loin. Tout se passait comme si l'Église, pour absoudre un excommunié, avait besoin de le faire d'abord déposséder par une tierce personne. Les sources de cette étrange situation remontent au concile de Latran: du point de vue de l'Église, le roi, légitime propriétaire (en tant qu'héritier des droits de Montfort), pouvait librement disposer du tout.
À moins de se déclarer contre l'Église, le comte et sa délégation n'avaient rien à répondre à de tels arguments qui, cependant, ne reposaient que sur une pure fiction juridique. C'est donc l'Église qui impose d'abord ses conditions: extermination des hérétiques par tous les moyens, restitution de biens d'Église, indemnisation des dommages faits aux églises et personnes ecclésiastiques, fondation de l'école de théologie, pénitence en Terre Sainte, etc.
La paix royale ne vient qu'après: le mariage de la fille du comte avec un des frères du roi. Jamais cadeau plus magnifique ne fut reçu avec autant de mauvaise humeur: "Espérant, dit le traité, que nous persévérerons dans notre dévouement à l'Église et notre fidélité pour sa personne, le roi nous fait la grâce de recevoir notre fille que nous lui livrerons pour la donner en mariage à l'un de ses frères, et de nous laisser Toulouse et son diocèse sauf la terre du maréchal que le maréchal tiendra du roi; de manière qu'après notre mort la ville et le comté reviendront à notre gendre, ou à leur défaut, au roi..." De cette façon, le classique droit d'héritage est transformé en une faveur royale, un prétexte inventé par le roi pour laisser au futur beau-père d'un de ses frères l'usufruit de ses anciens domaines. Cependant, Raymond VII, petit-fils lui-même d'une fille de France et d'un roi d'Angleterre, n'a pas à considérer comme une "grâce" le mariage de son héritière avec un frère du roi.
La lecture publique de ce traité équivoque se poursuit, avec l'énumération des villes à démanteler, des indemnités à payer, des serments de fidélité à exiger des vassaux, jusqu'à la dernière clause, la seule qui fasse mention des obligations du roi. (Le roi décharge les habitants de Toulouse et tous les peuples du pays des engagements contractés soit envers lui, soit envers son prédécesseur, soit envers le comte de Montfort). La lecture terminée, le comte et le roi apposent leur signature au bas du traité.
Une fois le traité dûment signé, et après que le comte eut donné la promesse de laisser vingt otages (choisis parmi les personnes de sa suite) comme garantie de sa loyauté, Raymond VII va être, enfin, réconcilié à l'Église. Mais il ne le sera qu'après avoir subi l'humiliation publique infligée à son père vingt ans plus tôt sur le parvis de l'église de Saint-Gilles. Dépouillé de ses vêtements, la corde au cou, il sera introduit dans la cathédrale par le légat R. de Saint-Ange et les légats de Pologne et d'Angleterre, et mené jusqu'à l'autel où, agenouillé, il sera frappé de verges par le cardinal-légat. "C'était pitié, écrira Guillaume de Puylaurens, de voir un si grand prince qui, pendant si longtemps, avait résisté à tant et de si puissantes nations, conduit pieds nus, en chemise et en braies, jusqu'à l'autel150". Le chroniqueur était lui-même du diocèse de Toulouse et attaché à ses princes; sa douleur n'était sans doute pas partagée par la majorité de l'assistance, pour laquelle le comte de Toulouse était l'étranger, l'ennemi de la France, un autre Ferrand de Portugal.
On a pu se demander pourquoi Blanche de Castille avait consenti à exposer son parent, déjà assez injustement traité, à cet affront sanglant et nullement nécessaire. Raymond VI, le jour où il fut flagellé à Saint-Gilles, était soupçonné d'un crime capital commis sur ses terres et dont il endossait la responsabilité en tant que chef d'État; il était châtié par le légat sur ses propres domaines; c'était une affaire d'Église, et aucun souverain étranger n'était là pour assister à son humiliation. Paris n'était pas le seul endroit où l'Église de Rome pût manifester son autorité (en principe, du moins).
Or, Raymond VII n'était pas accusé du meurtre d'un légat, et son catholicisme n'avait jamais été mis en doute; s'il avait pris les armes contre Simon de Montfort, ses prétentions étaient si légitimes que, même en l'écrasant, ses adversaires ne pouvaient lui refuser le titre de comte de Toulouse. De plus, il s'était soumis de son plein gré, et cédant aux sollicitations empressées de ses adversaires. Il semble que l'Église, au lieu de le fustiger, eût dû rendre hommage à son esprit de conciliation. Cette humiliation publique d'un prince méridional sur le parvis de la cathédrale de Paris semble être plutôt un triomphe de la politique royale qui, par l'intermédiaire de l'Église, abaissait un grand féodal.
Blanche de Castille, avec plus de hardiesse que son beau-père Philippe Auguste, orientait la monarchie capétienne vers un véritable culte de la personne du roi et vers cet absolutisme qui devait, quatre siècles plus tard, conduire à la quasi-déification d'un Louis XIV. Prenant pour modèle la papauté, la reine agissait comme si le seul fait de s'opposer à la volonté royale constituait un sacrilège. Elle avait de bonnes raisons pour agir ainsi: l'insoumission et les intrigues des grands barons mettaient sans cesse en péril un royaume exposé depuis près d'un siècle à la menace anglaise, et le jeune Louis IX était encore un enfant incapable de se faire craindre. Il fallait donc, non seulement réduire à l'obéissance le vassal insoumis, l'adversaire toujours dangereux qu'était le comte de Toulouse, mais l'humilier, afin de frapper les esprits par cette manifestation éclatante du pouvoir royal. Les verges que maniait Romain de Saint-Ange symbolisaient la victoire future de la monarchie sur la féodalité.
Après la douloureuse cérémonie du Jeudi saint 1229, le comte de Toulouse resta encore six mois prisonnier au Louvre, tant on se méfiait de lui, tant on craignait que sa présence n'empêchât l'exécution des clauses du traité. Il ne devait revenir dans sa ville que le jour où elle serait privée de ses murailles et occupée par les émissaires du roi.
Du mois d'avril jusqu'au mois de septembre Raymond VII restera incarcéré au Louvre, avec les notables et les barons toulousains qu'il avait amenés avec lui. Une lettre royale prétend qu'il est "resté en prison sur sa propre demande". En fait, on pourrait croire que la reine et le légat supposaient que, laissé libre, il eût aussitôt dénoncé le traité et leur eût fermé les portes de Toulouse, au risque d'une guerre à mort. Le traité, qui prévoyait la livraison d'otages, ne stipulait nullement que le comte se livrerait en otage lui-même.
Pendant que le comte restait enfermé dans une tour du Louvre, les commissaires de la reine et du légat - Mathieu de Marly et Pierre de Colmieu, vice-légat des Gaules - se rendaient en Languedoc pour prendre possession des territoires qui étaient concédés au roi et faisaient procéder à la destruction des murs de Toulouse et à l'occupation du château Narbonnais, puis au démantèlement des murailles des places fortes désignées par le traité. Il ne leur fut pas opposé de résistance: la paix était signée, le comte retenu en otage, et c'était sous la garantie de sa signature qu'agissaient les mandataires du roi. Les deux infantes d'Aragon, Éléonore et Sancie, belle-mère et femme de Raymond VII, furent expulsées de leur résidence du château Narbonnais pour céder la place au sénéchal du roi, et la petite princesse Jeanne fut enlevée à sa mère (qu'elle ne devait plus revoir) pour être conduite en France.
Les grands vassaux du comte de Toulouse vinrent prêter hommage aux émissaires du roi. Le comte de Foix refusa d'abord de se soumettre; le traité signé n'était pas celui auquel il avait donné son accord de principe. Au mois de juillet, cependant, il consentit à une entrevue à Saint-Jean-des-Verges (à une lieue au nord de Foix); ses vassaux eux-mêmes le pressaient de conclure la paix. Ce grand chef méridional eut tout au moins la chance de se soumettre sur ses propres terres, entouré de ses vassaux et de ses soldats; et de le faire avec les honneurs de la guerre. Il promit ce qu'on exigeait de lui: les libertés de l'Église, la restitution des dîmes, la poursuite des excommuniés, l'expulsion des routiers, etc. On n'osa pas lui demander des engagements trop précis au sujet de la répression de l'hérésie, son adhésion à la foi cathare étant trop notoire; par son courage, il sut la faire respecter. Cet accord signé, il se rendit lui-même en France et fut reçu par la reine.
Pendant ce temps le comte de Toulouse, toujours prisonnier, accompagnait Blanche de Castille et le jeune roi qui allaient recevoir des mains du sénéchal de Carcassonne la princesse Jeanne. Désormais, la fille du comte de Toulouse n'allait plus connaître d'autre mère que l'austère régente et, en vingt ans, son père ne la reverra que deux fois. Ce précieux otage livré, le père put jouir d'une demi-liberté, et fut même armé chevalier par le jeune roi Louis. (Sans doute considérait-on que son excommunication l'avait en quelque sorte privé du titre de chevalier).
Étrange faveur pour le héros de Beaucaire et de Toulouse, le guerrier éprouvé qu'était Raymond VII, que de se voir donner l'accolade rituelle par un enfant de quatorze ans. Du point de vue des canons de la chevalerie, l'inverse eût été plus logique, le plus modeste chevalier étant supérieur à un jeune homme sans expérience, ce dernier fût-il roi. Les personnes de sang royal étaient-elles (déjà!) en train de devenir les "enfants des dieux" dont parle La Bruyère? Quoi qu'il en soit, le comte accepta de bonne grâce ce douteux honneur, il en avait vu bien d'autres.
Le comte de Foix, arrivé à Paris pour faire ratifier l'accord signé à Saint-Jean-des-Verges, dut comprendre qu'il est plus difficile de négocier en pays ennemi que sur ses propres terres, car la reine réussit à lui extorquer la remise aux forces royales du château de Foix pour une durée de cinq ans. Après quoi, elle lui alloua une pension de mille livres de Tours sur les revenus des domaines confisqués sur l'héritage du comte de Foix dans le Carcassès.
Après avoir reçu l'hommage du dernier baron insoumis du Languedoc, la reine laissa les deux comtes repartir dans leur pays.
137 Op. cit., ch. CLXV.
138 L'affaire de Montgey fut le seul véritable massacre en masse de croisés et de "pèlerins". D'après Catel (cité par Dom Vaissette, éd. de 1879, t. VI, p. 355) "il y en eut mille de tués". En représailles, le bourg et le château de Montgey furent détruits de fond en comble.
139 Op. cit., ch. CLIV, 3812.
140 Guillaume de Puylaurens, ch. XXXX.
141 Tel, par exemple, Bernard-Raymond de Roquefort, déjà cité, dont la mère et le frère étaient notoirement cathares.
142 Rituel cathare. P. Dondaine, Un traité manichéen du XIIIe siècle. Le "Liber de duobus principiis", suivi d'un fragment du"Rituel cathare", Instituto storico domenicano, S. Sabina, Roma, 1939.
143 Liste des seigneurs faidits. Dom Bouquet, Recueil des historiens des Gaules et de France t. 24.
144 Op. cit., ch. CLIV, 3812.
145 Thierry d'Apolda et Constantin d'Orvieto.
146 Constantin d'Orvieto nous apprend que cet homme s'appelait Raymond Gros. En 1236 un parfait de ce nom se convertissait et dénonçait à l'Inquisition un grand nombre de croyants. Il ne s'agit peut-être pas de la même personne.
147 Thibaut de Champagne. Œuvres poétiques.
148 Bernard de La Barthe, "...patz forsada..." Cf. Dom Vaissette, éd. 1885, t. X, p. 337.
149 Texte du Traité de Meaux.
150 Guillaume de Puylaurens, ch. XXXIX.
CHAPITRE IX
LA PAIX DE L'ÉGLISE
I - L'ÉGLISE ET L'HÉRÉSIE
À la fin du XIIe siècle et au début du XIIIe, l'Église catholique ne pouvait prétendre au titre de catholique, c'est-à-dire d'universelle, que sur un plan théorique ou mystique; en fait elle était une des religions du monde occitendal, et en se voulant seule et unique elle tendait de plus en plus à devenir une secte puissamment organisée, plutôt que la patrie spirituelle de tout homme comme elle prétendait l'être.
Les grandes hérésies des premiers siècles avaient déjà enraciné en elle un profond esprit d'intolérance. Les grandes invasions, et les conversions en masse des barbares (certaines très tardives, comme celles des Saxons, des Scandinaves et des Slaves) avaient enrichi la chrétienté d'une masse hétéroclite de peuples encore à demi païens, qui en adorant le Christ et les saints les distinguaient assez mal de leurs divinités anciennes. L'Islam avait conquis l'Afrique du Nord, l'Orient méditerranéen, une grande partie de l'Espagne, et semblait moins que jamais décidé à renoncer à ses conquêtes. Sa combativité et son esprit de prosélytisme étaient au moins aussi grands que ceux du christianisme, et les croisades de Terre Sainte étaient des guerres défensives de la chrétienté contre un adversaire qui cherchait sans nulle équivoque à imposer sa foi par les armes. L'Église grecque, opposée depuis longtemps en esprit et en fait à l'Église romaine, dominait les pays d'Europe orientale soumis à Byzance ou influencés par sa culture, tels la Bulgarie, la Russie, et disputait le terrain à l'Église romaine dans les autres pays slaves qui, attachés à leur langue nationale, s'accommodaient mal du latin que la papauté leur imposait comme langue d'Église.
L'Italie, l'Espagne (qui se trouvait encore en partie sous la domination des Maures), la France, l'Angleterre, l'Allemagne, la Pologne, les Pays Scandinaves, la Hongrie, la Bohême, la Bosnie, étaient catholiques - à des degrés très divers suivant leur éloignement de Rome et l'ancienneté de leur conversion au christianisme. Tel pays, comme la Hongrie ou la Bosnie, étaient encore à moitié païens, et les Juifs et même les musulmans y rivalisaient d'influence avec les catholiques; le Sud de la Russie était païen, et le chef des Coumans ne se fit baptiser qu'en 1227. Les Pays baltes restaient païens malgré les efforts conjugués des Polonais, des Allemands et des Scandinaves pour les convertir de gré ou de force. En Allemagne et en Angleterre le catholicisme, religion d'État, était accepté par les peuples, mais les pouvoirs publics étaient sans cesse en conflit avec Rome. L'empereur était l'ennemi politique le plus redoutable du pape, et son influence dans le Nord de l'Italie était si grande que ce pays devait longtemps rester un des plus rebelles à l'autorité de l'Église. L'Espagne, obligée de défendre sa foi contre l'Islam, était une terre où le catholicisme était d'autant plus ardent qu'il était la foi nationale opposée à celle d'un oppresseur étranger, mais ce pays qui était en train de reconquérir son indépendance était lui-même sans cesse menacé par l'Islam.
La France capétienne était, pour Rome, le seul allié puissant et sûr; et cependant, la conduite de Philippe Auguste avait montré à la papauté qu'un roi de France n'est pas toujours ni forcément le paladin de l'Église. L'ambition d'un Grégoire VII, d'un Innocent III: la fondation d'un Empire chrétien ayant à sa tête le pape dont les rois seraient les lieutenants, était à la mesure du caractère autoritaire de ces grands papes, mais ne correspondait nullement à la réalité. Et si l'Islam et même l'Église grecque (malgré le coup que lui avait porté la croisade de 1204) restaient pour Rome une menace extérieure permanente, les pays officiellement catholiques voyaient surgir des mouvements de plus en plus nombreux d'opposition ouverte à l'Église, car toutes les hérésies avaient pour caractère commun une condamnation absolue et violente de l'Église de Rome.
Les pays balkaniques, le Nord de l'Italie et le Languedoc étaient les terres d'élection des hérésies, parmi lesquelles le catharisme était, aux XIIe et XIIIe siècles, de loin la plus puissante. Cependant, en France, en Allemagne, en Espagne, les foyers d'hérésie étaient également nombreux et actifs.
Au début du XIIIe siècle, l'Église romaine, devenue une grande puissance politique, était en train de perdre la confiance des élites laïques dans les pays mêmes où son orthodoxie n'était nullement contestée; et dans bon nombre de pays catholiques l'hérésie obtenait l'adhésion des foules et avait déjà ses traditions, son organisation, ses ministres et ses martyrs.
Vers 1160, l'Église cathare de Cologne comptait des adeptes dans plusieurs villes du Sud de l'Allemagne, en particulier à Bonn, et malgré la condamnation et le martyre de ses chefs elle inspirait au chanoine Eckbert de Schönau les craintes les plus vives à cause du nombre de ses croyants. En Angleterre, les cathares semblent n'avoir eu guère de succès, et pourtant des missionnaires partis des Flandres y firent vers 1159 un assez grand nombre de néophytes pour provoquer l'inquiétude du clergé, qui d'ailleurs ne les condamna pas au bûcher mais les fit marquer au fer rouge et les chassa dans la campagne où, n'étant pas secourus par une population hostile, ils moururent de froid; cependant, en 1210 encore, il y eut des cathares en Angleterre car l'un d'eux fut brûlé à Londres, et l'on prêche une croisade contre eux.
Dans les Flandres, les cathares étaient nombreux, et l'église cathare d'Arras était si puissante que l'évêque Frumoald, vers 1163, ne pouvait que s'en désoler sans essayer de la combattre, et en 1182 seulement les chefs de cette église furent jugés et brûlés. Mais les Flandres restèrent jusqu'aux temps de l'Inquisition un foyer d'hérésie.
En Champagne, les cathares comptaient plusieurs communautés secrètes mais activement recherchées par le clergé, durant la seconde moitié du XIIe siècle et la première moitié du XIIIe. Nous connaissons l'histoire de la jeune Rémoise qui paya de sa vie son attachement à la virginité; si elle et la vieille qui l'instruisit furent les seules hérétiques découvertes à Reims, il ne s'ensuit pas qu'il n'en existait pas d'autres: ces femmes intrépides devaient être capables de garder le secret. Mais c'est à Montwimer (Mont-Aimé) qu'il y avait surtout, depuis 1140 environ, une grande communauté cathare, qui ne devait être découverte que sous l'Inquisition: elle devait être importante, puisque cent quatre-vingt-trois hérétiques y furent brûlés par l'inquisiteur Robert le Bougre.
Près de Vézelay, dans le comté de Nevers, en 1154, un méridional, Hugues de Saint-Pierre, fonda une communauté hérétique à tendances sociales mais indubitablement cathares d'inspiration, qui groupa les habitants de la région désireux de s'affranchir de la tyrannie des abbés de cette ville; ils furent soutenus par le comte lui-même mais, convaincus d'hérésie, leurs chefs furent condamnés en 1167, ce qui n'empêche pas leurs doctrines de se répandre dans tout le Nivernais, ainsi qu'en Bourgogne où, dans la région de Besançon, ils s'attirèrent les sympathies du peuple à tel point que les prêtres qui les réfutaient risquaient d'être lapidés. Les deux chefs du mouvement furent convaincus d'hérésie par l'évêque et brûlés.
À la Charité-sur-Loire, l'évêque d'Auxerre, Hugues de Noyers, découvrit dès 1198 un foyer d'hérésie; le doyen du chapitre de Nevers protégeait lui-même les doctrines cathares, et l'hérésie était puissante jusque dans les milieux ecclésiastiques. Terric, le chef de la communauté locale, fut brûlé en 1199, mais les progrès de la secte forcèrent tout de même le pape Innocent III à envoyer un légat avec mission spéciale pour enquêter dans le Nivernais, et en 1201 le chevalier Évrard de Châteauneuf, disciple de Terric, fut brûlé à Nevers, tandis que son neveu, le doyen du chapitre Guillaume, parvenait à fuir et se réfugiait dans le pays de Narbonne, où il allait devenir un des chefs de l'Église cathare du pays sous le nom de Théodoric (ou Thierry). En dépit de ces persécutions, le catharisme ne désarme pas et en 1207 la secte cathare de la Charité provoquait encore les foudres des évêques de Troyes et d'Auxerre. En 1223 le fameux inquisiteur Robert le Bougre recevait l'ordre du pape d'exterminer l'hérésie en cette région.
Dans la France du Nord, les communautés hérétiques étaient peu nombreuses, et contraintes à s'entourer de mystère, la majorité de la population étant hostile à l'hérésie. Cependant, le succès des mouvements de Vézelay, d'Arras, l'existence de colonies puissantes comme celle de Montwimer ou de la Charité, fait penser que les cathares étaient plus nombreux que les pouvoirs publics et l'Église ne le soupçonnaient. En France, le catharisme ne représentait pas encore un danger sérieux pour l'Église au début du XIIIe siècle, les membres des diverses communautés ne pouvant former qu'une société occulte, donc assez peu combative. Il n'est pas certain que ce mouvement n'eût pas été capable de s'amplifier et de paraître au grand jour comme il l'avait fait en Italie et dans le Languedoc cinquante ans plus tôt, si l'Église n'avait pas concentré sur la lutte contre l'hérésie tous les efforts de sa politique extérieure et de son organisation interne. Si la France, le plus catholique des pays chrétiens, entretenait des foyers d'hérésie assez tenaces pour que la création d'une Église cathare de France ait été jugée nécessaire par les évêques (cathares) de Bulgarie et du Languedoc, c'est que dans les autres pays catholiques le catharisme songeait déjà à disputer à l'Église de Rome sa suprématie.
De beaucoup la plus faible numériquement, l'Église cathare, à la fin du XIIe siècle, commençait déjà à se donner l'allure et les prérogatives d'une Église universelle; son prestige moral était grand partout où elle avait quelque influence; elle avait sa doctrine, que l'on retrouve (malgré quelques différences de détail) singulièrement stable et cohérente, toujours la même, au XIe comme au XIVe siècle, en Bulgarie comme à Toulouse ou dans les Flandres, et cette unité de pensée est à elle seule une preuve de la force de cette Église. Elle avait son rituel immuable, sa hiérarchie, ses traditions, sa théologie, sa littérature, elle était déjà de taille à opposer son ordre à elle à l'ordre de l'Église établie.
Nous avons vu le crédit dont elle jouissait dans le Languedoc; ce ne serait pas sortir de notre sujet que de proposer un très bref aperçu de l'histoire des Églises cathares des autres pays où l'hérésie était déjà assez forte pour être officiellement ou officieusement reconnue. Seules la grandeur et la réalité du danger expliquent l'attitude de l'Église romaine, depuis la croisade et le concile de Latran jusqu'à l'établissement de l'Inquisition. On ne peut pas dire que la politique de tyrannie et d'oppression adoptée par l'Église ait été un simple abus de pouvoir; si elle fut, à la longue, désastreuse pour l'Église elle-même, elle n'en correspondait pas moins à une nécessité vitale. En brûlant les hérétiques, Rome n'accablait pas un ennemi désarmé, elle se défendait contre un adversaire redoutable, qui avait sur elle l'immense avantage d'apparaître comme le champion de la liberté spirituelle. Pour peu qu'elle soit combative et organisée, une Église persécutée est toujours moralement plus forte qu'une Église établie; Rome ne devait parvenir à détruire les cathares qu'en détruisant dans l'Église catholique une bonne partie de sa raison d'être. Sans doute eût-elle mieux défendu sa foi en cédant la place à l'ennemi et en rentrant dans les catacombes. Mais l'Église romaine, depuis longtemps, n'était plus seulement une Église, mais une caste, une classe sociale et une puissance politique.
L'Église cathare n'était encore rien de tout cela: elle n'avait à défendre que des intérêts spirituels. Elle avait beau jeu, en attaquant Rome: dans beaucoup de pays catholiques l'Église romaine ne représentait ni une puissance civilisatrice, ni une tradition nationale, ni une protection contre l'anarchie féodale, mais une religion étrangère imposée de force par les pouvoirs publics.
Les Slaves des Balkans et de Hongrie, chez lesquels le rite grec s'était déjà répandu grâce aux travaux des Bulgares Cyrille et Méthode (qui avaient traduit la liturgie et les Écritures en langue vulgaire), restaient pofondément hostiles au clergé catholique qui leur imposait le latin, et les moines des nombreux couvents qui existaient dans ces pays, au lieu d'être le soutien de l'Église, en étaient les adversaires les plus dangereux car, méprisés et opprimés par le clergé latin, plus proches des traditions populaires que de la culture imposée par Rome, ils avaient tendance à embrasser les doctrines hérétiques et à les répandre grâce à leur autorité de ministres du Christ. D'autre part, les évêques et prêtres catholiques étaient, dans les pays slaves, très peu nombreux, n'avaient aucune influence sur le peuple, et donnaient l'exemple de la plus scandaleuse corruption.
À l'époque d'Innocent III, la Hongrie, la Croatie, l'Esclavonie, la Bosnie, l'Istrie, la Dalmatie, l'Albanie (de même que la Bulgarie, la Macédoine et la Thrace, d'obédience grecque) étaient des pays où la religion cathare jouissait de la plus grande liberté et souvent de la protection officielle des chefs de l'État. À la fin du XIIe siècle, en Bosnie, le "ban" ou prince Kulin, gouverneur de cette province, était acquis à l'hérésie, ainsi que toute sa famille. En Dalmatie, le diocèse de Trugurium était un des grands centres du catharisme, connu non seulement dans les Balkans mais en Europe occidentale; dans les villes de Split, de Raguse, de Zara, presque toute la noblesse était hérétique. Non seulement la Bulgarie, pays d'origine du catharisme, mais Constantinople même avait un évêché cathare des plus importants. Dans ces pays les évêques eux-mêmes manifestaient de la sympathie pour les doctrines cathares, tels Daniel de Bosnie, ou Arrenger, de Raguse.
Dès l'avènement d'Innocent III les évêques des pays slaves, effrayés par les progrès de l'hérésie, tentèrent d'intimider les adversaires par des persécutions, puis par des appels aux princes. Le roi de Hongrie, fidèle au pape, tenta d'exercer une pression sur le ban de Bosnie, qui fit quelques concessions apparentes; mais son successeur Ninoslas protégea les cathares plus ouvertement encore et fit nommer un hérétique au siège épiscopal vacant par la mort de Daniel. La Bosnie devint officiellement hérétique, aucun service catholique ne fut plus célébré dans le pays, et à partir de 1221 cette province fut une des terres d'élection du catharisme et offrit refuge et secours aux cathares persécutés des autres pays.
Innocent III faisait cependant des efforts pour convertir les Bulgares, soumis à l'Église de Byzance et où les cathares ou bogomiles étaient particulièrement nombreux: après avoir couronné le tsar bulgare Kalojan, qui s'était soumis à Rome pour bénéficier de l'aide du pape contre les Grecs, Innocent III vit son protégé accorder sa protection aux seigneurs hérétiques de sa province; Jean Azen, tsar de Bulgarie à partir de 1218, laissa aux cathares pleine et entière liberté de prêcher et d'exercer leur culte.
En Hongrie, les rois Émeric, puis André II, sincèrement catholiques et poussés par les papes Innocent III, puis Honorius III, tentèrent à plusieurs reprises d'exterminer l'hérésie dans leur pays. Avec leur aide, les évêques et les légats menèrent une lutte serrée contre les cathares de Bosnie et, en 1221, le moine hongrois Paul fonda un couvent de Frères prêcheurs à Raab; mais dès leur première mission en Bosnie, trente-deux Dominicains furent noyés dans la rivière par la foule exaspérée par leur prédication. Et malgré l'apparente soumission du ban Ninoslas, l'hérésie resta si puissante dans cette province qu'en 1225 Honorius III fit prêcher une croisade; sans succès d'ailleurs. L'archevêque de Colocza donne deux cents marcs à Jean, seigneur de Sirmie, pour l'engager à prendre la croix, et encore ne parvient-il pas à l'y décider; seul le roi de Hongrie, Coloman (fils d'André II), tente une action militaire en 1227, sans grand résultat.
Pour contrebalancer, en Bosnie, l'influence de l'unique évêque (lui-même passé à l'hérésie), le pape institue un second évêché, où il place le Dominicain allemand Jean de Wildeshusen, lequel se rend vite impopulaire par ses violences. Pour réduire à l'obéissance le ban de Bosnie, le pape fait appel au duc Coloman d'Esclavonie, comme naguère, pour le Languedoc, il avait fait appel au roi de France; Coloman, à la tête d'une nouvelle croisade, obtient ou prétend avoir obtenu quelques succès (1238), mais l'hérésie n'en semble nullement ébranlée. Le pape envoie un nouvel évêque dominicain qui, deux ans plus tard, découragé, abandonne son poste.
Si dans les pays slaves l'hérésie était forte au point de faire (suivant les circonstances politiques et les convictions des souverains) figure de religion officielle, son succès s'explique par l'opposition naturelle des peuples slaves à l'emprise de Rome, par l'affaiblissement de l'autorité de l'Église grecque (qui, si elle était tout aussi stricte que l'Église romaine sur le chapitre de l'orthodoxie, était moins fortement organisée, menacée à la fois par l'Islam à l'Orient, par Rome à l'Occident, et était même dans un sens plus proche en esprit du manichéisme que ne l'était l'Église catholique). Il n'y a donc rien d'étonnant à ce que l'hérésie ait rencontré un terrain particulièrement favorable dans ces pays à peine christianisés et soumis à tant d'influences diverses et rivales.
Ce qui paraît plus extraordinaire, c'est que l'Italie, patrie des papes et catholique de longue date, ait si longtemps été un pays aussi hérétique que l'était le Languedoc. Il y avait des communautés cathares à Rome même et, au XIIe siècle, on signale de puissantes colonies hérétiques à Milan, à Florence, à Vérone, à Orvieto, à Ferrare, à Modène et jusqu'en Calabre.
Pendant qu'une croisade dirigée contre les hérétiques plongeait dans la désolation le Midi de la France, les cathares d'Italie jouissaient d'une liberté presque officielle et formaient dans les villes des clans puissants qui parvenaient parfois à chasser les évêques et les seigneurs catholiques.
La Lombardie était tout particulièrement gagnée à l'hérésie; terre d'Empire où partisans du pape et de l'empereur s'affrontaient sans cesse dans des luttes sanglantes, ménagée à la fois par les deux grandes puissances dont elle dépendait et menacée par les deux, la Lombardie était un pays où les grandes cités commerciales étaient autant de républiques indépendantes et, en tout cas, jalouses de leur liberté. Plus que pour aucun autre pays chrétien, l'Église représentait pour les Lombards une puissance politique et, plus tard, les luttes entre Guelfes et Gibelins montreront qu'en Italie les passions religieuses cédaient le pas, et de beaucoup, aux passions politiques. C'est cet aspect de luttes pour l'indépendance nationale et l'émancipation sociale que prenaient les mouvements cathares d'Italie. Les évêques, féodaux puissants toujours prêts à défendre leurs privilèges par les armes, se heurtaient dans les villes à une résistance opiniâtre dont le zèle religieux n'était souvent que le prétexte. Et les catholiques se battaient moins pour leur foi que pour les intérêts de leur clan ou de leur parti politique.
C'est - assez paradoxalement - cet état de guerre civile permanente qui préserva, pendant longtemps, en Italie un climat de relative tolérance religieuse. Tant que les catholiques du pays prenaient eux-mêmes les armes pour combattre leurs compatriotes hérétiques, il existait un certain équilibre des forces qui obligeait les uns et les autres à certains ménagements; et le pape, qui tenait à garder son emprise sur la Lombardie, ne pouvait faire appel à l'empereur pour une croisade dont ce dernier n'eût que trop bien tiré profit. Si bien qu'en 1236, au moment où l'Inquisition à ses débuts déployait dans tous les pays catholiques une énergie allant jusqu'à l'excès, l'empereur pouvait accuser le pape de favoriser l'hérésie et de s'être laissé corrompre par l'or des hérétiques lombards. Le fanatique Grégoire IX ne pouvait pas être suspecté de vénalité; mais les cathares d'Italie, également hais par le pape et par l'empereur, durent à la rivalité politique qui séparait ces deux grands personnages leur relative sécurité.
L'Église était impopulaire en Italie, où le clergé était exceptionnellement combatif et même belliqueux et se mêlait avec ardeur aux guerres civiles; les prélats étaient avant tout soucieux de conserver les droits que les communes de plus en plus puissantes leur disputaient souvent avec violence. Toutes les sectes religieuses florissaient en Italie: les amaldistes, ou disciples du réformateur Arnaud de Brescia, les vaudois, les pasagiens ou judaïsants. Mais les cathares étaient les plus nombreux et les plus influents. Une grande partie de la noblesse leur était acquise, et ils se sentaient forts de l'appui des cathares du Languedoc et des pays slaves. Ils avaient des écoles, enseignaient sur les places publiques, engageaient des controverses avec les clercs, et la Lombardie au début du XIIIe siècle passait presque pour la terre de pèlerinage de tous les cathares d'Occident, qui s'y rendaient pour consulter des docteurs de leur secte et s'y faire accorder ou renouveler le consolamentum par des maîtres particulièrement vénérés.
À l'époque d'Innocent III, les Églises cathares étaient abondamment représentées en Italie, avaient un évêque à Sorano, un à Vicence, un à Brescia, et leurs fils majeurs gouvernaient les communautés d'autres villes; Milan était un centre officiel de toutes les Églises hérétiques, et les magistrats de cette ville, hostiles au clergé, protégeaient ouvertement toutes les sectes et accordaient refuge dans leurs murs à tous les hérétiques chassés d'autres pays. Dans des villes comme Vérone, Viterbe, Florence, Ferrare, Prato, Orvieto, les cathares dominent, et les évêques sont impuissants à sévir contre eux; à Faenza, Rimini, Côme, Parme, Crémone, Plaisance, ils ont des communautés florissantes; une grande Église cathare est établie dans la petite ville de Desenzano. À Trévise, les hérétiques sont protégés par les pouvoirs publics, à Rome même, ils ont des écoles où ils enseignent les Évangiles.
Les cathares d'Italie jouissaient au début du siècle d'une telle sécurité qu'ils pouvaient se permettre des divergences théologiques et des scissions au sein de leurs Églises: ainsi les évêques de Sorano et de Vicence suivaient-ils l'école de Trugurium ou d'Albanie, et celui de Brescia embrassait la doctrine des cathares de Bulgarie (les premiers affirmant que le principe du mal était éternel, les seconds que le Dieu bon avait été seul à l'origine). Les deux sectes se livraient, entre elles, à d'ardentes polémiques théologiques; et, vers 1226, la première se scinda elle-même en deux fractions, l'une étant représentée par l'évêque Belismansa et l'autre par son fils majeur Jean de Lugio.
Innocent III, épouvanté par les progrès rapides des hérésies dans la péninsule, commença par des menaces d'ordre administratif, telles que l'interdiction aux hérétiques des fonctions publiques; mais ces ordres ne furent pas souvent exécutés. L'excommunication, elle aussi, restait sans effet. L'action directe des émissaires du pape n'était guère plus heureuse: à Orvieto, le gouverneur Pierre Parentio, envoyé par le pape, est mis à mort par les citoyens hérétiques exaspérés par ses violences. À Viterbe, des hérétiques sont promus au rang de consuls malgré les menaces du pape, et ce dernier doit, en 1207, venir en personne dans la ville pour faire confisquer les biens et démolir les maisons des principaux membres de la secte. Après 1215, quand le concile de Latran eut confirmé et érigé en lois immuables toutes les mesures pratiquées par l'Église et l'État contre les hérétiques, la persécution devint plus serrée, à peine plus efficace; et ceci, malgré l'appui que l'empereur Frédéric II accordait à cette politique d'oppression. À Brescia, en 1225, catholiques et hérétiques en viennent aux armes, les premiers sont vaincus et les hérétiques incendient les églises et lancent des anathèmes contre Rome; et, malgré les menaces d'Honorius III, les cathares restent puissants dans la ville. À Milan, en 1228, les mesures les plus sévères sont décrétées par les évêques et jurées par les notables: expulsion des hérétiques, démolition de maisons, confiscation de biens, amendes, etc., mais ces mesures ne sont pas exécutées, et les plus riches bourgeois et notables donnent ouvertement asile aux cathares et créent pour eux des écoles et des maisons destinées au culte. À Florence, malgré l'arrestation et l'abjuration de l'évêque cathare Patemon, en 1226, la communauté reste puissante, et elle compte parmi ses fidèles bon nombre de prêtres, d'artisans, de gens du peuple, sans compter la noblesse. À Rome, les cathares sont si nombreux que leur influence reste grande dans cette ville malgré les menaces d'amendes, de pertes de droits, etc., et la création d'une milice de Jésus-Christ destinée à lutter contre l'hérésie.
Quand le pape eut recours à l'ordre des Frères prêcheurs qu'il chargea tout spécialement de combattre l'hérésie, plusieurs Dominicains doués d'une grande énergie et d'une éloquence remarquable, tels Pierre de Vérone, Moneta de Crémone, Jean de Vicence, parcoururent les villes lombardes, excitant les catholiques à la lutte, semant la terreur parmi les hérétiques et allant jusqu'à se mettre à la tête de troupes armées. Pierre de Vérone (cathare converti) fut assassiné en 1252, ce qui lui valut la canonisation et le titre de saint Pierre martyr. Les mouvements de réaction catholique se multiplièrent. À Parme est fondée une association de "chevaliers de Jésus-Christ". À Florence se fonda une congrégation de la Vierge, et le peuple s'enrôla dans des milices pieuses chargées de sévir contre les cathares; cependant, les hérétiques comptaient dans cette ville des partisans zélés parmi la plus haute noblesse, ainsi que dans le peuple; le clergé local n'osait rien entreprendre contre eux, malgré les efforts des inquisiteurs. Mais, à Milan, les menaces de l'empereur forcèrent les habitants à faire preuve d'orthodoxie et, en 1240, le podestat Oldrado de Tresseno fit brûler un grand nombre de cathares. À Vérone, Jean de Vicence fit brûler, en 1233, soixante personnes; en 1235, l'évêque cathare, Jean Beneventi, fut brûlé à Viterbe avec plusieurs de ses compagnons; à Pise, deux parfaits sont brûlés en 1240.
Mais l'exercice de l'Inquisition rencontra dans la plupart des villes une résistance de plus en plus grande; à Bergame, les magistrats de la ville restèrent sourds à toutes les menaces des légats, à Plaisance, l'inquisiteur Roland fut maltraité et chassé par la foule; à Mantoue, en 1235, l'évêque fut assassiné; à Naples, les hérétiques saccagèrent le couvent des Dominicains, etc.
À la mort de Grégoire IX, en 1241, les cathares sont aussi puissants en Italie qu'ils l'étaient un demi-siècle plus tôt: à cette date, on compte en Lombardie plus de 2000 parfaits, plus les 150 parfaits de l'Église française de Vérone. En 1250, la mort de Frédéric II déliera les mains au pape qui pourra concentrer tous ses efforts sur l'extirpation de l'hérésie en Italie du Nord, mais jusqu'au début du XIVe siècle les villes lombardes resteront de tenaces foyers de catharisme, et la lutte entre magistrats et évêques continuera avec la même violence, soutenue par les passions politiques et les rivalités de clans; les bûchers, de plus en plus nombreux, décimeront les rangs des parfaits, des inquisiteurs seront assassinés, de nouvelles hérésies surgiront pour remplacer le catharisme qui commencera à perdre du terrain, et les hérétiques français continueront à se réfugier en Lombardie pour y réorganiser leurs Églises persécutées.
Dans le Midi de la France, comme nous l'avons vu, l'expansion de l'hérésie n'avait pas donné lieu à des troubles sociaux, et seules quelques initiatives personnelles dans le genre de la Confrérie blanche de Foulques rappellent ce climat de guerre civile qui régnait en permanence dans les villes de Lombardie. Des catholiques italiens pouvaient prendre les armes pour le pape, en voyant en lui l'adversaire d'un empereur qui les opprimait. Il se trouve qu'en Languedoc à peu près tout le monde (sauf le clergé) était contre le pape, dès avant la croisade; les cités méridionales étaient patriotes et n'avaient guère de sympathie pour une puissance qui les exploitait sans leur fournir de compensation sur le plan politique ou social. Les évêques eux-mêmes, mondains ou cupides, ne servaient le pape que dans la mesure où ce dernier servait leurs intérêts et préféraient souvent laisser en paix les hérétiques parmi lesquels ils comptaient des parents et des amis. La croisade acheva de cimenter la profonde union du pays presque tout entier; mais elle avait créé, entre l'Église et la société laïque, une opposition qui allait toujours grandissant.
Frédéric II, ennemi et rival de la papauté, n'eût pas mieux demandé que d'exterminer par les armes les hérétiques de Lombardie pour occuper cette province, et le pape se garda bien de l'y inviter; le roi de France put occuper le Languedoc avec les encouragements et la bénédiction solennelle du pape, qui ne craignit pas d'identifier, pour ce pays, la cause de la France avec celle de Dieu. La croisade avait réussi à créer cet état de choses si rare au moyen âge: un pays où le peuple, la bourgeoisie, la noblesse, au lieu de s'entre-déchirer - ou tout au moins de vivre dans un climat de méfiance réciproque - formaient une véritable union nationale autour de leur souverain légitime; et si le malheur seul crée de ces situations privilégiées, elles ne peuvent se produire que chez un peuple déjà profondément uni et conscient de sa grandeur nationale.
Il serait difficile de croire que tout le peuple du Languedoc fût hérétique; il est à peu près certain qu'il était, en 1229, tout entier anticatholique, puisque l'Église était devenue l'ennemi national. Le traité de Paris met sur le même plan l'Église et le roi de France; qui donc pouvait, sans passer pour un traître, vénérer le pape, dans un pays où, depuis vingt ans, le nom de Français était devenu synonyme de bandit et de pillard? Le roi ne s'était pas montré plus magnanime que Simon de Montfort. Et il était plus difficile à éliminer.
Raymond VII, quand il eut signé le traité qui livrait le pays à la France, ne perdit pas sa popularité: il fut considéré comme une victime. Un pays mutilé et dévasté par la guerre accueillait des sénéchaux et des fonctionnaires étrangers qui venaient abattre les murs de ses places fortes, occuper sa capitale pour rendre impossible toute velléité d'indépendance de la part du comte, prélever sur des terres déjà ruinées des impôts assez lourds pour paralyser la vie économique du pays. Tout cela se faisait au nom et sur l'ordre de l'Église. Une grande partie des impôts exigés (la moitié) allait revenir aux églises et aux abbayes, et les évêques, plus puissants que jamais, allaient être libres de prélever les dîmes et les redevances dont les intendants royaux sauraient faire exiger le paiement. Le Carcassès, le Razès, l'Albigeois, le pays narbonnais devenaient terres du roi - ce qu'ils étaient déjà depuis 1226, mais cette fois-ci l'annexion semblait définitive; le Toulousain, le Quercy et l'Agenais dépendaient encore du comte de Toulouse, ce dernier étant sous la surveillance d'une garnison française installée dans la capitale. Revenu dans Toulouse invaincue et dont on allait de nouveau abattre les murailles, le comte était suivi par le cardinal-légat de Saint-Ange lui-même; le légat entendait bien faire comprendre aux Toulousains et à tout le Languedoc que cette paix était avant tout la paix de l'Église.
Mais ce n'était pas une Église victorieuse qui s'installait pour régner en maîtresse dans un pays conquis; c'était une Église vaincue. Les vrais vainqueurs - les croisés, le roi de France, et surtout la misère du peuple - avaient merveilleusement servi la cause de l'hérésie, et l'Église était si bien vaincue que seules les armes d'un occupant pouvaient lui faire partiellement sauver la face; il lui fallait à présent commencer lai reconquête de ce pays par d'autres moyens que le recours au bras séculier; et elle risquait fort de voir! son action réduite à des menaces impuissantes, a moins d'inventer un nouveau système de contrainte,; plus efficace que celui de la force armée.
La tâche n'était pas facile. Mais, depuis 1209, un profond mouvement de réforme à l'intérieur de l'Église lui avait permis de recruter parmi ses membres un grand nombre de lutteurs énergiques et décidés à tout pour faire triompher leur foi. Si leur activité allait ressembler davantage à celle de policiers qu'à celle de missionnaires, c'est qu'ils avaient affaire à trop forte partie, et qu'ils n'avaient plus guère le choix des armes. Pour désarmer la haine du peuple occitan, bonté, justice et modération ne leur eussent pas suffi; il leur eût fallu tout bonnement disparaître. Leur charité ne pouvait aller jusque là.
II - LE CONCILE DE TOULOUSE
En novembre 1229 le cardinal-légat de Saint-Ange arrivait à Toulouse pour inaugurer avec la pompe et l'éclat convenables l'ère nouvelle de prospérité et de paix qui commençait à présent pour le Languedoc; prospérité de l'Église catholique sous l'égide de la puissante et heureuse protection du roi de France, paix dans l'unité de la foi et dans la fidélité des seigneurs et du peuple à l'Église et au roi.
Une cérémonie solennelle eut lieu dans Toulouse même; le comte dut de nouveau faire publiquement acte de soumission au légat, qui ne lui imposa pas une seconde flagellation mais ne s'en donna pas moins des airs de souverain absolu accordant par bonté à un sujet rebelle et repentant le pardon et la restitution partielle de ses domaines. Le texte du traité fut lu à haute voix et rendu public devant l'assemblée des évêques et des nobles du pays, qui prêtèrent le serment d'en respecter fidèlement toutes les clauses.
Romain de Saint-Ange, dont la carrière en France se terminait par un si brillant succès, ne devait pas quitter Toulouse ni le Languedoc avant d'avoir établi sur des bases solides la nouvelle politique de l'Église dans ce pays. Les engagements pris par le comte, les serments prêtés par ses vassaux ne devaient pas, cette fois-ci, subir le sort de tous les engagements ultérieurs maintes fois pris par les maîtres du Languedoc, et restés au stade de bonnes intentions jamais réalisées et prétendues irréalisables. Voulant battre le fer tant qu'il était chaud, l'énergique légat fit réunir à Toulouse un concile où assistaient tous les prélats du Midi, et ayant pour objets: 1° la fondation ou plutôt la rénovation complète de l'Université de Toulouse (le légat Conrad de Porto avait déjà, pendant la croisade, jeté les bases de cette Université catholique); 2° une organisation solide et efficace de la répression de l'hérésie.
Il est curieux de lire la lettre circulaire rédigée lors de ce concile par les maîtres de théologie de la nouvelle Université et destinée à être envoyée dans les grands centres scolaires de l'Occident afin d'attirer à Toulouse de nouveaux étudiants. Romain de Saint-Ange avait amené avec lui les professeurs de théologie et de philosophie de Paris qui avaient quitté l'Université à la suite de la querelle qui avait opposé les écoles et le chapitre de Notre-Dame. La nouvelle Université ne manquait pas de fonds, le comte devant payer chaque année quatre mille marcs d'argent pour son entretien. À lire la lettre de propagande rédigée par les nouveaux professeurs, on pourrait imaginer que le pays où ils cherchent à attirer les étudiants est un havre de paix au milieu des troubles et des guerres qui sévissent dans toute l'Europe; les gens du pays sont doux et accueillants, la vie n'est pas chère, les logements nombreux, le climat agréable, etc. Enfin, là "où s'étaient développées comme une forêt les broussailles épineuses de l'hérésie", la nouvelle Université allait "exalter jusqu'aux cieux le cèdre de la foi catholique". Elle devait remplacer par les luttes pacifiques de la controverse les massacres de la guerre151. Bref, la réconciliation à l'Église du comte de Toulouse a apporté à son pays la paix, la victoire de la foi, et des promesses de prospérité et de bien-être.
Tel devait être, en effet, le désir non seulement des éléments catholiques du pays, mais aussi du comte lui-même et du peuple las de la guerre; une paix, même forcée, même cruelle, pouvait permettre au Languedoc de respirer, les paysans pourraient semer le blé sans craindre de voir leurs champs saccagés chaque année.
En vingt ans, Toulouse avait vu entrer dans ses murs en maîtres Simon de Montfort et le prince Louis, Foulques et les légats; elle pouvait espérer que le règne des nouveaux maîtres ne serait pas plus durable que celui des précédents. Le comte conservait une partie de ses pouvoirs et le légat allait bientôt rentrer à Rome.
Romain de Saint-Ange ne croyait évidemment pas avoir aboli l'hérésie d'un trait de plume, ni en être déjà au stade des "luttes pacifiques de la controverse", bien au contraire: jamais plus aucune controverse n'opposera dans ce pays l'hérésie à la vérité catholique; ce ne sera pas en chaire de théologie (ni dans aucun autre lieu, sinon la prison) que les hérétiques pourront produire leurs arguments pour être réfutés, et ces luttes pacifiques se réduiront à des monologues. Fort des termes du traité de Paris, le légat dresse une liste de règlements qui, s'ils ne sont pas, pour la plupart, une innovation en matière de législation ecclésiastique, seront pour la première fois appliqués de façon systématique et permanente.
La répression de l'hérésie entre dans le cadre des lois communes, obligatoires pour tous au même titre que le droit civil et criminel, et même plus strictes puisqu'elles doivent concerner tous les habitants du pays sans la moindre exception; et que, d'après ces règlements nouveaux, une fillette de douze ans qui, par suite d'une maladie ou d'une absence prolongée, aurait négligé de prêter serment de combattre l'hérésie (ou même n'aurait pas pu pour une raison quelconque se confesser à Pâques) pouvait devenir suspecte d'hérésie et passible de poursuites judiciaires!
Ce qui frappe, en effet, dans ces règlements, c'est leur caractère méthodique, pour ne pas dire bureaucratique; ils semblent - sur papier, du moins - instituer un véritable système de contrôle policier sur toute une population, et l'on se demande si l'Église possédait les moyens matériels de faire appliquer ces articles à la lettre. En tout cas, elle ne devait y parvenir qu'après de longues années d'efforts.
Voici les principaux articles de ce règlement:
Les archevêques et évêques doivent nommer, dans chaque paroisse, un prêtre et deux ou trois laïques de bonne réputation, qui visiteront chaque demeure, tous les lieux suspects, les souterrains, les greniers, etc., et en général tout ce qui pourrait servir de cachette aux hérétiques. S'ils y trouvent des hérétiques ils devront avertir de leur capture l'évêque et le seigneur du lieu ainsi que les bailes, pour procéder à leur jugement. Les mêmes recherches doivent être effectuées par les seigneurs et les abbés, dans les maisons, les villes, et surtout les forêts.
Quiconque serait convaincu d'avoir permis à un hérétique de demeurer sur sa terre la perdrait, et lui-même serait remis à la justice de son seigneur. Même si sa connivence avec les hérétiques n'était pas prouvée, il tombe sous le coup de la loi si les hérétiques trouvés sur sa terre sont nombreux. La maison où sera découvert un hérétique devra être brûlée, et la propriété sur laquelle elle se trouve, confisquée.
Tout baile qui se montre négligent dans la recherche des hérétiques perdra ses biens et sa place.
Nul ne sera puni comme hérétique ou croyant que par l'évêque du lieu ou un juge d'Église, et après jugement.
Chacun peut rechercher les hérétiques sur les terres d'autrui et les bailes du lieu doivent l'y aider. Ainsi les bailes du roi peuvent rechercher les hérétiques sur les terres du comte de Toulouse et vice versa.
Quand un hérétique abandonne l'hérésie de son plein gré, il changera de résidence, il sera déclaré hors de tout soupçon; il portera deux croix d'une autre couleur que ses vêtements, cousues sur les deux côtés de sa poitrine; il n'exercera aucune charge publique, ne sera pas admis à rédiger des actes publics (à moins d'être réintégré dans ses droits par lettre du pape ou du légat). Tout hérétique qui serait revenu à la foi catholique non spontanément mais par crainte de la mort ou toute autre raison, sera mis en prison par l'évêque; ceux auxquels ses biens seront donnés seront tenus de pourvoir à son entretien; s'il n'a pas de fortune l'ordinaire y pourvoira.
Tout homme âgé de plus de quatorze ans et toute femme de plus de douze ans devra abjurer l'hérésie, jurer fidélité à l'orthodoxie et promettre de rechercher les hérétiques et de dénoncer ceux qui lui sont connus. On relèvera les noms de tous les habitants de la paroisse, et tous prononceront le serment devant l'évêque ou son mandataire; les absents le prêteront dans les quinze jours qui suivront leur retour. S'ils ne le font pas (ce qui sera facile à constater par l'examen des noms) ils seront suspects d'hérésie. Ce serment doit être renouvelé tous les deux ans.
Toute personne des deux sexes, arrivée à l'âge de raison, doit se confesser à son curé (ou à un autre prêtre avec la permission de son curé) trois fois par an. Elle communiera à Noël, à Pâques et à la Pentecôte, à moins qu'elle ne s'en abstienne ad tempo sur le conseil de son curé. Les prêtres rechercheront ceux qui s'abstiendront de communier, et qui encourront, de ce fait, le soupçon d'hérésie.
Les chefs de famille sont tenus d'assister à la messe les dimanches et jours de fête sous peine d'une amende de douze deniers, à moins qu'ils n'en soient excusés par la maladie ou autre cause légitime.
Nul ne pourra posséder un Ancien ni un Nouveau Testament, sauf peut-être le Psautier, le Bréviaire ou les Heures de la Vierge, mais en latin.
Aucune personne suspecte d'hérésie ne pourra exercer la profession de médecin. Le malade qui a reçu la communion sera mis en surveillance pour empêcher l'approche d'un hérétique ou d'un suspect d'hérésie.
Les testaments seront faits en présence du curé, ou, en son absence, d'une personne ecclésiastique ou laïque de bonne réputation; sinon ils sont nuls.
Il est interdit à tout seigneur, baron, chevalier, châtelain, etc., de confier à un hérétique ou à un croyant l'administration de ses terres.
Sera "diffamé" celui qui sera dénoncé par l'opinion publique et dont la mauvaise réputation serait constatée par l'évêque ou par des personnes dignes de foi152.
Ces décrets, comme on le voit, exigeaient pour être appliqués un personnel nombreux chargé d'en surveiller l'exécution. Sans doute chaque prêtre pouvait-il dresser la liste de ses paroissiens et même signaler ceux qui se seraient abstenus de prêter serment ou de communier, et les déclarer suspects d'hérésie. Il était déjà difficile de les faire tous traduire en jugement pour peu qu'ils fussent nombreux. La crainte de s'attirer des ennuis pouvait pousser beaucoup de fidèles à se conformer aux règlements; mais encore fallait-il que cette crainte, fut justifiée, à la longue, par la puissance effective de l'Église.
Il n'était peut-être pas difficile de trouver dans chaque paroisse deux ou trois laïques désireux de rechercher les hérétiques, mais encore fallait-il que ces deux ou trois personnes fussent soutenues par la majorité des habitants du lieu, sinon il leur serait difficile de s'emparer des hérétiques découverts.
L'intérêt pouvait pousser les seigneurs à confisquer les terres des personnes qui abriteraient les hérétiques; la peur de perdre leurs biens ou leurs places et de voir leurs maisons démolies pouvait forcer les gens à refuser aux hérétiques le droit d'asile. Mais encore fallait-il qu'il existât une autorité assez forte pour se charger de cette chasse aux hérétiques, pour démolir les maisons et confisquer les terres. Outre les désordres inévitables qu'un tel système de répression risquait de provoquer dans le pays, il était difficile de compter, pour l'exécution de ces mesures, sur le comte et ses vassaux, et même sur les fonctionnaires du roi, déjà assez pris par leurs autres obligations. Les évêques possédaient des milices armées; mais pour capturer les hérétiques il fallait d'abord les trouver, et ils étaient habiles à dépister les recherches. Et parmi les gens "diffamés" se trouvait un grand nombre de puissants seigneurs auxquels il n'était pas facile de s'attaquer, et qui du reste avaient prêté serment pour prouver leur orthodoxie.
Romain de Saint-Ange ne se contenta pas de faire promulguer les décrets: il voulut, avant son départ de Toulouse, frapper l'opinion par un procès éclatant, susceptible d'intimider ceux qui croiraient ses règlements inapplicables. Or, il avait sous la main deux hérétiques récemment découverts et arrêtés par les hommes du comte de Toulouse (qui, pour inspirer confiance au légat, avait tenu à lui donner cette preuve de bonne volonté). Ces deux hommes étaient des parfaits; l'un, Guillaume, est même mentionné par Albéric des Trois Fontaines153 sous le titre de "pape" (apostolicus) des Albigeois; peut-être s'agissait-il d'un évêque du diocèse d'Albi, en tout cas d'un vieillard particulièrement vénéré que, pour donner plus d'éclat à leur capture, ses adversaires auraient paré du titre de pape. L'autre parfait, prénommé également Guillaume - de Solier - était aussi un hérétique de marque, bien connu dans le diocèse de Toulouse.
Le prétendu pape des Albigeois marche au supplice avec la fermeté qui était de règle chez les ministres cathares, et fut solennellement brûlé à Toulouse devant le cardinal-légat. Mais Guillaume de Solier se convertit au catholicisme et devint ainsi le plus précieux auxiliaire de l'Église. Le concile le réhabilita, afin de pouvoir légalement recueillir ses témoignages. Cet homme dénonça un grand nombre de personnes qu'il savait appartenir à l'Église cathare. Il était bien placé pour les connaître, pour révéler leurs cachettes et leurs lieux de réunion. Il ne semble pourtant pas qu'il ait dénoncé ou fait découvrir beaucoup de parfaits, car les personnes citées sur ses dénonciations étaient de simples croyants.
L'évêque de Toulouse fit ensuite convoquer un certain nombre de personnes dont l'orthodoxie était reconnue et en obtint des témoignages contre ceux des hérétiques qu'elles connaissaient; ce qui, avec les dépositions de Guillaume de Solier, forma une liste impressionnante de suspects. Ces derniers furent cités pour comparaître devant le tribunal ecclésiastique.
Mais cette première enquête ne donna pas de résultats appréciables: interrogés, les suspects refusèrent de parler. Certains, plus courageux ou plus instruits que les autres, exigèrent les noms des témoins qui avaient déposé contre eux - ce qui était leur droit le plus strict; il ne pouvait y avoir de procédure juridique régulière sans confrontation des inculpés avec les témoins à charge. Mais il est bien évident que le cas était un peu spécial; les juges ne pouvaient donner les noms de leurs informateurs, par crainte de les exposer à la vengeance publique et de décourager ainsi les délations dans l'avenir. Le cardinal-légat ayant refusé de donner aux inculpés les noms de leurs accusateurs, ils le suivirent jusqu'à Montpellier où ils lui présentèrent de nouveau leur requête.
Romain Saint-Ange s'en tira par une ruse: il leur montra la liste de toutes les personnes qui avaient été citées lors de l'enquête, sans dire si elles avaient déjà déposé ni contre qui elles avaient témoigné, demandant aux accusés s'ils pouvaient indiquer dans cette liste les noms de leurs ennemis personnels. Désorientés, et ne sachant si les témoins cités avaient déposé en leur faveur ou contre eux ou même s'ils avaient accusé qui que ce soit, les inculpés n'osèrent récuser personne et s'en remirent à l'indulgence du légat. La ruse de Romain de Saint-Ange devait être, plus tard, largement utilisée par les tribunaux ecclésiastiques.
Ce ne fut pas à Toulouse même, mais à Orange, que le légat examina le procès de ces hérétiques; il tint concile à Orange pour promulguer, dans les États du Languedoc soumis au roi de France, les règlements qu'il avait déjà institués à Toulouse. L'évêque de Toulouse, Foulques, l'avait accompagné, et ce fut lui qui, de retour à Toulouse, se chargea d'imposer aux accusés les pénitences que le légat avait ordonnées. Romain de Saint-Ange quitta le Midi de la France pour retourner à Rome, où le pape n'allait pas tarder à le nommer évêque de Porto.
III - IMPUISSANCE DE L'ÉGLISE ET RÉACTION DOMINICAINE
À ce moment-là, le légat put croire que l'"Église avait enfin trouvé la paix dans ce pays" (G.Pelhisson). Mais son acte d'inquisition, malgré le bûcher du parfait Guillaume et la citation en masse de suspects, ne dut pas faire grande impression sur les Toulousains. L'évêque Foulques, auquel était confiée la tâche de la répression de l'hérésie, était si impopulaire qu'il n'osait pas se déplacer sans escorte armée et avait du mal à percevoir les dîmes qui lui étaient dues. Le comte, cela se comprend assez, ne faisait absolument rien pour défendre les droits de son évêque, et le vieux prélat s'en plaignait amèrement, disant, avec un involontaire cynisme: "Je suis prêt à être de nouveau exilé, puisque je n'ai jamais été mieux qu'en exil154". Foulques, du reste, n'occupera pas longtemps le siège épiscopal de Toulouse; âgé, fatigué, et surtout découragé par l'hostilité invincible que lui témoignent ses diocésains, il se retirera au couvent de Grandselve où il se préparera à la mort en composant des cantiques. Il mourra en 1231.
La répression méthodique de l'hérésie, imposée par le traité de Meaux et solennellement inaugurée par Romain de Saint-Ange, s'avérait pratiquement irréalisable. Les mesures policières prises contre l'hérésie par un pouvoir ecclésiastique moralement isolé du reste du pays n'avaient, semble-t-il, servi qu'à créer chez les hérétiques et leurs partisans un esprit de dissimulation systématique et consciente; les lois nouvelles restaient sans vigueur, parce que toutes les personnes qui avaient affaire, de près ou de loin, à des gens d'Église, protestaient de leur orthodoxie, et qu'en fait la vie du pays échappait au contrôle d'une police ecclésiastique insuffisamment nombreuse et par conséquent peu redoutée.
"Les hérétiques et leurs croyants, dit le Dominicain Guillaume Pelhisson en parlant des années qui suivirent le traité de Meaux, s'armèrent de plus en plus, multipliant leurs efforts et leurs ruses contre l'Église et les catholiques. Ils firent à Toulouse et dans ses alentours plus de mal que pendant la guerre155".
Nous ne connaissons de l'activité des cathares durant cette période que des faits qui ont pu être constatés grâce à des procès, des enquêtes, ou ceux qui étaient de notoriété publique; même de ces derniers une grande partie a dû échapper à des juges qui ne pouvaient être omniscients et que personne ne se souciait de mettre au courant.
Les seigneurs de Niort, héros du long et spectaculaire procès sur lequel nous aurons à revenir, hébergeaient publiquement cinq parfaits dont ils ne voulaient pas se séparer malgré les injonctions de l'archevêque de Narbonne, organisaient des réunions d'hérétiques et accordaient asile à de nombreux suspects; leur mère Esclarmonde était une parfaite connue dans toute la région, et dont l'activité et l'influence étaient si grandes que ses chefs spirituels lui avaient accordé la dispense spéciale de manger de la viande et de mentir (au sujet de sa foi et de ses coreligionnaires) quand elle s'y trouverait forcée.
Chez le châtelain de Roquefort, en 1233, se tint une grande réunion d'hérétiques et de croyants qui étaient venus de tous les pays des alentours pour entendre la prédication de Guillaume Vidal. Fanjeaux restait toujours un centre officiel de l'Église cathare; toute la chevalerie du pays assistait aux réunions présidées par l'évêque Guilhabert de Castres; et la dame de Fanjeaux, Cavaers, avait, en 1229, solennellement convoqué dans son château de Mongradail toute la noblesse de la région pour l'"hérétication" de son neveu, Arnaud de Castelverdun. À Toulouse, la maison d'Alaman de Roaix (de la famille de ces Roaix qui avaient hébergé le comte de Toulouse chassé de son palais par l'évêque) était une véritable "maison d'hérétiques", où l'on recevait les parfaits et parfaites de passage et où se tenaient des réunions. Le château de Cabaret était la résidence du diacre Arnaud Hot; ce château, occupé cependant, en 1229, par les troupes françaises, était déjà deux ans plus tard un lieu de réunion pour les hérétiques de la région. Les parfaits et les diacres cathares parcouraient le pays sans même se cacher, accordaient le consolamentum, prêchaient, bref, exerçaient leur ministère d'une façon à peu près normale. On voit le parfait Vigoros de Baconia visiter ainsi tout le pays toulousain et les pays de l'Ariège; et il ne devait guère se cacher puisque des fidèles, à la nouvelle de son arrivée, accouraient des villes voisines pour entendre ses prédications et ses conseils.
La ferveur religieuse des cathares et de leurs croyants n'avait en aucune façon été ébranlée par les décrets du concile de Toulouse. En revanche, l'exaspération provoquée par la présence de troupes françaises, l'obligation de rendre à l'Église les biens confisqués pendant la guerre, l'obligation, pour le peuple, de payer régulièrement la dîme, l'obligation de rendre aux croisés de Montfort (ou à leurs descendants) les châteaux qu'ils avaient enlevés à leurs propriétaires légitimes - cette exaspération toute naturelle ne cessait de grandir; la paix de Paris, paix de spoliation, imposée au pays sans contrepartie et ne profitant qu'à l'Église, ne pouvait être considérée comme définitive.
La noblesse - surtout celle des vicomtés de Trencavel, - dépouillée et humiliée, et d'ailleurs belliqueuse par vocation et entraînée à la lutte par vingt ans de guerres, ne songeait qu'à comploter en attendant l'occasion de prendre sa revanche. Le pays n'avait déposé les armes que par manque d'argent pour poursuivre la guerre. Le comte, en dépit des engagements qu'il avait pris, ne songeait qu'à freiner les progrès que l'Église et les forces françaises pouvaient faire dans le pays grâce aux facilités que leur avait accordées la paix. Les seigneurs soumis disposaient de leurs terres en maîtres et songeaient d'autant moins à renoncer à leurs droits que leurs serments de fidélité devaient (en principe) les mettre à l'abri des soupçons de l'Église. Les autorités locales - bailes et viguiers des seigneurs - s'opposaient ouvertement aux recherches et aux arrestations des hérétiques, et ne sévissaient pas contre ceux qui prenaient les armes contre les fonctionnaires du roi.
Ainsi le sénéchal André Chauvet (ou Calvet) fut-il assassiné, en 1230, lors d'une battue qu'il avait organisée pour surprendre les hérétiques de La Bessède156; ce meurtre resta impuni et les seigneurs de l'endroit (les sires de Niort) et même le comte de Toulouse furent accusés de cet attentat. Les mêmes sires de Niort - de l'ordinaire de l'archevêque de Narbonne - avaient envahi, en 1233, les armes à la main, les terres de l'archevêché et, non contents d'avoir emprisonné une partie des serviteurs et enlevé le bétail, ils avaient pénétré dans la résidence de l'archevêque, l'avaient blessé, maltraité ses clercs, emporté le pallium (signe de la juridiction métropolitaine) et beaucoup d'objets précieux, et avaient ensuite incendié le pays. L'archevêque (Pierre Amiel) en avait porté plainte au pape, dénonçant lesdits seigneurs comme des hérétiques et des rebelles, et c'était le moins que l'on pouvait dire. Mais s'il pouvait protester auprès du pape, il ne parvenait pas à se faire rendre justice dans son propre diocèse, et cela malgré la présence des autorités françaises dans le pays.
Dans le Toulousain, la réaction de la population contre l'Église était d'autant plus violente qu'elle était soutenue presque ouvertement par le comte. Le Dominicain Roland de Crémone, ayant prêché dans la chaire de l'Université nouvelle contre les hérétiques et ayant accusé les Toulousains d'hérésie, les consuls avaient protesté hautement et demandé au prieur du couvent des Dominicains d'imposer silence au fougueux prédicateur. Le Frère Roland n'en continua pas moins de flétrir la conduite des gens de Toulouse, et provoqua le scandale dans la ville en faisant exhumer et brûler les corps de deux personnes mortes récemment: A. Peyre, donat du chapitre de Saint-Sernin, et Galvanus, ministre vaudois enterré au cimetière de Villeneuve; les deux hommes, bien qu'hérétiques ou du moins suspects d'hérésie, avaient joui d'une grande considération jusque dans les milieux catholiques. Ces actes accomplis "pour la plus grande gloire de Notre-Seigneur Jésus-Christ, du bienheureux Dominique et en l'honneur de notre mère l'Église romaine" (G.Pelhisson), révoltèrent l'opinion publique et amenèrent les consuls à protester de nouveau auprès du prieur des Dominicains et à obtenir le renvoi du Frère Roland. Le même Pelhisson se plaint des chevaliers et des bourgeois de Toulouse qui ne cessaient de multiplier les attentats contre les personnes qui recherchaient les hérétiques. Ces recherches devenaient si dangereuses qu'il fallait aux autorités ecclésiastiques beaucoup de courage pour les continuer malgré tout et pour amener les suspects capturés dans les prisons d'Église où ils pouvaient être interrogés et jugés.
La difficulté n'était pas de découvrir les hérétiques, mais de parvenir à s'emparer de leurs personnes; les tribunaux en étaient le plus souvent réduits à condamner par contumace ou à arrêter des gens très peu suspects et contre lesquels rien de grave ne pouvait être prouvé, comme cette Peyronnelle, de Montauban, âgée de douze ans, élevée dans un couvent de parfaites et réconciliée à l'Église par l'évêque Foulques. Encore mieux: les bourgeois passaient parfois à l'attaque en se servant des arguments mêmes de leurs adversaires. Ainsi un certain P. Peytavi ayant, au cours d'une dispute, traité le fabricant de boucles Bernard de Solaro d'"hérétique" (et avec raison, semble-t-il), ce dernier porta plainte en diffamation. Peytavi fut convoqué devant le conseil de la ville et condamné par les consuls à plusieurs années d'exil, à des dommages-intérêts à Bernard et à une amende. La faute de Peytavi n'était pas d'avoir suspecté l'orthodoxie du fabricant de boucles, mais d'avoir trop ouvertement manifesté ses sentiments catholiques. Il se plaignit d'ailleurs aux Dominicains de Toulouse, en appela à l'évêque, et, devant le tribunal d'Église, soutenu par les Dominicains Pierre Seila et Guillaume Arnaud, il gagna son procès avec éclat et son adversaire dut s'enfuir en Lombardie. À ce sujet, G.Pelhisson écrit: "Bénis soient Dieu et son serviteur Dominique qui a su si bien défendre les siens157!" L'importance accordée par l'Église à une affaire aussi insignifiante (les deux Dominicains qui aidèrent Peytavi n'étaient autres que les deux futurs Inquisiteurs de Toulouse) montre en elle-même combien âpre et infructueuse était la lutte que menaient à ce moment-là les autorités ecclésiastiques contre le pouvoir consulaire. Ils en étaient réduits à louer Dieu parce qu'ils avaient réussi à faire casser un jugement qui donnait raison à un homme suspect d'hérésie, et encore n'avaient-ils pas convaincu les consuls mais seulement leur propre évêque.
Cet évêque, intronisé depuis la mort de Foulques, était Raymond du Fauga - ou de Falgar - de la famille de Miramont, de la région de Toulouse. C'était un Dominicain fanatique et dur, qui, d'après Guillaume de Puylaurens, "débuta comme avait fini son prédécesseur, en poursuivant les hérétiques, en défendant les droits de l'Église, et en poussant le comte, tantôt avec énergie, tantôt avec douceur, à faire le bien158". Cet évêque devait, en effet, posséder beaucoup d'énergie, car il avait réussi à entraîner le comte (dont les catholiques déploraient la "négligence crasse" à persécuter les hérétiques) dans une battue à la tête d'une escorte armée, battue au cours de laquelle fut surprise une réunion nocturne dans un bois près de Castelnaudary. Dix-neuf hérétiques furent pris ainsi et parmi eux Pagan ou Payen de La Bessède, faidit et un des chefs de la noblesse cathare, chevalier réputé pour sa bravoure. Pagan et ses dix-huit compagnons furent aussitôt condamnés à mort et brûlés sur l'ordre du comte. On se demande de quels arguments put se servir l'évêque pour forcer le comte à cet acte de dureté qui était si peu dans son caractère et qui constituait une sorte de trahison à l'égard d'un vassal: les seigneurs faidits avaient toujours été les plus fidèles partisans de Raymond. En tout cas, ayant donné à Raymond du Fauga cette preuve indubitable de sa bonne volonté, le comte dut s'estimer quitte pour quelque temps et ne fit rien pour empêcher seigneurs et consuls de braver presque ouvertement l'autorité de l'Église.
L'agitation qui régnait dans le pays était si grande que le pape lui-même, par peur d'une révolte généralisée, adopta une politique de douceur relative à l'égard du comte de Toulouse: il recommanda, en 1230, au nouveau légat Pierre de Colmieu, de traiter le comte avec douceur "pour favoriser son zèle pour Dieu et pour l'Église". Il accorda au comte un délai pour le paiement des dix mille marcs de dommages-intérêts à l'Église, imposés par le traité de Meaux; il lui permit même, pour les payer, d'imposer des subventions sur les gens d'Église; enfin, il consentit à examiner le procès posthume de Raymond VI, que son fils se désolait de ne pouvoir enterrer en terre chrétienne selon ses dernières volontés (18 septembre 1230). Ce chantage sur la piété filiale de Raymond VII dura encore longtemps, puisque la sépulture chrétienne ne fut jamais accordée aux restes du vieux comte. Mais le pape n'en continuait pas moins à ménager le comte (du moins en apparence) car "il était utile, pour augmenter sa piété, de l'arroser bénignement comme une jeune plante et de le nourrir du lait de l'Église159". Cette attitude indulgente, que la conduite du comte ne justifiait que partiellement, ne s'explique probablement pas par le désir du pape de freiner les ambitions du roi de France, enfant de quinze ans dont sa mère avait déjà quelque mal à faire respecter l'autorité en dépit de son énergie. Dans la personne du comte le pape cherchait à ménager une opinion publique surexcitée et à protéger l'Église dans un pays qui lui était de plus en plus hostile.
Il semble bien que dans les pays qui n'étaient pas soumis à la suzeraineté du comte de Toulouse mais à celle des seigneurs français et des sénéchaux du roi, la situation de l'Église était pire encore, comme le montre la conduite des seigneurs de Niort à l'égard de l'archevêque de Narbonne. En tout cas, cet archevêque, dont la sécurité était si gravement menacée, se décida, en 1233, à intenter lui-même un procès à ses agresseurs, lesquels trouvèrent des défenseurs zélés jusque dans les rangs du clergé local. Encore ne put-il le faire que sur mandement exprès de Grégoire IX, qui désigna comme juges l'évêque de Toulouse, le prévôt de la cathédrale de Toulouse et l'archidiacre de Carcassonne. Pour obtenir la traduction en jugement de ces seigneurs, le prélat dut d'abord consulter le pape à Anagni, où Grégoire IX avait séjourné en 1232, puis se rendre à Rome, et le 8 mars 1233 une bulle papale fut remise à l'évêque de Toulouse, ordonnant de faire "exécuter les sentences portées contre les Niort par le concile de Toulouse".
Les seigneurs de Niort comptaient parmi les plus puissants féodaux du Languedoc, et possédaient des terres dans le Lauraguais, dans le Razès et le pays de Sault. Déjà excommuniés par le concile de Toulouse, ils le furent à nouveau en 1233; hérétiques notoires en dépit de leurs dénégations, ces personnages ne craignaient guère les foudres spirituelles de l'Église; et pour les réduire par la force il fallait l'accord et même le concours du comte de Toulouse, qui ne tenait pas à faire arrêter ses propres vassaux. Le pape dut donc recourir au roi de France (ou plutôt à la régente). Sous la double menace de la colère pontificale et d'une reprise des hostilités avec la France, le comte céda, et réunit un conseil d'évêques et de barons afin de promulguer une ordonnance contre l'hérésie (20 avril 1233). Il prenait les mêmes dispositions qu'avait déjà prises le concile de Toulouse en 1229; ces règlements, jusque-là du domaine de la justice d'Église, faisaient à présent partie du code pénal et relevaient de la justice du comte.
Les seigneurs de Niort (deux d'entre eux du moins, Bernard-Othon et Guillaume) convoqués par Guillaume Arnaud refusèrent de répondre et quittèrent le tribunal; le lendemain le sénéchal G. de Friscamps les arrêta et les jeta en prison. Seules les armes de l'occupant, avec l'accord forcé du comte, pouvaient en fait imposer la volonté de l'Église; et le procès de ces chefs laïques de la résistance cathare n'était possible que grâce à l'intervention d'un sénéchal français.
Le procès fut long et peu concluant. Bernard-Othon et Guillaume de Niort furent accablés par de nombreux témoins, ce qui à Toulouse était plus facile que dans leur pays, où ils étaient si puissants que leur mère Esclarmonde avait pu défier ouvertement et presque mettre à la porte l'archevêque lui-même. Des clercs et des prêtres vinrent déclarer que non seulement Bernard-Othon de Niort entretenait publiquement les hérétiques dans sa maison, mais faisait interdire l'entrée de ses domaines aux personnes qui recherchaient les hérétiques; qu'il avait, une fois, entré dans une église, imposé silence au prêtre pour faire prêcher à sa place un parfait; qu'il avait été complice du meurtre d'André Chauvet, etc. Chose curieuse, il y eut autant de témoignages de l'orthodoxie des Niort et en particulier du même Bernard-Othon, qui semblait avoir largement pratiqué la politique du double jeu; au dire de Guillaume de Solier (lequel, il faut le dire, montrait quelque répugnance à dénoncer ses anciens amis) l'inculpé passait dans les milieux cathares pour un "grand traître" et un homme à la solde du roi de France. Les Frères de Saint-Jean de Jérusalem, de la maison de Pexiora, parlèrent de l'inculpé comme d'un catholique sincère, qui avait même, par son zèle pour la foi, causé la mort de mille hérétiques; et l'archidiacre de Vielmoores, Raymond l'Escrivain, se présenta pour déclarer que Bernard-Othon était le plus fidèle partisan du roi et de l'Église, et que tout ce procès avait été obtenu "plus par haine que par charité".
En dépit de tant de témoignages favorables, Bernard-Othon fut reconnu pour hérétique et condamné à mort pour avoir jusqu'au bout persisté dans son obstination à ne rien avouer; son frère Guillaume et son fils Bernard, qui avaient fini par avouer, furent condamnés à la prison perpétuelle. La sentence de mort ne fut pas exécutée: les barons français établis dans le Midi (à l'exception toutefois de Guy de Lévis, fils du compagnon de Simon de Montfort) s'opposèrent à cette exécution qui, disaient-ils, risquait de provoquer des troubles graves dans le pays. Du reste Bernard-Othon et Guillaume recouvrèrent leur liberté peu de temps après, puisque trois ans plus tard ils étaient jugés de nouveau (Bernard-Othon par contumace). Le troisième des frères Niort, Guiraud, avait eu la prudence de ne pas comparaître à Toulouse, et s'était, au contraire, retranché dans ses terres où, avec sa mère, il continuait à servir avec le même zèle la foi cathare.
Si Bernard-Othon de Niort avait à plusieurs reprises pactisé avec les Français et s'était même battu aux côtés de Simon de Montfort, il n'en resta pas moins, même après sa condamnation, un fidèle serviteur de l'Église cathare. Son attitude équivoque s'explique par la nécessité de tromper l'adversaire, et de pouvoir ainsi plus efficacement aider les siens. Cependant, le jour où, grièvement blessé, il avait demandé le consolamentum, l'évêque Guilhabert de Castres lui avait amèrement reproché "tout ce qu'il avait enlevé à l'Église (cathare)" et exigé de lui une amende de mille deux cents sous melgoriens. L'Église cathare, elle aussi, savait se montrer dure et autoritaire quand il le fallait, et pouvait être aussi crainte par ses fidèles, bien que les châtiments dont elle disposait fussent d'ordre strictement spirituel. Rendue par les persécutions plus souple et plus tolérante sur quelques points de sa doctrine (comme le montre la permission donnée à certains parfaits de manger de la viande et de cacher leurs convictions au cas où les intérêts de leur Église seraient en jeu), elle devait s'être également durcie. Se voyant obligés d'exiger des fidèles des sacrifices plus grands, ne pouvant plus accorder leur confiance à n'importe qui, vivant de dons et de legs que les lois nouvellement établies rendaient illégaux, les parfaits devaient exercer sur leurs croyants une pression morale bien différente, certes, de celle qu'employait l'Église catholique, mais redoutable si l'on songe que pour bon nombre de Languedociens ces hommes étaient les seuls détenteurs de la Vérité, et le consolamentum la seule condition du salut.
Le mécontentement qui régnait dans le Languedoc avait pour cause première les dévastations qui en vingt ans de guerre avaient changé en pays pauvre et dépendant de l'étranger un pays libre et florissant.
Ai! Tolosa et Provensa!
E la terra d'Argensa!
Bezers et Carcassey!
Quo vos vi! quo vos vei!
se lamentait le poète Sicard de Marvejols.
Il est bien vrai que personne n'interdisait les cours d'amour et les réjouissances populaires, que l'on célébrait toujours des mariages et des baptêmes, que les cités commerciales continuaient à attirer, dans la mesure du possible, des clients et des fournisseurs de l'étranger; mais, ruinée, la noblesse n'avait pas plus d'argent pour les fêtes que pour la guerre; la présence dans les villes d'une autorité étrangère et d'une police ecclésiastique beaucoup plus active que par le passé créait un climat de méfiance et de rancune; dans les campagnes ravagées erraient des routiers affamés contre lesquels il devenait difficile de lutter: en forçant le comte et ses vassaux à licencier les mercenaires le traité avait à la fois privé les seigneurs occitans d'un moyen de se défendre et de faire la police sur leurs terres, et lâche dans le pays des bandes armées qui, n'étant plus payées par personne, se payaient elles-mêmes.
Et un peuple qui avait si longtemps lutté dans l'espoir de jours meilleurs, pour se voir imposer une paix qui le laissait non seulement plus pauvre que jamais mais encore soumis à l'étranger, vivait dans un état d'amertume croissante, et rendait responsable de ses malheurs moins encore les Français que l'Église. Le clergé était plus intimement lié à la vie du pays que ne l'étaient les fonctionnaires du roi et les seigneurs qui tenaient les terres de par le droit des conquêtes de Montfort; le clergé était partout, chaque village avait son curé, chaque ville des couvents, des chancelleries, des milices ecclésiastiques, le clergé était dans sa majeure partie composé de Méridionaux, que beaucoup de leurs compatriotes étaient, enclins à considérer comme des traîtres (et dont un certain nombre, du reste, s'opposaient par patriotisme à la politique de l'Église).
Ces hommes qui, d'un pays très appauvri, prétendaient tirer des bénéfices plus grands qu'autrefois, qui vivaient dans la richesse ou du moins dans l'aisance et recouraient aux armes des Français ou aux menaces de sanctions dès qu'on leur refusait le paiement des impôts; ces hommes qui passaient pour les grands profiteurs d'une guerre dans laquelle tant de vies, de forces et d'enthousiasme avaient été gaspillés en vain, s'étaient attiré une telle hostilité que Guillaume Pelhisson avait sans doute tort d'accuser les seuls hérétiques quand il écrivait qu'"ils firent dans Toulouse et ses environs plus de mal que pendant la guerre". Dans tous les cas les efforts du pape pour ménager le comte se révélaient inutiles: dans ce pays, toute politique de tolérance et de modération ne pouvait mener qu'à la ruine de l'Église.
Le pape ne pouvait faire appel à une nouvelle croisade, le Languedoc étant déjà en partie propriété directe du roi de France, en partie héritage futur d'un frère du roi; et la régente ne se souciait pas de recommencer une guerre longue et coûteuse qui eût compromis les accords du traité de Paris: elle se contentait de menacer de temps à autre Raymond VII, qui se hâtait de donner des gages de sa soumission.
Or, ce n'était plus le comte qu'il s'agissait de soumettre, mais un peuple, ou du moins une forte majorité de ce peuple. Quatre ans après le traité de Meaux l'affaire de l'Église en Languedoc semble plus compromise que jamais.
La répression de l'hérésie - et, tout autant que de l'hérésie, de l'anticléricalisme pur et simple - était difficile parce qu'elle n'était pas organisée, qu'elle dépendait de législations différentes, celle de l'ordinaire de l'évêque étant assurée par une force armée insuffisante, celle du comte peu énergique et suspecte de sympathies pour les hérétiques. Même les seigneurs français avaient, semble-t-il, autre chose à faire que d'entretenir d'incessantes guérillas sous prétexte de rechercher les hérétiques.
Lorsque le Pape décida de confier la répression de l'hérésie à une organisation spéciale, et à des hommes dont le métier d'"inquisiteur" serait l'unique fonction, il ne voulait pas simplement adjoindre un auxiliaire de plus à l'évêque, dans le but de décharger ce dernier d'une partie de ses responsabilités. Il est bien vrai que les évêques avaient déjà tant de soucis et d'obligations diverses qu'ils ne pouvaient consacrer leur vie au pourchas des hérétiques; et pourtant Raymond du Fauga, évêque de Toulouse, ainsi que Foulques, son prédécesseur, ou Pierre-Amiel de Narbonne, n'avaient manqué ni de zèle ni d'énergie dans la défense de la foi. L'Inquisition spéciale que Grégoire IX institua par sa lettre circulaire du 20 avril 1233 devait être, dans l'esprit du pape, un instrument de terreur, ou elle n'avait pas de raison d'être.
Le terme d'inquisition n'avait rien de nouveau, et s'appliquait depuis longtemps à la procédure juridique qui consistait à dépister la présence d'hérétiques dans un pays, et à leur faire reconnaître leurs erreurs. Tous les évêques procédaient périodiquement à des Inquisitions, et faisaient interroger et juger les personnes suspectes d'hérésie; les décrets des conciles de Vérone, de Latran, de Toulouse instituaient en quelque sorte des Inquisitions permanentes, puisqu'ils imposaient non seulement aux évêques mais aux pouvoirs civils l'obligation de rechercher et de punir les hérétiques. Pour la première fois, cependant, Grégoire IX prévoyait la création de dignitaires de l'Église dont le seul rôle serait d'exercer l'Inquisition, des hommes qui porteraient le titre officiel d'inquisiteurs, et qui, en tant qu'inquisiteurs, ne relèveraient pas de l'autorité de l'évêque, mais du pape lui-même. C'était, en soi, une mesure révolutionnaire, puisqu'elle mettait - dans l'exercice de ses fonctions, du moins - un simple moine sur un pied d'égalité avec l'évêque, et l'élevait même en quelque sorte au-dessus de ce dernier. Nous allons voir que les prérogatives de l'inquisiteur allaient être telles que l'évêque ne devait pouvoir ni l'excommunier, ni le suspendre, ni même s'opposer à ses décisions à moins d'un ordre formel du pape.
Le pouvoir accordé à ces hauts commissaires du pape allait être pratiquement illimité. Encore fallait-il choisir des hommes capables de justifier une telle confiance. Cette institution nouvelle n'eût sans doute pas été possible si le pape n'avait eu sous la main une milice religieuse toute neuve, farouchement combative et dont il connaissait bien la force et les possibilités.
Saint Dominique - il ne portait pas encore le nom de saint à l'époque mais allait être canonisé incessamment - était mort en 1221, âgé de cinquante et un ans. Il avait exercé son ministère dans le Midi de la France pendant plus de dix ans (de 1205 à 1217), luttant contre l'hérésie par la patience, par la prédication, puis par la violence, rassemblant autour de lui les éléments catholiques du pays; en 1218, il avait obtenu d'Honorius III la reconnaissance officielle de son mouvement de prédication et de pauvreté sous le titre des "Frères de l'ordre des prêcheurs". L'ascendant de sa personnalité et aussi le profond besoin de réforme et de réaction catholique avaient été tels qu'à la mort de Dominique il existait déjà dans toute l'Europe soixante couvents de Frères prêcheurs. À la mort de son successeur Jourdain de Saxe (1237) il en existait trois cents. Ces couvents avaient essaimé non seulement en France, en Italie, en Espagne, mais jusqu'en Pologne, en Grèce, dans les Pays Scandinaves, au Groenland et en Islande.
Les Frères prêcheurs, ou mendiants, constituaient donc bien un grand mouvement de missionnaires, de combattants de la foi catholique. Leur vie, austère jusqu'au dénuement, héroïquement vagabonde, consacrée à une ardente et inlassable prédication, séduisait les hommes jeunes et énergiques avides de se donner au service de Dieu; et leur mission était non seulement de donner l'exemple de la pauvreté volontaire et de la prière, mais encore et surtout de convertir des âmes à Dieu, en combattant soit l'hérésie, soit les religions païennes ou l'Islam.
Né en pleine croisade, parmi les batailles, les massacres et les bûchers, cet ordre ne pouvait être - dans les pays hérétiques du moins - que cruellement fanatique. C'est ce qui ressort en tout cas de la conduite des Dominicains qui vivaient dans le Languedoc et, en particulier, des inquisiteurs; et cependant, avant l'institution officielle de l'Inquisition, il ne semble pas qu'ils aient eu à déplorer des martyrs, et saint Dominique lui-même, parcourant presque seul des régions où les hérétiques étaient les maîtres, n'eut à subir d'autres mauvais traitements que des quolibets et des cailloux lancés sur lui par des paysans. La croisade avait fait renoncer les partisans des hérétiques à cette attitude de tolérance relative dans laquelle leurs ennemis voyaient déjà le comble de l'intolérance; mais le fanatisme religieux des Méridionaux n'était réellement pas meurtrier car, même lors des émeutes populaires les plus violentes, les moines seront parfois frappés et injuriés, rarement tués (sauf quelques cas dont nous aurons à parler plus tard). À côté de leurs adversaires, les Dominicains dont l'histoire nous a transmis les noms apparaissent comme des hommes d'une trempe tout à fait particulière. Il est évident qu'en s'adressant au prieur des Dominicains de la Province (France méridionale), le pape comptait sur ce dernier jour pour choisir des hommes exceptionnellement zélés pour leur foi; cependant, l'évêque Raymond du Fauga, qui devait se signaler par son fanatisme, n'était pas un inquisiteur; mais il était un Dominicain.
Si le pape avait confié à cet ordre la répression de l'hérésie, c'est qu'il savait pouvoir y trouver des hommes plus ou moins capables de tout.
151 Marcel Fournier, Les Statuts et Privilèges des Universités françaises avant 1789, t. I, p. 439.
152 Voir appendice IV.
153 Recueil des historiens des Gaules, t. XXI, p. 599.
154 Guillaume de Puylaurens, ch. XXXX.
155 G.Pelhisson, Chronicon, éd. Douais, p. 84.
156 Guillaume de Puylaurens, ch. XL.
157 G.Pelhisson, op. cit., id., p. 92.
158 Guillaume de Puylaurens, ch. XLXI
159 Lettre au légat Gautier de Tournay, 18 février 1232.
CHAPITRE X
L'INQUISITION
I - DÉBUTS DE L'INQUISITION
Le 27 juillet 1233, Grégoire IX nommait l'archevêque de Vienne, Étienne de Burnin, légat apostolique pour les provinces de Narbonne, Arles, Aix et Vienne et les diocèses de Clermont, Agen, Albi, Rodez, Cahors, Mende, Périgueux, Comminges, Lectoure et Le Puy, avec mission spéciale d'extirper l'hérésie dans la France du Midi, et étendait les pleins pouvoirs de ce légat aux provinces d'Auche de Bordeaux, d'Embrun, de Catalogne et de la Tarraconaise; et c'est par l'intermédiaire de ce légat que furent confirmés, au nom du Saint-Siège, les pouvoirs accordés aux deux Frères désignés par le provincial des Prêcheurs de Toulouse: Pierre Seila et Guillaume Arnaud. Ce furent les premiers inquisiteurs.
Pierre Seila était un riche bourgeois de Toulouse, un des premiers compagnons de saint Dominique; disciple fervent du moine espagnol, il avait donné une de ses maisons pour y abriter la communauté dominicaine naissante. Guillaume Arnaud était originaire de Montpellier et jouissait d'une grande autorité parmi les Dominicains de Toulouse. À ces hommes, pleins pouvoirs étaient donnés pour procéder contre l'hérésie, sans avoir de comptes à rendre à la justice épiscopale ni à la justice civile; et ces pouvoirs s'étendaient à tout le diocèse de Toulouse et à celui d'Albi.
Le premier acte d'inquisition des deux Dominicains fut la capture de Vigoros de Baconia, qui passait pour le chef des hérétiques de Toulouse. Vigoros fut jugé et exécuté presque aussitôt. En privant l'Église cathare d'un de ses chefs les plus énergiques, les nouveaux inquisiteurs inauguraient leur activité par un coup de maître.
Pierre Seila resta à Toulouse et Guillaume Arnaud partit pour une grande tournée inquisitoriale à travers toute la province. Il visita Castelnaudary, Laurac, Saint-Martin-la-Lande, Gaja, Villefranche, La Bessède, Avignonet, Saint-Félix, Fanjeaux, exigeant le concours des autorités ecclésiastiques de ces lieux pour la recherche des hérétiques et la convocation des suspects. Il faut croire qu'il procéda avec une énergie peu commune, car le comte écrivait dans la même année au pape pour se plaindre de ces plénipotentiaires du Saint-Siège, leur reprochant des faits dont il n'avait jamais accusé les juges de l'ordinaire épiscopal: les inquisiteurs, disait-il, s'écartaient de la procédure légale, interrogeaient les témoins à huis clos, refusaient aux inculpés l'assistance des avocats et inspiraient une telle crainte que les personnes qu'ils convoquaient dénonçaient des innocents, tandis que d'autres profitaient du secret dont la déposition des témoins était entourée pour dénoncer comme hérétiques leurs ennemis personnels.
Le comte les accuse également d'intenter des procès à des personnes depuis longtemps réconciliées à l'Église et de châtier comme rebelles ceux qui tentent de faire appel au Saint-Siège. "Si bien, dit-il, qu'ils semblent plutôt travailler pour engager dans l'erreur que pour ramener à la vérité; car ils troublent le pays et par leurs excès excitent les populations contre les couvents et les clercs".
Il semble donc bien qu'à partir de 1233 la répression de l'hérésie dans le Languedoc ait changé d'aspect, et soit devenue beaucoup plus vigoureuse. Et pourtant, les deux Dominicains ne disposaient pas de moyens matériels supérieurs à ceux de l'évêque; plus tard, ils reçurent l'autorisation de se faire accompagner par une escorte armée qui constituait une espèce de garde personnelle et se composait, outre les sergents d'armes, de geôliers, de notaires et aussi d'assesseurs et de conseillers. Ces auxiliaires des inquisiteurs ne devaient jamais être très nombreux et, en 1249, se plaignant de leur nombre excessif, le pape Innocent IV les limite à vingt-quatre en tout par inquisiteur, ce qui fait penser qu'il n'y en avait pas des centaines. Au début, les inquisiteurs ne disposaient même pas d'auxiliaires spéciaux, mais exigeaient le concours des autorités locales, tant ecclésiastiques que laïques.
C'était donc surtout l'énergie hors pair de ces hommes, leur certitude de ne pouvoir être entravés dans l'exercice de leurs fonctions par aucun organisme officiel et les procédés arbitraires et illégaux qu'ils pouvaient se permettre de ce fait, qui faisaient leur force, et il est certain qu'ils réussirent à semer dans le pays une véritable terreur.
Les plaintes du comte montrent que l'activité débordante de ces deux moines provoquait le mécontentement général, ce qui prouve, pour le moins, qu'elle était efficace. Le pape, pour la forme, recommanda à ses inquisiteurs de procéder avec plus de douceur, et écrivit au légat Étienne de Burnin et aux évêques, pour leur demander d'intervenir en cas de besoin pour protéger les innocents, mais il ne semble pas que le zèle des inquisiteurs ait été freiné si peu que ce soit par ces pieux souhaits de Grégoire IX. Bien au contraire, à Toulouse aussi bien que dans le Quercy, l'agitation grandissait sans cesse.
Ainsi, à Toulouse, les inquisiteurs rencontrèrent un adversaire inattendu en la personne d'un certain Jean Tisseyre, habitant du faubourg; cet homme du peuple parcourait les rues de la ville et haranguait la foule en ces termes: "Messieurs, écoutez-moi. Je ne suis pas hérétique: car j'ai une femme et je couche avec elle, j'ai des fils, je mange de la viande, je mens et je jure, et je suis un bon chrétien. Aussi ne croyez pas un mot de ce qu'on dit que je ne crois pas en Dieu. On pourra bien vous le reprocher aussi comme on me le reproche à moi-même, parce que ces maudits veulent supprimer les honnêtes gens et enlever la ville à son maître160". Ces propos subversifs attirèrent, bien entendu, sur Tisseyre, les soupçons des inquisiteurs, qui le firent arrêter et le condamnèrent au bûcher, bien qu'il persistât à se déclarer bon chrétien et catholique. Quand le viguier Durand de Saint-Bars voulut mettre la sentence à exécution, il y eut un soulèvement populaire et la foule manifesta si bruyamment contre les moines et le viguier que le condamné dut être ramené dans sa prison. La colère des bourgeois de Toulouse ne fut pas calmée pour autant, car ils exigeaient la libération de Tisseyre et voulaient détruire la maison des Dominicains qui inculpaient d'hérésie d'honnêtes gens mariés.
Il est propable, en effet, que Tisseyre n'était pas à proprement parler hérétique et que sa conduite était dictée par une indignation parfaitement désintéressée devant les excès de la procédure inquisitoriale. Ce patriote, qui se désolait de voir "ces maudits" chercher à enlever la ville à son maître, sympathisait sans doute avec les hérétiques comme le faisaient beaucoup de gens du peuple, par haine de l'Église. Mais, ce qui est significatif dans l'histoire de ce martyr de la liberté de Toulouse, c'est que, rencontrant dans sa prison plusieurs parfaits qui venaient d'être capturés par G. Denense, baile de Lavaur, il se convertit aussitôt à leur foi et avec tant d'ardeur qu'il se fit accorder par eux le consolamentum et, malgré les adjurations de l'évêque, confessa hautement son adhésion à l'Église cathare et son désir de partager le sort des parfaits. Il fut brûlé avec eux. "Tous ceux qui l'avaient soutenu jusqu'alors, écrit G.Pelhisson, couverts de confusion, le condamnèrent et le maudirent161". Ce qui semble bien montrer qu'on ne le considérait pas comme hérétique.
Si les protecteurs de Tisseyre furent couverts de confusion, les inquisiteurs durent l'être tout autant; la volonté de martyre d'un Jean Tisseyre constituait contre eux une charge tout aussi accablante que l'eût été l'exécution d'un hérétique douteux. S'il n'y eut guère de Toulousains décidés à suivre l'exemple de Tisseyre, son attitude dut raffermir dans la foi cathare beaucoup de sympathisants tièdes ou hésitants, car cet homme qui, de notoriété publique, n'était pas un croyant, avait embrassé cette religion au moment où il savait que sa conversion l'entraînait à une mort certaine. Et il devait être populaire non seulement parmi les hérétiques, mais parmi les catholiques qui, dévoués à leur comte, condamnaient la politique de l'Église plutôt que sa doctrine.
Pendant deux ans, G. Arnaud et P. Seila firent régner à Toulouse et dans le comté une véritable terreur: par peur de poursuites, les gens venaient s'accuser en si grand nombre que les Dominicains ne pouvaient les interroger tous et durent s'adjoindre des Frères mineurs (franciscains) et les curés de la ville. Cela se passait habituellement après un sermon public au cours duquel l'un des inquisiteurs assignait un temps de grâce - de huit à quinze jours - à tous ceux qui viendraient confesser leurs fautes spontanément. Ceux qui omettaient de se présenter étaient poursuivis en justice une fois le délai expiré, arrêtés et mis en prison par les Dominicains avec l'aide du viguier. La plupart du temps, ces dépositions concernaient des faits déjà anciens, mais il est évident que seules les personnes capables de faire arrêter des parfaits ou de compromettre sérieusement des croyants de marque bénéficiaient de l'indulgence plénière des juges.
Beaucoup de ces personnes se virent imposer des pénitences canoniques - port de croix, amendes et pèlerinages; elles échappaient ainsi à la prison, mais restaient toujours sous la menace d'une décision de l'inquisiteur, qui pouvait les convoquer à nouveau et les condamner, les jugements prononcés par l'Inquisition n'étant jamais définitifs (sauf en cas de condamnation à mort, naturellement).
À Toulouse, il y eut ainsi une inquisition générale avec présentations spontanées en masse et arrestations, après le vendredi saint 1235. Un homme (G. Doumenge), ayant négligé de se présenter, fut saisi et menacé de mort, et n'obtint sa liberté qu'en conduisant lui-même l'abbé de Saint-Sernin et le viguier à Cassés, où se trouvaient dix parfaits dont il connaissait la cachette: des dix hommes, trois purent s'échapper, les autres furent pris et condamnés au bûcher.
Dans le Quercy, Pierre Seila et Guillaume Arnaud se rendirent ensemble, firent des procès posthumes à Cahors où ils exhumèrent et brûlèrent un grand nombre de cadavres; à Moissac, l'administration locale devait être très catholique, car là, les inquisiteurs convainquirent d'hérésie et brûlèrent deux cent dix personnes. La terreur que ce bûcher monstrueux provoqua dans le pays fut telle qu'un des accusés ayant réussi à s'échapper, des religieux de Belleperche le cachèrent dans leur couvent sous un habit de moine; plus d'une fois, d'ailleurs, et tous les cas ne sont certainement pas connus, des monastères du pays accordèrent ainsi un asile à des hérétiques, la sévérité des Dominicains n'étant pas approuvée par les autres ordres religieux. Les plaintes incessantes du comte forçaient le pape à éloigner de temps à autre de Toulouse les deux inquisiteurs, qui se rabattaient sur le Quercy; et si, à Moissac, le succès semble avoir été complet (un bûcher de 210 personnes est même un fait unique dans l'histoire de ces années), de Cahors de nombreuses plaintes furent envoyées au pape, toutes dénonçaient l'arbitraire de la procédure des nouveaux juges. Pour calmer les esprits le pape adjoignit aux deux Dominicains un Franciscain, Frère Étienne de Saint-Thibéry, ce qui ne changea du reste rien. De leurs expéditions dans le Quercy, P. Seila et G. Arnaud revenaient à Toulouse, où l'opposition à briser était plus puissante qu'ailleurs, grâce à la présence du comte et au pouvoir considérable des consuls.
Le 4 août 1235, jour de la fête de saint Dominique - le premier qui eût jamais été célébré, le saint ayant été canonisé quelques mois plus tôt - il y eut dans toutes les églises de Toulouse et en particulier dans celle des Dominicains des messes solennelles, célébrant avec la pompe qui convenait la gloire du nouveau saint. Ce jour devait être signalé par un fait tragique dont les Dominicains ne manquèrent pas d'attribuer le mérite à leur saint fondateur. Au moment où l'évêque Raymond du Fauga, après la messe, se lavait les mains pour pénétrer dans le réfectoire, on vint lui annoncer qu'une grande dame avait reçu le consolamentum dans une maison voisine, rue de l'Olme sec. Révolté sans doute par une telle provocation, l'évêque, accompagné du prieur du couvent et de plusieurs moines, se rendit à l'adresse indiquée; la dame était la belle-mère de Peytavi Borsier, croyant notoire et agent de liaison des hérétiques.
La vieille dame, gravement malade, peut-être déjà mourante, devait sans doute avoir la vue troublée ou ne pas bien comprendre ce qui se passait - en tout cas, elle fut victime d'un sinistre malentendu, et quand on lui dit que Monseigneur l'évêque venait la voir, elle crut qu'il s'agissait de l'évêque des cathares. Raymond du Fauga ne fit d'ailleurs rien pour la tirer de son erreur et, tout au contraire, la prolongea par des propos à double sens; et interrogeant la moribonde sur sa foi il parvint à tirer d'elle une confession complète de la doctrine hérétique. Il poussa même la perfidie jusqu'à l'encourager à tenir bon dans sa croyance, car, dit-il, "par crainte de la mort vous ne devez pas en confesser d'autre que celle que vous professez fermement et de tout cœur". Et comme la vieille dame protestait de sa fermeté, disant que ce n'était pas pour ce qui lui restait à vivre qu'elle renoncerait à sa foi, l'évêque lui découvrit sa véritable identité, la déclara hérétique, et la conjura de se convertir à la foi catholique. La mourante, horrifiée sans doute, mais nullement intimidée, "persévéra de plus en plus dans son obstination hérétique". La scène se passait devant de nombreux témoins, dont le narrateur, G.Pelhisson.
Convaincu de l'irrémédiable endurcissement de la femme, l'évêque fit appeler le viguier; et après un jugement sommaire, la vieille dame, incapable de marcher, fut emportée dans son lit jusqu'au Pré-du-Comte, où elle fut déposée sur un bûcher que l'on alluma aussitôt. "Cela fini, dit G.Pelhisson, l'évêque, les religieux et leur suite revinrent au réfectoire, consommer avec joie ce qui leur avait été servi, rendant grâce à Dieu et à saint Dominique162".
Ce récit, qui eût pu passer pour une calomnie inventée par les ennemis de l'Inquisition, ne peut être mis en doute, car le Dominicain G.Pelhisson n'avait aucun intérêt à l'inventer; il est pourtant si étrange qu'il ressemble à une histoire de fou. La dureté des mœurs de l'époque ne l'explique pas, et du reste le principal personnage est un évêque et non un chevalier brigand; le fanatisme même n'explique pas l'acharnement de toute une assemblée de religieux contre une vieille femme impotente, qui, damnée pour damnée, eût peut-être pu mourir en paix, quitte à être brûlée après sa mort. Ce qui surprend davantage encore, c'est la comédie jouée par Raymond du Fauga, en présence du prieur et d'un grand nombre de Dominicains, tous complices volontaires ou involontaires; comédie tout à fait indigne de la majesté épiscopale et qui abaissait un évêque au rang d'un espion. Et cependant, le narrateur félicite plutôt l'évêque de son habileté, et ne ment sans doute pas en parlant de la "joie" des religieux qui reviennent au réfectoire manger leur repas si providentiellement interrompu. Une telle attitude fait penser à celle d'une confrérie militante, de quelque Ku-Klux-Klan légal, mais traqué, persécuté, décidé à vaincre par tous les moyens. Et une partie au moins des Dominicains du Languedoc devait à cette époque ressembler à une telle confrérie. C'était la raison pour laquelle l'office de l'Inquisition avait été confié à eux et non à d'autres; c'était aussi pourquoi les protestations, l'hostilité systématique du comte et des consuls visaient avant tout les Dominicains.
L'exécution de la belle-mère de Peytavi Borsier provoqua dans Toulouse plus de terreur encore que d'indignation; elle fut suivie par un sermon public du prieur des Dominicains, Pons de Saint-Gilles, lequel parla du bûcher où se calcinaient les restes de la pauvre vieille comme du feu que le prophète Élie fit descendre du ciel pour confondre les prêtres de Baal163, et défia solennellement les hérétiques et leurs protecteurs; ensuite il adjura les catholiques "de bannir toute crainte et de rendre témoignage à la vérité". Pendant les sept jours qui suivirent des foules de "catholiques" vinrent en effet rendre témoignage à la vérité, se repentir de leurs fautes passées ou se blanchir en dénonçant des suspects. "Parmi ces foules beaucoup de personnes abjurèrent l'hérésie, d'autres avouèrent qu'elles y étaient retombées et revinrent à l'unité de l'Église; d'autres enfin dénoncèrent des hérétiques et promirent de le faire toujours en temps utile164". Le narrateur, décidément peu optimiste, tout en louant Dieu de l'efficacité des recherches des inquisiteurs, ajoute: "Et ainsi commencées elles se poursuivront jusqu'à la fin du monde165".
Cependant, les exhumations et condamnations posthumes d'hérétiques, de plus en plus nombreuses, continuaient à provoquer des désordres dans la ville; et les consuls et les officiers du comte se servaient de leurs pouvoirs pour favoriser les évasions de beaucoup de personnes condamnées à la prison perpétuelle ou au bûcher. Pour mettre fin à cette opposition presque ouverte des autorités civiles, les inquisiteurs décidèrent de citer en jugement comme hérétiques plusieurs des notables de la ville. C'étaient des croyants notoires, ou même des ecclésiastiques suspects de favoriser l'hérésie; trois d'entre eux - Bernard Séguier, Mauran et Raymond Roger - étaient consuls. Ils refusèrent de comparaître, et demandèrent à Guillaume Arnaud de suspendre sur-le-champ tous les procès d'inquisition ou de quitter la ville. L'inquisiteur n'ayant pas tenu compte de cet avertissement, les consuls se rendirent avec leurs hommes d'armes au couvent des Dominicains, expulsèrent G. Arnaud de Toulouse et lui ordonnèrent de quitter les territoires du comte.
Guillaume se rendit donc à Carcassonne, terre du roi de France, et de là prononça une sentence d'excommunication contre les consuls (5 novembre 1235).
Cependant les Dominicains, pour ne pas avoir l'air de céder à la contrainte, décidèrent de citer en justice les personnes incriminées malgré la défense expresse des consuls qui avaient menacé de mort quiconque oserait remettre les citations à leurs destinataires. Le prieur choisit pour cette mission quatre Frères, qui acceptèrent ce choix comme une promesse de martyre - parmi eux se trouvait justement G.Pelhisson. Leurs adversaires, moins féroces que ces courageux moines ne l'imaginaient, n'attentèrent pas à leur vie; mais, dans la maison de Mauran l'Ancien les religieux furent tout de même roués de coups et traînés par les cheveux166.
Le lendemain, les consuls se présentèrent devant le couvent des Dominicains avec leurs sergents d'armes et accompagnés d'une foule de bourgeois; ils ordonnèrent aux religieux de quitter la ville, et sur leur refus ils les firent saisir et jeter dans la rue. Les Dominicains sortirent de Toulouse en chantant le Symbole de la Foi, le Te Deum et le Salve Regina. Ils furent bientôt obligés de se disperser, les consuls ayant interdit aux citadins de pourvoir à leur subsistance. Le prieur se rendit à Rome pour rendre compte à Grégoire IX de l'attentat dont les Dominicains avaient été victimes, de l'assentiment et même sur l'ordre du comte de Toulouse. L'évêque Raymond du Fauga fut à son tour expulsé de la ville.
Sans doute Raymond VII ne pouvait-il guère espérer voir le pape approuver cet acte de rébellion; cependant, les abus dont les Dominicains de Toulouse s'étaient rendus coupables devaient être si criants qu'il pensait pouvoir justifier sa conduite même devant le pape; en effet, il persistera toujours, tout en affirmant sa fidélité à l'Église, à supplier le pape de ne pas lui imposer la présence des Dominicains, ou tout au moins de ne plus confier à ces derniers l'exercice de l'Inquisition.
Informé de ce qui s'était passé à Toulouse, le pape adressa une lettre des plus sévères à Raymond VII; il y déclare notamment avoir appris que les consuls avaient défendu aux bourgeois de Toulouse de vendre ou de donner quoi que ce soit à l'évêque et même à son clergé, qu'ils ont saisi la maison de l'évêque, blessé des chanoines et des clercs, défendu à l'évêque et aux prêtres de prêcher en public, etc.; que le comte négligeait de payer leurs salaires aux professeurs de la nouvelle Université, ce qui avait amené la cessation des études; que le comte et les consuls avaient défendu à quiconque de comparaître en justice devant les inquisiteurs sous peine de punition corporelle et de confiscation des biens; après l'énumération de tous ces faits et de beaucoup d'autres - faits infiniment plus graves que ceux qui avaient jamais été reprochés à Raymond VI mort excommunié, - le pape menace le comte d'une nouvelle excommunication s'il persiste dans sa politique d'hostilité à l'égard de l'Église167.
Or, Raymond VII tenait à vivre en paix avec l'Église et l'avait déjà prouvé en arrêtant lui-même Pagan de La Bessède et en consentant au procès des Niort. Sa conduite était celle d'un chef d'État qui se voit obligé de satisfaire, fût-ce dans une faible mesure, aux revendications de ses sujets; craignant à la fois la guerre avec la France et l'excommunication, il ne favorisait pas l'hérésie; il cherchait à éviter des désordres et des troubles graves. Et sans doute parvint-il à convaincre partiellement le pape et le roi; car le roi (ou plutôt sa mère) écrivit au pape pour lui faire part des griefs du comte contre les inquisiteurs, et le 3 février 1236 le pape écrivait à l'archevêque de Vienne, légat de la Province, lui donnant des instructions en vue de restreindre les pouvoirs des inquisiteurs, lesquels finirent par reprendre leurs fonctions "du consentement et de la volonté du comte de Toulouse". Mais si le pape leur avait recommandé la douceur, il ne semble pas qu'ils aient tenu compte de cette recommandation, ni que leurs pouvoirs effectifs aient été diminués.
Dès le retour des inquisiteurs à Toulouse les procès recommencèrent, avec plus de violence qu'auparavant. Un grand nombre de personnes furent dénoncées par le parfait Raymond Gros qui était venu se convertir spontanément; ses révélations causèrent beaucoup de procès posthumes, et de nombreux défunts de la haute bourgeoisie et de la noblesse furent exhumés et livrés aux flammes. En septembre 1237 il y eut également une véritable rafle sur les cimetières, et les tombes d'une vingtaine de personnes des plus respectées dans la ville furent violées, leurs ossements ou leurs cadavres décomposés furent traînés par les rues sur des claies, tandis que le crieur public proclamait les noms des défunts et criait: "qui atal fara, atal pendra" (qui ainsi fera, ainsi prendra).
Quant aux vivants, G.Pelhisson en cite une dizaine environ qui furent brûlés, mais les condamnations à mort étaient plus faciles à prononcer qu'à exécuter; plusieurs condamnés appartenaient à des familles nobles ou consulaires, et les inquisiteurs, semble-t-il, n'avaient pas eu la possibilité de s'emparer de leurs personnes, car le viguier et les consuls avaient refusé de les arrêter, ce qui leur valut une nouvelle excommunication. Protégés par les autorités, les hérétiques notoires de Toulouse quittaient le pays, et allaient se réfugier soit dans des cachettes ignorées des inquisiteurs, soit au château de Montségur qui était un lieu de refuge pratiquement inviolable et était devenu le centre officiel de la résistance cathare.
Tout comme à Toulouse, l'Inquisition rencontrait dans les terres soumises au roi de France une résistance parfois sourde, parfois violente, mais obtenait un succès certain par la peur qu'elle inspirait. À ses débuts, en 1233, elle eut deux martyrs, car deux inquisiteurs venus enquêter à Cordes y furent assassinés au cours d'une émeute. Ils ne s'aventurèrent ensuite dans les campagnes qu'avec une escorte armée; mais à Albi, en 1234, l'inquisiteur Arnaud Cathala, ayant décidé d'aller lui-même déterrer une femme morte hérétique (le viguier s'y étant refusé), se vit traîné hors du cimetière, roué de coups et menacé de mort par la foule.
À Narbonne, ville qui avait échappé aux malheurs de la croisade et qui était réputée catholique, l'apparition de l'Inquisition provoqua des troubles; le bourg était, semble-t-il, plus atteint d'hérésie que la cité, et en tout cas hostile aux Dominicains et à l'archevêque. Ici, l'émeute avait pris plutôt un caractère politique, les consuls du bourg accusant l'archevêque et les inquisiteurs de vouloir réduire leurs franchises municipales. Donc, à l'exemple des villes italiennes, Narbonne se divisa en deux clans, la cité et le bourg, la première prenant parti pour l'archevêque et l'inquisiteur Frère Ferrier, le second exigeant leur départ; comme partout ailleurs les Frères prêcheurs, à cause de leur impopularité, eurent particulièrement à souffrir de ces querelles intestines, car leur couvent fut, en 1234, envahi par des bourgeois révoltés, saccagé et pillé. Hardiesse plus grande encore, les consuls du bourg appelèrent à leur aide le comte de Toulouse, et celui-ci y vint en personne pour rétablir la paix (bien que Narbonne fût terre du roi de France), établit dans le bourg un baile dépendant de lui et y installa Olivier de Termes et Guiraud de Niort, puissants seigneurs hérétiques et ennemis déclarés de l'archevêque.
L'affaire se termina par la victoire de la cité, grâce à l'appui de l'autorité royale représentée par le sénéchal J. de Friscamps. Et pour se défendre contre l'hostilité permanente des gens du bourg, les consuls de la cité durent longuement supplier Frère Ferrier de revenir à Narbonne pour y exercer à nouveau son office d'inquisiteur.
Tout en travaillant, selon les dires du comte, "plutôt pour engager dans l'erreur que pour ramener à la vérité", en cinq ans les inquisiteurs réussirent à créer dans le Languedoc un climat de terreur qui leur amena un grand nombre de soumissions volontaires, en général de personnes qui n'avaient fait que manifester leur sympathie pour l'hérésie. À titre d'exemple, on peut constater que P. Seila imposa, à Montauban, 243 pénitences canoniques durant la semaine avant l'Ascension en 1241; 110 pénitences diverses à Moissac la semaine suivante, 220 pénitences à Gourdon la semaine de l'Avent, 80 à Moncuq; toutes les tournées d'inquisition n'étaient pas aussi fructueuses. Beaucoup de registres et de comptes rendus de procès ne nous sont pas parvenus. Les chiffres qui nous sont donnés par les documents existants ne rendent compte que d'une partie des faits, mais il faut également dire que les inquisiteurs ne pratiquaient pas la justice sommaire que la croisade avait rendue possible à Lavaur et à Minerve, et tenaient, au contraire, à enregistrer tous les procès dans les formes. Ils y avaient d'autant plus intérêt que les interrogatoires avaient pour but d'obtenir des noms, et les minutes des procès servaient de pièces à conviction contre des milliers de suspects. Les registres, précieusement gardés, étaient une source d'inquiétude pour une grande partie de la population, car personne ne pouvait être assuré de n'avoir pas été au moins une fois dénoncé comme recéleur ou fauteur d'hérétiques; il suffisait d'avoir salué dans la rue tel ou tel parfait, vingt ans plus tôt; d'avoir pris part à un repas où étaient présents des hérétiques, etc.; il suffisait parfois d'une dénonciation calomnieuse, mais impossible à réfuter car, qui pouvait prouver qu'il n'avait pas, à une époque et en un lieu que l'on se gardait bien de lui préciser, été rencontré (par une personne dont on lui taisait le nom) en compagnie d'un parfait?
L'omniscience des inquisiteurs semble avoir été une des causes principales de la terreur qu'ils inspiraient. Tandis que les évêques s'étaient, pendant des dizaines d'années, révélés impuissants à lutter contre des adversaires qui, dans l'immense majorité, se disaient catholiques et déclaraient ne connaître que des catholiques, les inquisiteurs, comme par miracle, parvinrent à amener des milliers et des milliers de personnes à venir elles-mêmes se déclarer hérétiques (dans le présent ou dans le passé) et raconter qu'elles avaient fréquenté des hérétiques. Or, si certains évêques s'étaient montrés négligents dans la répression de l'hérésie, ceux qui gouvernaient les diocèses du Languedoc, en 1229, ne pouvaient nullement être accusés de tiédeur, et ne manquaient pas de subordonnés et d'hommes de confiance auxquels ils pouvaient confier l'office de l'Inquisition. La justice épiscopale était, depuis toujours, très dure pour les hérétiques. Mais la justice inquisitoriale n'était plus une justice du tout, et c'est ce qui la rendait si redoutable.
Elle démoralisait et déconcertait, et créait dans le pays une atmosphère d'angoisse permanente; et si les parfaits et les croyants les plus fermes savaient ce qu'ils risquaient et pour quoi ils s'exposaient aux dangers, la majorité de la population (fût-elle hérétique) se composait tout de même de gens qui voulaient vivre et qu'une éternelle menace de poursuites arbitraires et imprévisibles affolait ou exaspérait. Un peuple peut se battre pour sa liberté; mais un homme qui se demande sans cesse si le voisin d'en face ne l'a pas dénoncé et s'il ne ferait pas mieux d'aller s'accuser lui-même plutôt que d'attendre une convocation, est désarmé d'avance; car pour se battre, il a besoin d'être soutenu par le voisin d'en face et par les gens du quartier. Il y eut des émeutes populaires; une émeute ne saurait durer longtemps et, si elle ne triomphe pas, elle amène une terreur plus grande encore. De Toulouse, l'autorité des consuls et du comte avait réussi à chasser les Dominicains, la pression extérieure exercée par le roi et le pape les y avait ramenés plus puissants que jamais. Il n'était sans doute pas dans le pouvoir, ni peut-être dans les intentions du pape, de freiner le zèle des inquisiteurs: instrument de terreur, l'Inquisition dominicaine ne pouvait renoncer à sa fonction primordiale, et pendant des siècles encore les papes ne cesseront de soutenir et de défendre les Dominicains contre toutes les attaques des peuples et des autorités civiles.
II - PROCÉDURES DE L'INQUISITION
Avant de voir ce que fut la réaction de l'Église cathare devant ce nouveau danger, il faudrait essayer de comprendre en quoi consistait exactement la procédure inquisitoriale dans le Languedoc, quelle était sa puissance réelle et ce que furent ses répercussions sur la vie du pays.
Le principe d'une répression méthodique de l'hérésie, confiée à un organisme spécial, impliquait bien, dans l'esprit de Grégoire IX, un renouvellement des formes traditionnelles dans lesquelles cette répression s'était jusqu'alors exercée. Les hérétiques, depuis près d'un siècle, luttaient contre la justice ecclésiastique, et une longue habitude les avait rendus habiles à tenir l'adversaire en échec. Les procédés nouveaux, préconisés et encouragés par le pape, sortaient donc de la légalité, ou de ce qui était jusqu'alors communément admis comme légal. Le code de Justinien, en vigueur à l'époque pour la procédure criminelle, prévoyait pour les poursuites en justice une série de mesures susceptibles de garantir les droits de l'accusé. Toute poursuite reposait soit sur l'action d'un accusateur chargé de fournir les preuves du délit, soit sur une dénonciation faite au juge et devant être prouvée par des témoignages, soit sur la notoriété publique et manifeste du délit; et seul, ce dernier cas pouvait permettre au juge de procéder lui-même sans accusation ou dénonciation de la part de particuliers, et encore fallait-il que le fait de la notoriété fût prouvé par des témoins suffisamment nombreux.
Or, en ce qui concerne l'hérésie, les cas de dénonciation et à plus forte raison d'accusation étaient rares; et, après le traité de Paris, les cas de notoriété publique commençaient à l'être également; nous avons vu, dans le procès des seigneurs de Niort, que ces derniers ne manquèrent pas de témoins affirmant leur dévouement à la foi catholique, bien qu'ils fussent des hérétiques déclarés. Or, si de puissants seigneurs, qui protégeaient ouvertement l'hérésie et militaient pour sa cause, parvenaient à passer pour catholiques aux yeux de personnes ecclésiastiques, la masse des simples croyants devait être plus habile encore à dissimuler ses sentiments; et bien des gens pouvaient pratiquer en paix leur religion, quitte à ne pas l'afficher devant des personnes suspectes de sympathie pour les clercs. Dans un pays qui venait de passer par vingt ans de guerre et d'oppression, la force de cet esprit de dissimulation collective devait être assez grande. Une dissimulation qui n'est pas tenue pour de l'hypocrisie, mais pour une légitime réaction de défense, peut aller très loin: ainsi, à Toulouse, A. Peyre, donat du chapitre de Saint-Sernin, professait l'hérésie et fut cependant enterré dans le cloître de l'église.
En fin de compte, seuls étaient hérétiques notoires les parfaits connus pour tels et continuant à exercer leur ministère: ceux-là étaient difficiles à atteindre. Ils étaient des centaines, et les procès des années 1229-1233 ne signalent que quelques cas isolés de captures dues plus ou moins au hasard. La procédure judiciaire devait changer d'aspect pour devenir efficace.
Elle ne pouvait le devenir qu'en s'écartant de la lettre de la loi qui voulait qu'un suspect, pour être traduit en justice, fût dénoncé par une personne de bonne réputation et impartiale, et que l'accusé pût être confronté avec les témoins qui ont déposé contre lui. Or, étaient exclues du droit de témoigner contre un accusé: 1° toutes les personnes qu'il pouvait considérer comme ses "ennemis capitaux", et la définition de cette inimitié capitale embrassait en fait toutes les personnes qui, à une époque quelconque, avaient porté préjudice à l'accusé ou même proféré des injures à son égard; 2° les personnes de sa famille, ses serviteurs et, en général, les personnes dépendant de l'accusé d'une façon quelconque; 3° les excommuniés, les hérétiques, les personnes frappées d'infamie.
Pour des crimes particulièrement graves, dits "crimes exceptés", tels que la haute trahison, la lèse-majesté, le sacrilège et l'hérésie, les consanguins et les serviteurs pouvaient être entendus comme témoins. L'Inquisition étendit ce droit à toutes les autres catégories d'incapables, sauf les ennemis capitaux. Nous avons vu que, pour recevoir le témoignage de Guillaume de Solier contre ses coreligionnaires, le cardinal de Saint-Ange avait dû réconcilier à l'Église et réhabiliter l'ancien parfait. Les inquisiteurs supprimèrent cette formalité (qui les eût forcés à "réconcilier" trop de personnes qu'ils ne souhaitaient nullement traiter en bons catholiques): les témoignages d'hérétiques furent déclarés valables, s'ils tendaient à accuser d'autres hérétiques, sans valeur seulement dans le cas où le témoin était favorable à l'accusé. Les témoignages des personnes frappées d'infamie - voleurs, escrocs, prostituées, etc. - étaient reçus également. Quant aux "ennemis capitaux", étant donné le fait que l'accusé ignorait l'identité des témoins, et que le juge pouvait ignorer les rapports qui existaient entre les témoins et l'accusé, cette restriction n'avait presque plus de sens.
En outre, les accusés ne pouvaient bénéficier du secours d'avocats (bien qu'ils y eussent droit en principe): le seul fait de vouloir défendre un hérétique - ou un homme supposé tel - rendait l'avocat lui-même suspect d'hérésie; ses arguments ne pouvaient être pris en considération et il s'exposait à des ennuis graves; peu d'avocats avaient le courage de se charger de cette tâche aussi ingrate qu'inutile.
Il semble bien que c'est l'audition de témoins à huis clos qui a été la grande invention de l'Inquisition dominicaine (bien que R. de Saint-Ange l'ait déjà plus ou moins pratiquée lors du concile de Toulouse, mais sans l'ériger en système). Elle a été la première et presque la principale cause de la terreur qu'inspiraient les inquisiteurs, et une des grandes raisons de leur succès final. En créant un climat de méfiance et de suspicion dans les communautés les plus unies, ce procédé a été un puissant facteur de désagrégation morale et a fini par rendre impossible une résistance organisée: la résistance ne se manifesta plus guère que là où les pouvoirs publics en prenaient la responsabilité directe. Nous avons vu l'activité des consuls de Toulouse, de ceux du bourg de Narbonne. Nous avons vu les bailes des sires de Niort défendre aux commissions de recherches l'accès de bourgs appartenant à leurs seigneurs; en 1240, les bailes du comte de Toulouse agirent ainsi, par la menace ou la force armée, contre la commission du Frère Ferrier, à Montauriol et à Caraman. Ces faits, plus fréquents sans doute que ne le montre l'examen de documents, étaient malgré tout des exceptions: les officiers et fonctionnaires qui se rendaient coupables de ces actes de rébellion contre l'Église risquaient les peines les plus graves et ne pouvaient agir que sur ordre formel de leurs maîtres; et le comte lui-même, perpétuellement harcelé, menacé, trop faible pour se permettre une attitude de révolte ouverte, n'intervenait que là où l'exécution de ses ordres pouvait, à la rigueur, passer pour une initiative spontanée des pouvoirs locaux.
Les inquisiteurs, eux, n'avaient peur de rien. Si plusieurs payèrent de leur vie leur zèle excessif, leur énergie et leur hautaine assurance en imposaient à une population déjà habituée à voir dans l'Église un terrible danger: les clercs avaient provoqué la croisade et finalement triomphé; même peu nombreux, ils avaient derrière eux la formidable puissance d'une Rome toujours prête à attirer sur le pays de nouvelles calamités.
Quand un inquisiteur, accompagné de notaires, greffiers, geôliers et parfois de quelques hommes d'armes, se présentait dans une ville ou un bourg, il s'installait soit dans le palais épiscopal, soit au couvent des Dominicains s'il y en avait un dans le pays, soit dans tout autre couvent de la ville, et prononçait ensuite un sermon public, flétrissant l'hérésie et proclamant un "temps de grâce", limité en général à une semaine. Ceux qui ne se présentaient pas spontanément durant le temps de grâce risquaient d'être, passé ce délai, poursuivis d'office; les personnes qui se présentaient d'elles-mêmes ne pouvaient encourir de peines graves telles que la confiscation de leurs biens, l'emprisonnement ou la peine de mort; même très compromises elles n'étaient assujetties qu'à des pénitences canoniques.
Donc, même dans une ville où l'hérésie était puissante, un certain nombre de croyants - les plus craintifs, ou ceux qui se savaient des ennemis - accouraient pour s'accuser, avouant parfois des fautes soit imaginaires soit insignifiantes, dans l'espoir peut-être d'en dissimuler de plus graves168.
Les juges, bien entendu, n'avaient que faire de pareils aveux, et pour prouver sa bonne foi le pécheur repentant devait, avant tout, dénoncer des personnes qu'il savait suspectes d'hérésie. On lui promettait le secret sur ses révélations. Il commençait, bien entendu, par accuser ses ennemis ou des gens qu'il ne connaissait presque pas, ou qu'il savait peu compromis. Cependant, la pénitence qui devait lui être imposée était proportionnée non à la gravité de sa faute, mais à la sincérité de son repentir; et cette sincérité se mesurait au nombre et surtout à l'importance des hérétiques dénoncés.
Or, selon toute vraisemblance, les gens qui venaient s'accuser ainsi n'étaient pas des héros; les pénitences canoniques, même sans privation de liberté, pouvaient être dures - nous allons les examiner plus loin - et le secret promis garantissait le suspect interrogé contre des représailles possibles. La lâcheté de beaucoup de convertis spontanés fut le grand et premier auxiliaire de l'Inquisition. Car il suffisait de la dénonciation de deux témoins pour autoriser des poursuites d'office contre un hérétique présumé.
Un grand nombre de personnes furent ainsi dénoncées, quand elles ne l'étaient pas déjà par les autorités locales; durant le temps de grâce, elles avaient encore la ressource de se présenter d'elles-mêmes, ce que beaucoup faisaient, se sachant de toute façon compromises. Ceux qui ne le faisaient pas étaient passibles de poursuites. Ces poursuites consistaient, d'abord, en une citation écrite, remise en mains propres, après réception de laquelle le suspect devait se présenter devant le tribunal. Il était interrogé hors de la présence de témoins, et sans se voir communiquer la nature exacte des charges relevées contre lui. Dans ces conditions l'accusé avouait souvent plus qu'on ne lui en demandait, croyant les juges mieux renseignés qu'ils ne l'étaient. Si les faits reprochés à lui étaient graves, il était mis en prison en attendant le jugement; il l'était presque toujours s'il refusait d'avouer ses fautes; or, le cas était d'autant plus fréquent que l'aveu impliquait l'obligation de compromettre des coreligionnaires, ce à quoi les personnes honorables se refusaient, même quand elles n'étaient pas vraiment hérétiques. S'il n'était pas mis en prison, l'accusé restait, en quelque sorte, en liberté surveillée, sous caution d'une forte somme d'argent, et sans le droit de quitter la ville. Mais une fois en prison il tombait entièrement au pouvoir des juges, et ne pouvait bénéficier d'aucune espèce de garantie ni d'aucun secours du dehors.
L'inquisiteur était, à lui seul, juge, procureur et juge d'instruction. Les autres religieux qui l'assistaient ne pouvaient servir que de témoins, de même que le notaire qui enregistrait les dépositions. Donc, il n'y avait ni délibérations ni conseil, la seule volonté de l'inquisiteur décidait de la culpabilité du prévenu et de la peine qu'il méritait. Les aides de l'inquisiteur, s'ils n'avaient aucun pouvoir, étaient chargés d'obtenir des aveux, la seule personne de l'inquisiteur ne pouvant y suffire. Ceux qui refusaient d'avouer étaient soumis à des interrogatoires serrés au cours desquels il leur arrivait souvent de se trahir; sinon, ils étaient mis en prison, dans des conditions si dures qu'une détention plus ou moins prolongée forçait les plus rebelles à se soumettre. Les cachots où ces suspects récalcitrants étaient enfermés étaient parfois si exigus qu'on ne pouvait s'y tenir ni couché ni debout; sans lumière, telles les prisons de Carcassonne ou du château des Allemans, à Toulouse; aux plus endurcis on mettait des fers aux mains et aux pieds; on les torturait également par la faim et la soif. Il est certain que les personnes qui, plutôt que de parler, acceptaient de subir pendant des mois, parfois pendant des années, un traitement pareil, n'étaient qu'une infime minorité; pour beaucoup la menace seule suffisait.
Cependant, confrontés avec des prévenus susceptibles de fournir des renseignements et assez fermes pour résister aux menaces, les inquisiteurs n'avaient pas toujours le temps de les laisser "pourrir" dans les prisons; à ceux-là, il était permis d'appliquer la torture, procédé légalement admis par la justice civile pour la découverte de crimes graves, mais dont la justice ecclésiastique devait, en principe, s'abstenir. En fait, elle la pratiquait aussi, avec cette réserve qu'il ne devait pas s'ensuivre de mort ou de mutilation, ni d'effusion de sang; l'effusion de sang constituant, pour les clercs, une irrégularité canonique. Depuis les temps les plus anciens, l'Église utilisait, pour châtier les coupables ou obtenir des aveux, la flagellation au moyen de verges ou de courroies; mais ce procédé, savamment utilisé, pouvait être égalé aux tortures les plus cruelles. Du reste, la torture, rendue légale pour l'Inquisition en 1252169, était certainement appliquée bien avant cette date, comme elle l'était par les tribunaux épiscopaux aux XIe et XIIe siècles: il n'y a aucune raison de croire que des juges qui avaient si rapidement semé la terreur dans toute une province se fussent abstenus de moyens de contrainte que les tribunaux réguliers employaient déjà.
Si l'accusé soumis à la torture consentait à parler, il devait réitérer ses aveux hors de la chambre de torture, devant un greffier, et en déclarant que ces aveux étaient volontaires et non obtenus par contrainte; s'il s'y refusait (un seul cas de ce genre est connu, cité par B. Gui dans les "sentences de l'Inquisition de Toulouse"), il devenait plus suspect qu'auparavant, considéré comme relaps et soumis à la torture de nouveau. Si, malgré la torture, il refusait de parler, l'inquisiteur était libre de le mettre à la question le lendemain et autant de fois qu'il serait nécessaire.
Il est vrai que dans la majorité des cas l'"emmurement" (emprisonnement), dans sa forme la plus dure, était considéré comme une torture suffisante. Mais l'on a enregistré des cas - très rares - de parfaits qui, dans leur prison, ont tenté de mettre fin à leurs jours par la grève de la faim; ceci devait leur être reproche comme une preuve de leurs convictions hérétiques et accrédita la légende de leur tolérance à l'égard du suicide.
L'aveu, que l'inquisiteur cherchait à obtenir à tout prix, n'était pas à proprement parler nécessaire pour justifier une condamnation, puisqu'il suffisait, pour prouver qu'un homme est bien hérétique, qu'il ait été dénoncé comme tel par deux témoins; mais dans la pratique les inquisiteurs obtenaient presque toujours les aveux de l'inculpé avant de le condamner. Il faut croire que, malgré les apparences, les témoignages n'étaient pas si faciles à obtenir, du moins au début; les gens qui venaient se confesser accusaient surtout soit des morts, soit des personnes qu'ils savaient hors d'atteinte, ce qui explique les très nombreux procès posthumes et par contumace. Avec les années, les témoignages se firent de plus en plus nombreux, les dénonciations, faisant boule de neigé, livraient aux soupçons des inquisiteurs les voisins, les parents, les amis des suspects, les uns après les autres; et de ceux-là, à leur tour, on exigeait de nouveaux noms, de nouvelles précisions, des révélations de refuges d'hérétiques, etc. Encore la capture des hérétiques proprement dits, des parfaits, n'était-elle jamais facile: G. Doumenge, l'homme qui, pour sauver sa vie, avait, en 1234, fait arrêter sept parfaits à Cassés, fut, peu de temps après, assassiné dans son lit; à Laurac, un sergent qui avait arrêté six parfaites et la mère du chevalier Raymond Barthe fut ensuite pendu par ce chevalier. La capture était dangereuse pour le traître, car seuls des initiés connaissaient les refuges des parfaits. La simple indication de noms touchait surtout des croyants peu actifs, la masse des fidèles de l'Église cathare, et pour ceux-là la vie commençait à devenir intenable.
Ceux qui avaient le courage d'affronter toutes les épreuves menaient une vie clandestine, se réfugiaient dans des asiles imprenables comme Montségur ou Quéribus, ou dans des régions comme le Lauraguais et le comté de Foix où l'hérésie restait assez puissante pour tenir tête à l'Église; capturés, ils devenaient martyrs. Les prisons de Carcassonne, de Toulouse, d'Albi étaient pleines (à Carcassonne il fallut en construire de nouvelles), les condamnations à la réclusion étaient presque toujours des condamnations à perpétuité.
À la différence de ce qui se passait avant 1229, les hérétiques revêtus n'étaient pas seuls à encourir la peine de mort; nous avons vu l'indignation des gens de Toulouse qui, lors de la première condamnation de Jean Tisseyre, avaient voulu empêcher les juges de brûler un homme marié; on n'exécutait plus les seuls parfaits, mais aussi des croyants obstinés, ce qui augmentait la terreur qu'inspiraient les inquisiteurs: tout homme, à présent, pouvait, avec un peu d'imagination, se croire promis au bûcher.
En fait, la grande majorité des suspects n'encouraient que des pénitences canoniques. Or, ces pénitences désorganisaient gravement la vie des personnes qui y étaient condamnées et celle de leurs familles. Ces pénitences étaient les suivantes: 1° le portement de "croix pour hérésie", pénitence inventée ou du moins appliquée pour la première fois par saint Dominique; 2° l'obligation de faire un pèlerinage; 3° l'accomplissement d'une œuvre de charité, comme par exemple l'entretien d'un pauvre pendant plusieurs années ou même toute la vie du pénitent. Ces pénitences n'avaient en elles-mêmes rien d'insolite, et étaient communément utilisées par la justice ecclésiastique. Mais imposées en grand nombre, pour des délits souvent minimes, elles risquaient de devenir un fléau.
Le portement de croix, peine infamante, visait en principe des hérétiques revêtus spontanément convertis (cf. règlements du concile de Toulouse). En fait, les parfaits bénéficiaient rarement d'une punition aussi douce, qui s'appliquait plutôt à des croyants ordinaires; il semble que, dans les premières années de l'Inquisition, cette pénitence n'ait pas été la plias usitée: en effet, le fait d'avoir été hérétique n'était pas une honte, dans un pays où l'hérésie n'inspirait ni haine ni mépris; et si ce châtiment peu sévère était le prix d'une délation grave, il pouvait désigner à l'hostilité des hérétiques des convertis que l'Église avait intérêt à protéger, et même à utiliser comme espions. Plus tard, vers la fin du siècle, ce châtiment devait devenir au contraire très redouté, car il fit des "croisés pour hérésie" de véritables parias, boycottés par leurs concitoyens; aussi devint-il beaucoup plus fréquent.
Les pèlerinages, par contre, de même que les peines pécuniaires, étaient imposés à presque tous les suspects qui s'étaient volontairement présentés au tribunal; ils présentaient l'avantage d'éloigner l'hérétique présumé de son pays pour un temps plus ou moins long; mais on imagine assez les difficultés qui devaient en résulter pour sa famille, pour ses affaires, sans compter le fait que pour des gens sans fortune ces voyages obligatoires entraînaient des dépenses au-dessus de leurs moyens. Beaucoup de pénitents n'étaient ainsi envoyés qu'au Puy ou à Saint-Gilles; mais la plupart devaient se rendre à Saint-Jacques-de-Compostelle ou à Cantorbéry, à Paris ou à Rome; certains, par exemple, au Puy, à Saint-Gilles, à Saint-Jacques-de-Compostelle et à Cantorbéry, ce qui les forçait à traverser les Pyrénées et la Catalogne, revenir en Languedoc, traverser la France, passer la mer, aller à Cantorbéry: un tel pèlerinage, avec le voyage de retour, devait prendre plusieurs mois. Le pénitent était porteur d'une lettre délivrée par le juge et qu'il devait faire viser par les autorités religieuses des lieux de pèlerinage. D'autres pèlerins - en particulier des militaires - étaient envoyés soit en Terre Sainte, soit à Constantinople, où ils devaient servir dans les armées croisées pendant un certain nombre d'années; en général deux ou trois ans, parfois cinq.
En dispersant ainsi sur toutes les routes d'Europe et dans les armées d'outre-mer des milliers et des milliers de croyants, les inquisiteurs se débarrassaient d'un certain nombre d'adversaires possibles; il est facile de voir le préjudice qui pouvait en résulter pour un pays déjà suffisamment appauvri et désorganisé. Encore ces pèlerins forcés devaient-ils s'estimer heureux d'en être quitte à si bon compte. Et cependant, ce genre de pénitences était imposé à des personnes coupables, par exemple, d'avoir adressé la parole à quelques hérétiques au cours d'un voyage en bateau, ou d'avoir, à l'âge de onze ans, adoré un hérétique sur l'ordre de ses parents (ces faits sont cités par B. Gui et sont donc plus tardifs; mais les inquisiteurs de la première heure ne négligeaient aucun fait, si minime soit-il, pour justifier une pénitence; la plupart des suspects ne se voient rien reprocher d'autre que d'avoir écouté des hérétiques ou d'avoir pris part à leurs réunions).
Toute une population - ou du moins une grande partie de la population d'un pays - se voyait ainsi systématiquement traquée, espionnée, harcelée par toutes sortes de mesures de caractère vexatoire. La participation aux sacrements, l'assistance à la messe devenaient elles-mêmes des corvées imposées par une police omnisciente, sous peine de poursuites que l'on savait absolument arbitraires: l'appréciation du délit d'hérésie était à l'entière discrétion de l'inquisiteur, et un homme soupçonné d'une peccadille et refusant de parler était puni plus sévèrement qu'un parfait qui dénonçait spontanément ses frères. Il n'y avait pas là - comme dans le code civil ou criminel - un tarif de peines prévues pour telle ou telle infraction à la loi. Il n'y avait qu'une surenchère à la délation.
D'où l'extrême monotonie des registres de l'Inquisition qui relatent les interrogatoires d'hérétiques: à ces gens on demandait où, quand, chez qui, avec qui ils avaient vu des hérétiques, et pas grand-chose d'autre. Encore La Pratique de Bernard Gui nous apprend-elle que toutes les dépositions des prévenus n'étaient pas bonnes à enregistrer; donc, tout ce qu'ils pouvaient dire pour présenter leur religion ou leurs chefs sous un jour favorable a probablement été escamoté par les greffiers. Du reste, La Pratique de l'inquisiteur nous donne le modèle de l'interrogatoire tel qu'il était pratiqué pour les cathares: "...on demandera au prévenu s'il a vu ou connu quelque part un ou plusieurs hérétiques, les sachant ou les croyant tels de nom ou de réputation; où il les a vus, combien de fois, avec qui et quand";
"item, s'il a eu quelque relation familière avec eux, quand et comment, et qui la leur a ménagée";
"item, s'il a reçu à son domicile un ou plusieurs hérétiques, qui et lesquels; qui les lui avait amenés; combien de temps ils restèrent; qui leur a fait visite; qui les a emmenés; où ils allèrent";
"item, s'il a entendu leur prédication et en quoi elle consistait";
"item, s'il les a adorés, s'il a vu d'autres personnes les adorer ou leur faire révérence à la façon hérétique";
"item, s'il a mangé du pain bénit avec eux et quelle était la manière de bénir ce pain";
"item, s'il a conclu avec eux le pacte convenensa...";
"item, s'il les a salués ou s'il a vu d'autres personnes les saluer à la mode hérétique";
"item, s'il a assisté à l'initiation de l'un d'eux";
"comment celle-ci s'est opérée; quel était le nom du ou des hérétiques; les personnes présentes, l'endroit de la maison où gisait le malade";
"...si l'initié a légué quelque chose aux hérétiques, quoi et combien, et qui a acquitté le legs";
"si l'adoration a été rendue à l'hérétique initiateur";
"si l'initié succomba de cette maladie et où on l'enterra; qui a amené ou ramené le ou les hérétiques";
"item, s'il a cru que la personne initiée à la foi hérétique pouvait être sauvée..." etc. Les autres items portent sur la conversion personnelle du prévenu et sur son passé, sur les autres "croyants" qu'il connaît, sur ses parents, etc170. Les réponses et révélations des croyants interrogés par les premiers inquisiteurs montrent que les juges avaient dès le début pratiqué ce genre d'interrogatoire, et ne cherchaient pas à varier leurs méthodes.
Que ces questions aient été posées à des gens de peu de courage accourant au-devant des juges dès le premier jour du temps de grâce, ou à des malheureux épuisés par des mois de cachot ou par des tortures, les réponses ne varient guère. Des noms. Des lieux. Des dates. "...À Fanjeaux, au consolamentum d'Auger Isam assistaient Bec de Fanjeaux, Guillaume de La Ilhe, Gaillard de Feste, Arnaud de Ovo, Jourdain de Roquefort, Aymeric de Sergent (milites) (déposition de R. de Perrella, 1243), Atho Arnaud de Castelverdun demande le consolamentum dans la maison de sa parente Cavaers à Mongradail, Hugues et Sicart de Durfort allèrent chercher Guillaume Tournier et son compagnon. Les diacres Bernard Coldefi et Arnaud Guiraud résidaient à Montréal et à leurs réunions venaient: Raymond de Sanchas, Rateria femme de Maur de Montréal, Ermengaude de Rebenty, veuve de Pierre, Bérengère de Villacorbier, veuve de Bernard Hugues de Rebenty, Saurina veuve d'Isarn Garin de Montréal et sa sœur Dulcia, Guiraude de Montréal, Poncia Rigaude femme de Rigaud de Montréal... c'était en 1204 171". La déposition relate donc des faits vieux de plus de trente ans. D'ailleurs, mortes ou vivantes, les personnes convaincues d'avoir participé à une cérémonie hérétique, trente, quarante, voire cinquante ans plus tôt, devaient être punies; les morts par l'exhumation et la confiscation des biens de leurs héritiers, les vivants par des peines canoniques ou par la prison.
On comprend la sensation d'écœurement, d'étouffement progressif qui devait envahir le peuple soumis à un régime pareil. D'autres époques devaient connaître, plus tard, le poids de terreurs policières analogues; mais c'est à l'Inquisition dominicaine que revient l'honneur d'avoir inventé le système. La voie était tracée, les imitateurs ne manquèrent pas de la suivre, et de la perfectionner; et il semble même qu'il ne leur restât plus grand-chose à trouver, à part des améliorations d'ordre purement technique.
Mais dans les premières années, la résistance fut âpre, quoique condamnée d'avance à l'échec, à cause de l'appui total que la papauté accorda jusqu'au bout à sa nouvelle arme de combat.
160 G.Pelhisson, op. cit., p. 95.
161 G.Pelhisson, op. cit., p. 98.
162 G.Pelhisson, op. cit., p. 98.
163 Bernard Gui, Libellis de Ordine Praedicatorum, Recueil des Hist. des Gaules, t. XXI, pp. 736-737.
164 G.Pelhisson, op. cit., p. 98
165 Idem.
166 G.Pelhisson, op. cit., p. 98.
167 Registres de Grégoire IX, n° 3187.
168 Tel ce meunier de Belcaire qui était venu s'accuser du méfait suivant: des femmes en visite chez lui ayant souhaité à son moulin la protection de Dieu et de saint Martin, il leur avait répondu que c'était lui et non Dieu qui avait fabriqué le moulin et se chargerait de le faire bien marcher.
169 La bulle Ad exlirpanda, d'Innocent IV, en date du 15 mai 1252.
170 Bernard Gui, op. cit., ch. I. §5.
171 Doat, t. XXII, p. 142; t. XXIII, p. 165.
CHAPITRE XI
LA RÉSISTANCE CATHARE
I - ORGANISATION DE LA RÉSISTANCE
Les cathares désarmaient d'autant moins que la persécution leur fournissait les meilleurs arguments pour leur propagande: une preuve tangible, si l'on peut dire, du caractère diabolique de l'Église qu'ils combattaient.
D'ailleurs, ils ne croyaient pas leur cause perdue: les Églises de Bosnie, de Bulgarie, de Lombardie étaient puissantes et disputaient le terrain à l'Église de Rome, parfois victorieusement, comme c'était le cas des pays slaves. Ces Églises sœurs leur envoyaient des émissaires, des lettres d'encouragement, des secours. En 1243, en pleine bataille de Montségur, l'évêque cathare de Crémone enverra un messager à l'évêque Bertrand Marty pour l'assurer que son Église jouit d'une paix profonde et pour lui demander l'envoi à Crémone de deux parfaits. Ces pays où leur Église jouissait d'une paix profonde (qui n'allait pas toujours durer) pouvaient attirer, comme une Terre promise, beaucoup d'hérétiques et de croyants lassés par les persécutions; beaucoup de cathares, dès les années 1230-1240, émigrèrent en Lombardie.
Les plus courageux, les plus combatifs restaient à leur poste, préférant risquer la mort et ne pas abandonner leurs fidèles. Ils organisaient leur vie clandestine en attendant des jours meilleurs. Si G.Pelhisson constate que les hérétiques faisaient, en ce temps-là, plus de mal que pendant la guerre, c'est que, très probablement, les parfaits étaient sortis de leur attitude sinon passive du moins pacifiste, et encourageaient et absolvaient les actes de violence. Cette religion qui répugnait à l'effusion de sang, et interdisait à ses ministres le meurtre d'un poulet ou d'une souris, avait, elle aussi, trouvé un biais pour justifier la violence: certains êtres étant, non des âmes déchues accomplissant leur pénitence, mais des incarnations directes de la force du mal, ce n'était pas un crime de les supprimer. Les inquisiteurs et leurs complices ne pouvaient manquer d'être rangés au nombre de ces créatures diaboliques. D'ailleurs, les parfaits n'avaient nul besoin de pousser à la violence des gens qui n'y étaient que trop portés. Mais ils pouvaient jouer un rôle politique, et user de leur influence sur les seigneurs croyants pour les engager à la lutte, en leur faisant valoir l'avantage spirituel qu'ils en retireraient.
C'est à cette époque que fut institué par eux le pacte de la convenensa, qui ne semble pas avoir été pratiqué avant: lié par ce pacte, le croyant pouvait recevoir le consolamentum in extremis, même si, par des blessures ou pour quelque autre cause, il se trouvait privé de l'usage de la parole. (Plus tard, cette coutume devait se généraliser, pour des raisons assez évidentes: ne pouvant consentir à administrer le sacrement à des inconnus, par peur de tomber dans un piège, les parfaits trouvèrent ce moyen de dénombrer leurs fidèles; l'homme lié par la convenensa imposait, par ce fait même, aux parfaits l'obligation morale de le consoler à son lit de mort, si du moins il y avait possibilité matérielle).
La vie des cathares, en devenant clandestine, gagnait en intensité et en ferveur: les croyants tièdes, ou ceux qui, déjà (comme c'était le cas avant 1209, et même après la reconquête du pays par le comte), devenaient hérétiques par intérêt ou par respect des convenances, étaient peu à peu éliminés de la communauté. Les auditeurs des réunions hérétiques n'en étaient pas moins nombreux, puisque leurs rangs étaient grossis par tous ceux qui, mécontents du régime nouveau, trouvaient dans les Églises hérétiques les seules véritables organisations de résistance. En cette période, l'action des vaudois était devenue plus puissante que pendant la croisade; les deux Églises autrefois rivales faisaient front commun, et les registres citent de nombreux parfaits vaudois prêchant dans le Languedoc, surtout dans la région de l'Ariège.
L'apostolat de ces hommes était difficile; ils l'exerçaient avec constance, car ce n'était pas la crainte du danger qui les forçait à vivre dans des huttes de charbonniers, des cabanes de branchages au fond des forêts, des métairies abandonnées - à Montségur, à Quéribus, voire en Lombardie, ils eussent joui d'une sécurité plus grande que dans ces abris précaires. Ils menaient une vie vagabonde et traquée afin de pouvoir continuer leur activité et être proches de ce peuple qui leur restait fidèle ou qu'ils espéraient reconvertir à leur foi.
Arrivés dans les environs d'un village ou d'un bourg, le parfait et son socius commençaient par se trouver un abri sûr: parfois dans la maison d'un croyant, lorsque la localité n'était pas étroitement surveillée par l'autorité ecclésiastique (et ces pays étaient nombreux; à commencer par les châteaux des seigneurs de Niort ou d'autres féodaux moins puissants tels Lanta Jourda, le sire de Calhavel, la plus grande partie de la noblesse de Fanjeaux, de Laurac, de Miramont, etc.; et c'étaient parfois les bailes du comte qui désignaient eux-mêmes aux parfaits les maisons "sûres" où ils pouvaient être reçus. Des bourgs comme Sorèze, Avignonet, Saint-Félix avaient des curés sinon hérétiques du moins sympathisants). Le plus souvent les prédicateurs errants s'arrêtaient dans quelque retraite située en dehors de la ville, tant pour ne pas courir le risque d'être reconnus que pour ne pas compromettre les personnes qui leur offraient l'hospitalité. Leur présence n'était révélée qu'à des croyants dont on pouvait être sûr, et les cathares entretenaient un vaste réseau d'agents secrets qui servaient de messagers et de guides. Si le pays était sous la surveillance d'un curé ou d'un baile notoirement catholique, les croyants étaient obligés d'user de prétextes divers pour s'éloigner de la ville; les pauvres allaient ramasser du bois mort, les femmes cueillir des champignons ou des baies; les nobles allaient à la chasse; et encore ne fallait-il pas qu'il y eût un exode par trop massif de paroissiens, et ces expéditions ne pouvaient s'effectuer que par petits groupes ou à plusieurs jours de distance.
C'était, en général, sur des clairières en pleine forêt que les parfaits réunissaient leurs auditeurs; à proximité des bourgs, c'était la nuit que ces réunions avaient lieu; les bourgeois profitaient de l'obscurité pour sortir de la ville sans être vus. Plusieurs de ces réunions furent surprises par des battues d'hommes d'armes, ou au moyen d'espions (exploratores) payés par les inquisiteurs. La plus importante de ces battues fut celle où le comte de Toulouse fit arrêter Pagan de La Bessède et dix-huit hérétiques; la plupart du temps ceux qui recherchaient ainsi les hérétiques ne disposaient pas de forces importantes, et risquaient leur vie en s'aventurant dans une forêt où les croyants, parmi lesquels se trouvaient souvent des militaires, montaient la garde pendant les prédications et les cérémonies célébrées en plein air; surpris au milieu d'une réunion, les hérétiques parvenaient le plus souvent à s'enfuir: ainsi le dominicain Raoul venu avec une escorte pour arrêter les hérétiques sur les indications d'une espionne, dans un bois près de Fanjeaux, ne parvint à en prendre qu'un seul; en 1234, le curé Pierre, cherchant les hérétiques, tomba dans un guet-apens tendu par le baile du pays; il réussit à s'échapper mais son compagnon fut tué. En 1237, deux parfaites furent capturées et brûlées à Montgradail, deux à Saint-Martin-la-Lande, deux à Villeneuve près de Montréal. Les femmes, soit plus actives que les hommes, soit plus imprudentes parce qu'elles se sentaient moins menacées, se faisaient, semble-t-il, prendre plus souvent. Une fois, l'abbé de Sorèze avait envoyé un agent (nuncius) pour arrêter deux parfaites qui séjournaient dans le bourg; les femmes du pays s'opposèrent à cette arrestation en attaquant l'agent de l'abbé à coups de bâton et de pierres; et lorsque l'abbé vint leur reprocher leur conduite, elles tournèrent en ridicule le nuncius en déclarant qu'il avait pris pour des hérétiques deux braves femmes mariées. Mais les parfaites surprises seules au milieu des bois ou dans un bourg où la population était moins résolue ou moins hostile aux catholiques passaient, semble-t-il, assez rapidement de la prison au bûcher; il faut croire que les inquisiteurs savaient d'avance qu'il n'y avait rien à tirer d'elles.
Jean Guiraud rapporte, dans son ouvrage sur l'Inquisition, l'histoire de Guillelme de La Mothe qui, elle, raconta au moins une partie de ses tribulations avant d'être brûlée: avec sa compagne, elle demeura, après 1230, dans le bois d'un certain Pierre Belloc, puis dans un autre bois, le Bosc-Blanc, pendant trois semaines; puis des croyants vinrent les conduire dans la forêt de Salabose, puis dans celle d'Avellanet où elles vécurent un an; puis, passant de forêt en forêt, dans la région de Lanta, elles finirent par être conduites par le parfait G. Roger dans le bois de la Garrigue, puis vécurent quelques mois chez des croyants: chez un certain Pons Rivière, neuf mois entiers; puis, en 1240, elles ne firent que passer dans des maisons où on les recevait quelques jours par-ci quelques jours par-là; puis dans une cabane de forêt à nouveau; transférées ainsi de bois en métairie, de bourg en forêt, par des croyants qui cherchaient à les mettre en sûreté, par des parfaits qui leur donnaient de nouvelles instructions, elles finirent par être prises dans une forêt du Lantarès à Gratiafides. Guillelme de La Mothe ne raconta tout cela qu'après un an de prison. Toutes les personnes nommées par elle devenaient de ce fait receptatores haereticorum, et passibles du jugement et de la prison. Cette femme et sa compagne avaient vécu cette vie dangereuse pour servir la cause de leur Église; et ce n'était pas pour obtenir l'indulgence des juges que Guillelme parla, puisqu'elle fut brûlée172.
Si grands que fussent la confiance et le dévouement des croyants pour les parfaits, ils savaient que les plus courageux pouvaient être amenés, par des tortures, à les trahir. C'est pourquoi, dans les régions les moins sûres - et jusque dans les environs de Toulouse - les hérétiques se construisaient des cabanes dans les bois, où leur présence était en général connue des fidèles et où l'on pouvait venir les chercher s'il s'agissait de consoler un mourant ou de prendre part à quelque cérémonie du culte.
Ne pouvant se ravitailler eux-mêmes, les parfaits vivaient de la charité des croyants; charité bien organisée et largement suffisante, si l'on en croit les témoignages des personnes qui ont reconnu avoir porté à des hérétiques des vivres, des vêtements, de l'argent. Pain, farine, miel, légumes, raisin, figues, noix, pommes, noisettes, fraises... poissons frais ou même en pâté ou en ragoût, vin, pains, fouaces, plats modestes ou même délicats préparés par des femmes du peuple qui pouvaient se rendre en forêt ou y envoyer leurs enfants sans éveiller de soupçons; des croyants plus riches fournissaient aux refuges hérétiques des setiers de blé, des boisseaux de vin - et du meilleur vin de leur cave.
Des femmes faisaient des collectes pour ramasser de la laine avec laquelle les ermites forcés tissaient eux-mêmes leurs vêtements ou des vêtements pour des frères plus pauvres; les marchands de tissus donnaient des étoffes, d'autres des vêtements tout faits, des gants, des bonnets; d'autres donnaient des plats, des carafes, des rasoirs, etc. Tous ces dons ont été connus parce que leurs auteurs ont eu à en répondre devant la justice.
Parfois, tant pour gagner leur vie que pour dissimuler leur ministère, les parfaits exerçaient des métiers; on signale des parfaits cordonniers ou boulangers, des parfaites employées à filer la laine ou à tenir la maison de croyants fortunés. Les parfaits vaudois, en particulier, tenaient à vivre de leur travail et on en cite qui furent tonneliers, coiffeurs, bourreliers, maçons. Les hérétiques, après 1229, exercèrent moins souvent le métier de tisserand, cette corporation étant particulièrement suspecte d'hérésie; mais certains restèrent tisserands même au temps de l'Inquisition.
Beaucoup de parfaits cathares et vaudois jouissaient d'une haute réputation comme médecins et pouvaient, à ce titre, rendre service aux croyants qui les aidaient et les accueillaient; leurs adversaires n'ont pas manqué d'insinuer que c'était là un bon moyen de capter la confiance des gens et d'obtenir des legs pour leur Église en cas de maladie mortelle. C'était, en effet, un moyen comme un autre. Pour mieux gagner cette confiance, beaucoup d'entre eux, surtout les vaudois, n'acceptaient pas d'argent et fournissaient eux-mêmes les remèdes. Le vaudois P. de Vallibus, le cathare Guillaume d'Ayros allaient de village en village, de château en château, aussi occupés à soigner les malades qu'à prêcher. Il semble qu'il y ait eu là plus qu'une tactique de propagande, de véritables vocations de médecins, bien naturelles chez des hommes qui consacraient leur vie à la pratique de la charité. L'exercice de la médecine leur était, bien entendu, interdit, et ils se rendaient suspects par le seul fait de s'obstiner à soigner les malades.
Raynier Sacchoni, dans sa Somme (écrite en 1250), reproche aux cathares leur amour de l'argent et ajoute honnêtement que les persécutions dont ils étaient victimes leur créaient l'obligation de disposer de sommes importantes. Ne pouvant posséder ni terres, ni maisons, ni entreprises de commerce, et réduite peu à peu à l'illégalité totale, l'Église cathare ne pouvait continuer à exercer son activité que grâce à des dons en argent; elle en avait besoin moins pour l'entretien de ses ministres (qui, grands jeûneurs, dépensaient peu pour eux-mêmes) que pour l'achat et la diffusion de leurs livres sacrés et de leur littérature apologétique ou polémique; pour l'organisation des services de liaison, des réunions, dont le succès dépendait souvent du silence de quelque fonctionnaire intéressé; pour les déplacements, les voyages, les secours aux croyants nécessiteux. Partout et toujours, l'argent était un puissant moyen d'action, surtout pour des gens dont la tête était mise à prix. Ainsi, en 1237, le baile de Fanjeaux arrêta l'évêque Bertrand Marty lui-même avec trois parfaits, et les laissa repartir contre la somme de trois cents sous toisas que des croyants ramassèrent aussitôt sur place au moyen d'une quête. Pour un cas de corruption connu, des dizaines ont dû rester secrets; et des hommes, sans cesse à la merci du premier misérable qui leur ferait le chantage à la dénonciation, ne devaient guère éprouver de scrupules à acheter leur vie à prix d'or.
Les parfaits étaient riches et réputés pour tels. Ils payaient généreusement les services qu'on leur rendait. Ne pouvant porter de fortes sommes sur eux (c'était fort difficile à l'époque où les billets de banque n'existaient pas), ils en confiaient la garde à des personnes sûres, lesquelles, à leur tour, les enterraient dans des cachettes connues d'elles seules; et ces trésors devaient être mis à la disposition de l'Église cathare en cas de besoin urgent. Les sommes importantes que les cathares possédaient dans toutes les régions où ils exerçaient leur ministère provenaient d'abord de legs que les croyants consolés leur faisaient à leur lit de mort; pour les croyants riches, ces legs étaient pour ainsi dire obligatoires, et même les personnes de petite condition léguaient leurs vêtements, leur lit ou divers objets mobiliers. Une autre source de revenus était fournie par des collectes faites pour l'Église par des hommes de confiance, collectes qui recueillaient des dons en argent et en nature.
La vie clandestine des cathares semble avoir été bien organisée à l'époque des premières années de l'Inquisition: les registres des inquisiteurs font état de diverses catégories de croyants fauteurs d'hérétiques: les receptatores, délit le plus commun - ceux qui accordaient l'hospitalité aux parfaits; les nuncii, agents de liaison, guides ou messagers; les quaestores ou collecteurs de fonds; les depositarii ou dépositaires chargés de la garde des trésors. Toutes ces fonctions n'étaient évidemment pas rigoureusement délimitées, et les noms donnés à ces croyants servaient plutôt à qualifier la nature du délit, aucun croyant, et pour cause, ne se parait du titre de quaestor ou nuncius haereticorum. L'organisation n'en existait pas moins en fait, et plus la persécution devenait serrée, plus les liens qui unissaient les cathares et leurs fidèles devenaient rigoureux; le danger, qui rebutait les plus faibles, devenait un stimulant pour les natures généreuses; et même ceux dont la foi était médiocre devaient hésiter quand ils n'avaient plus d'autre alternative que le choix entre la fidélité et la trahison, et préféraient s'exposer aux dangers de poursuites plutôt que de trahir.
II - LE SANCTUAIRE DE MONTSÉGUR
Les cathares possédaient la forteresse de Montségur qui, au vu et au su de tous, était le centre officiel de l'Église cathare du Languedoc. Des chevaliers, accompagnés de leurs familles, y venaient en pèlerinage, des hommes du peuple s'y rendaient en secret, séparément ou par groupes, pour pouvoir assister librement au culte de leur Église, recevoir les bénédictions des bons hommes, leur demander des conseils ou des instructions sur la lutte à mener contre l'ennemi.
Ce château, situé sur les terres qui appartenaient à Guy de Lévis, maréchal de la foi et nouveau suzerain du Mirepoix, avait fait, semble-t-il, partie de l'héritage d'Esclarmonde, sœur de Raymond-Roger de Foix, et était tenu par Raymond de Perella, vassal des comtes de Foix; à ce puissant seigneur, personne ne contestait son domaine, parce que Montségur passait pour un nid d'aigle impossible à prendre d'assaut et était situé en pleine montagne, loin des grandes routes, dans un pays notoirement dévoué à l'hérésie; ni les croisés ni les troupes du roi n'avaient jugé utile de prendre cette forteresse d'un médiocre intérêt stratégique et dont le siège eût présenté d'immenses difficultés173.
Située sur le versant nord des Pyrénées, perdue au milieu de sommets de moyenne altitude (2000 à 3000 m) dominant, de trois côtés, des vallées profondes, la montagne ou pic de Montségur (1207 m) est un immense rocher arrondi, en forme de pain de sucre, et auquel on ne peut accéder que par son versant ouest, qui lui-même descend vers la vallée en pente fort raide et découverte. Le château construit au sommet, très petit, ne pouvait abriter de défenseurs nombreux, à plus forte raison servir d'habitation en temps de paix à une grande communauté. Les hérétiques qui se réfugiaient à Montségur logeaient dans le village situé au pied de la montagne et dans de nombreuses cabanes construites sur le versant ouest et dans le rocher; depuis le passage de Guy de Montfort aucune armée ennemie n'avait pénétré dans ces terres peu hospitalières et bien gardées, et autour de Montségur s'était formée, après la croisade, une véritable colonie cathare, si importante que des marchands des villes voisines y affluaient, toujours sûrs d'y trouver de la clientèle: le bourg perdu était en train de devenir un marché comme tout lieu de pèlerinage, car c'était bien ce qu'était Montségur.
En 1204, le château, considéré depuis longtemps par les cathares comme un lieu particulièrement propice à leur culte, tombait en ruines; et les parfaits demandèrent à son seigneur, R. de Perella, de le remettre en état et de le fortifier, ce qui fut fait, bien qu'à cette époque les cathares n'eussent pas un besoin urgent de se défendre. Cette demande prouve en elle-même que Montségur représentait pour les hérétiques autre chose qu'un éventuel refuge contre leurs ennemis. Dès le début du siècle, les évêques cathares et, en particulier, Guilhabert de Castres, venaient y prêcher; Esclarmonde de Foix, dont les droits sur Montségur semblent assez imprécis et dont la personnalité reste mystérieure, devait jouir d'une grande influence dans le pays, puisque Foulques lui rend un hommage indirect en déclarant qu'"avec sa mauvaise doctrine, elle a fait nombre de conversions174". Que cette grande dame, devenue parfaite en 1206, ait contribué ou non à rehausser le prestige de Montségur, c'est du début du XIIIe siècle que date l'intérêt tout particulier des cathares pour ce château. En 1232, Raymond de Perella en est le seul seigneur, et c'est à lui que Guilhabert de Castres demande la permission de faire de cette place le refuge officiel de l'Église cathare.
À cette époque, G. de Castres était le maître spirituel incontesté de la région et faisait à Montségur des séjours fréquents. Il n'y restait d'ailleurs pas longtemps et continuait à mener la vie vagabonde des ministres cathares. Mais des parfaites dont les couvents - autrefois lieux de retraite pour nobles veuves et maisons d'éducation pour jeunes filles pieuses - avaient été dispersés par la tourmente, se réfugièrent en grand nombre dans les environs de Montségur et se construisirent des cabanes sur la muraille de rocher; les parfaits, qui menaient une vie contemplative ou instruisaient dans la foi des candidats à l'apostolat, se voyaient également forcés de se chercher un refuge où ils pouvaient se consacrer à une vie de prière et d'étude. Au pied des murs du château s'édifia, peu à peu, un village de cabanes à moitié creusées dans le roc, à moitié suspendues dans les airs au-dessus des précipices; abri inaccessible et inconfortable qui ne devait pas répugner au tempérament ascétique de ces chercheurs de Dieu.
Autour de ce village collé en nids d'hirondelle contre la haute muraille du château était édifiée une solide palissade de pieux: étant donné la situation du château, les fortifications les plus primitives pouvaient suffire pour repousser n'importe quel assaillant. Mais il est évident que, sur un tel espace et dans de telles conditions, seuls pouvaient vivre des gens prêts d'avance à tous les sacrifices.
De nombreux parfaits et croyants demeuraient au village en bas de la montagne; c'était un lieu de passage, où les visiteurs de toutes conditions, de tout âge venaient faire des séjours plus ou moins longs, pour monter au château, assister au culte, vénérer les parfaits et repartir ensuite reprendre une vie de bons catholiques. Et par la force des choses, Montségur devenait en quelque sorte le quartier général de la résistance cathare et même de la résistance tout court: la classe de la population la plus dévouée à l'hérésie était justement celle qui était la plus indiquée pour l'organisation d'une révolte.
Décimée, ruinée, exilée, la noblesse du Languedoc était encore forte en 1240; la plupart des vassaux du comte de Toulouse, ceux du comte de Foix et une partie des anciens vassaux des Trencavel avaient gardé leurs domaines; ils n'avaient pactisé avec l'autorité occupante qu'à contrecœur et n'aspiraient qu'à être maîtres sur leurs terres; et l'Inquisition était pour eux une source de vexations sans nombre. Si le comte de Toulouse était assez puissant pour s'en plaindre ouvertement, ses vassaux se contentaient le plus souvent d'une opposition sourde mais systématique. Les plus forts, tels les frères de Niort, pouvaient au début se permettre de faire une guerre ouverte à l'Église; d'autres, sans aller jusqu'à envahir le palais de l'archevêque, s'attaquaient aux couvents et aux églises, ce qui était de bonne tradition féodale. Le comte de Toulouse, pour des raisons politiques, ne pouvait permettre à ses vassaux des actes de violence par trop notoires; mais sur les territoires du comte de Foix, les seigneurs étaient toujours plus ou moins maîtres chez eux. C'est dans les Pyrénées, à présent, que s'organisait la résistance armée de la noblesse occitane.
À cheval sur les Pyrénées, les domaines du comte de Foix comprenaient, en Languedoc, la vallée de l'Ariège et les pays environnants; en Espagne, le vicomté de Castelbon que Roger-Bernard possédait par son mariage avec l'héritière de cette terre; par liens d'hommage et de parenté, la noblesse du versant espagnol des Pyrénées était étroitement apparentée à celle du Languedoc méridional; une profonde similitude de race, de langue, de traditions unissait les pays situés des deux côtés des Pyrénées, et si le Roussillon est resté catalan jusqu'à nos jours, au moyen âge le Carcassès, le pays de l'Ariège, le Comminges étaient plus proches de la Catalogne et de l'Aragon que de la Provence ou de l'Aquitaine. Aussi, pendant la croisade, une bonne partie de la noblesse montagnarde du Languedoc avait-elle passé les monts et trouvé un refuge naturel auprès de la noblesse de Cerdagne et de Catalogne. Nous avons vu que Pierre II d'Aragon avait considéré l'attaque des comtés de Foix et de Comminges comme une offense personnelle et que, pour sa chevalerie, la défense du Languedoc avait été un acte de patriotisme. Dépossédés, expulsés de leurs terres, les faidits formaient en Espagne un parti puissant, malgré les sentiments catholiques du jeune roi Jacques I. Raymond Trencavel vivait à la cour du roi d'Aragon, entouré de ses vassaux et de ses amis, et préparait activement sa revanche.
Chassé de Carcassonne par les troupes de Louis VIII, en 1226, après avoir tenu le pays pendant deux ans, ce jeune homme175 bénéficiait du prestige de son père dont le courage et la fin tragique vivaient toujours dans la mémoire des Occitans. Pour tous les pays jadis soumis à la domination des Trencavel, il était le seigneur légitime dont on espérait le retour avec d'autant plus d'ardeur que la situation créée par la paix de Paris provoquait un mécontentement qui croissait avec les années.
Raymond Trencavel n'avait pas à compter sur le secours du roi d'Aragon. Ni le comte de Toulouse ni le comte de Foix ne pouvaient se risquer à soutenir ouvertement un seigneur qui élevait des prétentions sur des terres appartenant à la couronne de France. Il pouvait compter sur l'appui total des faidits - chevaliers sans terres qui n'avaient que leurs bras et leurs armes - et sur l'appui secret des seigneurs soumis au roi et prêts à se révolter à la première occasion.
Olivier de Termes, dans les Corbières, possédait plusieurs châteaux forts qui ne s'étaient pas soumis à l'autorité royale et qui pouvaient servir de dépôts d'armes et de lieux de rassemblement. Et c'est dans les montagnes des Corbières, du pays de Sault, de la Cerdagne, que se préparait le soulèvement de ces seigneurs indigènes qui, n'ayant plus à compter sur les princes qu'en cas de succès, réduits à leurs propres forces, se raccrochaient avec d'autant plus d'ardeur à la foi cathare, qui était déjà, pour la majorité d'entre eux, la foi de leurs pères et, surtout, le symbole de leur liberté.
En 1216, ils s'étaient battus pour le comte de Toulouse; à présent, Raymond VII, signataire du traité de Meaux, harcelé par le roi et le Pape, toujours en quête de nouvelles alliances, toujours en équilibre sur la corde raide, était un appui beaucoup trop incertain; s'il était encore le seul homme capable de réunir toutes les résistances autour de sa personne et de soulever le pays tout entier, on ne pouvait se battre en son nom contre son gré. Mais tout homme était libre de se battre pour sa foi.
C'est pourquoi Montségur fut, pendant dix ans, l'âme et le centre de la résistance occitane. D'Espagne, les faidits passaient les monts pour se recueillir dans le haut lieu vénéré où le culte cathare était célébré avec une solennité qui égalait et dépassait celle de l'époque d'avant-guerre; du Languedoc, les chevaliers qui conspiraient en secret montaient à Montségur pour y rencontrer leurs amis, se concerter, recevoir des instructions; beaucoup de ces pèlerinages devaient avoir un caractère plus politique que religieux et - bien que l'on ne sache rien de leur activité - les parfaits, de petite noblesse eux-mêmes pour la plupart, ne devaient pas rester étrangers à ce mouvement patriotique; et peut-être entretenaient-ils autant leurs fidèles de la libération de leur pays que de la vanité d'un monde créé par un dieu mauvais.
En fait, ce qui est étrange, nous n'en savons rien. Nous savons que Guilhabert de Castres, Jean Cambiaire, Raymond Aiguilher, Bertrand Marty et d'autres recevaient un grand nombre de chevaliers qui ont joué un rôle prépondérant dans la lutte pour l'indépendance. Guilhabert de Castres, qui devait être fort âgé, descendait de Montségur et se rendait sous bonne escorte dans des châteaux de la région pour y faire de brefs séjours; tous ces déplacements étaient organisés d'avance avec beaucoup de soin et dans le plus grand mystère; l'infatigable évêque ne voulait évidemment pas renoncer, par crainte du danger, à visiter ses ouailles; mais il est légitime de supposer qu'il prenait une part active et personnelle au soulèvement qui se préparait, et qu'il encourageait ses fidèles à la lutte plutôt qu'à la non-résistance.
Les témoignages qui nous sont parvenus constatent seulement que tel parfait est venu dans tel endroit, qu'il a rompu le pain et que telles personnes l'ont "adoré"; et en suivant l'activité de dizaines et de dizaines de chevaliers, de femmes nobles, de sergents d'armes qui allaient, venaient, repartaient, revenaient, séjournaient à Montségur, etc., on n'apprend absolument rien, sauf le fait qu'ils écoutaient des sermons. Ainsi verra-t-on, au début du siège de Montségur (13 mai 1243), deux sergents d'armes, le diacre Clamens et trois parfaits descendre du château, traverser les lignes ennemies pour aller jusqu'à Causson, et cette expédition n'aura été entreprise que dans le but d'aller manger du pain bénit avec deux hérétiques de Causson. Il est d'ailleurs possible que l'activité des parfaits et des croyants autour de Montségur ait été dictée par des impératifs strictement religieux et rituels, dont nous ne pouvons mesurer l'importance faute de renseignements précis. Mais le contraire n'est pas impossible.
Il est peut-être difficile d'imaginer les parfaits organisant une activité terroriste; mais après tout, nous avons vu des évêques et même des saints catholiques se lancer à corps perdu dans la bagarre, le péril que courait l'Église justifiant tous les moyens d'action; et les ministres cathares, en agissant de même, eussent été plus excusables, puisque leur foi était plus violemment persécutée. Ce sont des hommes de Montségur qui ont participé à l'acte de terrorisme le plus retentissant de toute l'histoire de l'Inquisition. Les parfaits ne l'ont pas inspiré, ils l'ont peut-être approuvé. En un moment où la défense de leur Église coïncidait avec celle de leur patrie terrestre, les saints hommes de Montségur, qui étaient après tout faits de chair et de sang, pouvaient être aussi patriotes que des chevaliers faidits.
Raymond de Perella et son gendre Pierre-Roger de Mirepoix étaient parmi les chefs les plus décidés de la noblesse résistante; il est à peu près sûr qu'ils entretenaient des rapports secrets avec le comte de Toulouse; sans doute aussi avec Raymond Trencavel et avec le comte de Foix, et la plus grande partie de la noblesse cathare.
De grands seigneurs comme les sires de Niort avaient fourni une aide matérielle importante aux bons hommes de Montségur après l'hiver 1234, où toutes les récoltes gelèrent sur pied: Bernard-Othon de Niort s'occupa lui-même à rassembler les soixante muids de blé qui furent envoyés à Montségur; la chevalerie de Laurac donna vingt muids, Bernard-Othon de Niort à lui seul dix muids, le reste avait été fourni par les dons des seigneurs et des bourgeois des environs de Carcassonne et de Toulouse. Il y eut d'autres collectes, fort nombreuses, en argent et en nature, destinées aux fonds du château et à son approvisionnement.
Montségur devenait un arsenal; un dépôt d'armes s'y constituait dont l'importance devait être grande ainsi que le montrera la suite des événements; il est à croire que les chevaliers qui venaient pour y prier profitaient de leur pèlerinage pour apporter dans la place leur contribution en lances, flèches, arbalètes ou armures; D. Vaissette pense même que Montségur aurait servi de place d'armes à Trencavel176 ce qui ne semble pas confirmé par les faits, aucun témoin ne faisant mention d'un passage de Trencavel à Montségur. Mais l'immense dépôt d'armes accumulé dans la forteresse pouvait aussi bien être destiné à la défense du château qu'à l'approvisionnement en armes d'une éventuelle armée libératrice.
De plus, Montségur, "capitale" de l'Église cathare du Languedoc, abritait non seulement une grande partie des ministres de la secte, mais aussi un "trésor". Ce trésor consistait, d'abord, en dépôts d'argent, car pour la défense du château et l'entretien d'un grand nombre de parfaits il fallait disposer de sommes considérables, et Montségur devait aider les frères qui militaient dans les régions où ils étaient exposés à la persécution. Le trésor comprenait certainement autre chose: des livres sacrés, peut-être des manuscrits très anciens, des œuvres de docteurs particulièrement vénérés; la littérature cathare était abondante, et les parfaits, pour instruire les fidèles et les néophytes, ne se contentaient pas du Nouveau Testament; tout aussi passionnés de théologie que les catholiques, ils tenaient à conserver la pureté du dogme et attachaient la plus grande importance aux livres qui les aidaient à se maintenir dans la tradition orthodoxe. Le trésor comprenait-il autre chose? Des reliques, des objets considérés comme sacrés? Ce qui est certain c'est qu'aucune déposition n'en a jamais fait mention; il est vrai aussi que l'interrogatoire des inquisiteurs ne prévoit aucune question de ce genre. Il est possible que tel manuscrit de l'Évangile ou tel objet servant au culte aient pu être entourés d'une vénération spéciale - les cathares étant, après tout, des hommes - et gardés à Montségur à titre d'objets sacrés. Mais quelle que fût la nature du trésor de Montségur, l'endroit lui-même commençait à prendre une importance exceptionnelle dans l'esprit de tous les croyants du Languedoc, et il devenait le lieu saint par excellence.
L'était-il avant 1232, ou avant la croisade? Il ne le semble pas. Au temps où les cathares étaient libres de célébrer leur culte où ils voulaient, Montségur n'était un lieu sacré que pour les hérétiques de la région de Foix, l'esprit d'indépendance locale jouant là comme ailleurs. Cependant, sa situation et sa construction montrent qu'il a pu être un temple autant qu'un château; qu'il a très probablement été aménagé en vue de la célébration du culte, à un moment peut-être où l'Église cathare se sentait assez forte pour édifier et consacrer ses propres sanctuaires à l'exemple de l'Église catholique: en 1204 dans la région de Foix, la religion cathare était presque la religion officielle.
Entre 1232 et 1242, le château devint un lieu saint vers lequel les mourants se faisaient transporter, à dos de mulet, par les chemins de montagne, pour y recevoir le sacrement suprême et être ensevelis à l'ombre de ses murailles. Ainsi le chevalier Jordan Calvent, déjà consolé, se fit porter à Montségur pour y mourir; Pierre Guillaume de Fogart, accompagné de deux bons hommes, entreprit le voyage dans un tel état de faiblesse qu'il ne put arriver jusqu'à Montségur et s'arrêta à Montferrier où il mourut. Des femmes nobles des régions environnantes s'y retiraient pour y recevoir le consolamentum et y vivre dans la prière: en 1234, Marquesia de Lantar, belle-mère de R. de Perella, s'y fit "hérétiquer" par Bertrand Marty; les nombreuses parfaites qui vivaient dans leurs "maisons" autour du château recevaient les visites de leurs sœurs ou de leurs filles, qui faisaient auprès d'elles des séjours plus ou moins longs, parfois de plusieurs mois; parmi les visiteurs qui montèrent au château au cours des années 1233-1243, on cite surtout des chevaliers et des hommes d'armes, et aussi des femmes, sœurs ou filles de chevaliers. Les croyants de moindre condition y montaient peut-être aussi, mais n'ont pas attiré l'attention particulière des tribunaux; ceux-ci mentionnent toutefois les marchands des environs qui se rendaient à Montségur pour vendre des vivres, et tombaient de ce fait sous le coup de la loi qui interdisait de fournir une aide quelconque aux hérétiques.
En 1235, Raymond VII envoya trois chevaliers avec la mission de prendre possession de Montségur; ces chevaliers furent reçus dans le château, adorèrent Guilhabert de Castres et retournèrent à Toulouse. Peu après, le comte envoya vin de ses bailes, Mancipe de Gaillac, qui se contenta, lui et ses compagnons, d'adorer les bons hommes, et repartit comme il était venu. Une troisième fois, le comte envoya le même Mancipe de Gaillac avec des hommes d'armes qui s'emparèrent du diacre Jean Cambiaire (ou Cambitor) et de trois autres parfaits, et les emmenèrent à Toulouse pour les brûler. Cet incident illustre assez bien la politique du comte à l'égard des hérétiques: l'attitude de Raymond VII envers l'hérésie restera équivoque jusqu'au bout. Tous les témoignages attestent qu'il fut un bon catholique. Il est même probable - certains faits de sa vie le montrent - qu'il détestait sincèrement l'hérésie, cause des malheurs de son pays. Si, à maintes reprises, il eut partie liée avec les cathares, il devait surtout chercher à se servir d'eux comme d'une arme qui pouvait l'aider à reconquérir son indépendance.
Raymond de Perella, seigneur de Montségur, était suzerain des châteaux de Péreille, de Laroque d'Olmes, d'Alzen (act. Nalzen), et Montségur n'était pas sa seule résidence, ni sans doute celle que les sires de Perella préféraient, puisqu'en 1204 le château tombait en ruines. L'édifice devait exister avant l'établissement de la famille de Perella dans le pays, mais sa construction ne paraît pas remonter plus haut que le IXe siècle. Sa construction (ou plutôt son plan, car les murs ont été au moins partiellement reconstruits en 1204) révèle certaines connaissances techniques et mathématiques fort rares en Europe occidentale à cette époque, et du reste l'architecture de Montségur est unique en son genre, non seulement dans la région mais dans tout le Languedoc.
Le rocher, dont le sommet atteint 1207 mètres d'altitude, et d'accès difficile, pouvait servir de défense naturelle; mais à première vue il semblerait que le bâtisseur du château ait été plutôt mal inspiré d'aller se percher si loin et si haut. De nos jours, les ruines de châteaux forts ne manquent pas en haut de pics et de crêtes qui dominent les grandes routes, les fleuves, les cols; Montségur est parmi les rares ruines situées dans des endroits qui ne dominent rien et ne mènent à rien. Le constructeur a dû être plus influencé par la beauté du site que par ses avantages pratiques. On a vu des églises s'édifier dans des endroits invraisemblables - rochers escarpés, sommets isolés, lieux désignés par quelque vision miraculeuse ou consacrés par une tradition païenne christianisée. Le choix du site de Montségur s'apparenterait à celui de Rocamadour ou de Saint-Michel de l'Aiguilhe; mais on ne relève guère, dans la région, de traces d'un culte qui eût justifié la construction d'un temple en ce lieu précis. Du reste, l'architecture de ce château ne ressemble pas à celle d'un édifice religieux; ce n'est pas, non plus, celle d'un château fort. Commandée par la forme du rocher, elle n'en suit pas moins un plan qui semble se soucier avant tout des effets d'éclairage, et de l'orientation des murs par rapport au soleil levant. Mais la particularité la plus étrange de cette construction, ce sont ses deux portes et ce qui reste des fenêtres du donjon: aucun château médiéval - si l'on excepte les murs d'enceinte des grandes villes - ne possède de porte aussi monumentale que la grande porte d'entrée de Montségur. Elle mesure près de deux mètres de largeur et n'est protégée par aucune tour ni aucun ouvrage de défense; dans cet imprenable château on pouvait entrer comme dans un moulin, à condition de franchir d'abord la pente du rocher. De tels portails étaient un luxe réservé aux églises; et, que cette porte ait été percée en 1204 ou laissée telle lors de la reconstruction, un détail de ce genre montre que le château était considéré comme autre chose qu'un ouvrage de défense: la seule idée de faire percer un portail pareil a quelque chose d'insolite et de tout à fait contraire aux règles de l'architecture du moyen âge.
Toutes ces considérations donneraient à penser que Montségur a bien été, soit à l'origine, soit plus tard, destiné à l'exercice d'un culte, et peut-être d'un culte solaire; mais on ne voit pas quels auraient pu être le ou les personnages puissants qui auraient pu faire élever, entre le IXe et le XIIe siècle, cet édifice monumental pour y pratiquer une religion dont on ne retrouve pas de traces dans le pays. Les cathares, semble-t-il, ne vouaient pas de culte au soleil; les manichéens anciens le faisaient, mais il est peu vraisemblable qu'une secte manichéenne ait pu subsister aussi longtemps dans cette région. Cependant, si des survivances de traditions manichéennes ont pu se maintenir dans ces lieux reculés et peu fréquentés, elles ont pu y favoriser la diffusion du catharisme, et Montségur aurait ainsi bénéficié de la faveur des hérétiques en tant que lieu de refuge de leurs ancêtres dans la foi. Ils ne devaient guère y attacher d'importance avant 1204, puisque le château tombait en ruines et était abandonné; mais des parfaites y avaient déjà une "maison", comme elles en avaient du reste dans d'autres endroits montagneux et isolés: elles pouvaient avoir choisi ce site pour sa beauté et son silence. Il est fort probable qu'une tradition locale ait accordé une certaine importance au château de Montségur, et l'ait considéré comme un vestige laissé par les "bons chrétiens" d'autrefois. Car, comme nous l'avons vu, les cathares ne se regardaient nullement comme des novateurs, mais comme des gardiens d'une tradition plus ancienne que le catholicisme.
En 1233, Montségur commençait à apparaître aux catholiques comme la "Synagogue de Satan" - terme emprunté au vocabulaire cathare qui désignait sous ce vocable l'Église romaine. Menacée de mort violente l'Église cathare du Languedoc se serait créé spontanément une capitale terrestre dont le rayonnement pût faire contrepoids à l'ombre de plus en plus dense que Rome projetait sur le pays; et, à l'heure où tant de croyants étaient envoyés, à travers toute l'Europe, vers des lieux de pèlerinage catholiques par mesure de contrôle policier, leurs chefs spirituels dressaient pour eux dans les Pyrénées un lieu saint dont la noblesse pût contrebalancer les splendeurs de Rome, de Saint-Jacques-de-Compostelle, de Notre-Dame du Puy et de Notre-Dame de Chartres.
Le règne de Montségur fut bref. Il n'en constitue pas moins la tentative la plus marquante de l'Église cathare pour s'imposer dans le Languedoc en tant qu'Église nationale. L'Inquisition à elle seule n'aurait peut-être pas eu raison de Montségur, et ce lieu, qui était si rapidement devenu, pour un peuple humilié et traqué, le symbole de tous les espoirs, aurait peut-être pu avoir une influence durable sur l'"Histoire du Languedoc"; mais la citadelle cathare ne devait entrer dans la légende que mutilée et désertée. De la vie intense dont elle avait été le centre, il reste si peu de traces que les hommes, sans doute admirables et héroïques, qui l'ont habitée, sont moins vivants pour nous que les flammes de leur bûcher.
III - LA RÉVOLTE ET L'ÉCHEC DE Raymond VII
Pierre Seila et Guillaume Arnaud dans le diocèse de Toulouse, Arnaud Cathala et Frère Ferrier sur les territoires du roi continuaient leur tâche avec une ténacité exemplaire, malgré la résistance sourde que leur opposait la population du Languedoc. La révolte couvait: elle éclata, une première fois, en 1240: en avril de cette année Raymond Trencavel, à la tête d'une armée composée de faidits, d'exilés et de soldats aragonais et catalans, traversait les monts et, par la vallée de l'Aude, avançait dans le Carcassès. Olivier de Termes soulevait les Corbières et Jourdain de Saissac prenait les armes dans le Fenouillèdes.
Accueillis comme des libérateurs à Limoux, Alet et Montréal, les seigneurs occitans sont en quelques semaines maîtres de tout le pays. Pépieux, Alzille, Laure, Rieux, Caunes, Minerve ouvrent leurs portes; Montoulieu, ayant résisté, est pris d'assaut et la garnison massacrée.
Carcassonne, où le sénéchal Guillaume des Ormes s'est enfermé avec l'archevêque Pierre-Amiel et l'évêque de Toulouse, est investie le 7 septembre par les troupes de Trencavel qui pénètrent dans le bourg où elles sont accueillies avec joie; la révolte est si bien dirigée contre l'Église autant que contre les Français que trente-trois prêtres pris dans le bourg sont massacrés par la population malgré le sauf-conduit donné à eux par le vicomte. Le siège dura plus d'un mois. Malgré les attaques vigoureuses de Trencavel qui tentait de réduire la cité par des travaux de sape et des tirs de machines, Carcassonne résista. Le 11 octobre, l'avance d'une armée royale commandée par Jean de Beaumont força les assiégeants à lever le camp, et l'armée de Trencavel et une partie des habitants du bourg quittèrent Carcassonne après avoir ravagé le couvent des Frères prêcheurs et l'abbaye Notre-Dame et mis le feu à plusieurs quartiers.
Retiré dans Montréal et à son tour assiégé, Raymond Trencavel se vit forcé à négocier. Le comte de Toulouse n'avait pas bougé; il attendait la suite des événements. Sommé par Pierre-Amiel et Raymond du Fauga de porter secours au sénéchal selon les engagements pris par lui au traité de Meaux, il avait demandé à réfléchir. Il n'était pas allé jusqu'à se soulever à son tour et voler au secours de son cousin: il guettait une meilleure occasion. De concert avec le comte de Foix, il s'entremit auprès des représentants du roi pour négocier une paix honorable pour Raymond Trencavel, qui fut autorisé à repartir en Espagne avec armes et bagages.
Les villes qui s'étaient soulevées furent sévèrement châtiées: le bourg de Carcassonne complètement incendié, Limoux, Montréal et Montoulieu saccagés; les autres payèrent de lourdes contributions. L'armée royale monta vers les Corbières et obtint la soumission des seigneurs de Pierrepertuse et de Cucugnan, puis celle des seigneurs de Niort.
Raymond VII, dont l'attitude pendant la révolte avait paru plus qu'écivoque aux Français, se vit obligé de se rendre à Paris pour y renouveler ses serments de fidélité au jeune roi Louis IX (à présent âgé de 25 ans); il jura de faire la guerre à tous les ennemis du roi, de chasser les hérétiques et les faidits, et de prendre et de détruire Montségur. De plus, le comte donnait des gages de sa loyauté au légat en faisant la paix avec le comte de Provence, qu'il attaquait pour: servir la politique de l'empereur Frédéric II, ennemi juré du pape.
De toute évidence, Raymond VII ne tenait à aucun prix à se brouiller avec le roi à ce moment-là et voulait effacer la fâcheuse impression qu'avait pu produire la révolte de Trencavel. Cette révolte était arrivée trop tôt; et il faut croire que ni les années ni les malheurs n'avaient pu détruire la vieille rivalité entre les comtes de Toulouse et les Trencavel: le jeune Raymond n'avait pas consulté son cousin, et ce dernier ne l'avait pas soutenu. Il est vrai qu'il préparait une opération de grande envergure et son heure n'était pas encore venue.
Raymond VII avait renoncé à l'espoir de reconquérir son indépendance par une résistance locale condamnée d'avance à l'échec: il avait déjà fait l'impossible, et sa victoire sur les troupes de Montfort l'avait amené au traité de Meaux. Ce n'est qu'en affaiblissant d'une façon durable la puissance des rois de France qu'il pouvait rendre à son pays sa liberté et sa prospérité; il n'avait aucune chance d'y parvenir par ses propres forces. Il songeait donc à des combinaisons politiques plus vastes: ce n'était pas Trencavel et Olivier de Termes qui pouvaient chasser les Français du pays; c'étaient le roi d'Angleterre, l'empereur d'Allemagne et une ligue de grands vassaux qui, en cas de victoire, pourraient dicter leurs conditions à la France. Pour assoupir les soupçons du pape et du roi, le comte de Toulouse était prêt à toutes les soumissions et à toutes les manifestations d'orthodoxie; du reste, les souverains qu'il se cherchait pour alliés étant tous catholiques, il tenait moins que jamais à passer pour un protecteur de l'hérésie.
De plus, il avait, du pape, deux faveurs importantes à obtenir: la permission d'enterrer son père et celle de répudier sa femme. Il était assez vain, en effet, de vouloir secouer le joug des Français, si de toute façon le Languedoc devait, après la mort du comte, tomber automatiquement aux mains du roi de France par droit d'héritage. Or, Raymond VII ne parvenait toujours pas à se séparer de sa femme, stérile depuis vingt ans: le pape se gardait bien d'autoriser un divorce qui nuisait aux desseins du roi de France. Pour complaire au pape, le comte sacrifia son alliance avec l'empereur (pas pour longtemps comme on le verra) et s'en trouva mieux armé pour procéder à l'annulation de son mariage, d'autant plus qu'il était soutenu par Jacques I, neveu de la comtesse. Raymond prétendit avoir découvert, après vingt-cinq ans de mariage, que son père Raymond VI avait été un des parrains de la princesse Sancie, et qu'il se trouvait avoir épousé une filleule de son père. Il produisit des témoins et le mariage fut déclaré nul, à la grande indignation de l'évêque de Toulouse et au mécontentement, plus grand encore, d'Alphonse de Poitiers et de son épouse Jeanne, fille de Raymond VII.
Débarrassé de sa femme, le comte de Toulouse devenait un assez bon parti pour les filles des grands féodaux du Midi de la France. Raymond-Bérenger, comte de Provence (fils d'Alphonse, frère cadet de Pierre II d'Aragon), après s'être appuyé sur le roi de France pour se défendre contre les prétentions de l'empereur, songeait à présent à un moyen de se débarrasser de la tutelle des Français; Raymond VII, après avoir fait, en 1239, la guerre au comte de Provence pour servir les intérêts de l'empereur, lui proposait la paix, faisant ainsi coup double: d'un côté il donnait satisfaction au pape, d'un autre côté il s'acquérait un allié dans sa lutte future contre le roi.
Raymond-Bérenger n'avait que des filles; l'aînée était mariée à Louis IX, la cadette à Henri III d'Angleterre; deux autres restaient à pourvoir. Pas plus que Raymond VII, le comte de Provence, ne tenait à voir le roi de France hériter ses domaines: dix ans de domination française dans le Carcassès et l'Albigeois avaient dû amplement édifier les seigneurs méridionaux sur le sort qui attendait leurs pays en cas de mainmise royale. Raymond-Bérenger élut pour son troisième gendre le comte de Toulouse, dans l'espoir de fonder, avec lui et son cousin Jacques I d'Aragon, une ligue de barons du Midi assez puissante pour mettre en échec l'autorité royale. Pour Raymond VII, le mariage était une question vitale, puisque seul un héritier mâle pouvait (malgré les clauses du traité de Meaux) sauvegarder l'indépendance de sa terre.
Le comte avait, en 1241, quarante-quatre ans; il n'y avait aucune raison de supposer qu'il n'aurait plus de descendants, et cette circonstance pouvait compromettre, pour la France, les avantages du traité de Meaux. Or, à moins d'aller chercher une fiancée au Danemark, aucun prince d'Europe ne pouvait se marier sans une dispense du Saint-Père, et les familles des grands barons du Midi étaient toutes unies entre elles par des liens de parenté: Raymond VII se trouvait être parent par alliance des filles de Raymond-Bérenger, son épouse répudiée étant (ironie du sort) grand-tante de ces jeunes princesses. La dispense ne semblait pas être difficile à obtenir et le roi Jacques I d'Aragon représenta le comte de Toulouse à Aix, pour un mariage par procuration avec Sancie, troisième fille du comte de Provence. Ce mariage ne devait pas être consommé: Grégoire IX mourut le 21 août 1241, son successeur Célestin IV n'eut pas le temps de s'occuper de la dispense: son pontificat ne dura que quelques semaines; après sa mort (octobre 1214), le siège pontifical resta vacant vingt mois et le comte de Provence (se disant sans doute que cette dispense qui tardait trop risquait de ne jamais venir) maria sa fille à Richard, frère du roi d'Angleterre.
Le comte de Toulouse n'eut plus qu'à se chercher un nouveau beau-père: il porta son choix sur la fille d'Hugues de Lusignan, comte de La Marche. Là aussi, une dispense était nécessaire: Marguerite de La Marche et Raymond VII étaient consanguins au quatrième degré, descendant tous deux de Louis VI le Gros. Cette dispense-là, pour d'autres raisons, ne sera pas obtenue non plus.
Hugues de Lusignan, suzerain du Poitou, poussé par sa femme Isabelle d'Angoulême, veuve de Jean sans Terre, se cherchait, lui aussi, des alliés contre le roi de France. En 1242, le jeune Louis IX vit se former contre lui une ligue où prenaient part (plus ou moins directement) le duc de Bretagne Pierre Mauclerc, le comte de Toulouse, le comte de La Marche, le comte de Provence, soutenus d'un côté par le roi d'Angleterre Henri III, d'autre part par Jacques I d'Aragon. La coalition, en apparence puissante, n'était ni assez unie ni assez organisée pour mettre en échec la jeune et combative monarchie française. Nous avons vu que sur le plan militaire les Français du Nord avaient sur les Méridionaux une incontestable supériorité; et la défaite rapide de Raymond Trencavel avait montré qu'en pays ennemi et avec des troupes numériquement faibles les Français finissaient toujours par avoir le dessus. L'espoir de Raymond VII: encercler les domaines du roi et frapper l'adversaire sur plusieurs fronts en même temps, eût pu se réaliser si tous ses alliés avaient été aussi désireux que lui de faire la guerre au roi de France.
Mais le plus intéressé de tous, le comte de Toulouse, était aussi le plus faible, avec les garnisons royales à quelques dizaines de kilomètres de sa capitale, ses places fortes démantelées, et le contrôle incessant que l'autorité royale et l'Église ne cessaient d'exercer sur lui. Passant de Provence en Poitou, du Poitou en Espagne, Raymond VII avait consacré les années 1240-1242 à une intense activité diplomatique, en prenant du reste toutes les précautions pour ne pas éveiller les soupçons de Blanche de Castille: les 19 et 26 avril 1241, il signait avec le roi d'Aragon un traité d'alliance qui avait pour objet la défense de l'orthodoxie catholique et du Saint-Siège. Puis, il conclut une alliance offensive et défensive avec Hugues de Lusignan. Ensuite, il obtint l'adhésion des rois de Navarre, de Castille et d'Aragon, puis de Frédéric II. On ne peut dire que Raymond VII ait manqué de bonne volonté, ni même d'habileté; mais son sort, à présent, dépendait beaucoup moins de lui que de ses alliés, et pour eux la défaite de la France n'était pas d'un intérêt vital.
De retour d'Aragon et en chemin vers le Poitou, le comte tomba malade à Penne en Agenais, si gravement qu'on le crut à la mort (14 mars 1242). Cette maladie tombait assez mal: le comte de La Marche n'attendit pas le rétablissement de son allié pour dénoncer le lien de vassalité qui le liait aux rois de France. À peine rétabli, Raymond VII convoqua en hâte ses vassaux, au début d'avril, pour s'assurer de leur fidélité; tous jurèrent de le soutenir jusqu'à bout: Bernard comte d'Armagnac, Bernard comte de Comminges, Hugues comte de Rodez, Roger IV comte de Foix, les vicomtes de Narbonne, de Lautrec, de Lomagne, etc., s'engagèrent à aider le comte dans sa lutte contre le roi de France. C'était la déclaration de guerre.
Le jeune Louis IX, ne perdant pas de temps, se précipite avec son armée en Saintonge, où il écrase les troupes du comte de La Marche. La guerre débutait mal. Comptant sur la force du roi d'Angleterre et de ses autres alliés, Raymond VII ne songea pas à reculer: il savait qu'une deuxième occasion ne se représenterait pas. Mais la rapidité de la décision royale avait déjà compromis le succès de l'entreprise; et les vassaux du comte, toujours prêts à se battre pour leurs propres terres, ne tenaient pas à voler au secours d'Hugues de Lusignan.
Dans le peuple, la révolte, qui couvait comme un feu sous la cendre, flamba brusquement à la nouvelle de la guerre qui se préparait. Le signal en fut donné par le massacre d'Avignonet.
D'après les dépositions de témoins qui ont participé de près à l'affaire, ce massacre fut décidé à l'instigation directe du comte de Toulouse. Voici le récit que Fays de Plaigne, femme de Guillaume de Plaigne, fit aux inquisiteurs: "Guillaume et Pierre-Raymond de Plaigne, deux chevaliers de la garnison de Montségur, se trouvaient au château de Bram lorsqu'un certain Jordanet du Mas arriva pour dire à Guillaume que Raymond d'Alfaro l'attendait dans la forêt d'Antioche. R. d'Alfaro était viguier de Raymond VII et baile du château d'Avignonet. G. de Plaigne rencontra R. D'Alfaro au lieu indiqué, et le baile, après lui avait fait jurer le secret, lui dit: "Mon maître le comte de Toulouse ne peut pas se déplacer, non plus que Pierre de Mazerolles ou les autres chevaliers disponibles. Or, il faut tuer frère Guillaume Arnaud et ses compagnons. Je demande à P.-R. de Mirepoix et à tous les hommes d'armes de Montségur de venir au château d'Avignonet, où se trouvent en ce moment les inquisiteurs. Je conduirai d'ailleurs des lettres pour Pierre-Roger. Hâte-toi. En récompense, tu auras le meilleur cheval que l'on trouvera dans Avignonet après la mort des inquisiteurs177"".
Ce témoignage met en cause le comte de Toulouse de la façon la plus explicite. Peut-être Fays de Plaigne n'a-t-elle déposé dans ce sens que pour dégager en partie la responsabilité des siens? Le premier responsable direct est, dans tous les cas, Raymond d'Alfaro, qui a convoqué les hommes de Montségur et, seul, a rendu le meurtre possible. Il est douteux qu'il ait pu agir de sa propre initiative, ou du moins sans être sûr de l'approbation de Raymond VII; du reste, il était, en dehors de son titre de baile, très lié avec le comte, lequel était son oncle (R. d'Alfaro était le fils de Guillemette, fille naturelle de Raymond VI). Le comte, malgré sa haine pour les inquisiteurs, ne pouvait charger ses propres chevaliers d'un acte de violence; les chevaliers de Montségur n'étaient pas ses sujets, mais des rebelles déclarés et, de plus, demeuraient en un lieu réputé imprenable.
Mais ce n'était pas une corvée que le comte imposait aux chevaliers de Montségur, loin de là. C'était une aubaine, une faveur inespérée, une fête; ces hommes coururent au macabre rendez-vous avec une impatience d'amoureux pressés de revoir leur belle. Guillaume de Plaigne se rendit à franc étrier à Montségur annoncer la bonne nouvelle à Pierre-Roger de Mirepoix, commandant de la garnison; celui-ci rassembla aussitôt ses chevaliers et ses sergents d'armes, en leur disant: "Préparez-vous. Il s'agit d'une affaire très importante, qui nous rapportera un grand profit178!"
Ils étaient une soixantaine environ, soit près de la moitié de la garnison de Montségur, quinze chevaliers et quarante-deux sergents d'armes; tous appartenaient à la petit noblesse de la région, les Massabrac, les Congost, les Plaigne, les hommes de Montferrier, d'Arzeus, de Laroque d'Olmes, de Castelbon, de Saint-Martin-la-Lande... tous croyants cathares, sans doute depuis deux ou trois générations, car la plupart étaient des jeunes gens. Peut-on croire que P.-R. de Mirepoix ait caché aux parfaits le but de cette expédition? Eût-il risqué de prendre une telle responsabilité sans consulter le chef de la communauté, l'évêque Bertrand Marty? Les bons hommes ne fréquentaient peut-être pas la salle d'armes, mais ils devaient participer avec ardeur à tout ce qui se passait au dehors, puisque eux-mêmes se déplaçaient sans cesse et entretenaient des rapports suivis avec les croyants des environs. La mission dont R. d'Alfaro avait chargé les hommes de Montségur était contraire à la charité chrétienne, mais il n'y a pas lieu de croire que Bertrand Marty et ses compagnons l'aient désapprouvée.
Guillaume-Arnaud entreprenait une nouvelle tournée inquisitoriale, accompagné du Franciscain Étienne de Saint-Thibéry que le pape Innocent IV lui avait adjoint pour satisfaire aux exigences du comte de Toulouse. Les deux inquisiteurs étaient assistés dans leurs fonctions par deux Dominicains, Garsias d'Aure et Bernard de Roquefort, d'un Franciscain, compagnon d'Étienne de Saint-Thibéry, de Raymond Carbonier, assesseur du tribunal, représentant l'autorité épiscopale, de Raymond Costiran, dit Raymond l'Écrivain, ancien troubadour devenu archidiacre de Lézat (cet homme avait, 10 ans plus tôt, pris la défense de B.-O. de Niort lors de son procès) et de quatre domestiques.
Avignonet, situé en plein Lauraguais, sur les confins du domaine du comte de Toulouse, passait pour un nid d'hérétiques; tous les pays des environs, les Cassés, La Bessède, Laurac, Sorèze, Saissac, Saint-Félix étaient de vieille tradition hérétique et il fallait à Guillaume-Arnaud et à ses compagnons un certain courage pour y organiser une Inquisition au moment même où le comte de Toulouse venait de déclarer la guerre au roi de France. Ils voyageaient à cheval, sans escorte, et s'installaient dans le logis que les autorités locales mettaient à leur disposition.
Ils arrivèrent à Avignonet la veille de l'Ascension, et furent reçus par Raymond d'Alfaro qui, en tant que baile du comte, les fit loger dans la maison qui appartenait au comte de Toulouse. Ils les reçut avec la joie que l'on devine, et nous savons déjà qu'il ne perdit pas de temps pour faire connaître leur arrivée à qui il fallait. De leur côté, les hommes de Montségur, après une bonne chevauchée (il y a soixante kilomètres à vol d'oiseau entre Avignonet et Montségur, et près de cent par la route), s'arrêtèrent à Gaja, où ils furent reçus dans la maison de Bernard de Saint-Martin; là, ils furent rejoints par une autre troupe, composée de Pierre de Mazerolles, Jordan du Vilar et plusieurs sergents d'armes; puis, au Mas Saintes Puelles, le chevalier Jordan du Mas se joignit à eux; le secret n'avait plus besoin d'être bien gardé, le seul fait de savoir les inquisiteurs à portée de leurs armes changeait tous les hommes du pays en conjurés.
Quand la troupe s'arrêta à la maison des lépreux, à la sortie d'Avignonet, un messager de Raymond d'Alfaro vint les trouver, demandant s'ils s'étaient munis de haches. Douze haches avaient été préparées, huit hommes de Gaja et quatre de Montségur avaient été choisis pour ouvrir la marche. Les conjurés furent conduits, à la nuit tombée, dans la ville, puis Raymond d'Alfaro, reçut lui-même les hommes d'armes "vêtu d'un pourpoint blanc", et les guida à la lueur des flambeaux à travers les couloirs de la maison, jusqu'à la porte derrière laquelle reposaient les inquisiteurs, Le baile était lui-même accompagné d'une quinzaine d'habitants d'Avignonet qui avaient, eux aussi, voulu se joindre au complot.
La porte s'abattit sous les coups de hache, et les sept moines, réveillés en sursaut, et ne comprenant que trop bien dans quel piège ils étaient tombés, s'agenouillèrent pour entonner le Salve Regina; on ne leur laissa pas le temps de le terminer, Raymond d'Alfaro se précipita en avant avec sa masse d'armes, répétant: "Va be, esta be" (C'est bien, c'est bien) et ses compagnons se disputaient tous l'honneur de frapper les premiers coups. Ce que dut être cette boucherie, on peut l'imaginer par le seul fait que plusieurs des conjurés se vantèrent plus tard d'avoir porté des coups mortels. Les crânes des moines furent fracassés par les haches et les massues, leurs corps transpercés par d'innombrables coups de lance et de poignard dont beaucoup ne frappèrent plus, sans doute, que des cadavres.
Puis, ce fut le partage du butin: les registres des inquisiteurs, les quelques objets de valeur qu'ils emportaient dans leurs déplacements; assez peu de chose: des livres, un chandelier, une boîte de gingembre, quelques pièces d'argent, des vêtements, des couvertures; des scapulaires, des couteaux. À voir l'avidité avec laquelle ces hommes qui, sans être riches, n'étaient pas des miséreux, se précipitèrent sur ces objets de valeur somme toute médiocre, dans une pièce jonchée de cadavres défigurés et sanglants, on croit assister plutôt à une distribution de trophées qu'à une scène de pillage. Ceux des conjurés qui n'avaient pas participé au meurtre s'étaient joints aux autres, chacun voulait en avoir sa part.
Puis, R. d'Alfaro fit distribuer aux conjurés des chandelles et des flambeaux, et la procession sortit de la ville pour rejoindre le reste de la troupe qui les attendait à la maison des lépreux. G. de Plaigne montait le "meilleur cheval" qui lui avait été promis: le palefroi de Raymond l'Écrivain. Le baile d'Avignonet prit congé de ses complices, en leur disant: "Tout a été bien fait. Allez en bonne fortune". Puis, il rentra dans la ville pour crier l'appel aux armes. La retraite aux flambeaux qui annonçait la mort des inquisiteurs donnait le signal du soulèvement.
Pierre-Roger de Mirepoix attendait ses hommes dans la forêt d'Antioche; ils arrivèrent, amenant leur butin chargé sur leurs chevaux; sept hommes (Pons de Capelle, P. Laurens, G. Laurens, P. de Mazerolles, P. Vidal, G. de La Ilhe, G. Acermat) se vantaient d'avoir porté les coups mortels aux deux inquisiteurs. Pierre-Roger, dès qu'il aperçut G. Acermat, lui cria: "Traître, où donc est la coupe d'Arnaud? - Elle est brisée. - Et pourquoi ne m'en as-tu pas rapporté les morceaux? Je les aurais réunis dans un cercle d'or et dans cette coupe, j'aurais bu le vin toute ma vie". La "coupe" n'était autre chose que le crâne de Frère Guillaume-Arnaud179.
Au matin de l'Ascension, la troupe arriva à Saint-Félix. La grande nouvelle s'était déjà répandue dans le pays: le curé du bourg, à la tête de ses ouailles, vint féliciter les meurtriers, qui entrèrent dans Saint-Félix aux acclamations de la foule.
Le comte commençait sa guerre de libération. Au lendemain du massacre d'Avignonet, Pierre-Roger de Mirepoix envoyait deux sergents d'armes à Isam de Fanjeaux, pour demander si les affaires du comte de Toulouse allaient bien. Elles allaient bien, en effet: en trois mois, avec l'aide de Raymond Trencavel, Raymond VII allait se rendre maître du Razès, du Termenès, du Minervois et entrer en triomphe à Narbonne que lui livrait le vicomte Aimery; et pour bien marquer l'annulation du traité de Paris, il allait reprendre solennellement son titre de duc de Narbonne180. Les Occitans purent croire un instant que l'heure de la délivrance était arrivée.
Le meurtre de Guillaume-Arnaud et de ses compagnons n'était ni une victoire militaire, ni un acte d'héroïsme; c'était même, à ne considérer que les faits tout nus, une histoire plutôt sordide. Moins sordide, à tout prendre, que des bûchers allumés au nom du Christ, mais les actes de justice légale bénéficient d'un préjugé favorable, parfois, aux yeux de ceux-là mêmes qui les condamnent. Le massacre d'Avignonet avait aussi été un acte de justice: de cette justice populaire qui finit par avoir raison des lois, des pouvoirs publics et du temps. L'Église ne mit pas Guillaume-Arnaud au rang des martyrs, et les meurtriers, malgré le triomphe définitif de l'Inquisition, restèrent impunis.
La révolte de Raymond VII fut un échec. Le comte avait sans doute sous-estimé l'énergie et les talents militaires des chefs français, et surestimé les forces de ses alliés; erreur bien excusable, la situation où il se trouvait était si terrible qu'il devait être enclin à prendre ses espoirs pour des réalités. Le temps travaillait pour le roi, dont la domination dans le Languedoc oriental affaiblissait progressivement les forces de résistance du pays par un contrôle de plus en plus serré, par l'augmentation du nombre des fonctionnaires et chevaliers français, par l'appauvrissement de la bourgeoisie et l'élimination de la noblesse indigène.
Raymond VII, tant qu'il n'avait pas de fils, n'était pour ses alliés qu'un bâton brisé sur lequel il ne faut pas risquer de trop s'appuyer: le comté de Toulouse n'était plus considéré comme un pays ami ou ennemi, ni comme une zone d'influence; il se trouvait réduit aux proportions de la personne assez fragile du comte lui-même, lequel ne prenait guère le chemin de vivre assez longtemps pour voir son fils non encore né parvenir à l'âge d'homme et tenir tête au roi de France.
Après Hugues de Lusignan, Henri III est battu par l'armée française à Taillebourg, et se replie sur Bordeaux; ni le roi d'Aragon ni le comte de Provence ne se pressent de soutenir des alliés aussi malchanceux; les vassaux du comte de Toulouse, sachant la partie perdue, ne songent plus qu'à éviter la réapparition de l'armée royale sur leurs terres. Pendant que Raymond VII, après avoir signé un nouveau traité d'alliance avec le roi d'Angleterre, se rendait en Agenais pour assiéger le château de Penne tenu par les Français, Roger IV de Foix offrait sa soumission au roi et rompait définitivement le lien de vassalité qui le liait au comte de Toulouse.
Raymond VII, se voyant abandonné de tous, n'eut plus qu'à se soumettre, en faisant appel à la médiation de la reine-mère Blanche de Castille; il remit au roi, en gage de sa soumission, les places de Bram et de Saverdun et tout le Lauraguais, et signa la paix à Lorris, le 30 octobre 1242.
La révolte était terminée: si bien terminée que le roi ne jugea même pas bon de punir sévèrement ces vassaux qui avaient porté les armes contre lui, au mépris de leurs serments. En janvier 1243, les comtes de Toulouse et de Foix se rendaient à Paris pour renouveler leur hommage à la couronne. Ce fut à Blanche de Castille que le comte dut (selon G. de Puylarens) les conditions relativement douces du nouveau traité de paix; la régente n'avait nul intérêt à appauvrir des domaines qui allaient revenir à son fils. Le meilleur moyen de rendre le comte de Toulouse inoffensif était encore de l'empêcher de se remarier, ce à quoi Blanche de Castille allait s'employer avec succès, dans les années qui suivirent. En attendant, Raymond VII promit - une fois de plus - de purger définitivement ses terres de l'hérésie. Blanche de Castille prenait très à cœur l'affaire de la foi, et le comte, de son côté, ne demandait pas mieux que de persécuter les hérétiques, pourvu qu'on le laissât le faire lui-même. Et, ne pouvant éliminer le roi de France, il allait du moins essayer de se débarrasser de l'Inquisition.
À peine revenu dans le Languedoc, le comte fit réunir un concile composé par la plupart des évêques et des grands abbés du pays, bien qu'il fût encore sous le coup de l'excommunication lancée contre lui par Frère Ferrier après le meurtre des inquisiteurs, et par l'archevêque Pierre Amiel après son entrée à Narbonne. Le concile avait pour but l'extermination de l'hérésie. L'archevêque de Narbonne lui-même présidait cette assemblée181. Pour le comte, le véritable but de ce concile était l'élimination des inquisiteurs au profit de la juridiction épiscopale.
À cette manœuvre dirigée beaucoup plus contre eux que contre l'hérésie, les Dominicains répondirent par une démarche qui, si elle réussissait, devait combler les vœux du comte de Toulouse: ils demandèrent au pape de relever leur ordre des fonctions inquisitoriales, qui ne leur causaient que des ennuis et leur attiraient une telle hostilité. Et il est vrai que nombre de Dominicains qui n'étaient nullement inquisiteurs avaient payé pour l'impopularité de leurs frères, puisque les couvents de Frères Prêcheurs étaient attaqués et saccagés dans beaucoup de villes. Mais d'autre part, le sort de Guillaume-Amaud n'était pas fait pour décourager les chefs du mouvement, hommes aussi peu sujets à la peur qu'à bien d'autres sentiments humains; il devait plutôt stimuler leur énergie. Comment ces terribles lutteurs eussent-ils envisagé d'abandonner la partie, au moment où l'ennemi était à demi vaincu et le roi de France triomphait? Ils tenaient surtout à faire comprendre au pape à quel point leur action était redoutée, donc efficace. Négligeant leur demande, Innocent IV les confirma dans tous leurs pouvoirs, sans les soumettre en aucune façon à la juridiction épiscopale; les prêcheurs, de leur côté, pour désarmer les évêques qui pouvaient leur être hostiles, s'empressèrent d'accorder une place importante à l'ordinaire dans la procédure de leurs tribunaux; concession purement honorifique, l'autorité suprême en matière d'hérésie appartenant toujours à l'Inquisition dominicaine, de auctoritate apostolica.
La tentative du comte avait donc échoué. Du reste, son excommunication n'était toujours pas levée, on exigeait de lui des actes, non des paroles. Au concile de Béziers, en 1243, les prélats du Languedoc décidèrent d'en finir avec Montségur (que le comte avait déjà, sans grande conviction, tenté de prendre) et qui se trouvait être le repaire des assassins de Guillaume-Araud. La révolte et la défaite du comte forçaient l'Église et le roi à une sévérité accrue; vaincu, Raymond VII ne cherchait plus qu'à limiter les dégâts, en sacrifiant ceux de ses sujets qu'il ne pouvait plus défendre sans se brouiller avec ses vainqueurs et avec ses alliés éventuels.
Hugues des Arcis, nouveau sénéchal de Carcassonne, et Pierre-Amiel, archevêque de Narbonne, prirent donc la résolution de rassembler une armée assez considérable pour mettre enfin le siège devant cette fameuse forteresse que la rumeur publique leur désignait comme le quartier général de l'hérésie. En avril 1243, après l'effondrement de la dernière tentative de révolte armée du Languedoc, dans cette atmosphère de découragement général où chacun ne songeait qu'à tirer son épingle du jeu, Montségur, isolé, irréconciliable, se trouvait - bien malgré la volonté de ses défenseurs - destiné à jouer le rôle du bouc émissaire de la résistance occitane.
Le jour où Raymond de Perella avait accepté de faire de son château le siège officiel de son Église, il avait prévu le danger auquel il s'exposait; excommunié et condamné à mort par contumace, il savait bien qu'il n'avait plus à attendre de secours que de la solidité de ses murailles. Il n'avait pas dû prévoir que de sa petite citadelle le roi et le pape allaient un jour faire le symbole de l'hérésie prête à dévorer l'Église.
172 Doat. T. XXIII, 2-39.
173 Il ne semble pas, malgré l'affirmation du traducteur anonyme de la "Chanson", que le château ait été pris par les croisés. En 1212, Guy de Montfort s'était emparé de Lavelanet et ravagé les environs, et peut-être brûlé le village de Montségur.
174 "Chanson de la Croisade", ch. CXLV. 3265.
175 Il était né en 1207.
176 Op. cit., éd. 1879, t. VI, p. 768.
177 Récit fait par F. de Plaigne à Frère Ferrier, 18 mars 1244. Doat, t. XXII, pp. 293 v°-294 v°.
178 Doat, t. XXII, pp. 293 v°-295 v°.
179 Doat, t. XXII, p. 287.
180 8 août 1242.
181 Béziers, le 15 avril 1243.
CHAPITRE XII
LE SIÈGE DE MONTSÉGUR
Au mois de mai 1243, Hugues des Arcis, avec une armée de chevaliers et de sergents d'armes français, vint planter ses tentes au pied du rocher de Montségur. Il allait recevoir des renforts, l'encerclement d'une montagne de cette dimension exigeait des effectifs importants. Cette place trop haut perchée ne pouvait, semblait-il, être réduite que par la faim et la soif. Il n'y avait qu'à l'empêcher de communiquer avec le dehors, et laisser le soleil d'été vider les citernes. Dans le château et dans les baraquements entassés sous ses murs logeaient plusieurs centaines de personnes: la garnison (entre 120 et 150 hommes), les familles des seigneurs et des hommes d'armes, et les hérétiques proprement dits, qui devaient être environ deux cents, hommes et femmes.
I - LE SIEGE
Le siège devait être beaucoup plus long que ne le furent tous les sièges entrepris par Simon de Montfort (si l'on excepte celui de Toulouse dont la situation était difficilement comparable à celle de Montségur). Carcassonne avait tenu quinze jours. Minerve et Termes quatre mois, Lavaur deux mois, Penne d'Agenais moins de deux mois, Montgaillard six semaines, etc. Toutes ces places étaient beaucoup plus fortes, militairement, que Montségur. Des châteaux tels que Termes et Minerve possédaient aussi des défenses naturelles qui les rendaient imprenables; ils avaient été réduits par la soif. Montségur, étant donné ses dimensions exiguës, était surpeuplé comme aucun des autres châteaux (à part Carcassonne) ne l'avait été au cours d'un siège.
Logiquement, il eût dû capituler à la fin de l'été, mais tint assez longtemps pour attendre les pluies; là, les assiégeants ne pouvaient plus compter sur le manque d'eau.
Ils n'avaient pas non plus à compter sur la faim; des dons abondants de croyants riches et pauvres avaient fait de Montségur un immense entrepôt de vivres; l'éventualité d'un siège était toujours à prévoir, et si en 1235 les croyants organisaient des collectes parce que les bons hommes de Montségur n'avaient rien à manger, en 1243 le ravitaillement de la place ne posait plus de problèmes: les dons affluaient, le petit village au pied du roc était devenu un marché où venaient tous les commerçants des bourgs voisins; du Toulousain et du Carcassès des convois de blé étaient acheminés sur Montségur. Et le meurtre des inquisiteurs n'avait pu que rehausser encore le prestige de la citadelle cathare, devenue de ce fait le refuge des héros de la liberté. Pendant le siège, le château continuait à être ravitaillé par des partisans venus de dehors qui parvenaient à forcer le blocus de l'armée assiégeante, et à monter jusqu'au sommet du roc d'importantes quantités de blé.
La garnison recevait le concours de forces fraîches; des hommes dévoués à la cause cathare traversaient de nuit les lignes ennemies pour grimper jusqu'au château et se joindre aux défenseurs. Tout le temps que dura le siège, les communications avec l'extérieur continuèrent: la montagne, longue, large, escarpée, énorme vague de blocs calcaires terminée au sommet par une roche nue descendant presque à pic dans la vallée, était très difficile à encercler complètement. L'armée assiégeante, dont les effectifs montèrent parfois jusqu'à dix mille hommes, ne pouvait contrôler de nuit et de jour tous les sentiers et pas de montagne par lesquels les assiégés sortaient, rentraient, ramenaient des amis, des provisions, des nouvelles du dehors. En fait, la difficulté du siège venait sans doute autant de la complicité inlassable et fervente de la population du pays avec les assiégés, que des merveilleuses défenses naturelles de la forteresse.
L'armée d'Hugues des Arcis, en se présentant au pied du roc formidable au sommet duquel le château semblait narguer l'adversaire, dut d'abord installer son camp au col du Tremblement, fermant ainsi aux assiégés l'accès le plus commode vers la vallée, et occuper le village; elle ne pouvait faire grand-chose d'autre, il ne restait qu'à attendre des renforts. L'archevêque de Narbonne envoya des milices recrutées parmi les bourgeois et les gens du peuple.
On ne possède aucun renseignement précis sur le nombre des chevaliers français amenés par le sénéchal: peut-être plusieurs centaines, car Hugues des Arcis s'était préparé à un siège sérieux et avait dû faire appel à une bonne partie des effectifs militaires dont il disposait. Aussi bien, les défaites toutes récentes de Trencavel et de Raymond VII laissaient-elles aux Français les mains libres; cette chevalerie, qui n'avait pas fait les campagnes de Simon de Montfort, ne possédait sans doute pas l'expérience nécessaire pour combattre dans un pays de montagne, mais elle constituait un corps d'armée discipliné et solide, capable de prendre l'ennemi par l'usure, au cas où l'escalade du pog s'avérerait impossible. Mais les Français, même avec leurs écuyers et sergents d'armes, n'étaient évidemment pas assez nombreux. Les armées locales, supérieures en nombre, étaient surtout composées de fantassins que, sur réquisition de l'archevêque, villes et bourgs équipaient et envoyaient à leurs frais; beaucoup n'étaient même pas soldats de profession. La plupart ne devaient pas avoir un grand désir de se battre contre leurs compatriotes et faisaient leur temps de service à contrecœur. Il formaient les détachements qui encerclaient la montagne et contrôlaient les routes, les passages et les gorges; tout au long du siège, malgré les efforts de l'archevêque, il y eut dans cette armée des désertions et, bien entendu, une complicité passive avec les assiégés. Ceux-ci traversaient sans cesse les lignes, parfois en groupes nombreux, et le blocus de la montagne, sur lequel Hugues des Arcis comptait pour réduire l'adversaire, se trouvait être pratiquement impossible. Ce nid d'aigle ne pouvait qu'être pris d'assaut, entreprise qui, à première vue, semblait désespérée.
On ne pouvait songer à tenter l'escalade du rocher, ni même celle de la pente découverte, encore assez raide, qui, du col du Tremblement, menait au château: le détachement qui se fût risqué sur cette pente eût été écrasé par les pierres jetées par les défenseurs bien avant d'avoir fait la moitié de la côte. Les Français étaient donc forcés de se tenir à une bonne distance du château, et ne pouvaient se servir ni de leurs armes ni de leurs machines.
La crête orientale, la seule qui pût être escaladée sans danger - si l'on peut dire - ne pouvait être atteinte que par des sentiers de montagne assez raides, des pistes forestières connues des gens du pays mais assez difficilement accessibles; et d'ailleurs, la crête elle-même, parcourue par des sentinelles et, de plus, séparée du château par une dénivellation d'une dizaine de mètres, ne donnait pas encore directement accès à la citadelle. Cette crête étroite, longue d'une centaine de mètres environ, constituait le seul point d'accès et était protégée par des fortifications en bois, d'où les défenseurs pouvaient aisément repousser les assaillants dans l'abîme.
Pendant cinq mois, assiégés et assiégeants restèrent sur leurs positions respectives, les uns perchés au sommet de la montagne, les autres éparpillés dans les vallées et sur les pentes des alentours; il semble qu'il y ait eu des tentatives d'escalade repoussées, car on sait que trois hommes de la garnison de Montségur furent mortellement blessés avant octobre 1243. C'était à peu près le seul résultat obtenu par cinq mois d'un siège coûteux et épuisant.
Qui étaient les défenseurs et les habitants de la place assiégée? Les registres des inquisiteurs nous révèlent les noms de trois cents personnes qui se trouvaient dans le château pendant le siège; plus cent cinquante au moins dont les noms sont restés inconnus parce qu'on n'a pas jugé utile de les interroger, nous verrons plus tard pour quelle raison.
Le seigneur du château, Raymond de Perella, s'était pour ainsi dire mis au service des bons hommes; il se trouvait être plutôt l'intendant et le premier défenseur que le propriétaire de la place. Il y vivait avec sa famille: sa femme Corba de Lantar, ses trois filles et son fils. Le fils, Jordan, devait être tout jeune, car il ne semble pas avoir pris une part active à la défense; des filles, deux étaient mariées: Philippa à Pierre-Roger de Mirepoix, Arpaïs à Guiraud de Ravat; la troisième, Esclarmonde, était infirme et s'était vouée à Dieu, de même que sa mère, qui n'était pas encore parfaite mais devait donner plus tard une preuve éclatante de l'ardeur de sa foi; elle était, elle-même, fille de Marquésia de Lantar qui vivait également à Montségur et était une hérétique revêtue. Pierre-Roger de Mirepoix, mari de l'aînée des filles du châtelain, était, comme nous l'avons vu, le chef de la garnison, et un des meilleurs chevaliers du pays; faidit, puisque les héritiers de Guy de Lévis occupaient à présent le Mirepoix, et issu d'une famille dévouée à l'hérésie: Fomeria, la mère de son parent Arnaud-Roger de Mirepoix, avait été une des parfaites qui séjournaient à Montségur en 1204; la fille de Fomeria, Adalays, avait également vécu au couvent des parfaites de Montségur et ses fils Othon et Alzeu de Massabrac se trouvaient parmi les chevaliers de la garnison. Une fille de cette même Adalays avait épousé Guillaume de Plaigne (déjà cité). Bérenger de Lavelanet, un des co-seigneurs du lieu, était le beau-père d'Imbert de Salas, sergent d'armes de la garnison, et une de ses sœurs était parfaite à Montségur. Les chevaliers et leurs écuyers appartenaient tous à la petite noblesse des environs et formaient pour ainsi dire une grande famille. Chacun comptait parmi ses proches parentes au moins une parfaite.
À ce propos, on peut se demander quel fut exactement le rôle joué par les femmes dans la religion cathare. Il est certain que beaucoup de femmes nobles, veuves ou même mariées mais déjà âgées, se retiraient du monde pour mener une vie de prière, en compagnie d'autres parfaites; ces austères matrones élevaient leurs enfants dans un dévouement total à leur foi, et la plupart des chefs de l'Église cathare devaient être, dès l'enfance, promis au sacerdoce par des mères ardemment croyantes (ce qui explique, sans doute, certains cas éclatants d'apostasie observés chez des parfaits). Mais aucune de ces femmes ne semble avoir joué un rôle comparable, même de loin, à celui des évêques et des diacres cathares; si certaines ont mené une vie clandestine très active, elles n'occupaient tout de même dans la hiérarchie cathare que des emplois subalternes; la plupart vivaient retirées dans des ermitages et dans des grottes, jeûnant et priant et engageant d'autres femmes à suivre leur exemple. Ce qui paraît évident, c'est que le catharisme, que l'on a accusé de vouloir détruire les affections naturelles, a été une religion très patriarcale, et dont la force résidait justement dans les liens de famille qui, de la grand-mère aux petits-enfants, du beau-père au gendre et des oncles aux neveux, avaient fini par gagner à l'Église cathare une société puissamment unie, solidaire dans sa foi comme dans la défense de ses intérêts. Et c'est pourquoi le rôle des femmes y était si apparent: gardienne de la famille, la femme était aussi la gardienne des traditions religieuses. Et les chevaliers et dames qui montaient à Montségur pour y célébrer les fêtes de Noël ou de la Pentecôte y venaient également pour rendre visite à quelque vénérable mère, tante ou aïeule et recevoir sa bénédiction.
À part les écuyers, qui étaient tous plus ou moins parents ou camarades d'enfance des chevaliers, la garnison comptait des soldats ou sergents d'armes, une centaine en tout; gens du pays pour la plupart, combattants redoutables et tout dévoués à leurs chefs. Certains d'entre eux avaient aussi leurs femmes dans la place. La femme et les filles de R. de Perella avaient près d'elles leurs servantes ou demoiselles de compagnie; les deux maîtres de Montségur - car l'autorité, dans le château, était en fait partagée entre le châtelain et son gendre P.-R. de Mirepoix, et les deux hommes ne s'entendaient pas toujours entre eux - avaient leurs bailes, chargés de la surveillance des domaines. De plus, à part les personnes appartenant à la maison des chevaliers, Montségur abritait aussi des hôtes qui s'y étaient réfugiés par crainte de l'Inquisition, tels Raymond Marty, frère de l'évêque Bertrand, ou G.-R. Golayran, qui avait pris une part active au meurtre d'Avignonet.
À l'époque du siège le nombre des personnes enfermées dans le château s'élevait, comme nous l'avons dit, à environ trois cents, plus les parfaits. Ceux-là étaient très nombreux - entre cent cinquante et deux cents - ce qui n'a rien d'étonnant, puisque Montségur était le refuge officiel et le lieu saint de leur Église. Les chefs de l'Église cathare du Languedoc qui s'y étaient établis depuis 1232 n'avaient pas jugé utile de changer de résidence en voyant l'armée française au pied du mont: ailleurs, ils risquaient encore davantage d'être pris; et il semble bien que Montségur ait déjà pris une telle importance aux yeux des hérétiques du pays que la fuite des bons hommes vers quelque autre lieu fût apparue comme une désertion. Ces hommes, qui niaient la réalité de toute apparence et de toute manifestation matérielle du sacré, voyaient leur sort mystérieusement lié à celui de ce vaisseau de pierre, de cette majestueuse cathédrale sans croix dressée sur un rocher en plein ciel: la force d'âme de leurs partisans venait peut-être du fait qu'ils défendaient autre chose que des vies humaines - leur temple, l'image terrestre de leur foi.
Le château était-il bien un temple? Sa construction, comme nous l'avons dit, semblerait l'indiquer; l'indiquer seulement, car personne n'a jamais parlé de cette forteresse comme d'une église. Les cathares qui, quoi qu'on en dise, ne faisaient nul mystère de leurs croyances, n'ont jamais prétendu détenir à Montségur quelque secret qui eût fait de ce lieu une exception à leur doctrine sur la matière. Ni Golgotha, ni Saint-Sépulcre, ni château du Graal.
Dans ce château fort qui possédait non pas une mais deux grandes portes et dont le donjon était percé (au premier étage) de fenêtres au lieu de meurtrières, le culte cathare devait évidemment être célébré avec plus de solennité qu'ailleurs. Mais ce que nous savons des rites cathares montre qu'ils étaient d'une extrême simplicité. Du reste, la salle du rez-de-chaussée du donjon - seul endroit où pouvaient avoir lieu les cérémonies et les prédications - était assez petite: cinquante mètres carrés environ, soit une surface qui, de nos jours, serait considérée comme à peine suffisante pour loger confortablement un jeune ménage. De telles dimensions ne se prêtent guère à de grandes solennités, ni à la réunion de foules d'auditeurs. Les prédications avaient peut-être lieu aussi dans l'enceinte pentagonale qui est en prolongement du donjon (600 m2); mais cet espace devait être en grande partie occupé par les entrepôts de vivres, les écuries, les réserves d'armes et de projectiles et aussi par les habitations des défenseurs. Bref, c'était un temple des plus modestes, sinon des plus inconfortables. Il semble que les cathares, logiques avec eux-mêmes, se fussent choisi comme capitale un endroit qui n'avait pour lui que sa beauté et son caractère inaccessible.
Ce haut lieu, voué par l'Église aux flammes de l'enfer, vivait d'une vie religieuse intense, et sans doute en grande partie étrangère aux vicissitudes terrestres; les bons hommes qui campaient dans leurs cabanes sous les murailles étaient probablement plus occupés à célébrer leur culte et à commenter les Évangiles qu'à suivre les progrès du siège. Cependant, la situation était grave: dès le mois de mai, le diacre Clamens, avec trois autres parfaits, était descendu de Montségur et était allé jusqu'à Causson, sans doute pour établir un contact avec des amis sûrs à qui l'on pourrait, le cas échéant, confier la garde du trésor. Clamens et ses compagnons revinrent à Montségur sans difficultés. Deux autres parfaits, R. de Caussa et son compagnon, descendirent également, à peu près à la même époque, pour se rendre au château d'Usson; ils pratiquèrent l'apparelhamentum et bénirent le pain; les hommes d'armes qui les accompagnaient revinrent seuls à Montségur.
En principe, les défenseurs du château eussent dû songer, avant tout, à mettre à l'abri les chefs de l'Église cathare, qui, en cas de prise du château, se trouveraient voués à une mort certaine. La chose était faisable, puisque pendant des mois on put sortir de la place et y rentrer et les parfaits, hommes endurcis à toutes les fatigues, ne devaient pas craindre de s'aventurer sur des sentiers de montagne. Or, la plupart restèrent à Montségur jusqu'au bout.
Parmi les grandes personnalités de l'Église du Languedoc qui se trouvaient à Montségur au moment du siège, on connaît l'évêque Bertrand Marty, Raymond Aiguilher, qui avait soutenu des controverses contre saint Dominique près de quarante ans plus tôt, élu en 1225 fils majeur de l'évêque du Razès; ces deux hommes devaient être fort âgés. Les diacres Raymond de Saint-Martin (ou Sancto Martino), Guillaume Johannis, Clamens, Pierre Bonnet - parmi eux, seul le premier était un personnage connu pour son activité de prédicateur. Par ailleurs, les aveux des témoins interrogés par les inquisiteurs montrent que huit diacres cathares au moins officiaient dans les différentes régions du Languedoc, après 1243; ces diacres n'avaient, semble-t-il, aucun rapport direct avec Montségur. Des quelque trente autres diacres dont les noms et l'activité ont été signalés par Jean Guiraud dans son ouvrage sur l'Inquisition, la trace se perd avant 1240-1242; les plus célèbres - Isam de Castres, Vigoros de Baconia, Jean Cambiaire - avaient été brûlés, le premier en 1226, les deux derniers en 1233 et 1234, Guillaume Ricard fut pris et brûlé en 1243 dans le Lauraguais. Les diacres Raymond de Saint-Martin, Raymond Mercier (ou de Mirepoix), Guillaume Toumier étaient, eux, de la circonscription de Montségur et y exerçaient leur activité depuis de longues années, mais il n'est pas certain que les deux derniers y eussent encore résidé pendant le siège. Raymond Mercier qui, déjà en 1210, jouissait dans le pays d'une immense popularité, était sans doute mort quelques années avant 1243; Guillaume Toumier était encore vivant en 1240, ainsi que l'évêque Guilhabert de Castres. En 1240, la trace de Guilhabert se perd également: il était probablement mort à Montségur, bien que nul document ne fasse mention de sa fin; dans tous les cas, à cette date, il devait avoir environ quatre-vingts ans, et continuait touours sa vie de chevauchées nocturnes et de réunions secrètes, de château en village et de forêt en forêt; la mort avait dû le surprendre en pleine action.
Donc, à part Raymond de Saint-Martin, l'évêque Bertrand et Raymond Aiguilher, aucune des grandes personnalités de l'Église cathare ne se trouvait à Montségur à l'époque du siège. La plupart étaient morts, ou continuaient leur apostolat dans une clandestinité de jour en jour plus dangereuse. Montségur n'était ni le dernier rempart ni le dernier espoir de cette Église; il en était le symbole vivant pour la masse des croyants.
Il est possible que les nombreux parfaits, hommes et femmes, retirés à Montségur, aient été dans leur majorité soit des personnes déjà âgées, soit des mystiques adonnés à la contemplation et à l'étude des Écritures, soit des néophytes faisant leur temps de probation. Montségur était un des derniers couvents et séminaires cathares.
En plein siège, pendant l'été 1243, ces cénobites et ces recluses vivaient dans l'étroit réduit qui leur était laissé sur la paroi rocheuse de la montagne, entre la haute muraille du château et les fortifications provisoires échafaudées le long de la petite terrasse inclinée qui entourait la forteresse. Le long édifice de pierre était entouré d'une ceinture de petites cabanes de bois, large par endroits de quelques dizaines de mètres, exposée sans défense aux intempéries, et n'ayant littéralement d'autre protection que l'altitude et la raideur de la pente du rocher: une telle cité eût été écrasée en quelques heures par des boulets, si elle s'était trouvée à portée d'une pierrière.
L'expression infra castrum182 qui se rencontre dans les dépositions de Bérenger de Lavelanet et de R. de Perella a pu faire croire à l'existence d'habitations souterraines auxquelles on eût pu accéder de l'intérieur du château: en effet, on a pu se demander pourquoi G. de Castres voulait obtenir de R. de Perella la permission d'habiter sous le château et non dans le château, et comment le chevalier R. del Congost a pu, pendant le siège, séjourner trois mois sous le château. Si l'état actuel des ruines ne permet de trouver aucune trace d'une ouverture conduisant à un passage souterrain, le nombre assez grand de cavernes et excavations que l'on rencontre dans le reste de la montagne permet d'envisager l'hypothèse d'une grotte souterraine assez importante, située sous l'emplacement même du château, et dont l'ouverture aurait été murée par les défenseurs à la fin du siège. Il serait téméraire, cependant, de supposer l'existence d'un véritable château souterrain, avec corridors, escaliers, salles d'armes, dortoirs, cellules et caveaux funéraires (comme le fit N. Peyrat): si la chose avait été vraie, elle eût été connue d'un grand nombre de personnes; or, aucun témoignage contemporain n'y fait allusion.
L'expression "habiter sous le château" s'explique probablement par l'existence des huttes et des baraques en bois édifiées autour des murailles: étant donné leurs dimensions et le fait qu'elles se trouvaient sur une pente assez raide et au-dessous des murs hauts de quinze à vingt mètres, on pouvait en effet dire qu'elles se trouvaient sous le château, et non pas à côté. C'est au grand air, dans des campements de fortune dont l'étroitesse et l'inconfort eussent effrayé les habitants des pires "taudis" de notre époque, que vivaient les ermites cathares, et non dans l'inaccessible labyrinthe d'un temple souterrain. Avant le siège, certains d'entre eux avaient probablememt des habitations sur la montagne même, dans les forêts, le long de la crête orientale; ils ont dû remonter vers le château, à l'approche des armées ennemies. Il est dit que telle parfaite, tel hérétique avait sa "maison"; dans ces maisons, les croyants, les hommes de la garnison, les femmes des châtelains, venaient parfois partager le pain bénit, "adorer" les bons hommes; on y apportait les mourants pour les consoler. Les maisons de l'évêque et des diacres se trouvaient sans doute à l'intérieur de l'enceinte de pierre, non celles des autres parfaits; jusqu'aux derniers mois du siège ces pauvres demeures purent être habitées, l'immense ceinture de vide qui s'étendait derrière les palissades de pieux les protégeait mieux qu'un rempart.
Ces hommes et ces femmes vivaient en général deux par deux, bien que (étant donné sans doute le manque de place) on cite des parfaites ayant eu plusieurs compagnes. Il est à présumer que le village - si l'on peut dire - des hommes était séparé de celui des femmes. La plupart des parfaits comptaient parmi les hommes de la garnison des parents, des amis intimes; pendant le siège surtout, la vie de Montségur dut être celle d'une communauté unie pour le meilleur et pour le pire.
On imagine assez mal ce que peut être la vie d'un groupe de plusieurs centaines de personnes, dont près de la moitié sont des candidats au bûcher; même dans l'Église primitive les martyrs restaient de glorieuses exceptions, des héros vénérés entre tous. Pour les parfaits, le martyre était, dans certaines circonstances, une obligation absolue et d'avance assumée. Même s'ils avaient des doutes sur l'issue du siège - ils ont dû espérer jusqu'au dernier moment, - en regardant du haut de leur montagne le grouillement des masses de soldats éparpillées sur le col et dans la vallée, ils ont dû, pendant des mois, se préparer à mourir. Rien ne nous dit qu'ils aient été de purs esprits inaccessibles à la crainte ou à la douleur; ce qui est certain, c'est que la plupart restèrent là-haut, préférant sans doute un danger affronté en commun dans la prière et la libre profession de leur foi aux risques d'une vie solitaire, traquée et humiliée, avec le même bûcher au bout de la route.
Les défenseurs de Montségur espérèrent longtemps lasser la patience de leurs adversaires. L'hiver approchait; en montagne, octobre est déjà la mauvaise saison. Ce fut en octobre que les assiégeants purent enfin obtenir un succès qui sembla compromettre gravement les chances des assiégés. Hugues des Arcis engagea un détachement de routiers basques, montagnards hardis que le terrain de Montségur n'effrayait pas. Les Basques grimpèrent le long de la croupe de la montagne et prirent pied sur l'étroite plate-forme de la crête orientale, à quatre-vingts mètres en contrebas du château.
Il y eut sans doute des combats, car le sergent d'armes Guiraud Claret fut blessé mortellement fin octobre, et le chevalier Alzeu de Massabrac fut blessé également. Les Basques, assez nombreux, semble-t-il, tinrent bon, et les assiégés voyaient ainsi l'adversaire occuper une position avancée, presque à la hauteur du château, et contrôler la plus grande partie de la montagne et le seul chemin commode pour communiquer avec le dehors. (Il existait du reste d'autres chemins que les assiégés et leurs amis empruntèrent à maintes reprises, la paroi du mont, escarpée, rocheuse et couverte d'une forêt épaisse, étant pratiquement impossible à surveiller).
En novembre, l'armée assiégeante, dont le moral venait d'être quelque peu remonté par le succès des Basques, vit arriver de nouveaux renforts amenés par l'évêque d'Albi, Durand. Cet évêque était un prélat énergique, qui, par ses discours et son exemple, relevait le courage des soldats; de plus, et surtout, c'était un ingénieur habile, expert dans la construction de machines de guerre. Sous son impulsion, les soldats hissèrent, jusqu'à la plate-forme déjà occupée, des madriers et des poutres, et les tailleurs de pierre se mirent à l'œuvre pour préparer une provision considérable de boulets. La machine une fois montée, les Français purent bombarder la barbacane de bois qui, avançant sur la crête, protégeait les abords du château.
La situation des assiégés n'était pas encore désespérée: si l'ennemi pouvait, à présent, parvenir à hisser sur la crête des hommes et du matériel, et s'y établir solidement, l'espace qu'il occupait était étroit et dangereux, et ne permettait aucune manœuvre de grande envergure; les assiégés contrôlaient toujours le sommet de la montagne et pouvaient communiquer avec le dehors: ayant appris que l'évêque d'Albi avait construit une machine pour bombarder Montségur, les partisans des cathares - lesquels? la question a été discutée - dépêchèrent dans la citadelle assiégée un ingénieur, Bertrand de La Baccalaria, de Capdenac, qui, forçant le blocus, monta jusqu'au château et fit aussitôt élever, dans la barbacane de l'est, une machine qui pouvait répondre coup pour coup au tir de la pierrière de l'évêque. Sur le mince espace suspendu entre deux vides qu'ils occupaient, les uns et les autres, défenseurs et assaillants, étaient à peu près à égalité. Les assiégés avaient de plus l'avantage de pouvoir s'abriter dans le château, tandis que les Français campés sur la crête, autour de leur machine, souffraient du froid, de la neige et du vent, et il fallait sans doute beaucoup de courage à l'évêque Durand pour diriger le tir de sa machine et forcer ses hommes à tenir bon au milieu des bourrasques et des brouillards glacés. La fin décembre approchait, et les adversaires restaient toujours sur leurs positions d'octobre, les deux machines échangeant un tir plus ou moins serré de boulets.
Les croisés avaient sur les assiégés le considérable avantage de pouvoir sans cesse renouveler leurs effectifs de combattants; la garnison de Montségur avait déjà perdu plusieurs hommes; les renforts qu'elle recevait étaient minces - deux ou trois soldats de temps à autre; les hommes d'armes étaient harassés, excédés par un siège qu'ils soutenaient depuis des mois; si avantageuse que fût leur position, ils étaient une centaine contre six à dix mille; eux, personne ne pouvait les remplacer ni les relayer, ils étaient bloqués sur un espace ridiculement étroit, avec un grand nombre de femmes, de vieillards et autres non-combattants; et dans de telles conditions la vie en commun, même avec les plus saints hommes du monde, peut devenir intolérable.
Le courage de ces soldats n'était pas en cause, ils devaient tenir bon longtemps encore. Mais il faut croire que la lassitude commençait à les gagner; au cours de ces mois d'hiver P.-R. de Mirepoix envoya plusieurs fois des messagers au-dehors pour savoir "si le comte de Toulouse menait bien ses affaires183". La réponse, transmise, non par le comte, bien entendu, mais par des personnes qui étaient sans doute en rapport avec lui, était toujours affirmative. La garnison résistait. Ces "affaires" du comte désignaient-elles quelque future tentative de soulèvement qui permettrait à Raymond VII d'envoyer une armée pour dégager Montségur? S'agissait-il d'une négociation concernant plus précisément les hommes de Montségur? Toujours est-il que le comte demandait à ces hommes de tenir encore, bien que sa position officielle de persécuteur des hérétiques lui défendît tout rapport direct avec les assiégés.
Les parfaits, qui ne pouvaient faire grand-chose pour aider les soldats de la résistance desquels dépendait leur sort, faisaient, semble-t-il, leur possible pour adoucir un peu la rigueur de leur vie; du moins apprend-on que certains des chevaliers et même des sergents d'armes étaient invités dans les maisons des bons hommes, mangeaient avec eux, en recevaient des présents (ainsi la parfaite Raymonde de Cuq invitait chez elle Pierre-Roger de Mirepoix, le diacre R. de Saint-Martin recevait G. Adhémar, Raymond de Belvis, Imbert de Salas et l'ingénieur Bertrand de La Beccalaria; plus tard, l'évêque Bertrand Marty devait distribuer aux sergents du poivre et du sel184). Il est à supposer que même ceux des soldats qui n'étaient pas unis aux parfaits par des liens de parenté et d'amitié finissaient par se sentir rapprochés d'eux dans l'épreuve commune, et par les considérer un peu comme des membres de leur famille, et non comme des êtres supérieurs qu'il faut se contenter d'adorer: on ne peut "adorer" sans cesse des êtres que l'on côtoie vingt fois par jour. Certains des sergents de la garnison donneront plus tard une preuve décisive de leur attachement à la foi des bons hommes.
Certains, exténués par les rigueurs du siège, ont dû espérer le voir finir à n'importe quel prix: on sait qu'Imbert de Salas avait eu un entretien avec Hugues des Arcis lui-même, pourquoi, et dans quelles circonstances? Dans tous les cas P.-R. de Mirepoix le lui avait reproché, et pour le punir lui avait enlevé l'armure du chevalier Jordan du Mas, tué au cours d'un des combats près de la barbacane185. Le chef de la garnison avait ordonné à ses hommes de ne recevoir les croisés qu'à coups d'arbalète - ce qui prouve que les assaillants tentaient parfois d'établir des contacts, et n'étaient pas toujours mal reçus.
Le moral de la garnison était sérieusement atteint; il n'était cependant pas question de capituler, et la prise d'assaut semblait presque impossible. Vers la Noël, ou peu après la Noël, les assaillants marquèrent pourtant un progrès décisif: ils réussirent à s'emparer de la barbacane et se trouvèrent ainsi à quelques dizaines de mètres du château. En fait, le château lui-même leur demeurait presque aussi inaccessible qu'avant: pour y accéder il leur eût fallu passer sur un crête large de 1,5 m entre deux précipices. Mais du moins avaient-ils pu chasser les défenseurs de la barbacane, et y installer leur pierrière; à portée des boulets, les faces méridionale et orientale de la forteresse étaient exposées au tir, et les habitations qui les entouraient durent être évacuées. Les personnes qui les occupaient durent sans doute se réfugier à l'intérieur des murs, où elles n'avaient pratiquement pas de place pour se loger. Les assaillants contrôlaient à présent toute la montagne, ils étaient presque dans la place, la machine de l'évêque d'Albi battait le mur oriental sans répit ni trêve.
Comment les croisés parvinrent-ils à atteindre ainsi la tour (ou barbacane) de l'est séparée de leur avant-poste par un chemin difficile et bien défendu? Selon G. de Puylaurens, ils empruntèrent un passage pratiqué dans le rocher même; les soldats furent guidés par "une bande d'alertes montagnards du pays, armés à la légère et connaissant bien les lieux186"; il s'agissait donc d'un chemin secret, puisque les Basques, tout bons montagnards qu'ils étaient, ne l'avaient pas trouvé; ce n'était pas un sentier, mais une série d'anfractuosités de la roche reliées entre elles, sans doute, par quelques marches creusées dans la pierre, et ce passage ne devait être connu que par un assez petit nombre de personnes appartenant soit au village de Montségur, soit aux escortes de guides qui avaient l'habitude d'accompagner les parfaits dans leurs déplacements. Encore ce chemin ne devait-il pas être utilisé souvent: il grimpait, dit G. de Puylaurens, au-dessus de "précipices horribles"; et les soldats qui le franchirent de nuit devaient avouer plus tard que jamais, de jour, ils n'eussent osé s'y engager. Après avoir ainsi escaladé une muraille de rocher presque verticale, ils étaient parvenus à la barbacane, défendue par les assiégés, qui les laissèrent approcher sans méfiance, trompés peut-être par la voix des guides et croyant avoir affaire à des amis.
La tour de l'est fut donc enlevé par surprise: les sentinelles avaient eu le temps de donner l'alarme, mais les hommes qui venaient de gravir le chemin secret devaient être assez nombreux et d'une bravoure à toute épreuve. On ne sait quel était le nombre des soldats qui gardaient la barbacane, mais ils furent probablement tous massacrés avant que leurs compagnons du château aient eu le temps de se porter à leur secours. À présent, les croisés étaient bien maîtres de toute la montagne et pouvaient faire monter des troupes sur la crête sans craindre d'être repoussés: l'étroit passage qui séparait le château de la barbacane protégeait les assiégés mais ne leur permettait aucune manœuvre offensive. Il semble bien que cette fois-ci les défenseurs de Montségur aient été victimes d'une trahison; d'une demi-trahison tout au moins, les guides (achetés sans doute à prix d'or par les croisés) ayant certainement été des gens qui jouissaient de la confiance des assiégés; autrement, on ne comprendrait pas que le passage secret n'ait pas été révélé aux assiégeants quelques mois plus tôt.
À partir de ce jour seulement les défenseurs de Montségur semblèrent se rendre compte que la partie était perdue, à moins d'un miracle: c'est après la prise de la tour que les hérétiques Matheus et Pierre Bonnet sortirent de la forteresse, emportant avec eux de l'or, de l'argent et une grande quantité de monnaie, pecuniam infinitam187: le trésor qui devait être mis à l'abri. Imbert de Salas, lors de son interrogatoire, révéla plus tard que les deux hommes bénéficièrent de la complicité de soldats de l'armée assiégeante qui montaient la garde devant le dernier passage encore accessible aux assiégés: ces soldats se trouvaient être des hommes de Camon-sur-l'Hers, du fief de Mirepoix. L'évacuation du trésor n'en fut pas moins une opération des plus risquées, le passage qu'il fallait emprunter étant encore beaucoup plus difficile et plus dangereux que celui par lequel les croisés étaient montés la nuit de l'escalade. Si les défenseurs de Montségur ont attendu de n'avoir plus que ce chemin-là pour songer à mettre leur trésor à l'abri, c'est qu'avant ce jour, ils avaient dû croire que la place ne pouvait être prise. L'or et l'argent - une somme sans doute très importante - fut enfoui par les deux parfaits dans le bois des montagnes du Sabarthès, en attendant le jour où une cachette plus sûre pourrait être trouvée.
Le siège continuait. Une tentative des Français pour surprendre les assiégés fut aisément repoussée. Le mur oriental, court et exceptionnellement épais, ne pouvait être démoli ni même sérieusement entamé par la pierrière; Bertrand de La Baccalaria montait en tout hâte une nouvelle machine. Le parfait Matheus revint dans la place vers la fin janvier, amenant deux hommes d'armes avec des arbalètes; le renfort était maigre, mais c'était mieux que rien. Par le passage de la cheminée du Porteil (voir, pour ce qui concerne les détails de ce siège, l'analyse qu'en fait F. Niel dans son ouvrage Montségur, la Montagne inspirée), seuls, pouvaient se risquer des hommes adroits et intrépides; et pour aller s'enfermer dans la forteresse à un tel moment, il fallait un dévouement sans bornes à la cause de l'hérésie. Le même Matheus redescendra encore une fois chercher des renforts: il ne ramènera qu'un seul homme et des promesses qui ne se réaliseront pas, sans doute à cause de la vigilance accrue des troupes qui encerclaient la montagne.
Cependant, les assiégés espéraient encore: les sergents amenés par Matheus étaient-ils, selon la déposition d'Imbert de Salas, envoyés par Isam de Fanjeaux qui faisait dire à Pierre-Roger que le comte de Toulouse lui demandait de tenir bon jusqu'à Pâques? Ces deux hommes auraient prétendu que le comte s'apprêtait, avec le secours de l'empereur, à lever une armée pour venir dégager Montségur. Pierre-Roger de Mirepoix pouvait-il croire à une promesse aussi vague et aussi peu réalisable? Il semble plutôt que les dires de Matheus et des deux hommes d'armes aient été destinés à relever le moral de la garnison. Mais le comte avait ses raisons pour demander aux hommes de Montségur de tenir le plus longtemps possible. La deuxième tentative de Matheus eût pu se solder par un succès réel: il avait persuadé deux seigneurs du pays, Bernard d'Alion et Arnaud d'Usson, de se mettre en rapport avec un homme capable de sauver la situation. Les deux chevaliers promirent cinquante livres melgoriennes à un chef de routiers aragonais, nommé Corbario, s'il amenait à Montségur vingt-cinq sergents d'armes; il devait s'agir évidemment d'un corps d'élite, de ces Aragonais rompus à tous les métiers de la guerre et dont chacun valait un chevalier. Ces hommes eussent été capables, avec l'aide de la garnison, de chasser les Français de la position avancée qu'ils occupaient et d'incendier leur machine. Mais Corbario ne put franchir les lignes toujours plus denses de l'armée assiégeante: cette fois-ci Montségur était bel et bien coupé du monde extérieur et n'avait plus à compter sur personne.
Le château tint encore tout le mois de février. G. de Puylaurens écrit: "On ne laissera aucun repos aux assiégés, ni de jour et de nuit188". La pierrière tirait toujours, rendant impossible la construction d'ouvrages défensifs sur le mur bombardé; à l'intérieur de la forteresse, le manque de place devait rendre intenable la vie de centaines de personnes littéralement entassées les unes sur les autres. Ce qui paraît curieux, c'est que jusqu'au bout la plupart des défenseurs - du moins parmi les chefs - aient eu leurs "maisons". Une grande partie de ces maisons devait encore se trouver en dehors des murs, sur les faces septentrionale et occidentale, inaccessibles au tir des boulets. Mais, tel que nous le voyons aujourd'hui, l'espace qui sépare le mur du château de la paroi verticale de la falaise est extrêmement réduit et descend en pente raide; il est vrai qu'aujourd'hui encore, on voit des villages de montagne perchés sur des parois presque verticales, mais à Montségur on ne trouve pas trace de maisons creusées dans le roc et de construction en pierre, à part des vestiges d'un mur d'enceinte assez rudimentaire qui servait sans doute à soutenir la palissade de pieux. C'est sur cette pente nue et glacée, dans de minuscule cabanes en bois sans doute impossibles à chauffer, ou dans le château où les quelques habitations collées aux entrepôts et à la citerne abritaient les vieux, les malades, les blessés, que les défenseurs de Montségur passèrent l'hiver, sous le fracas sans cesse renouvelé du boulet qui venait frapper la muraille.
D'accord avec l'évêque Bertrand et Raymond de Perella, Pierre-Roger de Mirepoix décida d'effectuer une sortie nocturne, pour tenter de s'emparer de la barbacane, d'en déloger les croisés et d'incendier leur machine. Les hommes de la garnison réussirent, en rampant le long des pentes dominées par la crête, à s'approcher du campement de l'ennemi. Ils furent repoussés, la tentative était désespérée; dans ce combat engagé sur une pente raide au-dessus des abîmes, un grand nombre des assiégés durent périr, précipités en bas des falaises; les autres durent battre en retraite, sur le très étroit passage qui séparait la barbacane du château, traînant les blessés et repoussant l'ennemi qui tentait de profiter de la situation pour forcer les dernières défenses du château.
Pendant que les blessés et les mourants étaient déposés en toute hâte sur les premiers lits disponibles, dans les cabanes les plus proches, le reste de la garnison courait sur le mur et aux palissades pour repousser les croisés qui avaient déjà pris pied sur la plate-forme du château. Les femmes et filles de chevaliers - Corba, femme de Raymond de Perella, Cecilia, femme d'Arnaud-Roger de Mirepoix, Philippa, femme de Pierre-Roger, Arpaïs de Ravat, Fays de Plaigne, Braïda de Mirepoix, Adalays de Massabrac et d'autres - sollicitent en hâte la convenensa et courent aider les hommes à défendre le château189.
L'évêque et les diacres, dans le tumulte, le bruit des armes, les gémissements des blessés, n'avaient que le temps de passer d'un mourant à un autre pour administrer les derniers sacrements; Bernard Roainh, le Catalan Pierre Ferrier, le sergent Bernard de Carcassonne, Arnaud de Vensa moururent "consolés" cette nuit-là190. Dans un dernier sursaut d'énergie, la garnison réussit à repousser les assaillants, qui se replièrent vers la barbacane. Étant donné la situation de ce champ de bataille suspendu dans le vide, le nombre des morts dut être plus grand que celui des blessés qui purent atteindre le château.
Au lendemain de cette nuit tragique, le cor sonna sur le mur de la forteresse. Raymond de Perella et Pierre-Roger de Mirepoix demandaient à négocier.
II - LE BÛCHER
Les pourparlers commencèrent le 1 mars 1244. Après plus de neuf mois de siège, Montségur capitulait. Excédés eux aussi par ce siège trop long, les croisés ne discutèrent pas longtemps. Les conditions de la capitulation étaient les suivantes:
1° Les défenseurs garderaient la place pendant quinze jours encore et livreraient des otages.
2° Ils obtenaient le pardon pour toutes leurs fautes passées, y compris l'affaire d'Avignonet.
3° Les hommes d'armes se retireraient avec armes et bagages, mais devraient comparaître devant les inquisiteurs en vue d'une confession de leurs fautes. Ils ne seraient passibles que de pénitences légères.
4° Toutes les autres personnes se trouvant dans la citadelle demeureraient libres et ne seraient soumises qu'à des pénitences légères, moyennant abjuration de l'hérésie et confession devant les inquisiteurs. Celles qui n'abjureraient pas seraient livrées au bûcher.
5° Le château de Montségur serait rendu au roi et à l'Église.
En somme, ces conditions étaient bonnes; il eût été difficile d'en obtenir de meilleures: grâce à leur héroïque résistance, les hommes de Montségur échappaient à la mort et leurs proches à la prison perpétuelle. Les auteurs du massacre d'Avignonet se voyaient garantir non seulement la vie sauve mais la liberté.
Comment l'Église - en la personne de ses représentants qui participaient au siège - a-t-elle pu consentir à absoudre un crime aussi grand, alors que le châtiment des assassins de Guillaume-Arnaud devait lui paraître aussi important que celui des hérétiques? Il semble pourtant que si les deux parties étaient tombées d'accord si vite sur ce point, c'est que le terrain était déjà préparé. Les messages à plusieurs reprises échangés entre le comte de Toulouse et les assiégés de Montségur devaient concerner, entre autres, l'affaire d'Avignonet.
En effet, à l'époque du siège, le comte était en pourparlers avec le pape en vue de faire lever son excommunication qu'il avait encourue au lendemain de ce crime dont il se proclamait innocent. Ce fut vers la fin de 1243 que le pape Innocent IV révoqua la sentence d'excommunication de Frère Ferrier, en déclarant que le comte de Toulouse était son "fils fidèle et catholique". L'excommunication lancée par l'archevêque de Narbonne devait être levée le 14 mars 1244, deux jours avant la prise de possession de Montségur par l'armée royale. Cette coïncidence de dates est peut-être fortuite; mais il est possible qu'il ait existé un rapport étroit entre les démarches du comte et le sort des hommes de Montségur et, en particulier, de P.-R. de Mirepoix qui s'intéressait tant à la bonne marche des affaires du comte de Toulouse. Le comte aurait conseillé aux assiégés de tenir bon, non dans l'intention d'amener des renforts (il est évident qu'il n'y songeait guère), mais dans l'intention d'obtenir le pardon total de l'affaire d'Avignonet. Les dépositions des gens de Montségur devaient compromettre beaucoup de personnes du dehors (en plus du comte lui-même), et ces personnes ne furent jamais inquiétées.
D'autre part, les mérites personnels des défenseurs et la nécessité d'en finir avec un siège qui, si la grâce était refusée, pouvait durer encore, avaient pu engager Hugues des Arcis et ses chevaliers à faire pression sur l'archevêque et sur Frère Ferrier. Le crime politique qu'était le meurtre des inquisiteurs ne devait pas être réprouvé outre mesure par les Français, qui commençaient peut-être à comprendre la situation du pays et les sentiments de la population indigène. Les soldats de Montségur n'étaient plus que des hommes qui avaient vaillamment combattu et qui avaient droit au respect de l'adversaire.
Une trêve était accordée à Montségur; quinze jours, pendant lesquels la forteresse déjà rendue refusait encore à l'ennemi l'accès de ses portes. Quinze jours pendant lesquels, sur la foi de la parole donnée, les deux adversaires resteraient sur leurs positions, sans chercher à attaquer ni à fuir. La machine de l'évêque Durand s'était tue, les sentinelles n'avaient plus à guetter sur les remparts; les soldats n'avaient plus à vivre dans l'attente perpétuelle d'une alerte. Montségur allait passer ses derniers jours de liberté dans la paix - si l'on peut appeler paix une attente de la séparation et de la mort, sous le regard vigilant de l'ennemi posté dans sa tour à moins de cent mètres du château.
À côté des heures tragiques qu'ils venaient de vivre c'était, pour les habitants de Montségur, la paix; pour beaucoup, un dernier répit. On a pu se demander pourquoi les assiégés exigèrent ce délai, qui prolongeait inutilement une existence devenue intenable. Peut-être cette demande s'explique-t-elle par le fait que l'archevêque de Narbonne et Frère Ferrier ne pouvaient prendre sur eux la responsabilité d'absoudre les assassins des inquisiteurs et ont jugé nécessaire de s'en référer au pape? Il est plus probable que le délai ait été demandé par les assiégés eux-mêmes, dans le but de rester encore avec ceux des leurs qu'après la reddition du château ils ne devaient plus revoir. Il est très probable (comme le suggère F. Niel) que l'évêque Bertrand Marty et ses compagnons aient voulu, avant de mourir, célébrer une dernière fois la fête qui correspondait pour eux à celle de Pâques. On sait que les cathares célébraient cette fête, puisqu'un de leurs grands jeûnes précédait justement Pâques.
Faut-il croire que sous ce nom ils désignaient la fête manichéenne de la Bema, qui se situait à peu près à la même époque de l'année? Aucun document ne permet de l'établir avec certitude et, comme nous l'avons vu, le rituel cathare qui cite avec tant d'insistance et si abondamment les Évangiles et les Épitres, ne mentionne pas une seule fois le nom de Manès. Cette religion aurait-elle eu deux enseignements distincts et le consolamentum, tenu pour le sacrement suprême, ne serait-il qu'une manifestation de piété réservée aux non-initiés? Il semble assez difficile de l'admettre; le catharisme, manichéen par sa doctrine, était profondément chrétien quant à la forme et à l'expression de sa pensée. Les cathares vénéraient trop exclusivement le Christ pour pouvoir accorder dans leur culte une place importante à Manès. Cependant, on manque de données qui pourraient faire comprendre ce que représentait exactement pour eux la célébration de la fête de Pâques, ou celle de la Bema.
Il est vraisemblable aussi, et humain, qu'avant de se séparer à jamais, les uns et les autres aient voulu s'accorder ce répit suprême. Ce n'était vraiment pas trop. Et il était sans doute difficile d'obtenir davantage.
Des otages furent livrés, dans les premiers jours de mars. C'étaient, comme il ressort des interrogations, Arnaud-Roger de Mirepoix, vieux chevalier, parent du chef de la garnison; Jordan, fils de Raymond de Perella; Raymond Marty, frère de l'évêque Bertrand; d'autres dont on ignore les noms, la liste des otages n'ayant pas été retrouvée.
Certains auteurs ont cru que Pierre-Roger de Mirepoix lui-même se serait retiré du château avant la fin de la trêve, voire avant la signature de l'acte de capitulation. Cette supposition n'est guère vraisemblable, puisque d'après la déposition d'Alzeu de Massabrac, Pierre-Roger se trouvait encore dans la forteresse le 16 mars. On sait qu'ensuite il se retira à Mongaillard, puis on perd sa trace, pour dix ans. Le silence qui s'est fait autour de son nom a peut-être contribué à le faire accuser sinon de trahison, du moins de désertion? Il est pourtant logique de penser que les vainqueurs devaient trouver gênante la présence du principal auteur du coup d'Avignonet, et qu'ils lui aient demandé de s'éclipser avec le maximum de discrétion: l'homme qui avait manifesté un si vif désir de boire du vin dans le crâne de Guillaume-Amaud ne pouvait bénéficier que d'une grâce accordée pour ainsi dire à la sauvette. Onze ans plus tard, il est mentionné par les enquêteurs royaux comme "faidit et dépossédé pour avoir été fauteur et défenseur d'hérétiques au château de Montségur". Il ne devait réintégrer ses droits civils qu'en 1257. Il est donc difficile de croire que cet homme ait, d'une façon quelconque, pactisé avec l'ennemi.
Pierre-Roger de Mirepoix et son beau-père Raymond de Perella restèrent donc dans la place jusqu'à la fin de la trêve, avec la majorité de la garnison, leurs familles, et les hérétiques - ceux qui ne voulaient pas abjurer leur foi et devaient, suivant les clauses de la capitulation, être livrés au bourreau. Les quinze jours durent être consacrés à des cérémonies religieuses, à la prière et aux adieux.
De la vie des habitants de Montségur durant cette quinzaine tragique, nous ne connaissons que ce que les inquisiteurs ont bien voulu demander aux témoins qu'ils interrogèrent par la suite: des détails précis, dépouillés, dont la sécheresse voulue ne parvient pas à cacher l'émouvante grandeur. D'abord le dernier partage des biens de ceux qui allaient mourir: en reconnaissance pour son dévouement les hérétiques Raymond de Saint-Martin, Amiel Aicart, Clamens, Taparell et Guillaume Pierre apportèrent à Pierre-Roger de Mirepoix une couverture pleine de deniers. Au même Pierre-Roger, l'évêque Bertrand Marty donna de l'huile, du poivre, du sel, de la cire, et une pièce d'étoffe verte: cet austère vieillard ne possédait sans doute pas d'objets plus précieux. C'est encore à Pierre-Roger de Mirepoix que les hérétiques attribuèrent une grande quantité de blé et cinquante pourpoints pour ses hommes. La parfaite Raymonde de Cuq donna une arche de froment à Guillaume Adhémar, sergent d'armes (les provisions déposées dans la forteresse étaient donc bien considérées comme appartenant à l'Église cathare et non aux propriétaires du château)191.
La vieille Marquesia de Lantar donna tous ses effets à sa petite-fille Philippa, femme de Pierre-Roger. D'autres hérétiques donnaient aux soldats quelques sous melgoriens, de la cire, du poivre, du sel, une paire de souliers, une bourse, des braies, du feutre192... tout ce que les bons hommes possédaient encore; et certains de ces objets devaient sans doute avoir surtout une valeur de reliques.
Les dépositions relatent ensuite les cérémonies auxquelles les témoins assistèrent ces jours-là - les seules sur lesquelles on leur ait demandé des détails - les consolamenta. En ces jours où le fait d'entrer dans l'Église cathare signifiait une mort certaine et imminente, il se trouva au moins dix-sept personnes assez croyantes pour aspirer à cette faveur. Ils étaient six femmes, et onze hommes, tous chevaliers ou sergents d'armes.
L'une de ces femmes était l'épouse du seigneur de Montségur, Corba de Perella. Corba, fille de la parfaite Marquesia, mère d'une enfant infirme et probablement déjà "consolée", devait s'être depuis longtemps préparée à ce pas décisif; elle le franchit le dernier jour, l'avant-veille de la fin de la trêve, abandonnant son mari, ses deux filles mariées, ses petits-enfants, son fils, dont la présence l'avait sans doute retenue jusque-là et auxquels elle préférait à présent le martyre pour sa foi193. Ermengarde d'Ussat était une noble femme de la région, Guillelme, Bruna et Arssendis étaient des femmes de sergents (les deux dernières devaient monter au bûcher en même temps que leurs maris, eux aussi volontaires de la onzième heure); ce n'étaient pas de vieilles femmes, les sergents d'armes étaient en général jeunes. Guillelme de Lavelanet était peut-être âgée, puisqu'elle était la femme du chevalier Bérenger de Lavelanet.
Parmi les hommes qui avaient reçu le consolamentum pendant la trêve figuraient deux chevaliers: Guillaume de l'Isle - grièvement blessé quelques jours plus tôt - et Raymond de Marciliano. Les sergents d'armes Raymond-Guillaume de Tornaboïs, Brasillac de Calavello (tous deux avaient participé au massacre d'Avignonet), Arnaud Domerc (mari de Bruna), Arnaud Dominique, Guillaume de Narbonne, Pons Narbona (mari d'Arssendis), Johan Reg, Guillaume du Puy, Guillaume-Jean de Lordat, enfin Raymond de Belvis et Arnaud Teouli entrés à Montségur au moment où la situation de la citadelle était déjà désespérée, et qui semblent n'y être venus au prix de tant dangers que pour devenir martyrs. Tous ces soldats qui pouvaient quitter le château avec les honneurs de la guerre et la tête haute ont préféré s'en laisser chasser comme des bêtes pour être parqués sur des fagots de bois sec et brûler vifs à côté de leurs maîtres dans la foi.
Sur ces derniers, nous ne savons pas grand-chose - à part le fait que l'évêque Bertrand, Raymond de Saint-Martin, Raymond Aiguilher accordèrent le consolamentum aux personnes qui l'avaient demandé, et distribuèrent leurs biens. Les parfaits et les parfaites étaient au nombre de 190 environ, puisque l'on sait que les hérétiques brûlés à Montségur étaient près de 210 ou 215; et les noms des personnes que l'on peut citer de façon certaine sont presque tous des noms de simples croyants, de ceux qui s'étaient convertis au dernier moment.
Il est assez émouvant de constater que, de ce qui restait de la garnison, un bon quart étaient des hommes prêts à mourir pour leur foi, non pas dans un sursaut d'enthousiasme, mais après des jours et des jours de consciente préparation. Les martyrs d'une religion vaincue ne sont pas canonisés; mais ces hommes et ces femmes dont le nom ne fut enregistré que dans le but de porter sur la liste noire ceux qui assistèrent à leur initiation, méritent pleinement le titre de martyrs.
Parmi les parfaits enfermés dans la place au moment de la capitulation, trois au moins échappèrent au bûcher. Ce fait constituait une violation des accords conclus; il ne fut du reste connu qu'après l'occupation du château par les Français: dans la nuit du 16 mars Pierre-Roger faisait évader, au moyen de cordes suspendues au-dessus de la falaise occidentale, les hérétiques Amiel Aicart et son compagnon Hugo Poitevin et un troisième homme dont le nom est resté inconnu, peut-être un guide de montagne. Pendant que les croisés entraient dans Montségur, ces hommes étaient restés cachés dans un souterrain et échappèrent ainsi au sort de leurs frères; ils devaient mettre à l'abri ce qui restait dans le château du trésor des hérétiques, et retrouver la cachette où était enfoui l'argent qu'ils avaient évacué deux mois plus tôt. En effet, P.-R. De Mirepoix et ses chevaliers quittèrent le château les derniers, après les parfaits, et après les femmes et les enfants; ils devaient donc, jusqu'à un certain point, rester maîtres de la place. L'évasion, semble-t-il, réussit pleinement, puisque ni les trois hérétiques ni le trésor ne furent découverts par les autorités.
"Lorsque les hérétiques sortirent du château de Montségur qui devait être rendu à l'Église et au roi, Pierre-Roger de Mirepoix retint dans ledit château Amiel Aicart et son ami Hugo, hérétiques; et dans la nuit pendant laquelle les autres hérétiques furent brûlés, il cache lesdits hérétiques; et il les fit évader; et cela fut accompli afin que l'Église des hérétiques ne perde pas son trésor qui était caché dans les forêts; et les fugitifs connaissaient la cachette...194" B. de Lavelanet dit aussi que l'on aurait descendu sur des cordes A. Aicart, Poitevin et deux autres, qui étaient restés cachés sous terre pendant que les croisés entraient dans le château. Montségur tombé, l'Église cathare continuait la lutte.
À part ces trois (ou quatre) hommes chargés d'une importante et dangereuse mission, aucun des parfaits ne put et peut-être ne voulut fuir le bûcher. La trêve expirée, le sénéchal et ses chevaliers accompagnés par les autorités ecclésiastiques, se présentaient à la porte du château. L'archevêque de Narbonne était rentré chez lui avant la fin de la trêve. L'Église était représentée sur les lieux par l'évêque d'Albi, et les Frères Ferrier et Duranti, inquisiteurs; la tâche des Français était terminée, ils avaient promis la vie sauve aux combattants; le sort des défenseurs de Montségur ne dépendait plus que du tribunal ecclésiastique.
Raymond de Perella, en livrant la place, livrait aux bourreaux sa femme et sa plus jeune fille; la loi qui depuis des siècles vouait au feu les hérétiques impénitents était si bien acceptée par tous que les pères, époux, frères ou fils qui devaient être séparés des leurs d'une façon aussi brutale ne pouvaient y voir que l'effet d'une aveugle fatalité, le résultat logique d'une défaite. Comment se fit le triage de ceux pour lesquels il ne pouvait y avoir de pardon? Ils se désignèrent probablement eux-mêmes, se séparant des autres. Dans les circonstances où ils se trouvaient il était bien inutile de les faire passer par des interrogatoires serrés dans le but de leur faire avouer ce qu'ils n'avaient nulle intention de nier.
Guillaume de Puylaurens écrit: "On les invita vainement à se convertir195". Par qui et comment y furent-ils invités? Il est probable que les deux cents et quelque hérétiques formaient un groupe à part, que les inquisiteurs et leurs aides firent sortir du château afin de les admonester, au moins pour la forme. La veille, Philippa de Mirepoix et Arpaïs de Ravat, les filles de Corba de Perella, firent leurs adieux à leur mère, qui venait d'accéder - pour un temps si court - à la dignité de parfaite. L'une des jeunes femmes, Arpaïs, sans oser entrer dans les détails, laisse deviner l'horreur de ce moment où sa mère, avec tous les autres, fut emmenée vers la mort: "...ils furent brutalement chassés du château de Montségur...196"
À la tête des condamnés se trouvait évidemment l'évêque Bertrand Marty. Les hérétiques furent enchaînés et traînés sans ménagements le long de la pente qui séparait le château de l'endroit où avait été préparé le bûcher.
Devant Montségur, sur la face sud-ouest du mont - la seule qui soit d'accès praticable - se trouve un espace découvert appelé aujourd'hui le champ des "Cramatchs" ou des crémats (des brûlés). Cet endroit se trouve à moins de deux cents mètres du château, et la pente à descendre est assez raide. G. de Puylaurens dit que les hérétiques furent brûlés "tout près au pied de la montagne", il est probable que ce fut au champ des Cramatchs.
Pendant que là-haut les parfaits se préparaient à la mort et disaient adieu à leurs amis, une partie des sergents du camp français avait été employée pour le dernier travail de ce siège: l'élévation d'un bûcher suffisant pour consumer les corps de deux cents personnes - le nombre approximatif des condamnés devait être connu d'avance. "On éleva, dit G. de Puylaurens, une palissade de pals et de pieux197", ceci pour délimiter le bûcher; à l'intérieur, d'innombrables fagots de bois, peut-être de la paille et de la résine, car au mois de mars le bois mort devait être humide et difficile à faire flamber. Pour une telle quantité de victimes on n'avait probablement pas eu le temps de dresser des poteaux pour y attacher les condamnés un par un; en tout cas G. de Puylaurens se contente de dire qu'on les enferma dans la palissade.
Les malades et les blessés durent être simplement jetés sur les fagots, les autres purent peut-être chercher à se rapprocher de leurs socii, de leurs parents... peut-être la dame de Montségur put-elle mourir aux côtés de sa vieille mère et de sa fille malade, les deux femmes de sergents d'armes à côté de leurs maris. Peut-être l'évêque put-il, au milieu des gémissements, du bruit des armes, des cris des bourreaux qui allumaient le feu aux quatre coins de la palissade, du chant des cantiques entonnés par les clercs, adresser à ses fidèles quelques dernières exhortations. Une fois les flammes bien prises, bourreaux et soldats durent se retirer à une certaine distance, pour ne pas souffrir de la fumée et de la chaleur répandues par l'immense bûcher. En quelques heures les deux cents torches vivantes entassées dans la palissade ne furent plus qu'un amas de chairs noircies, rougies, sanglantes, se calcinant toujours les unes contre les autres, et répandant une atroce odeur de brûlé dans toute la vallée et jusqu'aux murs du château.
Les défenseurs restés dans la citadelle pouvaient voir, d'en haut, les flammes du bûcher monter, grandir, et s'éteindre peu à peu faute de nourriture, et les épaisses fumées noirâtres couvrir la montagne; la fumée, âcre, nauséabonde, devait épaissir pendant que les flammes diminuaient. Dans la nuit le brasier devait encore achever de se consumer, lentement; éparpillés sur la montagne les soldats, assis autour des feux devant leurs tentes, devaient encore voir, de loin, frémir les braises rouges sous la fumée. Cette nuit-là, les quatre hommes dépositaires du trésor descendaient sur des cordes le long de la paroi rocheuse, presque en face du champ où se mourait l'immense feu nourri de chair humaine.
182 Doat, t. XXIV, 44, déposition de R. de Perella; Ibid., f° 58,
183 Doat, t. XXIV, pp. 170-171, 181.
184 Doat, t. XXIV, p. 180.
185 Id., p. 174.
186 Guillaume de Puylaurens, ch. XXXXVI.
187 Doat, t. XXIV, p. 172, déposition d'Imbert de Salas.
188 Guillaume de Puylaurens, ch. XXXXVI.
189 Doat, t. XXII, p. 263, t. XXIV, pp. 202-203, 207.
190 Doat, t. XXIV, p. 80; t. XXII, p. 255; t. XXII, p. 247; t. XXIV, p. 207.
191 Au sujet de ces dons, voir Doat, t. XXIV, p. 173.
192 Au sujet de ces dons, voir Doat, t. XXIV, pp. 180, 200.
193 On croit que Corba, à cette date, était peut-être malade, et déjà mourante. Parmi les hommes d'armes, il y avait sans doute aussi des blessés graves.
194 Témoignage d'A.-R. de Mirepoix, sur les dires d'Alzeu de Massabrac, Doat, t. XXII, p. 129.
195 Guillaume de Puylaurens, ch. XLVI.
196 Déposition d'Arpaïs de Ravat. Doat, t. XXII, p. 259.
197 Guillaume de Puylaurens, ch. XLVI.
CONCLUSION
Cinq ans après la chute de Montségur, Raymond VII mourait, sans fils légitime, à l'âge de cinquante-deux ans. Le comté de Toulouse passait aux mains d'Alphonse de Poitiers, mari de la comtesse Jeanne, fille unique du comte. Le couple mourut en 1271, sans laisser de postérité. Ces deux morts rattachaient définitivement à la couronne de France un pays qui depuis vingt ans était déjà en fait une province française, dans le sens ancien et traditionnel du mot province: un pays d'importance secondaire, colonisé, exploité, administrativement et intellectuellement dominé par une métropole puissante et soucieuse de ses propres intérêts.
Alphonse de Poitiers, en vingt-deux ans, ne se rendit à Toulouse que deux fois: en 1251, le jour où il vint recevoir l'hommage de ses nouveaux vassaux, et en 1270, un an avant sa mort. Ce bon administrateur s'occupa surtout d'organiser un système fiscal serré et efficace qui lui permit de prélever sur ses domaines les sommes dont il avait besoin pour la réalisation de ses desseins politiques, ou plutôt de ceux de son frère: pour saint Louis, la reconquête de la Terre Sainte restait le premier objectif de la politique française. Il faut croire qu'Alphonse ne prit jamais vraiment au sérieux son titre de comte de Toulouse et ne fut qu'un exécuteur fidèle des volontés de son frère. Le peuple qui, en 1249, suivait en pleurant le cercueil de Raymond VII, de Millau à Fontevrault, savait qu'il pleurait la fin de son existence nationale.
Quelques mois avant sa mort, le comte avait fait brûler à Agen quatre-vingts hérétiques, ou personnes suspectes d'hérésie, après un jugement sommaire que les inquisiteurs eux-mêmes ne se fussent pas permis. Sans doute par cet acte de violence pensait-il gagner les bonnes grâces de l'Église; mais peut-être aussi voulait-il faire expier aux hérétiques le malheur qu'ils avaient attiré sur son pays. La mesure était comble; lassé par les persécutions, les humiliations, démoralisé par l'étouffement progressif des forces vives du pays, le peuple occitan - du moins ses classes privilégiées, celles qui avaient le plus à perdre - abandonnait la religion cathare et se rangeait, amer et résigné, du côté des vainqueurs.
Le Languedoc était réuni à la France; il est assez vain de se demander si cette réunion, commandée somme toute par la situation géographique et politique du pays, n'eût pas pu se faire d'une manière moins brutale. Existait-il réellement, entre les hommes du Nord et ceux du Midi, une telle incompatibilité d'intérêts et de pensée que seule la plus cruelle des guerres de conquête était capable d'amener cette union entre Français? Avant 1209, il y avait peut-être une incompréhension réciproque, mais pas de haine. Après la mort de Raymond VII, un peuple las de haïr et de souffrir se résigna peu à peu - quoique non sans mal, ni sans révoltes - à voir son langage devenir un patois.
Qui a jamais calculé ce que perd un peuple en perdant son indépendance, et comment tracer la limite entre les particularismes régionaux et les légitimes aspirations nationales? En définitive, la raison du plus fort finit toujours par paraître la meilleure, ce qui est étant toujours plus réel que ce qui eût pu être.
La royauté française sortait de l'épreuve plus forte, plus consciente que jamais de son droit divin; elle allait bientôt tenir tête à la papauté qui l'avait servie et s'était servie d'elle. Afin d'extirper l'hérésie, l'Église s'était exposée au danger de voir son trop puissant allié empiéter sur sa puissance temporelle.
Ce danger-là, l'Église catholique ne l'avait certes pas ignoré: ses luttes contre l'Empire et sa toute récente expérience avec Frédéric II le lui avaient fait mesurer pleinement; le péril que représentait à ses yeux l'hérésie était plus terrible encore. Mais si, grâce à l'Inquisition, la papauté finit par avoir raison du catharisme, puis des divers autres mouvements hérétiques qui surgirent aux XIIIe et XIVe siècles, cette victoire devait lui coûter cher. La gifle d'Anagni ne devait pas atteindre l'Église dans sa dignité essentielle, elle ne fut qu'un des épisodes de l'incessant combat que l'Église était obligée de mener pour la sauvegarde de son indépendance matérielle et morale. Mais le régime de terreur policière que l'Inquisition sut, pendant plusieurs siècles, imposer aux peuples d'Occident, allait saper de l'intérieur l'édifice de l'Église et amener un abaissement terrible du niveau moral de la chrétienté et de la civilisation catholiques.
Avant la croisade des Albigeois, avant l'Inquisition, des voix d'évêques et d'abbés s'élevaient encore pour protester contre les bûchers d'hérétiques, pour prêcher la miséricorde envers les frères égarés; au XIIIe siècle, saint Thomas d'Aquin trouve, pour justifier ces mêmes bûchers, des paroles inadmissibles dans la bouche d'un chrétien. Des excès que l'on pouvait, autrefois, imputer à l'ignorance et à la rudesse des mœurs de l'époque, étaient à présent approuvés, consacrés en chaire de théologie par un des plus grands philosophes de la chrétienté. Ce fait est trop grave pour être minimisé: à partir du XIIIe siècle, il n'y eut plus, dans l'Église catholique, de saints ni de docteurs assez hardis pour proclamer qu'un homme qui se trompe en matière de religion est (comme le disait par exemple au XIIe siècle sainte Hildegarde198) une créature de Dieu, et qu'il est criminel de lui ôter la vie. L'Église qui oubliait aussi résolument cette vérité pourtant si simple ne méritait plus le nom de catholique, et dans ce sens on peut dire que l'hérésie avait porté à l'Église un coup dont celle-ci ne devait pas se remettre.
La victoire était trop chèrement payée: si même (ce qui n'est pas sûr) l'Église romaine, en sévissant comme elle l'a fait contre l'hérésie, a épargné à la chrétienté occidentale des troubles graves qui eussent peut-être amené la ruine de tout l'édifice social et culturel, elle n'y est parvenue qu'au prix d'une capitulation morale dont aujourd'hui encore elle subit les conséquences.

198 In Hildeg. Epist. 139.
APPENDICES
I
RITUEL CATHARE
Version abrégée de la traduction du Rituel par L. Clédat. On en trouvera le texte intégral dans son édition du Nouveau Testament traduit au XIII e siècle en langue provençale (reproduction photographique du manuscrit conservé à la bibliothèque municipale du palais Saint-Pierre à Lyon, dans le tome IV de la Bibliothèque de la Faculté des lettres de Lyon).
ADMISSION D'UN CROYANT AU RANG DE CHRÉTIEN.
Si un croyant199 est en abstinence200 et si les chrétiens201 sont d'accord pour lui livrer oraison, qu'ils se lavent les mains, et les croyants, s'il y en a, également. Et puis que l'un des bons hommes, celui qui est après l'ancien, fasse trois révérences à l'ancien, et puis qu'il prépare une table, et puis [qu'il fasse] trois autres [révérences]. Et puis qu'il dise: Benedicite parcite nobis. Et puis que le croyant fasse son melioramentu m 202 et prenne le livre de la main de l'ancien. Et l'ancien doit l'admonester et le prêcher avec témoignages convenables203...
Et puis que l'ancien dise l'oraison et que le croyant la suive. Et puis que l'ancien dise [au croyant]: "Nous vous livrons cette sainte oraison, pour que vous la receviez de Dieu et de nous et de l'Église, et que vous ayez pouvoir de la dire tout le temps de votre vie, de jour et de nuit, seul et en compagnie, et que jamais vous ne mangiez ni ne buviez, sans dire premièrement cette oraison. Et si vous y manquiez, il faudrait que vous en portassiez pénitence". Et il [le croyant] doit dire: "Je la reçois de Dieu et de vous, et de l'Église". Et puis qu'il fasse une melioramentum et qu'il rende grâce, et puis que les chrétiens fassent une double 204, avec veniae205, et le croyant après eux.
OCTROI DU "CONSOLAMENTUM".
Et s'il [le croyant qui vient d'être reçu chrétien] doit être consolé sur-le-champ, qu'il fasse son melioramentum et qu'il prenne le livre de la main de l'ancien. Et l'ancien doit l'admonester et le prêcher avec témoignages convenables et avec telles paroles qui conviennent à un consolamentum 206...
Et qu'il dise: "J'ai cette volonté, priez Dieu pour moi qu'il m'en donne sa force". Et puis que l'un des bonshommes fasse son melioramentum avec le croyant, à l'ancien et qu'il dise: "Parcite nobis. Bons chrétiens, nous vous prions par l'amour de Dieu que vous accordiez de ce bien que Dieu vous a donné à notre ami ici présent". Et puis que le croyant fasse son melioramentum, et qu'il dise: "Parcite nobis. Pour tous les péchés que j'ai pu faire ou dire, ou penser, ou opérer, je demande pardon à Dieu, et à l'Église et à vous tous". Et que les chrétiens disent: "Par Dieu et par nous et par l'Église qu'ils vous soient pardonnés, et nous prions Dieu qu'il vous les pardonne". Et puis, ils doivent le consoler. Et que l'ancien prenne le livre et le lui mette sur la tête et les autres bons hommes chacun la main droite, et qu'ils disent les parcias207 et trois Adoremus208, et puis: Pater sancte suscipe servum tuam in tua justitia et mite gratiam tuam et spiritum sanctum tuam super eum. Et qu'ils prient Dieu avec l'oraison, et celui qui conduit le service divin doit dire à voix basse la sixaine209 et quand la sixaine sera dite, il doit dire trois Adoremus et l'oraison une fois à haute voix, et puis l'évangile. Et quand l'évangile est dit, ils doivent dire trois Adoremus et la gratia et les parcias. Et puis, ils doivent faire la paix210 entre eux et le livre211. Et s'il y a des croyants, qu'ils fassent la paix aussi, et que les croyantes, s'il y en a, fassent la paix avec le livre et entre elles. Et puis qu'ils prient Dieu avec double et avec venia 212, et ils auront [ainsi] livré l'oraison [au croyant].
RÈGLES DE CONDUITE.
La mission de tenir double et de dire l'oraison ne doit pas être confiée à un homme séculier.
Si les chrétiens vont dans un lieu dangereux, qu'ils prient Dieu avec gratia.
Et si quelqu'un chevauche, qu'il tienne double. Et il doit dire l'oraison en entrant dans un navire ou dans une ville, ou en passant sur une planche ou sur un pont dangereux.
Et s'ils trouvent un homme avec qui il leur faille parler pendant qu'ils prient Dieu, s'ils ont [dit] huit oraisons, elles peuvent être comptées pour une simple, et s'ils ont [dit] seize oraisons, elles peuvent être comptées pour une double.
Et s'ils trouvent quelque bien en chemin, qu'ils ne le touchent pas s'ils ne savent pas qu'ils puissent le rendre. Et s'ils voient alors que des gens soient passés avant eux à qui la chose pût être rendue, qu'ils la prennent et la rendent s'ils peuvent. Et s'ils ne peuvent, qu'ils la remettent dans ce lieu. Et s'ils trouvent une bête ou un oiseau prise ou pris, qu'ils ne s'en mêlent pas.
Et si le chrétien veut boire pendant qu'il est jour, qu'il ait prié Dieu deux fois ou plus après manger. Et si après la double de la nuit ils buvaient, qu'ils fassent une autre double. Et s'il y a des croyants, qu'ils se tiennent debout quand ils disent l'oraison pour boire. Et si un chrétien prie Dieu avec des chrétiennes, qu'il conduise toujours l'oraison. Et si un croyant à qui eût été livrée l'oraison était avec des chrétiennes, qu'il s'en aille autre part et qu'il fasse par lui-même.
CONVERSION DES MALADES.
Si les chrétiens auxquels le service de l'Église est confié reçoivent un message d'un croyant malade, ils doivent y aller et ils doivent lui demander en confidence comment ü s'est conduit vis-à-vis de l'Église depuis qu'il a reçu la foi, et s'il est en quoi que ce soit endetté vis-à-vis de l'Église, ou s'il lui a causé du dommage. Et s'il doit quelque chose et qu'il puisse le payer, il doit le faire. Et s'il ne veut pas le faire, il ne doit pas être reçu. Car si l'on prie Dieu pour un homme coupable ou déloyal, cette prière ne peut profiter. Mais s'il ne peut payer, il ne doit pas être repoussé.
Et les chrétiens doivent lui montrer l'abstinence213 et les coutumes de l'église. Et puis, ils doivent lui demander, pour le cas où il serait reçu, s'il a l'intention de les observer. Et il ne doit pas le promettre s'il n'en a pas bien fermement l'intention. Car saint Jean dit que la part des menteurs sera dans un étang de feu et de soufre. Et s'il dit qu'il se sent assez ferme pour souffrir toute cette abstinence, et si les chrétiens sont d'accord pour le recevoir, ils doivent lui imposer l'abstinence...
Et puis, ils doivent lui demander s'il veut recevoir l'oraison. Et s'il dit que oui, qu'ils le revêtent de chemise et de braies, si faire se peut, et qu'ils le fassent se tenir sur son séant, s'il peut lever les mains. Et qu'ils mettent une nappe ou un autre drap devant lui sur le lit. Et sur ce drap, qu'ils mettent le livre et qu'ils disent une fois Benedicite et trois fois Adoremus patrem et filium et spiritum sanctum. Et il doit prendre le livre de la main de l'ancien. Et puis, s'il peut attendre, celui qui conduit le service doit l'admonester et le prêcher avec témoignages convenables. Et puis, il doit lui demander à propos de la promesse qu'il a faite, s'il a l'intention de l'observer et de la tenir comme il l'a faite. Et s'il dit que oui, qu'ils la lui fassent confirmer. Et puis, ils doivent lui passer l'oraison et il doit la suivre. Et puis que l'ancien lui dise: "C'est l'oraison que Jésus-Christ a apportée dans ce monde et il l'a enseignée aux bons hommes. Et que jamais vous ne mangiez ni ne buviez aucune chose, que vous ne disiez premièrement cette oraison. Et si vous y apportiez de la négligence, il faudrait que vous en portiez pénitence". Il doit dire: "Je la reçois de Dieu, de vous et de l'Église". Et puis qu'ils le saluent comme une femme214. Et puis, ils doivent prier Dieu avec double et avec veniae; et puis, ils doivent remettre le livre devant lui. Et puis, ils doivent dire trois Adoremus. Et puis qu'il prenne le livre de la main de l'ancien et l'ancien doit l'admonester avec témoignages et avec telles paroles qui conviennent au consolamentum...
Puis l'ancien doit prendre le livre et le malade doit s'incliner et dire: "Parcite nobis. Pour tous les péchés que j'ai faits ou dits ou pensés, je demande pardon à Dieu et à l'Église et à vous tous". Et les chrétiens doivent dire: "Par Dieu et par nous, et par l'Église qu'ils vous soient pardonnés, et nous prions Dieu qu'il vous les pardonne". Et ils doivent le consoler en lui posant les mains et le livre sur la tête... Et puis, ils doivent se donner le baiser de la paix, entre eux et avec le livre. Et s'il y a des croyants ou des croyantes, qu'ils se donnent le baiser de la paix. Et puis, les chrétiens doivent demander le salut et le rendre.
Et si le malade meurt et leur laisse ou leur donne quelque chose, ils ne doivent pas le garder pour eux, ni s'en emparer, mais ils doivent le mettre à la disposition de l'ordre. Si le malade survit, les chrétiens doivent le présenter à l'ordre et prier qu'il se console de nouveau le plus tôt qu'il pourra et qu'il en fasse sa volonté.
199 Un "sympathisant" initié à la croyance cathare, mais pas encore admis.
200 Épreuve préparatoire à la réception.
201 Nom que se donnaient les cathares entre eux.
202 Geste rituel de vénération, qui consiste en trois génuflexions et une demande de bénédiction.
203 Références à des passages adéquats du Nouveau Testament.
204 Une oraison répétée deux fois.
205 Inclination et génuflexion.
206 Voir p. 385-387.
207 Titre de prière cathare.
208 Autre prière cathare.
209 Oraison dominicale (?) répétée six fois.
210 Se donner le baiser de la paix.
211 C'est-à-dire baiser l'Évangile.
212 Cf. les notes 2 et 3 p. précédente.
213 Cf. supra, note 2 de la page 525.
214 Les salutations adressées au récipiendaire différaient selon qu'il s'agissait d'un homme ou d'une femme. Si c'est une femme malade qui recevait le consolamentum, elle était saluée comme un homme.
II
DISCOURS PRÉLIMINAIRE ADRESSÉ PAR L'ANCIEN AU RÉCIPIENDAIRE
Pierre215, vous voulez recevoir le baptême spirituel par lequel est donné le Saint-Esprit dans l'Église de Dieu, avec la sainte oraison, avec l'imposition des mains des bons hommes. De ce baptême, Notre-Seigneur Jésus-Christ dit dans l'évangile de saint Matthieu (XXVIII, 19-20) à ses disciples: "Allez et instruisez toutes les nations et baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à garder toutes les choses que je vous ai commandées. Et voici que je suis avec vous pour toujours jusqu'à la consommation du siècle". Et dans l'évangile de saint Marc (XVI, 15), il dit: "Allez par tout le monde, prêchez l'Évangile à toute créature. Et qui croira et sera baptisé sera sauvé, mais qui ne croira pas sera condamné". Et dans l'évangile de saint Jean (III, 5), il dit à Nicodème: "En vérité, en vérité, je te dis qu'aucun homme n'entrera dans le royaume de Dieu s'il n'a été régénéré par l'eau et le Saint-Esprit". Et saint Jean-Baptiste a parlé de ce baptême quand il a dit (év. de saint Jean, I, 26-27, et év. de saint Matthieu, III, 11): "Il est vrai que je baptise d'eau, mais celui qui doit venir après moi est plus fort que moi: je ne suis pas digne de lier la courroie de ses souliers. Il vous baptisera du Saint-Esprit et du feu". Et Jésus-Christ a dit dans les Actes des Apôtres (1,5): "Car Jean a baptisé d'eau mais vous serez baptisés du Saint-Esprit". Le saint baptême par l'imposition des mains a été institué par Jésus-Christ selon ce que rapporte saint Luc, et il dit que ses amis le feraient comme le rapporte saint Marc (XV, 18): "Ils imposeront les mains sur les malades et les malades seront guéris". Et Ananias (Actes, IX, 17-18) fit ce baptême à saint Paul quand il fut converti. Et ensuite, Paul et Bamabé le firent en beaucoup de lieux. Et saint Pierre et saint Jean le firent sur les Samaritains. Car saint Luc le dit ainsi dans les Actes des Apôtres (VIII, 14-17): "Les apôtres, qui étaient à Jérusalem ayant appris que ceux de Samarie avaient reçu la parole de Dieu, envoyèrent à eux Pierre et Jean. Lesquels y étant venus prièrent pour eux pour qu'ils reçussent le Saint-Esprit, car il n'était encore descendu sur aucun d'eux. Alors, ils posaient les mains sur eux et ils recevaient le Saint-Esprit".
Ce saint baptême par lequel le Saint-Esprit est donné, l'Église de Dieu l'a gardé depuis les apôtres jusqu'à maintenant, et il est venu de "bons hommes" en "bons hommes" jusqu'ici, et elle le fera jusqu'à la fin du monde; et vous devez entendre que pouvoir est donné à l'Église de Dieu de lier et de délier, de pardonner les péchés et de les retenir, comme le Christ le dit dans l'évangile de saint Jean (XX, 21-23): "Comme le Père m'a envoyé je vous envoie aussi. Lorsqu'il eut dit ces choses, il souffla et leur dit: Recevez le Saint-Esprit; ceux à qui vous pardonnerez les péchés ils leur seront pardonnés, et ceux à qui vous les retiendrez ils seront retenus". Et il dit à Simon-Pierre dans l'évangile de saint Matthieu (XVI, 18-19): "Je te dis que tu es Pierre, et que, sur cette pierre, je bâtirai mon Église et que les portes de l'enfer n'auront point de force contre elle. Et je te donnerai les clefs du royaume des cieux. Et quelque chose que tu lies sur terre, elle sera liée dans les cieux et quelque chose que tu délies sur terre, elle sera déliée dans les cieux". Et dans un autre endroit (Matth., XVIII, 18-20), il dit à ses disciples: "En vérité, je vous dis que quelque chose que vous liiez sur terre, elle sera liée dans les cieux, et quelque chose que vous déliiez sur terre, elle sera déliée dans les cieux. Et derechef, en vérité, je vous dis que si deux de vous se réunissent sur terre, toute chose, quoi qu'ils demandent, leur sera accordée par mon Père qui est au ciel. Car où deux ou trois personnes sont réunies en mon nom j'y suis au milieu d'elles". Et dans un autre endroit (Matth., X, 8), il dit; "Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons". Et en l'évangile de saint Jean (XIV, 12), il dit: "Qui croit en moi fera les œuvres que je fais". Et en l'évangile de saint Marc (XIV, 17-18), il dit: "Mais ceux qui croiront, ces signes les suivront: en mon nom ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils enlèveront les serpents, s'ils boivent quelque chose de mortel cela ne leur fera pas de mal. Ils poseront les mains sur les malades et ils seront guéris". Et en l'évangile de saint Luc (X, 19), il dit: "Voici que je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toutes les forces de l'ennemi, et rien ne vous nuira".
Et si vous voulez recevoir ce pouvoir et cette puissance, il vous faut tenir les commandements du Christ et du Nouveau Testament selon votre pouvoir. Et sachez qu'il a commandé que l'homme ne commette ni adultère, ni homicide, ni mensonge, qu'il ne jure aucun serment, qu'il ne prenne ni ne dérobe ni ne fasse aux autres ce qu'il ne veut pas qu'on lui fasse; qu'il pardonne à qui lui fait du mal, qu'il aime ses ennemis, qu'il prie pour ses calomniateurs et ses accusateurs et les bénisse. Si on le frappe sur une joue, qu'il tende l'autre, si on lui enlève la gonelle qu'il laisse le manteau; et qu'il ne juge ni ne condamne, et beaucoup d'autres commandements qui sont commandés par le Seigneur et son Église. Et il faut également que vous haïssiez ce monde et ses œuvres et les choses qui sont en lui. Car saint Jean dit dans l'épître première (II, 15-17): "Ô mes très chers, ne veuillez pas aimer le monde ni ces choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde la charité du Père n'est pas en lui. Car tout ce qui est dans le monde est convoitise de la chair, et convoitise des yeux et orgueil de la vie, laquelle n'est pas du Père, mais est du monde; le monde passera ainsi que sa convoitise, mais qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement". Et Christ dit aux nations (Jean, VII, 7): "Le monde ne peut vous haïr, mais il me hait, parce que je porte témoignage de lui, que ses œuvres sont mauvaises". Et dans le livre de Salomon (Eccl., I, 14), il est écrit: "J'ai vu toutes ces choses sous le soleil et voilà que toutes sont vanités et tourment d'esprit". Jude, frère de Jacques, dit pour notre enseignement dans l'épître (vers. 23): "Haïssez ce vêtement souillé qui est charnel". Et par ces témoignages et beaucoup d'autres, il vous faut tenir les commandements de Dieu et haïr ce monde. Et si vous le faites bien jusqu'à la fin, nous avons espérance que votre âme aura la vie éternelle.
215 Prénom supposé du postulant.
III
PRIÈRE CATHARE
(Traduction. D'après le recueil Spiritualité de l'hérésie: le catharisme, publié par René Nelli en 1953 aux Éditions Privât, Toulouse. On trouvera également dans ce recueil le texte provençal de cette prière).
Père Saint, Dieu juste des bons esprits, toi qui jamais ne te trompes, ni ne mens ni ne doutes, de peur d'éprouver la mort dans le monde du dieu étranger, puisque nous ne sommes pas du monde et que le monde n'est pas de nous, donne-nous à connaître ce que tu connais et à aimer ce que tu aimes.
Pharisiens séducteurs qui vous tenez à la porte du royaume, vous empêchez d'entrer ceux qui voudraient entrer, alors que vous autres vous ne voulez pas; c'est pourquoi je prie le Père Saint des bons esprits qui a pouvoir de sauver les âmes, et par le mérite des bons esprits les fait grener et fleurir, et à cause des bons donne la vie aux méchants - et il le fera aussi longtemps qu'il y aura des bons au monde, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus aucun de mes petits, ceux qui sont des sept royaumès et sont descendus du Paradis quand Lucifer les en a tirés sous le prétexte trompeur que Dieu ne leur a permis que le bien, et que le diable, parce qu'il était très faux, leur permettrait le bien et le mal, et dit qu'il leur donnerait des femmes qu'ils aimeraient beaucoup, qu'il leur donnerait le commandement des uns sur les autres, et qu'il y en aurait qui seraient rois, comtes ou empereurs, et qu'avec un oiseau ils pourraient en prendre un autre et avec une bête, une autre bête.
Tous ceux qui lui seraient soumis descendraient en bas et auraient le pouvoir d'y faire le mal et le bien comme Dieu en-haut; il leur valait beaucoup mieux (disait le diable) être en bas où ils pourraient faire le mal et le bien, qu'en haut où Dieu ne leur permettrait que le bien. Et alors ils montèrent sur un ciel de verre et autant s'y élevèrent, autant tombèrent et périrent; et Dieu descendit du ciel avec douze apôtres, et il s'adombra en Sainte Marie.
IV
MESURES RÉPRESSIVES DÉCRÉTÉES CONTRE LES CATHARES PAR LES CONCILES DE 1179 À 1246
ONZIÈME CONCILE ŒCUMÉNIQUE, TROISIÈME DE LATRAN, EN 1179.
Can. 27.
... Comme, en Gascogne, dans les environs d'Albi, de Toulouse et autres lieux, la folie des hérétiques appelés tantôt cathares, tantôt patares et publicains, s'est accrue de telle sorte qu'ils n'exercent plus seulement en secret leur malignité, mais la proclament ouvertement et pervertissent les gens simples et faibles, nous prononçons l'anathème contre eux et contre tous ceux qui adhéreront à leurs principes et les défendront; nous défendons, sous peine d'anathème, de les loger, de faire commerce avec eux... Quiconque s'associera à ces hérétiques sera exclu de la communion et tous sont déliés des devoirs et de l'obéissance contractés envers lui... Tous les fidèles doivent s'opposer énergiquement à cette peste, et même prendre les armes contre eux. Les biens de ces gens seront confisqués et il sera permis aux princes de les réduire en esclavage. Quiconque, suivant le conseil des évêques, prendra les armes contre eux aura une remise de deux ans de pénitence et sera placé, tout comme un croisé, sous la protection de l'Église.
LES 45 "CAPITULA" DU CONCILE DE TOULOUSE EN 1229.
1. Dans chaque paroisse de la ville et hors de la ville, les évêques désigneront un prêtre et deux ou trois laïcs, ou même davantage s'il le faut, de réputation intacte, qui s'engageront par serment à rechercher assidûment et fidèlement les hérétiques vivant sur la paroisse. Ils visiteront minutieusement les maisons suspectes, les chambres et caves, et les recoins les plus dissimulés qui devront être démolis. S'ils découvrent des hérétiques ou des personnes donnant créance ou faveur, asile ou protection aux hérétiques, ils prendront des mesures pour les empêcher de fuir, et les dénonceront le plus tôt possible à l'évêque et au seigneur du lieu ou à son bailli.
2. Les abbés exempts en feront autant pour leurs territoires qui ne sont pas soumis à la juridiction épiscopale.
3. Les seigneurs temporels feront rechercher avec soin les hérétiques dans les villes, les maisons et les forêts où ils se réunissent et feront détruire leurs repaires.
4. Quiconque laissera un hérétique séjourner sur sa terre, soit à prix d'argent, soit pour tout autre motif, qu'il avoue sa faute ou qu'il en soit convaincu, perdra à tout jamais sa terre et sera passible de peines personnelles de la part de son seigneur, suivant sa culpabilité.
5. Sera également puni celui sur les terres duquel on rencontre fréquemment des hérétiques, bien qu'à son insu, mais par suite de négligence.
6. La maison dans laquelle un hérétique est découvert sera rasée, le terrain sera confisqué.
7. Le bailli en résidence dans une localité où l'on soupçonne la présence des hérétiques, qui ne les recherchera pas avec zèle, perdra sa place sans compensation.
9. Chacun peut rechercher les hérétiques sur les terres de son voisin... Ainsi le roi pourra rechercher les hérétiques sur les terres du comte de Toulouse et réciproquement.
10. L'haereticus vestitus qui abandonne spontanément l'hérésie ne doit pas garder la même habitation si la localité passe pour contenir des hérétiques. On le placera dans une localité catholique et bien famée. Ces convertis porteront sur leurs habits deux croix, une à droite et l'autre à gauche, d'une autre couleur que celle de l'habit; ce qui ne les dispense pas d'avoir des lettres testimoniales de réconciliation délivrées par l'évêque. Ils seront inhabiles aux fonctions publiques et aux actes légaux jusqu'à réhabilitation par le pape ou son légat, après une pénitence convenable.
11. Celui qui revient à l'unité catholique, non spontanément mais par crainte de la mort ou tout autre motif, sera mis par l'évêque en prison, pour y faire pénitence, avec les précautions requises, pour qu'il ne puisse pas entraîner les autres...
12. Tous les fidèles adultes devront promettre par serment à l'évêque de garder la foi catholique et de poursuivre les hérétiques dans la mesure de leurs moyens. Ce serment devra être renouvelé tous les deux ans.
14. Il n'est pas permis aux laïcs d'avoir les livres de l'Ancien et du Nouveau Testament; sauf le Psautier, le Bréviaire et les Heures de la Sainte Vierge: défense rigoureuse d'avoir ces livres traduits en langues vulgaires.
15. Quiconque est diffamé ou soupçonné d'hérésie ne pourra être médecin. Lorsqu'un malade au reçu de son curé la sainte communion, on veillera soigneusement à ne laisser approcher de lui aucun hérétique ou suspect d'hérésie, car ces visites ont eu de tristes conséquences.
18. Seront regardés comme diffamés d'hérésie ceux que la voix publique désigne comme hérétiques, ou dont la mauvaise réputation auprès des personnes honorables aura été prouvée légalement par-devant l'évêque.
42. Les femmes, veuves ou héritières qui possèdent des places fortes ou des châteaux ne doivent pas se marier avec des ennemis de la foi et de la paix.
ORDONNANCES DU CONCILE DE BÉZIERS, 1233.
1 Les parfaits et les croyants, leurs protecteurs, défenseurs et receleurs doivent être excommuniés tous les dimanches. Le coupable qui, après une monition et une excommunication, ne s'amende pas dans un délai de quarante jours, sera lui-même traité en hérérique.
2. Tout particulier peut arrêter un hérétique, à condition de le livrer ensuite à l'évêque.
4. Tout hérétique réconcilié qui ne porte pas les deux croix sur ses habits sera traité comme relaps et ses biens seront confisqués.
CANON DU SYNODE D'ARLES, 1234.
6. Beaucoup d'hérétiques faisant seulement mine de se convertir n'en sont ensuite que plus dangereux. Désormais tous ceux qui sont convaincus d'hérésie et qui ne sont pas punis [de mort], seront emprisonnés pour le reste de leurs jours [même si leur conversion est sincère]. Ils seront entretenus avec les revenus de leurs biens.
11. Les corps des hérétiques et de leurs credentes seront exhumés et livrés au juge séculier.
13. Quiconque reste plus d'un mois sous le coup de l'excommunication doit payer lorsqu'il sollicite l'absolution, 50 solidi pour chaque mois supplémentaire de retard. La moitié de cette amende va au seigneur temporel et l'autre à l'évêque pour les causes pies.
21. Les testaments seront rédigés en présence du curé ou de son chapelain; sinon le notaire sera excommunié et le testateur privé de sépulture ecclésiastique.
CONCILE DE NARBONNE, 1243.
1. Les hérétiques, leurs partisans ou protecteurs qui se présentent d'eux-mêmes au tribunal, qui donnent des preuves du repentir, disent sur eux et sur les autres toute la vérité et par là obtiennent la remise de la peine d'emprisonnement seront néanmoins soumis aux pénitences suivantes: ils porteront la croix, et tous les dimanches entre l'épître et l'évangile ils se présenteront avec une verge au prêtre pour en recevoir la discipline. Ils seront soumis à la même peine dans toutes les processions solennelles...
4. On construira des prisons pour y renfermer les pauvres convertis de l'hérésie. Les inquisiteurs devront pourvoir à leur entretien, afin que les évêques ne soient pas trop gênés de ces frais.
9. Le nombre des hérétiques et des credentes qui devraient être enfermés pour le reste de leurs jours étant très considérable au point que l'on trouve à peine des pierres nécessaires pour construire les prisons indispensables, sans parler des autres frais occasionnés par cette multitude de prisonniers, on différera de les amener en prison jusqu'à ce qu'on ait consulté sur ce point les intentions du pape; néanmoins les plus suspects seront enfermés sans délai.
11. Quiconque retombe dans l'hérésie après l'avoir abjurée sera, sans autre procédure, livré au bras séculier pour être puni.
17. Les inquisiteurs dominicains ne doivent pas imposer pour pénitence des amendes; cela ne convient pas à leur ordre, et ils doivent s'en remettre sur ce point aux évêques et au légat pontifical chargé des pénitences.
19. Nul ne peut être dispensé de la prison en raison de l'état de mariage, des parents, des enfants, de l'âge ou de la santé.
22. Les noms des témoins ne seront pas communiqués; cependant, l'accusé donnera les noms de ses ennemis...
23. Nul ne doit être condamné sans preuves suffisantes ou sans son propre aveu...
24. En matière d'hérésie n'importe qui est admis à être accusateur ou témoin, sans en excepter les criminels, les infâmes ou les complices.
25. On n'écartera comme sans valeur que les dispositions inspirées par la malice ou l'inimitié.
INSTRUCTIONS ADRESSÉES AUX INQUISITEURS PAR LE CONCILE DE BÉZIERS, 1246.
1. Les inquisiteurs ne pouvant sans difficulté visiter chaque localité en particulier, devront, suivant l'ordre du pape,; choisir une résidence spéciale et exercer de là leur pouvoir inquisitorial sur tout le voisinage. Ils devront convoquer le clergé et le peuple, lire leur mandat et ordonner à toute personne tombée dans l'hérésie ou connaissant des hérétiques de comparaître et de dire la vérité.
20. Les hérétiques condamnés, relaps, les coutumaces et fugitifs, ceux qui n'ont pas comparu dans le délai prescrit et ne l'ont fait que sur une citation particulière, ceux qui, au mépris de leur serment, cachent la vérité, seront d'après les instructions apostoliques, enfermés pour le reste de leurs jours, peine que plus tard les inquisiteurs pourront mitiger ou commuer, si les coupables sont repentants, avec le conseil des prélats dont ils relèvent.
21. Mais ils devront auparavant garantir qu'ils accompliront exactement leur pénitence et s'engager par serment à combattre l'hérésie; et s'ils retombent, ils seront punis sans miséricorde.
22. Les inquisiteurs ont du reste le droit, si bon leur semble, de remettre en prison ceux qui avaient été graciés.
23. Les emmurés seront, conformément à l'ordonnance du Siège apostolique, placés en des chambres séparées et isolées afin qu'ils ne puissent se corrompre eux-mêmes ni les autres...
24. On ne remettra en entier la peine de l'emprisonnement perpétuel que pour de très graves raisons, par exemple, si l'absence du prisonnier exposait des enfants au danger de mort.
25. La femme peut visiter son mari emmuré, et réciproquement. On ne leur refusera pas la cohabitation, qu'ils soient l'un et l'autre emmurés ou l'un d'eux seulement.
(D'après Hefele-Leclercq, Histoire des conciles, t. V2, 2e partie).
V
SENTENCES DE L'INQUISITION
CONDAMNATION D'UNE RELAPSE.
Au nom du Père, du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.
Nous Frère Jacques, par permission divine évêque de Pamiers, ayant licence spéciale du Révérend Père en Dieu, Pierre, par la grâce de Dieu, évêque de Carcassonne et son remplaçant à ces lieu, jour et heure, dans son diocèse, et nous, Frère Jean de Prat, de l'ordre des Frères prêcheurs, Inquisiteur de la dépravation hérétique dans le royaume de France, député de l'autorité apostolique résidant à Carcassonne pour les recherches de tous les infectés et suspects du venin hérétique, nous avons trouvé et il nous est démontré que vous, Guilhelmette Tomier, épouse de Bernard Tomier, autrefois de Tarascon, diocèse de Pamiers... avez été condamnée par sentence à la prison perpétuelle et que vous avez fait abjuration solennelle en jugement, de toute hérésie, croyance, recel et participation, sous peine de vous voir infliger les peines réservées aux relaps.
Cependant, malgré votre serment prononcé sur les saints Évangiles, que vous avez touché de vos mains, de poursuivre les hérétiques croyants, fauteurs, receleurs et défenseurs d'iceux, révéler leurs méfaits, de les prendre ou faire prendre par tous les moyens en votre pouvoir, et par-dessus tout, de tenir et conserver la foi catholique... vous êtes retombée dans la dépravation hérétique, comme un chien qui revient à vomir, après s'être gorgé de viande pourrie, pour avoir suivi et écouté Pierre et Guillaume Antérieu, condamnés à raison de leur dépravation hérétique, en faisant plusieurs fois l'éloge de leur bonté, de leur sainteté, de leur vie exemplaire, de leur foi et de leur croyance, en disant que la secte des surnommés était salutaire et que tout être humain pouvait se sauver par elle, en faisant remarquer que notre Saint Père le pape, et les prélats de la Sainte Église étaient des mécréants, en réprouvant notre foi catholique et tous ceux qui la conservaient, en voulant donner aide à la secte hérétique et en la protégeant par toutes sortes de moyens.
Ainsi que le tout est attesté par deux témoins requis en jugement; que pour prévenir les faits ci-dessus mentionnés, vous avez été avertie, priée, suppliée, et exhortée à plusieurs jours d'intervalle... de prêter serment de vérité, sur la foi et le fait de l'hérésie, que vous avez refusé de prêter le dit serment et que vous refusez encore de le prêter, avec opiniâtreté comme impénitente et hérétique, et soutien des hérétiques...
C'est pourquoi, Nous, Évêque et Inquisiteur susdits, après avoir pris l'avis de beaucoup d'hommes de bien, tant religieux que séculiers, versés dans l'un et l'autre droit, ayant Dieu seul devant nos yeux... nous prononçons et nous déclarons Guilhelmette Tomier relapse en crime et protection d'hérésie, comme hérétique impénitente, et comme l'Église n'a que faire d'une hérétique comme vous, nous vous abandonnons à la cour séculière, en priant néanmoins cette cour, d'une manière instante, comme le recommandent les sanctions canoniques que l'on vous conserve la vie et les membres sans péril de mort216, si vous dite Guilhelmette Tornier, vous avouez pleinement les faits d'hérésie qui vous sont reprochés, si le repentir touche votre cœur, et si vous ne persistez pas à dénier le sacrement de la pénitence et de l'eucharistie... (Coll. Doat, t. XXVIII, p. 158).
DESTRUCTION DES MAISONS "SOUILLÉES" PAR LES CATHARES.
Au nom du Seigneur ainsi soit-il. Comme par la recherche faite, et les dépositions des témoins appelés en justice et assermentés, nous avons trouvé qu'il était évident que dans les maisons de Guillaume Adémar, jurisconsulte, de Raymond Fauret, de Raymond Aron, et dans la propriété de Me Pierre de Medens, située près de Réalmont, pendant les maladies dont ils étaient atteints et qui ont amené leur décès, les surnommés ont été reçus hérétiques dans les dites maisons, suivant le rite exécrable de cette damnée secte.
Nous, Inquisiteurs et Vicaires délégués de l'évêque d'Alby... après avoir pris l'avis d'hommes sages et experts, usant de l'autorité apostolique à nous confiée, nous disons et prononçons, par sentence définitive, que les maisons susdites et la propriété susdite, avec toutes leurs appartenances et dépendances seront démolies de fond en comble et nous ordonnons qu'elles seront détruites; nous ordonnons en outre que les matériaux des dites maisons soient livrés aux flammes, à moins qu'il nous paraisse utile, suivant notre volonté, d'employer les dits matériaux à des usages pieux.
Nous ordonnons encore qu'il soit interdit dans les susdits lieux de se livrer à aucune reconstruction, à aucune clôture; que les susdits lieux resteront inhabités, sans clôture et sans culture, à jamais, par cela seul qu'ils ont été le réceptacle des hérétiques, et qu'ils doivent devenir par cela seul un lieu de proscription...
Cette sentence a été portée l'an du Seigneur 1329, le jour du dimanche, après l'octave de la Nativité de la bienheureuse vierge Marie, sur la place du marché du bourg de Carcassonne. (Doat, op. cit.).
216 On sait que le bras séculier ne pouvait et ne devait tenir aucun compte de cette charitable recommandation.
VI
LE DEBAT D'IZARN ET DE SICART
Poème provençal du XIII e siècle, rédigé peu de temps après la prise de Montségur, à l'instigation des services de la propagande catholique, dans le but de discréditer le plus possible les militants cathares. Ce texte a été publié, traduit et annoté par Paul Meyer, en 1879, dans l'Annuaire-bulletin de la Société de l'histoire de France. On trouvera ici la version abrégée de sa traduction.
- Hérétique, je voudrais bien qu'avant que le feu te saisît, avant que tu sentisses la flamme, si tu ne te convertis pas ce soir, que tu dises ton sentiment, pourquoi tu refuses de croire notre baptême qui est bon et saint... Tu démens ton parrain et le chrême dont tu as été oint, car tu l'as renié et tu en as reçu un autre qui l'opère par l'imposition des mains, selon ta croyance... Tu dis quantité de mensonges dont je ne crois pas un mot... Tu fais croire à l'homme déçu, que tu as donné au diable le séparant de Dieu, qu'il passe de corps en corps, attendant le salut, croyant recouvrer ce qu'il a perdu. Tout lieu, toute terre qui t'a porté devrait périr, s'abîmer, pour le mal immense que tu as tissé, ourdi, semé, là où on t'a cru... Si actuellement tu ne te confesses, le feu est allumé, le crieur va par la ville, le peuple est assemblé pour voir le jugement s'accomplir, car tu vas être brûlé.
- Izarn, dit l'hérétique, si vous me garantissez et me faites garantir que je ne sois pas brûlé, ni emprisonné ni mis à destruction, je souffrirai avec résignation tous les autres tourments, pourvu que vous me sauviez de ceux-là. Et si je puis être assuré que vous ne me sépariez pas de vous, que vous me teniez honorablement, sans violence, vous en apprendrez si long sur nos missions, que, pour vous dire à vous qui maintenant me prenez par la douceur, Berit et P. Razolz217 n'en savent pas la valeur de trois dés en comparaison de ce que je vous dirai sur ce que vous demandez touchant les hérétiques et les croyants; mais je veux être à couvert, car, si je vous dis mes secrets, et qu'ensuite vous veniez à me trahir, à divulguer ma confession, si enfin vous ne me preniez pas sous votre protection, vous et les Prêcheurs, je serais volé. Et je vais vous dire pourquoi; je désire que vous le sachiez. C'est que j'ai sauvé, de ces mains-ci, bien cinq cents personnes que j'ai envoyées en paradis, depuis que je suis sacré évêque. Si je me sépare d'eux et les abandonne, j'enlève à ces cinq cents personnes le salut, et je les livre aux diables pour en faire leur volonté, plongés dans les peines de l'enfer et damnés, sans espoir pour aucun d'eux d'être jamais sauvé. Et que deviendrais-je, si ensuite j'étais rencontré par les amis de ceux-là, et si vous ne me receviez pas (parmi les vôtres), si j'étais raillé, tourné en dérision dans votre cour, si je perdais le lieu de Son où je suis installé, et ne pouvais plus y rentrer? Ce serait grande folie, et c'est pourquoi je voudrais qu'il y eût garantie, soit que je refuse, soit que j'accepte, dès l'instant que je suis venu avec sauf-conduit. Tout d'abord je veux que vous sachiez que ce n'est ni la faim, ni la soif, ni misère d'aucun genre qui m'ont amené à me présenter, sachez-le bien. Il est vrai que nous avons été prévenus de nous garder des traces de ceux qui ont été cités, qui n'obtiennent de conditions honorables et d'accord quelconque qu'en s'engageant, s'ils veulent être épargnés, à livrer à la cour tout hérétique qu'ils auront trouvé, en quelque lieu que ce soit. Cela produit des effets étonnants, plus grands que ce que vous pouvez croire: nos plus chers amis, ceux qui nous sont le plus inféodés, nous ont abandonnés, se sont faits nos adversaires, sont devenus nos ennemis; ils nous prennent, nous attachent, quand ils nous ont salués, pour obtenir leur acquittement au prix de notre condamnation. Ils croient ainsi racheter leurs péchés en nous vendant. Mais, avant d'être serré de près, j'ai pris mon parti: je suis venu à la cour de mon gré, non contraint; je vous ai fait une grâce qui, pour quiconque sait le bien-être dans lequel je vis, est plus grande que vous ne pensez! Je vais vous en dire quelque chose, si cela ne vous ennuie pas. J'ai nombre d'amis, riches et opulents, et il n'y en a pas un qui soit content tant qu'il ne m'a pas confié ses deniers ou son argent, s'il en a. Je suis largement fourni de biens meubles et de dépôts, au point que j'en tiens munis tous nos croyants; aussi en trouveriez-vous peu qui soient pauvres ni déguenillés. J'ai en abondance vêtements, chemises, braies, draps lessivés, couvertures, courte-pointes, à l'usage de mes amis privés, et il m'est bien aisé de les en servir quand je les ai invités. Si je jeûne fréquemment, n'allez pas me plaindre, car souvent aussi je mange d'excellente cuisine, des sauces au girofle, de bons pâtés. Le poisson vaut bien autant que de la mauvaise viande, et le bon vin à la girofle que du vin de barrique, le pain bluté que des miches de couvent. Être au sec aussi vaut mieux, à l'occasion, qu'être mouillé: tandis que vous passez les nuits au vent ou à la pluie, que vous arrivez trempés, je me tiens à couvert tranquillement et en paix avec nos confrères, mes adjoints, qui me cherchent mes puces et qui me grattent quand le désir m'en prend. Et si parfois il me vient une envie, que ce soit un cousin ou une cousine, le péché ne me coûte rien: je m'en donne l'absolution à moi-même, une fois démonté. Il n'y a impiété ni péché si mortel dont l'auteur, quel qu'il soit, ne soit sauvé, s'il vient à nous, croyez-le bien, par moi ou par le diacre que j'aurai près de moi. Telle est la bienheureuse situation dont je jouis. Si je consens à l'abandonner, reconnaissant que c'est péché, et si j'accepte la foi de Rome, je veux que vous m'en sachiez gré; je veux être reçu comme un homme honoré.
- Sicart, béni sois-tu: que ce Dieu droiturier qui a créé le ciel et la terre, les eaux, les tempêtes, le soleil, la lune, sans l'aide de personne, te donne d'être au nombre de ces ouvriers loyaux que Dieu mit en la vigne, donnant aux derniers venus, lorsqu'il les eut loués, autant qu'aux premiers arrivés. Tu seras un de ceux-là, si tu veux être sincère, si tu veux être envers la foi loyal et franc, autant que tu as été pervers et mensonger. Mais on ne peut guère espérer que des pénitents qui se convertissent par crainte soient jamais de bons ouvriers, qu'ils combattent hardiment contre leur conscience. Quand un homme a été hérétique, chef et celerier de la mauvaise semence dont le celier est rempli, il faudra qu'il soit bien habile le médecin, bien fourni le pharmacien qui saura donner un médicament capable de faire sortir la pourriture et la maladie, tant est dure la matière! Si tu n'es pas de ceux-là, Sicart, il te faut le montrer par des œuvres, et ne pas être lent ni faible de cœur, mais ferme et actif; il faut que tous les efforts soient à chasser l'hérésie. Et si tu veux être ferme, loyal, franc, dans l'œuvre du Christ que poursuit Frère Ferrier, bonne sera ta récompense, meilleur encore le salaire...
217 Deux enquêteurs au service de l'Inquisition.
VUE SCHÉMATIQUE DU CHÂTEAU DE MONTSÉGUR AVEC LE TRACÉ DE LA ROUTE QUI Y CONDUIT
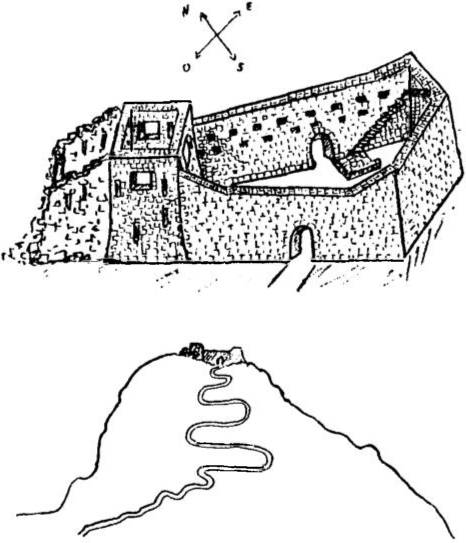
TABLEAU CHRONOLOGIQUE
1002 Premières exécutions de cathares en France (à Orléans et à Toulouse). Dix chanoines de l'église collégiale de Sainte-Croix montent sur le bûcher.
1049 Au concile de Reims il est question pour la première fois de nouveaux hérétiques parus en France.
1077 À Cambrai un cathare est condamné comme hérétique et brûlé.
1114 À Soissons le peuple arrache de la prison plusieurs hérétiques et les fait brûler.
1126 Pierre de Bruys monte sur le bûcher à Saint-Gilles dans le Languedoc.
1160 (Vers) Naissance de la secte des Vaudois à Lyon.
1163 Le concile de Tours dénonce les progrès menaçants de la nouvelle hérésie (catharisme).
1165 Concile de Lombez contre les boni homines (bons hommes).
1167 Un concile des albigeois à Saint-Félix-de-Caraman, présidé par un évêque bulgare, fixe leur organisation et leur culte.
Une assemblée ecclésiastique réunie à Vézelay fait périr par le feu sept cathares.
1172 Un clerc accusé d'hérésie est brûlé à Arras.
1177 Raymond V, comte de Toulouse, signale au chapitre général de Cîteaux le "développement effrayant" de l'hérésie cathare.
1179 Le 11e Concile œcuménique, troisième de Latran, prononce à l'instigation du pape Alexandre III l'anathème contre les hérétiques albigeois.
1180 Le pape fait prêcher par son légat Henri, cardinal évêque d'Albano, la croisade contre les hérétiques du midi de la France.
1181 Prise de Lavaur.
1184 Le pape Lucius III excommunie les Vaudois.
1194 Raymond VI succède à son père Raymond V, comte de Toulouse.
1198 Avènement du pape Innocent III.
Commission pour procéder contre les hérétiques délivrée par le pape aux cisterciens Reynier et Gui: premier établissement de l'inquisition dite épiscopale ou par les légats.
1200 Cinq hommes et trois femmes sont brûlés à Troyes sur accusation d'hérésie.
1201 Un chevalier du comte de Nevers est livré aux flammes à Nevers. (Persécution contre la colonie cathare de la Charité-sur-Loire).
1203 Légation de Pierre de Castelnau.
1204 Raymond de Perella reconstruit Montségur sur la demande des cathares de la région.
Colloque religieux entre catholiques et cathares tenu à Carcassonne sur l'initiative du roi d'Aragon Pierre II (février).
1206 Esclarmonde, sœur du comte de Foix, reçoit le consolamentum.
Saint Dominique établit à Prouille une communauté pour servir de refuge aux femmes cathares converties.
1207 Le pape confirme la sentence d'excommunication prononcée contre le comte de Toulouse par Pierre de Castelnau (29 mai).
1208 Meurtre de Pierre de Castelnau (15 janvier).
Pierre de Castlenau est canonisé (10 mars).
Saint François d'Assise prend la décision de se consacrer à la vie apostolique.
1209 Raymond VI se soumet à l'église et est publiquement flagellé à Saint-Gilles (18 juin).
L'armée des croisés marche sur le Languedoc (début juillet).
Sac et incendie de Béziers (22 juillet).
Prise de Carcassonne (15 août).
Simon de Montfort reçoit des légats le titre de vicomte de Carcassonne et de Béziers (fin août).
Un concile tenu à Avignon décrète vingt et un canons contre les hérétiques et les Juifs (septembre).
Mort de Raymond-Roger Trencavel, vicomte de Carcassonne et de Béziers (10 novembre).
Tombent aux mains des croisés: Albi (reddition). Castres, Caussade, Fanjeaux, Gontaud, Mirepoix, Puy-le-Roque, Saverdun, Tonneins, etc.
1210 Prise de Minerve; cent-quarante cathares brûlés (22 juillet).
Les légats du pape citent le comte de Toulouse devant un concile tenu à Saint-Gilles et l'excommunient pour la seconde fois (septembre).
Termes succombe après neuf mois de siège (23 novembre).
Création de l'ordre des Franciscains.
Philippe-Auguste fait brûler à Paris les disciples d'Amaury de Bène (20 décembre).
Tombent aux mains des croisés les châteaux d'Alayrac (massacre de la garnison), de Bram (mutilation de la garnison), de Pennautier, etc.
1211 Prise de Lavaur, bûcher de quatre cents cathares (3 mai).
Prise des Cassés: bûcher de quatre-vingt-quatorze cathares. Premier siège de Toulouse (fin mai).
Siège de Castelnaudary (septembre).
Tombent aux mains des croisés: Cahuzac, Cous-taussa, Gaillac, la Garde, la Grave (massacre de la garnison), la Guépie, Montaigu, Moncuq, Montferrand, Montgey (destruction totale), Puy-Celsi, Rabastens, etc.
1212 (Vers) Près de quatre-vingts hérétiques sont jugés à Strasbourg. La plupart montent au bûcher.
Pierre des Vaux de Cernay se rend en Albigeois.
Prise d'Agen par Simon de Montfort.
Simon de Montfort réunit à Pamiers une assemblée chargée d'établir le statut politique et juridique des vaincus (1 décembre).
Tombent aux mains des croisés: Ananclet (massacre), Auterive (brûlé), Biron, Castelsarrasin, Cauzac, Haut-poul (siège et massacre), l'Isle, Moissac (siège et massacre de routiers), Montant, Muret, Penne d'Agenais (siège), Penne d'Albigeois (siège), Saint-Antonin (sac du bourg), Saint-Gaudens, Saint-Marcel, Saint-Michel, Samatan, Verdun-sur-Garonne.
1213 Le prince Louis, fils de Philippe-Auguste, prend la croix (début de l'année).
Bataille de Muret (12 septembre).
Siège de Casseneuil: prise, massacre, démolition des murs.
1214 Bataille de Bouvines (27 juillet).
Prise des châteaux de Dome, en Périgord (donjon démoli) et de Montfort.
1215 Première croisade du prince Louis et entrée de Simon de Montfort à Toulouse (avril-octobre).
Le riche Toulousain Pierre Seila (ou Cella) fait don à Dominique de plusieurs maisons qui deviendront le siège de l'Inquisition.
Ouverture du concile de Latran (11 novembre).
Persécutions d'hérétiques à Colmar.
1216 Simon de Montfort reçoit l'investiture du roi pour le Languedoc (10 avril).
Siège de Beaucaire et première défaite des croisés (mai-août).
Mort d'Innocent III (16 juillet).
Entrée de Simon de Montfort à Toulouse, écrasement de la révolte et démantèlement de la ville.
Une bulle d'Honorius III confirme solennellement l'ordre fondé par saint Dominique.
1217 Persécutions d'hérétiques à Cambrai.
Prise par Simon de Montfort des châteaux de Crest en Dauphiné, la Bastide, Monteil, Montgrenier, Pierrepertuse.
Commencement du siège de Toulouse (octobre).
1218 Mort de Simon de Montfort (25 juin).
Mort de Pierre des Vaux de Cernay (fin décembre).
1219 Deuxième croisade du prince Louis. Prise de Marmande et siège manqué de Toulouse (mai-juin).
1120 Persécutions d'hérétiques à Troyes.
1221 Mort de saint Dominique (6 août).
1222 Mort de Raymond VI (août).
1223 Mort de Raymond-Roger, comte de Foix (avril).
Mort de Philippe-Auguste (14 juillet).
Sacre de Louis VIII à Reims (6 août).
1224 Amaury de Montfort quitte le Languedoc (15 janvier).
1225 Assemblée des églises cathares à Pieusse.
Mort d'Arnaud-Amaury, archevêque de Narbonne (29 septembre).
1226 Excommunication de Raymond VII par le concile de Bourges (28 janvier).
Croisade de Louis VIII (juin-novembre).
Mort de saint François d'Assise (3 octobre).
Mort de Louis VIII à Montpensier (8 novembre).
1227 Avènement de Grégoire IX.
1229 Signature du traité de Meaux. Flagellation de Raymond VII devant l'autel de Notre-Dame de Paris (12 avril).
Concile de Toulouse (novembre).
1231 Montségur devient la place forte du catharisme.
Mort de Foulque de Marseille, évêque de Toulouse.
1232 Guilhabert de Castres réunit le synode de Montségur.
1233 Grégoire IX consacre définitivement l'inquisition monastique et donne aux Dominicains une délégation générale pour l'exercice de cet office (13 avril).
Il confirme la création de l'Université de Toulouse "pour faire fleurir la foi catholique dans ces contrées" (29 avril).
Trois Dominicains sont jetés dans un puits à Cordes.
1234 Raymond VII publie ses Statuts contre les hérétiques.
L'inquisiteur Arnaud Cathala fait exhumer à Albi des personnes mortes en état d'hérésie et est maltraité par la foule.
Les inquisiteurs Guillaume Arnaud et Pierre Seila condamnent au bûcher deux cent dix personnes à Moissac.
À Narbonne le peuple saccage le couvent des Dominicains.
1235 Les Dominicains sont expulsés de Toulouse sur l'ordre du comte et des consuls (novembre).
1239 À Montwimer (Marne) cent quatre-vingt-trois cathares sont brûlés en présence du comte de Champagne.
1240 Siège de Carcassonne par Raymond Trencavel (septembre).
1241 Raymond VII promet à Louis IX de détruire le château de Montségur.
1242 Révolte de Raymond VII (avril-octobre).
Massacre d'Avignonet (28 mai).
1243 Traité de Lorris (janvier).
Le concile de Béziers décide de détruire Montségur.
Ouverture du siège de Montségur (13 mai).
Ramon Damors apporte à Bertrand Marty à Montségur des lettres de l'évêque cathare de Crémone (avant novembre).
L'évêque d'Albi, Durand, amène des renforts à l'armée des assiégeants de Montségur (novembre).
Le pape Innocent IV accorde l'absolution à Raymond VII (2 décembre).
Un concile se tient à Narbonne en présence des chefs de l'armée qui assiège Montségur.
1244 Escalade nocturne tentée par les assiégeants de Montségur (5 janvier?).
Sortie nocturne des assiégés. Échec (1 mars).
Une trêve est conclue entre les assiégés et les assiégeants (2 mars).
Capitulation de Montségur (14 mars).
BÛCHER DE MONTSÉGUR (16 mars).
1246 Saint Louis prescrit l'érection de prisons spéciales pour les hérétiques à Carcassonne et à Béziers.
1249 Le comte de Toulouse fait brûler à Barleiges (Agen) quatre-vingts croyants.
Mort de Raymond VII (27 septembre).
1255 Prise de Quéribus, une des dernières retraites des cathares en Languedoc.
1271 Mort d'Alphonse de Poitiers et de sa femme Jeanne de Toulouse. Le Languedoc passe à la couronne de France (21-24 août).
APERÇU BIBLIOGRAPHIQUE
SOURCES CONTEMPORAINES.
1. Textes.
Guillaume de Puylaurens. - Historia negotii Francorum adversus Albigensis (Recueil des Historiens des Gaules et de la France, t. XIX).
Guillaume de Puylaurens. - Chronique sur la guerre des Albigeois. (Trad. en français par Ch. Lagarde, 1864).
Guillaume de Tudèle. - "Chanson de la Croisade" albigeoise. (Ed. et trad. par Fauriel: 1837; Mary-Lafon: 1868; Meyer: 1875-1879; Martin-Chabot; 1931-1954). Pierre des Vaux de Cernay. - Historia Albigensis, publ. par Pascal Guébin et Ernest Lyon. - Paris, Champion, 1926-1939, 3 vol. in-8°.
Pierre des Vaux de Cernay. - Histoire albigeoise. Nouvelle traduction de Guébin et Maisonneuve. - Paris, Vrin, 1951. In-8°, XXXIV-258 p.
Pélisson (Le P. Guillaume), O. P. - Chronicon fratris Guillelmi Pelisso. - Paris, Fischbacher, 1880. In-8°, LXXVII-76 p. (Ed. par Ch. Molinier). Le Débat d'Izam et de Sicart de Figueiras. Poème provençal, traduit et annoté par Paul Meyer. (Annuaire-Bulletin de la Société de l'Histoire de France, 1873). Mounier (Ch.). - Un traité inédit du XIII e siècle contre les Albigeois. (Annales de la Faculté des Lettres de Bordeaux, 1883). Belhomme. - Chartes inédites des comtes Raymond VI et Raymond VII. Privilèges de saisies accordés aux consuls de Toulouse sur les biens des partisans de Simon de Montfort. (Mémoires de l'Académie de Toulouse, 1854, p. 401). 2. Commentaires et analyses.
Beyssier (J.). - Guillaume de Puylaurens et sa "Chronique". (Université de Paris. Bibliothèque de la Faculté des Lettres, XVIII. Troisièmes mélanges d'histoire du moyen âge, 1904, p. 85-175). Ducos (H.). - Note sur Guillaume de Puylaurens. (Mémoires de l'Académie de Toulouse, 1857). Ducos (Fl.). - Notice sur un historien de la croisade contre les hérétiques albigeois: Pierre des Vaux de Cernay. (Mémoires de l'Académie de Toulouse, 1856). Guébin (P.). - Les Commentaires du jurisconsulte François Roaldès sur l'Histoire albigeoise de Pierre des Vaux de Cernay. (Revue historique du Droit français et étranger, 1924). Guébin (P.) et Lyon (G.). - [Notice historique et bibliographique sur Pierre des Vaux de Cernay et sur son ouvrage.] (Voir le tome III de leur édition de l'Histoire albigeoise, p. I-CVII). Guibal (G.). - Le Poème de la croisade contre les Albigeois, ou l'Epopée nationale de la France du Sud au XIII e siècle. - Toulouse, 1863. In-8°, 616 p. (Thèse de doctorat). Maffre (J.B.). - Étude sur le poème-roman de la croisade contre les Albigeois. - Béziers, 1878. In-8°, 73 p. (suivi de notices biographiques sur les chefs de la croisade).
Meyer (P.). - Recherches sur les auteurs de la ""Chanson de la Croisade" albigeoise". (Bibliothèque de l'École des Chartes, t. XXVI, p. 401-422). Cenac-Moncaut (J.). - Lettre à M. Paul Meyer sur l'auteur de la ""Chanson de la Croisade" albigeoise". - Paris, Aubry, 1869. In-8°, 40 p.
Smedt (Ch. de). - Les Sources de l'histoire de la croisade contre les Albigeois. (Revue des Questions historiques, oct. 1874, t. XVI, p. 433-384).
LA CROISADE CONTRE LES ALBIGEOIS.
1. Ouvrages anciens (classement chronologique).
Gay (J.). - L'Histoire des schismes et hérésies des Albigeois. - Paris, Gaultier, 1561. In-8°, iv-53 p.
Fornier (Jean). - L'Histoire des guerres faictes en plusieurs lieux de France, tant en la Guienne et Languedoc contre les hérétiques que ailleurs contre certains ennemis de la couronne. - Toulouse, Colomier, 1562. In-4°, sign. A.-S.
Sorbin (Arnauld). - Conciles de Tholose, Besiers et Narbonne, ensemble les ordonnances du comte Raimond, fils de Raimond, contre les Albigeois et l'instrument d'accord entre ledit Raimond et sainct Loys, roy de France. - Paris, Chaudière, 1569. In-12, XII-36 p.
Du Tillet (Jean). - Sommaire de l'histoire de la guerre faicte contre les hérétiques albigeois, extraicte du Trésor des Chartes du Roy. - Paris, R. Nivelle, 1590, In-8°, 88 p.
Chassenier (Jean). - Histoire des Albigeois, touchant leur doctrine et religion, contre les faux bruits qui ont été semés d'eux et les écrits dont on les a à tort diffamés. - Genève, F. de Saincta. In-8°, 252 p.
Perrin (Jean-Paul). - Histoire des chrétiens albigeois, concernant les longues guerres et persécutions qu'ils ont souffert à cause de la doctrine de l'Évangile. - Genève, 1618, 2 vol.
Catel (G.). - Mémoires de l'"Histoire du Languedoc", tirés des archives de la même province et autres circonvoisines. -Toulouse, Bosc, 1638. In-fol. xi-1038-xl. p.
Benoist (Jean). - Histoire des Albigeois et des Vaudois ou barbets. - Paris, 1691. 2 vol. in-12, vm-372 et ix-332 p., table.
Benoist (Jean). - Suite de l'histoire des Albigeois contenant la vie de saint Dominique. - Toulouse, Pesch. 1693. 2 vol. in-12, iv-259 et m-260 p.
A llix (Peter). - Remarks upon the ecclesiastical history of the ancient churches of the Albigensis. - London, 1692. In-4°, xx-256 p. [Réédité en 1821.]
Langlois (J.B.). - Histoire des croisades contre les Albigeois, depuis la naissance de cette hérésie en 1106 jusqu'en 1270. - Rouen, 1703. In-12, 458 p.
Hardouin (Le P. Jean), S. J. - Histoire vraie des Albigeois et des Vaudois, séparée de leur histoire fabuleuse. (Manuscrit du début du XVIII e siècle, conservé à la Bibliothèque nationale, f. fr. 15250). Devic (Dom Cl.) et Vaissette (Dom J.). - Histoire générale du Languedoc. - Paris, 1730-1745. (Voir le tome III de l'édition originale, qui forme les tomes VI et VIII [preuves] de l'édition annotée par A. Molinier. Toulouse, 1879). Voltaire. - De la croisade contre les Languedociens. (Voir son Essai sur les mœurs et les esprits des nations, publ. sous sa forme définitive en 1769, chap. LXII). 2. Ouvrages modernes a) Études générales.
Barreau et Darragon. - Histoire de la croisade contre les Albigeois. - Paris, Claray, 1842, 2 vol.
Belperron (P.). - La Croisade contre les Albigeois et l'union du Languedoc à la France. - Paris, Pion, 1942. In-16, xxi-499 p.
Borst (A.). - Die Katharer. - Stuttgart, 1953. In-8°, XII -372 p.
Breillat (P.). - Recherches albigeoises. - Albi, Ed. du Languedoc, 1948. In-8°, 118 p. (Réfutation du livre de Belperron). Dieckhoff. - Die Waldenser im Mittelalter. - Göttingen, 1851.
Douais (C.). - Les Albigeois, leurs origines, action de l'Église au XII e siècle. - Paris, 1879. In-8°, XII-615-XXXIX p.
Lequenne (F.). - Le Drame cathare ou l'hérésie nécessaire. - Paris, 1954. In-16, 295 p.
Muller (K.). - Die Waldenser und ihre einzelne Gruppen bis zum Anfang des XIV-ten Jahrhunderts. (Theologische Studien und Kritiken, 1886, p. 665-732; 1882, p. 45-146). Niel (F.). - Albigeois et cathares. - Paris, Presses Universitaires de France (collection "Que sais-je?"), 1955. In-16, 128 p.
Ossokine. - Histoire des Albigeois. - Kazan, 1869-1872, 2 vol. in-8°. (en russe). Perctelaine (O. Quatresoux de). - Histoire de la guerre contre les Albigeois. - Paris, 1833. In-8°, 463 p.
Peyrat (N.). - Histoire des Albigeois. - Paris, 1880, 3 vol. in-8°.
Roch. (D.). - Le Catharisme. - Toulouse, 1947. In-16, 206 p.
Schmidt (C.). - Histoire et doctrine de la secte des Cathares ou Albigeois. - Paris-Genève, 1849, 2 vol.
Witch (M.). - Les Albigeois devant l'Histoire. - Paris, 1878. in-8°, 300 p.
b) Études spéciales.
Berne-Lagarde (P. de). - Bibliographie du catharisme languedocien. - Toulouse, 1957. In-4°, 86 p. (Un précieux instrument de travail). Boutaric. - Saint Louis et Alphonse de Poitiers. Étude sur la réunion des provinces du Midi et de l'Ouest à la couronne et sur les origines de la centralisation administrative. - Paris, Pion, 1870. In-8°, 547 p. (Voir chap. I). Cabie (E.). - Épisodes de la croisade contre les Albigeois, 1205-1228. (Abondants renseignements et précisions de caractère local. Voir Revue historique, scientifique et littéraire du département du Tarn, année 1897, p. 325-336; année 1898, p. 16-24, 137-145 et 215-225).
Carrière (Abbé A.-B.). - Histoire des martyrs d'Avignonet. Épisode de la guerre des Albigeois. - Toulouse, 1866. In-16, 148 p.
Carrière (Marcel). - La Crosada contra los Albigeses. -Toulouse, 1938. In-8°, 35 p.
Compayré (CL). - Études historiques et documents inédits sur l'Albigeois. - Albi, 1841. In-4°, 570 p.
Comte (P.). - Le Catharisme dans les contes populaires de la Gascogne. (Bulletins de la Société archéologique et historique du Gers, 1953, p. 133-146). Dessalles (L.). - Influence de la croisade des Albigeois sur la langue et la littérature romane en général. (Recueil des Actes de l'Académie scientifique de Bordeaux, 1857, XIX). Desazars de Montgaillard. - L'Hérésie des Albigeois et la croisade contre les hérétiques. (Mémoires de la Société archéologique du Midi, 1883, t. XII, p. 330-351). Domairon (Louis). - Code pénal de l'albigéisme. (Cabinet historique, 1864-1866, t. X, XI et XII). Dossat (J.). - La Société méridionale à la veille de la croisade des Albigeois. (Revue du Languedoc, 1944). Dossat (J.). - Le Clergé méridional à la veille de la croisade des Albigeois. (Revue du Languedoc, 1944). Dulaurier (E.) - Les Albigeois ou les Cathares du Midi de la France aux XIII e et XIVe siècles. Études sur les sources de son histoire. - Paris, 1880.
Guiraud (J.). - La Morale des Albigeois; le "consolamentum" ou l'initiation cathare. (Voir le même: Questions d'histoire et d'archéologie chrétienne, Paris, 1906, p. 95149). Guiraud (J.). - L'Albigéisme languedocien aux XII e et XIII e siècles. - Paris, 1907. (Introduction au recueil Cartulaire de Notre-Dame de Prouille, t. I). Jouhate. - La Croisade contre les Albigeois. Étude bibliographique. (Résumé des notes prises aux cours de Luchaire, à la Faculté de Bordeaux, et de Molinier, à la Faculté de Toulouse. Voir Revue historique, scientifique et historique du département du Tarn, 1906, p. 101-121). Julien (L.). - Itinéraire en terre cathare. (Cahiers d'Études cathares, 1952, n° 20). Lagger (L. de). - L'Albigeois pendant la crise de l'albigéisme. (Revue d'histoire ecclésiastique, 1933, p. 272-309, 536-633, 849-904). Maffre (J.-B.). - Notices biographiques sur les principaux chefs de la croisade contre les hérétiques albigeois. (Bulletin de la Société archéologique de Béziers, 1877). Maffre (J.-B.). - Les Prédicateurs albigeois. - Paris, 1864. (Brochure populaire). Mary-Lafon. - Histoire politique, religieuse et littéraire du Midi de la France. - Paris, 1845, 4 vol. (Voir t. II, p. 391-452). Molinier (Ch.). - L'Endura, coutume religieuse des derniers sectaires albigeois. (Annales de la Faculté de Bordeaux, 1881, III). Mondon. - Nomination d'un évêque hérétique en 1167 pour la vallée d'Aran. (Revue du Comminges, 1922). MouLIgnier (P.-H.). - Les Albigeois. - Montauban, 1846. In-8°, 39 p. (Thèse présentée à la Faculté de Théologie protestante de Montauban). Poulain (Mme S.). - Histoire et iconographie du catharisme. - Castres, 1955. (Catalogue de l'Exposition du catharisme au Musée Goya à Castres en 1955). Rahn (O.). - La Croisade contre le Graal. - Paris, 1934. In-8°, 288 p. (Trad. de l'allemand: Kreuzzug gegen den Graal: grandeur et chute des Albigeois). Reville (A.). - Les Albigeois, origine, développement et disparition du catharisme dans la France méridionale. (Revue des Deux Mondes, 1 mai 1874). Roger (P.-A.). - La Noblesse de France aux croisades. - Paris, 1845. In-4°, 399 p. (Voir p. 217-313). Salvat (Abbé J.) - La Crozada contra los Albigeses. - Castelnaudary, 1939. In-8°, 15 p.
Thomas (L.-J.). - Quelques aspects peu connus de la croisade contre les Albigeois. (Cahiers d'histoire et d'archéologie de Nîmes, 1931). Vacandard (Abbé). - Les origines de l'hérésie albigeoise. (Revue des Questions historiques, 1894, t. LV, p. 50-65-83. Cf. La Vie de saint Bernard du même auteur, t. II, p. 202-204 et 217-234).
L'ÉGLISE ET L'INQUISITION.
A lbe (E.). - L'Hérésie albigeoise et l'Inquisition en Quercy. (Revue d'histoire de l'Église de France, 1910, t. V, p. 271-293 et 412-428). Baudoin (Ad.). - De l'histoire et de l'organisation des tribunaux d'inquisition dans le Midi de la France aux XIII e et XIVe siècles. (Mémoires de l'Académie de Toulouse, 1878, X). Caragon. - L'Inquisition à Carcassonne aux XIII e et XIVe siècles. - Mazamet, Caragol, 1903. In-8°n 118 p.
Cauzon (Th. de). - Les Albigeois et l'Inquisition. - Paris, 1908. In-16, 124 p.
Desazars de Montgaillard. - Histoire authentique des inquisiteurs tués à Avignonet en 1242. - Toulouse, 1869. In-8°, 52 p.
Douais (C.). - Documents pour servir à l'histoire de l'Inquisition dans le Languedoc au XIII e et au XIVe siècles. - Paris, 1900, 2 vol.
Douais (C.). - L'Inquisition, ses origines, sa procédure. - Paris, 1906. In-8°, XI -366 p.
Emery (R.W.). - Heresy and Inquisition in Narbonne. - New York, 1941. In-80, 184 p.
Grandville (F.). - L'Organisation de l'Inquisition en France de 1233 à la fin du XVe siècle. - Orléans, 1908. In-8°, IV-196 p.
Guiraud (J.). - Histoire de l'Inquisition au moyen âge. - Paris, 1935-1938, 2 vol.
Havet (Julien). - L'Hérésie et le bras séculier au moyen âge jusqu'au XIII e siècle. - Paris, 1881. In-8°, 67 p. (Extr. de la Bibliothèque de l'École des Chartes, 1880, t. XLI). Jordan (E.). - La Responsabilité de l'Église dans la répression de l'hérésie au moyen âge. (Annales de philosophie chrétienne, 1907-1909, t. CLIV, CLVI, CLVIII, CLIX). Lea (H. Ch.). - Histoire de l'Inquisition. (Trad. française de Salomon Reinach). - Paris, 1900-1902, 3 vol.
Molinier (Ch.). - L'Église et la Société cathare. (Revue historique, 1907, t. XCIV, p. 225-248; t. XCV, p. 1-22, 263-291). Molinier (Ch.). - L'Inquisition dans le Midi de la France aux XIII e et XIVe siècles. - Paris, 1880. In-8°, XXVII-467 p.
Roch (D.). - L'Église romaine et les cathares albigeois, 1957. In-16, 204 p.
Tanon (Louis). - Histoire des tribunaux de l'Inquisition en France. - Paris, 1893. In-8°, 567 p.
ÉTUDES LOCALES
Béziers.
Bascoul. - La Croisade contre les Albigeois; le sac de Béziers, l'Inquisition. (Revue du Midi, 1895, p. 464-495). Domairon (L.). - Rôle des hérétiques dans la ville de Béziers à l'époque du désastre de 1209. (Cabinet historique, 1863, t. IX, p. 95-103). Haeger (Van der). - Le Siège de Béziers. - Paris, 1863. In-8°, 55 p.
Niel (F.). - Béziers pendant la croisade contre les Albigeois. (Cahiers d'études cathares, 1953, n° 15). Tamizey de Larroque. - Mémoire sur le sac de Béziers dans la guerre des Albigeois et sur le mot: "Tuez-les tous". - Paris, 1862. In-8°, 32 p.
Castelnaudary.
Marfan (Dr Antoine). - Conférence sur la guerre des Albigeois dans le Lauraguais et dans les environs de Castelnaudary. - Castelnaudary, 1895. In-8°, 39 p.
Salvat (Abbé J.). - Castelnaudary pendant la guerre des Albigeois. (Bulletin de la Société archéologique de l'Aude, 1930). Carcassonne.
A struc (Chanoine J.). - L'Albigéisme et la prise de Carcassonne par les croisés en 1209. - Carcassonne, Bonafoux, 1908.
A struc (Chanoine J.). - La Conquête de la vicomté de Carcassonne par Simon de Montfort. - Carcassonne, Gabelle, 1912.
Bessé (G.). - Histoire des comtes de Carcassonne. - Béziers, 1645, In-4°, VIII-256 p.
Delpoux (Ch.). - Le Siège de Carcassonne et l'Inquisition. (Cahiers d'études cathares, 1951, n° 11). Douais (C.). - Soumission de la vicomté de Carcassonne par Simon de Montfort, et la croisade contre Raymond VI comte de Toulouse. - Paris, 1884. In-8°, 70 p.
Douais (C.). - Un épisode des croisades contre les Albigeois: le siège de Carcassonne, 1-15 août 1209. (Revue des Questions historique, 1882, t. XXXI, p. 121-159). Douêt d'Arcq (L.). - Siège de Carcassonne, 1240. (Bibliothèque de l'École des Chartes, II, p. 363-379). Germain (A.). - Inventaire inédit concernant les archives de Carcassonne. - Montpellier, Martel, 1856. In-4°, 24 p.
Girou (J.). - Les Emmurés de Carcassonne ou la vie de Bernard Délicieux. - Aix-en-Provence, 1948. In-16, 260 p.
Jeanjean (J.-F.). - La Croisade contre les Albigeois à Carcassonne. - Carcassonne, Bonafoux, 1941. In-8°, 103 p.
Poux (J.). - La Cité de Carcassonne. - Toulouse, Privât, 1930, 3 vol. in-4°. (Voir t. II, chap. 2 et 3). Cordes.
Portal (Ch.). - Histoire de la ville de Cordes. - Albi, 1902. In-8°, XII-695 p. (Voir p. 12-40). Foix.
Castillon. - Histoire du comté de Foix. - Toulouse, 1852, 2 vol. In-8°.
Laffont (J.). - Albigeois du pays de Foix. - Cannes, 1955. In-16, III, p.
La Salvetat.
CABIE (E.). - La Salvetat-sur-Garonne, théâtre de l'un des combats de la guerre des Albigeois. (Revue de Gascogne, 1885, p. 201-208). Lavaur.
Toulouse-Lautrec (R. de). - Le Siège de Lavaur. (Revue du Tarn, 1885, p. 334). Collin (Ch.). - Histoire de Lavaur, 1944. In-8°, 119 p.
Lavelanet.
Causson (A.). - Le Siège du château de Lavelanet en 1212. - Le pays d'Olmes, 1929.
Limoux.
Sabarthes (A.). - Un épisode de l'Albigéisme à Limoux. (Bulletin philosophique et historique, 1932-1933). Sabarthes (A.). - L'Albigéisme à Limoux et le prétendu déplacement de cette ville. - Paris, 1926.
Minerve.
Boyer (Ch.). - Le Siège de Minerve. - Carcassonne, 1934. In-8°, 52 p.
Girou (J.). - Minerve, autel et bûcher de la patrie romane. (Cévennes et Méditerranée, 1950, n° 43). Sicard (G.). - Excursion [à Minerve]. (Bulletin de la Société d'Études scientifiques de l'Aude, 1900, p. 46-49). Mirepoix.
Pasquier (F.). - Cartulaire de Mirepoix. - Toulouse, Privât, 1921, 2 vol. in-4°. (Voir t. I, Introduction). Montségur.
Caumont (B.). - Siège et capitulation de Montségur. (Revue historique du Tarn, 1944). Caussou (A.). - Montségur. Prumiero partido. - Trencabel, Ramon Roger, 1206-1267. - Labelanet, 1890. In-16, 208 p.
Cazenove (R. de). - Les Ruines de Montségur. - Toulouse, Chauvin, 1883. In-8°, 16 p.
Comte (P.). - Le Graal et Montségur. (Bulletin de la Société Archéologique et historique du Gers, 1951, p. 332-345). Courrent (P.). - Visite du château de Montségur. (Bulletin de la Société archéologique de l'Aude, 1935). Courrent (P.). - Montségur, son rôle pendant la croisade des Albigeois. - Carcassonne, Gabelle, 1932. In-8°, 74 p.
Dossat (J.). - En marge de la prise de Montségur. (Revue du Tarn, 1944, p. 365-367). Eschouer (R.). - Toujours Montségur. (Revue du Languedoc, 1946). Gaussen. - Montségur, roche tragique. - Foix, Gadret, 1905. In-8°, 84 p.
LAFFONT (J.). - Autour du mystère de Montségur: Montségur et le Graal. - Cannes, 1945. In-8°, 31 p.
Lafurte (Pierre). - La Citadelle de Montségur. - Toulouse, 1894. In-8° 50 p.
MARCERON (Dr). - Montségur, mont du Graal. (La Montagne, revue du club alpin français). Niel (F.). - Montségur, la montagne inspirée. - Paris, La Colombe, 1954. In-8°, 239 p. (Très important ouvrage). Niel (F.). - La Capitulation de Montségur. (Cahiers d'études cathares, 1951, nos 5-6). Niel (F.). - Le Pog de Montségur. - Toulouse, Ed. I. E. O., 1949. In-8° 63 p.
Pasquier (F.). - Le Vandalisme au château de Montségur. (Bulletin de la Société archéologique de Toulouse, 1903). Roch (D.). - La Capitulation et le bûcher de Montségur. (Mémoires de la Société archéologique de l'Aude, 1944-1946). Salvat (Abbé J.). - Montségur (1244). - Toulouse, Collège d'Occitanie, 1954, In-16, 32 p.
Sigre (Ph.). - Le Château de Montségur. - Toulouse, 1954. In-80, 219 p.
Sire (S.-J.-P.-M.). - Châteaux en Languedoc: Montségur, Cabaret. (Cahiers du Sud, août-oct., 1942). Muret.
A nglade (J.). - La Bataille de Muret, d'après la ""Chanson de la Croisade"". - Toulouse, 1913. In-16, 99 p. (Texte et traduction). Assie (P.). - Bataille de Muret. - Toulouse, 1895. In-16, 25 p.
Delpech (H.). - Un dernier mot sur la bataille de Muret. (Bulletin de la Société des études romanes, 1878). Delpech (H.). - La Bataille de Muret et la tactique de la cavalerie au XIIIe siècle. - Paris, 1878.
Dieulafoy. - La Bataille de Muret. - Paris, 1859. In-4°, 44 p.
Ducos (FI.). - Note sur une circonstance de la bataille de Muret. (Mémoires académiques de la Société de Toulouse, 1853). Fons (V.). - Notice historique sur l'arrondissement de Muret. - Muret, 1852. In-8°, 212. (Voir p. 90-105: La bataille de Muret).
Gouget (A.). - Note sur le champ de bataille de Muret pendant la guerre des Albigeois. (Bulletin archéologique du Tarn-et-Garonne, 1881). Gouget (A.). - Vestiges du champ de bataille de Muret. (Revue de Gascogne, 1882). Molinier (A.). - La Bataille de Muret d'après les chroniques contemporaines. (Voir Dom Vaissette, "Histoire du Languedoc", éd. Privât, t. VII, p. 448-461). Pujols.
Molinier (Victor). - Notice historique sur la prise et la démolition de la forteresse de Pujols par les Toulousains, pendant la guerre des Albigeois, en 1213. (Mémoires de la Société académique de Toulouse, 1861). Quéribus.
Niel (F.). - La Dernière forteresse cathare. Quéribus. (Cahiers d'études cathares, 1951, nos 9 et 10). Quercy (Le)
PÉRIE (R.). - Histoire politique, religieuse et littéraire du Quercy. - Cahors, 1861-1865. (Voir t. I, p. 537-658). Roquefixade.
Darnaud (E.). - Le Passé de Roquefixade. - Paris, 1884. In-12, 52 p.
Toulouse.
A ldeguier (J.-B. A. d'). - Histoire de la ville de Toulouse. - Toulouse, 1834, 4 vol. in-8°. (Voir t. II, p. 212-439). Catel. - Histoire des comtes de Tolose avec quelques traités et chroniques anciennes concernant la même histoire. - Toulouse, Bosc, 1623, 1 vol. in-folio.
Douais (C.). - Les Hérétiques du comté de Toulouse dans la première moitié du XIII e siècle d'après l'enquête de 1245. - Paris, 1891. In-8°, 19 p.
Martura (J.-F. B.-A.). - Histoire des comtes de Toulouse. - Castres, 1827. In-8°, XVI-448 p.
Moline de Saint-Yon. - Histoire des comtes de Toulouse. - Paris, 4 vol. in-8°. (Voir t. III et IV). Ramet (H.). - Histoire de Toulouse. - Toulouse, 1935. Gr. in-8°, 922 p. (Voir chap. 4 et 5). Ussat.
GADEL (A.). - Ussat-les-Bains. La Cathédrale et les trois églises des Cathares albigeois. (Bulletin de la Société archéologique du Tarn-et-Garonne, 1930 et 1931).
ÉTUDES BIOGRAPHIQUES
Blanche de Castille.
Berger (G.). - Histoire de Blanch. de Castille. - Paris, 1895. In-8° x-428 p. (Voir plus particulièrement p. 93100). Saint Dominique.
Guimaud (J.). - Saint Dominique. - Paris, 1898. (Un volume de la collection "Les Saints"). Mandonnet (Le P.). - Saint Dominique, l'idée, l'homme et l'œuvre. - Paris, 1937, 2 vol. in-8°. (Voir t. I). Esclarmonde de Foix.
Bernard (Valère). - La Legenda d'Esclarmonda. - Toulouse, 1936. In-8°, LVI-239 p.
Coincy-Saint-Palais (Simone). - Esclarmonde de Foix, princesse cathare. - Toulouse, 1956. In-8°, 196 p.
Laffont (J.). - Digression autour d'Esclarmonde de Foix et de Raymond de Perelhat. - S.E.N.D. In-8°, 54 p.
NelLI (Suzanne). - Esclarmonde de Foix. (Cahiers d'études cathares, 1956, n° 24). Palauqui (Louis). - Esclarmonde de Foix. - Foix, 1911. In-8°, 39 p.
Vidal (Mgr J.-M.). - Esclarmonde de Foix dans l'histoire et le roman. - Toulouse, 1911. In-16, 41 p.
Vidal (Mgr J.-M.). - Esclarmonde de Foix dans la poésie. - Rome, 1911. In-8°, 40 p.
Foulque de Marseille.
Laffont (J.). - Le Neuvième prieur du Thoronet; Foulque, évêque de Toulouse. - Cannes, 1948. In-8°, 42 p.
Innocent III.
Luchaire (A.). - Innocent III et la croisade des Albigeois. -Paris, 1905. In-16, 262 p.
Hurter (F.). - Histoire du pape Innocent III et de ses contemporains. - Paris, 1838, 3 vol. (Voir t. III, p. 1-101). Louis VIII.
Petit-Dutailus (Ch.). - Étude sur la vie et le règne de Louis VIII. - Paris 1894, In-8°, XLIV-568 p.
Philippe-Auguste.
Capefigue (J.-B.). - Histoire de Philippe-Auguste. - Paris, 1829. 4 vol. in-8°. (Voir t. III). Pierre de Castelnau.
Bouillerie (Mgr de La). - Le Bienheureux Pierre de Castelnau et les Albigeois au XIII e siècle. - Paris, 1867. In-12, XII-69 p.
Simon de Montfort.
Boissons (R. de). - Les Deux expéditions de Simon de Montfort en Sarladais. (Bulletin de la Société historique du Périgord, 1900). Canet (V.). - Simon de Montfort et la croisade contre les Albigeois. - Lille, 1882. In-8°, 294 p.
Du Velay (A.). - Simon de Montfort à la croisade des Albigeois, 1875.
Girou (J.). - Simon de Montfort, du catharisme à la conquête. - Paris, 1953. In-8°, 207 p.
Malafosse (L. de). - Sur un passage de la "Chanson de la Croisade" relatif à la mort de Simon de Montfort. (Bulletin de la Société archéologique du Midi de la France, 1891). Malafosse (L. de). - Le Siège de Toulouse par Simon de Montfort. (Revue de Pyrénées, 1892). Molinier (A.). - Catalogue des actes de Simon et d'Amaury de Montfort. - Paris, 1871. In-8°, 110 p.
Varagnac (A.). - Pourquoi Simon de Montfort s'en alla défaire les Albigeois? (Annales, 1946, n° 3).
LES ALBIGEOIS DANS LA POÉSIE, DANS LE ROMAN ET AU THÉÂTRE.
Bonhomme (F.), et ESCOFFIER (G.). - Les Albigeois (drame en 5 actes). - Avignon, 1903. In-8°, 56 p.
Cénac-Moncaut (J.). - Adélaïde de Montfort ou la Guerre des Albigeois (roman historique). - Paris, 1849. In-16, 717 p.
Ducos (Fl.). - L'Epopée Toulousaine, ou la Guerre des Albigeois (poème en 24 chants). - Toulouse, 1850. 2 vol. in-8°.
La Cave (J. de). - Le Drame de Minerve (drame en 5 actes). - Toulouse, 1956. In-16, 89 p.
Lenau (N.). - Die Albigenser (poème épique; cf. l'édition allemande de ses Œuvres complètes).
Magre (Maurice). - Le Trésor des Albigeois. - Paris, 1938. In-16, 254 p; Magre (Maurice). - Le Sang de Toulouse, Paris, 1931.
Maturin (R. P. Charles-Robert). - The Albigenses, a romance. - London, 1824. 4 vol. in-12. (Trad. en français en 1825, avec une notice biographique sur l'auteur). Soulié (Frédéric). - Le Comte de Toulouse (roman). - Paris, 1840. In-16, 368 p.
Soulié (Frédéric). - Le Vicomte de Béziers. - Paris, 1834.
Soulié (Frédéric). - Le Comte de Foix. - Paris, 1852, 2 vol.
Suberville (Jean). - Simon de Montfort (pièce en 4 actes en vers). - Paris, 1926. In-16, 149 p.
Windeler (B. Cyril). - Roger de Trencavel, vicomte de Carcassonne (drame historique en 3 actes). - Carcassonne, 1937. In-8°, 159 p.