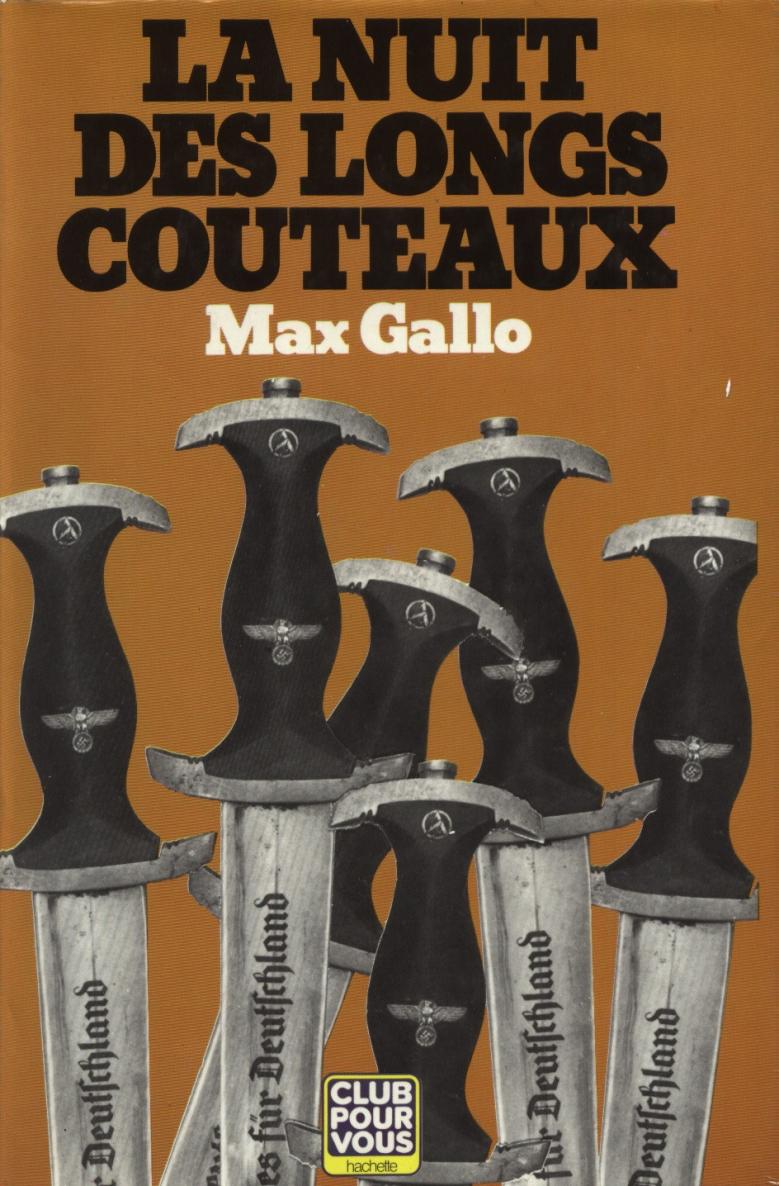
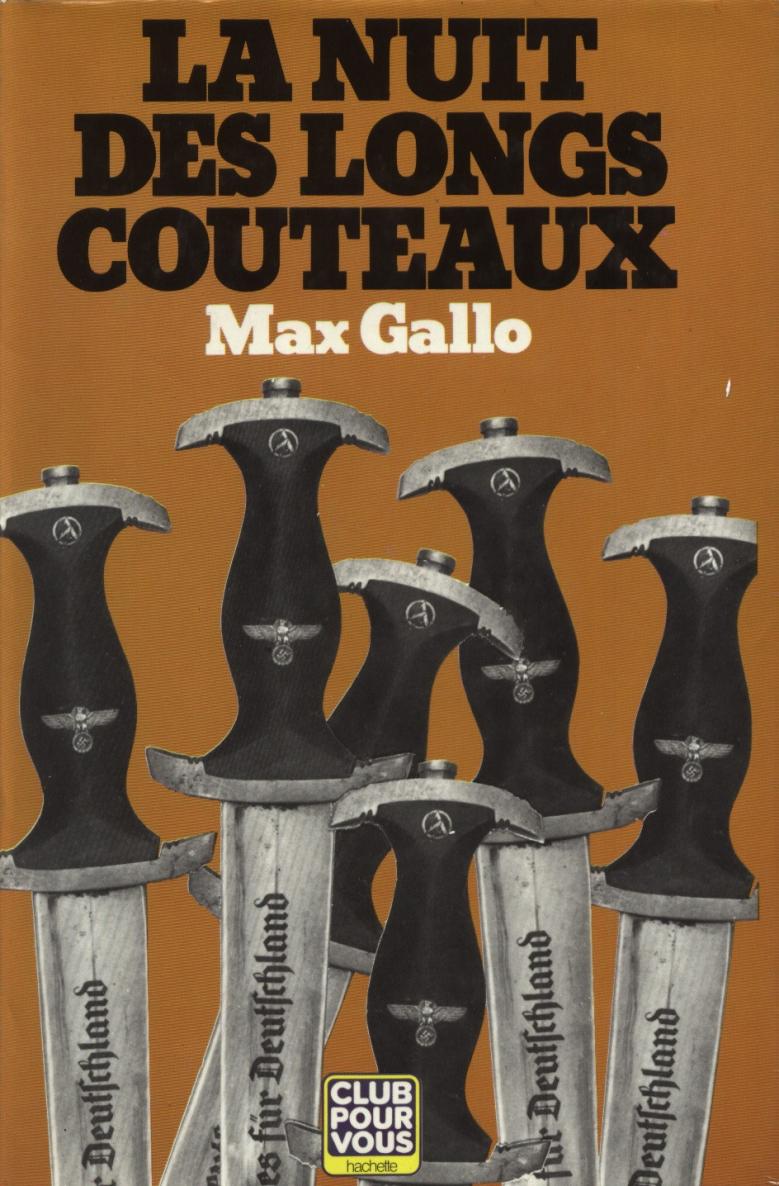
MAX GALLO
LA NUIT DES LONGS COUTEAUX
DU MEME AUTEUR
Chez le même éditeur :
ROMANS
Le cortège des vainqueurs, 1972
Un pas vers la mer, 1973
HISTOIRE. ESSAIS
La grande peur de 1989, 1966
Gauchisme, réformisme et révolution, 1968
Histoire de l'Espagne franquiste, 1969
La nuit des longs couteaux, 1970
Tombeau pour la Commune, 1971
En collaboration avec Martin Gray
Au nom de tous les miens, 1971
Chez d'autres éditeurs :
L’Italie de Mussolini, Perrin, 1964
L'affaire d’Ethiopie, Le Centurion, 1967
Maximilien Robespierre, Perrin, 1968
Cinquième colonne 1930-1940, Pion, 1970
MAX GALLO
LA NUIT DES LONGS COUTEAUX
30 juin 1934
Sélectionné par le CLUB POUR VOUS - HACHETTE
SOMMAIRE
AVERTISSEMENT ............................................................................................ 9
PROLOGUE..................................................................................................... 10
PREMIÈRE PARTIE
LA NUIT RHÉNANE
1. Vendredi 29 juin 1934. Godesberg. Hôtel Dreesen, entre 14 heures et 21 heures ... 20
2. Vendredi 29 juin 1934. Godesberg. Hôtel Dreesen. Vers 21 h 30… 33
3. Vendredi 29 juin 1934. Godesberg. Hôtel Dreesen. Vers 22 heures... 50
4. Vendredi 29 juin. Godesberg. Hôtel Dreesen. Vers 22 h 30… 58
5. Vendredi 29 juin 1934. Godesberg. Hôtel Dreesen. Vers 23 heures ... 74
6. Samedi 30 juin 1934.Godesberg. Hôtel Dreesen.Vers 0 heure... 88
DEUXIÈME PARTIE
CE MOIS QUI MEURT EN CE JOUR QUI COMMENCE
1. Samedi 30 juin 1934. Godesberg. Hôtel Dreesen. 1 heure... 93
2. Samedi 30 juin 1934. Godesberg. Hôtel Dreesen. 1 h 15 ... 102
3. Samedi 30 juin 1934. Route de Godesberg & Bonn-Hangelar 1 h 30... 109
4. Samedi 30 juin 1934. Aéroport de Bonn-Hangelar : 1 h 45… 117
5. Samedi 30 juin 1934. Aéroport de Bonn-Hangelar : 1 h 30… 126
6. Samedi 30 juin 1934. En vol au-dessus de Taunus : 2 h 30… 142
7. Samedi 30 juin 1934. En vol au-dessus d'Augsbourg : 3 h 30... 157
TROISIÈME PARTIE
« JUSQU'A BRULER LA CHAIR VIVE »
1. Samedi 30 juin 1934. Munich. Entre 4 heures et 6 heures… 161
2. Samedi 30 juin 1934. Bad Wiessee, pension Hauselbauer, 6 h 30 ... 166
3. Samedi 30 juin 1934. Berlin, dans la matinée... 174
4. Samedi 30 juin 1934. Munich, 10 heures - 20 heures ... 187
5. Samedi 30 juin 1934. Munich, Gleiwitz, Breslau, Brème... 195
6. Samedi 30 juin 1934. Berlin. Fin de l'après-midi ... 199
7. Nuit du samedi 30 juin 1934. Du dimanche 1" juillet au lundi 2 juillet,
vers 4 heures du matin… 206
ÉPILOGUE … 215
« CETTE FOIS, NOUS ALLONS LEUR RÉGLER LEUR COMPTE »
ANNEXES … 234
1. Extraits du discours du ministre d'Etat et chef d'état-major Ernst Rœhm au corps diplomatique et à la presse étrangère à Berlin, le 18 avril 1934 ... 234
2. Extraits du discours prononcé par le chancelier Hitler devant le Reichstag à l'Opéra Krool le 13 juillet 1934 à 20 heures... 237
Bibliographie ... 247
Photos … 250
« La nuit a été singulière : où nous dormions, Nos cheminées étaient renversées par le vent, Et dit-on, furent entendues des lamentations Dans l'air, avec d'étranges cris de mort, Et qui prophétisaient en terribles accents D'horribles rébellions, confus événements, nouvellement éclos pour des époques noires. »
Lennox in Macbeth II, 3 trad. de P.J. Jouve Club français du livre.
« Comment ne point penser à Richard le Troisième ?
Jamais depuis le temps de Lancastre et Tudor,
Jamais on n'avait vu la même Hitoire de flamme et de mort »
Bertolt Brecht, La Résistible Ascension d'Arturo Ui.
« On ne cachait pas que, cette fois, la révolution devrait être sanglante ; on parlait pour la désigner de la Nuit des longs couteaux. »
Adolf Hitler, le 13 juillet 1934.
« J'étais responsable de la nation allemande et, en conséquence c'est moi qui, pendant vingt-quatre heures, étais à moi seul, le Justicier suprême du peuple allemand.
Dans tous les temps et ailleurs, on a décimé les mutins... J'ai donné l'ordre de fusiller les principaux coupables et j'ai donné l'ordre aussi de cautériser les abcès de notre empoisonnement intérieur et de l'empoisonnement étranger jusqu'à brûler la chair vive... »
Adolf Hitler, le 13 juillet 1934.
« Ce n'est pas un beau crime... Du sang, de la volupté et de la mort ? Ah que non point ! On y sent la complicité, la trahison, l'hypocrisie. Ces cadavres sont exhibés dans la fange et les meurtriers se sont ménagés un alibi. Le bourreau se fait pudibond. Il ne tue pas seulement : il prêche. Il a toléré le stupre et l'orgie, et, quand il croit avoir à se défendre lui-même, c'est au nom de la vertu qu'il frappe. Vieille Allemagne... tu n'as pas mérité ça. »
Journal Le Temps, 3 juillet 1934.
Avertissement
Ce texte est un récit historique. C'est-à-dire que, délibérément, nous avons tenté de recréer l'événement non seulement dans ses causes générales ou dans ses mécanismes politiques mais aussi en évoquant les attitudes, les pensées, les visages de tel ou tel acteur ou encore en décrivant la couleur du ciel et les paysages qui servent de cadre à ces jours tragiques. Ce parti pris nous l'avons choisi peut-être pour dépasser un temps la rigueur un peu abstraite de l'analyse et surtout pour tenter de faire renaître un climat, un régime et une époque qui, Brecht ne s'y est pas trompé, renvoient à Shakespeare irrésistiblement.
Pour construire ce récit nous avons utilisé plusieurs sources. Les archives de l'Institut d'histoire contemporaine de Munich, les documents publiés à l'occasion de tel ou tel procès, les journaux du temps, les Mémoires des protagonistes, les études historiques relatives à l'événement lui-même et au IIIeme Reich. Enfin nous avons interrogé ceux des acteurs, grands ou anonymes, que nous avons pu retrouver et qui ont accepté de répondre à nos questions. Nous avons aussi parcouru les lieux de l'action.
Tous ces éléments nous les avons fondus ensemble, ordonnés comme dans un scénario où les temps se chevauchent, se télescopent, où le passé se mêle au présent car l'événement court, se construit minute après minute mais il concentre à chaque instant toute l'histoire déjà vécue. Et ne pas évoquer cette histoire c'est rendre l’événement obscur, incompréhensible.
Au lecteur de dire si ce puzzle et cette totalité qu'est une journée historique sont clairement reconstitués ici.
Qu'il soit répété que ce livre doit être pris pour ce qu'il a voulu être, un récit, et que notre ami germaniste Jacques Celerne soit remercié pour l'aide qu'il nous a apportée.
Max GALLO
PROLOGUE
Dans la prison de Stadelheim, à Munich, un peloton de S.S. a pris position dans la cour. C'est la fin de l'après-midi du samedi 30 juin 1934. Rapidement le Gruppenführer Sepp Dietrich parcourt les couloirs de la prison. Derrière les portes des cellules les hommes qui jusqu'à hier soir étaient ses camarades ou ses chefs attendent depuis plusieurs heures qu'on décide de leur sort. Sepp Dietrich sait qu'ils vont mourir. A chacun d'eux, détournant son regard il va lancer :
« Vous avez été condamné à mort par le Führer pour haute trahison. Heil Hitler »
Et il se fait ouvrir une autre porte ignorant les cris et les jurons. Déjà on entraîne dans la cour le premier prisonnier et l'officier SS qui commande le peloton de l'Ordre Noir crie dans la lumière rousse de juin :
« Le Führer l'exige. En joue. Feu. »
Edmund Schmid, Gruppenführer de la Sturmabteilung — l'armée des Sections d'Assaut —, cellule 497. Fusillé.
Hans Joachim von Spreti-Weilbach, Standartenführer S.A., cellule 501. Fusillé.
Hans Peter von Heydebreck, Gruppenführer S.A., cellule 502. Fusillé.
Hans Hayn, Gruppenführer S.A., cellule 503. Fusillé.
August Schneidhuber, Obergruppenführer S.A., préfet de police de Munich, cellule 504. Fusillé.
Quelques heures plus tard, un homme au visage balafré, sera abattu dans une cellule voisine portant le n° 474, par deux S.S. C'est Ernst Rœhm, ministre du Reich, l'un des fondateurs du parti nazi, chef d'Etat-major de la S.A. A Berlin, des tueurs assassinent le général Schleicher, ancien chancelier du Reich et sa femme. Ils abattent son adjoint au ministère de la Guerre, le général Bredow, ancien chef du Ministeramt, et un tueur solitaire liquide d'une balle dans le dos, dans son bureau du ministère des Transports, le Ministerialdirektor Klausener.
LA FIN D'UNE SEMAINE D'ETE
D'autres, beaucoup d'autres tombent : Jung, secrétaire particulier de Franz von Papen, vice-chancelier du Reich ; Gregor Strasser compagnon de Hitler depuis les premiers jours. Tous, illustres ou modestes, fusillés ou abattus entre le samedi 30 juin 1934 et le lundi 2 juillet durant cette longue nuit de l'histoire allemande, la Nuit des longs couteaux où tombent des hommes qui paraissaient les plus nazis parmi les nazis, les plus proches alliés de Hitler, ses camarades — Strasser, Rœhm — ou ceux qui semblaient les mieux protégés, les généraux Schleicher et Bredow.
Et le IIIeme Reich, le monde entier, surpris, ignorant les détails et le nombre des victimes s'interrogent, manquant d'informations précises, formulant les hypothèses les plus contradictoires. C'est que la mort nazie a frappé comme tant de fois elle le fera encore, à la fin d'une semaine, quand dans les capitales les responsables sont loin des ministères vides où ne demeurent que quelques fonctionnaires subalternes chargés d'expédier les affaires courantes, qu'il faut des heures pour trouver telle ou telle personnalité en promenade ; la mort nazie frappe en ces fins de semaine du printemps et de l'été quand les rédacteurs en chef dorment tranquillement sur leurs éditions dominicales déjà bouclées puisqu'il ne peut rien se passer d'important ; quand les villes sont désertées, que la vie publique est suspendue, la garde relâchée. Alors frappe la mort nazie comme un éclair inattendu.
Il fait si beau, si chaud sur toute l'Europe en ce samedi 30 juin 1934 et ce dimanche 1er juillet A Nogent, c'est dans le miroitement du fleuve, les canoteurs et les grappes de danseurs, la foule de la grande foire joyeuse de l'été. Autour de Londres et dans ses parcs l'herbe est drue et elle n'est pas humide : on y court pieds nus, on s'y allonge.
Sur les grèves des lacs berlinois, la foule est dense : femmes aux corps lourds, enfants blonds. L'oriflamme nazie flotte au mât des plages dans la brise tiède. A Berlin, ce samedi matin la radio annonce une température de 30°. Ce n'est que dans la soirée de samedi et surtout le dimanche que l'on apprend que des salves de peloton, des coups de revolver, ont sèchement claqué, décimant les rangs de la Sturmabteilung, l'armée des Sections d'Assaut
Pourtant le dimanche 1er juillet, dans l'après-midi, Berlin est toujours calme : promeneurs, consommateurs dans les cafés sont aussi nombreux que les autres dimanches. Sur Unter den Linden, c'est l'aller et retour des couples renouvelés. Au Kranzler, le célèbre café, il est impossible de trouver une table : c'est un dimanche d'été. La bière blanche berlinoise, teintée de sirop de framboise, coule à flots.
Presque trop d'indifférence. Les journaux du soir annoncent discrètement quelques décès. Des camions chargés de Schutzstaffeln, les S.S. noirs, passent. Mais personne ne commente ou ne cherche à savoir. Le Führer Adolf Hitler donne une garden-party très élégante dans les jardins de la Chancellerie du Reich. Tout va bien.
Anxieux, aux aguets dans ce calme apparent, les journalistes et les diplomates étrangers cherchent à savoir, à comprendre. Les interrogations affluent venant de leurs rédactions et des ministères. Combien de morts ? Qui ? Pourquoi ? On demande si X ou Y, ancien chancelier, fait ou ne fait pas partie des victimes. L'émotion, la surprise, l'indignation s'expriment ouvertement André François-Poncet l'ambassadeur de France, a dîné, il y a peu avec le capitaine Rœhm, chef d’Etat-major des S.A., mais François-Poncet est en vacances à Paris et il ne peut donner au ministère des Affaires étrangères que son impression sur ce Munichois de 57 ans qui est entré au Parti en même temps que Hitler et a aidé le futur chancelier dans ses premiers pas politiques.
« Je n'avais aucune idée des manœuvres de Rœhm, raconte François-Poncet Je ne me doutais pas de l'acuité qu'avait revêtue son conflit avec Hitler. J'avais toujours éprouvé à son égard une extrême répugnance et l'avais évité autant que j'avais pu, malgré le rôle éminent qu'il jouait dans le IIIeme Reich. Le chef du protocole, von Bassewitz, me l'avait reproché et, sur ses instances, je n'avais pas refusé de le rencontrer à une soirée. L'entrevue avait été peu cordiale et l'entretien sans intérêt [1] ». Mais Rœhm a été abattu.
On murmure aussi des noms de généraux, l'un qui fut chancelier, des noms de hauts fonctionnaires, et parfois à ces personnalités se mêle le nom d'un inconnu, d'un juif dont on a retrouvé le corps, d'un aubergiste, puis c'est à nouveau le nom de l'un des fondateurs du parti, Gregor Strasser lui-même. Tous abattus sans explication par des équipes de tueurs sans passion, méthodiques et glacés. Abattus devant leurs portes, devant témoin, et parfois l'épouse a payé de sa vie un mouvement trop brusque. Les cadavres sont restés là, dans une entrée, un bureau de ministère, sur le bord d'une route, dans un bois ou à demi enfoncés dans l'eau d'un marécage. Quelques heures plus tard, la police est arrivée, les corps ont été emportés ou bien plusieurs jours après on les a découverts par hasard. On a tué à Munich, à Berlin, en Silésie. Des pelotons d'exécution ont fonctionné dans les cours des casernes. Quelques dizaines ou quelques centaines de victimes ? Des hommes sont morts en criant Heil Hitler, d'autres en maudissant le Führer. On a été sans égards pour les proches, sans pitié pour les victimes : on a tué des hommes dans leur lit et on en a égorgé d'autres dans des caves. Les Nazis ont-ils, au cours de cette nuit, selon la logique implacable des révolutions, commencé à s'entredévorer ?
A Rome, le baron Pompeo Aloisi, aristocrate devenu chef de cabinet de Mussolini, est perplexe. Il y a moins de quinze jours, le 14 juin, à Venise, il a assisté à la première rencontre entre le Duce et le Führer. Rien ne laissait soupçonner les événements. Malgré quelques rumeurs, les Sections d'Assaut semblaient toujours l'une des forces sur lesquelles s'appuyait le régime. Les hommes en chemise brune et leur chef, le capitaine Rœhm, n'avaient-ils pas aidé Hitler à conquérir le pouvoir en contrôlant les rues des villes allemandes ? Maintenant, en ce 1er juillet, Aloisi note dans son journal : « La répression a été très dure car sur treize généraux de corps d'armée des Sections d'Assaut sept ont été fusillés. » Au fur et à mesure que, au poste privilégié qu'il occupe, Aloisi reçoit des renseignements nouveaux, il s'étonne davantage des circonstances de la tuerie. « Une Saint-Barthélemy allemande », dira Otto Strasser, le frère de Gregor. Mussolini ne cache pas son mépris. « Pendant les arrestations, lui a précisé Aloisi, il s'est passé des scènes répugnantes. » Le Duce avec sa virilité orgueilleuse de Latin a déjà insisté sur cet aspect. « Une des caractéristiques de la révolte, a-t-il conclu, est que la majeure partie des dirigeants étaient tous des pédérastes, à commencer par Rœhm. »
Rœhm « avait quelque chose de repoussant » dit André François-Poncet qui, à Berlin était le plus élégant et le plus spirituel des ambassadeurs. « Un banquier très versé dans la société berlinoise, raconte-t-il, et qui se plaisait à réunir autour de sa table les personnalités les plus diverses de l'ancien et du nouveau régime, m'avait instamment prié d'aller dîner chez lui pour faire plus ample connaissance avec Rœhm, j'avais accepté... »
L'ambassadeur de France, digne, hautain même, souverain dans ses manières et par son intelligence se rend donc à l'invitation. Le dîner n'est en rien clandestin. « II était servi par Horcher, le restaurateur le plus couru de Berlin. » François-Poncet attend donc le capitaine Rœhm. « Il était venu, se souvient-il, accompagné de six ou huit jeunes gens frappants par leur élégance et leur beauté. Le chef des S.A. me les présenta comme ses aides de camp. » Mais la surprise passée, François-Poncet s'ennuie, « Le repas avait été morne. La conversation insignifiante. J'avais trouvé Rœhm lourd et endormi. Il ne s'était animé que pour se plaindre de son état de santé et de ses rhumatismes qu'il se proposait d'aller soigner à Wiessee si bien qu'en rentrant chez moi, je pestais contre notre amphitryon ; je le rendais responsable de l'ennui de cette soirée. » Mais plus tard, repensant à ce dîner et à son hôte berlinois, François-Poncet ajoute : « Lui et moi, après le 30 juin, en étions les seuls survivants ; et lui-même ne dut son salut qu'au fait qu'il réussit à s'enfuir en Angleterre [2]. »
ERNST RŒHM
Rœhm exécuté, Rœhm, chef d'Etat-major des S.A. depuis le 5 janvier 1931, nommé à ce poste clé par le Führer en personne.
Le 2 décembre 1933, Hitler l'a même fait entrer dans son cabinet comme ministre sans portefeuille. Rœhm, on le voit partout en uniforme de S.A., passant en revue les unités de cette immense troupe de 2 500 000 hommes qu'il a constituée. Il parade, il parle, orgueilleusement provocant. Les mots les plus neutres deviennent chez lui, violents, durs, choquants presque. Peut-être est-ce à cause de sa laideur qui est au-delà même de la laideur. Le crâne est toujours rasé, le visage est gros, joufflu, vulgaire, parcouru d'une large cicatrice qui enserre le menton et le nez. Le bout de celui-ci, résultat d'une de ces opérations de chirurgie faciale qu'on pratiquait sur les « gueules cassées », pointe, rond, rouge, caricatural. Rœhm est là, pourtant, avec quelque chose de poupin dans cette physionomie violente et rude. Il est là, entouré de beaux jeunes gens aux joues lisses, aux yeux doux, aux profils de médailles, aux mains soignées, serrés dans leurs uniformes bien coupés. Rœhm est là, avec son visage difficile à supporter, un visage animal, là debout, avec son ventre proéminent que semble mal contenir le baudrier des S.A.
Lui, il fixe ses interlocuteurs avec audace et insolence, avec l'autorité du Chef, du maître qu'il est, avec tranquillité et orgueil. « Je suis soldat dit-il, je considère le monde de mon point de vue de soldat, c'est-à-dire d'un point de vue volontairement militaire. Ce qu'il y a d'important pour moi dans un mouvement c'est l'élément militaire. »
Son visage, ses balafres ce sont ses preuves, ses décorations, la signature de sa vie. 1908, sous-lieutenant. 1914, le voici en Lorraine, officier sur le front, officier de troupe entraînant les soldats dans la boue, le froid et le fer. Le 2 juin 1916, capitaine, il part à l'assaut de l'ouvrage de Thiaumont, l'une des fortifications de la ceinture de Verdun. Blessé gravement, le voici enlaidi, confirmé dans sa peau pour cette vocation militaire. Front roumain, front français, l'armistice et la honte. Il est avec le colonel von Epp de ces hommes des Freikorps, les corps francs, qui luttent pour ne pas avoir combattu en vain pendant quatre ans. Officier de la petite armée de l'armistice, il organise les Gardes Civiques bavaroises pour écraser les « rouges », ces spartakistes persuadés qu'ils peuvent rééditer dans l'Allemagne vaincue et humiliée la révolution russe. Rœhm des années 20, dans le brouillard des hivers bavarois, armant ces milices de l'ordre. Il entre pour le compte de l'armée au Parti Ouvrier Allemand, le futur parti nazi. Là, dans ce milieu de déclassés fanatiques, il rencontre un ancien combattant des premières lignes, pâle, malingre, mais le regard exalté, la passion nationaliste et l'ambition visionnaire brûlant sa vie, un orateur magnétique au débit saccadé : Adolf Hitler, qu'il choisit comme propagandiste du parti. Rœhm abattu le 2 juillet 1934 par deux officiers des S.S. sur l'ordre de Hitler. Chancelier du Reich. Pourtant, six mois avant ce sinistre samedi de juin, quand commence la Nuit des longs couteaux, Rœhm a reçu le 31 décembre 1933, de son Führer une lettre que la presse a rendue publique. Gœring, Goebbels, Hess, Himmler, en tout douze personnes reçurent aussi une lettre de Hitler, ce jour-là, qui marquait, après un an passé à la chancellerie, la reconnaissance de Hitler à ses fidèles camarades. La lettre du Chancelier à Rœhm était nette, elle sonnait franc :
Mon cher Chef d'Etat-major,
« J'ai pu mener le combat du mouvement national-socialiste et de la Révolution nationale-socialiste grâce à la S.A. qui a écrasé la terreur rouge. Si l'armée doit garantir la protection du pays contre le monde extérieur, la S.A. doit assurer la victoire de la Révolution nationale-socialiste, l’existence de l'Etat national-socialiste et l'union de notre peuple dans la sphère intérieure. Lorsque je t’ai appelé à ton poste actuel, mon cher Chef d'Etat-major, la S.A. traversait une crise sérieuse. C'est en tout premier lieu à tes services que cet instrument politique doit d'être devenu en quelques années la puissance qui m'a permis de livrer l'ultime combat pour le pouvoir et de mettre à genoux l’adversaire marxiste. C'est pourquoi à la fin de cette année qui a connu la Révolution nationale-socialiste, je me dois de te remercier mon cher Ernst Rœhm, pour les inestimables services que tu as rendus au nationalisme et au peuple allemand. Sache que je rends grâce à la Destinée de pouvoir donner à un homme tel que toi le nom d'ami et de frère d'armes.
Avec toute mon amitié, toute ma reconnaissance et toute ma considération.
Ton Adolf Hitler »
Rœhm parmi les douze chefs nazis que Hitler vient de distinguer est le seul qui ait eu le privilège d'être tutoyé. « Je rends grâce à la Destinée », écrit Hitler : six mois plus tard, sur son ordre, Rœhm sera abattu. Telle est la Destinée.
LE DISCOURS DU 13 JUILLET 1934
Ernst Rœhm : exécution sommaire donc. Traître au nazisme et au Führer ou trahi par le chef machiavélique qui l'entourait d'égards pour mieux le perdre, comme dans un drame shakespearien où le meurtre, l'hypocrisie et la bassesse se mêlent dans les intrigues pour le pouvoir ?
Hitler attendra près de deux semaines, deux longues semaines après la nuit sanglante, pour donner au peuple allemand l'explication officielle des événements.
La chaleur depuis les derniers jours de juin n'a fait qu'augmenter. Le vendredi 13 juillet, une atmosphère lourde écrase ainsi la capitale du Reich. Le Reichstag est convoqué pour le soir. A partir de 19 heures, des voitures officielles, descendent les députés nazis en uniforme, devant l'Opéra Kroll, à l'ouest de la Kœnigplatz, entre les jardins du Tiergarten et la Spree, dans ce quartier de Berlin aéré et calme. Ils se rassemblent, pénètrent par groupes compacts dans l'Opéra, lourde bâtisse de style néo-classique construite à la fin du XIXeme siècle et où, depuis l'incendie des bâtiments du Reichstag le 27 février 1933, siège le Parlement. Les saluts nazis se succèdent, les uniformes noirs et blancs se mêlent. C'est un monde d'hommes vigoureux, autour de la cinquantaine, les cheveux coupés courts, les gestes sûrs, la parole haute. Ils sont les vainqueurs depuis le 30 janvier 1933. Et ils sont aussi depuis le 30 juin 1934 des hommes qui ont échappé à une première épuration.
Quand Hitler entre et se dirige vers la tribune — gardée par des S.S. car on craint un attentat — tout le monde est debout et salue. André François-Poncet remarque que Hitler est « blême, les traits tirés ». Gœring, président en titre du Reichstag, ouvre la séance à 20 heures et immédiatement passe la parole au Führer qui est déjà à la tribune. Décor d'opéra, loges, fauteuils d'orchestre occupés par les députés en uniforme et le Chancelier qui, nerveusement tient le pupitre placé devant lui puis tend le bras, le poing serré.
« Députés, hommes du Reichstag allemand ! » lance-t-il.
La voix est dure, « plus rauque que d'habitude » se souvient André François-Poncet. Les mots sont lancés comme des ordres ou des coups. Prononcer un discours pour Adolf Hitler est un acte de violence.
Je dois, dit-il, « devant ce forum le plus qualifié de la nation, donner au peuple des éclaircissements sur les événements qui, je le souhaite, demeureront pour l'éternité, dans notre histoire, un souvenir aussi plein d'enseignement qu'il l'est de tristesse ». Dehors dans le Tiergarten, la foule stationne le long des allées fraîches, autour de la Kœnigsplatz. Le discours est retransmis par la radio. Maintenant, puisque le Führer s'explique, le peuple allemand a le droit et le devoir de connaître ce qui a eu lieu au cours de cette nuit de juin.
« Mon exposé sera franc et sans ménagement, continue Hitler, il faudra cependant que je m'impose certaines réserves et ce seront les seules, celles que me dicte le souci de ne pas franchir les limites tracées par le sens des intérêts du Reich, par le sentiment de la pudeur ».
Chaque Berlinois, devant l'Opéra Kroll, en ce vendredi 13 juillet 1934 sait quelque chose : certains journaux ont franchement décrit les « scènes répugnantes » dont parlait le diplomate italien Aloisi. Ces exécutions étaient donc aussi un acte de purification. La purification par le sang et la mort.
« Ce n'étaient plus seulement, martèle Hitler, les intentions de Rœhm, mais maintenant aussi son attitude extérieure qui marquaient son éloignement du Parti. Tous les principes qui ont fait notre grandeur perdirent pour lui leur sens. La vie que le chef d'Etat-major et, avec lui un certain nombre de chefs, commencèrent à mener était intolérable du point de vue national-socialiste. Il n'y avait pas seulement à redouter que lui et ses amis violent toutes les lois de la bienséance, mais que la contagion s'exerce dans les milieux les plus étendus. »
Le capitaine Rœhm, celui que le Chancelier tutoyait comme son plus ancien et son plus fidèle camarade c'était donc transformé en six mois en ce ferment, cet « abcès » qu'il faut détruire. La voix du Chancelier devient plus rauque, plus dure. « Les mutineries se jugent par leurs propres lois, martèle-t-il. J'ai donné l'ordre de fusiller les principaux coupables et j'ai donné l'ordre aussi de cautériser les abcès de notre empoisonnement intérieur et de l'empoisonnement étranger, jusqu'à brûler la chair vive. J'ai également donné l'ordre de tuer aussitôt tout rebelle qui, lors de son arrestation, essaierait de résister... »
« Fusiller, brûler la chair vive, tuer aussitôt. » Les mots claquent, les mots disent la violence de la nuit passée, il y a treize jours, seulement. « L'action est terminée depuis le dimanche 1er juillet dans la nuit. Un état normal est rétabli », ajoute le Chancelier, l'affaire est close. Les badauds peuvent regarder partir les députés ; on applaudit et salue les dignitaires : Hitler, Gœring, Himmler, Hess. Puis Berlin s'endort. Le « Justicier suprême du peuple allemand » a parlé. Hans Kluge se souvient de ce 13 juillet. Il était alors un jeune homme de 18 ans, maigre, blond, enthousiaste. Il habitait avec ses parents près de la Kœnigsplatz. Des groupes partaient en chantant ; la radio transmettait le discours du Chancelier Hitler. Le Führer s'en était pris à « un journaliste étranger qui profite de notre hospitalité et proteste au nom des femmes et des enfants fusillés et réclame vengeance en leur nom.» Hans Kluge se souvient, il avait injurié ce journaliste partial qui trahissait l'hospitalité allemande. En fait il ne savait pas, il ne lisait pas de journaux étrangers. Il n'imaginait même pas que, depuis le 1er juillet, la presse internationale dans son ensemble condamnait les méthodes hitlériennes.
Le Temps, pondéré et austère organe des milieux financiers français, officieux porte-parole du ministère des Affaires étrangères, écrit le 2 juillet que « ces scènes sanglantes » se déroulent « dans une atmosphère à la fois tragique et délétère de Bas Empire ». Le lendemain le journal ajoute : « Ce n'est pas un beau crime... C'est une affaire de police des mœurs. On y sent la culpabilité, la trahison, l'hypocrisie. Ces cadavres sont exhibés dans la fange et les meurtriers se sont ménagé un alibi. Le bourreau se fait pudibond. Il ne tue pas seulement il prêche. Il a toléré le stupre et l'orgie... »
A Londres, à New York, à Chicago, les mêmes mots reviennent. Là, c'est d'un « retour aux méthodes politiques du Moyen Age » qu'il est question. Ici, on indique que les « gangsters de Chicago sont plus honnêtes ». « Turpitudes morales », « sauvageries », « pourriture du nazisme », « férocité calculée et par là même plus répugnante », « despotes orientaux et médiévaux » : la presse internationale est sans excuses pour les nazis. La Pravda, qui n'est pas encore le quotidien d'une Union soviétique en proie aux purges et aux procès, dénonce « les événements du 30 juin qui rappellent les mœurs de l'Equateur ou de Panama ».
Cependant, ce 13 juillet, accroché rageusement à la tribune de l'Opéra Kroll, Hitler poursuit son discours-justification. Dans la salle les députés applaudissent longuement, violemment, Hitler poussé par cette passion qu'il déchaîne, parle de plus en plus rapidement « Si enfin, s'écrie-t-il, un journal anglais déclare que j'ai été pris d'une crise de nerfs, ceci aussi serait aisément vérifiable. Je puis déclarer à ce journaliste famélique que, jamais, même pendant la guerre, je n'ai eu de crise de nerfs... »
La voix est rauque, dure. « Je suis prêt moi-même à assumer devant l'histoire la responsabilité des décisions que j'ai dû prendre pour sauver ce qui nous est le plus précieux au monde : le peuple allemand et le Reich allemand. »
L'auditoire se lève comme un seul bloc, les applaudissements déferlent En ce vendredi 13 juillet soir d'été, alors que par les rues voisines de l'Opéra Kroll, dans les allées du Tiergarten, les groupes s'en vont en chantant ces décisions que le Führer revendique « devant l'histoire », les députés nazis les approuvent par acclamations dans la salle où brillent les grands lustres de cristal taillé.
Mais ces décisions qui ont provoqué les exécutions et les assassinats, elles ont surgi, au terme d'une longue histoire, un autre vendredi, le vendredi 29 juin 1934, au bord du Rhin, à Bad Godesberg. C'est là, dans une soirée orageuse, sur la terrasse d'un hôtel, qu'a commencé la Nuit des longs couteaux.
Première partie
LA NUIT RHÉNANE
Du vendredi 29 juin 14 heures au
samedi 30 juin 1934 1 heure
1
VENDREDI 29 JUIN 1934
Godesberg. Hôtel Dreesen,
entre 14 heures et 21 heures
SUR LES BORDS DU RHIN
Au nord, à une centaine de kilomètres, il y a la Ruhr. Parfois quand le vent s'engouffre dans la vallée du Rhin, le vent aigre et humide du nord-est, il porte jusqu'ici à Godesberg les fumées grises de la Ruhr, chargées d'oxyde de carbone et d'odeurs de soufre.
Mais en juin, le vent du nord-est ne souffle pas. Le Rhin ressemble alors, vu de la terrasse de l'hôtel Dreesen à Godesberg au début de l'après-midi, au fleuve d'autrefois: le Rhin des burgs et de la Lorelei, et le soleil chaud et tendre de juin le fait miroiter comme une tresse blonde. Sur la terrasse de l'hôtel Dreesen, souvent, des directeurs, venus des villes dures, noires, enfumées, venus des villes puissantes dont les noms résonnent comme des forges, Essen, Cologne, Bochum, Dortmund, Gelsenkirchen, des directeurs engourdis par le vin capricieux du Rhin, rêvent en regardant les paysages doux de juin.
La terrasse de l'hôtel Dreesen, ce Claridge de la bourgeoisie rhénane, est habituellement l'un de ces lieux calmes où les hommes d'affaires aiment à se rencontrer, entre hommes, dans la chaleur des conversations sérieuses, des alcools et des cigares. Les garçons du Dreesen sont stylés, silencieux, discrets. En semaine surtout, le Dreesen est le lieu rêvé pour un déjeuner important ou une rencontre clandestine, surtout au début de l'été.
Mais tous les étés ne se ressemblent pas et, ce 29 juin 1934, un vendredi, les quelques habitués qui achèvent de déjeuner au Dreesen sont totalement abandonnés. Le service est suspendu : seul le maître d'hôtel va et vient, inutile et désorienté... Le personnel a quitté son poste. Des curieux se sont glissés dans le hall et jusque sur la terrasse. Au premier rang, Walter Breitmann. Il était alors l'un des plus jeunes serveurs de l'hôtel. Il se souvient. Le maître d'hôtel tentait de le rappeler. En vain.
Walter Breitmann regarde fasciné les voitures noires, des Mercedes-Benz, dont deux sont décapotées, s'arrêter lentement devant le perron, faisant à peine crisser le gravier de l'allée. Le Führer ! Des applaudissements éclatent, des cris, Walter Breitmann applaudit aussi, puis il salue, le bras tendu, comme il le voit faire autour de lui. De la première voiture descend un homme massif, en uniforme des S.A., les Sections d'Assaut C'est l'Oberleutnant Wilhelm Brückner qui tient auprès d'Adolf Hitler les rôles de garde du corps, d'ordonnance et d'aide de camp. Dans les défilés, sur les tribunes, il est derrière le Führer, impassible, dominant de sa haute taille la silhouette du Chancelier.
Brückner, tout en se penchant vers la voiture, jette un regard circulaire sur la petite foule où Walter Breitmann, immobile, le bras tendu, attend. Maintenant Wilhelm Brückner ouvre la portière et Adolf Hitler descend à son tour. Les cris, les acclamations redoublent le Chancelier salue, le bras à demi levé ; le visage est sévère, il monte rapidement les quelques marches.
Le propriétaire de l'hôtel Dreesen le suit cependant que les portières des autres voitures claquent et que la première déjà, celle d'où est descendu Hitler, démarre lentement et va se ranger quelques dizaines de mètres plus loin. L'Oberleutnant Wilhelm Brûckner parle au propriétaire : Walter Breitmann observe la haute stature du nazi, sanglé dans son uniforme. Le propriétaire s'excuse par avance : on ne l'a prévenu qu'il y a quelques heures.
Le Führer visitait les camps de travail, une grande tournée d'inspection à travers tout le Gau du Rhin inférieur et de la Westphalie. Il avait rendu visite à l'Ecole régionale des cadres du R.A.D. (Service du Travail du Reich) à Schloss Buddenberg près de Lunen.
Il pleut sur Schloss Buddenberg, une pluie d'été, agréable, pareille à une vapeur tiède. C'est le matin, vers 10 heures, la foule est là, massée, elle crie, Heil, Sieg Heil, elle entoure la voiture découverte du Führer qui serre des mains de tous côtés, souriant Quand la voiture s'arrête devant le bâtiment central de l'Ecole, le directeur, le docteur Decker s'avance et souhaite la bienvenue. La pluie à ce moment a presque cessé : des flaques, l'herbe humide, une odeur de terre mouillée la rappellent encore.
Des centaines de jeunes gens sont là, les muscles tendus, leurs torses et leurs jambes nus, bronzés, luisants de sueur et de pluie, maigres et virils, les tempes et les nuques rasées, tendant leurs bras presque à l'horizontale pour le salut hitlérien. Le Chancelier Adolf Hitler passe lentement devant eux. Il porte un long manteau de cuir, et il tient sa casquette à la main. Ses cheveux mouillés paraissent encore plus noirs. Hierl, secrétaire d'Etat et Führer du R.A.D., est avec lui. Il marche quelques pas en arrière, silhouette enveloppée comme celle du Chancelier dans un manteau long qui étonne car, malgré l'humidité, il fait chaud, lourd, étouffant. Derrière les deux hommes, il y a Brückner, Dietrich, Schaub.
Bientôt les jeunes hommes s'élancent devant le Chancelier du Reich : les exercices de gymnastique font virevolter leurs corps. D'autres chantent en chœur, d'autres récitent des poèmes à la gloire de l'Allemagne nazie. Les chefs du parti regardent : la jeunesse est là devant eux, dans la fête de ses muscles, la jeunesse qu'ils ont entraînée avec eux.
Pourtant Hitler parait soucieux. Il salue à peine le docteur Decker quand le cortège officiel quitte l'Ecole, ses baraques décorées de guirlandes et ses stagiaires qui crient leurs Heil sonores et joyeux.
De Schloss Buddenberg on est passé au camp d'Olfen : même cérémonial, mêmes corps tendus dans la joie de la discipline physique et de la certitude morale. Devant les groupes formés en rectangle parfait, Hitler parle à voix basse à son aide de camp, des hommes courent Brückner donne des ordres. L'inspection est interrompue. Le Chancelier ne visitera pas les camps 210 et 211, il ne verra pas les travaux que les volontaires du R.A.D. ont entrepris sur la rivière Niers. Hierl s'y rendra. Brusquement le Führer vient de se décider à réunir une conférence à Godesberg. C'est Brückner qui choisit l'hôtel Dreesen,
Les dignitaires s'engouffrent dans les voitures. On reconnaît le Docteur Ley, le Führer du Front du Travail, Marrenbach, son aide de camp, et aussi le Docteur Dietrich, chef du service de presse du Chancelier.
Le cortège officiel a roulé vers Godesberg, rapidement. On ralentissait au passage des agglomérations. A la hâte, les chefs nazis locaux avaient rassemblé les habitants : partout des cris, des bras tendus et ces drapeaux rouges à croix gammée noire, fascinant emblème du nouveau Reich. « Comme un feu de poudre, raconteront les journalistes, la nouvelle parcourut les rues et les places : le Führer arrive, le Führer arrive ! En quelques instants, des milliers et des milliers de personnes se rassemblèrent le long de la route que suivait le Führer. Soudain des drapeaux et des fanions apparurent à toutes les fenêtres. »
A Godesberg même, dans les petites rues pittoresques de cette station thermale, les habitants se rassemblent, les drapeaux surgissent. Mais la voiture du Chancelier est déjà passée, il reste les nombreuses voitures officielles qui la suivent : celles des chefs du parti, des chefs des organisations nazies qui viennent de toutes les parties de l'Allemagne de l'Ouest et qui se rendent à l'hôtel Dreesen. C'est l'hôtel connu des bourgeois de la Ruhr et de Bonn, un hôtel tranquille et discret. Plus tard, en 1938, Hitler y rencontrera Neville Chamberlain au cours d'une des conférences de la dernière chance. En ce vendredi 29 juin 1934, le Dreesen n'est encore qu'un hôtel où Gustav Stresemann, ce fils de limonadier, ministre des Affaires étrangères, partisan d'une entente avec la France, est venu souvent se détendre, au temps de la République de Weimar, avant la tourmente qui a jeté bas ce régime : la grande crise de 1929.
Le propriétaire est honoré d'accueillir le nouveau Chancelier, Hitler. D'un geste emprunté, il montre le panorama qui s'ouvre sur Bonn, au loin vers le Nord, à une dizaine de kilomètres ; vers le Rhin qui forme un large méandre dans la plaine alluviale étalée sur la rive gauche. Le Führer aime les vastes paysages naturels. Il s'avance vers la terrasse qui domine le Rhin. Il fait bon. Les chefs nazis sont autour de lui.
Une dernière voiture s'arrête devant l'hôtel : c'est Hierl qui a visité quelques camps rapidement et a rejoint le plus vite qu'il a pu Godesberg. Il fait son rapport au Chancelier, puis tout le monde s'assied autour du Führer et la discussion commence.
On entend des éclats de voix, Hitler parle fort, à sa façon saccadée, brutale. Quelques heures passent Hitler maintenant s'est tu. Fatigué comme après chaque allocution ou conversation quand il se donne tout entier à sa passion. Vers la fin de l'après-midi alors que déjà des chefs S.S. et S.A. prennent congé en saluant, que les voitures viennent à intervalle régulier s'immobiliser devant le perron, le Führer se détend, il fait quelques pas vers le bord de la terrasse. Le Gauleiter de la région de Cologne - Aix-la-Chapelle, un homme d'une cinquantaine d'années, lui présente les fonctionnaires importants de la région et les Kreisleiter du Gau. La foule de curieux est toujours là, saluant criant agitant des drapeaux. Martial, manœuvrant avec la précision mécanique des vieilles unités prussiennes, un détachement du R.A.D. prend position devant l'hôtel.
Hitler sort sur le perron, il salue satisfait ces jeunes hommes à la fixité de statues puis les passe en revue. Alors la fanfare attaque des airs nazis et dans le crépuscule, six cents volontaires du Service du Travail allument leurs torches et forment au pied de la terrasse, une immense croix gammée de feu. Hitler s'appuie au rebord de marbre de la terrasse. Maintenant les musiciens jouent le grand Zapfenstreich (couvre-feu). Les torches brûlent et leurs flammes se couchent parfois sous la brise humide qui monte du fleuve, parfumée à l'odeur douceâtre du Rhin, odeur de vigne aussi et senteur de l'herbe. Les péniches noires qui se croisent dans la pénombre ont déjà allumé leurs feux de position.
En face, sur l'autre rive, les Siebengebirge (les Sept-Montagnes) dressent leurs sommets ronds comme des arapèdes, posées là, isolées, vestiges volcaniques : Drachenfels, Olberg, Petersberg, et la plus massive, le Lœwenburg. Le regard depuis Godesberg s'accroche à ces reliefs, à la vallée du Rhin, majestueuse, donnant l'impression vivante de la puissance, de la paix.
La nuit tombe : l'une des nuits les plus brèves de l'année. Sur la rive gauche ou sur la rive droite du fleuve, en amont en aval, l'histoire allemande est là, dressée, et les souvenirs se découpent sur l'horizon avec les tours hautaines. La Godesburg, ces ruines du château de l'électeur de Cologne auquel l'ombre rend leur vigueur ; plus loin encore, visible, on discerne la pyramide gothique du Hochkreuz. Le Chancelier regarde longuement, les conversations se sont tues, puis il félicite Brückner de son choix. La Ruhr, sa grisaille aux couleurs de métal rouillé et de charbon, la Ruhr si proche parait pourtant un autre monde, ici au pays des vignes et des châteaux.
Vendredi 29 juin 1934. Toute la journée, sur la vallée du Rhin, il a fait lourd. Le matin il a plu. Pas un souffle de vent. Des masses blanc sale de nuages ont obscurci le ciel, se mêlant au-dessus de la Ruhr aux fumées noires des aciéries. Peut-être est-ce la moiteur épaisse de l'été allemand qui donne à Hitler ce teint terreux, ce regard vague qui ne se fixe pas. On devine une peau humide. Peu à peu cependant, sur cette terrasse dominant le Rhin, l'artère disputée et chantée de la vie germanique, il semble se détendre, s'apaiser. Walter Breitmann a repris sa place. De temps à autre, il passe sur la terrasse ou réussit à regarder. On s'affaire autour de la table près de laquelle le Führer s'est assis, il rejette souvent la tête en arrière paraissant regarder le ciel. La nuit apporte une sensation physique, visuelle, de fraîcheur. Maintenant le fleuve est une simple traînée plus noire encore.
Hitler sourit, il interroge l'une des serveuses avec la bienveillante et pourtant distante autorité dont il est capable quand il parle avec des hommes ou des femmes de ce peuple qui l'a accepté depuis le 30 janvier 1933, il y a plus d'un an déjà, comme Chancelier du Reich. La serveuse est tout émue, elle répond par monosyllabes en souriant un peu niaisement. Sa famille, ses affaires, l'avenir, le Führer paraît pris par le questionnaire auquel il la soumet. Pourtant le regard est lointain, les mots viennent rapides, les interrogations se succèdent, mais les réponses hésitantes de cette femme sont-elles entendues ?
Au bord du Rhin, alors que la nuit s'étend sur l'Allemagne, cette nuit d'été, court intervalle sombre entre des chaleurs éclatantes, le Chancelier Hitler sait que chaque minute compte. Peut-être parle-t-il pour laisser sa réflexion cheminer, couverte, en lui-même. Peut-être est-il là, loin de l'agitation des villes de la Ruhr, loin aussi de la lourdeur compassée des fastes officiels berlinois, là sur cette terrasse enveloppée par les senteurs rhénanes, parce qu'en lui, la décision doit surgir, décision qui sera brutale comme un couperet, brûlante comme un fer rouge dans la chair vive. A moins que, déjà, les ordres n'aient été donnés et que cet entracte au bord du Rhin ne soit qu'un dernier répit laissé aux victimes désignées déjà, pour endormir leur méfiance !
Brückner passe la commande du souper, puis il se lève, demande le téléphone. Le Chancelier le suit du regard. A nouveau, c'est la tension qui se lit sur son visage. Il se tasse dans le fauteuil qui fait face au panorama, la tête enfoncée dans les épaules, et celles-ci soulevées légèrement, avec un air de malade qui a froid. Il se tait, méditatif. Parfois, un curieux s'avance prudemment jusqu'aux abords de la terrasse pour voir le Führer. Des S.S. et des inspecteurs vêtus de longs manteaux de cuir sont là qui veillent On s'écarte. L'homme frêle assis, enveloppé dans la légère nuit d'été, est au centre des regards, au cœur de l'Allemagne, et il paraît être absent. Immobile, le menton dans la main, le visage légèrement bouffi, ses cheveux noirs plaqués, il est un homme quelconque, pensif. Ni Walter Breitmann ni personne parmi les serveurs et les employés de l'hôtel Dreesen ne sait que des camions chargés de S.S. s'apprêtent à quitter Berlin, que la nuit qui commence au bord du Rhin paisible et souverain sera celle des crimes et des exécutions. Le Chancelier tassé, fatigué, qui se repose de ses tournées d'inspection en Westphalie, paraît somnoler, rêver. Il peut pourtant d'un bout à l'autre de l'Allemagne, de Hambourg à Munich, de Brème à Breslau, de Berlin à Cologne, déchaîner la violence ou la retenir. Mais tout n'est-il pas déjà enclenché ?
Vendredi 29 juin 1934, Godesberg, vers 20 heures.
C'est le silence, le calme et la douceur rhénane ; seulement le bruit de conversations à voix basse entrecoupées de rires polis, le ronronnement régulier d'un moteur qui monte de la vallée et le pas de l'Oberleutnant Wilhelm Brückner qui revient
LES SECTIONS D'ASSAUT
Le jeune Walter Breitmann regarde l'Oberleutnant traverser d'un pas lent et long la salle puis se diriger vers le Chancelier qui tourne la tête. Une conversation s'engage à voix basse et Brückner repart vers le téléphone de l'hôtel Dreesen. Le dîner a été servi. Le Chancelier mange peu comme à son habitude. A Brückner qui, une fois de plus, reparaît sur la terrasse il demande des nouvelles de Viktor Lutze qu'il a convoqué à Godesberg. Brückner pense qu'on a pu le joindre. Hitler se détend un peu: avec Lutze, il tient un fidèle de la Sturmabteilung. Cet Obergruppenführer est le chef du Gau de Hanovre. Il est donc l'un des dix hommes placés à la tête des circonscriptions de la S.A. qui contrôlent l'Allemagne. Homme quelconque, effacé, au visage de bon élève discipliné. Selon son chef Ernst Rœhm, Viktor Lutze n'est qu'un « exécutant capable et consciencieux qui manque d'envergure ».
Brückner le confirme au Führer, Viktor Lutze sera là dès que possible, le temps de rouler de Hanovre à Godesberg, quelque trois cents kilomètres de route sans aucune difficulté. Dans quelques heures Viktor Lutze se présentera : il suffira de lui donner des ordres. Le Chancelier se plonge à nouveau dans le silence. Quand l'Obergruppenführer S.A. Viktor Lutze apparaîtra, le choix devra être fait. Les S.A. du capitaine Rœhm devront s'y plier. Combien sont-ils ces hommes en chemise brune, à la casquette à visière et qui portent sur le bras gauche, au-dessus du coude le brassard à croix gammée ? 2 500 000, 3 000 000 ? A peine 100 000 ? Ils font la puissance du capitaine Rœhm, qui, outre les S.A., a directement ou indirectement sous ses ordres les Schutzstaffeln (S.S. = sections de protection), qui de 280 en 1929 sont peut-être 50 000 à la prise du pouvoir en janvier 1933 et 300 000 en juin 1934, le N.S.K.K. (Corps automobile national-socialiste), les Hitler-Jugend (1 500 000), soit en tout près de 5 000 000 d'hommes alors que le Generaloberst von Blomberg, ministre de la Guerre, n'a que 300 000 hommes sous ses ordres. L'essentiel pourtant ce sont les S.A. Ce sont eux qui font la force de Rœhm.
Le Chancelier, alors qu'il attend sur la terrasse de l'hôtel Dreesen qu'arrive Lutze, qu'arrivent les nouvelles de Berlin, qu'arrive dans la nuit du 29 juin 1934 le moment où il faudra faire le geste du destin, le Chancelier ne peut que penser à tous ces hommes en uniforme, et dont la règle est l'obéissance jusqu'à la mort à sa personne. Il ne peut que penser à ces S.A., dont Rœhm dans le dernier grand discours qu'il prononce le 18 avril 1934, à Berlin devant la presse étrangère, a dit qu'ils avaient été « non pas une bande de conjurés intrépides mais une armée de croyants et de martyrs, d'agitateurs et de soldats ». Les « soldats politiques » d'Adolf Hitler. « Le Führer nous a donné, disait Rœhm, le drapeau rouge à croix gammée, symbole nouveau de l'avenir allemand, il a donné la chemise brune que revêt le S.A. dans le combat, les honneurs et dans la mort. Par l'éclat de la couleur, la chemise brune distingue pour tous le S.A. de la masse. C'est dans ce fait qu'elle trouve sa justification: elle est le signe distinctif du S.A. Elle permet à l'ami comme à l'ennemi de reconnaître au premier coup d'œil celui qui croit à la conception du monde national-socialiste ».
Ce soir, les S.A., ces « soldats politiques » qui, comme le dit Rœhm, « ont ouvert à coups de poing à l'idée nationale-socialiste la voie de l'avenir, la voie qui mène à la victoire », ces hommes, leur sort est en question et il se joue sur cette terrasse de l'hôtel Dreesen qui domine le Rhin.
Mais il faut jouer à coup sûr. Rœhm l'a dit et répété, « les S.A. ne sont pas une institution de moralité pour l'éducation de jeunes filles, mais une association de rudes combattants ».
Le Chancelier, alors que passent les heures qui le rapprochent du choix, peut se souvenir de ce petit service d'ordre né à l'initiative de Ernst Rœhm, l'officier expérimenté, le 3 août 1921, quand il avait fallu avec les premiers S.A. défendre les réunions du Parti et empêcher les adversaires de tenir les leurs. Section d'Assaut recrutée parmi les durs, les anciens des Freikorps, venus de la brigade de marine du capitaine Ehrhardt et de von Löwenfeld, du Corps des Chasseurs du général Maerker ou de, l'organisation Escherich. Avant d'être les S.A., ils avaient été les combattants de ces nouvelles « grandes compagnies » qui menaient dans les landes des bords de la Baltique, face aux Polonais ou dans les villes, contre les marins et les ouvriers en révolution, des combats incertains, à demi clandestins, avec ces mitrailleuses lourdes que l'armée fournissait, avec cet armement et cet uniforme de hasard qui donnaient à ces troupes aguerries, faites d'anciens combattants de moins de trente ans, l'allure de bandes d'aventuriers maigres et nerveux, de réprouvés se déplaçant dans les brouillards du Nord, et dans l'Allemagne en anarchie comme dans un empire à conquérir.
Le premier chef des S.A., le lieutenant de vaisseau H. Klintzsch était d'ailleurs un ancien de la « brigade Ehrhardt ». Von Killinger, meurtrier du signataire de l'armistice, Erzberger, Heines qui abattit le ministre Rathenau vinrent aux S.A. Puis était arrivé, en mars 1923, Hermann Gœring, l'as de la chasse allemande, au visage d'une éblouissante beauté que la drogue et l'embonpoint n'avaient pas encore affaissé. Et quand dans les rues froides et grises de Munich, le 9 novembre 1923, le premier putsch nazi se produit, les S.A. sont là, derrière leurs chefs. Interdits, après l'échec du putsch, comme le Parti, les S.A. sont reconstituées par Rœhm, toujours prêt à construire une troupe de combattants : ils deviennent le Frontbanner puis à nouveau les S.A. en 1925 : neuf ans seulement et pourtant tout a changé.
1925 : Ce temps proche et lointain où le Parti national-socialiste paraissait se déchirer : Goebbels demandait l'exclusion du Parti du « petit-bourgeois Hitler », Gregor Strasser qui avait permis au Parti de gagner le Nord de l'Allemagne, parlait du socialisme, de bolchevisme national et s'éloignait de la prudence de Hitler, décidé à s'appuyer sur les forces conservatrices. Et puis il y avait Rœhm qui voulait subordonner le Parti aux S.A., transformer le Parti en un nouveau corps franc, Rœhm, militaire d'abord et toujours. Hitler avait choisi et Rœhm, déçu et discipliné, soldat et aventurier, avait quitté l'Allemagne pour devenir organisateur et instructeur de l'armée bolivienne.
Les S.S. avait alors commencé leur croissance : groupe de choc au service exclusif de Hitler, garde personnelle à la fidélité et à la discipline absolues et qui, le 6 janvier 1929, reçoivent pour chef un homme au visage inexpressif, aux yeux dissimulés derrière des lunettes cerclées de fer : Heinrich Himmler. « Jamais je n'ai pu accrocher son regard toujours fuyant et clignant derrière son pince-nez », disait de lui Alfred Rosenberg.
Mais ce fils de bourgeois, ce catholique devenu Reichführer S.S. réussit à construire un ordre, l'Ordre noir, qui, pas à pas, mêlant le mysticisme fanatique à la terreur, va accroître sa puissance.
Pourtant, en 1931, le Führer avait dû rappeler Rœhm pour organiser la Sturmabteilung, qui grossissait au rythme même des succès électoraux nazis : 100 000 hommes vers 1930, 300 000 vers 1933, 2 500 000 à 3 000 000 en 1934, aujourd'hui.
Maintenant ils sont partout, ils sont l'armée privée du Führer, l'armée qui a ses unités motorisées, ses escadrilles d'avions. L'organisation en Gruppen, Standarten, Sturme est efficace, elle enserre le pays dans les mailles de la violence et de la terreur.
Pas de place dans les rues, dans les salles de réunion pour les adversaires des nazis: tel est le mot d'ordre des S.A. Déjà, quelques mois à peine après leur fondation, le 4 novembre 1921, ils étaient intervenus au Hofbräuhaus.
Adolf Hitler lui-même a raconté dans Mein Kampf cette réunion qui vit naître l'action des S.A. « Quand je pénétrai, à 8 heures moins un quart, dans le vestibule du Hofbräuhaus l'intention de sabotage ne pouvait plus faire de doute... La salle était archipleine... La petite Section d'Assaut m'attendait dans le vestibule. Je fis fermer les portes de la grande salle et je dis à nos quarante-cinq ou quarante-six hommes de se mettre au garde-à-vous. Je déclarai alors à mes gars que c'était la première fois qu'ils devaient prouver leur fidélité au mouvement, quoi qu'il arrive aucun de nous ne devait quitter la salle. Un Heil proféré trois fois d'un ton plus âpre et plus rauque que d'habitude répondit à mes paroles ». Hitler parle puis sur un mot la bagarre éclate.
« La danse n'avait pas encore commencé, continue-t-il, que mes hommes de la Section d'Assaut — qui s'appelèrent ainsi depuis ce jour-là — se lancèrent à l'attaque. Comme des loups ils se jetèrent sur leurs adversaires par meutes de huit à dix et commencèrent en effet à les chasser de la salle en les rouant de coups. Cinq minutes après, tous étaient couverts de sang. C'étaient des hommes ! J'ai appris à les connaître en cette occasion : à leur tête mon brave Maurice ; mon secrétaire particulier Hess, bien d'autres qui grièvement atteints attaquaient toujours tant qu'ils pouvaient se tenir debout » Tel fut selon le Führer, l'acte de baptême des S.A.
Ces hommes ne se recrutent pas parmi les timides ou les tendres ni même parmi les petits-bourgeois guindés : la crise économique a été, à partir de 1929, le vivier dans lequel les Sections d'Assaut ont puisé les mécontents : chômeurs, ouvriers du « Lumpenproletariat » qui reçoivent un uniforme, une solde et qui trouvent dans les S.A. une organisation accueillante qui promet « la révolution ».
Il faut se battre et les risques se multiplient : contre les socialistes organisés dans la Bannière d'Empire, contre les communistes rassemblés dans la Ligue Rouge des Combattants du Front On s'observe, on défile avec fanfares et étendards, on lance des pierres. La police le plus souvent favorable aux S.A., tente parfois de séparer les camps, mais elle est vite débordée ou complice. Et les incidents succèdent aux incidents. Une violence entraîne l'autre : on se venge. A Essen, les communistes enterrent l'un des leurs et quand le cortège passe devant la Braunes Haus où un S.A. monte la garde, ils le menacent d'une exécution sommaire ; on échange des coups de feu. Un S.A. est capturé, on pense l'abattre contre un mur. Ailleurs ce sont des cadavres de syndicalistes qu'on retrouve dans les marécages. Là ce sont encore des rixes dans des débits de boisson. Quand un « rouge » est tué il y a toujours une excuse pour le S.A. A Essen, c'est en tombant que le S.A. ivre Kiewski a appuyé involontairement sur la gâchette de son revolver : le communiste Ney a été abattu.
Dans l'euphorie du 30 janvier 1933, quand défilent sous les fenêtres du nouveau Chancelier, Hitler, les milliers de partisans du Reich qui crient leur joie, les S.A. comprennent que les derniers obstacles à leur violence sont tombés. Les tribunaux condamnent sans hésiter leurs adversaires. Un foyer S.A. (S.A. Heim) est-il attaqué à coups de pierre, les sentinelles répondent à coups de feu et les agresseurs supposés — car l'attaque n'est pas prouvée — sont condamnés à mort ou à la détention à perpétuité. Et les effectifs des S.A. gonflent : quand on porte la chemise brune la violence devient héroïsme. Des délinquants, des obsédés sexuels, les bas-fonds qui surnagent quand la société est bouleversée, adhèrent et se mêlent aux S.A. du rang, entraînés à la violence et au sadisme.
Les rues sont parcourues par leurs bandes en uniforme, « Judas, crève », crient-ils. Ils montent la garde devant les magasins juifs, pour décourager les clients. Ils collectent des fonds au bénéfice du nazisme ou simplement à leur profit, et qui pourrait refuser ? D'ailleurs le 22 février 1933, par décision de Goering, ministre de l'Intérieur et bientôt Président du Conseil de Prusse, 25 000 S.A. et 15 000 S.S. sont constitués en police auxiliaire. Comme l'écrivait Goering le 17 février, donnant ses instructions aux forces de l'ordre : « Les policiers qui font usage de leurs armes en accomplissant leur devoir seront couverts par moi, sans égard aux conséquences de l'usage de leurs armes. Mais celui qui se dérobe par suite d'une délicatesse mal comprise doit s'attendre à des peines disciplinaires ». La voie était libre. Les S.A. pouvaient chanter le Horst Wessel Lied, qui rappelle le souvenir d'un héros S.A., par ailleurs ancien souteneur, tué au cours d'une rixe.
Les temps ont changé depuis ce jour de juillet 1932 où pour recruter de nouveaux adhérents les S.A. organisaient des concerts, comme dans cette petite ville où l'affiche suivante est placardée le samedi 2 juillet 1932.
« Soirée de marches militaires avec recrutement S.A. donnée par la musique de l'étendard 82 (44 exécutants)
Attractions présentées par les S.A. Le chef d'étendard parlera de la « volonté de se défendre, chemin de la liberté ».
— Les SA. héritiers de Fesprit de 1914
— Soirée exceptionnelle pour des cœurs de soldats
— La soirée commencera par un défilé de propagande à travers la ville.
Sturmbann 1/82 ;... Standarte 82.
Aujourd'hui le pouvoir est entre leurs mains. L'heure est aux avantages, aux places. De toutes parts accourent les nouveaux adhérents. Parfois ce sont d'anciens socialistes ou communistes qui, dans l'organisation S.A., cherchent à faire oublier leur opinion passée. Rœhm n'a pas hésité à dire, provocant comme à son habitude : « J'affirme que parmi les communistes, surtout parmi les membres des « Anciens Combattants rouges », il y a beaucoup d'excellents soldats ». D'ailleurs selon certains de leurs adversaires quelques Sections d'Assaut méritent le nom de « Beefsteak-Stürme », bruns dehors et rouges à l'intérieur !
Mais pour ceux des opposants qui n'acceptent pas ce sont les camps et les tortures. Les S.A. sont parmi les premiers à soumettre leurs prisonniers à la question. Rudolf Diels, monarchiste, un temps chef de la police politique secrète de Prusse par la volonté de Hermann Gœring, réussit à visiter les caves où les S.A. enferment leurs prisonniers. Le spectacle est hallucinant : les victimes meurent de faim, les os brisés, le visage tuméfié, le corps couvert de plaies infectées. Il réussit à en sauver quelques-uns, à les faire monter dans les voitures de la police. « Comme de gros tas d'argile, des poupées ridicules aux yeux sans vie et à la tête brûlante, ils pendaient, collés les uns aux autres, sur les bancs du car de police. Les policiers étaient devenus muets à la vue de cet enfer. » Parfois les S.A. ont obligé les prisonniers à grimper dans les arbres et à crier à intervalles réguliers comme des oiseaux perchés. Visitant pour enquête le cachot souterrain de la forteresse de Wuppertal, Rudolf Diels est horrifié : « L'épouvante me saisit comme devant l'apparition de spectres », dit-il. Les prisonniers sont debout devant lui, « les visages aux meurtrissures jaunes, vertes et bleues n'avaient plus rien d'humain ». Tout à coup, alors que Diels s'apitoie sur le sort d'un prisonnier, surgissent, « parés d'uniformes resplendissants, sur la poitrine et autour du cou des médailles anciennes et nouvelles, Ernst, un des chefs S.A. à Berlin et sa suite ». Ils pénètrent en riant et en bavardant dans la pièce sinistre.
« Qu'est-ce que vous venez foutre ici ? » hurle Ernst
« Les S.A. ne sont pas des jeunes filles », disait Rœhm. En effet.
Dans toute la Prusse, sans prêter attention à Gœring, les S.A. agissent. Dans le seul Berlin on compte une cinquantaine de lieux de toutes sortes, caves, entrepôts, remises, garages, qui sont devenus des prisons où l'on frappe, où l'on tue. En province, à Sonnenburg, Barnim, Königswusterhausen, Wuppertal, Kemma, partout ce sont les mêmes plaintes qui s'élèvent des cachots tenus par les S.A. Rudolf Diels réussit dans la plupart des cas à faire libérer les prisonniers, il obtient la fermeture des prisons de la Sturmabteilung. Non sans mal, non sans susciter entre la police politique de Prusse dont il est le chef et les S.A., et aussi entre Gœring et Rœhm, de solides et tenaces inimitiés.
C'est que les S.A., qu'ils pratiquent la torture ou égorgent des adversaires, qu'ils se livrent au pillage d'un appartement ou à de petites vexations, ont le sentiment d'avoir tous les droits puisqu'ils ont été les artisans de la victoire nazie. Ils peuvent casser des dents ou des vitres, enlever un homme et l'abattre dans une cave ou une forêt, ils peuvent comme lors de cette parade à Berlin, systématiquement empêcher de voir les jeunes filles des organisations nazies de jeunesse en se plaçant résolument devant elles et rire grassement en proposant : « Passez la tête entre nos jambes si vous voulez regarder. »
Ils sont les S.A., Rœhm n'a-t-il pas répété : « Les bataillons bruns ont été l'école du national-socialisme... La S.A. a ouvert la voie du pouvoir au chef suprême des S.A. : Adolf Hitler ».
Pourtant Rœhm lui-même, le 31 juillet 1933, est contraint, sous la pression des partisans nazis de l'ordre, de recommander à ses S.A. le respect de certaines règles. « Je m'efforce, écrit-il, de conserver et de garantir en tous sens les droits des S.A. en tant que troupe de la Révolution nationale-socialiste... Je couvre également de ma responsabilité toute action effectuée par des S.A. qui sans être conforme aux dispositions légales en cours, sert les intérêts exclusifs des S.A. Dans le contexte il y a lieu de considérer qu'il est permis au chef S.A. compétent d'exécuter'jusqu'à douze membres d'une organisation ennemie pour expier l'assassinat d'un S.A. perpétré par cette organisation.
« Cette exécution est ordonnée par le Führer, elle sera faite brièvement et avec une rigueur martiale.
« Par contre j'ai eu connaissance de certaines informations, rares il est vrai, selon lesquelles des membres d'organisations S.A. — je ne veux pas les appeler des S.A. car ils ne le sont pas — se sont rendus coupables d'excès inouïs.
« Il faut compter parmi ces derniers : la satisfaction de vengeances personnelles, des sévices inadmissibles, des rapines, des vols et le pillage. »
Le capitaine Rœhm s'indigne contre « ces profanateurs de l'uniforme d'honneur des S.A. ». Et il menace de « la mort immédiate pour l'exemple (...) les chefs S.A. rendus responsables, s'ils font preuve d'une indulgence mal comprise et n'interviennent pas sans le moindre ménagement ».
Mais le 8 août, les S.A. ne font plus partie de la police auxiliaire mise sur pied par Gœring. Leur indiscipline ou leur force et leur indépendance menaçantes les ont-elles déjà écartés du pouvoir ?
C'était il y a un an, dans l'été 1933.
2
VENDREDI 29 JUIN 1934
Godesberg. Hôtel Dreesen. Vers 21 heures 30.
JOSEPH GOEBBELS
Devant l'hôtel Dreesen, une voiture vient de freiner brutalement Des policiers s'avancent avant même que le portier n'ait eu le temps de sortir sur le perron. Quand l'homme descend, tout le monde reconnaît Joseph Goebbels. Nerveux, semblant encore plus maigre et plus pâle qu'à l'habitude, il salue d'un geste brusque et se dirige vers Brückner qui est apparu lui aussi. Les deux hommes se serrent la main et l'Oberleutnant Brückner indique la terrasse où Goebbels va trouver le Führer. Goebbels se lisse les cheveux et en boitant monte les quelques marches. Walter Breitmann se souvient de ce visage osseux, à la peau tendue, aux joues creusées, un visage où les yeux brillants disent la volonté anxieuse de cet infirme malingre qui a su grâce à son intelligence vive, aux aguets, affûtée par l'infériorité physique, devenir, après avoir été le secrétaire de Gregor Strasser, le grand maître de la propagande du Parti nazi. Il a évincé son ancien patron, il l'a trahi et s'est rallié à Hitler quand les deux hommes se sont trouvés en conflit. Goebbels monte les marches, traînant sa jambe infirme, les mâchoires crispées, un sourire figé dévoilant ses dents qui paraissent, dans ce visage en lame de couteau, démesurées. Breitmann s'efface pour le laisser passer : Goebbels, petit sautillant brun, l'intellectuel du parti n'a pas le type aryen. Devenu ministre de la Propagande, il suscite toujours l'ironie des Alte Kämpfer, les vieux nazis qui croient d'abord à la force.
Mein lieber Gott, mach mich blind
Dass ich Goebbels arisch find.
(Dieu tout-puissant, ôte-moi la vue
Que je puisse croire Goebbels aryen.) chantent les S.A.
Si Joseph Goebbels est à Godesberg ce soir, c'est précisément à cause des S.A. Goebbels salue Hitler, s'assied auprès de lui et commence à parler en multipliant les gestes. Le Chancelier paraît distant, soupçonneux. Il écoute, il se tait, il regarde ce visage où le menton trop long, la bouche trop large, semblent perpétuellement et presque spasmodiquement en mouvement parce que le débit de la parole est rapide et que chaque mot provoque une contraction du visage, une grimace qui dessine de larges et profondes rides autour de la bouche, presque une crispation. Adolf Hitler se tait, il observe, il écoute. « J'étais plein de respectueuse admiration, dira Goebbels, évoquant cette soirée de Godesberg, pour cet homme sur lequel reposait la responsabilité du sort de millions d'êtres humains et que je voyais en train de peser un choix douloureux : d'un côté, le repos de l'Allemagne, de l'autre, ceux qui avaient été jusqu'à présent ses familiers. »
Joseph Goebbels est de ces familiers et Hitler le regarde. Le « boiteux », dans le Parti, n'est pas un dirigeant comme les autres. Il n'a pas de troupes à son service, ni S.A. ni S.S., il n'a que son intelligence manœuvrière qui lui permet de sentir où se trouve le camp des vainqueurs. Et puis, c'est un intellectuel, l'un des rares parmi les chefs nazis — avec Rosenberg — à avoir fréquenté une université et à y avoir acquis des diplômes : il est docteur en littérature. Mais dans la vie professionnelle c'est, à la sortie de l'université, bientôt l'échec : il ne réussit pas à obtenir ce poste de critique littéraire au Berliner Tageblatt, le journal des juifs, dit-il. Et le voici, amer, sceptique, aigri, qui se tourne vers le nazisme. Dans ce nouveau parti, où les valeurs sont encore rares, son cynisme et ses dons font merveille : là, il dévoile ses talents de propagandiste et d'organisateur. Mais, il est surtout habile à exploiter le côté « social » et « radical » du parti, ces quelques formules qui, dans le programme en 25 points, que Hitler avait établi en 1920 avec Anton Drexler, annonçaient que le nouveau parti n'était pas seulement national mais aussi socialiste. Il faut, disaient-elles, « abolir le revenu qui n'est pas le produit du travail et de l'effort. II faut briser l'esclavage du prêt à intérêt.. Nous exigeons la participation des employés aux bénéfices dans toutes les grandes entreprises... » Goebbels avait avec Gregor Strasser, popularisé cet aspect du premier programme nazi.
Et en ce soir du 29 juin 1934, Hitler regarde attentivement ce « nazi de gauche », ce familier, qu'il a joué contre Strasser — et il a gagné — et qui maintenant vient à lui, au bord du Rhin, alors qu'il faut briser ceux qui, naïvement parmi les S.A. notamment continuent à réclamer la « révolution ».
La révolution ? Le plus souvent cela veut dire des places, tout simplement des places que d'autres occupent. A Dantzig, peu après la prise du pouvoir, Hermann Rauschning, président du Sénat de la ville libre reçoit l'un de ces Alte Kämpfer, ces vieux combattants des premières heures du nazisme, qui réclament des avantages substantiels maintenant que Hitler est chancelier. L'homme hurle devant Rauschning: « Je ne redescendrai pas la pente une fois de plus ! Peut-être que vous, vous pouvez attendre. Vous n'êtes pas assis sur des charbons ardents. Pas de travail mon vieux, pas de travail ! Je resterai au sommet quoi qu'il m'en coûte. On ne peut arriver au sommet deux fois de suite ».
Ils veulent tout tout de suite, ces S.A. auxquels on a promis la révolution nationale et socialiste. Ils veulent parce que parmi eux il y a aussi des boutiquiers, la fin des grands magasins, ils veulent le pouvoir et la richesse, ils veulent que la révolution soit faite à leur profit. Or, le Parti nazi, maintenant parti de gouvernement se peuple de « gens respectables ». Hitler est en costume de cérémonie et eux, les rudes Alte Kämpfer, ne seront-ils pas les dindons de la victoire qu'ils ont obtenue ? Et rejoignent les Alte Kämpfer tous les mécontents, tous ceux qui espèrent tirer profit du changement de régime qui vient de se produire. Ils passent une visite médicale, ils prêtent serment et les voici incorporés dans les S.A. Parfois, on se sert directement : un homme abattu ou arrêté, c'est un appartement que l'on peut occuper, un emploi à prendre, des biens à distribuer entre S.A. Mais cela ne peut évidemment suffire.
Hitler lui-même, devant une telle poussée révolutionnaire, a été contraint de faire des promesses ambiguës. Il déclare aux S.A. de Kiel parmi les acclamations : « Vous devez être les garants de l'achèvement victorieux de cette révolution et elle ne sera victorieusement achevée que si le peuple allemand est éduqué à votre école ».
C'était le 7 mai 1933, dans la ville de Kiel, là où en 1918 les marins s'étaient révoltés contre leurs officiers, où les groupes spartakistes avaient essayé de recommencer Cronstadt. Mais depuis ?
Hitler regarde Goebbels qui s'explique toujours, qui renseigne son Führer sur la situation à Berlin d'où il arrive. Il n'a pas eu le temps de voir Gœring.
Il a pris l'avion, a atterri à Bonn-Hangelar, mais le Führer venait de partir pour sa tournée d'inspection des camps du R.A.D. A Essen, on lui a dit que le Führer était à l'hôtel Dreesen à Godesberg, qu'il avait tenu une conférence politique dans l'après-midi, alors il a immédiatement décidé de le rejoindre ici, à Godesberg. La musique du Service du Travail joue sur l'autre rive. Elle reprend périodiquement le Horst Wessel Lied et le Saar Lied. « Camarades, ceux des nôtres que le Front rouge et la Réaction ont abattu sont, en esprit, toujours parmi nous, et marchent dans nos rangs ». Puis viennent et reviennent des marches militaires : la Badenweilermarsch, le morceau préféré de Hitler.
Il fait frais, et dans l'obscurité, on devine que le ciel se couvre, il pourrait éclater l'un de ces orages brutaux de l'été. Goebbels parle : certes il a abandonné depuis 1926 Gregor Strasser qui refusait de lier le parti nazi à la droite traditionnelle. Il a rejoint le camp de Hitler qui, après l'échec du putsch de novembre 1923, sait qu'il faut conquérir le pouvoir avec l'appui des forces conservatrices, donc limiter le programme social et révolutionnaire à la démagogie antisémite. Mais sait-on jamais ? N'a-t-il pas trop longtemps gardé le contact avec Rœhm, n'est-il pas suspect ? Hitler se tait.
Goebbels parle. Il n'a plus rien de commun avec Ernst Rœhm. Rœhm qui, en juin 1933, lance une proclamation où il déclare : « Une victoire grandiose a été remportée, mais ce n'est pas la victoire. » Rœhm qui menace toujours : « Si les âmes petites-bourgeoises croient suffisant que l'appareil d'Etat ait changé de signe », elles se trompent. « Que cela leur convienne ou non, nous continuerons notre lutte. S'ils comprennent enfin quel est l'enjeu, nous lutterons avec eux, s'ils ne veulent pas : sans eux ! Et s'il le faut contre eux ! » Rœhm incorrigiblement provocant ; quand Gœring annonce le licenciement des policiers auxiliaires S.A., le chef d’Etat-major rassemble ses troupes. 6 août 1933, chaleur toujours de cette journée d'été d'il y a un an : 80 000 hommes au moins en uniforme brun, 80 000 membres des Sections d'Assaut sont groupés à Tempelhof, dans la banlieue de Berlin, près du champ d'aviation. Le ciel est couvert et l'atmosphère est lourde, brûlante de passion. Clameurs, approbations, hurlements, Rœhm ne mâche pas ses mots : « Celui qui s'imagine, s'écrie-t-il, que la tâche des Sections d'Assaut est terminée, devra se résigner à l'idée que nous sommes là et que nous resterons là, quoi qu'il advienne. »
Tel est le langage du chef d'Etat-major Rœhm. Mais les S.A. sont plus nets encore : « Il faut nettoyer la porcherie, disent-ils. Il y a des cochons qui en veulent trop, on va les écarter de la mangeoire, et plus vite que ça », et ils lèvent leurs mains épaisses habituées à bousculer et à frapper.
LA DETERMINATION DES SECTIONS D'ASSAUT
Et Rœhm n'abdique pas. Suit-il ses troupes, les devance-t-il pour ne pas être débordé par elles et mieux canaliser la colère des hommes en chemise brune ou bien entretient-il leur hargne et leurs espoirs de butin pour disposer de leur soutien dans sa lutte personnelle pour le pouvoir ?
En novembre 1933, il récidive. Dans Berlin, enveloppé par un brouillard glacé les groupes de S.A. stationnent devant le bâtiment massif du Sportpalast. La salle est déjà pleine : 15 000 gradés de la Sturmabteilung sont là, massivement, impressionnants dans leur uniforme brun. Ils saluent le capitaine Rœhm quand il apparaît à la tribune et lance sans ménagement : « De nombreuses voix s'élèvent dans le camp bourgeois et prétendent que la S.A. a perdu toute raison d'être... Ils se trompent, ces messieurs ». Les S.A. se lèvent, acclament Rœhm avec enthousiasme. « Nous extirperons le vieil esprit bureaucratique et l'esprit petit-bourgeois par la douceur ou, si c'est nécessaire, sans douceur ». Nouvelles acclamations, nouveaux cris.
Puis les S.A. se répandent dans les rues et les brasseries. Bientôt, annoncent-ils, viendra la seconde révolution, la vraie révolution. Et ce sera la Nuit des longs couteaux. On l'attend.
Pas seulement les S.A., mais tous ceux qui craignent la prolongation des troubles. Durant cette Nuit des longs couteaux dont parlent les S.A., qui égorgera-t-on ? Cette nuit que veulent les chemises brunes, pour laquelle spontanément ils ont trouvé cette appellation sinistre, quand viendra-t-elle ? On a peur en ce début de l'année 1934. La prise du pouvoir par Hitler, il y a un an à peine, semble n'avoir été qu'un bon souvenir par rapport à ce qui se prépare dans l'armée brune. « Nous ne sommes pas un club bourgeois, rappelle Rœhm, je ne veux pas conduire des hommes qui plaisent aux boutiquiers, mais des révolutionnaires qui entraînent leur pays avec eux ». Mais les boutiquiers, mais le pays ont soif d'ordre et de paix civile. N'est-ce pas précisément pour cela qu’Hitler a été porté au pouvoir ?
Hitler écoute Goebbels. Sur la rive, les porteurs de torche du R.A.D. défilent maintenant en criant et en chantant en cadence. L'orage s'est rapproché : le tonnerre roule dans la vallée entre les collines et à l'horizon, vers Bonn, de brusques zébrures bleutées brisent l'obscurité et révèlent les nuages noirâtres qui arrivent sur Godesberg. L'ordre, la discipline, les voici vivants dans ce défilé, dans ces uniformes que l'on devine, dans ces chants et ces slogans lancés dans la nuit rhénane. Mais le capitaine Rœhm s'est obstiné.
Il a continué à défendre ses S.A. Déjà, jeune capitaine, dans la fange des tranchées, il se faisait auprès des officiers d'Etat-major, distants et seigneuriaux, l'interprète des fantassins, ses hommes dont il partageait la vie sous les éclats des obus français. Maintenant ses hommes sont les Chemises brunes et ils répètent avec un jeune S.A. de Hambourg ces mots qui sont la rancœur des Alte Kämpfer :
« Aujourd'hui, que nous avons réussi, que la victoire est à nous, que la canaille antiallemande est à nos genoux, vous êtes là aussi et vous criez plus fort que nous : Heil Hitler ! comme si vous étiez des combattants, dégoûtants, visqueux, vous vous insinuez dans nos rangs... Ce que nous avons conquis dans et par le sang vous tentez de le monnayer. »
Ces opportunistes qui accourent au nazisme victorieux, un mot a été forgé pour les désigner : ils sont les Märzgefallene qui s'accrochent à la victoire. Alors, la colère des S.A. éclate : « Ecoutez bien, hommes du passé, vous n'insulterez plus longtemps les Alte Kämpfer... »
Bientôt ce sera donc la Nuit des longs couteaux, la nuit du vrai règlement de comptes avec les « gardiens de la Réaction », comme disent les S.A. Et Rœhm se range aux côtés de ses hommes. Le 16 avril 1934, il défend les droits communs que le ministère de l'Intérieur veut chasser des S.A. Rœhm protège ses camarades.
« Lorsque, au cours des années de lutte qui précédèrent la prise du pouvoir, écrit-il, nous avions besoin d'hommes à poigne, alors des citoyens qui, dans le passé, s'étaient écartés du droit chemin sont venus grossir nos rangs. Ces hommes chargés d'un casier judiciaire venaient à nous parce qu'ils pensaient pouvoir effacer leurs fautes en servant dans les S.A... Mais maintenant beaucoup d'Alte Kämpfer des S.A. ont dû se retirer à cause de leurs antécédents judiciaires et cela dans le IIIeme Reich pour lequel ils ont risqué leur vie... Les esprits boutiquiers ne comprendront jamais que l'on puisse garder de tels éléments dans la Sturmabteilung. »
Rœhm au mois d'avril 1934, il y a seulement deux mois, Roehm se crispant dans la défense des S.A. : le vieux camarade de Hitler sent peu à peu dans ce printemps le Führer changer, s'éloigner des Alte Kämpfer et imprudemment avec le franc-parler du reître arrogant et bravache, il n'hésite pas à dire tout haut ce qu'il pense.
Quand il rencontre Rauschning, il s'emporte : « Adolf devient un homme du monde ! Il vient de se commander un habit noir... Il nous trahit tous, il ne fréquente plus que les réactionnaires. Il méprise ses anciens camarades ».
Camaraderie déçue, amitié jalouse de Rœhm, déception presque amoureuse du plus vieux des compagnons de Hitler, ce Rœhm qui est aussi un homosexuel, lié, au-delà des sentiments normaux, aux hommes en qui il a placé sa confiance. Rœhm qui s'entoure de jeunes fils de la noblesse qui constituent un brillant Etat-major aux visages d'anges pervers : baron von Falkenhausen, comte von Spreti, prince de Waldeck : tous aides de camp du capitaine Rœhm qui sait défendre ses fidèles, Rœhm qui parle trop.
Tous les matins, Rœhm fait une promenade à cheval dans le Tiergarten. Il va avec un ou deux compagnons, dans la fraîcheur d'avril, parcourir au trot, la Siegesallee, qui, décorée des 32 statues de souverains prussiens, traverse le parc berlinois du nord au sud. Puis l'allure ralentit, Rœhm mène son cheval au pas, les jambes tendues sur les étriers, le torse bombé, il parle, il pérore. Le groupe passe devant la fontaine Wrangel, le monument de Gœthe, celui à Lessing, on s'enfonce dans les allées qui mènent vers Potsdam et que les promeneurs évitent le soir, on franchit les petits cours d'eau qui parcourent le parc. « Un matin d'avril, dit l'un des compagnons habituels du capitaine, nous rencontrâmes un groupe de responsables du Parti. Rœhm les suivit des yeux d'un air méprisant et dit :
« — Regardez bien ces types-là ! Le Parti est devenu un hospice pour vieillards, ce n'est plus une force politique. Ces gens-là ont peut-être été utiles pour obtenir une décision, maintenant ils sont un poids mort. Nous devons nous en débarrasser rapidement Alors, alors seulement, pourra commencer la vraie révolution ».
Rœhm a parlé avec détermination, il presse sa monture qui prend le trot
« — Comment cela serait-il possible ? demande à Rœhm son compagnon.
« — J'ai mes S.A. »
Matin d'avril 1934 dans le Tiergarten.
LE DISCOURS DU 18 AVRIL 1934
Bien sûr Hitler et ceux qui l'appuient, ceux qui craignent les « longs couteaux » des tueurs et que rassure le Chancelier partisan de l'ordre et de la grande industrie, savent ce que pensent Rœhm et ses S.A. et ce qu'ils espèrent. D'ailleurs Rœhm ne dissimule rien. Le 18 avril 1934, celui que, privilège unique, le Führer tutoie, qui commande les forces les plus nombreuses du IIIeme Reich, celui qui est ministre d'Etat, chef d'Etat-major de la Sturmabteilung décide de frapper publiquement un grand coup. Il convoque le corps diplomatique et les journalistes étrangers pour une conférence de presse, officielle, à Berlin. Pas une ambassade n'est absente, tous les correspondants de presse sont là. Quand Rœhm se lève, trapu et rond dans son uniforme brun, le silence s'établit instantanément. Chacun ici comprend que, à l'occasion de ce discours, Rœhm s'adresse à l'Allemagne, à ses camarades qui sont au pouvoir et à Adolf Hitler.
Rœhm parle d'abord des principes du national-socialisme : « Le national-socialisme, s'écrie-t-il, signifie la rupture spirituelle avec la pensée de la Révolution française de 1789 ». Cela est banal et ressemble à ce que répète depuis des années Rosenberg, l'idéologue du Parti. L'intérêt décroît : se serait-on trompé sur Rœhm ?
Le capitaine fait une pause. Dans le grand salon brillamment éclairé où la chaleur est lourde, on toussote, les chaises remuent. Par les larges baies on aperçoit le jardin pris dans une lumière douce d'avril.
« Je vais vous parler de la Sturmabteilung et de sa nature ». Immédiatement tout le monde se fige, « La S.A. est l'héroïque incarnation de la volonté et de la pensée de la révolution allemande », commence Rœhm, puis il fait l'historique de la formation qu'il commande. « La loi de la S.A., continue-t-il, est nette : obéissance, jusqu'à la mort, au chef suprême de la S.A. Adolf Hitler. Mes biens et mon sang, mes forces et ma vie : tout pour l'Allemagne ».
Tout cela n'est encore que répétition de formules connues : il faut attendre. Rœhm parle de sa voix terne dans les intonations, mais puissante, voix d'officier habitué à donner des ordres, où l'accent bavarois transparaît. « Le combat de ces longues années, poursuit-il, jusqu'à la Révolution allemande, l'étape du parcours que nous franchissons en ce moment nous a enseigné la vigilance. Une longue expérience et souvent une expérience fort amère, nous a appris à reconnaître les ennemis déclarés et les ennemis secrets de la nouvelle Allemagne sous tous les masques ».
Cela ne signifie-t-il pas qu'ils peuvent aussi avoir pris le masque nazi ? Tout le monde dès lors ne peut-il pas être l'ennemi des S.A. ? Phrase maladroite, agressive de Rœhm, qui inquiète tous ceux qui ne sont pas avec lui, derrière lui, et ses S.A.
« Nous n'avons pas fait une révolution nationale, dit-il en haussant le ton, mais une révolution nationale-socialiste et nous mettons l'accent sur le mot socialiste ». Et le ton monte encore, inhabituel devant une assemblée de diplomates et de journalistes étrangers. « Réactionnaires, conformistes bourgeois, s'écrie-t-il,... nous avons envie de vomir lorsque nous pensons à eux. » Dans la salle, c'est le silence, un silence passionné et gêné comme si les mots et le ton ne convenaient pas, comme si Rœhm s'était trompé de public et de lieu et se croyait au Sportpalast. « La S.A., conclut-il, c'est la révolution nationale-socialiste ! » Des applaudissements éclatent venant des côtés et du fond de la salle où sont regroupés des gradés de la Sturmabteilung. Rœhm s'assied : ses aides de camp, surtout le comte von Spreti, le congratulent.
C'était il y a un peu plus de deux mois. Et, ce soir, sur la terrasse de l'hôtel Dreesen, entre Goebbels et Hitler, c'est de cela qu'il est question même si on ne rappelle pas les termes du discours de Rœhm. C'est inutile, Hitler ne peut que se souvenir.
Brusquement, l'orage éclate, quelques gouttes énormes s'écrasent sur la terrasse. En même temps se lève un vent frais qui entraîne la légère poussière ; le tonnerre retentit dans un claquement proche. La pluie, la pluie maintenant violente, balayant le jardin devant la terrasse, courbe avec le vent les arbres et les haies. C'est une bousculade vers l'abri. Le Führer se lève lentement, il rit en repoussant ses mèches trempées, il se secoue ; Goebbels rit avec lui et marche à ses côtés en faisant de grands gestes.
Dehors, devant l'hôtel, les chants continuent, avec plus de vigueur encore comme si la pluie tendait les énergies en permettant à chacun des jeunes volontaires de montrer sa résistance personnelle. Puis, le vent tombe aussi brutalement qu'il est venu ; les dernières gouttes et c'est à nouveau le calme, il monte de la terre une fraîcheur inattendue et vivifiante.
On apporte des fauteuils secs sur la terrasse pour le Führer et pour Goebbels. Quand Hitler reparaît, des cris s'élèvent de la foule, Hitler répond en saluant presque machinalement. On l'acclame. « Le Führer a l'air grave et pensif, dira Goebbels plus tard, il regarde le sombre ciel de la nuit qui, après un orage purificateur, s'étend sur ce vaste paysage rempli d'harmonie ».
La conversation entre les deux hommes reprend : Brückner fait plusieurs apparitions, montrant des dépêches. Qui est fidèle au Chancelier, qui ne l'est pas ? Rœhm lui-même, le 20 avril, deux jours à peine après son discours devant le corps diplomatique n'a-t-il pas renouvelé son serment de fidélité au Führer ? C'était le 45eme anniversaire de Hitler. Fêtes et discours remplissaient toute l'Allemagne ; les organisations de jeunesse organisaient des défilés, le Parti des rassemblements où se succédaient, sous les portraits immenses du Führer les orateurs qui invitaient la foule à crier Heil Hitler ! Goebbels, à la propagande, avait orchestré toutes les cérémonies et Rœhm aussi célébrait, dans un ordre du jour, l'éloge de « Adolf Hitler, Chef suprême des S.A... C'était, continuait-il, c'est et ce sera toujours notre bonheur et notre fierté d'être ses hommes les plus fidèles en qui le Führer peut avoir confiance, sur lesquels il peut compter dans les bons et encore davantage dans les mauvais jours ». Et Rœhm concluait ; « Vive Adolf Hitler, Vive le Führer des Allemands, chef suprême des S.A. » Dissimulateur, comploteur ce Rœhm ou plutôt adversaire non pas de Hitler, mais de ceux que les S.A. appellent la Reaktion ?
Hitler pourtant doit choisir et Goebbels est là pour qu'il n'hésite plus et pour savoir aussi quel est le choix du Chancelier.
Un S.S. s'approche de l'Oberleutnant Wilhelm Brückner et lui parle à voix basse. L'aide de camp de Hitler se lève rapidement et gagne l'intérieur de l'hôtel Dreesen. Joseph Goebbels se tait lui aussi : il attend comme le Chancelier. Voici Brückner qui revient. Il tient un message.
Devant l'hôtel, un motocycliste fait hurler le moteur de sa machine, puis repart dans un éclatement d'explosions saccadées.
Le message est du Reichsminister Gœring. Le Chancelier le lit, puis le tend à Goebbels. A Berlin, Karl Ernst, Obergruppenführer de la Sturmabteilung, aurait mis ses S.A. en état d'alerte depuis cet après-midi du vendredi 29 juin. Goebbels confirme : il allait lui-même donner l'information. Elle est grave : la Sturmabteilung est-elle décidée à passer à l'action dans la capitale ? Est-ce la Nuit des longs couteaux qui commence ? Ce Karl Ernst est un homme résolu : l'un de ces chefs S.A. sorti de rien, qui ont servi d'hommes de main, d'hommes à tout faire, au Parti nazi, d'autant moins arrêtés par les scrupules qu'ils voyaient dans le nazisme l'occasion de s'emparer à leur profit personnel de la puissance et de la richesse. Et ils y sont parvenus.
Karl Ernst, qui n'a pas 35 ans, commande à 250 000 hommes. Ancien portier d'hôtel, ancien garçon de café, il arbore maintenant des uniformes flamboyants, baroques, abusant des médailles, des insignes. Sur sa tête puissante et vulgaire de mauvais garçon, où la bouche épaisse dit la soif de jouissances, il porte, obliquement, crânement, de façon désinvolte, sa casquette d'Obergruppenführer des S.A. Il séduit les héritières des familles de la haute société berlinoise. On le dit aussi homosexuel. Son rire, son cynisme éclatent, et ses yeux s'allument quand il visite les entrepôts abandonnés ou les caves transformées en Bunkers, tous ces lieux où les S.A. « corrigent » les Allemands récalcitrants. Les hommes d'Ernst bénéficient de l'impunité : vols, meurtres, viols, tout devient affaire politique et Ernst couvre ses S.A. A Berlin, on le craint : pour certains il n'est qu'un sadique, un droit commun transformé en responsable officiel, en représentant de l'ordre et de l'Etat. Il est pourtant reçu dans la bonne société et on ne le voit qu'en compagnie d'Auguste Guillaume de Prusse, quatrième fils du Kaiser. Et c'est ce Karl Ernst qui vient selon le message reçu par Hitler à Godesberg, de mettre ses S.A. en état d'alerte. Le mécontentement des Chemises brunes a-t-il donné naissance à un complot ?
Déjà, vers la fin du mois d'avril, Karl Ernst avait fait part de ses difficultés à un interlocuteur inattendu. Ernst, en effet, avait reçu l'attaché militaire français, le général Renondeau. Quelle satisfaction pour l'aventurier d'accueillir cet officier étranger, de mesurer ainsi, vraiment, qu'on a réussi. Devant le général, Karl Ernst fait étalage de son passé, de ses responsabilités nouvelles. La conversation en tête à tête dure près de deux heures. « Il me raconta, écrit le général Renondeau, maints épisodes d'une carrière qui n'est encore qu'à ses débuts mais qui a été jusqu'à la prise du pouvoir par Hitler pleine d'aventures et de coups d'audace. » Sur ses coups de main de Alte Kämpfer, Ernst est intarissable.
« Comme je lui disais, continue le général Renondeau, que ses fonctions actuelles devaient lui paraître très aisées à remplir, par comparaison avec ce qu'il avait fait, il me répondit : « Détrompez-vous. Nous avons promis beaucoup et c'est terriblement difficile à tenir. Il y a bien des impatients et des exigeants qu'il faut calmer ; j'ai commencé par pourvoir les vieux camarades qui ont mené le combat avec moi. Ceux-là sont casés, tous. Mais il y a les autres qui ne me rendent pas toujours la tâche facile. » Et le général Renondeau ajoutait : « Cet aveu d'un des chefs les plus ardents qu'il m'ait été donné jusqu'ici de rencontrer parmi les S.A. est significatif ».
Les S.A. de Berlin, ces S.A. insatisfaits, sont maintenant, si le Chancelier Hitler se fie à Goebbels et à Gœring, en état d'alerte.
HERMANN GŒRING
On entend devant l'hôtel Dreesen à nouveau le bruit d'une moto : c'est un autre message de Gœring. Il donne des informations sur la situation à Berlin et à Munich : là aussi, les S.A. seraient en état d'alerte. Le Chancelier en relit le texte. Il ne le commente pas. Goebbels, témoin de cette nuit, assis en face du Führer, dira plus tard : « Le Fuhrer, comme cela est arrivé dans d'autres situations graves et périlleuses, a de nouveau agi selon son vieux principe : ne dire que ce que l'on doit dire absolument, ne le dire qu'à celui qui doit le savoir et seulement lorsqu'il doit le savoir ». Hitler se tait : Goebbels n'est pas encore à mettre dans le secret des décisions. Par contre, Hitler dicte une réponse à Gœring.
D'ailleurs, durant toute la journée de ce vendredi 29, Hitler a échangé des messages avec Hermann Wilhelm Gœring et, chaque fois, la voie aérienne a été choisie. Un appareil a décollé, soit de l'aérodrome d'Essen, soit de celui de Hangelar près de Bonn pour Tempelhof. De là, un courrier rejoint Gœring qui a communiqué avec Hitler de la même façon. Souci du secret, de la rapidité, mais aussi marque du style de Hermann Gœring qui cumule les fonctions, à la fois de ministre sans portefeuille dans le cabinet de Hitler, de ministre de l'Intérieur du gouvernement prussien, de commissaire du Reich pour l'Aviation. Du Reichsminister Gœring, le Chancelier sait qu'il n'a pas à craindre une quelconque complicité avec la Sturmabteilung et son chef d'Etat-major Rœhm.
On raconte parmi les dignitaires nazis et naturellement le Chancelier est au courant, comment le 15 septembre 1933 les deux hommes se sont discrètement mais nettement heurtés.
Hermann Goering voulait présider, le jour de la séance inaugurale du nouveau Conseil d'Etat, une grande parade des forces nazies : S.S. et S.A. rassemblés devaient défiler devant lui seul. Mais Rœhm et Karl Ernst, écartés de la cérémonie, avaient fait comprendre que si elle se déroulait sans eux l'indiscipline régnerait dans les rangs des Chemises brunes, ridiculisant Goering. Ce dernier fut contraint de s'incliner. Cent mille hommes, en brun et en noir, furent rassemblés mais les S.A. et les S.S. défilèrent au pas de l'oie devant les trois chefs nazis. Ernst et Rœhm avaient fait reculer Goering. Il n'était pas homme à l'admettre et d'autant plus que son opposition à Rœhm était ancienne, profonde, faite de bien d'autres choses que de la rivalité née d'une parade à partager.
Avec Karl Ernst aussi il y a de vieux comptes et des liens anciens, liens troubles de la complicité.
Au moment où devant la Cour suprême de Leipzig s'ouvre, le 21 septembre 1933 le procès contre les communistes et van der Lubbe, accusés d'être coupables de l'incendie du Reichstag, en février 1933, une fête des S.A. bat son plein dans un grand hôtel de Berlin. On boit sec, on chante, des hommes oscillent se tenant par les épaules au rythme des chants guerriers du nazisme. Dans un coin, entouré de courtisans respectueux et admiratifs, il y a l'Obergruppenführer Karl Ernst qui parle et boit On évoque l'ouverture du procès de Leipzig contre le communiste Dimitrov, les causes de l'incendie du Reichstag. Personne ne parle de la culpabilité de Gœring ou de celle de Rœhm qui aurait placé à la disposition du Reichminister un groupe de S.A. décidés à mettre le feu au bâtiment afin de donner un prétexte à la répression qu'un mois après la prise du pouvoir, les nazis veulent exercer.
Mais l'Obergruppenführer Ernst part d'un grand éclat de rire, on le regarde, on se tait : « Si je dis oui, c'est moi qui y ai mis le feu, je serai un foutu imbécile, lance-t-il. Si je dis non, je serai un foutu menteur », et il rit à nouveau. Ces complicités entre un exécutant et l'organisateur d'un forfait sont toujours dangereuses : Ernst et Gœring ont raison de se méfier l'un de l'autre. Et d'abord l'Obergruppenführer Karl Ernst car Gœring n'est pas homme à tolérer les obstacles.
Déjà pendant la Première Guerre mondiale, le brillant officier d'aviation, au regard métallique dans un visage beau, régulier, apparut à ses camarades comme l'homme qui sait atteindre son but, à n'importe quel prix. C'était un officier dur, autoritaire : « Cela se voyait à ses gestes et à sa façon de parler », dira le lieutenant Karl Bodenschatz. Pilote aux multiples victoires, Gœring a collectionné les décorations : Croix de fer, Lion de Zaehring avec épées et surtout l'Ordre pour le Mérite, la plus haute décoration de l'armée allemande. Le voici lieutenant, commandant de l'escadrille Richthofen, prêt à faire tirer sur les révolutionnaires.
Quand l'armistice tombe sur l'Allemagne, Gœring, le brillant héros, fait partie de ces officiers révoltés qui crient à leurs camarades la nécessaire désobéissance au nouveau régime. Il le fait un soir, à l'Opéra de Berlin, interrompant le ministre de la Guerre, le général Reinhard. « Camarades, lance-t-il, je vous conjure d'entretenir votre haine, la haine profonde, la haine tenace que méritent les brutes qui ont déshonoré le peuple allemand... Mais un jour viendra où nous les chasserons de notre Allemagne. Préparez-vous pour ce jour. Armez-vous pour ce jour. Travaillez pour ce jour ».
Bientôt, Gœring quitte l'armée, refusant de servir un gouvernement républicain ; il entre dans l'industrie aéronautique, voyage, et en Suède, par hasard, il rencontre Karin von Kantzow, mariée à un aristocrate suédois. Elle est d'une beauté régulière, d'une douceur et d'une grâce fascinantes. Gœring s'éprend d'elle ; c'est une passion romantique et absolue. Les voici en Allemagne, mariés, amoureux l'un de l'autre, tous deux ardemment nationalistes et bientôt, dans la capitale bavaroise, Gœring rencontre Hitler. « Il cherchait depuis longtemps un chef, racontera-t-il, qui se serait distingué d'une manière ou d'une autre pendant la guerre... et qui jouirait ainsi de l'autorité nécessaire. Le fait que je me plaçais à sa disposition, moi qui avais été le premier commandant de l'escadrille Richtofen, lui paraissait être un coup de chance ».
Rapidement Hermann Gœring devient le responsable de la Sturmabteilung, créée par Ernst Rœhm. Ainsi pour la première fois, les routes des deux hommes se croisent. Mais Gœring, ancien combattant qui fait figure de héros national, auréolé de la gloire qui touche les pilotes survivants, Gœring, lié aux milieux traditionnels de l'armée et de l'aristocratie, mari d'une comtesse suédoise, riche des deniers de son épouse, Gœring est une personnalité très différente de celle du capitaine des tranchées. Gœring est ainsi dès le début le lien entre Hitler et la société traditionnelle, un moyen aussi pour le chef du parti nazi d'opposer une force à Rœhm, de ne dépendre de personne en jouant sur les rivalités entre ces anciens officiers si opposés.
Gœring va payer cher dans son corps son entrée au parti nazi et les responsabilités qu'il y assume. Lors du putsch manqué du 9 novembre 1923, quand dans les rues défilent les S.A., que le garde du corps de Hitler crie aux policiers qui forment un barrage compact : « Ne tirez pas, le général Ludendorff arrive », que les premiers coups de feu claquent sinistrement, que Hitler s'enfuit, que Ludendorff imperturbable continue d'avancer, Hermann Gœring s'écroule, gravement blessé à l'aine. On le pousse dans l'encoignure d'une porte. II perd son sang. On le panse sommairement et l'on réussit à le soustraire à l'arrestation. Mais la blessure est mal soignée dans les conditions de la clandestinité, et bientôt pour calmer la douleur on lui administre des doses toujours plus fortes de morphine. Il grossit, son visage s'affaisse, le regard se voile et le svelte et autoritaire officier de 1918 n'est plus, vers 1923, qu'un morphinomane obèse, atteint de crises d'épilepsie et que l'on doit interner. Mais il se reprend, suit des cures de désintoxication, et surtout se grise d'action politique : député, mandataire des nazis dans les milieux de la grande banque et de l'industrie, dans les centres militaires, il est bientôt président du Reichstag, bientôt ministre de l'Intérieur du gouvernement prussien.
Actif, jouissant de sa puissance, il est soucieux d'assurer son pouvoir. Le pouvoir pour un homme comme lui qui ne se paie pas de mots, qui a vu naître dans les rues, par la violence, la domination nazie, ce sont d'abord des hommes à sa disposition, et d'autant plus que Rœhm maintenant est le chef d'Etat-major des S.A.
Mais Gœring est habile. Il ne faut pas heurter de face ce rival qui commande à des millions d'hommes. Alors le Reichsminister Gœring louvoie : contre Rœhm et pour détruire aussi les adversaires du nazisme. « Frères allemands, s'écrie-t-il à Francfort le 3 mai 1933, aucune bureaucratie ne viendra paralyser mon action. Aujourd'hui, je n'ai pas à me préoccuper de justice, ma mission est de détruire et d'exterminer... Je ne mènerai pas un tel combat avec la seule puissance de la police, cette lutte à mort, je la mènerai avec ceux qui sont là devant moi, les Chemises brunes. » Il suffit à 25 000 S.A. et à 15 000 S.S. de passer un brassard blanc sur leurs chemises brunes ou noires pour devenir des policiers, représentants officiels de l'Etat. Mais, en même temps, il faut réduire la puissance d'Ernst Rœhm. Rœhm qui parle toujours de liquider le Reaktion alors que Gœring est au mieux avec les magnats de la Ruhr, les hobereaux prussiens et les officiers du Grand Etat-major.
Il y a aussi que dans son fief prussien Gœring se heurte quotidiennement à la puissance de la Sturmabteilung. Les conseillers S.A. sont dans toutes les administrations ; les préfets de police prussiens portent l'uniforme S.A. : tous ces hommes qui détiennent l'autorité échappent au contrôle de Gœring.
Alors le Reichsminister manœuvre. Dès sa prise de pouvoir en Prusse, il a constitué sous les ordres de Rudolf Diels une police spéciale issue d'un service déjà existant (la section IA) de la préfecture de police de Berlin. Diels est un homme capable, actif. Il rassemble des techniciens du renseignement policier, criminalistes jeunes et efficaces et il crée un bureau politique de renseignement qui va devenir la police secrète d'Etat. Le service s'étoffe, les spécialistes affluents : ils bénéficient de toutes les libertés. Ils peuvent agir sans respecter la Constitution. Bientôt les hommes de Diels quittent l'Alexanderplatz où s'élève le bâtiment de la préfecture de police et s'installent les uns dans l'ancien immeuble du Parti communiste Karl-Liebknecht Haus, les autres au n° 8 de la Prinz-AlbrechtStrasse, tout près de la résidence de Gœring. Désormais, le service de Rudolf Diels peut recevoir son appellation officielle. Elle va résonner sur le monde, pendant des années, comme un glas : Geheime Staatspolizei, GESTAPO. Son chef est Hermann Gœring.
HIMMLER, HEYDRICH ET LES SS.
Gœring et la Gestapo doivent immédiatement défendre leur fièf : contre les S.A. dont Diels nettoie les prisons, mais aussi contre les S.S. dont le chef est un homme de l'ombre, le Reichsfuhrer S.S. Heinrich Himmler. Gœring comprend vite qu'il ne peut à la fois lutter contre Rœhm et contre Himmler ; il lui faut choisir. Un jour d'octobre 1933, Diels, rentrant dans son bureau à la Gestapo, surprend un S.S., Herbert Packebusch (homme de confiance du Gruppenführer S.S. Kurt Daluege) en train de fouiller dans ses papiers. Il le fait arrêter, mais le lendemain Gœring ordonne après une entrevue avec Daluege sa libération. Rudolf Diels a compris : son chef a choisi l'alliance avec Himmler.
Le Reichsführer S.S. Heinrich Himmler est pourtant, théoriquement, un subordonné de Rœhm. Il ne manque jamais, à chaque anniversaire, de répéter à son chef son allégeance.
« Comme soldat et ami, je te souhaite tout ce qu'on peut promettre dans l'obéissance, écrit Himmler à Rœhm. C'était et c'est toujours notre plus grande fierté d'appartenir à ta suite la plus fidèle ».
Mais l'allégeance c'est aussi la garantie de la jalousie et de l'ambition.
Or, Himmler monte vite, ses S.S., aux uniformes noirs, à la tête de mort comme emblème, sont des troupes triées sur le volet. N'entre pas qui veut dans les S.S., la discipline y est stricte. Les S.S. parlent peu, ils agissent, dit-on à Berlin. Ils laissent la rue, et les fanfaronnades aux S.A. Eux, ils sont la cuirasse dure, impénétrable qui protège le parti. Chaque chef nazi a sa garde S.S. qui porte, sur la manche de son uniforme, brodé en lettres blanches, le nom du dirigeant qu'elle protège. Les miliciens noirs sont donc des soldats d'élite, des seigneurs de l'ombre dont la puissance réelle s'accroît, discrète et efficace. Ils sont les puritains du parti. C'est le Reichsführer Himmler lui-même qui les opposera aux Sections d'Assaut : « La S.A. c'est la troupe, dira-t-il, la S.S. c'est la garde. Il y a toujours eu une garde. Les Perses en ont eu une, et les Grecs, et César, et Napoléon, et le vieux Fritz. La garde de la Nouvelle Allemagne, c'est la S.S. »
De plus, Himmler, froid, réaliste, sachant le rôle de la police, ajoute à la direction des S.S. la présidence de la police politique de Bavière (Bay-PoPo). Il a trouvé un complice, un ancien officier de marine révoqué au profil d'oiseau de proie, au corps d'athlète, au visage long, au nez busqué, Reinhardt Tristan Eugen Heydrich. Ce séducteur glacé a vu sa carrière militaire brisée par une affaire de femmes. Traduit devant un jury d'honneur par l'amiral Raeder, ses déclarations, qui mettent en cause une ancienne maîtresse, sont à ce point dénuées du sens de l'honneur que le jury d'officiers de marine prononce une sanction sans équivoque : « mise à pied immédiate pour cause d'indignité ». Il ne reste plus à Heydrich qu'à entrer dans les S.A. Le 14 juin 1931, il rencontre le Reichsführer S.S. Himmler. Bientôt, le 5 octobre, Heydrich fait partie de l'Etat-major S.S. : il est Sturmführer chargé de mettre sur pied un service de renseignements. Heydrich va faire merveille : calculateur, précis, dissimulé, il monte le Sicherheitsdienst — S.D. —. Heydrich est comme le dit Himmler « un agent de renseignement né, un cerveau qui sait démêler tous les fils et les nouer là où il faut ». Heydrich veut tout surveiller, tout contrôler, tout espionner. Son ambition est de faire du S.D. le service de renseignements tout-puissant du Parti nazi. Il va y réussir.
Partout, dans les différents Länder, Himmler l'idéologue, Heydrich le technicien, tissent la toile de la police secrète, au service de Hitler — et à leur service — et doublent les organismes et les fonctionnaires officiels. Bientôt dans toute l'Allemagne, sauf en Prusse, Himmler et Heydrich contrôlent la police secrète.
Et Gœring choisit de s'allier à eux, Budolf Diels prend peur : il a heurté de front l'Ordre noir, le voici désavoué. Connaissant les méthodes expéditives des S.S., il s'enfuit à Karlsbad. Pourtant ce n'est pas encore la fin de la puissance policière de Gœring : il lutte pied à pied. Diels peut revenir, être autorisé par décret du 9 novembre 1933 à porter l'uniforme de Standartenführer S.S., preuve qu'un accord est intervenu et que le passé est oublié.
Mais le combat sourd et souterrain se poursuit. Heydrich continue son travail de rongeur et d'organisateur. Il a l'appui du ministre de l'Intérieur du Reich Wilhelm Frick qui lutte pour que toutes les polices des Länder, les provinces allemandes, soient unifiées. Et Gœring peu à peu cède du terrain, car il a besoin de Heydrich et de Himmler et de l'Ordre noir pour combattre les S.A. de Rœhm, chaque jour plus remuants, chaque jour plus nombreux, défilant dans les villes en colonnes sombres, précédées de tambours et de fanfares et réclamant à grands cris la poursuite de la révolution.
Au mois d'avril 1934, Himmler atteint son but : le 10 avril, il visite en compagnie de Heydrich et de Gœring le 8 de la Prinz-Albrecht-Strasse, le siège de la Gestapo. Il vient d'obtenir le contrôle de la police secrète de Prusse. Rudolf Diels a été renvoyé et nommé « Regierungspräsident » à Cologne. Quelques jours plus tard, le 20 avril, le couple Himmler-Heydrich contrôle toute la police secrète d'Allemagne et aussi les compagnies noires, les hommes implacables, les S.S.
Heydrich et Himmler se sont partagé les rôles : le Reichsführer est chef et inspecteur de la police secrète d'Etat (Gestapo) , Heydrich représente le Reichsführer et dirige le Geheime Staatspolizeiamt, administration de la Gestapo ou Gestapa. Heydrich demeure chef du S.D. (Sicherheitsdienst) qui devient, officiellement, le service de renseignements du Parti. Désormais, Himmler et Heydrich dirigent les forces de l'ombre qui « tiennent » le Parti et l'Allemagne. Le lendemain même de leur intronisation, la National-Zeitung dans un éditorial signé simplement des deux initiales H.O., révèle quelques-unes des intentions des deux chefs S.S. :
« La répression se fera désormais plus dure », écrit la National-Zeitung. Et pour bien indiquer que les S.A. aussi sont désormais visés, le journal poursuit : « Par ennemis de l'Etat il ne faut nullement entendre uniquement les agents et les agitateurs bolcheviques, par ennemis de l'Etat il faut entendre tous ceux qui, par la parole ou l'action, quels que soient leurs motifs, compromettent l'existence du Reich ».
Le journaliste ajoute, s'en prenant à la clémence supposée des mois qui viennent de s'écouler : « Depuis la fin de la révolution, l'ennemi politique ne court plus de risques. Dans les premières semaines, il y a eu des actions brutales : aujourd'hui, ceux qui font de l'agitation, du dénigrement, les saboteurs et les calomniateurs sont exposés tout au plus à être internés préventivement pour une durée plus ou moins longue dans un camp de concentration. Cette détention a des formes qui ne sont pas totalement effrayantes, mais cela va changer maintenant Nous ne torturerons et ne tourmenterons personne, mais nous les fusillerons et tout d'abord les communistes. »
Sur tous les perturbateurs plane ainsi la menace du peloton d'exécution. Aux S.A. de réfléchir. Gœring doit se féliciter d'avoir choisi l'alliance avec le Reichsführer S.S. A Nuremberg, face aux juges alliés avec sa morgue et son intelligence, il expliquera comment il avait réagi en cet avril 1934 à la décision du Führer de confier à Himmler et à Heydrich la direction de la Gestapo. « A cette époque, explique-t-il, je ne me suis pas expressément opposé à ce principe. Cela m'était désagréable car je voulais diriger ma police secrète moi-même. Mais, quand le Führer me demanda d'accepter, disant que c'était la voie correcte, qu'il était nécessaire que la lutte contre les ennemis de l'Etat fût menée d'une manière uniforme sur toute l'étendue du Reich, je remis la police entre les mains de Himmler qui plaça Heydrich à sa tête. »
Ainsi Himmler est parvenu à ses fins et Rœhm va devoir aussi compter avec ce subordonné dont la puissance est désormais secrète et immense, étendant ses rets sur toute l'Allemagne. Gœring qui s'est incliné, qui sait avoir en Himmler un allié contre Rœhm ne s'en méfie pas moins. Il crée rapidement une nouvelle police personnelle, nouvelle garde prétorienne, la Landespolizeigruppe, qui va prendre ses quartiers près de Berlin à Lichterfelde.
Maintenant Hermann Gœring est plus tranquille. Dans son luxueux appartement du Kaiserdamm, il reçoit royalement singeant la légèreté, lui qui pèse près de 127 kilos, montrant à tous le portrait de sa femme Karin morte d'émotions et de fatigues, alors qu'il était engagé dans la bataille pour la prise du pouvoir, Karin à laquelle il voue un culte sincère et théâtral.
Hitler le récompense de ses services et le voici en plus de ses charges ministérielles, Grand Louvetier du Reich et Grand Maître des Eaux et Forêts, s'employant à protéger les animaux par des lois précises, commençant sur la propriété qu'il s'est attribuée dans la région de Schorfheide, près du lac de Wackersee, à faire édifier un immense bâtiment, rendez-vous de chasse et demeure seigneuriale, sanctuaire, mausolée puisqu'il rêve d'y transporter le corps de Karin et qu'il donne à cette « folie » le nom de Karinhall. Sur les landes où la bruyère est courbée par le vent froid, parmi les arbres à l'écorce noirâtre, il fait bâtir cette résidence baroque où il va pouvoir recevoir en mégalomane, puissant et habile, en maître du Reich. Mais celui que Schacht, le magicien des finances du Reich, dépeignait comme une personnalité dont les connaissances dans tous les domaines relevant d'un homme d'Etat étaient nulles » sait bien quels sont ses ennemis.
Rœhm est de ceux-là, Rœhm dont il faut se débarrasser, pour jouir à l'aise du pouvoir, de la fortune et des titres. Et Gœring les collectionne : ne vient-il pas d'être aussi nommé général ? Ridicule, Gœring ? A écouter Schacht, on le croit. « Son comportement personnel était si théâtral qu'on ne pouvait que le comparer à Néron. Une personne qui prit le thé avec sa seconde femme raconta qu'il était vêtu d'une sorte de toge romaine avec des sandales ornées de joyaux, les doigts couverts d'innombrables bagues et ruisselant de pierreries de la tête aux pieds. Son visage était maquillé et il avait du rouge à lèvres. »
Ridicule ? Mais Schacht ajoute : « J'ai décrit Hitler comme un personnage amoral, mais je ne puis considérer Gœring que comme un être immoral et criminel ». Et l'un des proches parents d'Hermann Gœring précise : « Son manque de scrupules l'aurait fait marcher sur des cadavres. »
Hermann Gœring, Heinrich Himmler, Reinhardt Heydrich : Rœhm, Ernst et les S.A. peuvent se méfier. Et c'est précisément Gœring qui, durant toute la journée du vendredi 29 juin 1934, communique avec Hitler et vient encore de lui expédier par avion un message à l'hôtel Dreesen à Godesberg.
3
VENDREDI 29 JUIN 1934
Godesberg. Hôtel Dreesen. Vers 22 heures.
Goebbels regarde le Chancelier qui lit ce nouveau message. « De Berlin et Munich arrivaient des nouvelles graves », commentera plus tard Goebbels. Les messages de Gœring, ceux de Himmler font état de la nervosité des S.A., de préparatifs guerriers. « Le Führer est profondément blessé dans son âme, ajoute Goebbels. Mais aussi comme il est ferme dans sa résolution d'agir impitoyablement, de jeter à terre ces rebelles réactionnaires qui, sous le slogan de Deuxième Révolution, voulaient briser la loi, la fidélité qui les unissaient au Führer et au Parti et plonger le pays dans une confusion dont ils ne pouvaient prévoir la fin. » Goebbels croit-il réellement à cette menace alors que sur la terrasse de l'hôtel Dreesen il approuve et confirme les messages que Gœring fait parvenir depuis Berlin à Hitler ?
Goebbels est en tout cas suffisamment perspicace pour comprendre qu'en cette nuit du 29 juin, il doit y croire, s'il veut rester le chef nazi et le ministre qu'il est devenu. Il doit sans doute se féliciter d'être là, dans l'ombre du Führer, à l'abri de cette ombre, protégé de Gœring, de Himmler, de Heydrich ayant choisi le même camp qu'eux. A temps.
LES SIGNES ANNONCIATEURS...
Il est vrai que les signes n'ont pas manqué depuis quelques mois et Goebbels a toujours su les interpréter. Lui qui jongle avec la vérité il connaît la valeur des mots. Et il y a presque un an déjà, le 6 juillet 1933, les premiers avertissements ont retenti.
Hitler lui-même reçoit ce jour-là, à la Chancellerie du Reich, les Reichstatthalter. Quand le Führer pénètre dans la grande salle aux murs recouverts de marbre, les responsables nazis sont debout, le bras tendu. C'est bien l'une de ces réunions militarisées qu'aime par-dessus tout Adolf Hitler. Sa voix est forte, brutale, comme si au-delà de la salle il s'adressait aux millions de Chemises brunes du Reich que la prise du pouvoir n'a pas apaisés.
« La révolution, commence le Führer, n'est pas un état de choses permanent et nous ne pouvons lui permettre d'en arriver là. Le fleuve de la révolution déchaînée doit être conduit dans le canal sûr de l'évolution ». Autant dire que la révolution est finie et qu'il n'y aura jamais de seconde révolution.
Et, le 16 juillet, à Leipzig, dans un nouveau discours, Hitler est encore plus clair : « Les révolutions ayant réussi au départ, proclame-t-il, sont beaucoup plus nombreuses que les révolutions, qui, une fois réussies, ont pu être contenues et stoppées au moment opportun ».
Sans doute est-ce depuis ces jours de l'été 1933 que Goebbels a compris qu'il lui fallait désormais être prudent dans ses relations avec Ernst Rœhm et les Sections d'Assaut
Pourtant fallait-il déjà choisir ? Rœhm était toujours une force : Hitler lui-même n'agissait-il pas avec prudence ? Lettre personnelle, tutoiement et à l'occasion de la promulgation le 1er décembre 1933, de la loi d'union du Parti et de l'Etat, entrée de Rœhm dans le gouvernement du Reich avec son titre de chef d'Etat-major des S.A. La partie n'était donc pas jouée. Pourtant, pourtant, en même temps que Rœhm, Hess, ce personnage curieux au visage asymétrique qui avait servi de secrétaire à Hitler au temps où celui-ci incarcéré dans la forteresse de Landsberg écrivait Mein Kampf, Hess, au regard d'illuminé et de fanatique, est lui aussi entré au ministère comme chef de cabinet du Führer, son représentant personnel. Rudolf Hess, qui a donc la confiance totale du Chancelier, est devenu le deuxième personnage du Parti après Hitler.
Or, Rudolf Hess prend lui aussi position contre les méthodes chères aux S.A. : « Chaque national-socialiste doit savoir, martèle-t-il, que le fait de brutaliser les adversaires prouve une mentalité judéo-bolchevique et représente une attitude indigne du national-socialisme ». Que pouvait penser un Karl Ernst d'une pareille phrase ? Lui, l'Obergruppenführer qui riait devant les visages martyrisés des prisonniers?
Naturellement la « correction » que Rudolf Hess demande, il ne faut pas la prendre au pied de la lettre. Joseph Goebbels comprend parfaitement qu'elle n'est qu'une façon, la plus payante, de se séparer des S.A., de les obliger à se plier à la discipline du gouvernement nazi, d'exiger, même dans la brutalité, l'ordre et l'organisation méthodique comme savent déjà le faire la Gestapo et les S.S.
Dès lors les avertissements aux S.A. se multiplient, de plus en plus clairs. Joseph Goebbels, lui, ne donne pas de la voix dans le chœur des partisans de l'ordre. Il attend, il note les prises de position : il comprend. Gœring licencie les policiers auxiliaires S.A. et proclame : « A partir du moment où selon les paroles du Führer et chancelier de l'Etat national-socialiste, la révolution est terminée et que la reconstruction nationale-socialiste, a commencé, tous les actes non conformes à la législation pénale, quels qu'en soient les auteurs, seront réprimés sans la moindre indulgence ».
Frick, ministre de l'Intérieur du Reich, est encore plus précis : « La tâche la plus importante du gouvernement du Reich, écrit-il, est maintenant de consolider idéologiquement et économiquement le pouvoir absolu concentré entre ses mains. Or, cette tâche est sérieusement compromise si l'on continue de parler d'une suite à donner à la révolution ou d'une deuxième révolution ». Les S.A. sont une fois de plus directement visés et Frick conclut, menaçant : « Celui qui parle encore en ces termes doit bien se mettre dans la tête que de cette manière il s'insurge contre le Führer lui-même et qu'il sera traité en conséquence ». C'était le 11 juillet 1933.
Les mois passent et les plaintes se précisent Goebbels suit la progression des assauts insidieux ou directs que la vieille bureaucratie allemande ralliée au national-socialisme ou le Parti et ses puissants dirigeants (Gœring, Hess) mènent au nom de l'ordre contre les Sections d'Assaut et donc contre leur chef.
Frick, le 6 octobre, relève que des délits de droit commun, perpétrés par des S.A. ont bénéficié d'un non-lieu. Et le ministre de l'Intérieur du Reich poursuit : « Le service de l'administration d'Etat nationale-socialiste et de la police ne doit plus être gêné d'aucune façon par les interventions inadmissibles des S.A. Les actes répréhensibles commis par des membres des S.A. devront faire l'objet de poursuites énergiques. » Goebbels sait lire un communiqué : celui-ci signifie que les S.A. doivent rentrer dans le rang. Quelques mois plus tard, le 22 février 1934, alors que Rœhm est devenu ministre, Hess, dans le Völkischer Beobachter, lance un nouvel avertissement: « Tout S.A. de même que tout dirigeant politique ou dirigeant des Jeunesses hitlériennes n'est qu'un combattant au sein du parti... Il n'y a, ni à l'heure actuelle ni dans l'avenir, aucune raison de mener une existence propre. »
Rœhm et les Sections d'Assaut doivent plier. Ils peuvent répéter : « Ecoutez bien, hommes du passé, Vous n'insulterez plus longtemps les Alte Kämpfer. » leur marge de manœuvre se rétrécit. Et Goebbels les voit se débattre. Il se tait encore mais il est bien placé, à Berlin, dans le Parti et dans le gouvernement pour savoir ce qui se trame. Il est d'ailleurs en contact avec Ernst Rœhm, il l'écoute, attentif à guetter dans les paroles du chef d'Etat-major ce qui peut dévoiler ses intentions. Rœhm est là, en face de lui. « Il faut, dit-il, faire de l'Allemagne, ein totaler S.A.-Staat. » Il s'obstine donc.
Goebbels suit aussi les progrès de Himmler en marche vers la puissance secrète. Il sait que Rœhm est confiant : Himmler est son vieux compagnon des temps héroïques de Munich en 1922-1923. Himmler alors faisait partie de la Reichskriegsflagge. Lors du putsch, il était derrière les barbelés, tenant le drapeau du Parti. Rœhm aime son vieux camarade Himmler ; il ne s'inquiète pas de la croissance des S.S. Il trouve normal que quelques S.A. deviennent S.S. et d'autant plus que les effectifs des S.S. ne doivent pas dépasser 10 % de ceux des S.A. Goebbels, au printemps 1934, apprend d'ailleurs par ses informateurs que Rœhm et Himmler se sont rencontrés.
RŒHM ET HIMMLER
Vers le début mars, on a vu arriver à Rathenow, venant de Berlin qui n'est qu'à 78 kilomètres, de nombreuses voitures officielles. Elles traversent rapidement la petite ville au moment où les ouvriers des usines d'instruments optiques quittent sur leurs bicyclettes les bâtiments gris pour la pause de midi. Les voitures s'arrêtent devant l'entrée du Gut Gross-Wudicke qui appartient à M. von Gontard.
De la voiture d'Ernst Rœhm descendent aussi le S.A. Standartenführer Graf Spreti, cet aide de camp à visage de fille dont on sait qu'il est la dernière passion de Rœhm, puis le S.S. Gruppenführer Bergmann qui est aide de camp de Rœhm avec le titre de Chef Adjudant et enfin Konsul Rolf Reiner, chef du cabinet de Rœhm. Lui aussi est S.S. Gruppenführer et avec Bergmann ils sont auprès de Bœhm les agents de liaison de Himmler et ses informateurs. D'une autre voiture descendent Himmler et son aide de camp, l'Obersturmbannführer de la S.S. Karl Wolff. A pas lents, le groupe où se mêlent les uniformes noirs et bruns se dirige vers les bâtiments du domaine. Un repas doit y avoir lieu. La conversation est amicale.
Rœhm a même familièrement pris Himmler par le bras. A table, le ton des conversations monte. Rœhm qui a bu et mangé d'abondance, s'enflamme, interpelle Himmler : « Les S.S. ont une attitude conservatrice » dit-il, ils protègent la « Reaktion » et les petits-bourgeois, « leur soumission à la bureaucratie traditionnelle, à l'armée est trop grande ». Himmler se tait : il n'a pas l'habitude d'être ainsi frappé par des reproches publics. C'est son aide de camp Karl Wolff qui prendra — il s'en souvient encore des années plus tard — la défense de son chef, qui était un timide, dira-t-il, et des S.S.
Goebbels et les autres dirigeants du parti — Gœring d'abord — avaient eu connaissance de la rencontre et de son objet. Himmler est apparemment toujours le second fidèle de Rœhm : mais ses réseaux policiers s'étendent Gœring lui envoie des intermédiaires : Pili Körner surtout qui fait la liaison entre « l'aviateur dément », comme l'appellent certains militaires, et le chef des miliciens noirs. Gœring cherche à obtenir des garanties pour lui-même et à pousser Himmler et Heydrich contre Rœhm.
Joseph Goebbels observe ces préparatifs. Il sait que Himmler et Heydrich rassemblent à Berlin des collaborateurs sûrs, qu'ils font venir de Munich : Müller, Heisinger, Huber, Flesch. Autour de Rœhm ils resserrent le cercle.
La Gestapo et aussi des agents de renseignements de l'armée découvrent à Berlin une ancienne ordonnance du mess des officiers de Himmelstadt. Rœhm avait été en garnison dans cette petite ville. L'ordonnance est maintenant restaurateur dans la capitale. Des messieurs auxquels il n'est pas question de refuser de parler lui posent des questions précises sur la lointaine vie privée du capitaine Rœhm. A Himmelstadt, Rœhm avait une liaison avec une jeune fille, commence par dire le restaurateur. L'interrogatoire continue. Bien sûr, ajoute-t-il, les ordonnances savaient que Rœhm avaient aussi des mœurs particulières : « Vous comprenez, dit-il, il tentait toujours de se livrer, sur nous, les ordonnances, à des choses pas morales. »
Les messieurs enregistrent la déposition. Quand la police s'intéresse ainsi à la vie privée d'un ministre cela signifie, à tout le moins, que sa situation n'est plus indiscutable et que certains cherchent à constituer les dossiers de la future accusation.
C'est le mois d'avril 1934 : Rœhm proclame à tous qu'il faut poursuivre la Révolution, l'achever. « Ne débouclez pas vos ceinturons », lance-t-il aux Sections d'Assaut. Et les S.A. parlent de « nettoyer la porcherie ».
Vers la fin de ce mois d'avril, Himmler demande à Bergmann et à Rolf Reiner de lui organiser une nouvelle rencontre avec Ernst Rœhm. Démarche de la dernière chance ? L'entrevue est entourée de mystère. Goebbels ne la connaîtra que plus tard. Il semble que Himmler ait mis Rœhm en garde : « L'homosexualité, dit-il au chef d'Etat-major des S.A., constitue un danger pour le mouvement ». Il n'implique pas Rœhm lui-même mais dénonce les Obergruppenführer S.A. qui comme Heines, Koch, Ernst et beaucoup d'autres sont ouvertement, publiquement, des invertis. « N'est-ce pas un grave danger pour le mouvement nazi, continue Himmler, que l'on puisse dire que ses chefs sont choisis sur des critères sexuels ? »
Rœhm ne répond pas : il hoche la tête, il boit. Himmler évoque les bruits qui courent à Berlin : des chefs S.A. auraient organisé un véritable réseau de recrutement qui, dans toute l'Allemagne, draine les jeunes et beaux S.A. vers Berlin et les orgies auxquelles Rœhm et ses aides de camp participent Himmler se contente de rappeler l'intérêt supérieur de l'Etat, qui est au-dessus de tout. Rœhm brusquement éclate en sanglots, il remercie bruyamment Himmler de ses conseils, lui prend les épaules. Il semble que l'alcool aidant, Rœhm reconnaisse ses torts, promette de s'amender, de suivre les avis de son vieux camarade Himmler.
Les chefs S.A. quittent l'auberge retirée où a eu lieu l'entrevue. Mais le lendemain matin les agents de Himmler auprès de Rœhm lui apprennent que durant toute la nuit une des plus fantastiques orgies qu'ils aient vues s'est déroulée au Stabsquartier, le quartier général de Rœhm. Des bouteilles se sont brisées sur les trottoirs, lancées depuis les fenêtres ; les rires retentissaient jusque dans la rue. Rœhm a, toute la nuit, participé à l'orgie avec ses Lustknaben, ses garçons de joie. Himmler s'emporte. Plus tard, on l'avertit aussi que Rœhm a entrepris un voyage en Allemagne, visitant les unités S.A. Himmler comprend que l'affrontement ne peut plus tarder longtemps et quelques jours après Rœhm, il va à son tour de ville en ville donner ses ordres aux S.S.
Joseph Goebbels qui a ses informateurs dans tous les clans sent lui aussi venir l'explication finale. Il apprend que Heydrich commence à établir des listes d'ennemis. Himmler et Gœring donnent aussi les noms de ceux qu'il faut inscrire. Himmler parle déjà du successeur de Rœhm, un chef S.A. Viktor Lutze.
Goebbels n'est évidemment pas le seul à être informé des dissensions qui se creusent entre Rœhm et les autres chefs nazis. Dès la fin mars, un correspondant à Berlin de l'Associated Press en fait état, mais le service de presse de la Chancellerie du Reich dément avec indignation de pareilles rumeurs. Démenti vaut preuve, dit-on parfois dans les milieux politiques. Hitler sent si bien qu'il n'a pas convaincu qu'il reçoit personnellement, quelques jours plus tard, le journaliste américain Louis P. Lochner. Avec la brutalité et l'audace des reporters des Etats-Unis, Lochner pose d'entrée la question décisive :
« Monsieur le Chancelier, on prétend que parmi vos proches collaborateurs, il y a des hommes qui cherchent à vous évincer. On dit ainsi que l'un d'entre eux parmi les plus éminents essaie de contrarier les mesures que vous prenez ».
Hitler ne s'emporte pas, au contraire, il sourit : « Il semblait passer en revue, note Lochner, les figures des hommes qui lui étaient les plus proches dans sa lutte et se réjouir de ce qu'il voyait en eux ». Puis, le Chancelier nie qu'il y ait dans son entourage la moindre rivalité à son encontre. « Certes, continue-t-il, je ne me suis pas entouré de nullités, mais de vrais hommes. Les zéros sont ronds : ils s'éloignent en roulant quand ça va mal. Les hommes autour de moi sont des hommes droits et carrés. Chacun d'eux est une personnalité, chacun est rempli d'ambition. S'ils n'étaient pas ambitieux, ils ne seraient pas là où ils sont. J'aime l'ambition ». Le Chancelier marque une pose. « Quand il se forme un tel groupe de personnalités, continue-t-il, des heurts sont inévitables. Mais jamais encore aucun des hommes qui m'entourent n'a tenté de m'imposer sa volonté. Bien au contraire, ils se sont parfaitement pliés à mes désirs ».
Duplicité du Führer ou espoir que tout peut encore, entre les clans qui l'entourent, se résoudre par un compromis ? Goebbels en tout cas tient compte de ces hésitations du Chancelier. Il garde le contact avec Rœhm, sert d'intermédiaire entre le chef d'Etat-major et Hitler, mais en même temps, il est prêt à l'abandonner si un signe décisif montre que Hitler a choisi la liquidation de Rœhm. Aussi Goebbels est-il prudent dans ses contacts avec Rœhm : les deux hommes se rencontrent dans des auberges discrètes, sans témoin. Goebbels sait bien que les listes de Heydrich s'allongent vite : chaque personnalité inscrite a un numéro d'ordre. Il sait aussi que Hess, Martin Bormann et le major Walter Buch, président de la Uschla (tribunal suprême du Parti), continuent de rassembler les témoignages sur la corruption et la débauche des chefs S.A. Sur Heines, qui avait participé à l'assassinat du ministre Rathenau, les fiches s'accumulent
Car cet Obergruppenführer S.A. est lui aussi malgré son allure de fonctionnaire tranquille au visage rond, digne et soigné, un homosexuel notoire. Il est pourtant l'un des plus proches collaborateurs de Rœhm et l'un de ses compagnons d'orgie. En 1926, Hitler l'a fait rayer de la Sturmabteilung mais sur l'insistance de Rœhm il est rentré en grâce et occupe un poste de commandement
Depuis 1934 il est Polizeipräsident (préfet de police) de Breslau. Son Etat-major ressemble à celui de Rœhm : on y rencontre les « passions » du maître. L'homosexuel Engels est Obersturmbannführer et le jeune Schmidt est aide de camp. C'est ce jeune homme de 21 ans qui est la dernière « folie » de Heines. Quoi que fasse ce joli garçon blond, il est couvert par son amant. Quand, un jour d'ivresse, il tue d'un coup de poignard en public, un compagnon de beuverie, le Polizeipräsident interdit au parquet d'intervenir. En fait Schmidt est plus un jeune ambitieux avide qu'un inverti : il cède à Heines par goût de l'argent et sans doute est-ce pour cela que cet adhérent des jeunesses hitlériennes a accepté à 17 ans de se prêter à Heines. Aux côtés de ce couple, l'Obersturmbannführer Engels, dépravé, inverti joue le rôle du mauvais génie de Heines, de l'intrigant aux aguets. Il est de ceux qui utilisent l'organisation S.A. et la Jeunesse hitlérienne pour recruter des compagnons pour les jeux érotiques. D'ailleurs auprès des chefs S.A., Peter Granninger, en qui ils ont pleine confiance est chargé, moyennant un salaire de deux cents marks par mois, de trouver des « amis » et de mettre sur pied les fêtes de la débauche que se donnent Rœhm et ses proches.
Goebbels sait cela, et il sait aussi que les haines se sont accumulées sur la tête de Rœhm et des siens : le major Walter Buch, juge du Parti, son gendre Martin Bormann ont depuis longtemps, des années, un compte à régler avec Rœhm. Dès que Rœhm, rentré de Bolivie, a repris en main les S.A. ils ont essayé d'abattre ce rival. Au nom de la morale. Rœhm ne cache guère ses penchants : « Je ne me compte pas parmi les gens honnêtes, a-t-il dit, et je n'ai pas la prétention d'être des leurs. » En 1932, Buch a monté une opération pour liquider Rœhm et son Etat-major : les Standartenführer comte von Spreti, comte du Moulin Eckart et l'agent de renseignements des S.A. Georg Bell sont désignés aux membres d'un groupe de tueurs à la tête duquel le major Buch place l'ancien Standartenführer Emil Traugott Danzeisen et un certain Karl Horn.
Mais Horn a peur : il dévoile l'affaire aux S.A. Un matin des tueurs essaient en vain de le supprimer. Rœhm, les comtes Spreti et du Moulin Eckart se rendent compte que Horn n'a pas menti. Effrayés, ils saisissent la police de l'affaire et, en octobre 1932, Emil Danzeisen est jugé et condamné à six mois de prison pour tentative d'assassinat. Rœhm pour se protéger a même pris contact avec des adversaires du Parti nazi, des démocrates. Dans le clan des Buch, Bormann, c'est l'indignation. Ils ne lâcheront plus Rœhm : au printemps 1934, ils sont à la tâche, constituant leurs dossiers, dressant leurs listes. Eléments nouveaux et décisifs par rapport à 1932, le Parti nazi est au pouvoir et Himmler, Reichsführer S.S., Heydrich, chef du Gestapa et du Sicherheitsdienst, Gœring, Reichsminister, sont les inspirateurs de la nouvelle opération. En 1932, au contraire, Himmler n'avait pas ouvertement pris parti contre Roehm. Il avait servi de médiateur entre le major Buch et Rœhm, en vain. Peut-être se souvenait-il de ce jour de mai 1922 où à l'Arzberger Keller à Munich, il avait rencontré Rœhm pour la première fois, Rœhm qui l'avait fait adhérer à l'organisation nationaliste Reichskriegsflagge. Depuis ce jour, douze ans ont passé, la situation à changé. Himmler est désormais l'adversaire de Rœhm.
4
VENDREDI 29 JUIN
Godesberg. Hôtel Dreesen. Vers 22 heures 30.
Brusquement le Führer se lève. Goebbels aperçoit alors, arrivant d'un pas rapide un S.S. qu'il connaît bien : c'est le Gruppenführer S.S. Sepp Dietrich, un homme de taille moyenne, à la mâchoire carrée et puissante, aux dents éclatantes qu'il montre souvent dans un sourire large, tranquille, inquiétant même à cause précisément de ces dents bien plantées, blanches, serrées comme celles d'un fauve. Sur son uniforme noir brillent les feuilles de chêne dorées de son grade. Sans doute le Führer a-t-il convoqué Sepp Dietrich à la fin de l'après-midi et le Gruppenführer a rejoint Godesberg aussitôt, en avion d'abord de Berlin à l'aéroport de Bonn-Hangelar, puis par la route. Goebbels se tient derrière le Führer, à quelques pas : la présence de Sepp Dietrich prouve que Hitler avance dans la décision et qu'il se donne les moyens d'agir.
Car Sepp Dietrich est un exécutant fidèle qui vit quotidiennement dans l'entourage de Hitler. Il commande sa garde personnelle : une unité S.S. qui ne compte pas plus de 200 hommes mais tous choisis avec soin. Les hommes retenus sont d'une fidélité absolue au Führer, ils possèdent de solides qualités militaires : il faut être tireur d'élite et aussi athlète accompli pour être recruté après de nombreuses épreuves de sélection. Ainsi si Hitler, est sûr de Sepp Dietrich, celui-ci est sûr de ses hommes. Il le faut car la garde doit veiller sur la vie du Führer qui vit dans la hantise de l'attentat : à chacune de ses apparitions en public, 120 hommes de sa garde sont disposés autour de lui en trois cordons de sécurité. C'est à Nuremberg, alors que brûlent les torches des milliers de nazis présents, en septembre 1933, à l'une des premières grandes cérémonies du régime, le Reichsparteitag, que le Führer donne à sa garde le nom de Leibstandarte S.S. Adolf Hitler. Et le Führer a raison d'avoir une entière confiance dans cette unité et dans son chef : leurs yeux disent assez que ce sont des fanatiques prêts à mourir et à tuer pour leur Führer.
Le Gruppenführer S.S. salue le Chancelier du Reich. Celui-ci donne un ordre bref : « Vous allez prendre l'avion pour Munich. Dès que vous serez sur place, appelez-moi, ici, à Godesberg, par téléphone ».
Sepp Dietrich salue, claque des talons et s'éloigne. Quelques secondes plus tard, on entend le moteur de la voiture, puis son accélération brusque. Sepp Dietrich est un officier efficace, bientôt il sera dans la capitale bavaroise et de là il pourra joindre facilement, si besoin est, la petite ville de Wiessee.
BAD WIESSEE
Elle est là, blottie sur la rive ouest du Tegernsee. Le lac reflète les maisons de bois, les hôtels style 1900. Tout autour ce sont les montagnes rondes couvertes de forêts et de pâturages, c'est l'ondulement vert et apaisant de la Bavière, interrompu comme ici par un lac effilé, bleu profond, qui fait penser à une goutte de pluie démesurée restée là, entre les montagnes, eau miroitante vers laquelle courent les torrents.
Sur la promenade, à Wiessee, les couples tranquilles vont et viennent avant de regagner leurs hôtels et leurs lieux de cure. Car Wiessee a le visage apaisant des stations thermales. Les sources jaillissent dans les fontaines : eaux sulfureuses, iodées, ferrugineuses, qui permettent de tout soigner, des rhumatismes aux affections cardiaques, de la goutte aux maladies nerveuses. Les familles se pressent C'est l'heure du bain ou l'heure du massage.
Il fait frais en ces derniers jours de juin 1934. Les sommets voisins, le Wallberg, le Baumgartenberg et le Risserkogel, qui culmine à 1 827 mètres, ces lieux de promenades, sont souvent enveloppés par les nuages. Il y pleut. Il faut donc rester à Wiessee : on regarde le lac, on le traverse sur les petites embarcations accostant à Egern, à Rottach, à Wiessee. On visite le château de Tegernsee, le parc immense de l'abbaye, puis on monte vers le Grand Parapluie, cette rotonde qui permet d'apercevoir tout le panorama, le lac et la vallée de la Wiessach. Ce vendredi 29 juin, de nombreux Munichois sont arrivés, ils ont fui la capitale bavaroise écrasée sous la chaleur lourde et humide. Certains campent : leurs tentes apparaissent dans les pâturages, peut-être des membres de la Hitler Jugend.
Dans leurs promenades au bord du lac, les touristes, les curistes évitent une pension qui est un peu en retrait, c'est la pension Hanselbauer. Dans la journée elle est gardée militairement Des voitures officielles stationnent souvent dans le parc. On dit que de nombreux chefs S.A. y séjournent et même le chef d'Etat-major de la Sturmabteilung, le ministre du Reich, le capitaine Ernst Rœhm, qui souffre de rhumatismes.
Le Gruppenführer S.S., Sepp Dietrich, chef de la Leibstandarte S.S. Adolf Hitler vient de quitter Godesberg sur l'ordre du Chancelier pour Munich qui est à moins de soixante kilomètres de la tranquille station thermale de Wiessee.
Sur le lac, les barques blanches se balancent régulièrement. Comme chaque nuit, en cette nuit du vendredi 29 juin 1934, une brise fraîche coule depuis les sommets le long de la vallée de la Wiessach et vient soulever de petites vagues sur le Tegernsee ; elle fait bruisser les arbres de la pension Hanselbauer où dort Ernst Rœhm, à moins d'une heure de route de Munich où va arriver le Gruppenführer S.S. Sepp Dietrich.
VIKTOR LUTZE
Après son départ de Godesberg, le calme un instant s'est établi. Les chœurs se sont tus pour reprendre souffle et les fanfares ont cessé de jouer. Adolf Hitler va de long en large, sur la terrasse, nerveux. La venue de Sepp Dietrich l'avait un peu détendu : une action à décider, un ordre à donner. Maintenant c'est à nouveau l'attente, l'hésitation, les pensées qui se bousculent. Tous les témoins se souviennent du visage du Führer, lors de cette nuit, creusé et bouffi en même temps, blanc. Les yeux sont brillants comme ceux que donne une forte fièvre. Souvent Hitler d'un geste machinal et brusque, repousse la mèche de cheveux luisants qui retombe sur le front L'attente dure. Brutalement les fanfares se remettent à jouer, crevant la nuit du bruit de leurs cuivres, et le silence de la vallée rhénane semble amplifier la musique martiale. Il n'y a plus dans la nuit que cette musique prolongée par l'écho.
Tout à coup Brückner se lève : un homme en uniforme brun vient d'apparaître sur la terrasse : c'est Viktor Lutze, Obergruppenführer S.A. du Gau de Hanovre. Hitler s'avance, Lutze salue. Hitler lui prend les mains, le félicite d'avoir répondu à sa convocation, d'avoir réussi si vite à rejoindre Godesberg. Lutze s'incline, claque des talons ; il dit qu'il allait partir pour Wiessee où Rœhm a convoqué les chefs S.A. et où, croyait-il, le Führer devait se rendre le lendemain 30 juin, pour une explication entre camarades. Hitler balaie d'un geste de la main ces projets et demande à Viktor Lutze s'il peut compter sur sa fidélité absolue dans le cas où des événements graves viendraient à se produire. Lutze répond qu'il a prêté serment de fidélité au Führer, que tout ce qu'il possède et sa vie sont entre les mains du Führer. Il est aux ordres du Führer. « Mein Führer », conclut-il.
Hitler sourit se détend : il a su choisir l'homme qu'il fallait. Himmler lui avait aussi parlé de cet Obergruppenführer S.A. mais le Chancelier s'est en fin de compte déterminé seul, lançant ce nom aujourd'hui, comme s'il lui venait brusquement à l'esprit, alors que voilà des semaines qu'il sait à quoi s'en tenir sur la fidélité de Viktor Lutze.
C'était un jour du mois de mars 1934, le tout début mars. Hitler passait quelques heures à Berchtesgaden. Vêtu à la tyrolienne malgré le froid vif de l'air, il restait au soleil de midi de longs moments sur la terrasse face au panorama des sommets enneigés, dans le silence immobile de l'altitude, quand gestes et paroles prennent une sorte de pesanteur et de grandeur symboliques. Hitler aimait ce paysage. Il y recevait ses intimes, et ce jour-là, précisément l'Obergruppenführer S.A. Viktor Lutze avait demandé à le voir. Il était là, assis sur la terrasse du chalet buvant du thé, cependant que le chien loup du Führer dormait la tête posée sur ses pattes près de son maître. Et Lutze parlait dans l'éclat de ce printemps alpin alors que les champs de neige miroitaient comme des plaques de métal poli, Lutze avec sa timidité de bon élève fidèle, parlait d'Ernst Rœhm.
Certains S.A. sont mécontents, a-t-il dit et le chef d'Etat-major Rœhm a pris le 28 février une attitude intolérable. Il a ouvertement critiqué le Führer : « Ce que ce caporal ridicule a raconté, s'est écrié Rœhm, ne nous concerne pas, si nous ne pouvons pas faire l'affaire avec Hitler, nous la ferons sans lui ». Lutze a répété à voix basse une dernière phrase de Rœhm : « Hitler est un traître, il faut qu'on lui fasse prendre des vacances ». Puis Viktor Lutze s'est tu. Le Führer n'a pas laissé paraître ses sentiments. Il a simplement demandé des précisions, peut-être Hess, son second, auquel Lutze s'est préalablement confié, l'a-t-il déjà averti ? Hitler murmure : « Il faut laisser mûrir l'affaire ».
Lutze est reparti inquiet et décu : ne s'est-il pas découvert inutilement ? L'Obergruppenführer a alors décidé de rencontrer un homme dont l'influence croît rapidement, le général Walther von Reichenau, pour lui faire part des propos de Rœhm. Dans cette affaire, la protection d'un officier de la Reichswehr peut être indispensable. Walther von Reichenau a grande allure : monocle, maintien raide de l'officier prussien, corps athlétique. C'est un jeune général d'artillerie au regard perçant qui intimide. Et pourtant ce membre de l'Offizierskorps ne ressemble pas tout à fait aux autres officiers de la grande armée allemande, pétris de traditions, dressés dans les écoles de cadets à la discipline inconditionnelle et à l'autorité hautaine.
Reichenau refuse la morgue, la distance : il connaît les soldats qu'il a sous ses ordres. Il participe avec eux à des courses à pied, à des matchs ; il leur parle comme à des hommes, on le dit partisan d'une armée populaire.
Les chefs nazis ont vite distingué ce général ambitieux, membre du Comité allemand des jeux Olympiques, qui est en même temps homme de science et stratège hors de pair. II a été l'un des plus brillants élèves du maître Max Hoffmann dont on murmure que, pendant la Grande Guerre, il a monté les opérations spectaculaires de Hindenburg et Ludendorff. Walther von Reichenau semble ainsi incarner la possibilité d'une liaison vivante entre l'armée traditionnelle et le national-socialisme.
LA REICHSWEHR
Or, c'est là le grand problème de Hitler et des chefs nazis, car à côté d'eux, dans l'Allemagne de 1933, il n'y a plus qu'une seule force : l'armée. D'elle sont sortis les hommes des corps francs et aussi les premiers nazis, mais elle est restée pour la plupart des officiers le seul refuge : armée qui est comme une Eglise, où l'on entre comme en religion. Plus de 20 % des officiers sont des nobles et puisqu'il n'y a plus d'empereur depuis 1918, ils sont devenus les dépositaires de la tradition et de l'Etat allemand. Ils attendent. Ils encadrent la petite armée de 100 000 hommes que le honteux diktat, le traité de Versailles, leur a imposée. Ils ont déjà écrasé les spartakistes, les conseils de soldats qui, en 1918-1920, voulaient étendre, comme dit le maréchal Hindenburg, « le bolchevisme terroriste à l'Allemagne ». Ils inventent des méthodes qui permettent de tourner les clauses du traité de Versailles : ils essaient leurs nouvelles armes dans la Russie bolchevique, loin de tout contrôle. Ils ont l'obsession de la revanche, ils désirent laver l'affront de la défaite, cette défaite dont ils veulent croire qu'elle a été provoquée par « un coup de poignard dans le dos ». Ils craignent une invasion française qui briserait définitivement l'Allemagne. Aussi ont-ils lutté contre les Français qui occupent la Ruhr en 1923. Des membres de l'Offizierskorps ont perpétré des attentats, des hommes sortis de l'armée ont assassiné Rathenau. Tendus, maigres, raides, sévères, les officiers de la Reichswehr se veulent l'âme austère et infaillible de l'Allemagne dont l'armée est le cœur vivant sur lequel ils veillent.
Autour de l'armée il y a les associations d'anciens combattants comme celle du Stahlhelm (casque d'acier) : chaque année le Reichsfrontsoldatentag (journée des soldats du front) rassemble des dizaines de milliers d'hommes autour du Kronprinz ; on porte le casque, l'uniforme feldgrau, on défile avec une canne lourde qui tient lieu de fusil, cependant que retentissent les fifres et que passent les survivants des grandes guerres, droits malgré les ans : guerres de 1866, 1870, 1914. C'est le général Hans von Seeckt qui définit le mieux l'état d'esprit de l'Offizierskorps et de l'armée quand il dit au chancelier Stresemann, le 7 septembre 1923 : « Monsieur le Chancelier, la Reichswehr marchera avec vous si vous suivez la voie allemande. » Mais ce « deutscher Weg », qui en décide sinon les chefs de l'armée ? A partir du 26 avril 1925, tout est simplifié d'ailleurs : le résultat du deuxième tour des élections présidentielles est connu ce jour-là et c'est l'ancien chef du Grand Etat-major qui est élu Reichsprüsident.
Imposant comme une statue de bronze, Paul von Beneckendorff und von Hindenburg est lui-même fils d'un officier prussien. Cet ancien élève de la Kriegsakademie, combattant des guerres de 1866 et 1870, déjà atteint par la limite d'âge en 1911 est ainsi devenu le président de la République : il symbolise la vieille et immortelle Prusse, les Junker indestructibles et quand, serrant son bâton de Generalfeldmarschall, drapé dans sa capote militaire grise à parements, coiffé du casque à pointe dorée, il s'avance, c'est toute la tradition germanique qui semble avancer avec lui d'un pas solennel et régulier.
Hitler, en habit et haut-de-forme à la main, s'incline timidement devant lui, jeune homme d'un autre temps face à un puissant symbole. Car l'armée n'a pas que des souvenirs : elle a les hommes, les armes, et aussi le pouvoir. Hindenburg est président. Le ministère de la Guerre — le Reichswehrministerium — est une place forte, la plus puissante du gouvernement ; l'immeuble massif de la Bendlerstrasse aux hautes salles à colonnes, aux murs revêtus de marbres, gardé par des soldats qui marchent au pas de parade, a fait figure, avant que Hitler ne devienne chancelier, de véritable centre du pouvoir. Là, les généraux Seeckt, Heye, Grœner, tous anciens du Grand Etat-major, ont défini la voie allemande, le deutscher Weg, faisant et défaisant les ministères. Leurs collaborateurs, ces officiers des bureaux de la Bendlerstrasse que l'on voit arriver ponctuels chaque matin sont d'ailleurs pour la plupart des esprits d'élite. En eux survit le Grand Etat-major impérial [3] qui s'il n'existe plus officiellement est remplacé efficacement par un Bureau des Troupes.
Les généraux qui sont à la tête de ce Truppenamt ou qui sont chef de la Direction de l'armée (Heeresleitung) ou chef du Ministeramt (chef de cabinet du ministre de la Guerre) sont des puissances respectées. Mais la tourmente nazie est venue battre les murs des casernes et de la Bendlerstrasse et très vite les officiers ont dû définir une attitude face au caporal autrichien. L'ignorer ne sert à rien car souvent dans les unités, les jeunes officiers sont gagnés par les idées nazies ; leurs généraux eux-mêmes, un temps réticents, commencent à regarder les groupements paramilitaires nazis avec intérêt : peut-être y a-t-il là une réserve d'hommes ? Peut-être le nazisme est-il un moyen de souder indissolublement le peuple à son armée, gardienne de la tradition germanique ?
Beaucoup parmi les officiers ont séjourné en U.R.S.S. où ils ont exercé les fonctions de conseillers de l'armée rouge en échange de camps d'entraînement pour les armes modernes. Le nazisme ne pourrait-il jouer le rôle du bolchevisme qui a donné à l'armée rouge des moyens considérables et un prestige populaire dont rêvent les plus jeunes des officiers de la Reichswehr ?
KURT VON SCHLEICHER ET WERNER VON BLOMBERG
Ces réflexions, le dernier chef du Reichswherministerium Kurt von Schleicher, un général habile, intelligent, un ancien de l'Etat-major, les partage. Né en 1882, il a des ambitions personnelles et en même temps il s'imagine être un Machiavel en politique. Il veut ainsi s'appuyer sur les nazis, les utiliser, jouer au plus malin avec Adolf Hitler qu'il rencontre en octobre 1931 et qu'il espère « apprivoiser » comme il espère faire éclater le parti nazi, gouverner avec Gregor Strasser contre Hitler si besoin est.
Pour atteindre ses fins, Schleicher, depuis la Bendlerstrasse, continue comme ces prédécesseurs à faire, tomber les derniers chanceliers du Reich. Une visite à Hindenburg, un conseil, une pression et voici Bruning renversé. Schleicher pousse alors en avant un ancien officier, fidèle lui aussi de Hindenburg, un homme de la Reichswehr, Franz von Papen, puis on fait tomber Papen et voici, le 2 décembre 1932, Kurt von Schleicher chancelier, dernier chancelier du Reich.
Mais pour peu de temps : Hitler retourne la situation, utilise les divisions qui opposent Papen et Schleicher à Hindenburg. Papen fait le siège du président et c'est Hitler qui devient chancelier avec Papen comme vice-chancelier. Schleicher a perdu, mais la Reichswehr est-elle perdante ?
Hindenburg, est toujours Reichspräsident. Le ministre de la Guerre est toujours un général, Werner von Blomberg. Cet officier souriant, blond, grand, portant monocle, est lui aussi un officier traditionnel à l'allure aristocratique. Il a fait le voyage de Russie. « Il s'en est fallu de peu, confie-t-il un jour à des amis, que je ne rentre de Russie complètement bolcheviste. » Pour Werner von Blomberg, c'était une façon de dire et de penser qu'il ne pouvait plus supporter un régime parlementaire comme celui de Weimar, un régime de désordre que la présidence de Hindenburg n'arrivait pas à sauver. Il fallait pour l'Allemagne un pouvoir fort, populaire et national. Blomberg est séduit par Hitler : il jouit aussi de l'estime de Hindenburg. Il est le parfait ministre de la Guerre du cabinet Hitler.
Son premier soin est de chasser de la Bendlerstrasse les hommes de Schleicher. Le général von Bredow, chef du Ministeramt, est remplacé par Walther von Reichenau, lui aussi gagné à la conviction qu'il faut, à l'aide de Hitler, permettre à l'armée de redevenir une immense force, le cadre unique, l'armature de la société allemande.
Pourtant, il y a des résistances : tous les officiers ne sont pas des partisans de la ligne Blomberg-Reichenau. Il y a ceux qui pensent que Blomberg est un Gummilöwe, un lion de caoutchouc, ceux qui craignent la démagogie de ce caporal Hitler, ceux surtout qui redoutent de voir la Reichswehr perdre ses prérogatives au bénéfice de l'armée nazie du capitaine Rœhm. Car si l'armée veut utiliser Hitler, elle ne veut pas disparaître. Et les officiers d'Etat-major chargés des plus hautes responsabilités, comme Blomberg ou Reichenau, les officiers en fonction dans les unités, ont une répulsion instinctive pour ces S.A. -Fiihrer qui se disent officiers et sont d'anciens portiers d'hôtels, noceurs affichés, fauteurs de scandales.
Jamais l'Offizierskorps n'acceptera de baisser la tête devant les S.A.
Aussi quand, en janvier 1934, von Hammerstein, le dernier homme de Schleicher, démissionne de son poste de chef de la Heeresleitung, Hindenburg cède aux officiers qui lui conseillent de refuser la candidature de Reichenau soutenue par Blomberg et Hitler. C'est un officier plus traditionnel, moins marqué par ses sympathies à l'égard des nazis, le général von Fritsch qui est nommé. Hindenburg et la Reichswebr défendent leurs prérogatives et Hitler sait bien quelles sont les forces de ces hommes qui, aux yeux de l'Allemagne, incarnent la tradition nationale.
Il lui faut donc tenir compte de leurs sentiments, biaiser, et pourtant il y a les S.A., plusieurs millions, et ce capitaine Rœhm qui tempête, qui a ses idées sur l'armée, sur la défense nationale.
LE FUHRER ET L'ARMEE
En 1933, peu après la prise du pouvoir par les nazis, Rœhm rencontre Hermann Rauschning. Avec sa tête ronde et chauve, ses yeux rieurs, ses silences attentifs, le président du Sénat de Dantzig attire les confidences. Rœhm parle. Les chefs S.A. sont mécontents : eux aussi (moi aussi, ajoute-t-il) sont des officiers, mais pas des officiers de bureau. « Nous avons combattu dans les Freikorps, dans la Ruhr ». Par la bouche de Rœhm s'exprime la hargne des officiers subalternes ou des sous-officiers que révolte la hiérarchie stricte de l'armée régulière. Les nazis ont pris le pouvoir ? Qu'attend-on pour récompenser les S.A. en leur donnant grades, titres, émoluments ; pourquoi tant de précautions avec les officiers de la Reichswehr qui n'ont pas bougé quand il fallait se battre dans la rue et dans les salles enfumées des meetings ?
Rœhm continue, s'enflammant de plus en plus : « La base de la nouvelle armée doit être révolutionnaire. On ne peut la gonfler par la suite. On n'a qu'une seule fois l'occasion de faire quelque chose de grand qui nous permettra d'ébranler le monde sur ses bases. Mais Hitler m'éconduit avec de belles paroles... Il veut hériter d'une armée toute faite, prête à marcher ».
Un temps d'arrêt : sur le visage ingrat de Rœhm se lit la déception, le mépris. « Il va laisser, dit-il, les « experts » en faire ce qu'ils voudront ». Il frappe du poing sur la table et c'est l'officier de tranchée, l'homme du putsch de Munich qui a eu, en 1923, à se heurter au général von Lossow, à von Kahr, qui se souvient. Mais Hitler a oublié. « Hitler prétend, ajoute Rœhm, que plus tard il fera de tous les soldats des nationaux- socialistes. Mais il commence par les abandonner aux généraux prussiens. Je ne vois pas où il trouvera un esprit révolutionnaire chez ces gens-là. Ils sont aussi lourdauds qu'autrefois et ils vont certainement perdre la prochaine guerre ».
En fait, le Führer voit clairement la situation. Il y a les généraux, puissants, respectés, il y a les S.A. souvent craints et méprisés, il y a Hindenburg toujours Reichspräsident, il y a Papen lié à la Reichswehr, lié à Hindenburg et qui est vice- chancelier, il y a des monarchistes, des conservateurs et lui Hitler qui n'est que chancelier. Il vient à peine de prendre le pouvoir. Il ne faut pas le perdre.
Le matin du 31 janvier 1933, moins de vingt-quatre heures après sa nomination au poste de chancelier, Hitler s'est rendu à la caserne de la garnison de Berlin. Il a harangué les troupes, rassemblées dans la cour, immobiles dans le matin glacial, il leur a parlé de l'avenir de l'Allemagne nationale-socialiste. Immédiatement les officiers se sont dressés contre ce procédé qui brise la hiérarchie.
Pour effacer l'incident et aussi pour faciliter le contact, le 2 février, von Hammerstein invite le nouveau Chancelier à dîner. Soirée austère : les généraux, les amiraux sont en grand uniforme, pourtant Hitler n'est nullement intimidé, il discourt deux heures et avec ce sens politique qui lui a permis de réussir il donne des gages : l'armée et la marine restent souveraines, lui ne s'en occupera pas. Il leur promet simplement de tout faire pour le réarmement ; il va soustraire les militaires aux tribunaux civils. Hitler flatte, respectueux des prérogatives. Ce soir-là, il conquiert la plupart des officiers présents. L'amiral Raeder qui assiste à la réunion note : « Aucun chancelier n'a jamais parlé avec une telle fermeté en faveur de la défense du Reich ».
Toujours prudent le nouveau Chancelier multiplie les actes de séduction : avec ceux qui sont puissants Hitler sait biaiser le temps qu'il faut Le 21 mars 1933, Goebbels et Hitler organisent la cérémonie d'ouverture du nouveau Reichstag dans l'église de la garnison de Potsdam : tous les maréchaux sont là, Von Mackensen et le Kronprinz en uniforme des hussards de la mort Hindenburg qui se souvient être venu dans cette église en pèlerinage en 1886 après qu'il eut participé à la guerre austro-prussienne. Ici les Hohenzollern s'agenouillèrent pour prier, ici venait s'asseoir Guillaume II. Hindenburg salue le siège vide de l'Empereur, puis Hitler tourné vers le vieux maréchal déclare : « Monsieur le Maréchal, l'union a été célébrée entre les symboles de l'ancienne grandeur et de la force nouvelle. Nous vous rendons hommage. Une Providence protectrice vous place au-dessus des forces neuves de notre nation. »
En Hindenburg c'est l'armée qui reçoit l'hommage de Hitler. Et le Führer continue d'ajouter les signes de bienveillance aux marques de respect : il a besoin de l'armée. Ses officiers sont les seuls professionnels de la chose militaire et si la guerre de revanche vient, il faut les avoir avec soi : les S.A. compteront peu devant des armées de métier. Pour conserver le pouvoir il faut aussi compter avec les militaires : ils ont les armes, l'appui des cercles conservateurs, le respect de la plus grande partie de la nation ; et pour élargir son pouvoir Hitler a encore et toujours besoin des officiers. Si Hindenburg meurt, il faudra bien le remplacer et il faudra alors l'accord de l'armée.
Hitler dès son accession aux fonctions de chancelier, alors même que, le regard à terre, il serre respectueusement la main du Maréchal, songe à cette mort qui peut lui permettre d'augmenter considérablement ses prérogatives. Mais pour cela il faut l'accord du général Blomberg et du général Reichenau, l'accord du général von Fritsch, l'accord du général Ludwig Beck, nouveau chef du Truppenamt : l'accord de l'ensemble de cette caste militaire qui constitue l'Offizierskorps. Alors le Führer ménage l'armée.
Le 1er juillet, il parle aux chefs S.A. réunis à Bad Reichenall. Les S.A. écoutent, acclament leur Führer qui dit, en leur nom, ce qu'ils ne pensent pas. « Les soldats politiques de la révolution, s'écrie le Führer, ne désirent nullement prendre la place de notre armée ou entrer en compétition avec elle. » Les officiers de la Reichswehr enregistrent avec satisfaction. Mieux : Hitler célèbre les vertus de l'armée le jour du Stahlhelm. Or l'Association des casques d'acier apparaît le plus souvent aux chefs S.A. comme un repaire de conservateurs, d'aristocrates raidis par leurs principes vieillots et leurs privilèges. Mais Hitler reconnaît, lui, qu'il a contracté une dette envers le Stahlhelm, envers l'armée allemande. « Nous pouvons assurer l'armée que nous n'oublierons jamais cela, dit-il, que nous voyons en elle l'héritière des traditions de la glorieuse armée impériale allemande et que nous soutiendrons cette armée de tout notre cœur et de toutes nos forces. »
L'armée est séduite. Et Hitler ne donne pas que des mots. Des promotions accélérées sont accordées aux jeunes officiers. Le jeune colonel von Witzleben est promu Generalmajor et prend la tête de la 3eme division d'infanterie de Berlin. Pourtant on le dit presque hostile aux nazis. L'attaché militaire français, le général Renondeau, s'inquiète : « Le Parti, écrit-il à Paris au début de 1934, gagne donc la Reichswehr. Il en conquiert le sommet et la base. L'armée perd sa neutralité ». En septembre 1933 le général Blomberg a d'ailleurs fait un geste qui confirme cette analyse : officiers et soldats doivent désormais en certaines circonstances faire le salut hitlérien.
REICHSWEHR CONTRE S.A. LE ROCHER GRIS ET LA MAREE BRUNE
Tout irait bien s'il n'y avait les S.A., sans lesquels pourtant, Hitler ne serait probablement pas parvenu au pouvoir. Eux, ils sont de plus en plus agressifs et ils s'en prennent à l'armée. A tous les niveaux entre les deux groupes c'est l'hostilité ou le mépris.
Quand le général Fritsch invite Rœhm à assister aux manœuvres de l'armée à Bad Liebenstein, en Thuringe, Rœhm, grand seigneur, délègue son aide de camp, un homosexuel notoire. Les officiers sont outrés. Rœhm n'apparaîtra que le dernier jour pour le dîner officiel. Partout les incidents se multiplient.
Ratzebourg est une petite ville tranquille de la Prusse-Orientale. Elle se serre autour d'un lac d'un bleu presque noir. Le dimanche est un jour paisible où les familles se rendent à la cathédrale du XIIeme siècle qui est la fierté de la cité. Mais le deuxième dimanche de janvier, une colonne de Chemises brunes défile dans les rues, arrogants, provocants. Une section de S.A. avance sur le trottoir faisant sauter les chapeaux des passants qui tardent à s'immobiliser ou à saluer. Souvent les coups pleuvent Deux soldats sont là dans la foule, ils paraissent goguenards. Immédiatement les S.A. se précipitent sur eux. L'un des soldats tire sa baïonnette et riposte, l'autre subit et se plaint à son commandant. Aussitôt le commandant de la garnison réagit ; le soldat qui ne s'est pas défendu est condamné à plusieurs jours d'arrêts ; l'autre est félicité et les S.A. se voient interdire l'utilisation du terrain d'exercice de la Reichswehr tant qu'ils n'auront pas fait d'excuses.
Au camp de Jüteborg où manœuvre l'artillerie allemande il ne se passe pas de jours que des heurts ne se produisent entre S.A. et membres de la Reichswehr : on échange des insultes, des coups. Un S.A. est même arrêté par l'armée et condamné par ses tribunaux. Les chefs S.A. sont hors d'eux : ce pouvoir nazi, c'est le leur et voilà qu'il leur échappe. Pourtant ils ont des hommes, des armes ; les adversaires de gauche sont dans les camps de concentration, Hitler est au pouvoir, Rœhm ministre. Alors ? Il leur faut digérer l'armée allemande, la fondre dans la S.A., faire de la Sturmabteilung une armée révolutionnaire où ils auront les bonnes places, les hauts grades ; fini le temps des officiers de cavalerie, de cette noblesse de Junker, propriétaires terriens et soldats de père en fils qui ne veulent les admettre dans la Reichswehr qu'aux grades inférieurs, après leur avoir fait subir des examens. Leur compétence, ils l'ont prouvée dans les rues avant janvier 1933.
« Les S.A., s'écrie Rœhm devant des auditoires exaltés, sont des soldats qui ont continué à faire leur devoir alors que beaucoup d'autres se reposaient sur les lauriers de la Grande Guerre. »
Rœhm ne se contente pas de crier : il déjoue le plan du général Reichenau qui, en proposant la fusion du Stahlhelm et de la S.A. espérait, en mai 1933, confier tous les postes de commandement à des officiers de la Reichswehr. Rœhm, fort de l'organisation de la S.A. qui est une véritable armée du Parti avec ses 5 Obergruppen (armées) et ses 18 Gruppen (corps d'armée), contre-attaque. « Il n'existe aucun lien d'aucune sorte entre la Reichswehr et les S.A. », proclame-t-il. Et quelques jours plus tard, dans un discours qui secoue l'immeuble de la Bendlerstrasse, il réclame pour les membres des S.A. « une situation priviligiée dans le IIIeme Reich, même à l'égard de la Reichswehr, parce que c'est aux S.A. seuls qu'est due la victoire nationale-socialiste ».
La guerre S.A.-Reichswehr est ouverte. La Bendlerstrasse est en effervescence. « Des mesures imprévues sont prises, confie un officier d'Etat-major, des projets contradictoires se succèdent et il en résulte un certain désarroi dans l'esprit des officiers ». Dans la Reichswehr les bruits les plus contradictoires circulent, on se communique d'unité à unité ce que l'on croit être le plan de Rœhm : constituer une garde prétorienne d'élite recrutée sur la base de l'attachement au Parti et à côté de cette garde une milice populaire dont les S.A. donnent l'exemple. Les officiers qui ont tant peiné dans les écoles militaires sont scandalisés par les demandes d'équivalence de grades que revendiquent les officiers S.A. On ricane dans les Etats-majors, on pense à Heines, dont on dit à la Bendlerstrasse que son réseau de rabatteurs, qui cherchent des jeunes garçons pour emplir son harem, s'étend à toute l'Allemagne. Un officier revenant de Breslau où Heines règne toujours comme préfet de police, répète outré ce qu'il a vu. Au Savoy, l'un des hôtels les plus chics de Breslau, les chefs S.A. s'étaient réunis : il y avait là le chef d'Etat-major du groupe S.A. Silésie, Graf Puckler, qui tentait vainement de calmer les S.A. lesquels tiraient des coups de pistolet en l'air, hurlaient et finalement bombardaient les chauffeurs de leurs voitures officielles à coups de bouteilles de Champagne pleines. Et de tels hommes allaient être — si Rœhm triomphait — intégrés à la Reichswehr avec souvent le grade de général !
Un autre officier précise que les S.A.-Führer interdisent à leurs hommes de prendre part au cours de formation organisés par le Grenzschutz (Défense des frontières). Les plans prévus en cas de mobilisation ne pourraient donc pas être exécutés. Heines en particulier avait promis qu'il porterait remède à cette situation, mais l'Oberst von Rabenau avait dû plusieurs fois retourner à Breslau et toujours en vain : Heines jurait que tout allait s'arranger mais rien ne changeait. Les officiers pestent contre ces « amateurs », ces irresponsables, qui compromettent la défense du Reich. Le général von Brauchitsch résume le sentiment de beaucoup de ses camarades, ceux dont les mobiles sont les plus sincères quand il confie à ses proches : « Le réarmement est une entreprise trop grave et trop officielle pour qu'on puisse y faire participer une bande d'escrocs, d'ivrognes et d'homosexuels. »
La tension monte. Rœhm multiplie les interventions. Les généraux se réunissent. Hitler, entre les millions d'hommes de la S.A. et la puissante Reichswehr qui détient la clé de la succession de Hindenburg, Hitler hésite, favorable à un compromis. Mais chaque jour sa marge de manœuvre se réduit.
« Le rocher gris sera submergé par la marée brune » (la Reichswehr par les S.A.), chantonnent les S.A. devant les soldats. Ils giflent un officier qui ne s'est pas incliné devant le drapeau S.A. Le S.A. commissaire aux Sports du Reich, entrant dans le bar d'une garnison et n'étant pas salué par un aspirant, le maltraite et crie : « Tu ne peux pas te lever, petit morveux, quand le commissaire aux Sports du Reich arrive ? »
Réunis à la Bendlerstrasse, stricts, immobiles, les généraux écoutent le récit de ces incidents, au cours d'une de ces conférences qui régulièrement se tiennent sous l'autorité du général ministre de la Guerre. Les conclusions tombent, sèches, les officiers qui ne se sont pas défendus doivent être renvoyés de l'armée. L'aspirant aurait dû gifler le commissaire aux Sports du Reich. Les instructions partent de la Bendlerstrasse vers les commandants de garnison : « Il est nécessaire de renforcer chez les officiers et tous les membres de l'armée, concluent-elles, le sentiment de leur propre valeur ».
Mais Rœhm ne plie pas. Au contraire. Il fonce vers son but : une nouvelle armée. Il sait qu'il tient une force ; il veut contraindre Hitler à prendre parti pour lui.
Le 2 février tous les chefs de corps de la Reichswehr sont réunis à Bendlerstrasse. Objet de la réunion : rapports S.A.-Reichswehr. Ambiance glaciale. Blomberg annonce que Rœhm a remis un mémorandum : il propose, ni plus ni moins, la création d'un grand ministère qui regrouperait toutes les formations armées du Parti et de l'Etat. Ce serait la fin de la Bendlerstrasse, la fin de l'organisation patiemment mise au point par von Seekt, la fin du Truppenamt, la fin de la Reichswehr. Le refus se lit sur tous les visages. Le général Liebmann, qui note le texte des déclarations, relève que von Fritsch déclare « qu'il va s'opposer de toutes ses forces et de toute sa personne aux exigences présentées par les S.A. ». Fritsch aura derrière lui toute l'armée : pas un seul officier n'admettrait Rœhm comme successeur des généraux de la Bendlerstrasse, héritiers du Grand Etat-major. Et il ne fait aucun doute que le'maréchal-président Hindenburg ne pourra même pas envisager la chose. Si Rœhm veut l'emporter, il lui faudra bien faire une seconde révolution. Avec, sans, ou contre le Führer.
Ce 2 février, après un court exposé de la question, von Blomberg quitte la salle, puis Fritsch reprend la parole pour traiter en technicien brillant les questions d'instruction militaire. Tout à coup, une ordonnance pénètre dans la salle, se penche, cassée en deux, vers le général von Reichenau, Fritsch poursuit son exposé. Reichenau se lève. Il s'excuse, il a un message urgent à lire. Dans la vaste salle, austère et solennelle comme une église luthérienne, c'est le silence. Von Reichenau lit d'une voix nette : « Je reconnais la Reichswehr uniquement comme école de la nation. La conduite des opérations et par conséquent également la mobilisation sont à l'avenir l'affaire de la Sturmabteilung. Heil Hitler. Rœhm. »
Le télégramme est une véritable provocation. Tous les chefs de la Reichswehr vont faire bloc : Blomberg, Fritsch, Reichenau, les commandants des sept Wehrkreise (régions militaires) manifestent leur refus. Von Blomberg demande à être reçu par Hitler, il aurait présenté sa démission. Ce qu'elle signifierait, Hitler le sait : l'hostilité de la Reichswehr, l'impossibilité de succéder à Hindenburg sans affrontement avec tous ceux (conservateurs, chrétiens, opposants, indifférents) qui ne sont pas nazis. Et ils sont nombreux. Le Führer ne peut que refuser la démission de von Blomberg, il doit donner satisfaction à l'armée.
Mais... il y a les S.A. Et Rœhm qui ne cède pas. Il vient même de demander qu'on incorpore dans la Reichswehr 2 000 officiers et 20 000 sous-officiers S.A. Le Führer se résout à convoquer son vieux camarade. Le chef d'Etat-major se rend à la Chancellerie. C'est la fin février : le temps sur Berlin est implacablement froid et clair. Rœhm arrive d'un pas décidé. Il connaît bien Hitler : il sait que le Fuhrer déteste les oppositions et qu'il lui arrive de céder si elles sont tenaces. Rœhm est tenace. Dans l'antichambre, il remarque le comte von Tschirchsky, l'un des collaborateurs directs de Franz von Papen, cet homme de la Reichswehr et de Hindenburg que le Führer a accepté comme vice-chancelier. Maintenant ce renard de Papen espère exploiter, au profit des conservateurs, au profit de son clan militaire, l'opposition des S.A. à la Reichswehr. Dans certains milieux, on murmure qu'un plan existe pour pousser la S.A. à une action : Hindenburg inspiré par Papen décréterait l'état d'exception au bénéfice de la Reichswehr. Pour Hitler, on verrait bien. Rœhm soupçonne cela. Hitler aussi, et le Chancelier sait bien que sa force lui vient d'être ainsi entre deux forces : S.A. et Reichswehr.
Tschirchsky dans l'antichambre patiente depuis un long moment II entend des éclats de voix de plus en plus violents. Brückner à son poste ne bouge pas. Les voix montent encore. Tschirchsky reconnaît celle de Hitler, rauque, violente. Ironique, Tschirchsky se tourne vers Brückner. « Mon Dieu, dit-il, est-ce qu'ils sont en train de s'égorger là-dedans ? » Puis il distingue la voix de Rœhm, qui parle des 2 000 officiers à intégrer dans la Reichswehr, et celle, plus forte, de Hitler : « Le Reichspräsident ne le fera jamais. Je vais m'exposer à perdre la confiance du Reichspräsident. »
Bientôt les deux hommes sortent du bureau du Chancelier. Tschirchsky s'est dressé, mais Hitler, hagard, ne le reconnaît pas. Il passe, suivant Rœhm, puis il va s'enfermer dans son bureau.
Le lendemain c'est le Volkstrauertag (journée de deuil national) ; le gouvernement national-socialiste est reçu par le président Hindenburg. Après les échanges de compliments réciproques, Hitler présente au Maréchal les propositions de Rœhm. D'un mot Hindenburg les rejette. Hitler se tait. Il accepte la gifle dont Rœhm est responsable. Il savait. Comme il sait que l'entourage du vice-chancelier Papen sonde les milieux militaires : les généraux Beck, Rundstedt, Witzleben seraient-ils prêts à intervenir pour balayer les S.A. et la racaille nazie ? Mais tous ces officiers hésitent refusent parfois même d'écouter : ne sont-ce pas des leurs qui sont ministres de la Guerre, et qui occupent les fonctions clés de la Bendlerstrasse ? D'ailleurs ils n'obéissent qu'à Hindenburg et Hindenburg est toujours là, recevant l'hommage du Chancelier national- socialiste et refusant les propositions de Rœhm. Naturellement si ces dernières étaient acceptées, si la S.A. s'insurgeait... Mais Hitler va empêcher cela.
UN NOUVEAU TRAITE DE VERSAILLES
Quelques jours plus tard, Hitler a tranché, en faveur de la Reichswehr, mais il veut aussi la réconciliation, il a besoin de l'armée et des S.A.
Le 28 février, il convoque une grande réunion à la Bendlerstrasse : c'est la parade des uniformes, tous les dignitaires des S.A. et des S.S., Rœhm lui-même et les généraux de la Reichswehr sont présents.
Hitler se lève, il regarde droit devant lui ; il est le point d'appui des hommes qui sont ici, des hommes des deux camps. Il veut convaincre. Il parle lentement, détachant les expressions les unes des autres, il force l'attention.
« Le peuple allemand va au-devant d'une misère effroyable. » Tels sont ses premiers mots et bien que le silence soit total dans la salle, on sent la surprise qui éclate. Le propos tranche sur les avenirs radieux que le Führer promet aux foules dans les grands meetings enthousiastes. « Le nazisme a éliminé le chômage, poursuit Hitler, mais lorsque les commandes de l'Etat seront satisfaites, dans huit ans environ, surviendra un recul économique. Un seul remède : créer un nouvel espace vital pour l'excédent démographique. » Tous les officiers écoutent, l'étonnement se lit dans les regards de ces hommes qu'une longue discipline a entraînés à une impassibilité de façade. « Les puissances occidentales ne nous accorderont jamais cet espace vital, continue Hitler, c'est pourquoi des coups rapides mais décisifs pourront devenir nécessaires d'abord à l'ouest puis à l'est »
28 février 1934 : déjà Hitler fait surgir de l'avenir l'ombre de la guerre. Pourtant aucun des officiers présents ne semble mesurer l'importance de ces projets. Personne n'en parlera. Les propos de Hitler resteront ce jour-là, secrets. Certains des présents imaginent même que le Führer brosse un tableau apocalyptique des années qui viennent pour mieux convaincre les S.A. de céder la place à l'armée. Ce n'est que plus tard, beaucoup plus tard, en 1945, qu'un officier se souviendra. Il parle de ce jour de février 1934 avec von Blomberg. Tous deux auront vieilli, pris par l'âge et la tourmente ; ils évoqueront ce jour de 1934 alors qu'autour d'eux passent les sentinelles américaines qui gardent le camp de prisonniers où ils se trouvent C'est bien ce 28 février 1934 devant les S.A. et la Reichswehr que Hitler évoquait pour la première fois la nécessité de la guerre éclair pour conquérir l'espace. Mais qui aurait pu croire en l'obstination de ce visionnaire qui venait à peine de prendre le pouvoir ? En février 1934 ce que les auditeurs du Führer attendent ce n'est pas l'annonce de la guerre, mais la solution de ce conflit S.A.-Reichswèhr qui menace le nouveau Reich.
Hitler s'est tu. Pour le moment il n'a parlé que de l'avenir, sombre et guerrier. Mais c'est dans le présent qu'il lui faut trancher. Il commence à voix basse, fait un cours d'histoire militaire qui semble un long détour puis, tout à coup, tourné vers Rœhm, il dit avec force : « Une milice n'est appropriée que pour défendre de petits territoires ». Rœhm semble se désintéresser de ce que dit Hitler. Dans son visage rougeaud se marque peu à peu une moue d'indifférence affectée. Il regarde le plafond. Le ton de Hitler s'élève ; le Führer parle toujours, tourné vers Rœhm, et ce qu'il dit est une condamnation des ambitions du chef d'Etat-major de la S.A. : « La S.A. devra se limiter à des tâches politiques. » La voix est ferme. « Le ministre de la Guerre, continue Hitler, pourra faire appel à la S.A. pour les tâches du Grenzschutz et pour l'instruction prémilitaire. »
Un silence. Rœhm ne dit toujours rien. Les généraux sont figés dans leur raideur. Hitler, après un nouveau et long silence conclut : « Je réclame de la Sturmabteilung une exécution loyale des tâches qui lui seront confiées. » Hitler a tranché : la Reichswehr seule sera la base de la future armée nationale. Aucun applaudissement ne retentit. Tout le monde se lève, on entoure Hitler, Rœhm, Blomberg. Chacun se regroupe autour de son chef. Hitler est au milieu, souriant, détendu ou paraissant l'être. Il parle vite, prend Rœhm par le bras. C'est le moment de la grande réconciliation publique. Face à face, autour de Hitler, il y a Blomberg, le monocle enfoncé sous ses sourcils blonds qui barrent son visage rond et distingué, et il y a Rœhm, plus petit engoncé dans son uniforme brun. Les deux hommes se serrent la main, puis le chef d'Etat-major de la Sturmabteilung invite les généraux à un déjeuner de réconciliation à son quartier général. Là, quand les larges portes s'ouvrent on aperçoit une table immense, royalement dressée avec le faste ostentatoire des nouveaux riches. Les places sont indiquées : Rœhm et Blomberg sont à chaque bout. Des serveurs s'empressent : le menu est excellent le Champagne coule en abondance, mais l'atmosphère est glaciale, personne ne parle. Les généraux ne tournent pas la tête. La réconciliation ressemble à une cérémonie mortuaire. Le déjeuner se déroule, solennel, morne, puis sur un signe de Rœhm les S.A. se lèvent. Alors viennent les saluts, les serrements de main, les claquements de talons. Bientôt les lourdes voitures de la Reichswehr s'éloignent lentement
Rœhm a demandé aux S.A.-Führer de demeurer avec lui. Ils sont revenus autour de la table après le départ des officiers. Ils attendent. Rœhm se sert une nouvelle coupe de Champagne. Quelques-uns de ses hommes l'imitent. « C'est un nouveau traité de Versailles », lance brusquement Rœhm. Les S.A.-Führer se taisent ils sentent venir la colère de leur chef, colère contenue pendant les longues heures de la « réconciliation ».
Et tout à coup elle explose. Dans un coin de la salle, Viktor Lutze observe, écoute : « Ce que ce caporal ridicule a raconté... » commence Rœhm. Lutze est aux aguets, hésitant à comprendre, le visage impassible pour cacher son désarroi. « Hitler ? Ah si nous pouvions être débarrassés de cette chiffe » conclut Rœhm.
Des groupes se forment les conversations sont âpres, les jurons sifflent. L'Obergruppenführer Lutze se tait, il ne conteste pas les propos de Rœhm, il se confond, silencieux, avec les autres, il n'est que l'un des chefs S.A., le plus anodin. Pourtant, quelques jours plus tard il rend compte à Rudolf Hess, la deuxième personnalité du parti, et sur son conseil il se rend auprès de Hitler dans son chalet de Berchtesgaden. Mais le Führer s'est contenté de dire : « Il faut laisser mûrir l'affaire.» Et l'Obergruppenführer, étonné de cette modération, a demandé conseil au général von Reichenau.
Mais le Führer n'a pas oublié. Le 29 juin 1934, c'est Lutze qui est convoqué à Godesberg ; il se trouve devant un Hitler nerveux qui lui demande s'il peut avoir confiance en lui.
5
VENDREDI 29 JUIN 1934
Godesberg. Hôtel Dreesen. Vers 23 heures.
Hitler, depuis un long moment, parle avec Lutze. Il le questionne sur la réunion de Wiessee, s'assure que rien d'autre qu'une rencontre entre les chefs S.A. et lui-même n'était prévu. Voilà plusieurs fois que Viktor Lutze avec d'autres mots répète et assure son Führer de sa fidélité. Goebbels s'est approché : il approuve Lutze, montre par toute son attitude que lui aussi, toujours, n'a jamais eu à l'esprit que le service du Führer. Otto Dietrich, le chef du service de presse de Hitler, arpente la terrasse avec Brückner ; l'un ou l'autre des deux hommes fait la liaison avec le téléphone, surveille le perron de l'hôtel devant lequel s'arrêtent les motocyclistes ou les voitures envoyées depuis l'aéroport de Hangelar.
Peu après 23 heures, alors que la fanfare du R.A.D. attaque une nouvelle marche militaire, Brückner et Dietrich s'approchent de Hitler. Ils lui tendent un message qui est arrivé de Berlin à Hangelar par voie aérienne. La fanfare n'a pas permis d'entendre le moteur de la voiture qui vient de l'apporter. Le message est de Gœring. Hitler le lit, puis le tend à Goebbels. Le texte est court : Gœring a appris, il y a quelques heures, que le docteur Sauerbruch, l'un des plus célèbres médecins berlinois, vient d'être appelé au chevet du président Hindenburg, dans sa propriété de Neudeck. Hitler ne commente pas le message, il le pose sur la table, le lissant du bout des doigts, puis il regarde devant lui, immobile, la joue et la paupière parfois agitées d'un tic nerveux qu'il ne peut réprimer dans les périodes de grande tension. Comme lui, Goebbels se tait.
Peut-être est-ce l'instant attendu depuis des mois, celui où Hitler va devoir une nouvelle fois saisir la chance, celui qui verra s'écrouler la statue de bronze de Hindenburg frappée par la mort.
LA CROISIERE DU DEUTSCHLAND
Car la mort tournoie autour du vieux Reichspräsident depuis le printemps de 1934. Le combattant de Sadowa et de Sedan, qui paraissait défier le temps, a alors commencé à perdre la mémoire, ses absences devenant nombreuses. Au début d'avril, les médecins qui le soignent avertissent ses proches. Dans l'ombre du Maréchal vivent son fils, le colonel Oskar von Hindenburg, un quinquagénaire médiocre et ambitieux qu'ont étouffé la gloire et l'autorité paternelles, des conseillers comme ce vieux chambellan von Oldenburg, cynique et blasé, et qui répète sa devise favorite : « Les mangeoires ne changent pas, seuls les veaux qui passent devant changent. » Il y a aussi Meissner, le secrétaire général à la présidence, corpulent, le visage quelconque, rond ; Meissner dissimule sous son regard doux et vague de myope, la ferme intention de demeurer à son poste même après la mort de Hindenburg. Tous ces hommes qui survivront au Maréchal veulent préserver leur avenir ; ils peuvent monnayer leur influence tant que Hindenburg est vivant. Après, que seront-ils ?
Dès qu'ils apprennent que la santé de Hindenburg faiblit, ils préviennent le général von Blomberg et le Chancelier Hitler, les deux hommes qui représentent les deux forces du moment, c'est leur devoir et leur intérêt.
Avril 1934 : le général et le Chancelier sont les deux seules personnalités dépositaires du secret qui peut bouleverser l'avenir de l'Allemagne et Blomberg et Hitler ont décidé de se rencontrer.
Le 4 avril au matin, c'est à bord du croiseur de poche Deutschland, le branle-bas qui précède l'appareillage. Sur le pont, les marins au béret noir dont les deux rubans flottent dans l'air salé, courent au sifflet. L'ancre est remontée lentement, le Deutschland, énorme masse grise battant pavillon de la Kriegsmarine, quitte Wilhelmshaven et la baie de Jade ridée par le vent. Il descend lentement vers la mer du Nord, passant devant Brunsbuttellt et Holtenau ; les jeunes filles d'un pensionnat agitent des foulards, sur la rive une fanfare joue des airs martiaux. Le navire doit se diriger vers Kiel où embarqueront, à l'occasion des grandes manœuvres de printemps, les principaux chefs du IIIeme Reich. Pendant tout le trajet, l'équipage est soumis à un rythme d'enfer. On repeint une partie des superstructures ; les ordres d'alerte, les simulacres de branle-bas de combat se succèdent. Le 9 avril, le Deutschland entre dans le port de Kiel, salué par les sirènes des destroyers et des petits chalutiers noirauds et ventrus qui fendent les eaux verdâtres du célèbre port de guerre. L'équipage est consigné à bord. C'est le lendemain, 10 avril, que Hitler arrive à Kiel par avion, son trimoteur habituel. Une unité de la Kriegsmarine a rendu les honneurs, puis le Chancelier accompagné de l'amiral Raeder, des généraux von Blomberg et von Fritsch a gagné le Deutschland.
Hitler est radieux : quand il parait à la coupée, les sifflets stridents des quartiers-maîtres modulent leurs notes aiguës. Les mouettes tournoient et le chancelier découvre l'ordre fascinant et efficace d'un grand navire de guerre. L'appareillage a lieu le 11 avril, Hitler assiste aux manœuvres. Ici, c'est le monde de la technique militaire la plus perfectionnée qu'il peut voir à l'œuvre. Ici, les professionnels de la guerre, formés dans les dures écoles navales, les hommes qui savent dompter et plier la machine pour en faire un instrument de guerre, sont rois. Ici ne peuvent pas gouverner les S.A. avinés, débauchés, ou anormalement turbulents et indisciplinés. Ici la guerre est une affaire de science et de précision. Hitler observe. Entouré de Raeder, de Blomberg et de von Fritsch, il arpente le pont. Lui qui a dit devant les officiers de la Reichswehr, dès février 1934 : « C'est ma ferme décision que l'armée allemande de l'avenir soit une armée motorisée. Quiconque essaiera de m'opposer des obstacles dans l'accomplissement de ma tâche historique de donner à la nation allemande les moyens de se défendre, je l'écraserai », il ne peut qu'être sensible à cette machine aux rouages parfaitement réglés qu'est le Deutschland.
Le croiseur navigue à une vitesse moyenne dans le Grand Belt, puis devant Laaland. A 6 heures du matin, on passe devant Skagen ; au loin, dans la brume qui se lève, on aperçoit le bateau-bouée. Puis, le croiseur met cap au nord et remonte la côte norvégienne ; la neige tombe sur la mer grise.
Hitler et Blomberg se sont réunis : ils décident d'avertir Raeder et Fritsch des nouvelles concernant la santé du Reichspräsident. L'amiral et le général sont en effet les chefs de la marine et de l'armée. Puis Hitler et Blomberg s'isolent dans la large cabine du commandant. Il continue de neiger. La côte au loin n'est qu'une barre haute et foncée comme une grande vague qui déferlerait, Hitler et Blomberg ont parlé longuement. Peut-être ont-ils conclu ce pacte du Deutschland qu'on a souvent évoqué depuis : en échange du sioutien de Blomberg et de l'armée pour la succession de Hindenburg, Hitler confirme son engagement de limiter une fois pour toutes les ambitions de Rœhm et des S.A. La Sturmabteilung ne concurrencera jamais la Reichswehr seule responsable de la défense du Reich.
Personne ne sait ce que Hitler et Blomberg se sont dit réellement mais tout laisse penser que les deux hommes se sont entendus sinon sur le détail des moyens à employer pour réduire les S.A. et faire de Hitler le successeur de Hindenburg, du moins sur les principes. Pour le Führer c'est l'essentiel.
Le 12 avril, le Deutschland pénètre dans le Sogne Fjord. Les parois noirâtres sont par longues traînées couvertes de neige. Il fait froid. L'Amirauté a choisi, en accord avec la Chancellerie, ce fjord pour saluer le Fridjoff-Denkmal, le monument construit par Frédéric le Grand. Nouvel hommage que le régime nazi rend à l'Allemagne éternelle. Tout à coup, le Führer paraît sur le pont au milieu de l'équipage. C'est l'instant de la détente après la discipline d'acier. Les matelots poussent des hourras. Les officiers un peu mal à l'aise sourient. Le Führer accepte même de se laisser photographier par des marins. Puis le navire vire de cap. Le 13, il entre dans le Hardanger Fjord et reprend sa route vers le sud. Hitler est monté à plusieurs reprises sur la passerelle, manifestement enchanté par le voyage et les conversations qu'il a eues loin des indiscrets avec le général von Blomberg. Le 14, on aperçoit le bateau-bouée de Skagen et, quelques heures plus tard, le navire arrive à Wilhelmshaven. Seul incident : lors d'un exercice, ce dernier jour, un homme est tombé à la mer.
L'ANNONCE D'UNE PERMISSION
Rentré à Berlin par avion, Hitler a regagné la Chancellerie. Son pavillon personnel hissé au haut du mât signale aux Berlinois sa présence. Des groupes patientent devant les lourdes portes guettant la relève de la garde ou la sortie d'une voiture officielle. Car le va-et-vient est permanent devant la Chancellerie en ce mois d'avril.
En effet, après la croisière du Deutschland, les décisions, les réunions politiques vont se succéder. Hitler tranche là où il hésitait depuis des semaines, comme si les conversations avec Blomherg l'avaient définitivement conduit à choisir, comme si le pacte du Deutschland n'était pas qu'une hypothèse mais une réalité. C'est le 20 avril, que Himmler et Heydrich deviennent les maîtres de la Gestapo et au même moment Joachim von Ribbentrop, l'ancien représentant en Champagne au visage régulier et fin, l'ami de Himmler, est nommé ambassadeur extraordinaire de Hitler pour les questions du désarmement. Après les organes de police, le ministère des Affaires étrangères est ainsi à son tour pénétré par le parti nazi. Et une des premières démarches de Hitler et de Ribbentrop en matière de désarmement c'est de proposer à la France et à l'Angleterre une importante réduction de l'effectif des... S.A.
Le 20 avril, sans commentaire et en petits caractères comme une nouvelle anodine, le journal National~Zeitung publie un communiqué de l'Etat-major de la S.A. annonçant que la Sturmabteilung sera en permission durant le mois de juillet. Or, cette démobilisation de toute la S.A. pendant trente jours n'est pas, compte tenu des circonstances, une décision de routine mais bien une mesure inattendue, exceptionnelle. Pourtant aucune autorité ne la commente et la nouvelle s'enfonce dans l'actualité renouvelée qui, jour après jour, apporte un élément nouveau au puzzle qui, peu à peu, se compose.
En ouvrant leur journal le 27 avril, les Allemands découvrent un communiqué officiel, encadré, en première page, qui annonce que la santé du Reichspräsident donne de sérieuses inquiétudes à ses médecins. Des photos montrent Hitler s'inclinant devant Hindenburg et déjà beaucoup comprennent que le successeur désigné ne pourra être que le Chancelier du IIIeme Reich. Des officiers maugréent, il y a d'autres candidats : le général Ritter von Epp, qui, pour être nazi et Reichstatthalter de Bavière, n'en est pas moins un membre distingué de l'Offizierskorps. Il y a aussi le Kronprinz dont on pourrait faire un régent s'il était Reichspräsident. Or, beaucoup d'officiers sont restés attachés à l'ancienne dynastie. Mais von Blomberg va leur faire comprendre qu'il ne faut plus cultiver ces chimères monarchiques. Un ordre du ministre de la Guerre parvient à mi-avril dans toutes les unités : à compter du 1er mai 1934, officiers et hommes de troupes devront arborer sur leurs képis et leurs uniformes l'aigle et la croix gammée qui sont les insignes du Parti nazi et du IIIeme Reich. Quelques vieux officiers protestent dans les salons et les mess mais à voix basse, partout les jeunes capitaines et les soldats acceptent d'enthousiasme et puis comment s'insurger contre un ordre qui émane du chef de la caste et des dignitaires de l'Offizierskorps dont il est entendu qu'ils savent ce qu'ils font ? En prenant leur décision derrière les murs épais de la Bendlerstrasse, ils ne peuvent avoir en vue que l'intérêt supérieur de la Reichswehr, et puisqu'ils sont confondus, celui du Reich.
Ce 1er mai, alors que dans les casernes les compagnies manœuvrent pour la première fois sous les emblèmes nazis, toutes les villes d'Allemagne connaissent les grands rassemblements du Jour National du Travail.
Torses nus, pelle sur l'épaule, avançant comme des régiments, les volontaires du travail paradent et la pelle, sur ces épaules, devient une arme. Dans la banlieue de Berlin, à Tempelhof, Hitler parle devant 100 000 personnes qui crient leurs Heil Hitler devenus traditionnels. Ailleurs, sur des estrades ou sur l'herbe des clairières, alors qu'une pluie fine commence à tomber, des milliers de jeunes gens, avec ensemble, s'affrontent dans une escrime étrange où les épées sont remplacées par des troncs d'arbre de deux mètres de long. Partout le régime nazi démontre la puissance de son emprise sur la jeunesse, l'Etat nazi paraît bien « exister ».
Et pourtant dans les jours qui précèdent ces manifestations du 1er mai, aux S.A. qui paradent à Iéna, le S.A.-Gruppenführer Lasch dit que « la révolution du national-socialisme n'est pas encore terminée. Elle prendra fin seulement le jour où l'Etat S.A. sera formé ». A la tribune se trouve, à côté du Gauleiter Sauckel, Maximiliam von Weichs ; c'est un officier de la Reichswehr, très hostile aux S.A. Il se penche vers Sauckel : « Qu'est-ce que l'Etat S.A. ? » demande-t-il. Le Gauleiter hausse les épaules. Le lendemain, un S.A. Brigadeführer qui hurle en état d'ivresse dans les rues d'Iéna est arrêté et Sauckel refuse de le faire libérer. Le Gauleiter Sauckel appartient pourtant à la S.A. mais ses fonctions ont fait de lui un homme du gouvernement et de l'ordre. Quand Rœhm veut réunir un tribunal d'honneur de la Sturmabteilung pour y faire comparaître Sauckel celui-ci refuse de se présenter, arguant des ordres reçus. En Thuringe, le 1er mai, la S.A. ne prendra pas part aux cérémonies du Jour National du Travail.
A nouveau, les forces se sont heurtées et quand Goebbels s'adresse à la nation allemande, le 4 mai, peut-être est-ce aussi aux S.A. qu'il pense. « Les délégués de la propagande du parti, lance-t-il, ont décidé de mener une campagne énergique contre les critiqueurs professionnels et les propagateurs de fausses nouvelles, contre les provocateurs et les saboteurs. Il apparaît en effet que ceux-ci n'ont pas perdu tout espoir de détruire l'œuvre constructive du national-socialisme ». Puis c'est tout un programme d'action que Goebbels fait surgir. La voix est nasillarde, dure : « Du début du mois de mai, continue- t-il, au 30 juin, des réunions, des démonstrations et des manifestations quotidiennes auront lieu en ce sens. Elles mettront en garde le peuple allemand contre ce bas dénigrement, véritable fléau pour le pays. Il faut que ce fléau disparaisse pour toujours ». Et la menace vient, sans surprise : « Nous emploierons des méthodes éprouvées ».
HINDENBURG ET FRANZ VON PAPEN
Quelques jours plus tard, un cortège officiel s'arrête devant la gare centrale de Berlin. La garde rend les honneurs. Appuyé sur von Papen, le Feldmarschall Hindenburg s'apprête à partir pour son domaine de Neudeck.
Il aime cette vieille terre de Prusse-Orientale qui se confond avec le ciel gris sombre. Neudeck, c'est son domaine seigneurial, le contact avec ce sol foulé par les légions teutoniques. Mais de génération en génération la propriété familiale s'était réduite, parce que les officiers pauvres avaient dû vendre. Dans toute la région, d'autres Junker, serviteurs de la Reichswehr, ont aussi vu leurs domaines fondre au grè de leurs besoins. Avec Hindenburg à la présidence ils ont voulu changer cela. En 1927, par souscription nationale, le domaine de Neudeck a été racheté et offert à Hindenburg pour son 80eme anniversaire. Le vieux maréchal a accepté cet acte symbolique sans se rendre compte peut-être que la camarilla de Junker qui l'entourait espérait ainsi le « tenir », l'associer à ses projets. Effectivement, la loi dite « secours à l'Est » (Osthilfe) les comble : ils vont bénéficier de larges subventions, d'exemptions d'impôts, de passe-droits. Et le domaine de Neudeck lui-même a été attribué à Oskar Hindenburg pour qu'à la mort du maréchal il n'y ait pas de droits de succession à payer. Von Papen qui est là, aux côtés de Hindenburg sur le quai de la gare de Berlin, a joué de cette passion du Feldmarschall pour Neudeck. On murmure qu'il a ruiné dans le cœur du président, son rival, le général von Schleicher en affirmant que celui-ci allait révéler les secrets de Neudeck. Et c'est peut-être sur son conseil que Hitler, en août 1933, a fait ajouter sans taxe 2 000 hectares au domaine.
Aussi Franz von Papen, officier de cavalerie, ancien attaché militaire aux Etats-Unis pendant la Grande Guerre et organisateur de sabotages, membre du Club des Seigneurs, conservateur et catholique est-il bien en cour. Hindenburg se penche vers lui avant de monter dans le train : « Les choses vont très mal Papen, dit-il. Faites de votre mieux pour redresser la situation. » Papen relatant, plus tard, ce qui s'est passé ce jour-là, ajoutera : « Aujourd'hui encore, je me souviens de sa dernière phrase prononcée de sa voix profonde et impressionnante. »
Papen reste sur le quai avec les officiels cependant que le train s'éloigne et qu'immobiles, les soldats de la garde continuent de rendre les honneurs. Le vice-chancelier Papen est placé devant ses responsabilités. Cet homme habile, au visage souriant, agrémenté d'une moustache poivre et sel, de cheveux grisonnants soigneusement, minutieusement peignés, est avec son allure de bourgeois un membre de la caste. C'est un ancien de l'Ecole des Cadets : autant dire qu'il a « tenu » face à l'implacable discipline imposée à des enfants de onze ans, face au code lui aussi inflexible que les cadets eux-mêmes s'imposent les uns aux autres, enfants dressés à une conception de l'honneur et prêts à se faire tuer pour elle. Là, à l'Ecole des Cadets, Franz von Papen, comme tous ses camarades, a été marqué à jamais. Plus tard, il expliquera comment, au printemps de l'année 1897, il a appris « une magnifique nouvelle : je faisais partie des quatre-vingt-dix élus, sur six cents élèves aspirants, qui, grâce à leurs bonnes notes, allaient former la classe Selecta. Honneur qui signifiait que, durant une année supplémentaire, je resterais soumis à la discipline rigide des sous-officiers du corps des Cadets, mais qui, en revanche, me plaçait sur la liste des candidats à la dignité fort recherchée de page de l'Empereur ».
Aujourd'hui, l'ancien page de Guillaume II, l'ancien gentleman-rider, le membre du Herrenklub, Franzchen, le petit Franz comme l'appelle Hindenburg, qui a pour lui la passion paternelle qui lie certains puissants vieillards à leurs proches collaborateurs, le vice-chancelier Papen doit agir. Il lui est difficile de se dérober. L'évolution de la situation l'inquiète. Peut-être en introduisant les nazis à la Chancellerie a-t-il lâché le diable ? Car Papen est partisan d'un pouvoir fort, mais il est heurté, blessé, par le déchaînement sans mesure de la terreur. Certes, il veut composer avec la dictature sans prendre trop de risques personnels, mais il espère aussi la canaliser. Plus tard, habile toujours à se trouver des excuses, il écrira : « L'Histoire d'Allemagne ignorait, jusqu'en 1933, le phénomène d'une dictature antichrétienne, d'un chef de gouvernement sans foi, ni loi. Par conséquent, nous ne savions pas comment le combattre ».
Papen prononce donc des discours. En décembre 1933, la ville de Brème fête le 150eme anniversaire de la fondation du Club hanséatique. Tout ce que la cité compte d'important est rassemblé : 2 000 invités sont venus écouter le vice-chancelier. Papen rend hommage au nouveau régime, puis sans trop préciser qui il vise, il s'en prend à ceux qui nient « l'existence personnelle de l'individu ». Des applaudissements frénétiques éclatent : les paroles de Papen sont devenues pour les auditeurs une attaque contre les nazis. Quelques mois plus tard, Papen est reçu dans une association beaucoup plus importante : le Dortmunder-Industrie-Club. Dehors, dans la ville industrielle les rues sont vides. La Ruhr travaille ou dort. Ici, dans la salle brillamment éclairée, enfoncés dans les larges fauteuils de cuir du Club, les chefs d'industrie écoutent le vice-chancelier avec d'autant plus d'attention qu'il a été l'un de ceux qui ont fait connaître Hitler aux magnats de l'industrie. Ce soir du 26 avril 1934 Papen évoque des thèmes auxquels ils sont sensibles : « Le rôle du chef d'entreprise est essentiel, dit Papen, il doit garder une liberté aussi grande que possible par rapport à l'Etat ». On applaudit fortement mais à la manière de gens influents et responsables qui ne se laissent pas aller à des manifestations exagérées. L'approbation est encore plus vive quand Papen discute les projets d'autarcie économique. « L'autarcie rend illusoire l'existence d'une économie mondiale, conclut-il, ce qui comporte un danger de guerre à plus ou moins longue échéance. »
Après son discours, on félicite Papen, il a exprimé le point de vue d'une large partie des milieux économiques qu'inquiètent les proclamations enflammées des S.A., qui craignent aussi certaines tendances de membres du gouvernement comme Walther Darré, ministre de l'Agriculture, rêvant d'une race saine et pure de paysans, d'une Allemagne retrouvant la force par le sol et le sang : que deviendrait alors l'industrie ? Il y a aussi Kurt Schmitt, ministre de l'Economie, dont on dit qu'il veut limiter le programme de réarmement et réorganiser l'industrie du Reich au détriment de la puissance des Krupp.
Par contre, dans la Ruhr, on a confiance en Papen. Pourtant, le vice-chancelier ne cache pas son inquiétude aux membres puissants du Dortmunder-Industrie-Club. « Chaque fois, dit-il, que j'attire l'attention de Hitler sur les conséquences dangereuses qu'aurait toute concession faite à Rœhm, il ridiculise les exigences du chef des Chemises brunes et les traite d'aberrations sans importance ».
Naturellement, Hitler a ses informateurs : il voit se nouer des fils qui mènent de la Reichswehr à Papen et aux milieux industriels. Il connaît aussi l'entourage du vice-chancelier et il sait que des hommes comme von Bose, chef de cabinet de Papen, von Tschirschky, cet ancien monarchiste qui a rallié Papen, faute de mieux ; le docteur Klausener, directeur de l'action catholique, haut fonctionnaire au ministère des Transports, sont des adversaires plus ou moins déterminés du nazisme. Il y a surtout le secrétaire particulier de Papen, Edgar Jung, à la fois chrétien, conservateur et monarchiste qui, depuis des mois déjà, multiplie les contacts pour renverser le nouveau régime. Ces hommes sont d'autant plus dangereux qu'ils peuvent avoir l'appui de la Reichswehr ; elle reconnaît en eux des proches, sinon certains de ses membres. Le Führer prend donc garde à ce « nid de vipères » de la vice-chancellerie, mais rien n'est simple et Hitler hésite. Il perd le sommeil, en proie à l'inquiétude et au doute. Il se plonge devant Brückner somnolent dans l'audition de longues pièces musicales. C'est que le choix est difficile pour Hitler. Pour empêcher les conservateurs de séduire la Reichswehr, il faut certes mettre un terme aux violences et surtout aux prétentions de la Sturmabteilung, mais s'il n'y a plus de S.A. la Reichswehr n'abandonnera-t-elle pas aussi Hitler qui n'aura plus rien à monnayer en échange de son appui ?
Situation délicate et ambiguë. Hitler attend, observe, lit les rapports.
LE PIEGE DE HIMMLER ET DE HEYDRICH
Or les rapports sur la vice-chancellerie se multiplient. Himmler et Heydrich craignent aussi Papen et ses collaborateurs et pour être prêts à se défendre et à attaquer, ils ont introduit un homme à eux dans la place.
Un jour d'avril 1934, Otto Betz est convoqué à Munich par Heydrich, chef du S.D. de la Gestapo. Otto Betz est un agent du contre-espionnnage,- au service de Heydrich en Sarre. Cet homme d'apparence terne et modeste a été mêlé dans la nuit du 8 au 9 janvier 1923 à un attentat — réussi — contre un séparatiste rhénan. A cette occasion, il a connu le docteur Edgar Jung. Heydrich expose son plan : Betz collaborera avec Papen tout naturellement puisque le vice-chancelier est commissaire pour la Sarre. Mais Heydrich, toujours impassible, efficace, ne disant que le nombre minimum de mots, ajoute : « Vous devez surveiller :
« 1° von Papen,
« 2° l'Oberregierungsrat von Bose,
« 3° le docteur Edgar Jung.
« Les rapports me seront transmis personnellement par voie directe. »
Le 4. mai 1934, l'agent de Heydrich prend des fonctions à Berlin dans deux pièces installées à deux pas du siège de la Gestapo, le fief de Himmler et de Heydrich, au 8 bis, PrizAlbrecht-Strasse. Heydrich a bien fait les choses : Otto Betz a deux dactylos et quatre inspecteurs de police sous ses ordres. Le lendemain même, il se présente à la vice-chancellerie où von Bose l'accueille avec méfiance. On n'aime pas les hommes du S.D. et de la Gestapo à la vice-chancellerie. Mais Betz se fait reconnaître de Jung : on évoque les années 1923, les attentats contre les Français et les séparatistes, la blessure que Jung a reçue alors. Peu à peu Betz est admis, les relations entre lui et les membres de l'entourage de Papen se détendent Il les met même en garde contre les communications téléphoniques qui, dit-il, sont surveillées par le S.D. Cela ne l'empêche pas de transmettre des rapports circonstanciés à Heydrich et à Himmler. Ceux-ci, maîtres tout-puissants des services secrets — seule l'Abwehr, service de renseignements de l'armée leur échappe — les modifient selon leurs intérêts et les communiquent à Hitler.
Or, tous les rapports confirment Hitler dans ses craintes. Tous font état de préparatifs, de rumeurs. Dans les cercles conservateurs on s'inquiéterait des projets de Rœhm ; ailleurs, dans d'autres cercles, on songerait au contraire à s'allier avec la Sturmabteilung. Les hommes de Heydrich auraient la preuve que certains conservateurs sont en contact avec le prince August Wilhelm de Prusse, député nazi, Gruppenführer S.A. qui est le fils du dernier Empereur, le frère du Kronprinz. Or, pour les monarchistes, le prince peut être naturellement le candidat à la succession du Feldmarschall Hindenburg. Ainsi la question des S.A. rejoint-elle par cet autre biais la question de la mort du vieux Reichspräsident Et les rapports de la Gestapo et du S.D. s'accumulent sur le bureau du Führer. Hindenburg aurait fait son testament politique et c'est Papen qui l'aurait rédigé annoncent-ils. Fränzchen, d'après des confidences recueillies par les agents du S.D. aurait sans peine incité Hindenburg à exprimer son souhait de voir, après sa mort, la monarchie restaurée. Un rapport de la Gestapo indique même que le testament a été signé le 11 mai.
Le Chancelier s'inquiète d'autant plus que d'autres bruits lui parviennent, toujours rapportés par l'intermédiaire de Heydrich et de Himmler : des listes d'un nouveau cabinet seraient déjà prêtes. L'historien anglais, sir John W. Wheeler-Benett vit alors à Berlin. Il fréquente les cafés politiques de la capitale, y rencontre de nombreuses personnalités allemandes en vue. Un jour, dans l'un de ces bars, l'un de ses interlocuteurs sort une feuille de papier : c'est le futur cabinet, et sans se soucier des serveurs qui passent et repassent près de la table, il commente devant Wheeler-Bennett les noms de ceux qui sont promis à la succession. Or, il est de notoriété publique que les garçons de ce bar sont au service de la Gestapo. Heydrich peut ainsi citer des noms à Hitler : Rœhm se serait allié au général Schleicher qui veut évincer Papen. Gregor Strasser serait ministre de l'Economie nationale, Rœhm, ministre de la Défense et les S.A. seraient incorporés à la Reichswehr, Bruning aurait le ministère des Affaires étrangères. Mais Hitler conserverait la chancellerie, les victimes du changement étant Papen et Gœring. Wheeler-Bennett se souvient que « tous ces bruits circulaient à Berlin à ce moment-là et que l'on se passait de main en main des listes tapées à la machine donnant la composition du nouveau cabinet et cela avec un manque de prudence qui faisait frémir plus d'un observateur étranger ».
Heydrich et Himmler peuvent donc, sans difficulté, rassembler les informations. Ils annoncent même que Schleicher et son adjoint, le général von Bredow, ont pris des contacts avec des émissaires français.
En fait, le général Schleicher qui a été la tête politique de la Reichswehr, l'homme de confiance de Hindenburg, le tombeur de chanceliers et le dernier chancelier avant Hitler, s'ennuie. Dans sa villa de Neu Babelsberg, sur les bords du lac Wannsee, il a vécu retiré depuis janvier 1933. Sa jeune femme et sa fille paraissent suffire à occuper sa vie. Mais il voit les généraux Bredow et Hammerstein et par eux il se tient au courant des rivalités qui déchirent le parti nazi, des incertitudes qui régnent quant à l'avenir. Il espère à nouveau jouer un grand premier rôle et au printemps, il rentre dans le circuit des diners, des rencontres, des projets. A-t-il vu Strasser et Rœhm ? Il parle longuement avec l'ambassadeur de France à une réception chez le ministre de Roumanie. Il n'en faut pas plus pour que les rapports des agents de Heydrich s'enflent D'autant plus qu'André François-Poncet et le général vont se revoir.
« Je connaissais assez bien Schleicher, raconte l'ambassadeur de France, je l'avais vu pour la dernière fois le lundi de Pâques (le 2 avril) ; nous avions passé la journée ensemble à la campagne, il avait l'habitude de me parler librement et je n'avais jamais constaté qu'il me trompât. Ce jour-là, il ne fit, pas plus que dans les conversations précédentes, mystère de son opposition au régime, mais à aucun moment il ne me dit quoi que ce fût qui pût me laisser deviner qu'il eût des projets subversifs ou qu'il fût mêlé à une conspiration quelconque ; à aucun moment il n'eut le langage d'un traître à son pays, et chaque fois qu'il prononça le nom de Rœhm ce fut avec dédain et dégoût »
Mais les agents du S.D. se soucient peu des intentions réelles de Schleicher. Ils le surveillent, comme ils surveillent von Bredow qui séjourne près de la frontière française. Bredow, qui se rendait à Paris, aurait même été prié de descendre du train à la frontière et dans ses bagages on aurait trouvé une recommandation pour une personnalité française. Bredow aurait en vain téléphoné à Blomberg pour lui demander d'intervenir, mais le ministre de la Reichswehr aurait refusé.
Pour un homme aux aguets comme l'est Hitler ces indices — et Heydrich les multiplie — doivent être pris en considération. Le Führer sait qu'un pouvoir est vulnérable et peut être renversé. Ses adversaires ne cherchent-ils pas à obtenir l'appui français ? Que peuvent s'être dit Schleicher et François-Poncet ? L'ambassadeur du Reich à Paris ne signale-t-il pas précisément que le 9 mai, Louis Barthou, ministre des Affaires étrangères, a fait devant la commission des Affaires étrangères de la Chambre des « déclarations sensationnelles concernant la situation intérieure de l'Allemagne » ? Qu'espèrent donc les Français ? Qui les renseigne ? Schleicher est-il leur homme ?
LES PREMIERES LISTES
Himmler et Heydrich utilisent, interprètent tous les détails dans le sens de leur thèse : Rœhm et les S.A. menacent le pouvoir du Reich, mais peu à peu autour de ce premier noyau viennent s'agglomérer d'autres périls qui s'incarnent en quelques noms : les conseillers de Papen, Jung, Bose, les généraux Schleicher, Bredow. C'est un étrange amalgame que constituent les maîtres de la Gestapo et de l'Ordre noir. Chacun d'eux mais aussi Gœring complice, ajoutent de nouveaux noms à la liste, qu'ils soient ceux de personnalités catholiques, comme le docteur Klausener, d'un témoin gênant ou d'un Gruppenführer S.A.
Car il s'agit bien de listes. Ce sont les hommes de confiance de Heydrich et de Himmler qui les dressent. L'un d'eux a une fonction toute nouvelle dans le IIIeme Reich : il est le commandant du camp de concentration de Dachau, l'un de ces K.Z. appelés à une si grande extension et dont le Reichsführer S.S. a eu l'idée. Theodore Eicke est Oberführer S.S. : devant lui, les prisonniers politiques de Dachau se tiennent au garde-à-vous, le calot à la main, dans une discipline toute militaire. Ce sont surtout des communistes et des opposants de gauche. Mais quand Heydrich convoque Theodore Eicke et lui demande de préparer ses S.S. à une action éclair — éventuelle — contre les S.A., l'Oberführer ne pose aucune question : il met le plan de Heydrich à exécution. Avec les agents du S.D. il dresse des listes. Ces papiers funèbres circulent entre la Gestapo et le bureau de Gœring : on ajoute ou l'on barre suivant ses sympathies et ses craintes. Gœring efface le nom de Rudolf Diels, l'ancien chef de la Gestapo que Himmler ou Heydrich avait placé sur l'une des listes. Best essaie de protéger l'Obergruppenführer Schneidhuber, mais Best n'est qu'un agent du S.D. et il n'a pas l'autorité de Gœring, Schneidhuber reste sur la liste. Que faire de ces listes ? Heydrich a convaincu Himmler qu'il n'y a qu'une solution : la liquidation de Rœhm, de sa clique, des opposants. Puis Heydrich gagne ceux dont il a besoin à sa solution définitive : Gœring qui a déjà choisi l'alliance avec les hommes des S.S. et de la Gestapo ; le général von Reichenau : l'officier, chef du Ministeramt, se rend de plus en plus souvent au siège de la Gestapo, Prinz-Albrecht-Strasse. A son poste clé, von Reichenau peut beaucoup, il lui est facile de mettre à la disposition des S.S. des armes, des moyens de transport, des casernes. Et les rapports de l'Abwehr qui arrivent sur le bureau du Chancelier « peuvent » aussi confirmer ceux du S.D. et de la Gestapo. Car le plan de Heydrich séduit Reichenau : si l'action contre les S.A. se déchaîne, ce sont les S.S. qui agiront. Les hommes de la Reichswehr se contenteront d'aider discrètement et de tirer les bénéfices de l'opération. Or, les S.A. liquidés, la Reichswehr ne serait-elle pas la seule force réelle du IIIeme Reich et Hitler ne devrait-il pas accepter les vœux de l'Offizierskorps ?
LE CHOIX DE LA REICHSWEHR
Le 16 mai, la petite ville de Bad Nauheim est encombrée par les véhicules officiels. C'est là, au milieu des prairies et des forêts de la Wetterau, dans cette ville protégée des coups de vent froid par le Vogelsberg, que les officiers supérieurs de la Bendlerstrasse et les inspecteurs de la Reichswehr ont décidé de se réunir. Le général von Fritsch, chef de la Heeresleitung, préside avec son autorité impassible d'officier du grand Etat-major. Pour participer à la discussion sont rassemblés ce jour-là autour de von Fritsch tout ce qui compte dans la Reichswehr : une décision prise ici, à Bad Nauheim, deviendra la décision de tout l'Offizierskorps. Blomberg et Beichenau sont présents. Le général Fritsch, immédiatement, aborde le thème central de la discussion : qui la Reichswehr veut-elle voir succéder au Feldmarschall Hindenburg ? Les officiers supérieurs lancent plusieurs noms qui circulent depuis longtemps : Ritter von Epp, ou le Kronprinz ? Reichenau puis Blomberg vont alors intervenir. L'un et l'autre sont des partisans de Hitler. Reichenau met l'accent sur les dangers que représentent les S.A., or, dit-il, Hitler accepterait de débarrasser l'Allemagne de la Sturmabteilung en échange de la présidence. Blomberg est encore plus net : sur le croiseur Deutschland, un pacte a été conclu : les S.A. contre la présidence. Dès lors, la discussion est sans objet car l'accord de tous est acquis : les officiers supérieurs, puisqu'on ne menace pas directement la Reichswehr, cœur et âme du Reich, sont prêts à se rallier à Hitler.
Quand dans l'air doux de ce mois de mai, les voitures portant fanion du général Blomberg, du général Fritsch, du général Reichenau, quittent Bad Nauheim par la petite route pour rejoindre Francfort, une étape importante vient d'être franchie. Aucun des curistes qui, sur les allées, regardent passer les voitures n'a conscience qu'une nouvelle fois la Reichswehr vient de décider pour l'Allemagne.
Le 25 mai, von Fritsch fait publier, à l'usage de tous les membres de la Reichswehr une nouvelle version des Devoirs du Soldat allemand. C'est le bréviaire de l'armée, son code de l'honneur, que les jeunes conscrits doivent jurer de respecter.
« Le service militaire est un service d'honneur envers le Volk allemand », dit le nouveau texte en lieu et place de l'affirmation que la Reichswehr servait l'Etat Volk : après les aigles et les croix gammées qu'arborent les soldats, c'est une nouvelle référence aux thèmes nazis qui est introduite dans la Reichswehr. La réunion de Bad Nauheim n'a mis que quelques jours à porter ses fruits.
A peu près à la même époque, toujours à la fin de ce mois de mai 1934, à l'occasion de rencontres discrètes, de promenades dans la campagne berlinoise, de dîners entre intimes, deux hommes de premier plan sont avertis d'avoir à être très prudents. Ce sont les deux anciens chanceliers Brüning et le général Schleicher. Les informateurs disent tenir leurs renseignements de l'entourage de Gœring. Certains laissent entendre que Gœring lui-même ne serait pas étranger à ces fuites. De façon imprécise, mais néanmoins formelle, on leur révèle ainsi l'existence de listes prêtes pour une « purge » dont on ne sait trop quelle forme elle prendra. Et leurs noms figurent parmi les victimes éventuelles. Il leur faudrait quitter Berlin. Brüning qui a su voir ce qu'était le nazisme n'hésite pas. Il réussit facilement — sous un déguisement — à gagner l'étranger. Le général Schleicher hausse les épaules. Des camarades insistent : il consent à prendre quelques vacances au bord du lac de Starnberg, mais il n'est pas question qu'un officier de la Reichswehr abandonne son pays. D'ailleurs il ne croit pas à la gravité de la menace. Il a toujours confiance dans son habileté et dans la protection que lui assurerait sa qualité de général de la Reichswehr. Il ne semble pas comprendre que celle-ci n'a qu'une seule obsession : se débarrasser de la menace S.A.
L'attaché militaire français en est, lui, persuadé. Par nécessité, il entretient des relations amicales avec des officiers allemands. Il rencontre l'un d'eux à la Bendlerstrasse et celui-ci, au terme d'une longue conversation, lui déclare : « Voyez-vous, je suis intimement convaincu qu'un conflit sanglant est inévitable et peut-être nécessaire entre l'armée allemande et les S.A. » Le général français s'étonne et l'officier allemand ajoute alors : « Ce qui ne pourra être imposé à ces derniers par le seul moyen de la persuasion devra l'être sans doute par la force. »
Or, Hitler, par les rapports de Heydrich, apprend que la S.A. se procurerait des armes — des mitrailleuses notamment — à l'étranger. Le Führer est sceptique. Mais Heydrich et Himmler insistent : ils ont un homme dans la place. Le Gruppenführer S.S. Friedrich Wilhelm Krüger qui est en fonction à la S.A. Ce Krüger est lui aussi un ancien de l'Ecole des Cadets.
Il a quitté l'armée en 1920 mais il est entré aux S.S. en 1931. A la S.A. il est chargé de questions d'instruction des jeunes recrues, façon pour la Reichswehr d'assurer, malgré le traité de Versailles, une préparation militaire d'ampleur nationale. Krüger fait donc la liaison entre la Reichswehr et la S.A. : très vite il est plus militaire que les militaires, dénigrant la S.A., affirmant que « l'Etat-major S.A. à Munich est une porcherie » ou bien « qu'il faut nettoyer les écuries ». Il joue aussi le rôle d'espion de Himmler et son but est sans doute pour le compte du Reichsführer S.S., d'envenimer les relations des S.A. avec la Reichswehr. Dans ses rapports, que Heydrich montre au Führer, il est question de dépôts d'armes S.A. à Berlin, à Munich, en Silésie. Hitler est toujours sceptique. Alors Heydrich donne des détails : les armes proviennent de Liège et sont déclarées comme fret pour l'Arabie. Le chef du S.D. est d'autant mieux renseigné que la S.A., si elle achète les armes, le fait souvent pour le compte de la... Reichswehr avec l'argent et les moyens du service de renseignement de l'armée, l'Abwehr. Provocations, pièges, habiletés, fausses informations : il faut perdre la S.A. et décider Hitler à agir. Une opération est montée. Un agent, habillé en civil, sur le quai de la gare marchande de Berlin, renverse une caisse qui tombe et se brise : tout le monde peut apercevoir des mitrailleuses démontées. La caisse était destinée au chef S.A. Ernst. Autre révélation : le commandant de la région militaire de Stettin, le général von Bock, a saisi — lui aussi et par hasard — une de ces livraisons composées de fusils et de mitrailleuses belges. Sur le bureau de Hitler les rapports du S.D. et de l'Abwehr convergent. Les preuves sont là, irréfutables.
Autour des S.A. et de Rœhm, le piège s'est refermé. Les listes sont prêtes. On pourra aussi se débarrasser de quelques opposants plus ou moins turbulents. Heydrich, Himmler, Gœring ont tous quelques comptes à régler. Il faut pourtant attendre le verdict du Führer.
Les S.A. eux aussi guettent le Führer, mais avec espoir car dans la Sturmahteilung, on a toujours confiance en Adolf Hitler. Les S.A., pourtant, ont recueilli des bruits : ils savent que des listes circulent. L'attitude des militaires, arrogante, souvent méprisante, n'hésitant pas à sévir contre des S.A. quand ils le peuvent les a éclairés. Mais comment Hitler pourrait-il rompre avec son plus vieux compagnon, le ministre Rœhm ? Ce serait contre nature. Et tant que Rœhm vivra, la Sturmahteilung ne craindra rien. Le danger, il vient d'hommes comme Gœring, Papen. Les sous-officiers de la S.A., les officiers subalternes haïssent ces nazis du sommet, ces ralliés de la dernière heure. Hitler, par contre, veut la seconde révolution comme Rœhm. Seulement il y a la « Reaktion », Gœring, la Reichswehr.
« Nous pensions, racontera un chef S.A., que le Führer, après avoir rétabli la situation de l'Allemagne face à l'étranger, allait redonner aux S.A. l'ordre de se mettre en marche : ce serait la seconde révolution... La « Reaktion » devrait aussi vite que possible réaliser son coup de force... Gœring assuré de la bienveillante tolérance du Reichspräsident Hindenburg, s'emparerait du pouvoir exécutif, arrêterait le Führer ainsi que tous les chefs supérieurs S.A. et tenterait de convaincre la masse des S.A. de la trahison de ses chefs. »
La Sturmabteilung devait donc protéger Hitler, Hitler qui voyait s'entasser sur son bureau les rapports de Heydrich et de Himmler la dénonçant, Hitler dont il fallait attendre le verdict.
6
SAMEDI 30 JUIN 1934
Godesberg. Hôtel Dreesen. Vers 0 heure
Sur toute la vallée du Rhin, autour de Godesberg, c'est le silence du milieu de la nuit. La légère brise qui montait régulièrement du fleuve, portant des rumeurs, est tombée. Une immobilité douce a saisi les reliefs peu à peu, gagnant depuis le fond de la vallée, recouvrant le paysage, s'étendant jusqu'à l'horizon maintenant noyé lui aussi, à peine plus sombre. Une lie blanche brille, à mi-hauteur : l'hôtel Dreesen, une lie battue par le silence et la dense profondeur d'une nuit campagnarde et tranquille. Les volontaires du R.A.D., après de longs Sieg Heil, les fanfares, les porteurs de torche viennent de partir, il ne reste sur la frange de la zone éclairée que les hommes du service d'ordre, en longs manteaux de cuir, qui font les cent pas, reparaissant dans la lumière, disparaissant dans la nuit. Aux étages de l'hôtel Dreesen, formant un damier irrégulier, des lampes brillent. Les fenêtres sont ouvertes. La terrasse est faiblement éclairée par de petits projecteurs d'angles, noyés dans des massifs de fleurs et qui n'arrivent pas à se rejoindre. Dans cette demi-obscurité où la lumière se dissout et reste comme une traînée de poussière hésitant à retomber, un groupe d'hommes silencieux guette le Führer.
L'ORDRE DONNÉ A SEPP DIETRICH...
Le visage d'Adolf Hitler paraît gris, des poches ridées se sont formées sous les yeux, le regard est fixe, tourné vers la nuit ne prenant rien dans son champ, regard d'attente et d'incertitude. Goebbels, assis près de lui, l'observe ne dissimulant pas son anxiété. Quand le lieutenant Brückner surgit, Hitler se lève. Tout le monde entend Brückner annoncer que le Gruppenführer S.S. Sepp Dietrich est arrivé à Munich, il appelle de la capitale bavaroise, comme le Führer lui en a donné l'ordre et il attend les nouvelles instructions de son Führer. Hitler n'hésite pas : la voix est rauque, voilée, elle s'assure au fur et à mesure que les mots résonnent, comme si de les entendre donnait au Führer confiance en lui-même. Les hommes de sa garde, la Leibstandarte S.S. Adolf Hitler, doivent être arrivés à Kaufering, dit-il. Que le Gruppenführer Sepp Dietrich s'y rende et prenne la tête de deux compagnies. Et qu'avec ces hommes de la Leibstandarte il se dirige vers Bad Wiessee. Brückner répète avant de courir vers le téléphone. Leibstandarte, Bad Wiessee : les expressions de Hitler reviennent amplifiées comme en écho. On les entend encore parce que, au téléphone proche de la terrasse, Brückner est contraint de crier fort. Puis c'est à nouveau le silence, le même silence du milieu de la nuit qui doit envelopper à Bad Wiessee, la pension Hanselbauer, où dorment Ernst Rœhm et les chefs de la Sturmabteilung.
Sur la terrasse de l'hôtel Dreesen, personne ne commente l'ordre que Hitler vient de donner. Goebbels s'est redressé dans son fauteuil : il sourit nerveusement, de grosses rides cernent la bouche. Hitler est resté debout. Il demande qu'on lui apporte son manteau de cuir : il le pose sur les épaules, commençant à marcher.
Maintenant Sepp Dietrich a quitté Munich. Dans la nuit, la voiture qui a été mise à sa disposition par le Quartier Général de la S.S. dans la capitale bavaroise, le fief de Heydrich et de Himmler, roule entre les prairies humides, les phares éclairent les pommiers en fleur. La route vers Kaufering est déserte. Le chauffeur a reçu l'ordre de « foncer ». Il fonce. Un officier S.S. a embarqué avec Sepp Dietrich : les deux hommes se taisent. Dans leur cantonnement les S.S. de la Leibstandarte sont allongés tout habillés sur les lits que la Reichswehr met à leur disposition.
Ils ne sont pas hommes à se poser des questions. Ils obéissent et puis tout dans cette opération paraît avoir été bien organisé, prévu depuis longtemps. Ils sont en alerte depuis plusieurs jours, avertis que la mission à accomplir va exiger d'eux la plus grande fidélité au Führer. Ils attendaient à Berlin. Une unité du train, appartenant à la Reichswehr et stationnée à Ludwigsburg, a assuré leur transport jusqu'ici. Ils somnolent, prêts à exécuter les ordres. C'est vers eux que roule par cette nuit douce leur Gruppenführer Sepp Dietrich.
Dans le hall de l'hôtel Dreesen, Adolf Hitler vient de prendre lui-même une communication en provenance de Berlin. Le Reichsführer S.S. Himmler a demandé à parler directement au Führer en personne : il téléphone du siège de la Gestapo. Hitler, au fur et à mesure qu'il écoute Himmler, paraît ne plus maîtriser sa nervosité. Il répond par monosyllabes, puis il laisse presque tomber l'appareil, se mettant à parler fort, le regard tout à coup brillant. Il prend Goebbels à témoin, il mêle son récit d'injures. Il est environ minuit et demi. Himmler lui apprend, explique-t-il, que l'Etat-major de la S.A. de Berlin a ordonné une alerte générale pour aujourd'hui samedi à 16 heures. A 17 heures les S.A. doivent occuper les bâtiments gouvernementaux : « C'est le putsch », lance Hitler et il répète plusieurs fois les mots « le putsch », « le putsch ». Il crie de nouvelles injures. « Ernst dit-il, n'est pas parti pour Wiessee comme il le devait. » Le Gruppenführer doit donc diriger le putsch. « Ils ont l'ordre de passer à l'action », « un putsch ». Les phrases violentes se télescopent Goebbels s'est approché, il maudit lui aussi les S.A. En 1931, déjà le chef S.A. de Berlin, Stennes, ne s'était-il pas révolté contre le parti ? Goebbels à voix basse rappelle ce passé, il rappelle ce tract que les S.A. avaient le 1er avril 1931, fait distribuer dans les rues de Berlin et qui accusait le Parti nazi et son Führer de trahir les S.A. et le « socialisme-national ». Aujourd'hui, n'est-ce pas la même chose qui recommence, mais de façon plus dangereuse ?
Hitler est de plus en plus nerveux. Sur son visage se lisent la violence et l'inquiétude. A aucun moment il ne paraît douter de la réalité des informations transmises par Himmler. Goebbels, qui est arrivé tard de Berlin hier soir, sait pourtant que le Gruppenführer Karl Ernst a quitté la capitale pour Brème afin d'y prendre un paquebot à destination de Ténériffe et de Madère où il doit séjourner pour son voyage de noces. Mais Goebbels ne dément pas Himmler.
LA DECISION DU FUHRER
De courtes minutes passent puis, avant qu'il ne soit 1 heure du matin, le téléphone fonctionne à nouveau. Hitler, pour la deuxième fois, prend la communication. Adolf Wagner, Gauleiter et ministre de l'Intérieur bavarois, téléphone de son ministère. A Munich dit-il, la Sturmabteilung est descendue dans la rue ; des slogans hostiles au Führer et à la Reichswehr ont été poussés. Les S.A. bavarois ont donc les mêmes consignes que ceux de Munich.
« Tout est coordonné » s'écrie Hitler. Autour de lui, on se rassemble. Le Führer injurie les chefs S.A. : c'est de la « vermine » lance-t-il. Ce sont des traîtres. La fureur éclate ; Goebbels approuve. Hitler parle de châtiment. Il marche fébrilement Il est près de 1 heure du matin, ce samedi 30 juin.
A Bad Wiessee Rœhm dort paisiblement et les S.A. de Munich sont chez eux. Quelques-uns ont bien manifesté dans la soirée, protestant contre l'attitude de la Reichswehr, mais les officiers sont intervenus. L'un d'eux, juché sur une voiture arrêtée, Kœnigsplatz, a crié : « Rentrez tranquillement chez vous et attendez la décision du Führer.
« Quoi qu'il arrive, qu'Adolf Hitler nous congédie, qu'il nous autorise à porter cet uniforme ou qu'il nous l'interdise, nous sommes avec lui, derrière lui. » La manifestation s'était terminée aux cris de Heil Hitler !
Mais Wagner vient de téléphoner â Hitler la nouvelle d'une insurrection S.A. et le Führer s'emporte dans l'une de ces colères de la nuit qu'amplifie le manque de sommeil et qui déferlent comme une tornade. « Rœhm », « Rœhm », le nom revient et Hitler le couvre d'insultes.
Brusquement Hitler s'écrie : « Tout le monde à Munich, tout de suite, puis de là, en avant à Bad Wiessee ». Après tant d'heures incertaines voici venu le moment du choix. Hitler a tranché.
« Il n'y avait plus pour moi qu'une seule décision possible, dira-t-il le 13 juillet. Il m'apparaissait clairement qu'un seul homme pouvait se dresser contre le chef d'Etat-major Rœhm. C'est moi qu'il avait trahi et moi seul devais lui en demander compte. » Le verdict de Hitler vient de tomber et le piège mûrement préparé par tant d'hommes aux intérêts et aux buts différents se referme sur les S.A.
Samedi 30 juin 1934. Hôtel Dreesen vers 1 heure du matin. Le Chancelier Hitler a pris sa décision. La Nuit des longs couteaux devient réalité. Toute l'histoire du nazisme, le destin des chefs du Parti, sont venus se concentrer dans ces quelques heures, les dernières heures de l'hésitation. Maintenant l'action commence pour Hitler. Il va s'envoler pour Munich et tout au long de ces heures entre le moment où il va quitter l'hôtel Dreesen et le moment où il atterrira à Munich, les jours, chaque jour de ce mois de juin 1934 décisif, vont resurgir. Et quand l'avion de Hitler touchera le sol sur l'aérodrome de Munich-Oberwiesenfeld le mois de juin sera achevé. Il sera le samedi 30 juin à 4 heures du matin.
Deuxième partie
CE MOIS QUI MEURT EN CE JOUR QUI COMMENCE
— Samedi 30 juin 1934 entre 1 heure et 4 heures du matin
(Du vendredi 1er juin au samedi 30 juin 4 heures du matin)
1
SAMEDI 30 JUIN 1934
Godesberg. Hôtel Dreesen. 1 heure
(du vendredi 1er juin au samedi 9 juin 1934)
« UN PUTSCH ». CRIE LE FUHRER.
Samedi30 juin, 1 heure. Devant l'hôtel Dreesen des hommes courent lourdement vers les garages ou les voitures dont certaines sont rangées dans le jardin même. L'Oberleutnant Brückner, imposant, les jambes écartées, se tient immobile sur le perron. Un sous-officier de la S.S. prend des ordres : il faut ouvrir la route jusqu'à l'aéroport de Bonn, à moins d'une quinzaine de kilomètres de Godesberg. Le Führer ne veut pas perdre de temps. Bientôt les moteurs pétaradent : les deux estafettes démarrent, les puissantes motos noires s'inclinent jusqu'à paraître devoir se renverser, puis il semble que leurs conducteurs réussissent à les redresser d'un coup de reins et rapidement elles ne sont plus signalées que par deux cônes blancs qui crèvent la nuit et par le pointillé de deux lumières rouges dansantes.
Dans le hall de l'hôtel, l'agitation est fébrile. Walther Breitmann court frapper aux chambres du premier étage où déjà quelques chefs nazis s'étaient retirés. Il les a prévenus du départ imminent du Führer. Ils sont là, les manteaux de cuir jetés sur les fauteuils, parlant à haute voix puis se taisant brusquement quand paraît Adolf Hitler. Celui-ci va et vient, passant de la terrasse au hall ; il a, à ses côtés Goebbels, et les deux hommes ne cessent de parler, parfois à voix basse, Goebbels agitant les mains, regardant le visage du Führer pour y guetter une approbation. Mais le Chancelier ne tourne pas le visage vers le ministre de la Propagande. Il marche, légèrement penché en avant, il interrompt Goebbels, il parle à son tour, les yeux brillants, le visage contracté. « Un putsch, répète-t-il, contre moi. » Joue-t-il la comédie de la surprise avec Goebbels, Goebbels qui sait que les nouvelles transmises depuis Berlin par Himmler et depuis Munich par Wagner sont fausses ? Hitler l'ignore-t-il vraiment, vient-il réellement de prendre sa décision ou bien agit-il en comédien consommé qu'il est capable d'être ?
Il parle, dressant un bilan, refaisant l'histoire à sa manière, préparant déjà ce discours qu'il lui faudra prononcer un jour. « Depuis des mois, continue-t-il, il y a eu de graves discussions entre Rœhm et moi ».
Hitler s'arrête : il prend les dignitaires du parti à témoin. Viktor Lutze, parmi eux, se tient au garde-à-vous, respecteux.
« C'est alors que, pour la première fois, j'ai conçu des doutes sur la loyauté de cet homme ».
Brückner apparaît, il annonce qu'à l'aéroport de Bonn-Hangelar l'appareil personnel du Führer sera prêt à décoller dans moins d'une heure. Hitler ne semble pas l'entendre, tout à son accusation, à la justification de la décision qu'il vient de prendre et qui est déjà hors de lui, devenue un acte, avec cet avion dont les mécaniciens vérifient les moteurs dans la lumière métallique des projecteurs, avec ces hommes du Gruppenführer Sepp Dietrich qui maintenant sont dans la cour de leur caserne à Kaufering, rassemblés par leur chef qui leur donne les consignes. Jeunes S.S. aux uniformes noirs, ils écoutent, engourdis dans leur sommeil brisé, à peine réveillés par la nuit dont la fraîcheur les saisit. La décision de Hitler est devenue un acte qui prend davantage vie à chaque minute, qui bientôt recouvrira toute l'Allemagne.
Hitler parle, cependant que Brückner et les serveurs de l'hôtel portent les manteaux et les serviettes noires vers les voitures. Il parle, paraissant ne pas pouvoir cesser. C'est qu'il y a toutes les années depuis qu'il a rencontré Rœhm, les mois depuis la prise du pouvoir, et surtout ce mois de juin qui meurt en ce jour qui commence, ce jour qui n'a qu'une heure, ce mois de juin 1934, qui vient se condenser et s'ordonner dans cette première heure du samedi 30 juin.
Car chaque heure de ce mois, chaque jour a poussé une pièce, pion, fou, tour, comme si dans cette partie commencée depuis des mois, qui avait connu tant de retournements, le mouvement sur l'échiquier allemand était désormais inéluctable. Chaque heure, chaque jour de ce mois, mêlant les intrigues et les hommes, faisant surgir de nouvelles données qui allaient toutes s'ordonner dans ce matin du samedi 30 juin, vers 1 heure. Depuis 30 jours, chaque jour de juin, une pièce.
L'OBERFUHRER EICKE
Au camp de Dachau, les détenus attendent, rangés entre les baraques de bois, regardant droit devant eux, par-dessus les hauts barbelés, la campagne plate et grise : c'est l'aube du vendredi 1er juin. L'appel s'éternise plus que de coutume. La boue et la fange des allées collent à leurs sabots. Ce matin, après plusieurs heures d'immobilité, l'Oberführer Eicke, commandant du camp de concentration de Dachau, les passe en revue. Noir, sec, sinistre, il est le destin de cette vie réglée comme une horloge macabre. Mais il s'attarde peu, soucieux de réunir au plus vite ses chefs de groupe. Il vient de recevoir l'ordre de Heydrich d'avoir à entraîner ses hommes pour une action rapide contre les S.A. de Munich, de Lechfeld, de Bad Wiessee. Les chefs de groupe S.S. ne posent aucune question : à Dachau, les S.S. sont, encore plus qu'ailleurs s'il est possible, disciplinés et aveugles. Ils sont vraiment les membres des troupes à tête de mort, les Totenkopfverbände, qui obéissent, tuent, chantent. Heydrich en s'adressant aux hommes du camp de Dachau a choisi en connaissance de cause.
L'Oberführer Eicke est un homme comme les aime Heydrich, un bon officier dévoué aveuglément à la personne de ses chefs. Il a confectionné les listes d'hommes à liquider sans poser de questions, il connaît les lieux, il obéit et avec ses chefs de groupe il dresse des plans pour une action rapide qui saisira dans leurs nids les S.A.
A Munich aussi, les sections S.S. reçoivent les consignes de Heydrich et se préparent à l'opération. Le jour seul n'est pas fixé, mais les ordres de Heydrich sont formels : il faut se tenir prêt comme si l'action pouvait être déclenchée dans quelques heures. Le chef du S.D. et de la Gestapo et le Reichsführer S.S. Himmler paraissent sûrs de leur fait. Eicke dès le samedi 2 juin entraîne ses hommes et il attend, cependant que les S.S. Totenkopf, nerveux, irrités, se vengent sur les détenus.
Mais qui sait ce qui se passe au camp de Dachau le 1er et 2 juin 1934 ? Dachau n'est encore qu'une petite ville tranquille dont les Allemands et le monde ignorent le destin sinistre. Les guides signalent qu'elle est à 9 kilomètres à l'ouest de Schleissheim là où se dressent les deux magnifiques châteaux des XVIIeme et XVIIIeme siècles dont l'un ressemble à Versailles. Dachau n'est qu'un lieu privilégié qui domine la plaine bavaroise. On peut apercevoir les Dachauer Moos (marais de Dachau) que les peintres aiment à fréquenter parce que les verts, les gris, les bleus, les blancs, le ciel, la terre et l'eau se mêlent et changent. Qui connaît les ordres de l'Oberführer Eicke et pourquoi se soucier de ces détenus qui, le samedi 2 juin, s'alignent devant les S.S., les doigts et les bras tendus dans un garde-à-vous immobile, le calot à la main ? Et les coups tombent et les corps.
Pourtant même à Dachau, le dimanche 3 juin, le repos est respecté. Les détenus sont dans les baraques, ils somnolent dans la tiédeur et les odeurs, voyant se dérouler ce jour, ce seul jour de fausse liberté, un jour dur et sans joie parce que la pensée peut construire ses souvenirs et ses tourments, mesurer le temps passé et à venir, écouter le silence du monde et les Heil Hitler de l'Allemagne.
Des détenus catholiques prient, ignorant que ce jour-là à Fulda, les évêques du IIIeme Reich sont rassemblés en réunion plénière.
LES FAUX PROPHETES.
Dans la petite ville, belle comme un musée, la messe a été célébrée au Dom, qui dresse ses deux tours baroques, son dôme, dans la légèreté bleutée de cette matinée de juin. Au loin, la Rhôn, le Vogelsberg sont enveloppés de brume. La messe est solennelle comme si les siècles s'étaient arrêtés au temps de la foi triomphante. Mais la foi triomphe-t-elle jamais ? Au-dessous du chœur, la chapelle Saint-Boniface renferme les reliques du saint martyrisé par les païens en 755. Boniface : l'apôtre de l'Allemagne. Les évêques communient certains s'agenouillent sur le sol dallé, comment ne penseraient-ils pas au martyr alors qu'un Ordre noir aux rites païens s'est établi en Allemagne ? On reconnaît, dans ses vêtements sacerdotaux, Mgr Faulhaber, primat de Bavière, vieil homme qui, sous l'or et la parure, ressemble déjà à l'une de ces statues de bois doré qu'on trouve dans les églises de l'Allemagne du Sud.
A côté de Mgr Faulhaber se tient un homme jeune, au visage énergique que l'or de sa dignité ne vieillit pas. Le regard est vif, animé, il tourne souvent la tête vers les fidèles, d'un mouvement brusque : c'est le nouvel évêque de Berlin, Mgr Barres. Depuis son intronisation, il y a moins de six mois, en janvier, la Gestapo l'a mis sous surveillance et Heydrich lit personnellement les rapports qui le concernent. Mgr Barres a, en effet, rassemblé des militants catholiques ; ses lettres pastorales condamnent les excès, les violences. Souvent, devant l'évêché, vient se ranger la voiture d'un haut fonctionnaire du Reich, le docteur Klausener. Il est directeur général des Travaux publics, catholique pratiquant, homme à principes et proche du vice-chancelier Papen, catholique lui aussi. Depuis des semaines, Klausener est, avec Bose, Jung et d'autres, inscrit sur les listes d'hommes à surveiller de près. Est-il aussi sur les listes établies par Heydrich ? Il voit souvent Mgr Barres, Papen aussi et la Gestapo n'aime pas les coïncidences. Elle a délégué à Fulda quelques-uns de ses agents : ils écoutent, ils notent, ils observent. Le Reichsführer Himmler lui-même, qui fut catholique, dont l'Ordre noir copie l'ordre jésuite, a donné personnellement les consignes. Apparemment pourtant rien ne se passe. Les hommes de la Gestapo traînent dans la vieille cité épiscopale. Après la messe, les évêques se sont retirés, guidés par Mgr Bertram, cardinal-primat de Silésie, qui préside l'Assemblée.
Tout est calme jusqu'à ce qu'éclate la première phrase du mandement :
« Gardez-vous des faux prophètes ! »
Puis le texte des évêques dénonce les « athées qui, la main levée, mènent consciemment la lutte contre la foi chrétienne ». A l'heure où socialistes, communistes, juifs, répondent à Dachau et dans d'autres camps à l'appel du soir, au milieu des aboiements des chiens et des S.S., cette phrase ne peut viser que les nazis. Elle ne peut être dirigée que contre les hommes de l'Ordre noir qui rétablissent pas à pas un culte païen, sonnant dans des trompes venues des lointains pays germaniques, et faisant renaître la mythologie nordique d'avant l'évangélisation.
Au n° 8 de la Prinz-Albrecht-Strasse, Himmler et Heydrich sont inquiets. Le standard du siège de la Gestapo à Berlin qui est équipé en table d'écoute ne cesse de noter des communications entre Fulda et différentes villes d'Allemagne ; puis, à Berlin même les agents de la Gestapo notent que de nombreuses personnalités catholiques se répètent le texte du mandement des évêques. L'Eglise catholique, longtemps passive, se dresserait-elle contre le régime ? Gœring est averti. De longs conciliabules ont lieu. Est-ce une opération Papen-Hindenburg qui commence ? Peut-être avec l'appui de certains éléments de la Reichswehr : toujours les mêmes généraux, Schleicher, von Bredow ? Quel sera le rôle de la S.A. et de Rœhm ?
La chancellerie du Reich est à son tour mise au courant. Mais cependant que Gœring, Himmler, Heydrich se concertent, Hitler reste à l'écart. Dans le grand bâtiment endormi où les gardes noirs de la Leibstandarte ressemblent à des blocs de granit sculpté, recouverts d'uniformes et de métal, Hitler doit observer le mouvement des hommes et des clans. Hermann Gœring, héros, officier, Junker, lié aux milieux financiers et à la Reichswehr ne pourrait-il être un rival, succéder avec l'appui de certains conservateurs à Hindenburg à la tête d'un Reich sans Hitler ?
LA DERNIERE RENCONTRE.
La nuit du dimanche au lundi 4 juin est longue. Quand se lève le nouveau jour Hitler ne sait toujours pas comment s'attacher définitivement ces hommes puissants de l'armée, de l'industrie, ces hommes qu'il méprise et qu'il craint. Faut-il payer leur appui en sacrifiant la Sturmabteilung, en appliquant jusqu'au bout le pacte du Deutschland, ou au contraire conserver une S.A. domestiquée mais suffisante, une S.A. épée et bouclier, prétexte, moyen de chantage ? Mais peut-on longtemps ne pas passer aux actes alors que tout s'accélère ?
Dans la matinée de ce lundi, le secrétaire général à la présidence, Meissner, appelle la chancellerie du Reich. Le Feldmarschall va mal. Il quitte Berlin aujourd'hui même pour Neudeck ; là-bas, dans la plaine apaisante et grise, peut-être résistera-t-il mieux au temps. Mais Hitler n'est pas dupe : pour Hindenburg, c'est le dernier voyage. Le vieux guerrier d'un autre siècle va se coucher sur sa terre de Neudeck, force et foi de sa caste. Les ordres partent de la chancellerie pour que le voyage de Hindenburg soit solennel, puis Hitler s'enferme et à nouveau ce ne peut être que la méditation sur l'avenir qui s'avance jour après jour. A Neudeck, autour du vieillard qui s'endort, il y aura Meissner l'ambitieux, le dévoué Meissner en qui le Führer peut avoir confiance, et à ses côtés, Oskar von Hindenburg, qui pense à sa terre, à son rang dans l'armée, Oskar qu'on peut tenir par quelques hectares et quelques grades. Mais ces hommes ne seront fidèles qu'autant qu'ils sauront que le Führer conserve solidement le pouvoir et le conserve seul. Et de nouveau le choix se présente. On avertit Hitler que von Papen accompagnera Hindenburg à Neudeck et qu'il y demeurera quelques jours ; Papen, renard sans courage mais qui peut devenir l'emblème d'un clan — les Jung, les Klausener, les Bose, les Tschirchsky — qui a fait le testament de Hindenburg et que le vieillard cherche toujours comme un fils, un successeur, un ami, à travers sa mémoire gagnée par la mort.
A la gare centrale de Berlin, rituellement, la garde rend les honneurs cependant que part Hindenburg pour ne plus revenir. Hitler brusquement prend une décision : Brückner téléphone, un motocycliste quitte la chancellerie. Ernst Rœhm est convoqué en audience par le Führer, immédiatement, aujourd'hui lundi 4 juin 1934. Au siège de la Gestapo, la nouvelle inattendue déferle de bureau en bureau jusqu'à Heydrich et Himmler. Faudra-t-il rentrer les listes, annuler les ordres donnés à l'Oberführer Eicke, trancher tous ces liens, ces marchés passés avec Hermann Gœring, avec von Reichenau ? Que médite Hitler ? Lundi sombre au n° 8 de la Prinz-Albrecht- Strasse : le Führer peut toujours faire volteface, passer un nouveau contrat avec Rœhm. Il faut attendre, ne rien précipiter. Heydrich impassible, classe des fiches, lit des rapports d'écoutes téléphoniques, convoque ses agents au sein de la Sturmabteilung. Il faut savoir.
Dans un claquement de bottes à l'entrée de la chancellerie du Reich, la garde salue Ernst Rœhm. Il répond joyeusement, assuré, marchant vers sa revanche. Il sourit à l'Oberleutnant Brückner cependant que le Führer détendu, amical, avance vers lui, comme au bon vieux temps de la camaraderie.
Puis la haute porte noire du bureau du chancelier se referme sur les deux hommes.
Cinq heures plus tard, Brückner s'incline devant deux hommes las qui sortent ensemble du bureau : Hitler est voûté, la fatigue est la seule expression qui se lit sur son visage. Chez Rœhm, les heures passées à discuter se sont marquées en plaques rouges sur son cou et sur ses joues. Dans le hall de la Chancellerie, Rœhm marche lentement, seul, vers sa voiture.
Plus tard, le 13 juillet 1934, quand Rœhm ne sera plus qu'un cadavre, Hitler parlant sous les lumières vives de l'Opéra Kroll aux députés et à l'Allemagne, Hitler seul témoin, racontera cette dernière rencontre. « Au début de juin, dira-t-il, je fis une dernière tentative auprès de Rœhm. Je le fis venir et eus avec lui un entretien qui dura près de cinq heures. » Le dialogue réel nous ne le connaîtrons pas, mais peut-être dans le récit du Führer passe-t-il un peu de la vérité de cette dernière entrevue entre deux hommes qui s'étaient rencontrés quatorze ans auparavant, dont l'un avait contribué à la gloire de l'autre, devenu Führer.
« Je lui dis, continue Hitler, avoir acquis l'impression que des éléments sans conscience préparaient une révolution nationale-bolcheviste, révolution qui ne pouvait qu'amener des malheurs sans nom. Je lui dis aussi que le bruit m'était venu que l'on voulait mêler l'armée à cette action. »
Peut-être Hitler a-t-il réellement lancé les noms de Schleicher et de Bredow, peut-être a-t-il simplement évoqué cette seconde révolution, cette Nuit des longs couteaux dont rêvaient certains S.A. Mais l'essentiel entre Rœhm et lui n'était pas là. Et son vrai propos apparaît quand il raconte :
« Je déclarai au chef d'Etat-major que l'opinion selon laquelle la S.A. devait être dissoute était absolument mensongère, que je ne pouvais m'opposer à la diffusion de ce mensonge, mais qu'à toute tentative d'établir du désordre en Allemagne je m'opposerais immédiatement moi-même et que quiconque attaquerait l'Etat devrait d'emblée me compter comme ennemi ».
Hitler a dû expliquer à Rœhm les vagues dangers qui pesaient sur le IIIeme Reich, sur le Parti, sur lui, Hitler. Les violences des S.A. compromettaient la réputation du Parti, elles l'affaiblissaient
« Je me plaignis aussi amèrement des excès de la S.A. et demandai des sanctions contre les éléments responsables, pour que des millions de braves membres du Parti n'aient pas leur honneur atteint par l'action d'une minorité ».
C'est moins d'honneur que de prudence qu'il s'agit. Rœhm s'est défendu pied à pied montrant qu'il a fait faire des enquêtes, qu'il a châtié déjà, « qu'il ferait le nécessaire pour rétablir l'ordre », attaquant à son tour, démasquant ceux qui veulent nuire à la Sturmabteilung, aux Alte Kämpfer. Puis les deux hommes sont sortis, après cinq heures d'entretien.
LE COMMUNIQUE DE RŒHM
Cependant, quand il justifie, dans son discours du 13 juillet, la répression devant l'Allemagne, Hitler ne dit pas l'essentiel. Dès le mardi 5 juin pourtant le S.D. et la Gestapo sont avertis qu'un accord sur plusieurs points» a été passé entre Rœhm et Hitler. Il ne touche pas au fond de leur opposition, mais il montre que les deux hommes ont conclu une trêve. Heydrich et Himmler, puis von Reichenau, en étudient les termes. Le siège de la Gestapo et la Bendlerstrasse sont en communication permanente. Apparemment tout est clair : ainsi qu'il avait été décidé le 20 avril, la S.A. est mise en congé durant le mois de juillet. Rœhm a déjà fait savoir qu'il allait prendre un repos bien gagné durant le mois de juillet et en riant a annoncé qu'il irait à Bad Wiessee, faire une cure pour ses rhumatismes et ses blessures. Aux chefs S.A. qui l'attendaient avec impatience, il a simplement déclaré que Hitler voulait dissiper les malentendus, qu'il rencontrerait tout l'Etat-major de la Sturmabteilung à Wiessee même, avant le départ en congé de la S.A., pour faire le point sur l'avenir du mouvement Rœhm n'a fait aucun autre commentaire. Il a parlé de Wiessee qu'il connaît bien, du lac, des eaux thermales. Déjà il délègue ses pouvoirs au Gruppenführer von Krausser, son adjoint à l'Etat-major de la S.A. Ses paroles, cette décision sont connues dès le mercredi 6 au siège de la Gestapo. Les agents de Heydrich en service chez les S.A. font leur rapport : les chefs de la Sturmabteilung ont tout accepté. Les uns, un peu inquiets, se demandent si leur mise en congé n'annonce pas un putsch de la « Reaktion » contre Hitler ; les autres, les plus nombreux, se réjouissent. Les vacances, n'est-ce pas aussi l'un des avantages que donne le pouvoir !
Karl Ernst, le commandant S.A. de Berlin, l'ancien portier d'hôtel est le plus heureux. Il s'est lancé dans un long rêve à haute voix. Il parle de soleil, d'îles, d'océan comme un nouveau riche satisfait, il prépare son voyage de noces — il vient de se marier et Hitler a été son témoin — les Canaries, Madère, pourquoi pas ? Il demande qu'on lui réserve un passage sur un paquebot en partance de Brème à la fin du mois de juin. Le Gruppenführer Georg von Detten, chef du service politique de l'Etat-major S.A. prend ses dispositions pour se rendre à Bad Wildungen, une petite et charmante station thermale, entourée de parcs et située sur la Wilde, un affluent de l'Eder. Là, à quelque cent cinquante kilomètres de Cologne, il pourra lui aussi soigner ses rhumatismes. D'autres préparent des voyages à l'étranger ; certains louent des chambres, des maisons pour leurs familles. Tous les rapports convergent et font naître l'inquiétude au 8, Prinz-Albrecht-Strasse : il sera difficile d'accuser ces hommes absents, en vacances, de préparer un putsch. Le piège monté minutieusement par Heydrich, Himmler, Gœring, le piège approuvé par von Reichenau risque de ne pas fonctionner si on laisse la S.A. partir en congé durant le mois de juillet. Pour la détruire il faut frapper avant la fin du mois de juin, il faut convaincre Hitler avant le samedi 30 juin.
Heydrich et Himmler étudient toutes les possibilités d'action. C'est alors que, dans la soirée du jeudi 7 juin, est transmis au siège de la Gestapo le texte d'un communiqué de l'Etat-major de la Sturmabteilung. Il doit être publié dans les heures ou les jours qui viennent (il le sera le 10 juin par la National Zeitung). Heydrich est le premier à le lire et immédiatement avec cette intelligence en éveil que donne la chasse, il voit tout le parti qu'on peut tirer de cette proclamation où l'orgueil et l'imprudence d'Ernst Rœhm éclatent.
« J'espère, écrit Rœhm, que le 1er août, la S.A. bien reposée et pleine d'une vigueur nouvelle sera prête à remplir les glorieuses missions qu'elle doit au Peuple et à la Patrie. Si les ennemis de la S.A. espèrent ne pas la voir revenir, ou n'en voir revenir qu'une partie, qu'ils profitent de leurs illusions pendant quelque temps. Le jour venu, et dans la forme qui se révélera nécessaire, ils recevront une réponse adéquate. La Sturmabteilung est, et restera le destin de l'Allemagne ». La dernière phrase claque comme une gifle : Hitler n'a pas convaincu Rœhm. Le chef d'Etat-major, l'officier de tranchée aux manières rudes n'accorde qu'un sursis. Il n'a renoncé à aucune de ses ambitions.
Dans la nuit du jeudi 7 juin les voitures noires de la Gestapo s'arrêtent devant la résidence de Hermann Gœring. Les jambes largement écartées, le corps lourd dissimulé par une tenue blanche, les bagues brillant à ses doigts, le ministre-président Gœring accueille les deux hommes discrets : Himmler, terne, le visage insignifiant qu'ont souvent les fanatiques, Heydrich, mince, glacial. Ils apportent le communiqué de Rœhm, Rœhm qui vient de se découvrir trop tôt, en lansquenet bavard et aventureux, joueur et téméraire. La Bendlerstrasse est avertie, puis la Chancellerie.
Le Führer se tait, impénétrable, inquiétant par son silence. Himmler, Heydrich, Gœring accumulent les indices : les armes, les troubles en Prusse provoqués par les S.A., les liaisons avec la France, avec Schleicher, Bredow. Himmler lance aussi le nom de Gregor Strasser : il serait de la conspiration. Von Alvensleben, le président du Club des seigneurs, dont Papen est un membre éminent, aurait pris contact avec les conjurés. Tout est prêt. Ernst à Berlin, Heines en Silésie, Hayn en Saxe, Heydebreck en Poméranie, tous ces Obergruppenführer de la S.A. font partie du complot. Et le Standartenführer Uhl a été désigné pour abattre le Führer.
Hitler lit les rapports, écoute les demi-confidences, mais ne se décide pas. Heydrich, Himmler, Gœring se sont livrés, ils sont prêts. Mais le Chancelier Hitler ne dit rien.
A la Bendlerstrasse, on s'interroge. L'attitude de Hitler sème le doute. Le pacte du Deustchland sera-t-il respecté ? Blomberg, Fritsch, Reichenau se concertent Les messagers apportent des plis au siège de la Gestapo et Reichenau lui-même, général de la Reichswehr, n'hésite pas à rencontrer Lutze et Himmler, à revoir ce dernier au 8, Prinz-Albrecht-Strasse. Les voitures de la Gestapo et celles de l'armée sont souvent aperçues, côte à côte devant le siège de la Gestapo ou celui de l'Etat-major. Dans la nuit du vendredi 8 au samedi 9 juin, un élément nouveau intervient : l'immeuble de la Bendlerstrasse est brusquement mis en état d'alerte. Des patrouilles circulent sur le toit du ministère, des camions de la Reichswehr chargés de soldats armés jusqu'aux dents stationnent Bendlerstrasse et sur les quais voisins. Des voitures de la Gestapo surviennent aussi. Le lendemain les journaux ne mentionneront pas l'incident. Il est pourtant grave : l'armée a craint un coup de main des Sections d'Assaut. Dans la journée quelques rixes ont opposé des officiers de l'armée à des hommes de la Sturmabteilung. Or, l'armée est inquiète : toute la caste est atteinte dans son honneur car dans les heures précédentes une enquête de police a prouvé que Mesdemoiselles von Natzmer et von Iéna, Madame von Falkenhayn, filles ou parentes de généraux glorieux, sont gravement compromises dans une affaire d'espionnage au bénéfice de la Pologne. On vient d'arrêter un élégant Polonais, ancien officier de l'armée allemande, Sosnowski, qui, par l'intermédiaire de ces jeunes femmes employées dans l'immeuble austère de la Bendlerstrasse a obtenu communication de documents secrets. Le capitaine de la Reichswehr responsable des documents s'est donné la mort, bien qu'il fût innocent : un officier de la Reichswehr a le sens de l'honneur. Peut-être la S.A. voulait-elle profiter de l'incident pour déconsidérer la Reichswehr, ameuter les Chemises brunes autour du Reichswehministerium, entraîner Hitler dans une action surprise ?
Le matin du 9 juin pourtant les cordons de soldats qui stationnaient dans la Bendlerstrasse sont retirés : l'assaut des S.A. n'a pas eu lieu. Mais les généraux Blomberg et Reichenau se souviendront de cette nuit du début du mois de juin 1934.
2
SAMEDI 30 JUIN 1934 Godesberg. Hôtel Dreesen.
1 heure 15 (du dimanche 10 juin au samedi 16 juin 1934)
VERS BONN
Samedi 30 juin 1 heure 15. Les voitures se sont rangées devant le perron de l'hôtel Dreesen. Hitler et Goebbels montent côte à côte dans la première des Mercedes, à l'arrière ; Brückner s'installe à l'avant, à côté du chauffeur. La voiture du Chancelier démarre aussitôt. L'Obergruppenführer S.A. Viktor Lutze, le chef du service de presse de Hitler, Otto Dietrich, d'autres chefs nazis se répartissent au hasard dans les voitures noires qui s'ébranlent. Direction : l'aéroport de Bonn-Hangelar. La route après quelques courbes larges au milieu des vignes qu'on aperçoit basses, trapues, dans la lueur des phares, est une longue ligne droite dans la plaine alluviale. Les lourdes voitures s'y lancent, laissant les dernières villas de Bad Godesberg, abordant déjà la légère déclivité qui annonce Hochkreuz, faisant parfois jaillir des gerbes d'eau, flaques demeurées sur la route depuis la grosse averse tombée il y a quelques heures, alors que rien encore n'était définitif, que le choix de Hitler n'avait pas encore donné la liberté d'agir à Himmler, à Heydrich, à Gœring.
A cette heure, alors que Hitler roule vers Bonn, Gœring a déjà reçu la nouvelle de la décision du Führer. La Gestapo l'a prévenu immédiatement Dans son palais présidentiel, entouré de cordons de police depuis le début de l'après-midi du 29 juin, protégé par des nids de mitrailleuses, Hermann Gœring se sent à l'abri Dans une pièce faiblement éclairée du palais, le conseiller Arthur Nebe, haut fonctionnaire de la police criminelle, sommeille ; depuis 14 heures, Gœring lui a confié la tâche de veiller sur sa personne. Dans l'après-midi, il a exercé une filature de protection, suivant Gœring et sa femme Emmy qui, très simplement, innocemment, sont allés faire des achats — de luxe comme à l'habitude — dans un des grands magasins de la Leipzigerstrasse. Curieuse mission pour Nebe que son rang n'appelle ni à des filatures, ni à des fonctions de garde du corps : mais tel est le nouveau régime. Maintenant Nebe somnole, entendant les sonneries ininterrompues du standard téléphonique du ministère, les pas des courriers, les ordres qui commencent à retentir dans le grand hall du palais présidentiel de Hermann Gœring.
KARINHALL
Ce bâtiment lourd, pompeux, Gœring a essayé de le rendre fastueux, selon ses habitudes de mégalomane qui partout laisse la marque de sa démesure. Nebe avait été chargé le dimanche 10 juin d'assurer la protection de Karinhall, lors de la pendaison de la crémaillère. Dans la propriété baroque où s'entassent les toiles de maîtres, les dépouilles de chasse, les portraits de Frédéric le Grand et de Napoléon, Gœring avait réuni une quarantaine de personnes : hauts dignitaires du régime et diplomates.
Parmi eux, visitant la chambre des cartes, la chambre d'or, la chambre d'argent, la bibliothèque, la salle de cinéma, le gymnase, Sir Eric Phipps, ambassadeur du Royaume-Uni, observe de son regard ironique de Britannique, membre de l'Establishment, le gros Hermann Gœring, ministre-président, qui change de costume plusieurs fois au cours de la soirée. Tour à tour vêtu « d'une tenue d'aviateur en caoutchouc, chaussé de ses bottes à retroussis, un large couteau de chasse à la ceinture », puis apparaissant en tenue de tennis, cherchant à réaliser sous les yeux de ses invités l'accouplement d'un bison et d'une vache. « Le bison, raconte Phipps, quitta sa stalle avec la plus grande répugnance et, après avoir considéré la vache d'un air empreint de tristesse, il essaya de faire demi-tour ». Pour finir Gœring fait visiter le caveau qu'il destine au cercueil de sa première femme, Karin.
Arthur Nebe avait été témoin de ces fastes démesurés. Le bruit et les allées et venues dans le ministère achèvent de le réveiller. Ils lui confirment l'impression que la nuit qui commence est lourde d'événements, la nuit que son ami H.B. Gisevius et lui ont prévue. Nebe a promis d'appeler Gisevius au téléphone — c'est un haut fonctionnaire du ministère de l'Intérieur de la police d'Etat — si « quelque chose » intervenait dans la nuit. Les deux jeunes fonctionnaires de la police sont en effet réticents à l'égard du nazisme et placés comme ils le sont, là où arrivent les informations, ils « sentent » depuis des semaines monter la tension entre les clans : l'explication avec les S.A. de Rœhm leur semble inéluctable. Ils attendent, ils observent : les rapports de police qu'ils examinent au ministère et qui leur parviennent de toutes les villes d'Allemagne montrent, jour après jour, que les hommes, les groupes ne se tolèrent plus.
Le dimanche 10 juin à Halle, dans le cœur de la ville, près de l'université, on inaugure le musée de la Révolution nationale-socialiste. Des anciens combattants appartenant à l'organisation nationaliste du Stahlhelm (les Casques d'acier) se présentent en groupes à l'entrée du bâtiment. Sur les marches, des S.A. sont là, sur deux rangs, agressifs. Ils interdisent l'entrée du musée à tous ceux qui portent un autre insigne que celui du Parti. Les anciens combattants protestent, certains sont en chemise brune, mais les S.A. sont formels : le préfet de police de Halle a pris un arrêté: un autre insigne que celui du Parti « serait une insulte à un mouvement dont ce musée rappelait les gloires et auquel ils n'avaient pas voulu participer ». Comme des membres des Casques d'acier essaient de pousser les S.A., de franchir leur barrage, une bagarre éclate, courte, mais dure. Les Casques d'acier sont repoussés : qu'ils enlèvent leurs insignes et ils passeront. Les protestations des anciens combattants de Halle arrivent à Berlin le lundi 11 juin, mais ce même jour un incident encore plus grave a lieu.
Magdebourg est une ville austère, prussienne avec sa citadelle aux pierres luisantes et verdâtres serrée entre les bras de l'Elbe. La Reichswehr est ici chez elle et la ville est le siège du commandement du IVeme corps d'armée. Le lundi 11 juin, les membres du Stahlhelm se sont rassemblés pour accueillir leur ancien président aujourd'hui ministre du Travail du Reich.
Seldte s'est rallié à Hitler, Seldte a poussé son organisation vers le nazisme. Mais Seldte et les Casques d'acier, à Magdebourg comme à Halle, ne sont pas en faveur auprès des membres de la Sturmabteilung : à entendre les S.A., ces hommes n'ont rien fait pour la conquête du pouvoir et ils ont simplement couru vers le camp vainqueur. Quand le ministre Seldte arrive à Magdebourg, seuls les Casques d'acier et des représentants de la Reichswehr sont là pour l'accueillir. Dans la salle, près du Domplatz, alors qu'il s'apprête à prendre la parole, des S.A. interviennent ; il est bousculé, arrêté. Les hommes de la S.A. entrent dans la salle, dispersent la réunion, Seldte est entraîné, maintenu quelques heures sous surveillance par la Sturmabteilung. Des témoins appartenant à la Reichswehr et aux Casques d'acier ont essayé en vain de s'interposer, puis ils ont tenté de prendre contact avec le préfet de police, qui est aussi le général de la Sturmabteilung, Schragmuller. Le général-préfet est introuvable. Avec des sourires ironiques, son Etat-major répond qu'il est en tournée d'inspection ; quand les témoins insistent, racontent l'incident, criant presque que Seldte est ministre du Reich, on leur déclare tout ignorer de l'affaire. Dans son commentaire, le général Schragmuller se contentera de déclarer que Seldte n'avait pas été reconnu, qu'une enquête était ouverte.
A Berlin, au ministère de l'Intérieur, Nebe, Gisevius et tous ceux qui prennent connaissance de tels commentaires et de tels événements ne peuvent que conclure à la complicité bienveillante du préfet S.A. et à sa volonté de ne pas rechercher les coupables. Pourtant, ce même lundi 11 juin, le journaliste Erich Seipert, qui passe pour bien informé et dont les articles reflètent l'opinion du gouvernement du Reich, fait paraître un article intitulé « Sturmabteilung et désarmement », qui laisse entendre que les relations entre la S.A., la Reichswehr, le Parti, sont excellentes et que cela annonce une période de paix pour l'Allemagne. Manifestement dans les milieux proches de Hitler on essaye de rassurer l'opinion, peut-être même veut-on faire comprendre aux différents clans que le Führer reste partisan d'un accord entre tous ceux qui l'ont soutenu.
Rien d'étonnant donc si le mardi 12 juin aucun des journaux allemands ne fait mention des incidents de Halle ou de Magdebourg. Mieux, ce mardi une rencontre qui n'est connue que de quelques personnes marque que rien n'est encore tranché.
RŒHM ET GOEBBELS
C'est au début de la matinée que le propriétaire de la brasser Nürnberger Bratwurstglökl am Dom, située au n° 9 de la Frauenplatz à Munich, reçoit un visiteur qui lui demande de réserver une salle particulière pour la soirée, deux personnalités importantes devant s'y rencontrer. Le propriétaire comprend immédiatement qu'il s'agit de membres du Parti et il confirme qu'on peut compter sur la salle et sur son absolue discrétion.
La brasserie Bratwurstglöckl est bien connue à Munich : ses saucisses grillées sont célèbres dans toute la ville. Placée sur cette admirable Frauenplatz où convergent quatre rues, elle fait face à l'un des côtés de l'église Notre-Dame, la Frauenkirche, dont la raide grandeur, l'austère dessin sont un peu corrigés par la rougeur des briques et le blanc du marbre des pierres tombales insérées dans la façade. C'est un îlot du vieux Munich : la Frauenkirche a été construite au XVeme siècle.
Au soir du mardi 12 juin, deux voitures, à quelques minutes d'intervalle, s'arrêtent dans l'ombre de l'église et stationnent au coin de la Filserstrasse, là où la rue marque, débouchant sur la place, un décrochement. De chaque voiture un homme est descendu et seul il a gagné la brasserie. Deux hommes en civil, l'un portant un large chapeau, l'autre tête nue ; l'un gros, vêtu sans élégance, la démarche lourde, l'autre boitillant, fluet. Dans le brouhaha de la salle enfumée où des chants d'après boire sont repris en chœur par l'assistance, cependant que le martèlement de dizaines de grosses chopes sur les tables de bois rythme les refrains, les deux hommes sont passés inaperçus. Un maître d'hôtel qui les attendait tout au fond, les a guidés vers la salle retenue que ferme une lourde porte : les bruits ne parviennent qu'assourdis. Le maître d'hôtel, quand les deux hommes se rejoignent qu'ils se serrent la main, ne peut que reconnaître Ernst Rœhm et Joseph Goebbels, qui, seuls, assis en face l'un de l'autre dans cette brasserie munichoise, buvant de la bière, vont parler longuement. Avant d'entrer pour apporter les commandes, le maître d'hôtel frappe et attend un long moment. La discrétion est de règle. La Gestapo pourtant qui suit Rœhm à la trace et qui piste aussi toutes les personnalités importantes du régime a pu faire un rapport. Pour Heydrich, Himmler et Gœring, la nouvelle est grave, de celles qu'il faut soupeser, évaluer, pour en tirer les conséquences : Goebbels agit-il de son propre chef, choisissant le camp de Rœhm, retrouvant son passé de nazi de « gauche », prompt à la démagogie, ou bien se contente-t-il à sa manière prudente et habile de flairer le terrain avant de prendre son parti, ou bien encore est-il l'envoyé de Hitler, le Führer ne voulant pas perdre le contact avec Rœhm, Hitler n'ayant pas, lui non plus, encore choisi définitivement de quel côté il va pencher; répression, liquidation comme le veulent la Gestapo, la S.S. et la Reichswehr ou bien compromis ?
Or, dans la soirée du mercredi 13 juin le S.D. et la Gestapo font parvenir au 8, Prinz-Albrecht-Strasse une nouvelle information qui semble prouver que Goebbels a agi pour le compte de Hitler : ce qui, pour tous les adversaires de la Sturmabteilung est l'hypothèse la plus grave. L'information est inattendue, spectaculaire même : le Führer a rencontré dans l'après-midi Gregor Strasser. L'ancien pharmacien bavarois, l'ancien chef de la propagande du Parti nazi, celui qui a dirigé la fraction nazie au Landtag de Bavière puis au Reichstag, n'exerce pas, depuis plus de deux ans, de fonctions officielles. Mais il reste un homme dont le nom peut résonner dans le Parti et Adolf Hitler le sait. Peut-être aussi se souvient-il de ce jour où, protestant contre la détention de Hitler dans la forteresse de Landsberg, Gregor Strasser s'était écrié : « L'emprisonnement de ce juste est un stigmate d'infamie pour la Bavière. ». Le visage large, le crâne rasé, le puissant Gregor Strasser, même passif, est encore une ombre trop grande pour Hitler. Heydrich et Gœring le savent bien qui ont inscrit leur ancien camarade sur leurs listes. Mais le Chancelier Hitler semble, face à Strasser, encore disposé à la conciliation. Les agents de la Gestapo rapportent que Strasser a obtenu à nouveau le droit de porter son insigne d'honneur du Parti où est gravé le n° 9. Certains informateurs affirment que Hitler aurait proposé à Strasser le ministère de l'Economie nationale, mais Strasser, sûr — comme Rœhm — de sa position, aurait demandé l'élimination de Gœring et de Goebbels.
Et de qui d'autre encore ? Au siège de la Gestapo, dans le palais présidentiel de Gœring, c'est le silence. Les nouvelles sont là, brutales. Les « conjurés » mesurent le prix qu'il leur faudrait payer un retournement de Hitler. Peut-être aussi Rœhm a-t-il fait établir des listes, peut-être les équipes de tueurs S.A. sont-elles prêtes, réellement, comme déjà s'entraînent les S.S. du commandant de Dachau, l'Oberführer Eicke. Quand un piège est monté il doit s'abattre, saisir l'adversaire, l'écraser, sinon la vengeance vient et le piège se retourne. Plus que jamais, alors qu'il leur semble que Hitler hésite, le Reichsführer Himmler, Heydrich et Gœring sont décidés à agir, à faire pression sur le Führer. Mais Hitler n'est plus à Berlin.
LES CONSEILS DU DUCE
Le jeudi 14 juin c'est, sur le terrain d'aviation de Munich Oberwiesenfeld, une succession d'ordres, de précautions. A 8 h 10, le Führer est arrivé dans sa Mercedes noire. Peu après, descendent d'autres voitures officielles Brückner, Otto Dietrich, Schaub, Hoffmann puis des fonctionnaires de la Wilhelmstrasse. On reconnaît Neurath, le Ministerialrat Thomson, le Legationsrat von Kotze et l'Oberführer directeur du service de presse de Bavière. Hitler plaisante, serre familièrement la main de Bauer son pilote, puis se dirige vers son avion personnel dont les moteurs viennent d'être arrêtés, après un essai. On peut lire sur le haut de la carlingue le nom de l'avion, Immelmann, et sur le fuselage gris le numéro d'immatriculation, 2 600. Ceux qui connaissent bien le Führer décèlent chez lui, malgré sa bonne humeur, des signes de nervosité, un geste fréquent de main vers les cheveux, une démarche saccadée. Il garde son chapeau, à la main et, serré dans un imperméable beige, légèrement voûté, il ressemble à un petit et médiocre fonctionnaire allemand. Pourtant cet homme qui monte l'échelle de fer, que saluent les officiels va rencontrer le chef du gouvernement dont le monde et l'Europe parlent le plus, un homme aux apparences vigoureuses, à la tête rasée, au ton déclamatoire : le Duce Benito Mussolini. Par bien des aspects il a servi de modèle à Hitler et le Chancelier se souvient sans doute de ce jour de 1923 — avant le putsch de novembre, à Munich, imitation de la Marche sur Rome de 1922 — où agitateur politique presque inconnu, il sollicitait du Duce une photo dédicacée que, hautain, Mussolini, refusa d'envoyer. Aujourd'hui, Hitler doit rencontrer Mussolini à Venise.
A 8 h 20 l'avion de Hitler décolle suivi par un deuxième appareil piloté par Schnäbele et qui emporte les différents experts allemands. La discussion, la première entre les deux dictateurs depuis la prise du pouvoir de Hitler, peut être capitale : on doit évoquer l'avenir de l'Autriche, passer en revue les problèmes posés par les rapports entre les deux partis. Surtout, dans les couloirs de la Wilhelmstrasse des réunions discrètes ont eu lieu : des émissaires envoyés par le vice-chancelier Papen, d'autres agissant pour le compte de Gœring ont expliqué que le Duce avec sa grande autorité pouvait conseiller au Führer d'en finir avec l'anarchie au sein de son parti. Des envoyés spéciaux ont gagné l'ambassade allemande à Rome ; là, les diplomates ont écouté, demandé des rendez-vous, vu leurs collègues italiens sûrs et surtout les membres du cabinet du Duce — ils ont à mots couverts parlé de Rœhm, des violences des S.A. : Hitler écouterait sûrement un conseil du Duce — Rien n'a été dit précisément mais les Allemands se sont fait comprendre, maintenant il faut attendre. Le Duce parlera-t-il et le Führer écoutera-t-il ?
Les deux avions s'élèvent lentement Immédiatement on distingue les sommets des Alpes et, fichées au fond des vallées, les petites plaques brillantes des lacs glaciaires. Au bord de l'un d'eux, le Tegernsee qu'on ne peut voir car l'avion a viré sur l'aile vers l'est, la ville de Bad Wiessee où vient d'arriver le chef d'Etat-major, le capitaine Rœhm. Peu à peu, le ciel, d'abord légèrement nuageux, se découvre et, au-delà du Brenner on aperçoit Brixen, les Dolomites. Hitler, comme il a souvent l'habitude de le faire, s'asseoit près du pilote. Il aime l'avion ; ses campagnes électorales ils les a couvertes, allant de ville en ville, dans son avion personnel. Maintenant ses visites d'inspection, il les réalise avec le même moyen, sautant ainsi en quelques heures d'une région à l'autre. Le pilote montre à Hitler le massif blanchâtre de la Marmelata, sorte de château fort naturel, puis les Alpes vénitiennes et bientôt long et sinueux ruban couché dans les teintes sombres, le Pô. Les avions allemands font deux fois le tour des lagunes, descendant chaque fois un peu plus. Des points scintillants apparaissent dans le ciel : ce sont les escadrilles italiennes qui viennent à la rencontre du Führer. Bientôt les avions survolent Murano et le Lido. A 10 heures, ils se posent sur l'aéroport de San Nicolo.
C'est le soleil d'ahord. Puis la foule des officiels italiens, puis Mussolini en grand uniforme, les diplomates, les Squadre fascistes. Le petit groupe des Allemands fait piètre figure. Hitler dans ses vêtements mal coupés paraît encore plus tassé, plus emprunté. Il marche vers Mussolini, lui serre la main avec respect. Le Duce, la poitrine bombée, condescendant, souriant, montre Venise, ruisselante de lumière, Venise dans sa beauté éclatante et séculaire et qu'un printemps léger paraît rendre encore plus étrangère au temps. L'ambassadeur d'Allemagne, von Hassel, salue le Führer, il est de ceux qui ont fait comprendre au Duce qu'il fallait inciter Hitler à remettre de l'ordre dans les rangs tumultueux de la Sturmabteilung.
Bientôt Mussolini et Hitler embarquent dans un bateau à moteur escorté d'une flottille, et les embarcations, au milieu des hululements des sirènes, des cris de la foule, s'engagent dans la lagune ; des torpilleurs où les uniformes des marins tracent des lignes blanches rendent les honneurs aux deux chefs de gouvernement. Puis c'est l'eau noirâtre du Grand Canal, les gondoles fleuries, le Palais des Doges, le Grand Hôtel où va descendre le Führer, la villa Pisani Di Stra où Hitler et Mussolini se retrouvent pour une longue conversation en tête à tête de deux heures. Le Duce a-t-il parlé de Rœhm ? Les diplomates italiens observent le Führer : « Physiquement il a l'aspect très boche, mais quelque chose dans les yeux qui exprime la profondeur de pensée », note le baron Aloisi.
Le soir de cette première visite de Hitler à l'étranger, un grand concert est donné au Palais des Doges « Décor et lustres merveilleux, raconte un diplomate, mais organisation médiocre. De plus, la foule a acclamé le Duce durant tout le concert ce qui produisait une violente cacophonie. La popularité du Duce est immence ». Le Führer, avec un sourire crispé, regarde ces démonstrations désordonnées où l'on semble l'ignorer. Vendredi 15 juin, foules délirantes autour du Führer et du Duce, 70 000 personnes sur la place San Marco, bal à l’Excelsior en l'honneur du chancelier allemand. Samedi 16 juin, au matin, c'est le départ. Le hangar où le Immelmann du Führer est rangé, est décoré aux couleurs italiennes et allemandes, la croix gammée et les faisceaux fascistes s'entremêlent les fanfares jouent puis à 7 h 50, c'est le décollage et deux heures plus tard, les deux avions allemands atterrissent sur l'aéroport de Munich-Oberwiesenfeld. Ici aussi des fanfares, le Deutschland über alles et comme à l'habitude la Badenweilermarsch, la marche préférée de Hitler.
Le Führer semble fatigué, nerveux, un peu déçu : les cris allaient vers le Duce, seigneur tout-puissant d'un pays en ordre. Lui, il n'est apparu que comme un comparse, encore mal assuré. Les conseils de Mussolini — car le Duce a parlé — l'ont irrité. Maintenant, cependant que la voiture roule vers Munich sur la large route au milieu des prés, Hitler sait qu'il retrouve avec l'Allemagne toutes les questions en suspens. Et il sait aussi qu'on le guette.
A Berlin, Heydrich communique déjà à Gœring que le Duce a effectivement dit au Führer qu'il lui fallait rétablir l'ordre sur tout le parti, sur les S.A. Le Duce a évoqué son exemple personnel, les années 24. Alors il a su faire plier les anciens squadristi. L'ordre dans un Etat totalitaire est nécessaire, l'ordre et l'obéissance de tous au Chef. Comment Hitler a-t-il reçu cette nouvelle pression ?
Dans à peine deux semaines les S.A. vont partir pour leur long congé d'un mois. Il faudrait frapper avant Hitler se décidera-t-il à temps ?
3
SAMEDI 30 JUIN 1934 Route de Godesberg à Bonn-Hangelar.
1 heure 30 (dimanche 17 juin 1934)
AGIR VITE
Samedi 30 juin, 1 h. 30. Ce sont déjà les premières maisons de Bonn : les phares éclairent des volets clos et des arbres dont les branches légèrement inclinées par le vent se dessinent sur les murs de ces habitations cossues, villas résidentielles situées loin des fumées de la Ruhr. Les deux motocyclistes ont attendu les voitures à l'entrée de la ville et maintenant qu'elles apparaissent ils démarrent, faisant résonner leurs moteurs dans les rues des quartiers périphériques désertes comme celles d'un village. L'aéroport de Bonn-Hangelar n'est plus qu'à quelques minutes de voiture : à chaque tour de roue le choix de Hitler devient de plus en plus l'inéluctable destin de cette ville, de ce pays qui, profondément, reposent dans cette courte et légère dernière nuit de juin.
Au bord du lac de Tegernsee, l'air est plus vif que dans la vallée du Rhin. Des voitures officielles viennent de quitter la pension Hanselbauer où, comme chaque soir, il y a eu des réunions, des chants. Les chefs S.A. ont bu gaiement. La nuit maintenant est tranquille et déjà sa zone sombre semble être dépassée. L'obscurité doit régresser peu à peu, la dernière section de la garde personnelle de Rœhm qui a veillé jusqu'au départ des convives embarque dans le camion bâché. Le chef d'Etat-major Ernst Rœhm n'a plus rien à craindre de cette nuit qui n'a plus que quelques heures à durer. Bad Wiessee est calme. Seul le bruit du camion qui s'éloigne couvre le froissement du vent et des vagues.
Les voitures ont contourné Bonn par le nord, évitant le centre, abandonnant les bords du Rhin ; passant devant l'ancien château des Electeurs dont l'ombre lourde et massive semble accrocher la nuit ; droit devant, la Poppelsdorfer Allée s'enfonce dans la ville et l'on distingue malgré le faible éclairage les quatre rangées de marronniers d'Inde qui la bordent Les chauffeurs ont ralenti, mais à nouveau ils accélèrent... parce qu'il faut faire vite, parce que le Führer a hâte de rejoindre l'avion qui attend, hâte d'en finir avec ce mois, hâte d'en finir avec les hésitations qui, après son retour de Venise, n'ont pas cessé de le hanter.
LES INQUIETUDES DE HITLER
Au contraire il semble même qu'elles aient augmenté malgré les conseils de Mussolini. Les journaux allemands sont pourtant pleins en ces vendredi et samedi 15 et 16 juin d'articles sur l'importance de la rencontre du Duce et du Führer, mais Hitler reste inquiet. Tous ceux qui le rencontrent notent sa nervosité. Rentré le 16, Hitler s'installe à Munich à la Maison Brune. Là, il se fait longuement commenter le procès des meurtriers de Horst Wessel. Ce S.A. est devenu un symbole du nouveau régime : la jeunesse nazie chante le Horst Wessel Lied et les opposants, à l'étranger, affirment que Horst Wessel n'a pas été abattu, comme l'affirment ses camarades, dans une bataille avec des communistes mais au terme d'une querelle de souteneurs. Ce qui est sûr, c'est qu'un soir de janvier 1930, des hommes ont tué Horst Wessel chez lui, au n° 62, Grosse Frankfurt Strasse. Aujourd'hui deux d'entre eux, Sally Epstein, 27 ans, et Hans Ziegler, 32 ans, sont jugés. Le meurtrier Höller a déjà été liquidé par les S.A. et d'autres accusés sont en fuite. Hitler se réjouit. Le 15 juin, le jugement a été rendu et Epstein et Ziegler ont été condamnés à mort. Mais il demeure insatisfait. Les journaux n'ont pas assez insisté sur la machination internationale qui fait de Horst Wessel un souteneur. C'est l'honneur du régime, l'honneur des S.A. qui est en cause. Et ainsi ce procès ramène Hitler à ses préoccupations. Quand on lui annonce que ce même vendredi 15 juin, André François-Poncet vient de quitter Berlin pour passer deux semaines à Paris, il s'étonne, s'inquiète : la période est précoce pour des vacances d'été. Ce départ ne confirme-t-il pas les rumeurs qui courent sur le rôle de François-Poncet, instigateur d'un complot qui lierait ensemble les chefs S.A., les généraux Schleicher et Bredow, et l'ambassade de France ? François-Poncet habile comme à son habitude ne quitterait-il pas Berlin au moment où ses alliés s'apprêtent à frapper ?
Hitler s'arrête d'autant plus sur cette nouvelle que les rapports de la Gestapo et du S.D. se multiplient, mettant au jour de nouvelles intrigues. Dans l'entourage de Papen, on se préparerait aussi à agir. Le docteur Jung multiplierait les démarches, les pressions morales auprès du vice-chancelier pour le pousser à se dresser contre le régime. Tschirschky ferait pression dans le même sens. Le Reichsführer Himmler et Heydrich ne cessent d'adresser des mises en garde au Führer : ils signalent notamment le 16 juin la visite que Papen doit faire le lendemain, dimanche 17 juin, à l'Université de Marburg. Hitler prend connaissance des rapports, mais que peut-il contre l'intention de Papen sinon parler aussi ? Comme prévu le Führer se rendra donc à Géra et s'adressera aux cadres du Parti et aux organisations nazies dans cette ville industrielle, l'un des vieux fiefs socialistes, aujourd'hui voué à l'hitlérisme.
Ce dimanche du milieu de juin, s'ouvre ainsi comme un moment important de la pièce qui depuis la prise du pouvoir se met en place en Allemagne.
A Berlin, pourtant, c'est la fête : sur le champ d'aviation de Tempelhof, des milliers de personnes sont réunies pour un grand meeting aérien : Hermann Gœring a décidé d'offrir à la capitale du Reich un immense ballon libre mais, retenu par ses obligations ministérielles ou soucieux de donner le change, d'endormir la méfiance et l'hostilité des S.A., il a délégué ses pouvoirs à l'Obergruppenführer S.A. Karl Ernst. Celui-ci, au milieu des fanfares et des acclamations, baptisera le ballon du nom de Hermann Gœring puis, montant dans la nacelle, il le pilotera. Des centaines de mouchoirs, de bras tendus saluent l'envol de ce qui semble symboliser l'union des hommes du Parti, la réconciliation en ce dimanche 17 juin des S.A. avec Gœring. Mais Karl Ernst est inscrit sur les listes de Heydrich en très bonne place, et la fête aérienne n'y change rien.
LE DISCOURS DE MARBURG.
Au moment où Karl Ernst rayonne de joie, éprouvant physiquement l'importance de la situation politique qu'il occupe, lui, l'ancien portier, Franz von Papen, vice-chancelier du Reich, entre dans le grand amphithéâtre de l'université de Marburg. C'est l'une des plus vieilles universités d'Allemagne : au fronton des bâtiments construits dans un style gothique, une date, 1527. Tout ici est calme, paisible. De l'université, on domine la rivière douce qu'est la Lahn, le jardin botanique puis la ville s'allongent ainsi, comme un écrin. L'histoire de l'Allemagne, mystique et rêveuse, puissante et austère, est là, inscrite dans les églises, l'Hôtel de ville, les maisons trapues de la place du Marché, le château où les grands Luther, Zwingle, Melanchthon, les grands réformateurs intrépides se réunirent en 1529 autour de Philippe le Magnanime. C'est adossé à tout ce passé que Papen le catholique va parler.
« Sachant que les premières personnalités du monde intellectuel assisteraient à cette manifestation, écrira-t-il plus tard, je préparai mon discours, esquissé dans ses grandes lignes par Ernst Jung, avec un soin tout particulier. C'était, pensais-je, le meilleur moyen d'atteindre la nation tout entière ».
En fait, Papen n'était pas aussi déterminé qu'il veut bien l'écrire des années plus tard.
C'est dans le train qui le conduit à Marburg, le samedi 16 juin, que le vice-chancelier a lu, pour la première fois, avec soin le discours que Jung a pour l'essentiel rédigé. Il se tourne vers von Tschirschky, son secrétaire, et, à l'expression du regard, ce dernier comprend que Franz von Papen est effrayé. Il faut pourtant qu'enfin Papen se décide à parler. Dans la semaine précédente Jung et Tschirschky se sont rencontrés à plusieurs reprises pour mettre au point avec précision les termes du discours. Il faut frapper juste. Ernst Jung a souvent recommencé ce qui doit être un texte capital, un avertissement lancé à toute l'Allemagne. « Ce discours avait exigé des mois de préparation, raconte Tschirschky. Il fallait trouver l'occasion convenable. Tout devait être préparé avec soin ; minutieusement préparé. Si M. Papen, ajoutera son secrétaire avec une nuance de mépris, s'était rallié à notre point de vue, le discours aurait été prononcé bien plus tôt ».
Mais Franz von Papen n'est pas intrépide. Ses yeux vifs, perçants, révèlent une prudence que certains n'hésitent pas à appeler de la couardise. Ambitieux, il a voulu le gouvernement de Hitler contre le général Schleicher mais depuis quelques mois des craintes ont surgi : les S.A. du Chef d'Etat-major ne risquent-ils pas d'établir le règne de la violence anarchique ou un bolchevisme national qui serait la fin de la caste des seigneurs, des Junker, à laquelle Franz von Papen pense appartenir ? Souvent, rencontrant le Führer à la fin d'une réunion du cabinet, il l'a averti des menaces que font peser les S.A. sur le régime, sur l'Allemagne. Mais il le fait à sa manière, allusive, et le Führer d'un mot rejette les craintes de son vice-chancelier. Et Papen répète ce qu'il a déjà dit aux industriels de la Ruhr : « Hitler, chaque fois, ridiculisait les exigences du chef des Chemises brunes et les traitait d'aberrations sans importance. »
Pourtant, semaine après semaine, la situation empire. « Au mois de juin, ajoute Papen, j'étais arrivé à la conclusion qu'il fallait dresser le bilan de la situation. Mes discussions lors des réunions du cabinet, mes arguments, mes insistances directes auprès de Hitler s'étaient révélées absolument vains. Je résolus de faire publiquement appel à la conscience de Hitler. »
Franz von Papen ne peut plus se dérober : ses collaborateurs sont là, qui le pressent d'agir. « Nous l'avons plus ou moins obligé à prononcer son discours » précisera Tschirschky. Ils arrachent à Papen la promesse d'intervenir à Marburg pour la cérémonie du dimanche 17, où l'université l'a convié. Maintenant Papen roule vers Marburg et il regarde Tschirschky avec inquiétude, puis il prend son crayon et méticuleusement commence « à rayer certaines formules qui lui semblent trop claires ». Tschirschky intervient aussitôt : « Monsieur Papen, qu'est-ce que vous faîtes là ? » demande-t-il. Le vice-chancelier s'est arrêté. Dans le compartiment les deux hommes sont seuls : les collines défilent, boisées, coupées de gorges qui entaillent ce cœur cristallin de l'Allemagne. Bientôt ce sera la vallée de la Lahn, Marburg. Papen regarde Tschirschky, il interroge silencieusement son secrétaire. Tschirschky ne voit donc pas ce que fait Papen, qu'a-t-il besoin de poser cette question ? Entre les deux hommes, il y a un instant de gêne puis Tschirschky lentement révèle à Papen que déjà, par différents canaux, le texte du discours, le texte intégral, insiste-t-il, a été transmis à des journaux étrangers et que, de ce fait, le scandale serait encore plus grand si l'on constatait des différences entre les deux versions. Franz von Papen est aussi un réaliste : il rentre son crayon. Il ne lui reste plus qu'à avancer et à tirer parti de ce courage qu'on lui impose.
Dans le grand amphithéâtre de l'université de Marburg, tout le monde est debout quand Franz von Papen pénètre en cette fin de matinée du dimanche 17 juin. Pas une place n'est libre sur les gradins. Dispersés, isolés, on remarque à peine des hommes en chemise brune, un brassard nazi sur la manche ; peu nombreux, ils paraissent perdus au milieu de ces étudiants, de ces professeurs en toge. Papen toussote à plusieurs reprises puis, dans le silence le plus absolu, commence sa lecture :
« Il paraît, dit-il, que mon rôle dans les événements de Prusse et dans la formation du gouvernement actuel a été extrêmement important Si important par ses effets sur l'évolution de l'Allemagne qu'il m'oblige à juger cette situation plus sévèrement, avec un sens critique plus aigu que la plupart de nos compatriotes ».
Pas un murmure : l'attention se durcit. Papen continue plus lentement, adressant les louanges au nouveau régime puis, une phrase vient : « Convaincu de la nécessité d'une régénération de la vie publique, je faillirais à mon double devoir de citoyen et d'homme d'Etat en taisant les choses qu'à présent il faut dire. » Et les critiques contre les méthodes nazies déferlent alors d'autant plus inattendues que depuis deux ans le pays est assommé sous la propagande, que toutes les plumes et toutes les voix sont serves et que Franz von Papen est le vice-chancelier de ce gouvernement qu'il critique.
« Le ministre de la Propagande (il s'agit de Goebbels) semble enchanté, poursuit Papen, par l'uniformité et la docilité de la presse. Il oublie qu'une presse digne de ce nom doit justement signaler les injustices, les erreurs, les abus ».
« Tout d'abord, racontera Papen, professeurs et étudiants parurent frappés de stupeur. En silence, ils m'écoutèrent énumérer mes accusations, mais je sentis que je les tenais par ma liberté de langage. »
Et Papen continue : le pays se trouve à la croisée des chemins. Dans cette université de Marburg si proche des souvenirs de la Réforme, dans cette ville où vint Luther, il parle des principes chrétiens, « assise de la nation depuis des siècles ». Ces phrases, celles de Jung, éclatent dans l'amphithéâtre comme l'expression enfin libérée de ce que pensent les intellectuels allemands, même les plus conservateurs, depuis l'année 1933 quand d'autodafés en persécutions le pays a commencé de sombrer dans le silence et les acclamations rythmées qui marquent toujours la montée du fanatisme.
« Si nous trahissons nos traditions, si nous ignorons les leçons de notre longue histoire et oublions de tenir compte des obligations qui découlent de notre position européenne, nous aurons perdu la plus belle, la plus magnifique occasion que nous offre ce siècle... Dans un univers en pleine évolution, acceptons les responsabilités que nous impose notre conscience ».
La conclusion, naturellement, n'est pas précise mais elle soulève la salle. « Le tonnerre d'applaudissements qui salua ma péroraison, noyant complètement les protestations furieuses de quelques nazis, parut exprimer l'âme du peuple allemand » écrira Papen. Tschirschky s'incline devant lui, des professeurs lui serrent la main cérémonieusement mais avec chaleur. Papen sourit, il n'a pas encore eu le temps d'avoir peur. « J'éprouvais un immense soulagement, note-t-il. J'avais enfin déchargé ma conscience ».
Cependant que Papen est très entouré et qu'il commence à mesurer le sens que va prendre inéluctablement son discours, ce discours qu'il voulait atténuer, les communications téléphoniques se multiplient entre Marburg et les services officiels à Berlin. Goebbels est un des premiers prévenus. Il a été personnellement attaqué par le vice-chancelier : n'est-ce pas l'offensive des conservateurs que beaucoup parmi les nazis craignent ? Immédiatement Goebbels prend ses dispositions : la diffusion par radio du discours de Papen qui avait été prévue pour la soirée est interdite. Des journalistes qui, à Marburg, s'apprêtent à transmettre le texte du discours sont interpellés et invités à ne rien communiquer à leurs rédactions, dans la journée du lendemain des exemplaires de quotidiens seront même saisis. Seule la Frankfurter Zeitung eut le temps de publier quelques extraits dans son édition de l'après-midi. Or, cette censure s'applique au vice-chancelier du Reich. Pourtant autour de Jung, les collaborateurs de Papen à la vice-chancellerie s'emploient à briser le cercle de silence dans lequel Goebbels veut enfermer l'Allemagne. Déjà des textes sont partis pour l'étranger. Les presses du journal Germania en impriment des versions intégrales qui sont remises aux représentants diplomatiques et aux correspondants de la presse étrangère. « Nous expédiâmes également, écrit Papen, un grand nombre d'exemplaires par la poste, à nos amis en Allemagne même ». Mais la vice-chancellerie est surveillée nuit et jour par les agents de la Gestapo. Heydrich qui soupçonnait l'initiative de Jung et de Papen a d'ailleurs été l'un des premiers avertis.
Au 8, Prinz-Albrecht-Strasse, l'après-midi du dimanche 17 juin est un après-midi de travail intense. Les réunions se succèdent, les communications téléphoniques avec Marburg, avec le palais présidentiel de Gœring, encombrent le standard. Heydrich donne l'ordre de saisir toute correspondance suspecte qui émanerait des services de la vice-chancellerie et qui aurait pour but de permettre la diffusion du discours de Marburg. Dans les bureaux postaux les agents du S.D. et de la Gestapo donnent leurs consignes et elles sont efficaces. « Je devais apprendre par la suite, raconte Papen, que la Gestapo avait réussi à intercepter la plupart de ces lettres » contenant la version intégrale du discours.
LA REPONSE DE HITLER.
Heydrich dont les informateurs à la vice-chancellerie se sont montrés bien renseignés dès le début de la semaine, a averti Hitler qui réside toujours à Munich depuis son retour d'Italie. Le Führer a peut-être alors pris la décision de se rendre à Géra pour faire pièce au discours de Papen et à ce que l'on pouvait en attendre. A 8 h 15, Hitler est arrivé sur l'aéroport de Munich. Mêmes cérémonies, mêmes hommes, mais un avion différent, le D. 260, réservé aux déplacements intérieurs, attend le Führer. La météo du dimanche 17 juin est bonne entre Munich et Leipzig, quelques bancs nuageux mais à faible altitude au-dessus des Erzgebirge. A 8 h 25, l'avion décolle et à 10h 15 il se pose sur l'aéroport de Leipzig. L'avion : c'est cela la nouvelle arme du Führer. Dans ce petit pays qu'est finalement l'Allemagne, le Führer peut être partout en à peine deux heures : ses adversaires l'oublient souvent.
Une voiture attend le Fuhrer sur l'aéroport de Leipzig : Il est tôt, à peine 10 h 30, quand Hitler traverse la grande cité industrielle et commerçante. Il n'y a presque personne dans les rues. Les travailleurs, le dimanche matin, restent chez eux. Par la vallée de l’Elster, les voitures s'enfoncent vers le sud, vers Géra, ses usines textiles et métallurgiques. Depuis les premières heures de la matinée, des cars ont conduit les formations de la S.A., de la S.S., des organisations de jeunesse vers la petite ville. Des milliers de personnes sont arrivées emplissant les rues de leurs chants, de leurs groupes joyeux qui déambulent en attendant l'heure des rassemblements. Sur les murs des maisons grises caractéristiques de cette région industrielle pendent les longues oriflammes du régime. Elles flottent, soulevées, gonflées par le vent printanier. A Géra, quand la voiture du Führer apparaît et s'arrête devant l'hôtel Victoria, situé près de la gare, les acclamations éclatent. Sauckel, le Gauleiter de Thuringe, accueille le Führer qui, après avoir salué la foule, entre dans l'hôtel où il va parler aux cadres du Parti. A 13 heures, Hitler apparaît à nouveau cependant que commence le défilé, grandiose pour une petite ville comme Géra. Goebbels, Ley sont là aux côtés du Führer. Ici, il y a quelques années, les « rouges » tenaient la rue, ici — et dans la région — on votait social-démocrate, ici, les S.A. ont subi de dures pertes dans des affrontements avec les ouvriers organisés et farouches. Mais maintenant — au moment où à Marburg Franz von Papen est félicité par le corps professoral et applaudi par les étudiants — maintenant ici, s'avancent avec à leur tête Sauckel, et sur neuf rangs, S.A., S.S., Hitler-Jugend, R.A.D. Motor-S.A. : 20 000 hommes représentant les organisations paramilitaires du Parti.
Il défilent au milieu des Heil Hitler, dans le martèlement sourd de leurs bottes, disant la détermination du nouveau régime de ne céder ni à Papen ni à un éventuel retour de la menace rouge. Il semble que toutes les forces nazies soient à nouveau unies en réponse au discours de Marburg qui vient à peine de s'achever, que le compromis souhaité par le Führer soit réalisé. Toutes les unités convergent vers la Schutzenplatz où plus de 70 000 personnes sont rassemblées. Des coups de canon annoncent l'arrivée du Führer et au milieu des acclamations retentissent les roulements de tambour de la Badenweiler Marsch.
Dans la foule personne n'imagine que cette mise en scène n'est pas la répétition, plus inattendue peut-être dans cette région industrielle, de l'un de ces meetings qui doivent endoctriner l'Allemagne, personne ne sait qu'elle est aussi réponse au vice-chancelier et démonstration de force contre les conservateurs, contre ceux qui grouillent autour de Papen et cherchent peut-être à renverser le nouveau régime.
Quatre heures de défilés, des centaines de cars, des cris, des dizaines de milliers d'hommes pour mesurer la popularité du Führer, grouper autour de lui toutes les forces du Parti, faire comprendre que rien sans lui ou contre lui n'est possible.
Pourtant même dans cette foule ignorante et enthousiaste, la voix dure du Führer, portant des menaces alors que le pays semble soumis et entraîné, étonne. Discours violent, que Hitler appuie de grands gestes des bras, un Hitler ruisselant de sueur et qui semble retrouver la violence vindicative et débridée des premières prises de parole exaltées dans les brasseries enfumées de Munich.
« Tous ces petits nains, s'écrie Hitler, qui s'imaginent avoir quelque chose à dire contre notre idée, seront balayés par la puissance de cette idée commune ». Des cris montent, des Heil, Sieg Heil ! « Car tous les nains oublient une chose, quelles que soient les critiques qu'ils croient pourvoir formuler : où est le mieux qui pourrait remplacer ce qui existe ? »
Poussé par la vague, Hitler multiplie les expressions ironiques. Les acclamations s'élèvent encore insultantes : « Ridicule, ce petit ver... qu'arriverait-il si ces petits rouspéteurs atteignaient leur but ? L'Allemagne se désintégrerait ». Et, lançant son bras la main fermée, Hitler, debout sur la pointe des pieds, s'écrie : « C'est le poing de la nation qui est serré et qui écrasera quiconque osera entreprendre la moindre tentative de sabotage ».
On crie, les fanfares se déchaînent : sur qui s'abattra ce poing que, le dimanche 17 juin, Hitler brandit d'abord contre son vice-chancelier, l'homme qui l'a aidé à atteindre le pouvoir, le gentleman-rider Franz von Papen, l'adversaire du capitaine Ernst Rœhm ?
4
SAMEDI 30 JUIN 1934
Aéroport de Bonn-Hangelar : 1 heure 45
(du lundi 18 juin au jeudi 21 juin 1934)
L'AEROPORT DE BONN-HANGELAR
Samedi 30 juin. 1 h. 45. L'aéroport de Hangelar est signalé par de vastes panneaux avertissant les automobilistes de ne pas avoir à stationner sur les remblais. Les voitures, depuis quelques minutes, ont ralenti et suivent la route qui, venant de Bonn longe le terrain jusqu'à la large entrée qu'encadrent deux bâtiments de bois. Les pistes balisées de lampes jaunes se perdent vers le nord et quand les voitures arrivent devant le poste de garde on aperçoit, immobilisé, le trimoteur Junker du Führer, pris dans les projecteurs, l'équipage et les mécaniciens formant un groupe sur le terrain au-dessous des moteurs. Il y a de nombreux officiers que Hitler ne salue que d'un geste distrait, parlant avec Goebbels puis d'un pas rapide se dirigeant vers l'avion cependant que le pilote, vêtu d'un blouson à col de fourrure, s'avance vers son passager. Il fait les honneurs de l'appareil montrant le ciel légèrement brumeux, mais Hitler ne lui prête qu'une attention distraite et déjà il marche vers la carlingue à grandes enjambées, les mains profondément enfoncées dans les poches de son manteau de cuir, le dos voûté.
Il faut faire vite. Il est un moment, quand la décision a été prise, où l'attente de sa conséquence devient insupportable et surtout quand, durant des semaines, le choix est resté suspendu, qui séparent la décision d'agir de l'acte et ce qui avait été longue hésitation devient fébrilité, rage d'intervenir. Hitler est, alors qu'il monte l'étroite échelle de fer, sans doute porté par de tels sentiments ; il a peur aussi qu'il ne soit trop tard. Peur de s'être laissé prendre de vitesse par l'une de ces conjurations qu'on lui signalait depuis des mois et que semblaient rythmer les communiqués de Rœhm, le départ de François-Poncet ou le discours de Marburg.
DES PREUVES ?
II y a eu aussi ce rapport Daluege, transmis par Gœring le lundi 18 juin dans lequel le général S.S. a rassemblé toutes les preuves de la culpabilité des chefs S.A., de leur volonté de s'emparer du pouvoir. A vrai dire, les preuves sont ténues mais le rapport contient les doubles des lettres qu'ils échangent, l'enregistrement des écoutes téléphoniques qui révèlent la teneur de leurs conversations : les chefs S.A. ne disent rien de précis mais ils se moquent du Führer, des ministres. Ils manient la lourde ironie roturière et cela Hitler ne le pardonne pas. Alors que chaque jour davantage l'humilité de façade et la flagornerie entourent le Führer, ces mots irrespectueux, grossiers, le blessent. De tels hommes — les Ernst, les Heines — qui lui doivent tout, qui ont accédé aux plus hautes charges, osent pourtant multiplier les critiques ; ils continuent de vouloir davantage. Comment avec un tel état d'esprit ne seraient-ils pas capables de participer aux complots de leurs ambitions et de leurs appétits ? Hitler, le rapport Daluege en main, écoute Gœring, Himmler, Heydrich. Mais il y a plus grave que l'atteinte à l'orgueil du Führer : le rapport indique que les Obergruppen-führer Ernst et Heines ont, à plusieurs reprises, fait allusion à leur rôle lors de l'incendie du Reichstag. Ils bavardent, entre deux beuveries, ils multiplient les sous-entendus, ils se conduisent comme des complices sans talent et subalternes qui dans un gang s'imaginent avoir des droits sur le chef parce qu'ils ont participé à l'un de ses coups hasardeux. La règle des gangs en de telles circonstances ne laisse aucune place à la pitié. D'autant plus que le Chancelier reçoit en fin de journée, ce lundi 18 juin, un rapport de Ribbentrop.
Le représentant personnel du Führer aux Affaires étrangères a rencontré à Paris, ce même lundi dans l'après-midi, le Président du Conseil français. Or, les informations qu'il câble à Berlin parce qu'elles s'ajoutent aux différents éléments contenus dans le dossier Daluege et aux indications fournies par Heydricb ou Himmler, sont graves. Ribbentrop signale que « dans son entretien avec le Président du Conseil français il a reçu confirmation de son impression que les milieux gouvernementaux français croyaient fermement à des difficultés économiques et internes en Allemagne et qu'on désirait à Paris, pour le moment, attendre les développements ultérieurs en Allemagne. En effet, l'attitude négative, rigide, du gouvernement français envers nous est fondée sur l'opinion française que des difficultés intérieures sérieuses étaient imminentes en Allemagne ».
Alors que des centaines d'exemplaires du discours de Papen à Marburg sont saisis, attestant la volonté des hommes proches du vice-chancelier d'engager une campagne ouverte contre le régime, alors que la Gestapo et le S.D. ne cessent de communiquer des indices — vrais ou faux — le rapport de Ribbentrop est un élément non négligeable : il est presque une preuve.
Le Führer pourtant ne prend toujours pas de décision ; les événements, les informations se succèdent à un tel rythme, jour après jour, qu'il semble ne pouvoir isoler ces quelques heures qui lui permettraient de se déterminer. Ceux qui ont choisi paraissent eux-mêmes bousculés, entraînés par les obligations quotidiennes, laissant à des hommes qui demeurent en retrait, Heydrich, Eicke, Sepp Dietrich, l'organisation du « nettoyage ». Hermann Gœring qui est pourtant l'une des âmes du complot ne pense, semble-t-il, en ces jours de la mi-juin où la tension monte, qu'à tranférer le corps de sa première épouse Karin dans la crypte immense qu'il a fait aménager dans sa propriété.
KARIN.
Le mardi 19 juin, l'exhumation a lieu au cimetière de Lovöe. Le temps est beau, le ciel d'un bleu léger, il fait chaud de façon inattendue pour la Suède, même en juin. Il semble que le jour se soit installé pour ne plus être chassé par la nuit Le cercueil où repose Karin est un long coffre de zinc brillant A 6 heures du matin, une cérémonie religieuse courte mais émouvante se déroule en présence de quelques intimes.
Les représentants des trois partis nazis suédois sont là aussi, leurs étendards inclinés vers le sol. Peu à peu la masse des couronnes s'élargit, elles sont innombrables venant de toutes les régions d'Allemagne, de toutes les organisations du Parti, la plus grande de toutes porte la marque de Gœring et l'inscription « A ma Karin ». Lentement le cercueil est placé dans un wagon spécial rattaché au train régulier qui rallie Berlin, puis le convoi s'ébranle emportant la dépouille de cette Suédoise qui avait voué sa vie à Hermann Gœring et au nazisme. A Stockholm, la foule se presse sur le quai, les hommes, tête nue, saluent le bras tendu. Toutes les manœuvres se font en silence, le wagon est placé sur le bac Drottning Viktoria où une garde rend les honneurs. La mer est calme, elle semble phosphorescente.
Gœring a quitté Berlin et à 1 h 45, le mercredi 20 juin, il arrive à Sassnitz dans le port duquel le bac est déjà amarré. Le wagon est couvert de couronnes et quand Gœring, après s'être incliné devant le cercueil, ressort du bac, le roulement sourd des tambours étouffés résonne, longue plainte qui annonce des cérémonies grandiloquentes. Car Gœring n'a rien négligé. Ce transfert du corps de Karin doit être l'occasion pour lui et le régime d'ordonner une mise en scène païenne qui inaugurera les fêtes du solstice d'été et renouera avec les traditions germaniques. Pour cela Gœring a convié les chefs nazis à Karinhall sauf un : Rœhm. Ainsi, ce qui semblait ne devoir être que le premier service du culte de Karin devient aussi une manœuvre politique : la rencontre des conjurés, comme dans une pièce de Shakespeare, autour du cercueil d'une femme.
Et pendant que le train spécial chargé de fleurs passe les gares de Bergen, Stralsund, Greifswald, Ducherow, Pasewalk, Prenzlau, que sur les quais, figés dans un garde-à-vous de marbre, les représentants des différents mouvements nazis inclinent leurs drapeaux et que roulent sombrement les tambours, la campagne de l'Allemagne du Nord, immobile et humide, respire dans le printemps. Ce paysage semble être le reflet de ces fastes dénués de sensibilité mais où vibre une grandeur sauvage et démesurée : le ciel ici est très haut sur l'horizon, les landes sableuses paraissent s'étendre à l'infini seulement coupées parfois par une vague de collines ou interrompues par un bois de pins ou de hêtres, noirs sur le sable et le ciel argentés.
A 8 h 30, le fourgon arrive à Eberswald. Gœring en grand uniforme est là, entouré de la comtesse Rosen Willamovitz Mollendorf, la sœur de Karin, d'officiers, de princes prussiens, du général de la police Wecke. Devant la gare, sur la petite place, des délégations de tous les mouvements nazis sont rangées, les bannières sont cravatées de crêpe, la musique joue la marche funèbre de Beethoven et dans des claquements de talon le prince August Wilhelm Hohenzollern, Gruppenführer S.A., le Gauleiter Oberpräsident Kube saluent Gœring. C'est une grande parade qui commence : le cercueil est porté alternativement par 8 officiers de police, 8 chefs de l'organisation nationale de sport aérien, 8 gardes forestiers, hommes qui, tous, appartiennent à l'une ou l'autre des sections que dirige Hermann Gœring. Le long de la route, la population silencieuse fait la haie. Les femmes s'inclinent, les hommes se découvrent : ils sont là, en tenue de travail, habillés de leurs vêtements de paysans, souvent noirs, regardant avec respect passer les « seigneurs ». Car ce cortège mis en scène par Gœring est un des visages du régime qui veut rappeler les temps autoritaires et durs de l'épopée teutonique.
A la maison forestière de Döllkranz, le cercueil est posé sur une voiture tirée par 6 chevaux, des groupes de cavaliers appartenant à la police personnelle de Gœring ouvrent et ferment le cortège qui avance au milieu des bois noirs. C'est bien toute une Allemagne seigneuriale qui essaie de renaître — ou de ne pas mourir — avec le nazisme ; le descendant des Hohenzollern marche aux côtés de Gœring et la foule des paysans, silencieuse, soumise, regarde passer les maîtres.
Peu à peu, les ministres, les hauts dignitaires se sont joints au cortège. Voici Adolf Hitler qui apparaît, suivi de Brückner, de Sepp Dietrich, de Meissner qui représente Hindenburg. Les cors retentissent, les uniformes noirs, les hêtres et les pins noirs, les têtes de mort sur les uniformes, la marche funèbre du Crépuscule des dieux, les visages lourds, la crypte entourée de blocs immenses, menhirs germaniques, et le sable argent, tout cela compose un tableau où se greffent le nazisme et le passé, unis pour honorer une morte et annoncer des temps de violence. Les chœurs s'élèvent : on chante le Trutzlied de Luther, on chante le choral Prends-moi dans tes mains. Au-delà de la clairière, on aperçoit les eaux scintillantes du lac Wackersee et retentit le son des trompes de chasse qui jouent l'hallali. Autour de la crypte, dans les larges vasques, les flammes oscillent couchées par le vent. La voix du pasteur, le Dr Fendt, s'élève : « Et maintenant, Karin Gœring, c'est la forêt allemande, c'est le lac allemand qui te saluent ; au-dessus de toi brillent les étoiles de notre patrie qui est devenue ta deuxième patrie. Tu l'as cherchée d'une âme ardente, tu as souffert pour elle aux côtés de ton époux, tu as lutté pour elle et tu t'es réjouie pour elle jusque dans la mort».
Autour de la crypte, les hommes sont figés, la voix du pasteur résonne nette et dure.
« La splendeur de la terre allemande t'enveloppe désormais pour toujours et dans la grandiose solitude de ces forêts, tu entendras retentir pour toi la gratitude, le salut et la paix de l'Allemagne ».
Brusquement alors qu'on s'apprête à descendre le cercueil, la foule s'ouvre. Himmler apparaît, son visage exprime la colère et l'émotion, il se dirige vers Gœring et Hitler, leur parle à voix basse, Brückner s'approche, puis donne des ordres. Enfin la cérémonie reprend et Gœring, accompagné du seul Chancelier du Reich, descend se recueillir dans la crypte. Himmler, entouré de quelques S.S. de haut grade, parle rapidement. Sur la route de Berlin à Karinhall, à quelques kilomètres à peine d'ici, on a tiré sur sa voiture des coups de feu : son pare-brise a été traversé. C'est un véritable miracle qu'il n'ait pas été blessé ou tué. Himmler réclame des représailles : il faudrait exécuter 40 communistes, car ce sont des communistes, entrés dans la S.A., précise le Reichsführer S.S., qui ont perpétré l'attentat On se dirige vers sa voiture : le pare-brise est en effet étoilé. Bodenschatz, l'aide de camp de Gœring, ancien pilote comme lui, examine le verre : une balle n'aurait jamais pu faire si peu de dégâts, l'incident est dû tout au plus à une pierre de la route. Mais il ne dit rien. Himmler parle toujours de l'attentat. Maintenant le mot même de communiste a disparu, il n'est plus question que de la menace S.A., du complot S.A. qui cherche à supprimer les chefs fidèles à Hitler.
Autour du cercueil de Karin, autour de cette crypte massive comme un rocher surgi des sables gris et cernée par la forêt noirâtre, alors que retentissent les cors de chasse et que Hitler, le visage grave, s'avance aux côtés de Gœring, communiant avec lui dans cette cérémonie païenne, la Sturmabteilung de Rœhm reparaît, isolée, menaçante, désignée à la vindicte, une vindicte qui sera le reflet violent de cette inhumation au cœur de la forêt profonde.
Après la cérémonie Hitler est rentré à Berlin. Ceux qui le côtoient durant le voyage de retour, puis à son arrivée à la chancellerie du Reich à la fin de la journée, sont frappés par l'expression recueillie et grave de son visage plus sévère que de coutume : le Führer paraît avoir été marqué par la mise en scène teutonique de l'inhumation, frappé par la place qui lui a été faite par Gœring alors que descendait dans la crypte le cercueil de Karin. Sans doute est-il sensible aux liens d'un mysticisme païen qu'entre la morte, Gœring et lui, la cérémonie a tissés. Le ministre-président a atteint son but : Rœhm, ses S.A., exclus de ce monde mystérieux qui puise ses sources dans la mythologie germanique, là où dans les immenses forêts résonnent les cors, viennent de perdre dans l'esprit du Führer une nouvelle bataille. Le clan Gœring-Himmler s'est par contre renforcé.
Ce mercredi 20 juin, à la Chancellerie, Hitler prend d'abord connaissance de l'article qu'Alfred Rosenberg publie dans le Völkischer Beobachter et qui est l'une des premières réponses au discours de Papen à Marburg. Le théoricien nazi affirme au nom du parti : « Nous n'avons pas fait la révolution de notre temps pour qu'une époque surannée puisse proclamer sous le mot d'ordre « révolution conservatrice » la restauration de l'Etat d'il y a cinq cents ans... » Hitler donne de nouveaux ordres : les chefs du Parti, Goebbels, Hess, doivent eux aussi contre-attaquer, montrer que le régime n'acceptera pas d'être vidé de son contenu par Messieurs les seigneurs conservateurs.
Au moment où le Führer s'apprête à regagner ses appartements, Franz von Papen demande à être reçu immédiatement. En fait, le vice-chancelier patiente depuis plusieurs heures et Hitler va être contraint d'affronter l'homme de Marburg, celui contre lequel « il monte » une vigoureuse campagne de presse. Les deux hommes se craignent ; il y a quelques mois montrant le bâtiment de la vice-chancellerie, le Führer avait dit à Rosenberg : « C'est de là que viennent toutes nos difficultés, un jour je nettoierai tout cela ». Mais, ce soir, les deux hommes se saluent cérémonieusement, pourtant derrière la façade des politesses la tension est présente. L'entrevue menace d'être orageuse. Papen proteste contre la censure imposée par Goebbels : un ministre peut-il interdire la diffusion des discours du vice-chancelier du Reich ? « J'expliquai à Hitler, raconte Papen, que je considérais comme mon devoir de prendre nettement position, car la situation était devenue critique. Le moment était venu, afflrmai-je, où lui-même devait prendre position. »
Hitler écoute : il a parfaitement compris qu'on l'invite à mettre de l'ordre, à freiner l'ardeur des S.A., les violations de la légalité que commettent les nazis. Toutes les forces — Reichswehr, Gestapo, conservateurs — le poussent à rompre l'équilibre établi entre les différents courants qui l'ont porté au pouvoir. Mais chacun des hommes — Himmler, Heydrich, Blomberg, Gœring et aussi Papen — qui veulent voir l'équilibre rompu, se tourne vers le Führer. Franz von Papen n'échappe pas à la règle : « II devait se rendre compte, continue le vice-chancelier, que je tenais toujours à notre association, c'était justement pour cette raison que je le suppliais de réfléchir aux problèmes que j'avais soulevés ». On a besoin du Führer, et cela Hitler le sait, on a besoin de lui dans tous les camps, y compris dans celui des S.A.
Puis Papen hausse le ton, son attitude se fait plus arrogante. « De toute façon, dit-il, le vice-chancelier du Reich ne peut tolérer qu'un nouveau ministre (Goebbels) interdise la publication d'un discours officiel ».
Papen ménage ses effets, puis il lance : « J'ai parlé en mandataire du président. L'intervention de Goebbels va m'obliger à démissionner. J'en avertirai immédiatement Hindenburg... »
Voilà la carte des conservateurs pour contraindre Hitler à céder, à rompre avec les S.A., à respecter la légalité. Hindenburg, statue du commandeur qui pourrait foudroyer Hitler en ralliant autour de lui l'armée, les conservateurs, la masse des Allemands. « A moins que l'interdiction de mon discours ne soit rapportée, continue Papen, et que Hitler lui-même ne prenne l'engagement d'adopter la ligne de conduite que j'ai préconisée ».
Hitler paraît hésiter. « Il essaya de me calmer, raconte Papen. Il admit que Goebbels avait gaffé pour essayer d'éviter une aggravation de la tension déjà existante ». Mais Papen menace encore, il va démissionner et von Neurath, ministre des Affaires étrangères, Schwerin von Krosigk, ministre des Finances, partiront avec lui. « Je vais à Neudeck, àjoute-t-il, et je demande que le discours soit publié ». Hitler saisit la balle au bond : il ira à Neudeck avec Papen. Les collaborateurs du vice- chancelier l'ont mis en garde contre cette proposition de Hitler. Papen ne doit pas accepter une visite commune à Hindenburg qui viderait de toute signification le discours de Marburg. Mais Papen, comme il l'a dit, ne veut pas rompre son « association avec Hitler ». Le Führer insiste. « Il faut examiner l'ensemble de la situation, dit-il, la discussion ne pourra avoir de résultats tangibles que si le chancelier y assiste. » Papen, finalement, accepte la proposition du Führer. Alors, celui-ci promet d'ordonner à Goebbels de lever l'interdiction du discours de Marburg, puis « il se lance dans une violente tirade contre l'insurbordination générale des S.A. Elles compliquent de plus en plus sa tâche et il va être forcé de les ramener coûte que coûte à la raison ». Les Sections d'Assaut : une fois de plus ce sont elles, qui dans cette journée du 20 juin, subissent le contrecoup de l'événement. Pour se protéger de l'attaque de Papen, de Hindenburg, pour éviter de se couper de l'aile « conservatrice» de son gouvernement Hitler charge la S.A. Ira-t-il jusqu'à la sacrifier ?
LA FETE DE L'ETE
La nuit du mercredi 20 au jeudi 21 juin est pour l'Allemagne une nuit de veille. Sur les stades, sur les places, dans les clairières, partout brûlent des feux de bois et se rassemblent des milliers de membres des organisations nazies. Jeunes gens portant des torches, chantant des hymnes, marchant au pas cadencé. Pour la première fois en cette nuit, la plus courte de l'année, l'Allemagne célèbre une nouvelle solennité, la fête du Solstice d'été. Déjà l'inhumation de Karin avait annoncé, la veille, le début du cycle païen, maintenant il atteint sa plénitude et durant plusieurs jours il va se poursuivre.
A Verden, une petite ville de Westphalie, située sur l'Aller, Alfred Rosenberg, qui est à l'origine de ce retour au paganisme, magnifie la mémoire des 4 500 Saxons rebelles que Charlemagne fit exécuter là, en 782. Alors que les flammes hautes s'élèvent des foyers dans la nuit fraîche et claire, que les torches grésillent, Rosenberg prononce une allocution inspirée : « Hitler, déclare-t-il, est pour nous le continuateur direct de Hermann le Chérusque et du duc Witikind. L'histoire a donné raison à ce duc des Saxons. La Terre sainte n'est pas pour nous en Orient. Elle est partout, ici, en Allemagne. » Ainsi la fête de l'été devient-elle exaltation du Reich et de son Führer.
Dans l'après-midi du jeudi, à Berlin, Goebbels prend le relais de Rosenberg. Sur l'immense stade de Neuköln, devant des dizaines de milliers de Chemises brunes, la mythologie à nouveau s'anime à l'occasion de cette fête du Solstice. Pourtant ici, il n'est plus question du passé, mais du présent : « Un petit cercle de critiques s'est constitué pour saboter notre travail, dans la pénombre mystérieuse du café du Commerce... Ce sont de ridicules galopins ! » hurle Goebbels et continuant sous les applaudissements frénétiques, le ministre ajoute : « Ces cercleux qui discutent gravement de politique en se prélassant dans de bons fauteuils n'ont pas le monopole de l'intelligence... Ils représentent la réaction. L'histoire ne gardera pas leurs noms, mais les nôtres ».
Papen, membre du Club des seigneurs, vice-chancelier du Reich, est clairement désigné par Goebbels, ministre de la Propagande qui ne peut parler qu'avec l'accord du Führer. Papen lit et relit les dernières phrases de Goebbels : « Pas de Kronprinz, pas de conseiller, pas de grand banquier, pas de cacique parlementaire ! »
Cela signifie-t-il que Hitler, une fois encore, a changé de cap, choisissant le chemin de la seconde révolution ? Qu'il veut rompre avec ceux qui, éléments traditionnels et raisonnables, se sont ralliés à lui ? Hitler a-t-il décidé de rejoindre le camp de la S.A. et de Rœhm, avec qui précisément Goebbels, peut-être avec l'accord du Führer, entretient encore des contacts ? Ou cela indique-t-il simplement que le Führer hésite ? L'inquiétude est grande autour de Papen, mais aussi dans les milieux proches de Himmler, de Gœring ou encore à la Bendlerstrasse. Il faut donc essayer, une fois encore, de « sonder » Hitler et l'occasion se présente puisque, ce jeudi 21 juin, il doit saluer le Reichspräsident Hindenburg à Neudeck.
HITLER ET LE VIEUX MARECHAL.
Cependant, Hitler se rend auprès de Hindenburg, seul. Papen apprendra le voyage plus tard. Officiellement la visite de Hitler auprès du président du Reich a un but précis : faire connaître à la plus haute autorité d'Allemagne le contenu des entretiens de Venise avec Mussolini. A Neudeck au bout d'une large allée, il y a la demeure austère et massive du Feldmarschall. Des officiers, Meissner, secrétaire général de la présidence, le comte von der Schulenburg, le colonel Oskar von Hindenburg, accueillent cérémonieusement le Führer sur le perron. On pénètre lentement à l'intérieur. Dans les vastes pièces froides semble régner déjà le silence pesant d'un mausolée. Les familiers précisent à Hitler que les visites doivent être brèves : d'ailleurs, pour l'heure, Hindenburg se repose, il somnole, il ne pourra recevoir Hitler que dans la soirée après que les médecins l'auront une nouvelle fois examiné. Le Führer mesure encore combien l'échéance est proche : il lui faudra être prêt à saisir le pouvoir suprême au moment de la mort de Hindenburg et pour cela, l'armé devra se ranger derrière lui.
Le Führer est sorti dans le jardin. L'air y est vif, les couleurs de cette première journée d'été sont nettes et franches, le sol est sec, crissant sous les pas, tout le paysage est précis, presque gai. C'est dans ce jardin que ce jour-là, Hitler a sans doute rencontré le général von Blomberg. Le ministre de la Guerre accomplissait une visite d'inspection en Prusse-Orientale et, apprenant que Hitler se trouvait à Neudeck, il s'y est rendu sous le prétexte de présenter ses devoirs au Feldmarschall Hindenburg. Autour de Hindenburg, statue de la vieille Allemagne prussienne que le temps achève d'abattre, le représentant de l'armée et le Führer du nouveau Reich ne peuvent qu'évoquer l'avenir, rappeler le pacte du Deutschland. L'élégant général veut savoir si Hitler, depuis avril, n'a pas varié, s'il est toujours prêt à sacrifier la S.A. Les deux hommes marchent côte à côte dans un jour qui semble ne pas vouloir finir, le général et le chancelier, l'officier de tradition et l'ancien Gefreiter, ce caporal parvenu au sommet du pouvoir mais vulnérable encore. Blomberg a dû être précis parce que la santé de Hindenburg décline vite, parce que la tension monte en Allemagne, parce que Papen, Bose, Jung, Klausener, Schleicher, agissent de leur côté, font pression sur certains éléments de l'armée, parce que la Bendlerstrasse craint que cette tension ne favorise une tentative d'invasion à l'Est ou à l'Ouest, de la part de la Pologne et de la France, parce qu'il faut mettre fin au désordre que provoquent les S.A. et assurer à l'armée une réserve stable de recrues sur laquelle elle aurait la haute main.
Les deux hommes, côte à côte, avancent dans l'allée. Naturellement, si Hitler renouvelle le marché, la Reichswehr prêtera serment de fidélité au nouveau chef d'Etat du Reich. Sur le perron, le secrétaire général Meissner attend le Führer : Hindenburg est réveillé, il peut recevoir Hitler pour quelques minutes. Le vieux maréchal est assis dans un immense fauteuil au dossier droit, il est en civil, vêtu d'une longue redingote noire, un col blanc cassé serré par une cravate noire bâille autour de son cou où se dessinent les deux sillons profonds de la vieillesse. Quand Hitler parait, Hindenburg se lève, le poing gauche serré, la main droite appuyée sur une canne, il salue Hitler d'une inclination de tête. Le lourd visage carré, creusé, couronné de cheveux blancs coupés en brosse, n'exprime aucune sensation : un marbre impassible. Puis Hindenburg se rassied et un chambellan chamarré avance un siège pour le Chancelier. Hitler commence à parler de Venise, du Duce, de l'amitié de l'Italie, mais Hindenburg va l'interrompre par quelques mots et des interrogations qui sont des ordres : Rœhm ? La seconde révolution ? Il faut rétablir le calme en Allemagne, tel doit être le rôle d'un chancelier du Reich, telle est la mission du président du Reich. Le pays a besoin d'ordre, insiste-t-il, l'armée a besoin de calme pour préparer la défense du Reich. Puis, avec l'aide du chambellan, Hindenburg se lève à nouveau, il s'avance lentement, traversant les pièces pesamment ; à ses côtés, Hitler parait frêle, insignifiant, sans lien avec l'histoire de l'Allemagne que Hindenburg semble exprimer par sa seule façon d'être, par son visage même. Il reconduit Hitler jusqu'au perron et là, entouré de ses proches, d'officiers, de chambellans, appuyé sur sa canne, il regarde partir le Führer avec cette indifférence sévère, ces yeux vides qu'ont les vieillards puissants et qui suscitent toujours l'inquiétude chez ceux qui dépendent d'eux.
Or, Hitler, pendant qu'il roule dans le paysage plat de la Prusse-Orientale, mer moutonneuse de landes et de sables qui continue la Baltique, sait que pour quelques semaines encore son sort dépend de Hindenburg, de l'entourage du Feldmarschall et surtout de l'armée : depuis avril, depuis la croisière sur le Deutschland rien n'a changé fondamentalement mais simplement tout s'accélère. Les choix s'imposent, les engrenages tournent : il faut trancher sinon l'armée peut basculer, Hindenburg peut décréter la loi martiale, confier le pouvoir réel aux généraux, balayer les S.A. et que restera-t-il alors du pouvoir de Hitler ?
A Berlin, alors que Hitler grimpe dans son avion pour le retour, Goebbels donne un thé « politique ». Ses réunions d'apparence mondaine sont un moyen commode pour faire se rencontrer des hommes de différents milieux, pour échanger des idées, nouer des contacts, influencer des personnalités. Gœring et Goebbels, mais aussi Hitler, affectionnent ce genre d'assemblées. Le jeudi 21 juin, autour de Goebbels, des hommes d'affaires et des hommes politiques sont réunis : on reconnaît le capitaine d'industrie, le Dr Dorpmuller et le magicien des finances, le Dr Schacht, puis, un peu à l'écart, le vice-chancelier Franz von Papen qui a donc — et cela donne la mesure de sa « souplesse politique » — accepté l'invitation du ministre de la Propagande qui censure pourtant ses discours ; on voit aussi le conseiller d'Etat Gorlitzer, le secrétaire d'Etat von Bülow, l'nspecteur des troupes des transmissions von Kluge, Gordeler. Une assemblée choisie, où se mêlent, comme à l'image du IIIeme Reich, l'Allemagne prussienne et traditionnelle, les représentants de l'armée, les barons des affaires, les hommes politiques conservateurs et les nazis. Goebbels demande un moment d'attention pour Schacht qui veut exposer le problème des réparations : le président de la Reichsbank a un programme ambitieux. Un moratoire sera établi qui favorisera le transfert des intérêts des créanciers étrangers du Reich ce qui les incitera à acheter des produits allemands. Ces exportations accrues permettront au Reich de se procurer des matières premières ce qui aura pour effet de faciliter le réarmement. Papen, Kluge, écoutent avec passion : l'un est lié à la grande industrie de la Ruhr et l'autre à l'armée, or Schacht bénéficie de l'appui total de l'Etat-major et des milieux de l'industrie sidérurgique. Mais Schacht a un adversaire en la personne de Schmitt, ministre de l'Economie, plus favorable à un développement de la consommation intérieure : et Schmitt a le soutien de Rœhm. Le thé politique de Goebbels, façon de présenter la politique de Schacht et l'aide-mémoire qu'il prépare pour le Führer avec l'appui de la Reichswehr est donc loin d'être anodin. Les options économiques de Schacht imposent aussi qu'on en finisse avec Rœhm pour pouvoir se lancer enfin, vraiment, sur la voie du réarmement.
Ses derniers invités partis, Goebbels se fait conduire à l'aéroport de Tempelhof. Rudolf Hess est déjà arrivé et tous deux, sous un ciel rouge d'été, arpentent la piste cimentée : Goebbels, bavard, souriant nerveusement, ayant du mal à se tenir à la hauteur de Hess, qui, l'air soucieux, les mains derrière le dos, écoute, la tête légèrement penchée avec ce visage obstiné et un peu hagard qu'il a toujours. Dans l'immense ciel de l'Allemagne du Nord, l'avion de Hitler apparaît enfin, point noir dans le crépuscule, bientôt le vrombissement des moteurs est distinct et après un premier passage, l'avion, un Junker gris trimoteur, se pose et roule lentement vers le groupe des officiels. L'appareil immobilisé, Hitler descend le premier : il salue Goebbels et Hess, remercie le pilote, puis se met à parler à ses deux ministres. Sans doute fait-il le récit de son entrevue de Neudeck, évoque-t-il la silhouette massive et autoritaire de Hindenburg, le sourire légèrement ironique du Gummilöwe le « lion de caoutchouc » Blomberg. Même s'il n'insiste pas sur le choix qu'on lui impose, ceux qui l'écoutent, ceux qui le voient, le visage crispé, comprennent qu'inéluctablement le temps des décisions vient.
Hitler sur cette plaine de Tempelhof avec sa démarche saccadée, ressemble un peu à ces chefs de pièces qui vont et viennent derrière les artilleurs, scrutant le ciel, écoutant les rapports, enregistrant toutes les données et ne se décidant pas pourtant à commander le feu, parce qu'ils savent d'expérience, qu'une fois partis, les obus ne peuvent plus retourner dans les tubes des canons.
5
SAMEDI 30 JUIN 1934
Aéroport de Bonn-Hangelar, 1 heure 50
(du vendredi 22 au lundi 25 juin 1934)
L'ENVOL
Samedi 30 juin, 1 h 50. La brise s'est levée. Douce et régulière, elle vient du Rhin poussant vers les hauteurs la brume humide. Autour de l'avion, les personnalités nazies se sont rassemblées. Goebbels serre des mains. Hitler, soucieux, fait de brefs et mécaniques saluts nazis, puis le Führer monte l'étroite échelle de fer et le pilote qui est déjà dans l'appareil lui tend la main ; Goebbels, qui semble soulever avec peine sa jambe raide, grimpe à son tour ; Brückner disparait le dernier se courbant en deux pour pouvoir se glisser dans l'avion. Il est 1 h 50 du matin. De la tour de contrôle, une petite construction blanche, basse, éclairée, un signal lumineux confirme l'indication radio : le pilote lance les moteurs les uns après les autres et leur vrombissement aigre d'abord, puis régulier, résonne, répercuté au loin par les hauteurs qui bordent le fleuve. L'appareil commence à rouler lentement, cahotant, prenant la piste qui se dirige vers le Rhin, affrontant la brise de face, accélérant, arrachant d'abord son empennage du sol, puis augmentant encore sa vitesse et décollant enfin aux limites est du terrain, passant au-dessus des barrières, faisant courber les herbes. De la tour de contrôle au pied de laquelle quelques officiels se sont rassemblés, on n'aperçoit plus bientôt que les feux de position rouges et verts qui clignotent dans la nuit qui semble déjà, vers l'est, devenue moins noire et plus grise. Alors que les chefs nazis qui ont accompagné le Führer se dirigent vers les voitures, l'avion prend en enfilade la vallée du Rhin, puis amorce une courbe vers le sud-est, vers Munich.
Très vite l'avion a laissé à sa droite la ville de Bonn, signalée sous la brume par le pointillé des lampadaires.
LA MULTIPLICATION DES INCIDENTS.
Bonn : le vendredi 22 juin, il y a à peine une semaine, l'université de la ville a été le théâtre d'un incident qui inquiète les nazis. Ce matin du vendredi 22 juin, le Gauleiter Grohé, le responsable des organisations nazies, est reçu à l'université. Autour de l'ancien château des archevêques électeurs de Cologne qui abrite l'université, le service d'ordre des groupes nazis est impressionnant : jeunes de la Hitler-Jugend, S.S. et S.A. placés près de l'entrée principale et, dispersés dans le grand jardin qui se trouve derrière le château, de nombreux policiers déambulent dans les allées. Grohé doit parler dans la salle des fêtes de l'université, l'Aula monumentale. Les professeurs, les dignitaires nazis sont au premier rang. A l'entrée du Gauleiter, les étudiants se sont levés. Les représentants des Corporations sont placés sur l'un des côtés de l'amphithéâtre. Le Gauleiter commence son discours dans le silence : il parle du conflit qui oppose la jeunesse hitlérienne et les organisations confessionnelles d'étudiants, il évoque des incidents qui ont eu lieu, il excuse naturellement les violences des Hitler-Jugend : « Si la Hitler-Jugend a été parfois maladroite dans ses méthodes, c'est l'esprit de la jeunesse qui explique cela. Les responsables de la Hitler-Jugend ont pour tâche de ramener cet esprit révolutionnaire de la jeunesse dans les limites nécessaires ». Ainsi sont absoutes les agressions, les vindictes dont se sont souvent rendues coupables les Jeunesses Hitlériennes. Brusquement, alors que le Gauleiter Grohé continue de parler, les représentants des Corporations sans un mot se lèvent et quittent la salle en groupe. Grohé s'interrompt, un murmure parcourt l'assistance, un professeur se lève puis se rassied jugeant son intervention inutile, enfin la séance reprend mais le malaise est perceptible et le Gauleiter abrège son intervention. Il quittera rapidement le château dans sa lourde voiture noire, salué par les autorités universitaires. Sur le visage du Recteur on lit l'inquiétude et le désespoir, le Gauleiter Grohé paraît hors de lui.
Le camouflet qu'il vient de recevoir est d'importance : la presse ne s'en fera pas l'écho mais les nazis s'inquiètent Après le discours du vice-chancelier Papen à Marburg et l'accueil qu'il a reçu des étudiants et des universitaires, l'incident de Bonn semble indiquer que les nazis ne parviennent pas à arrêter la montée de l'opposition dans les milieux intellectuels : n'est-ce pas un signe de plus indiquant que dans les cercles modérés, conservateurs, intellectuels, religieux, on s'écarte du régime ?
N'est-ce pas la preuve qu'il faut réagir vite, montrer à l'Allemagne, aux opposants de tous bords que le nazisme ne peut ni se dissoudre, ni se balayer, qu'il tient l'Allemagne et assurera l'ordre à n'importe quel prix ?
Les services de Berlin sont avertis par Bonn de l'incident. Himmler et Heydrich réunissent immédiatement leur Etat-major. Le général Reichenau est présent à la réunion qui se tient au siège de la Gestapo. Les premières décisions concernant la mise en œuvre du plan de liquidation des opposants — et d'abord naturellement des S.A. — sont prises et transmises. Ce vendredi 22 juin, l'Oberabschnittsführer S.S. Freiherr von Eberstein reçoit l'ordre de mettre ses troupes en état d'alerte. Reichenau pour sa part s'engage à avertir les cadres supérieurs de la Reichswehr de l'imminence de l'action. Ce jour-là aussi, on essaie de prévenir la chancellerie du Reich. Mais le Führer vient de quitter Berlin. A peine rentré de Neudeck, après une nuit passée dans l'austère et massif bâtiment officiel, il a, tôt le matin de ce vendredi, gagné l'aéroport de Tempelhof, pris son avion et décollé vers la Bavière, les montagnes apaisantes de l'Obersalzberg et de Berchtesgaden. Fuite, refus de choisir, souci de laisser faire les autres et le temps ? Hitler ressemble à l'un de ces rois hésitants qui se réfugient loin des complots qu'ils ne veulent pas voir, ou bien à l'un de ces oiseaux de proie qui tournoyaient dans le ciel de l'Allemagne avant de plonger comme une pierre sur leurs victimes.
Il vient donc de quitter Berlin laissant une fois de plus les chefs de la S.S., de la Gestapo et de l'armée dans l'incertitude. Mais maintenant, les hommes du Freiherr von Eberstein dans les casernes S.S. vérifient leurs armes, les gardes sont renforcées, les permissions supprimées. Hitler semble ne rien vouloir savoir de tout cela, de ce grouillement d'ombres qui placent leurs pièges et préparent l'assaut
Ils utilisent tous les événements, les faits divers pour accroître l'inquiétude. Le vendredi 22 juin, toujours, un corps affreusement mutilé est découvert à Gollmütz, près de Schwerin, dans cette région où les collines boisées et les lacs donnent au Mecklembourg le visage d'une contrée riante et douce. Le corps est là, dans l'herbe : les bras sont presque détachés du tronc, le cou est à demi tranché comme si le meurtrier avait essayé en vain de dépecer le cadavre. Les officiers de police, le médecin légiste, les fonctionnaires de l'identité judiciaire entourent le corps. Finalement un témoin reconnaît la victime : il s'agit du régisseur Elsholtz qui administre un domaine avec l'autorité de ces « chefs » d'exploitation agricole rudes avec la terre, les animaux et les hommes. Mais Elsholtz n'est pas que cela : il est aussi trésorier général du parti nazi. Le meurtre dès lors devient une affaire politique. Un certain Meissner est arrêté, il serait le coupable, assassin par vengeance, ulcéré par ces rivalités « paysannes » qui rongent les hommes liés au sol. Cependant les milieux nazis ne se contentent pas de cette explication : Meissner serait proche des milieux catholiques ; l'agence D.N.B. dément mais le bruit est répandu à Berlin par les agents de Heydrich et de Himmler. L'enquête d'ailleurs s'oriente vers la thèse du meurtre politique : 11 personnes sont arrêtées dont 9 font partie de la Deutsche Jugendkraft, organisation de la jeunesse catholique. Le samedi 23 juin, le Westdeutscher Beobachter, publie un article incendiaire, le parti catholique Zentrum, le journal du Zentrum, Germania, sont déclarés responsables de l'assassinat d'Elsholtz : si ces milieux n'attaquaient pas constamment les nazis, écrit le journal nazi, de tels actes ne se produiraient pas. Messieurs les catholiques conservateurs poussent au meurtre des bons Allemands ! L'accusation est précise et elle contient une menace grave. Les hommes du Zentrum protestent mais leurs démentis se perdent dans le flot des nouvelles orientées. La tension monte donc et les dirigeants nazis l'utilise pour préparer l'opinion.
Le samedi, à Potsdam dans la ville de Frédéric le Grand, a lieu l'enterrement d'Elsholtz. La cérémonie est imposante : les tambours résonnent lugubrement dans la grande allée qui conduit à la Nikolaikirche, la grande église à dôme, qui se trouve sur la place de l'Altmarkt. Le cortège s'approche d'un pas lent, les groupes se scindent passant de part et d'autre de l'obélisque dressé au milieu de la place, décoré de médaillons du Grand Electeur et des trois premiers grands rois de Prusse. Le cortège funèbre avance : en tête marchent le ministre Ley et le Gauleiter Oberpräsident de Berlin Kube. Après la cérémonie à la Nikolaikirche, le cortège s'ébranle à nouveau, se dirigeant vers le cimetière de Potsdam : là, l'inhumation a lieu alors que s'inclinent les étendards à croix gammée. Les nazis ont un nouveau martyr.
Après la cérémonie à Potsdam, les personnalités regagnent Berlin rapidement : la plupart sont mobilisées pour prendre la parole à l'une ou l'autre des grandes manifestations que les nazis continuent d'organiser pour célébrer la fête païenne du Solstice d'été.
LA MISE EN CONDITION.
Et tout semble se prêter à cette exaltation de l'épanouissement de la nature. Le ciel, au-dessus de l'Allemagne, en ce samedi 23 juin est d'une beauté légère, les couleurs des lacs et des prés sont douces, c'est moins l'été que l'éclat du printemps. Ley ne s'arrête pas à Berlin. Il se fait immédiatement conduire à Tempelhof où un appareil Junkers l'attend. Dans l'avion, il revoit son discours : il doit parler au début de l'après-midi à Oberhausen, dans la Ruhr. De la carlingue, étroite, où sont assis les uns derrière les autres de part et d'autre les collaborateurs du ministre, on aperçoit les hauteurs qui, au sud, marquent le début de ce cœur hercynien de l'Allemagne avec les masses sombres des forêts, les nuages bourgeonnants et blancs qui commencent à s'élever au-dessus des sommets. Au loin, vers l'avant, une couverture grise et floconneuse que crèvent des colonnes de fumées noires annonce la Ruhr, ses aciéries, le royaume de Krupp et le cœur martelant de la puissance germanique.
Précisément, ce 23 juin, le général Blomberg transmet à la chancellerie du Reich, pour le Führer, un mémorandum, préparé par le général Thomas, spécialiste des questions économiques de la Reichswehr, et qui réclame un dictateur économique pour organiser le réarmement de l'Allemagne : ce dictateur ce devrait être Schacht. Il faudrait liquider l'actuel ministre Schmitt qui veut favoriser une hausse du niveau de vie. Avec Schacht, la production passera avant la consommation et tout sera orienté vers la fabrication de ces barres d'acier qui deviennent des tubes de canon ou des affûts de pièce et qu'on forge depuis plus d'un siècle dans cette Ruhr vers laquelle se dirige l'avion de Ley.
C'est une fois de plus le miracle de l'avion utilisé systématiquement par Hitler et les nazis qui leur permet d'être ainsi dans plusieurs villes d'Allemagne dans la même journée. Le matin, enterrant Elsholtz à Potsdam, l'après-midi parlant aux ouvriers d'Oberhausen.
« Le national-socialisme, s'écrie Ley, veillera à ce que tous prennent leur part des sacrifices nécessaires et il ne tolérera pas que quelques hyènes du champ de bataille tirent profit de ces sacrifices. »
Les groupes nazis applaudissent, les ouvriers sont plus réservés. « Que personne, lance encore Ley, ne s'imagine qu'il pourra vivre comme autrefois... Celui qui espère pouvoir se réfugier sur une île des bienheureux, celui-là commet une erreur immense... »
La mise en condition continue ; pas de pitié pour l'ancien monde, pas de survie possible pour les mœurs d'autrefois, répètent les chefs nazis. On ne peut plus vivre comme avant. Gare à ceux qui s'obstinent
A quelques kilomètres à peine d'Oberhausen où parle le ministre Ley, à Duisbourg, le grand port enfumé de la Ruhr, le ministre Joseph Goebbels s'est chargé d'animer le Gauparteitag (la journée du Parti pour le Gau d'Essen). Il arrive à 14 heures sur le terrain d'aviation pavoisé. Puis ce sont les réceptions, les visites au Hall de la foire d'exposition d'Essen où sont réunis les membres des organisations féminines du Parti. On présente au malingre Goebbels la présidente Madame ScholzKlink : les musiques jouent, les oriflammes nazies sont agitées à bout de bras par des jeunes filles. Goebbels ravi, sourit et son visage paraît encore plus grimaçant. Entre 16 heures et 17 heures au milieu des hurlements des sirènes, Goebbels parcourt les eaux noires du port de Duisbourg où les lourdes péniches chargées de charbon et de minerai de fer ne cessent d'accoster. Enfin, sur le grand stade de Duisbourg c'est la parade attendue : cent cinquante fanfares de la Jeunesse hitlérienne jouent à tour de rôle. Il fait frais : les flammes des torches s'allongent en même temps, couchées par la brise. A 20 heures 57, 1 000 garçons et filles des organisations nazies entonnent le chant des reîtres. L'Allemagne éternelle faite de sève acide et brutale, l'Allemagne des forêts sombres, bondissante, fascinante et puissante semble s'être réveillée sous ce ciel gris chargé de fumées industrielles qui rappellent la force immense des aciéries ; le chant s'élève dans ce décor de cheminées et de poutrelles, de superstructures de grues et de puits de mine. A 21 heures, Terboven, le dirigeant nazi d'Essen prend la parole : quelques mots couverts par les acclamations pour annoncer Joseph Goebbels, cette petite silhouette nerveuse et blême qui monte à la tribune dans la lumière des projecteurs. Il ne mâche pas ses mots : « Il faudra maintenir un bas niveau de salaires, dit-il, parce qu'il a fallu donner du travail à 4 millions de chômeurs. » Les haut-parleurs répercutent au loin, dans la nuit, la voix nasillarde de Joseph Goebbels. Il brosse le programme du parti, « construire un avenir heureux... Ce sera la mission de la jeunesse de le réaliser ». Les cris montent des milliers de poitrines juvéniles : la ferveur et l'enthousiasme éclatent dans cette nuit joyeuse. « Notre mouvement est devenu notre deuxième patrie, nous avons lutté pour qu'il devienne grand. Nous voulons veiller sur ce mouvement comme sur la prunelle de nos yeux », achève-t-il en martelant ces mots. Déjà il avait lancé les mots de fidélité, de constance, de simplicité dans le style de vie. Comment les initiés ne penseraient-ils pas à la Sturmabteilung ? Goebbels a parlé une vingtaine de minutes. A 21 heures 30, le défilé commence au chant du Horst Wessel Lied. Les 150 fanfares accompagnent la marche et à 22 heures 05 s'ouvre la fête du Solstice. Le nazisme tient la jeunesse dans son poing et elle s'exalte croyant avec l'ardeur de ses vingt ans retrouver une force profonde et naturelle. A 22 heures 30, Goebbels quitte le stade où la joie est générale et prend la route pour Osnabrück où il doit à nouveau parler le lendemain.
En arrivant à Osnabrück tard dans la nuit, Joseph Goebbels trouve les nazis de la ville préoccupés. Des nouvelles parvenues de Quentzin, près de Greifenhagen font état d'incidents entre les S.A. et l'association nationale-socialiste des anciens combattants. Le Sturmführer S.A. Moltzahn, l'un des plus anciens chefs S.A. de Poméranie — il fait partie du mouvement national-socialiste depuis 1924 — était à l'honneur ce samedi 23 juin. Dans la petite ville grise, on célébrait aussi la fête du Solstice d'été. Les S.A., les membres des organisations de jeunesse écoutaient le discours du Sturmführer. Les Heil se répètent, scandant les phrases du chef S.A. Mais quand celui-ci veut donner des ordres au chef de la formation des combattants, l'ancien combattant Kummerow, celui-ci refuse. Kummerow s'empare d'un gourdin de chêne, en menace le S.A., puis on en vient aux mains et finalement Kummerow se saisit du poignard du S.A. et frappe Moltzahn à l'abdomen. Les S.A. se précipitent au milieu du tumulte, Moltzahn dont la chemise brune se rougit de sang s'est effondré : on arrête Kummerow. L'Etat-major de la Sturmabteilung s'enflamme. Goebbels à Osnabrück lit les premiers communiqués. La S.A. réclame la dissolution de l'Association d'anciens combattants, « le coup de poignard de Quentzin a atteint tous les Allemands ». Les autres communiqués de la S.A. condamnent par avance tous ceux qui voudront faire de l'incident une affaire individuelle. C'est, selon la Sturmabteilung, une affaire politique « Je ne connais rien de pire que toi et ta S.A. » avait à plusieurs reprises répété Kummerow en s'adressant à des S.A. Après avoir frappé Moltzahn, Kummerow a même lancé : « Si seulement j'avais pu lui transpercer les tripes. » « Un chef de la S.A. qui a sauvé l'Allemagne a été tué », répètent les S.A. Il est sûr qu'ils cherchent à se présenter en victimes : ce ne sont pas eux qui sont responsables du désordre. C'est eux qu'on frappe quand on veut frapper le national-socialisme. Voilà quels sont les résultats de la politique « modérée » des hommes qui conseillent le Führer. Il faut réagir, lance comme mot d'ordre la S.A. après l'incident de Quentzin. On ne peut plus laisser massacrer les héros du national-socialisme, les valeureux chefs S.A. Que va tenter la S.A. ? Dans le climat tendu de cette fin de juin, la question circule, angoissante, de la Bendlsrstrasse au 8 Prinz-Albrecht-Strasse, le siège de la Gestapo. Ceux-là même qui ont fait naître les faux bruits d'un complot S.A. qu'il faudrait déjouer commencent à s'inquiéter. Si réellement les hommes de Rœhm prenaient de vitesse leurs adversaires et frappaient en se servant du moindre prétexte comme l'incident Quentzin ? On essaie, en ce 23 juin, de toucher Hitler mais il est en route pour son chalet de Berchtesgaden et on ne peut le joindre. Goebbels téléphone longuement à Heydrich, puis à Himmler.
A Berlin, dans tous les groupes qui sont hostiles aux S.A., un pas de plus est ainsi franchi : l'inquiétude, la crainte d'être devancés poussent les uns et les autres à brûler leurs vaisseaux.
Ce samedi 23 juin, en fin de journée, le Generaloberst Fromm, chef des services généraux de l'armée, a rassemblé les officiers qui sont sous ses ordres pour une conférence confidentielle. Elle se tient à la Bendlerstrasse. Ne sont présents dans la salle au sol pavé de marbre blanc, raides sur leurs chaises à haut dossier symétriquement rangées autour de la longue table noire, que des officiers supérieurs. Le Generaloberst après un bref salut annonce solennellement qu'il tient de source sûre qu'un projet de coup d'Etat — un coup d'Etat imminent — a été mis au point par le capitaine Rœhm qui compte agir avec l'aide des hommes de la S.A. L'armée doit être prête à intervenir pour assurer la défense de la légalité. Les officiers restent immobiles : ce n'est pas le lieu où l'on peut faire des commentaires.
Le lendemain, dimanche 24 juin, la nouvelle donnée par le generaloberst Fromm est confirmée : le général von Fritsch rassemble à son tour les officiers supérieurs présents à Berlin et leur ordonne de se préparer à faire échec à une tentative de putsch S.A. Toutes les informations, déclare Fritsch, tendent à prouver que le putsch S.A. est pour bientôt : quelques heures ou quelques jours au plus. Nécessairement, avant la mise en congé de la Sturmabteilung qui doit intervenir le 1er juillet. Les officiers supérieurs sont tenus de rassembler avec le maximum de discrétion leurs troupes et de les mettre en état d'alerte. Ainsi, après les S. S., la Reichswehr est donc à son tour sur pied de guerre. Et à Berlin, ce dimanche 24, les promeneurs d'Unter der Linden voient passer de nombreuses voitures de la police : depuis ce matin, elle aussi est en alerte. Autour des Sections d'Assaut, le piège se referme inexorablement.
Pourtant ces combattants des premières heures du nazisme, ces hommes qui ont participé aux assassinats et dont certains ont été mêlés à l'affaire de l'incendie du Reichstag, ces chefs S.A. qui, parce qu'ils connaissent le passé de leurs camarades aujourd'hui membres des S.S. ou de la Gestapo, qu'ils n'ignorent rien de tant de règlements de comptes maquillés en faits divers anodins, ces vieux Alte Kämpfer ne paraissent pas se méfier.
Devant la pension Hanselbauer face au lac, les voitures stationnent, les visites se succèdent, les S.A. de la région, les responsables qui arrivent de toute l'Allemagne sont détendus, joyeux. Certains, ce dimanche 24 juin, se précipitent dans l'eau glacée du lac de Tegernsee ; d'autres somnolent ou boivent. Rœhm plastronne, entouré de ses jeunes aides de camp, il répète, devant des auditeurs nouveaux chaque fois, qu'il a confiance dans le jugement du Führer, son vieux camarade Adolf Hitler qui, finalement tranchera en faveur de la Sturmabteilung. Certains chefs S.A. expriment des inquiétudes : Rœhm éclate de rire ou balaie d'un geste les objections : quand le Führer aura pris connaissance, ici-même, dans la grande salle de la pension Hanselbauer, des doléances des S.A., il ne pourra que s'incliner et leur donner raison. Et puis si... Le capitaine Rœhm n'achève pas ses menaces à demi formulées, de toute façon, elles se situent dans l'univers de l'impossible. Et la fête éclate dans ce dernier dimanche de juin, on chante le Horst Wessel Lied, on boit la bière légère de Munich. Tour à tour, les chefs S.A. présents lèvent leurs chopes, prononcent des allocutions à la gloire de la Sturmabteilung. On flétrit les associations d'anciens combattants responsables du meurtre de Quentzin. Rœhm dit quelques mots, puis l'on reprend en chœur des chants de guerre. Dans la petite ville, les curistes, paisiblement, longent le bord du lac. Des Munichois sont venus passer ce dimanche à la montagne : certains applaudissent ou saluent quand ils croisent les voitures des S.A. Il fait beau, l'air est vif et les uns encourageant les autres, des S.A. plongent à nouveau dans les eaux du lac.
LES DERNIERS PREPARATIFS
Pendant que les S.A., le corps nu, s'ébrouent dans l'eau bleutée du Tegernsee, au siège de la Gestapo, à Berlin, Himmler et Heydrich reçoivent les responsables S.S. d'Allemagne : la plupart sont arrivés à Berlin la veille et ont passé la nuit dans les casernes S.S. ou bien au 8 Prinz-Albrecht-Strasse. Maintenant, alors que Berlin sous le ciel d'été s'apprête à vivre un dimanche de détente, les officiers de l'Ordre noir sont réunis autour de leurs chefs. C'est Heydrich qui parle : toujours efficace et glacé, il va droit au but ; l'Etat-major de la Sturmabteilung, dit-il, prépare une révolte qui va être déclenchée avant peu, d'ici à quelques jours. Les mots tombent comme un couperet ; cette révolte S.A. devra être prévenue — Heydrich insiste sur le terme — et réprimée avec la plus extrême rigueur. Les listes des conjurés S.A. et de leurs complices ont été fournies déjà sous pli scellé aux différentes formations S.S. Le moment venu, l'exécution des ordres devra se faire sans défaillance. Avec la rigueur nationale-socialiste. Les complices qui n'appartiennent pas à la S.A. devront aussi être pourchassés. Il faudra suivre les consignes, sans considération du passé des complices, de leur grade dans la S.A. ou la Reichswehr.
Les chefs S.S. écoutent, enregistrent la détermination de Heydrich et de Himmler. Chez certains d'entre eux qui ont, pour différentes raisons, eu à souffrir des S.A., que la réussite de tel ou tel ancien camarade a ulcérés, la joie monte : enfin le jour est proche où leur rancœur accumulée deviendra action politique bienfaisante pour l'Allemagne. Et ils liquideront aussi ces prétentieux qui ergotent et contestent parce qu'ils sont généraux de la Reichswehr ou conseillers de Franz von Papen.
Ce jour précisément, ce dimanche tranquille de juin où un degré de plus est franchi, le général von Schleicher regagne Berlin. Des amis sûrs, sans doute en poste à la Bendlerstrasse, l'avaient averti, au printemps, du danger qu'il pouvait courir. Il a entrepris un long voyage en voiture, après avoir séjourné un temps sur les rives apaisantes et verdoyantes du lac de Starnberg.
Maintenant, avec sa femme, il rentre dans la capitale et retrouve sa villa bourgeoise et cossue des faubourgs. Une fois de plus, il lui semble que son flair ne l'a pas trompé : le calme règne. Ses amis s'étaient inquiétés à tort. La vie va reprendre son cours. Schleicher ne se doute pas que ce même jour Heydrich, Himmler et les chefs S.S. achèvent leurs derniers préparatifs. Il ne sait pas qu'il figure sur leurs listes et que le dimanche 24 juin, coloré par la joie qu'il éprouve à retrouver Berlin, est son dernier dimanche.
Il ne voit pas, lui qui s'imagine être le général le plus politique et le plus habile de la Reichswehr, les signes qui s'accumulent : non seulement les voitures de police qui circulent lentement comme pour surveiller la ville pourtant tranquille, mais aussi cette interview du Chancelier Hitler qui paraît dans le News Chronicle et dans laquelle le Führer parle du « sacrifice », peut-être nécessaire « des amis des premiers jours ». Sans doute le général Schleicher comme tant d'autres Allemands et les chefs S.A., est-il rassuré par l'absence de Hitler dont la radio et la presse annoncent qu'il se repose dans son chalet de Berchtesgaden. Comment une opération brutale pourrait-elle se préparer alors que le Führer n'est pas à Berlin, qu'il pose pour les photographes en culotte tyrolienne et reçoit ses intimes dans le grand salon vitré qui domine les alpages ?
Et les cinquante mille personnes qui se rassemblent dans un grand parc de la banlieue sud de Berlin pour assister à la messe dominicale célébrée par Mgr Barres sont, elles aussi, tranquilles. Dans l'herbe courte et drue, les fidèles s'agenouillent, en longues files, ils se dirigent vers l'autel pour communier, puis le Dr Klausener, directeur général des Travaux publics du Reich, qui fait figure de leader des catholiques allemands, prend la parole. Son discours est modéré : il adresse même quelques éloges au gouvernement et se contente de réclamer le droit, pour les catholiques, de célébrer dignement leur culte. Mais n'est-ce pas précisément ce qu'ils font, ce qu'ils viennent de faire et n'y a-t-il pas là la preuve que tout est calme dans le IIIeme Reich ?
Le Dr Klausener est applaudi vigoureusement avec calme, résolution et tranquillité.
Au même moment dans une autre banlieue, l'enthousiasme se déchaîne sur le stade de Berlin. Des dizaines de milliers de spectateurs crient leur joie en agitant des drapeaux à croix gammée et des drapeaux bavarois ; à la dernière minute de jeu, l'équipe de football de Oberhausen, la célèbre Schalke 04 vient de briser le match nul et de marquer le but décisif contre le I.F.C. Nuremberg : elle remporte le championnat d'Allemagne. La foule reste longtemps sur les gradins à commenter les dernières passes : Kalwitzki a « feinté » deux défenseurs et glissé la balle à l'avant de Oberhausen Kuzonna qui a marqué. Puis la foule s'écoule joyeusement, les enfants sont sur les épaules de leurs pères, des ouvriers endimanchés des faubourgs de Berlin discutent âprement avant de se rendre dans les brasseries trinquer au vainqueur. Tout paraît normal dans la capitale, joyeux même, parce que la journée d'été est longue.
Les voitures noires des chefs S.S. qui regagnent leurs régions croisent à la sortie de la ville des groupes qui reviennent du rassemblement catholique ou du stade. Les S.S. passent, la foule s'écarte, des S.A. mêlés à elle saluent, goguenards.
Ces hommes en chemise brune que peuvent-ils craindre ? Ne sont-ils pas toujours les puissants Alte Kämpfer auxquels les ministres eux-mêmes rendent hommage ? Les S.A. de la Ruhr, mêlés aux travailleurs aux visages burinés, à la peau racornie et comme brunie par la lueur des forges et des fours sont rassemblés depuis le dimanche matin 8 heures 40 dans le hall n° 5 de la foire-exposition d'Essen-Mülheim. Ce grand bâtiment de ciment armé, démesurément long, gris, triste, avec sa voûte en arc brisé, ressemble au temple austère de l'industrie, puissante et sinistre. Une large allée a été aménagée au centre et les sièges ont été disposés de part et d'autre. Des drapeaux, d'immenses étendards à croix gammée, pendent des balcons, couvrent la tribune qui a été aménagée au milieu du hall. S.A., travailleurs, jeunes des organisations nazies attendent depuis le matin et sous la voûte résonnent les éclats de voix, montent les vapeurs de milliers d'haleines car, dans ce hall de ciment, la température n'est pas élevée. A 8 heures 45, le chef régional de la Hitler-Jugend grimpe à la tribune : la grande démonstration a commencé. Il faut lutter contre les préjugés sociaux et l'esprit de classe, on va brûler, lance-t-il, les casquettes des lycéens et des étudiants qui sont le signe des hiérarchies passées. Certains, dans le hall, commencent à hurler de joie, et les cris redoublent quand on annonce l'arrivée de Rudolf Hess : « Il faut une discipline à la jeunesse » dit l'adjoint du Führer, et les cris d'exploser. Bientôt, après que Hess a terminé son allocution, ce sont les chants qui retentissent, les S.A. présents crient avec les jeunes et quand, vers 10 heures, la voiture découverte où ont pris place Ley et Goebbels arrive devant le hall, c'est un salut violent qui court sous la voûte.
Les deux ministres portent une casquette, Goebbels, sur sa veste, arbore un brassard à croix gammée et assis à côté de Ley, Ley corpulent et massif, le ministre de la Propagande ressemble à un être inachevé, rabougri, grimaçant. Les deux ministres vont faire appel à la discipline. « Le pouvoir atteint son apogée, lorsque la violence n'est pas nécessaire » dit Ley. Pourtant Goebbels après avoir répété une formule voisine, lance, le poing serré, des attaques contre les ennemis du régime : « Ils se manifestent sous bien des masques, tantôt ils apparaissent comme des officiers de réserve ou comme des intellectuels ou comme des journalistes ou encore comme des prêtres », dit-il. Les S.A. présents hurlent à tout rompre. Karl Kuhder se souvient, il était au fond du hall, près de la porte avec d'autres S.A. Quand Goebbels a ajouté : « En fait, c'est toujours la même clique... Elle n'a rien appris. Elle ferait aujourd'hui ce qu'elle a fait hier », lui et ses camarades ont « reconnu leur Goebbels et leur Reich». Enfin, à nouveau dur aux Junkers, aux officiers, aux intellectuels. Karl Kuhder et ses camarades ont acclamé Goebbels. « Nous avions tellement crié, dit-il, que nous étions totalement sans voix. » Ils n'ont pas écouté Goebbels répéter : « Notre révolution s'est développée sous le signe de la discipline et de la loyauté », mais ils ont hurlé de joie quand il a lancé : « Je suis persuadé que nous avons le pouvoir de faire tout ce que nous jugeons utile. Notre pouvoir est illimité. »
« Notre pouvoir est illimité » reprennent les S.A. et les jeunes de la Hitler-Jugend. Ils courent le long de l'allée, accompagnant Goebbels jusqu'à sa voiture. Une ovation salue son départ. « Nous croyions que l'on nous avait enfin donné raison, nous en étions sûrs », dit encore Karl Kuhder. Goebbels ne venait-il pas de condamner tous les Papen d'Allemagne, ceux que Rœhm et les siens dénonçaient depuis des mois et des mois ? Karl Kuhder ajoute : « C'est vers 12 heures que Goebbels a quitté le hall d'Essen. On disait qu'il partait en avion pour Hambourg, qu'il devait assister au Derby allemand. »
LE DERBY DE HAMBOURG
Le ciel, au-dessus de Hambourg, est gris, des nuages légers mais tenaces s'effilochent en bandes parallèles. Il tombe une petite pluie fine : la foule est considérable. Le Derby, créé en 1869, attire toutes les catégories sociales. Sur la pelouse, de nombreux ouvriers de Hambourg, des employés se pressent malgré la pluie. Un train spécial a amené, de Berlin, de nombreux diplomates qui doivent aussi assister à la Kieler-Woche — les régates de Kiel. Les personnalités, la plupart en uniforme, se saluent dans les tribunes. On reconnaît des membres du gouvernement du Reich, du gouvernement de Prusse, le Reichssportführer Tschammer von Osten. Sur la route qui vient de Hambourg, s'étire une file de voitures longue de plus de 5 kilomètres. Brusquement, une automobile officielle, escortée par deux motocyclistes double la file et on reconnaît Franz von Papen qui assiste au Derby. Il gagne la tribune centrale. De toutes parts, on accourt vers lui, les applaudissements éclatent. Le vice-chancelier raconte : « Je me rendis à Hambourg, pour assister au Derby d'Allemagne. A peine eus-je atteint les tribunes que des milliers de gens accoururent vers moi en criant « Heil Marburg, Marburg ! » Une manifestation vraiment inattendue de la part des Hambourgeois d'habitude plutôt flegmatiques, d'autant plus qu'il s'agissait d'une fête purement sportive ». Au fur et à mesure que la foule apprend la raison de ces applaudissements ils redoublent, on s'avance vers les tribunes. « Je pouvais à peine faire un pas sans me trouver bloqué par des centaines d'hommes enthousiastes, si bien que je commençais à me sentir quelque peu gêné », dit encore Franz von Papen.
Des officiers S.S. affichent leur mépris. Des S.A. bardés de décorations quittent les tribunes : la manifestation spontanée a un sens politique clair. On approuve Papen d'avoir su clamer quelques vérités sur le fonctionnement du IIIeme Reich.
Cependant les chevaux se sont présentés et l'attention se détourne de Papen. C'est la première course : Orchauf, à l'extérieur, une magnifique bête nerveuse, tendue, piaffe, alors que les jockeys tiennent bien en main Agalire qui est à l'intérieur, Palander au deuxième rang. Très vite, Graf Almaviva prend la tête du peloton qui court sous le ciel bas, dans le silence entrecoupé d'acclamations lointaines qui déferlent brutalement quand Athanasius, l'un des favoris, démarre, talonné par Blintzen. Course magnifique que ne trouble même pas le temps puisque la pluie a cessé : on voit simplement jaillir sous les sabots rageurs des chevaux des éclats de boue. A la fin de la première course, on entend à l'entrée du champ de course des acclamations, des mouvements agitent la foule, des officiers courent : le ministre Joseph Goebbels arrive d'Essen où il vient de prononcer un discours. On l'aperçoit qui gesticule, paraît s'indigner. Des informateurs lui racontent la manifestation en faveur de Papen. Il proteste, refuse de se trouver assis, à la tribune d'honneur, aux côtés de l'homme qu'il vient d'attaquer à Essen et qui symbolise cette « clique qui n'a rien appris ». Il se rend donc sur la pelouse parmi « les travailleurs du poing », le peuple des ouvriers allemands. On le reconnaît, on l'acclame. Papen note seulement : « Il obtint quelques applaudissements isolés — les Hambourgeois sont des gens polis — mais ce fut tout. »
Papen hésite un instant puis sentant que la foule lui est favorable, il prend la décision d'affronter Goebbels. « Je résolus, raconte-t-il, de profiter au maximum des bonnes dispositions du public. C'était au fond une excellente occasion de me rendre compte si mon discours de Marburg avait plu aux seules classes supérieures ou s'il avait rencontré l'approbation des masses laborieuses. Je suivis donc Goebbels aux places à bon marché. Là, ma réception fut encore plus chaleureuse. Débardeurs, étudiants, ouvriers me firent une ovation délirante. Cette fois, c'en fut trop pour Goebbels. Vert de rage, il décida de ne pas assister au banquet officiel ».
Le ministre de la Propagande quitte donc le champ de courses. Il regagne la capitale allemande. A Gœrlitzer, Gauleiter adjoint de Berlin, il déclare : « Cet animal de Papen est beaucoup trop populaire. Essayez donc, dans vos journaux, de le rendre ridicule. » Heydrich et Himmler sont immédiatement avertis de la manifestation du Derby. Hitler, dans son chalet de Berchtesgaden reçoit aussi de Goebbels un récit détaillé. Il y a les clameurs enthousiastes d'Essen, la Jeunesse hitlérienne qui a hurlé sa joie, les fêtes du Solstice durant lesquelles ont brûlé les torches et les feux de la ferveur germanique où communient le nazisme et les mythes païens. Mais, il y a aussi tous les Papen, les Klausener ; cette constellation imprécise d'opposants plus ou moins déterminés, et aussi ces S.A. qui, autour de Rœhm, à Bad Wiessee attendent, espèrent tirer parti des agitations de la « clique » réactionnaire dénoncée par Goebbels.
Le Führer écoute, médite, se repose. Il regarde les sommets glacés. Il lui faut choisir : de part et d'autre il sent l'impatience monter. Papen pousse ses avantages, Roehm rassemble ses troupes, Himmler et Heydrich lancent déjà leurs tueurs sur les routes du Reich et les soldats de l'Ordre noir n'attendent plus qu'un signe pour traquer leurs victimes. Heure après heure, alors que l'Allemagne se passionne pour les résultats du Championnat national de football, que les joueurs enregistent que, dans le pari couplé du Derby de Hambourg, lors des deuxième et troisième courses, Tilly et Mitternach sont dans les rapports gagnant 204 et placé 10, que les Munichois, après la journée du dimanche passée à Bad Wiessee, regagnent la capitale bavaroise, que dans la pension Hanselbauer les chefs S.A. somnolent, heure après heure, alors que l'Allemagne vit dans l'ignorance et la quiétude de ce dernier dimanche de juin, le moment du choix et de l'action s'est encore rapproché pour le Führer.
Franz von Papen rejoint Berlin quelques heures après Goebbels. Le banquet offert par la ville de Hambourg aux différentes personnalités présentes au Derby a été animé. Seuls, agressifs, quelques officiers de la Sturmabteilung qui boivent beaucoup et parlent haut ont ignoré ostensiblement le vice-chancelier. Après une courte nuit de sommeil, Papen a, à nouveau, quitté la capitale dès le matin du lundi 25 juin. Il doit assister, en Westphalie, au mariage de sa nièce.
Mais, durant toute la cérémonie solennelle, à laquelle assistent de nombreux officiers de la Reichswehr, Franz von Papen se montre distrait, inquiet. Son secrétaire particulier, à plusieurs reprises, lui remet de courts messages, des dépêches. Et le visage du vice-chancelier se crispe : il sourit aux jeunes époux, aux parents, mais on devine que son esprit est ailleurs. C'est que de Nuremberg à Cologne, les attaques contre lui se multiplient. Papen a trop pratiqué les milieux gouvernementaux et politiques pour ne pas sentir que l'atmosphère se tend en Allemagne, que les nazis — le pouvoir — se préparent à agir.
A Nuremberg, c'est Gœring qui prend la parole. « Nous n'avons pas besoin de froide raison, il nous faut de l'ardeur » martèle-t-il. Son lourd visage empâté, où le dessin régulier des traits est enseveli sous la graisse pâle, est secoué tout entier par l'effort. De grands événements se préparent, dit-il, menaçant. « On verra bientôt que l'Allemagne diffamée est la plus grande des nations civilisées ». Papen médite ; quels sont ces grands événements ? On lui transmet un autre texte : Hess parle en ce moment même à la radio de Cologne et son discours est retransmis par tous les émetteurs d'Allemagne. Ce discours du deuxième personnage du Parti, un lundi, ne peut que surprendre. Pourquoi cette visite inopinée de Hess à Cologne, ces officiels rassemblés à la hâte sur le terrain d'aviation de Butzweilerhof, le Sturm S.A. qui rend les honneurs constitué en dernière minute et le Gauleiter Grohé, le Brigadeführer Hovel qu'on a retrouvés in extremis pour les conduire au champ d'aviation afin d'accueillir le ministre du Reich ? Celui-ci n'a qu'un seul but : se rendre à la maison de la radio et y prononcer un discours, puis repartir pour Berlin. Etrange procédé qui marque à la fois la détermination et l'improvisation, comme si une décision venait d'être prise qui mûrissait depuis longtemps et qu'il fallait immédiatement faire passer dans les actes, fût-ce un lundi, fût-ce sans aucune apparence de prétexte. Et le discours de Hess est violent, exalté, mais aussi imprécis, menaçant tout le monde, Papen et Rœhm, répétant seulement : « Une seule personne est au-dessus de toute critique : le Führer. Chacun sait qu'il a toujours eu raison et qu'il aura toujours raison. Dans la fidélité aveugle, dans l'abandon total au Führer sans que jamais on ne demande le pourquoi des choses, dans l'exécution sans restriction de tous ses ordres, est la racine même de notre national-socialisme. Le Führer obéit à un appel, à une vocation plus haute. Il a la tâche de former les destins de l'Allemagne. » Hess attaque les « critiqueurs » puis il détache mot à mot les phrases qui sont autant de sombres avertissements. « Malheur à celui qui, chaussé de lourdes bottes, veut avec maladresse se glisser dans la trame subtile des plans stratégiques du Führer, s'imaginant parvenir au but plus rapidement. C'est un ennemi de la révolution. » Qui, sinon Rœhm et ses S.A. impatients, peut être visé ? Et l'avertissement retentit encore: « Seuls les ordres du Führer à qui nous avons juré fidélité sont valables. Malheur à celui qui devient infidèle, malheur à celui qui croit pouvoir servir la révolution par une révolte ! »
Malheur sur celui-là ! Et qui d'autre que Rœhm cette malédiction peut-elle viser ? Mais Franz von Papen demeure inquiet : il sait que les révolutions pratiquent souvent l'amalgame et que dans les charrettes qui cahotaient sur les pavés de Paris en 1794 on trouvait, côte à côte, destinés à la même guillotine, un ci-devant noble, officier de l'armée royale et un enragé ou un girondin, révolutionnaires rejetés ou dépassés. Pourquoi Hitler ne jetterait-il pas dans le panier de son, la tête de certains S.A. et celles de certains modérés, la tête du reître Rœhm et la tête du gentlemen-rider Papen ?
Les radios de toutes les villes d'Allemagne reprennent le discours de Hess, les journaux l'impriment à la hâte sous le titre « Seul le Führer ordonne les révolutions ». Et pourtant les chefs S.A., à Bad Wiessee ne se sentent pas concernés. Hitler ne doit-il pas venir s'expliquer avec eux ? Que craindraient-ils de leur Führer ? Ailleurs dans les villes et les villages d'Allemagne c'est aussi la même passivité comme si la politique, les avertissements de Hess, répétés pourtant, ne concernaient que quelques groupes.
« IL EST TROP TARD MAINTENANT »
A Oberhausen, on se soucie bien peu de ce que dit le ministre Hess. Toute la ville est dans la rue pour accueillir la Schalke 04 qui rentre de Berlin après son match victorieux ; la gare est assiégée : les S.A., les S.S., la police ferroviaire, tous sont débordés par la marée humaine qui acclame les joueurs, et surtout l'avant Kuzonna qui a marqué le but décisif. On lui pose sur les épaules une couronne en feuillage, énorme, qui lui descend au-dessous des genoux, puis le défilé commence dans la ville pavoisée. L'équipe de football est entassée dans deux voitures découvertes et toute la population la salue avec enthousiasme. Qui se soucie de Hess, des S.A., de la Gestapo? La foule est là dans la fête populaire, toute une ville détendue et joyeuse agitant des drapeaux, ovationnant les vainqueurs d'un match de football comme dans n'importe quel régime démocratique où personne ne craint la brutale intervention des hommes armés, les persécutions des S.S. et des S.A. qui saluent le bras levé, mais que la foule ignore. On se croirait en Angleterre, dans l'une de ces villes industrielles où l'acier est roi ou bien en Suède. Oberhausen, ce lundi 25 juin, ce pourrait être la cité ouvrière de l'un de ces pays tranquilles, qu'enthousiasme le sport et qui ont oublié depuis des siècles les putschs, les complots, les polices secrètes et leurs tueurs, qui n'ont pas au cœur de l'Etat, une puissance respectée, inquiétante, la Reichswehr.
La Reichswehr, alors qu'on crie dans les rues d'Oberhausen, est sur ses gardes. Elle attend le putsch des S.A. Les officiers sont tenus d'avoir en permanence à portée de la main une arme. Certains s'insurgent : ils ne croient pas à la menace et refusent d'être dupes de ce qu'ils sentent être une machination. Quand un lieutenant vient, parce qu'il en a reçu la consigne, placer dans le bureau du colonel Gotthard Heinrici, des services généraux de l'armée, un fusil, pour qu'il puisse se défendre contre les S.A., Gotthard Heinrici s'emporte : « Je vous en prie, crie-t-il, ne vous rendez donc pas ridicule ! » Dans de nombreuses casernes ou dans les bureaux d'Etat-major des officiers ont des réactions semblables.
En Silésie, le général Ewald von Kleist commande les troupes de la région militaire. C'est un officier remarquable, un militaire qui a le sens de l'honneur et une haute idée des principes. Depuis plusieurs jours des avertissements lui annoncent que la Sturmabteilung s'apprête à agir. Les dépêches proviennent de la Bendlerstrasse et de la Gestapo. Finalement, le général prend contact avec Heines qui commande les S.A. en Silésie : celui-ci nie, jure tout ignorer, et Kleist, sceptique déjà, se rend à ses arguments. Ne se trouve-t-on pas avec ces fausses alertes, ces rumeurs, en face d'une provocation montée par un groupe, sans doute les S.S., afin de dresser l'armée contre les S.A. pour permettre à l'Ordre noir de tirer parti de l'affrontement ? Kleist se rend immédiatement à Berlin. A la Bendlerstrasse, il lui est impossible d'attendre patiemment, il fait les cent pas dans l'antichambre du général Fritsch qui, sur la foi de nombreux rapports, a transmis les ordres d'alerte aux différentes unités. Finalement Kleist est reçu. Après quelques mots, sans hésiter, il dit son inquiétude, analyse le cas de la Silésie où tout est calme chez les S.A., il multiplie les arguments, et Fritsch peu à peu est ébranlé. La Reichswehr serait-elle dupe ?
On convoque Reichenau. Il arrive, raide, sanglé dans son uniforme. Il écoute sans bouger, sans manifester la moindre surprise ; Reichenau est au cœur de la machination. Il sait, mais pendant que le général Fritsch parle, et malgré son impassibilité distante, Reichenau s'inquiète : les scrupules d'hommes comme Kleist peuvent fort bien freiner l'action, sinon la compromettre. Et plus le temps passe, plus les doutes et les réticences d'officiers peuvent s'accroître. Il faut aller de l'avant, prendre de vitesse les hésitants, entraîner les tièdes, passer aux actes pour créer l'irréversible. Reichenau dans le grand bureau du général Fritsch regarde Kleist puis Fritsch et ne se donne même pas la peine de discuter leurs thèses.
« De toute façon, dit Reichenau sèchement, il est trop tard maintenant. »
6
SAMEDI 30 juin 1934
En vol au-dessus du Taunus. 2 heures 30
(du mardi 26 au jeudi 28 juin 1934)
LES S.S. A KAUFERING
Samedi 30 juin, 2 h. 30. Le bruit des moteurs dans le Junkers rend difficile toute conversation. Il faut crier pour se faire entendre, et Joseph Goebbels s'y essaie, parlant avec Lutze. Cela fait environ une demi-heure que l'appareil a quitté Bonn-Hangelar. Le ciel est clair. Hitler est dans la cabine aux côtés du pilote, le col de son manteau de cuir relevé, il est penché en avant et, Goebbels l'indiquera plus tard, « il a le regard fixé devant lui, il regarde sans mouvement l'obscurité infinie ». Le Führer se tait. De temps en temps, le pilote lui donne une indication, criant un nom de ville et montrant du doigt le damier irrégulier dessiné par les lumières clignotantes. On a ainsi aperçu Ems, Nassau, laissées sur la droite de l'appareil, vite disparues ; l'avion, progressivement, a pris de la hauteur et maintenant il survole la ligne de crête du Feldberg qui fait une barre plus sombre. Légèrement à droite, encore, on distingue, scintillant faiblement, le confluent du Main et du Rhin et, paraissant voisines, Wiesbaden et Mayence entourées d'un halo lumineux. Régulièrement, résonnant dans la cabine, la voix du technicien d'une station de contrôle de vol, donne des indications sur le temps au-dessus du Steigerwald, de la Frankenhöhe, ces hauteurs moyennes qui courent comme des nervures sur le sol de l'Allemagne. Sur toute la région, jusqu'à Munich, le ciel est clair : le pilote signale au Führer qu'il va obliquer plus nettement vers le sud-est, gagner directement Munich.
Il est 2 h 30. Tout le monde dort dans la pension Hanselbauer au bord du lac de Tegernsee. Dans l'une des petites chambres, Edmund Heines a passé son bras autour de l'épaule d'un jeune S.A. et l'attire contre lui, lui demandant de rester avec lui, de ne pas rejoindre les autres, de prolonger les gestes amoureux par cette promiscuité du sommeil commun, côte à côte. Il aura bien le temps, au petit matin, de quitter discrètement la chambre. Le jeune S.A. somnolent, s'endort.
A Kaufering, les ordres claquent Les S.S. de la Leibstandarte dans le bruit des bottes qui frappent le sol exécutent mécaniquement les gestes de la mise en rang : ils redeviennent à nouveau un seul groupe, chacun d'eux lié à son voisin, pièce d'une machine efficace, exécutants sélectionnés et dressés. Le Gruppenführer S.S. Sepp Dietrich vient d'arriver. Il parle d'une voix gutturale : obéir, les traîtres doivent être mis hors d'état de nuire quelles que soient leurs fonctions, leur passé. L'état-major S.A. est un nid de traîtres, de débauchés, nous de la S.S. Leibstandarte, nous allons nettoyer ce bourbier, défendre l'honneur de l'Allemagne et protéger le Führer. Heil Hitler, Heil ! Dans la nuit, les cris achèvent de souder les hommes les uns aux autres. Les camions s'avancent. Les deux compagnies de S.S. s'installent en silence. Entouré des officiers, les mains derrière le dos, les jambes écartées dans une attitude qui lui est familière, un sourire de satisfaction sur les lèvres, le Gruppenführer Sepp Dietrich surveille la scène. Il connaît la direction du convoi : pension Hanselbauer, Bad Wiessee, sur les bords du lac de Tegernsee.
LE DOCUMENT SECRET DU CAPITAINE PATZIG
Sepp Dietrich n'est pas qu'un exécutant : il est l'un des chefs S.S. sur qui se sont appuyés Himmler et Heydrich pour monter leur piège. Un piège qu'il faut perfectionner chaque jour parce qu'il est menacé par tous ces impondérables qui font que tant de conspirations politiques minutieusement préparées, paraissant bénéficier de tous les appuis, se sont effondrées comme château de cartes pour une confidence imprudente ou l'action inattendue d'un homme pris de scrupule.
Heydrich sait cela : c'est un méthodique. Quand Reichenau l'avertit que les généraux von Kleist et von Fritsch commencent à avoir des doutes sur la réalité du complot S.A., il réagit. Il faut accentuer les inquiétudes des officiers : leur montrer que les S.A. les menacent réellement. La Gestapo est déjà experte en matière de fabrication de documents.
Le mardi 26 juin, Sepp Dietrich se présente à la Bendlerstrasse, demande à voir un officier du cabinet du général Blomberg, et lui transmet un document confidentiel qu'il aurait obtenu d'un Führer de la S.A., révolté par le texte du plan. Blomberg quand il prendra connaissance quelques instants plus tard du document sera saisi de panique et de colère : l'état-major de la Sturmabteilung prévoit la liquidation, au cours du putsch, de tous les officiers supérieurs de la Reichswehr. Il faut purger l'armée de ces conservateurs bornés, dit le texte, les remplacer par des officiers révolutionnaires ; les généraux Beck et Fritsch sont nommément désignés comme devant figurer parmi les premières victimes.
Ce même jour, le capitaine de corvette Patzig pénètre comme à l'habitude dans son bureau. Il a longtemps servi dans la marine, mais depuis quelques mois il dirige le service de renseignements de l'armée, l'Abwehr, que la défaite de 1918 n'a pu démanteler et qui a constitué dans les années noires l'âme secrète de la Reichswehr, âme de la nation vaincue. Or, sur sa table de travail, bien en évidence, le capitaine Patzig trouve un document. Consultés, les plantons, les officiers de service diront tout ignorer de sa provenance. Il est là, mystérieux, explosif : il s'agit en effet de la copie d'un ordre donné par Rœhm à la S.A., pièce secrète décidant l'armement immédiat de la Sturmabteilung. N'est-ce pas la preuve décisive de la préparation d'un putsch S.A. ? Patzig avertit ses supérieurs et peu après le général von Reichenau pénètre dans le bureau du chef de l'Abwehr. Reichenau, son monocle fixé dans l'arcade sourcilière droite, lit le document puis sans un regard pour Patzig s'exclame : « La coupe est pleine. Je vais trouver le Führer. »
Mais le Chancelier Hitler n'est pas encore rentré à Berlin. Il s'attarde à Berchtesgaden, il laisse les uns et les autres abattre leurs cartes, se dévoiler : pour gagner avec certitude, il n'y a qu'une règle et le Führer ne l'ignore pas : il faut connaître le jeu de l'adversaire. Hitler reste donc dans son chalet. Il reçoit des délégués des villages voisins, caresse les joues des enfants des montagnards. Le général von Reichenau insiste auprès du secrétariat de la chancellerie, on lui répond que Hitler rentrera sans doute demain, mercredi 27 juin, mais il ne séjournera pas dans la capitale.
Reichenau regagne donc la Bendlerstrasse. L'absence de Hitler accentue le malaise général et le sentiment que tout demeure possible. Or l'Abwehr a un autre renseignement à soumettre à Reichenau. Dans un des bâtiments assignés à la S.A. (le siège de la Reiterstandarte 28), situé en face du domicile d'un diplomate français, les membres de la Sturmabteilung s'entraînent régulièrement au tir à la mitrailleuse lourde. Le diplomate français a sûrement transmis un rapport à Paris car les tirs s'entendent de la rue. Et il y a moins d'une semaine qu'ils sont commencés. L'indication est grave : plus sérieuse que celles contenues dans les documents transmis par l'Oberführer S.S. Sepp Dietrich ou trouvés par hasard sur le bureau du capitaine de corvette Patzig.
Les coups sourds des mitrailleuses S.A. résonnent dans la tête de tous ceux qui préparent l'action contre Rœhm et ses hommes. Himmler, Heydrich, Reichenau, eux qui ont fabriqué ou utilisé les documents compromettants pour la Sturmabteilung, les voici devant des faits qui semblent prouver que la réalité est bien telle qu'ils ont voulu la présenter. Les S.A. s'entraînent, ils ont des mitrailleuses lourdes et si, effectivement, ils entraient en action, et si réellement, le putsch avait lieu ? Comme toujours ceux qui agissent dans l'ombre sont prêts à voir partout des hommes s'affairant dans l'ombre à d'autres conspirations. Chez Himmler et Heydrich la peur maintenant s'ajoute à la détermination.
Gœring lui-même semble inquiet. Le mardi 26 juin, il parle à Hambourg. Auditoire mêlé où l'on reconnaît les grands bourgeois du port et les nazis dont certains sont parfois d'anciens employés modestes. On entend de temps en temps le bruit des sirènes des navires. Gœring est tout bonhomie, il n'est plus le tribun tonitruant de Nuremberg. Il ne menace plus, il n'insulte plus les conservateurs, au contraire, il prêche l'union autour de Hitler et cela dit assez qu'il est, lui aussi, saisi par la crainte. « A ceux qui veulent l'ordre dans le pays, à ceux qui regrettent parfois la grandeur et la discipline de l'époque impériale, dit Gœring, nous affirmons qu'Adolf Hitler est le seul homme capable de rendre à l'Allemagne sa force, le seul capable de faire respecter les anciens soldats des Hohenzollern... Nous qui vivons aujourd'hui, réjouissons-nous d'avoir Adolf Hitler. » Peut-être pour Gœring le bruit des mitrailleuses de la Sturmabteilung efface-t-il un peu l'écho des paroles de Franz von Papen à Marburg. D'ailleurs, Hermann Gœring, le héros de 14-18, élevé au grade de général par Hindenburg, veuf de Karin, l'aristocrate suédoise, est le plus conservateur des nazis, celui qui est le plus proche des Junkers, de l'Offiziers-korps, de la Reichswehr. Rien d'étonnant à ce qu'il essaie de maintenir les liens avec les conservateurs.
Parfois on le soupçonne de préparer son avenir personnel et de se soucier moins du régime nazi que de sa carrière. On l'observe, on le surveille : le général von Reichenau, cet ambitieux glacé, craint même qu'un jour Gœring ne soit le grand ministre de la Reichswehr, peut-être d'un nouveau Reich. La hargne de Reichenau contre les S.A., les liens qu'il a noués avec la Gestapo et l'Ordre noir de Himmler et de Heydrich, peut-être ne sont-ils qu'un moyen de se défendre contre le général Gœring, de le paralyser.
Dans ce grouillement d'ambitions, d'intrigues et de rivalités qu'est le grand IIIeme Reich nazi, chacun se défend contre tous. Sont vos alliés ceux que l'on tient. Hermann Gœring, parce qu'il pense avoir besoin des conservateurs, peut bien pardonner le discours de Marburg, d'autres se souviennent et ne pardonnent pas.
LA DISPARITION DE JUNG
Le vice-chancelier Franz von Papen a décidé de passer la journée du mardi 26 juin en Westphalie, auprès des siens. Le banquet qui a suivi le mariage de sa nièce s'est prolongé fort tard dans la nuit, et Papen, fatigué par plusieurs jours d'activité, compte consacrer la journée du mardi au repos. Il a fait une longue promenade dans la matinée, bavardant avec son secrétaire mais, au début de l'après-midi, une communication de Berlin met fin à sa brève quiétude : « Le 26 juin, raconte-t-il, Tschirschky m'appela au téléphone pour m'apprendre que Edgar Jung, un de mes collaborateurs officieux, venait d'être arrêté par la Gestapo ». Jung : c'est un journaliste, un homme de lettres au style brillant et au réel courage politique. Il a assuré pour le compte de Papen la liaison avec le maréchal Hindenburg, installé à Neudeck, et surtout il a rédigé le discours de Marburg, que Papen et ses collaborateurs ont à peine modifié. La Gestapo sait tout cela. Elle veut en savoir davantage et elle ne pardonne pas.
Et les amis de Jung, maintenant, relèvent des traces du passage des hommes de Himmler et de Heydrich. C'est la femme de ménage de Jung qui a donné l'alerte. Elle est arrivée ce mardi matin vers 9 heures. Elle a ses clés. Dès qu'elle a eu ouvert la porte, la peur l'a saisie. Des vêtements sont répandus sur le sol de l'entrée ; dans le bureau, les tiroirs sont ouverts, les papiers en désordre témoignent d'une perquisition hâtive. Dans la chambre, les meubles sont renversés, le lit défait ; sans doute Jung a-t-il été surpris durant son sommeil et a-t-il tenté de résister. La femme de ménage a téléphoné, affolée, à tous ceux dont elle sait qu'ils sont des amis de Jung. Elle n'a pas averti la police : sur un mur, elle a reconnu l'écriture de Jung qui a dû être autorisé à se rendre dans la salle de bains et a pu tracer ce mot au crayon : GESTAPO. Dans l'appartement bouleversé, les collaborateurs du vice-chancelier, les proches de Jung sont atterrés. Le désordre et la violence sont là dans les vêtements froissés et les papiers répandus, dans le mot GESTAPO, avertissement sinistre qui annonce pour l'Allemagne les malheurs à venir. Que peut-on faire ? On cherche Papen et finalement Tschirschky réussit à l'atteindre en Westphalie. Papen se fait répéter les détails pour pouvoir réfléchir en écoutant une nouvelle fois, mais en fait dès que le mot Gestapo a été prononcé, il a parfaitement compris : Heydrich et Himmler viennent de lancer leur offensive, ils commencent à serrer leurs collets, à rafler leurs proies, jusqu'où iront-ils ? Papen décide de rentrer immédiatement à Berlin. Il faut essayer de tirer Jung des griffes des tortionnaires, il faut savoir ce qu'ils veulent, qui ils veulent et Papen pense aussi à assurer sa sécurité. A Berlin, dans le monde officiel, le vice-chancelier sera davantage à l'abri des arrestations clandestines, des tueurs anonymes. Mardi 26 juin : arrestation de Jung ; la partie est engagée.
Papen est à Berlin le mercredi 27 juin. Sur la capitale des nuages noirâtres d'orage forment des masses crénelées qui s'avancent en front depuis le sud-ouest. A l'atterrissage, l'avion du vice-chancelier a été secoué et c'est épuisé, inquiet de cette inquiétude où se mêlent les préoccupations et les fatigues que Papen rencontre Tschirschky qui l'attend sur la piste même. Il faut tenir les chapeaux, le vent humide soulève les imperméables, créant des tourbillons de poussière. Après un rapide entretien, Papen décide d'entreprendre une série de démarches en faveur de son collaborateur : sauver Jung c'est aussi se protéger. Mais Franz von Papen ne peut rencontrer le Führer : à la chancellerie on répond que Hitler vient d'arriver de Munich et qu'il se repose. Gœring est absent. Il prononce un discours à Cologne. Papen se fait conduire au 8, Prinz-Albrecht-Strasse, et finalement obtient d'être reçu par le Reichsführer S.S. Himmler. Le chef de l'Ordre noir est glacial, poli, rassurant : une simple enquête, dit-il, sur laquelle il ne pouvait rien dévoiler pour l'instant. Papen racontera plus tard cette journée où la tragédie s'annonce proche. «Rentré à Berlin, se souvient-il, j'essayai vainement de joindre Hitler ou Gœring. En désespoir de cause, je protestai avec véhémence auprès de Himmler qui répondit que Jung avait été arrêté sous l'inculpation de contacts illégaux avec des puissances étrangères. Une enquête était en cours. Himmler affirma ne pouvoir me donner d'autres précisions pour le moment, mais me promit l'élargissement rapide de mon collaborateur. »
Papen est un homme prudent : parfois il faut accepter d'attendre, accepter de ne pas insister, de s'en tenir aux apparences, aux déclarations officielles. Papen est un homme d'expérience. L'attitude de Himmler, les dérobades de Hitler et de Gœring lui ont permis de sentir que le climat n'était plus à la conciliation. Papen regagne donc son domicile berlinois et Jung reste entre les mains de la Gestapo. Personne ne saura ce qu'il a subi dans les caves du grand bâtiment du 8, Prinz-Albrecht-Strasse, personne ne sait encore qu'il est la première victime de la Nuit des longs couteaux.
Seuls d'ailleurs les initiés sentent monter la vague rageuse des règlements de compte. Pour la masse des Allemands, tout est calme. Ceux qui ont acheté la National Zeitung se sentent rassurés : en première page, sous le titre « Situation de l'économie allemande », on leur annonce que l'avenir est radieux. L'Allemagne du IIIeme Reich triomphe de la misère et du chômage et cela est inespéré : « Rendons grâce au Führer Adolf Hitler qui donne du travail à tous ».
A Radio-Berlin, Rosenberg s'adresse aux écoliers et aux lycéens. Dans tous les établissements d'enseignement, les élèves sont rassemblés : ils écoutent l'idéologue du Parti affirmer que « l'Allemagne se trouve plongée dans un combat politique qui est aussi un combat spirituel sans précédent dans l'histoire ». Il faut, martèle-t-il, que nos compatriotes aient le « sentiment de l'unité allemande. Servez cette unité en entretenant entre vous une véritable camaraderie ». Dans les classes, les professeurs commentent le discours de Rosenberg avec les élèves : qu'est-ce que dans le nouveau Reich la véritable camaraderie ? Les membres de la Hitler-Jugend répondent les premiers. C'est la camaraderie des soldats du front, l'indestructible camaraderie des Alte Kämpfer. Les jeunes gens blonds, un foulard autour du cou, en chemise blanche et en culotte courte noire, pendant que Rosenberg parle ou qu'un camarade lit sa réponse à la question, laissent rêver leur imagination : ils vivent la virile amitié des temps de guerre qui se prolonge dans le parti nazi.
A quelques centaines de mètres de l'une de ces écoles berlinoises où la jeunesse allemande s'enivre de mots, au siège de la Gestapo, Himmler préside une conférence de travail. Dans son bureau sont rassemblés le Oberabschnittsführer du Sicherheitsdienst, le S.D. (service de sûreté du Reichsführer S.S.) qui surveillent les unités et les hommes de la Sturmabteilung. L'action, déclare Himmler, est pour bientôt. Chacun des chefs régionaux du S.D. expose son plan, met au point avec Himmler les dernières consignes. Ce même jour, Sepp Dietrich, est reçu à la Bendlerstrasse et demande une attribution d'armes pour ses unités de la Leibstandarte Adolf-Hitler afin d'accomplir une « mission très importante qui lui a été confiée par le Führer ».
Cependant, à Berlin, à la Chancellerie, Adolf Hitler donne un thé en l'honneur de quelques personnalités du régime et de diplomates étrangers. Il apparaît faussement détendu, encore hâlé par l'air vif de Berchtesgaden mais nerveux. L'un des participants l'entend déclarer à un chef nazi, d'une voix rageuse :
« Chaque groupe croit l'autre capable de frapper le premier. » A qui peut-il faire allusion, sinon aux S.S. de Rœhm et à leurs adversaires ? Mais cette phrase colportée dans Berlin inquiète Himmler et Heydrich, elle semble prouver que le Führer n'a pas encore choisi. Tout peut donc être compromis et les S.A. ne paraissent-ils pas persuadés de la neutralité bienveillante de Hitler ?
Le soir du mercredi 27 juin, ils festoient dans la résidence berlinoise de Rœhm. Les éclats de rire, les chants se mêlent au bruit des verres, au pétillement du Champagne. Dehors, dans la Standartenstrasse, les voitures des invités rendent la circulation presque impossible. Les passants s'attardent, regardent les fenêtres ouvertes d'où jaillissent les refrains et les musiques ; on célèbre les vacances prochaines, le mariage d'Ernst, les fiançailles d'un autre compagnon de Rœhm, le lieutenant Scholz. Les policiers qui assurent le service d'ordre devant le bâtiment, le font de façon débonnaire et blasée. Ils vont par groupes de deux, invitant les passants à circuler, dirigeant les voitures, ne levant même pas la tête, ce sont les hommes de Hermann Gœring et leur chef, alors qu'Ernst et Scholz portent un toast à l'avenir de la Sturmabteilung, parle à Cologne, dans le hall de la foire.
GŒRING ET TERBOVEN
Des milliers d'hommes et de femmes sont là, serrés les uns contre les autres dans une chaleur accablante. Depuis le matin toute la ville est paralysée par les parades, les réceptions, en l'honneur du ministre du Reich. Il est arrivé à 13 h 20, dans un Junkers rouge, qui a, à trois reprises, survolé le terrain d'aviation à basse altitude, puis s'est posé, roulant jusqu'au groupe des personnalités — le Gauleiter Grohé, le Regierungs- präsident Diels, le Landeshauptmann Hake, les Gruppenführer Weizel et Knickmann. Les saluts, l'amabilité de Gœring envers son ancien collaborateur Diels, tout cela marque les premières minutes du séjour de Gœring à Cologne. Les S.S. forment la haie devant la salle des séances de l'Hôtel de Ville : le Oberburgermeister, le docteur Reisen, offre à Gœring le glaive celte, vieux de 3 000 ans. On déjeune dans la Muschel Sali (la salle des rocailles) avant le grand défilé devant l'Opéra : police, S.S., S.A., Motor-S.A., service du travail de la Jeunesse hitlérienne. Dans un ordre mécanique, portant des centaines de drapeaux à croix gammée, les hommes passent et le martèlement de leurs bottes sur l'asphalte gris couvre parfois les fanfares. Gœring, sur la tribune, Gœring déjà obèse, tourne son corps lourd à droite et à gauche, souriant d'aise, la vanité inscrite sur son visage et dans toute son attitude. Les S.A. défilent Déjà c'était la Sturm d'honneur du S.A. Präsentiermarsch qui avait accueilli Gœring sur le terrain d'aviation. Maintenant, les hommes aux chemises brunes passent devant la tribune ornée de branches de sapin : qui pourrait croire que c'est sur eux, sur cette Sturmabteilung que va se refermer le piège monté par les S.S., et aussi par Hermann Gœring, qui les salue, martial et satisfait ?
Et le soir la foule est là, dans le hall de la foire, à écouter Gœring, à l'acclamer, à se rassurer encore : « Personne, dit-il, que ce soit à l'étranger ou en Allemagne n'a le droit de construire des raisonnements selon lesquels, ici, en quelque sorte, quelque chose se passe sous un régime de terreur sanglante. » Et rien en effet ne semble refléter la « terreur sanglante », rien ne semble l'annoncer.
A quelques kilomètres de Cologne, à Essen, c'est aussi la fête. Jamais, de Berlin à Cologne, de Hambourg à Nuremberg ou à Essen, l'Allemagne n'a autant défilé, autant écouté de discours.
A Essen, depuis 21 heures, la Huyssenallee est interdite à la circulation : c'est un hommage rendu par la municipalité au Gauleiter Terboven qui se marie demain. Les nouveaux seigneurs font participer leur bon peuple à leurs joies intimes. Devant le Parkhotel, on a dressé un arc de triomphe et dans le balancement des flammes agitées par le vent le cortège des porteurs de torches avance vers cet arc de triomphe. Il suit la Holzstrasse, l'Adolf-Hitler-Strasse et les voici, ces milliers de jeunes gens, des fanfares, les mineurs en uniforme de parade, la Jeunesse hitlérienne, le S.A. Standarte 58, le corps de gendarmerie arrivant au pas de l'oie, d'autres régiments S.A. et puis, unité d'élite vers qui tous les regards se tournent le Sturmbann S.S. n° 1 séparé du reste du défilé par un grand espace et qui dans ses uniformes noirs, avec ses gants blancs, paraît sortir d'une création mythologique et maléfique, les voici ces milliers d'hommes qui passent devant l'estrade.
Le Gauleiter Terboven, à l'allure juvénile, se tient raide, près de sa fiancée, jolie, souriante, en robe longue à fleurs. Ils symbolisent les nouvelles élites, le nouveau régime et autour d'eux se presse la foule des officiels en uniforme : S.S., S.A., membres de la Reichswehr. De 22 h 10 à 23 h 15, les unités, impeccablement alignées passent et la population de Essen applaudit cette démonstration d'ordre et de force. Le régime du IIIeme Reich paraît à ces milliers de spectateurs comme un bloc, semblable à ce régiment de S.S. où la précision des pas, l'immobilité des visages et des épaules, rendent impossible la séparation d'un homme de l'ensemble. On ne voit que ce groupe noir qui avance, volume aux angles vifs, hérissé de fusils, recouvert d'acier, le Sturmbann S.S. n° 1, image du régime nouveau, force en marche qui, peu à peu, doit tout niveler, tout encadrer, tout contrôler. Gœring à Cologne a répété que le IIIeme Reich n'est pas « le régime de la terreur sanglante » mais il a ajouté : « Chacun, ici, peut rester tranquillement couché sur son sofa, vraiment à celui-là, je ne ferai rien. » Mais aux autres ? Ceux qui veulent agir ou ont agi, quel sera leur sort ? Gœring parle à Cologne en cette fin du mercredi 27 juin Depuis l'aube de ce jour, le docteur Edgar Jung sait ce qu'il en coûte de ne pas « rester tranquillement couché sur son sofa ».
UN MARIAGE NAZI
Maintenant c'est l'aube du jeudi 28 juin 1934, le ciel blanchit à l'est de Berlin comme une plage immense recouverte par une mince marée, et les remparts sombres de l'obscurité reculent peu à peu. Dans les rues de la capitale, les premiers travailleurs font résonner leurs pas dans le silence. Devant le bâtiment de la chancellerie, c'est la relève de la garde. Un sous-officier et trois hommes casqués, marchant au pas de l'oie, comme des figurines sortant de l'une de ces horloges allemandes en bois sculpté, exécutent la première passation des consignes de la journée, et dans ce temps suspendu de l'aube, ce temps calme, immobile comme une mer apaisée, les deux groupes se saluent et les soldats prennent position de part et d'autre de la grande entrée.
Jeudi 28 juin 1934. A la Bendlerstrasse, dans la cour, un autre peloton de soldats répond aux premiers commandements de l'officier de service et les hommes se rangent autour du mât où chaque matin est hissé le drapeau de l'Allemagne. Dans chaque caserne, les mêmes gestes se répètent, les talons claquent, les bottes ferrées crissent sur les pavés des cours où, parfois depuis plus d'un siècle, des soldats de la Grande Prusse ont, avec la même discipline, aligné leurs corps sous le regard des jeunes officiers implacables.
Il est 7 h 30 maintenant. La ville est animée. Les cyclistes en file glissent le long des rues de banlieue : dans les cours des casernes, des compagnies sont rangées l'arme au pied, et voici qu'arrivent les chefs de corps. Ils saluent les hommes figés dans le garde-à-vous et le drapeau s'élève enfin lentement et s'arrête au milieu du mât; il pend le long de la hampe, à peine soulevé par une brise fraiche. Partout, aux mâts des édifices publics, à Cologne ou à Dresde, au mât de la chancellerie du Reich ou à celui du siège de la Gestapo, le drapeau est en berne. Il y a 15 ans en effet, le 28 juin 1919, l'Allemagne était contrainte de signer le traité de Versailles : d'accepter le diktat des vainqueurs. Depuis, Erzberger, le signataire du traité, est mort assassiné par les jeunes demisolde, par ces officiers humiliés qui rêvent à la revanche ; depuis la Reichswehr s'est reconstituée, indestructible comme une force vitale qu'on peut réduire mais qu'on ne peut écraser, depuis Hitler est parvenu au pouvoir et Versailles est devenu la grande honte, l'odieuse trahison. Et, ce matin du 28 juin 1934, 15 ans plus tard, le deuil officiel, proclamé dans le ciel clair par ces drapeaux en berne dit bien que le IIIeme Reich n'oublie pas, ne veut pas oublier l'affront et la défaite. « Il y a vingt-cinq ans, dit un texte qui est lu dans les casernes, la glorieuse armée allemande, vos camarades, étaient trahis, poignardés dans le dos, cela jamais plus ne se reproduira. »
A l'aérodrome de Tempelhof, les drapeaux aussi sont en berne. Des S.S. en tenue de parade, le blanc des baudriers et des gants tranchant sur l'uniforme noir forment une allée jusqu'à l'avion. Le ciel s'est déjà couvert et les premières gouttes tombent quand, un peu avant 9 heures, arrivent Gœring et Hitler. L'avion porte en lettres noires le nom du Generalfeldmarschall von Hindenburg. L'équipage est rangé près de la petite échelle de fer. Hermann Gœring et Adolf Hitler paraissent joyeux. Gœring en grand uniforme de général, une cape jetée sur les épaules, parle avec animation ; Hitler est en manteau de cuir, sa chemise blanche fait ressortir son teint pâle, il tient sa casquette à la main. Le Führer salue l'équipage ; Gœring plaisante avec le pilote, puis les deux hommes disparaissent dans l'appareil. Il est 9 heures. L'immense et lourd drapeau rouge à croix gammée claque maintenant dans le vent et la pluie s'est mise à tomber régulière.
Elle tombe à flots quand l'avion se pose sur l'aérodrome de Essen-Mülhleim. L'arrivée du Führer a été tenue secrète jusqu'à la dernière minute. Depuis le matin pourtant des S.A. sont là, sous la pluie, postés tous les dix mètres le long de la route qui conduit à Essen et que les voitures officielles suivent maintenant. Dans la ville, les guirlandes, les drapeaux, la foule dense sur les trottoirs annoncent un jour de fête : hier soir, c'était le défilé aux torches, aujourd'hui, c'est le mariage du Gauleiter Terboven. Devant l'hôtel Kaiserhof, la foule est nombreuse, elle stationne malgré la pluie, acclame Gœring et Hitler et les attendra près d'une heure avant de les revoir rapidement, suivis de l'aide de camp Brückner, du docteur Dietrich, de l'Oberführer Schaub, au moment où, quittant l'hôtel, ils gagnent la mairie d'Essen.
Les voitures avancent lentement par la Huyssenallee et enfin se rangent devant l'Hôtel de ville. La foule est immense : elle crie son attachement au Führer. lise Stahl, la mariée, est là, drapée dans une robe longue de soie blanche, un large diadème dans les cheveux, son regard est fixe, comme dans une extase et elle serre contre elle un bouquet de roses. A ses côtés, marche le Gauleiter Terboven, son bras gauche entouré par le brassard à croix gammée, la Croix de fer à sa poitrine. Avec ses cheveux lisses, sa raie sur le côté, son visage résolu et glabre, il semble un très jeune homme. Deux enfants — une fille et un garçon — des Jeunesses hitlériennes tiennent la traîne de la mariée et derrière eux, sévères, Hitler et Gœring. Tout est lent, lourd, emphatique dans cette grande salle de l'Hôtel de ville d'Essen : les femmes, au fond de la pièce, sont elles aussi en robes longues, les hommes en uniforme ; on reconnaît parmi eux des S.A.-Führer et d'abord Karl Ernst, le S.A.-Gruppenführer de Berlin qui, hier soir, festoyait encore dans la capitale et qui a tenu à assister au mariage avant de partir pour son propre voyage de noces. Ils sont là, S.A. et S.S., côte à côte, se demandant sans doute pourquoi le Führer et Gœring ont jugé bon d'honorer de leur présence ce mariage. Ernst se penche vers son voisin, un officier de l'Ordre noir : l'entente politique et humaine paraît régner ici. Une femme en robe longue salue, le bras tendu, seule, regardant fixement le Führer, cependant que s'immobilisent lise Stahl et le Gauleiter Terboven devant le docteur Reismann-Grone, maire d'Essen. S.A. et S.S. sont côte à côte, écoutant le discours qui va célébrer ces noces des nouveaux temps, solennelles, symboliques et que, dans quelques heures, quand le sang aura jailli, que les corps des S.A. tomberont sous les balles de leurs camarades, Ernst exécuté lui aussi, on n'appellera plus que « les noces sanglantes d'Essen ».
« Un étrange bonheur est répandu aujourd'hui sur Essen, commence Reismann-Grone. Sur le tronc antique du chêne qui est l'arbre généalogique des DarBoven et qui, depuis 1550, enfonce ses racines dans notre lourde terre, la terre de notre Stift (monastère), le rejeton Joseph Terboven a conclu une alliance. »
Tout le monde s'est assis. Hitler, les mains posées l'une sur l'autre, semble écouter intensément. Gœring, à ses côtés, a le visage figé par un sourire. Le maire d'Essen parle : « Le chef politique de la province rhénane du Nord-Ouest est pour nous les anciens, une promesse d'avenir » dit-il. Dehors la foule crie et on entend les hourras poussés par les jeunes de la Hitler-Jugend. Ernst et le S.A. Obergruppenführer Prinz August Wilhelm sont côte à côte, tranquilles et près d'eux des officiers S.S., impassibles. Qui sait déjà dans cette salle de l'Hôtel de ville d'Essen qu'un ordre secret de mobilisation de toutes les unités S.S. a été transmis ? Qui sait que le capitaine Ernst Rœhm, qui, ce jeudi 28 juin au matin, fait comme à son habitude sa promenade sur les bords du lac de Tegernsee, vient d'être exclu du Cercle des officiers allemands et de toutes les associations d'anciens combattants, qu'ainsi l'Offizierskorps vient de le rejeter, de le livrer ? « Le Gauleiter Joseph Terboven, continue le maire, épouse une jeune fille venue de l'Est le plus lointain, dont les ancêtres étaient résistants comme l'acier (ne s'appelle-t-elle pas Stahl ?) c'est un heureux symbole. Car cette tendre fleur qui arrive d'une province éloignée n'est pas une étrangère. Elle aussi est membre de notre parti et nous avons tant d'amour pour elle qu'elle trouve ici sa nouvelle patrie. »
Assourdis, lointains, parviennent les hurlements des sirènes qui signalent un changement d'équipes dans les usines sombres et noires qui ceinturent Essen : là-bas, dans les galeries bruyantes où résonnent les coups sourds des marteaux-pilons, où éclatent les gerbes d'étincelles, où l'acier flamboyant roule sur les laminoirs, on forge la puissance de l'Allemagne nazie, ce IIIeme Reich dont les chefs sont rassemblés ici. « Cette cérémonie constitue un événement historique et politique, poursuit le docteur Reismann-Grone. Notre Essen, la millénaire Assindi, a vu Charlemagne, elle a vu Otto le Grand, elle a vu le dernier des Hohenzollern. C'est une citadelle solide. C'est un lieu d'accueil paisible. Mein Führer, et vous, Monsieur le Premier Ministre, vous êtes les hôtes bienvenus de la grande cité de la métallurgie. »
Dehors retentissent les Sieg Heil en l'honneur du Führer et du couple, Hitler et Gœring se lèvent et inaugurent le nouveau livre d'or de la cité. Puis, à travers la ville et les hourras, le cortège officiel se dirige vers la cathédrale pour le mariage religieux. Devant l'église, sur la Adolf-Hitler-Platz, les jeunes gens de la Hitler-Jugend ne vont pas cesser de crier en cadence leur enthousiasme, attendant la sortie du Führer ; c'est seulement quand les dernières voitures ont quitté la place qu'ils se dispersent.
L'ATTITUDE DE LA REICHSWEHR.
Le repas de noce est solennel, Gœring y prend la parole, des Sieg Heil sont lancés, puis le S.S.-Gruppenführer Zech, dans une courte allocution, tourné vers les S.A. déclare : « Je célèbre ici la vieille camaraderie, la bonne vieille camaraderie, entre S.S. et S.A., la camaraderie de combat qui unit les S.S. et les S.A. aux travailleurs manuels et intellectuels. »
Il est environ 16 h 30 le jeudi 28 juin. C'est exactement l'heure à laquelle le général Beck, chef du Truppenamt, rappelle à ses officiers qu'ils doivent avoir constamment une arme à portée de la main. Dans la cour de la Bendlerstrasse, des coups de sifflets retentissent, des soldats courent, se rangent rapidement devant le Hauptmann de service. Les faisceaux sont formés avec les fusils et les hommes montent dans la cour, en créneaux, des chevaux de frise. Des officiers qui rentrent de permission sont sévèrement contrôlés à l'entrée du ministère et, ahuris, regardent la cour de la Bendlerstrasse organisée comme pour soutenir un siège. On les avertit qu'ils sont consignés car la menace d'un putsch S.A. ou d'éléments communistes qui ont noyauté la Sturmabteilung est sérieuse. Le putsch serait imminent. De la Bendlerstrasse, par téléphone, les dernières directives partent pour les Etats-majors des différentes régions militaires. Elles sont précises :
1) avertir dans chaque caserne un officier sûr de la menace du putsch SA. ;
2) vérifier les consignes d'alerte ;
3) vérifier la garde des casernes ;
4) vérifier la garde des dépôts d'armes et de munitions ;
5) ne pas éveiller l’attention.
La dernière consigne étonne certains officiers : mais peut-être veut-on prendre les S.A. la main dans le sac ?
Cependant Ernst a regagné Berlin et il prépare ses bagages pour son voyage de noces : les noces d'Essen, la présence de Hitler, l'unité affirmée des S.S. et des S.A., comment tout cela n'aurait-il pas rassuré le S.A.-Gruppenführer ? Le congé de la Sturmabteilung commence le 1er juillet, dans deux jours : que peut-il se passer en quarante-huit heures alors que le Führer, loin de Berlin, honore une union de sa présence ou visite les usines Krupp ?
C'est vers 17 heures en effet, que Adolf Hitler, accompagné par Brückner, les Oberführer Dietrich et Schaub, est arrivé devant les bâtiments de la Firme. La haute cheminée de 69 mètres et de 9,50 m de diamètre à la base est couronnée d'un grand drapeau nazi. Dans le hall d'honneur du bâtiment administratif principal Krupp von Bohlen und Halbach et Mademoiselle Irmgard von Bohlen accueillent le Führer comme d'autres Krupp avaient accueilli les empereurs d'Allemagne et les rois allemands. Un éminent technicien fait au Führer les honneurs de l'usine : on visite la forge, les ateliers, les laminoirs, la fabrique de camions. Dans la pénombre fraîche ou brûlante, dans l'air chargé des odeurs fortes et âcres de l'acier en fusion, Hitler fasciné écoute à peine les indications. Il regarde ces jets d'or et de rouge qui jaillissent dans les creusets, ces lingots incandescents qui roulent et s'aplatissent sous la pression tonitruante des marteaux-pilons hauts comme deux étages. Ici, il puise sa force, ici est un empire, l'empire Krupp dont son empire à lui, le Reich, ne peut se passer. Krupp montre au Führer une plaque commémorative où on lit : « A la mémoire des camarades de l'entreprise qui, le 31 mars 1923, sont tombés sous les balles françaises à cet endroit ».
C'était le vendredi saint, les troupes françaises occupaient la Ruhr. Un de leurs détachements est entré dans l'usine en grève vers 9 heures du matin, là, dans le hall de montage des camions Krupp. Les ouvriers protestent, se groupent, deviennent menaçants. Vers 11 heures du matin, les Français tirent : on relèvera sur le sol gris couvert de poussière de charbon et d'éclats de métal 11 morts et 30 blessés graves. Les ouvriers, dit Krupp, exprimaient leur solidarité avec l'entreprise, avec l'Allemagne.
Hitler écoute : 1923, l'occupation de la Ruhr, c'était le temps des débuts quand, fouetté par l'action française, le nationalisme allemand se redressait vigoureusement et que le nazisme y puisait ses premières forces. Aujourd'hui, vingt-cinq ans après Versailles revoici le Reich debout et les usines Krupp puissantes. Autour du Führer les ouvriers se sont rassemblés et applaudissent Puis, Hitler a un long entretien avec Krupp : peut-être le Führer de la sidérurgie allemande s'est-il, comme on l'a dit, plaint de l'activité des S.A., de leurs revendications, du désordre qu'ils font régner, de leurs appels incessants à une seconde révolution.
Quand Hitler quitte les bâtiments de Krupp, il semble préoccupé. Les voitures officielles filent à vive allure vers le centre d'Essen, vers l'hôtel Kaiserhof où Hitler doit séjourner. Là, dans le grand salon de l'hôtel transformé en bureau de travail, le Führer dépouille les messages. Himmler les a multipliés : ils font tous état du putsch S.A. qui se prépare, ils contiennent les indications précises sur l'armement de telle ou telle unité de la Sturmabteilung, sur les propos des membres des Sections d'Assaut. Hitler réunit ses collaborateurs : Gœring est toujours présent ; Lutze, le Führer S.A. digne de confiance assiste à l'entretien. Himmler continue de téléphoner : la S.A. selon lui va s'attaquer à la Reichswehr. Au même moment, les services du S.D. de Rhénanie communiquent une nouvelle information : des S.A. auraient molesté un diplomate étranger dans la région du Rhin. Tout dans le récit est imprécis, vague, sent la provocation ou l'événement forgé de toutes pièces. Mais Hitler explose : la S.A. est un danger pour la sécurité de l'Allemagne. S'il est vrai que Krupp lui-même l'a mis en garde contre les Sections d'Assaut, la colère du Führer s'explique. Les trois éléments essentiels de sa politique : la puissance économique, la puissance militaire et les relations extérieures, sont perturbés par les S.A.
Il demande immédiatement, de l'hôtel Kaiserhof, à communiquer avec la pension Hanselbauer, à Bad Wiessee. A Rœhm, il confirme la nécessité d'une explication urgente : il sera à Bad Wiessee, comme convenu, le 30 juin à 11 heures, tous les Obergruppenführer de la S.A., les Gruppenführer, les inspecteurs de la S.A. devront être convoqués par Rœhm pour cette confrontation. Rœhm ne s'étonne pas : il a commandé, dit-il, un grand banquet à l'hôtel Vierjahreszeiten, il y aura un menu végétarien à l'intention du Führer.
Après ce coup de téléphone, Hitler se détend. Il échange quelques mots avec le personnel de l'hôtel, accompagne Gœring jusque sur le perron du Kaiserhof puisque le ministre de Prusse regagne Berlin. Pendant que la voiture de Gœring démarre, Hitler salue la foule qui l'acclame. Pourtant Lutze a l'impression que le Führer, rentré dans l'hôtel, retrouve son inquiétude, ses hésitations, maintenant que Gœring est parti, qu'il est à nouveau seul en face d'une décision à prendre qui engage son pouvoir, qui tranche avec tout un pan de son passé, avec son vieux camarade Rœhm : une décision qui, comme tout choix, est un coup de dés.
Mais si Hitler est encore, alors que s'achève cette journée du jeudi 28 juin irrésolu, hésitant, seulement sûr qu'il ira à Bad Wiessee, d'autres savent ce qu'ils veulent et pourquoi, et comment l'obtenir. « J'ai eu le sentiment, dira Lutze plus tard, que certaines gens avaient intérêt à profiter de l'absence de Hitler pour accélérer le train de l'affaire et parvenir à une conclusion rapide. »
Et pour eux, chaque heure compte. Ils créent, ils amplifient les différents bruits, les plus alarmistes, ils font pression sur les officiers qui, à l'état-major de la Reichswehr, ont leur confiance pour que les consignes d'alerte soient renforcées et précisées : il leur faut créer dans les cercles officiels une atmosphère d'inquiétude qui permettra toutes les exactions. Il faut accuser les S.A. pour pouvoir les abattre ou simplement pour qu'on les laisse abattre. Il faut faire naître un état de crise.
Dans la nuit du 28 au 29 juin, à Munich, l'officier de la Reichswehr Stapf, qui commande la nouvelle section motorisée de reconnaissance n° 7 reçoit ainsi des précisions de l'état-major : les officiers ne doivent pas quitter les casernes, l'ordre est impératif. Le texte ajoute qu'ils sont menacés directement, les S.A. ayant établi des listes d'officiers à abattre. Dans les unités, les services de l'armement reçoivent l'ordre de distribuer aux hommes de garde des munitions de guerre. Dans les cours des casernes de Munich, devant les magasins d'armes et de munitions, les hommes des compagnies de garde, à tour de rôle, viennent prendre leurs cartouches. Des officiers surveillent la distribution. Les plus vieux évoquent les années 23, le temps des putschs.
A quelques dizaines de kilomètres de Munich, jeudi 28 juin, alors qu'on distribue ces munitions, Rœhm, que le corps des officiers a abandonné, fait expédier les premiers télégrammes qu'il adresse aux Obergruppenführer des S.A., aux principaux chefs et inspecteurs des Sections d'Assaut pour les convoquer à la réunion du samedi 30 juin 1934 à 11 heures, en présence du Führer. Dans la pension Hanselbauer, l'atmosphère est toujours à la confiance, à l'attente tranquille de l'arrivée du Führer. Rœhm est allé en personne à l'hôtel Vierjahreszeiten pour indiquer au directeur que la présence du Führer est confirmée et qu'il importe de veiller tout particulièrement au banquet. La garde personnelle de Rœhm assurera la protection du Führer et dès le vendredi 29 juin, elle viendra protéger l'hôtel. Puis le chef d'Etat-major est rentré à la pension Hanselbauer.
A Berlin, les premières épreuves d'un texte, des feuilles grasses encore d'encre noire, viennent d'être posées sur les larges tables de l'imprimerie. Deux officiers d'état-major, envoyés de la Bendlerstrasse, sont là, à les lire attentivement avec le rédacteur en chef, cependant que tournent les rotatives et que dans le bruit feutré du papier que l'on presse et de l'encre qui s'imprègne, minutieusement, les deux officiers lisent le texte. « La Reichswehr se sent en union étroite avec le Reich d'Adolf Hitler. Les temps sont passés où les gens intéressés des divers camps se posaient en oracles de l'énigme de la Reichswehr. Le rôle de l'armée est clairement déterminé : elle doit servir l'Etat national-socialiste qu'elle reconnaît. Son cœur bat à l'unisson avec le sien... Elle porte avec fierté l'insigne de la reconnaissance allemande sur son casque et sur son uniforme. Elle se range disciplinée et fidèle, derrière les dirigeants de l'Etat, derrière le Maréchal de la Grande Guerre, le président von Hindenburg, son chef suprême, ainsi que derrière le Führer du Reich Adolf Hitler, qui, issu des rangs de l'armée est et restera toujours l'un des nôtres. » Au bas de l'article, un nom en grosses lettres, général von Blomberg, ministre de la Défense : Gummilöwe (le lion en caoutchouc).
Les officiers donnent leur accord : l'article de l'homme qui incarne l'armée va être imprimé en première page du Völ kischer Beobachter du vendredi 29 juin. Il dit que la Reichswehr, par la plume de la plus haute autorité, approuve par avance les actions du Führer. Déjà, la Reichswehr a, ce matin, rejeté Rœhm de ses rangs, maintenant elle proclame que, prête à suivre Hitler, avant même que les premières rafales claquent elle accepte toutes ses décisions.
Il reste au Führer, alors que les premiers exemplaires du journal s'entassent les uns sur les autres dans l'imprimerie berlinoise, à choisir, à agir.
7
SAMEDI 30 JUIN 1934
En vol au-dessus d'Augsbourg, 3 heures 30
(Vendredi 29 juin au samedi 30 juin 1934)
MUNICH DANS 25 MINUTES
Samedi 30 juin, 3 h 30. Le pilote se penche vers le Führer et lui montre à gauche de l'appareil la ville d'Augsbourg dont on distingue avec précision le dessin des rues brusquement coupées par la nuit environnante, quand cessent les quartiers éclairés. Le temps de situer les points lumineux et c'est déjà la plaque sombre du sol enfoui dans la nuit qui recommence. Pourtant, dans cette nuit d'été qui s'achève, le jour, le jour de ce samedi 30 juin 1934, commence à poindre, à peine sensible parce que l'est paraît plus délavé. Dans le Junkers du Chancelier les conversations qui s'étaient interrompues depuis un long moment recommencent La radio vient d'annoncer que l'avion était pris en charge par le contrôle de Munich : tout est prêt pour l'atterrissage de l'appareil sur la piste de Munich-Oberwiesenfeld. Le Führer demande au pilote dans combien de temps on touchera le sol. Environ vingt-cinq minutes.
Vingt-cinq minutes : une infime parcelle de temps, le dernier et bref répit avant d'être plongé dans l'action, de voir sur la piste, des hommes qui attendent les ordres. Ce vol depuis Bonn-Hangelar, ce vol au-dessus de l'Allemagne, ce vol qui dure depuis près de deux heures a été comme un long recueillement dans le bruit qu'on oublie des moteurs. Hitler s'est encore tassé davantage dans son siège de la cabine de pilotage. A chaque minute qui passe le jour gagne rapidement comme si, symboliquement, la longue hésitation des semaines et des mois prenait fin avec la nuit, se dissipait avec elle. Dans quelques minutes ce sera Munich, les S.A., les S.S. : les hommes vivants, avec leurs visages et leurs muscles, leurs instincts, leurs violences, leur peur et ce sera aussi l'engrenage des hasards, l'imprévisible toujours au cœur d'un événement
LES DERNIERES HESITATIONS DE HITLER
Il y a à peine vingt-quatre heures, hier, ce vendredi 29 juin, vers 9 heures, avant de partir pour sa tournée dans les camps de travail de Westphalie, tout pouvait encore être arrêté. Hitler, à l'hôtel Kaiserhof d'Essen, avait pourtant appris qu'à Berlin, dès son retour, Hermann Gœring avait renforcé l'état d'alerte de sa police : la Landespolizeigruppe General-Gœring multiplie les patrouilles, les gardes sont doublées. Le Führer savait donc que dans la capitale, ce dernier vendredi de juin, Heydrich, Himmler, Gœring poussaient leurs ultimes préparatifs. Il sent aussi la peur s'abattre sur certains hommes : Franz von Papen qui accepte de parler à l'Opéra Kroll aux représentants des chambres de commerce allemandes à l'étranger et qui proclame : « Personne ne doute en Allemagne que le Chancelier et Führer Adolf Hitler mènera jusqu'à une issue victorieuse l'œuvre de rénovation matérielle et morale de la nation ». Papen qui fait donc amende honorable et qui oublie dans les caves du 8, Prinz-Albrecht-Strasse le docteur Jung, dont il avait lu le discours à Marburg. Tôt le matin du 29, on a aussi déposé sur la grande table du salon du Kaiserhof d'Essen, un exemplaire du Völkischer Beobachter, avec l'article du général Blomberg. Hitler le lit lentement : il en connaissait la teneur mais un texte imprimé à des milliers d'exemplaires prend un autre visage. Blomberg lui laisse les mains libres. Et puis il y a eu ces nouvelles qui viennent de Breslau. Gœring, ministre de Prusse, a donné l'ordre à l'Oberabschnittsführer S.S. Udo von Woyrsch, responsable du secteur sud-est de mettre tous les chefs S.A. de sa région en état d'arrestation, d'occuper la préfecture de Breslau et de se placer à la disposition, avec les S.S., du commandant de la police.
Vendredi 29 juin, il fait gris au-dessus d'Essen : nuages et fumées lourdes que l'humidité de l'air chaud de l'été empêche de s'élever. Hitler a pris dans le salon du Kaiserhof, un thé léger. A 10 heures, il est attendu dans le camp de travail de Schloss-Buddenberg : déjà les jeunes hommes doivent être rassemblés sous la pluie fine, attendant leur Führer.
Il y a moins de vingt-quatre heures. 10 heures ce vendredi 29 juin. Rœhm se promène au bord du lac de Tegernsee avec son ordonnance, il est heureux, il va pouvoir expliquer au Führer ses sentiments. Les premiers chefs S.A. vont arriver ; avant la rencontre du samedi 30 avec Hitler il faudra faire le point.
A Essen, au moment où le Führer s'apprête à partir, l'Obergruppenführer S.A. von Krauser qui remplace Rœhm en congé à Bad Wiessee demande à être reçu. Le Führer s'isole avec lui et il parle d'abondance au chef S.A. : il faut que demain à Bad Wiessee, l'explication soit profonde, sincère, totale. Lui, le Führer, reconnaît qu'il a des torts envers les S.A., il faut vider l'abcès. Il va rendre justice aux S.A.
L'Obergruppenführer S.A. est parti rassuré et Hitler sous une pluie fine et tiède quitte Essen pour sa tournée d'inspection.
DEMAIN, C'EST MAINTENANT
C'était hier, vendredi 29 juin 1934, entre 9 heures et 10 heures du matin. Rien n'était encore tranché. Puis la journée s'est déroulée, les Sieg Heil des jeunes gens enthousiastes, la route vers Bad Godesberg, le Rhin et ses odeurs douces, les burgs en ruine qu'on aperçoit depuis la terrasse de l'hôtel Dreesen, l'arrivée de Goebbels et de Viktor Lutze, les coups de téléphone de Himmler, de Wagner, la décision prise et cette route encore vers Bonn-Hangelar, le Junkers, ce vol au-dessus de l'Allemagne vers Munich.
Demain, c'est maintenant, samedi 30 juin 1934, 3 heures 55 du matin.
Il fait presque jour : le ciel est blanchâtre, grisâtre, sans joie, couleur de plâtre et de ciment. L'appareil amorce sa descente : on aperçoit les balisages de la piste, bleus et rouges, qui forment comme une traînée continue et clignotante, et devant la tour de contrôle trois voitures noires et un groupe de personnes. Le Junkers fait un premier passage, puis prenant la piste par le nord, il se pose à son extrémité, réservant une longue course pour rouler lentement vers l'aire d'arrivée, à quelques dizaines de mètres des voitures.
Samedi 30 juin, 4 heures du matin.
L'appareil s'est immobilisé sur la piste de Munich-Ober-wiesenfeld. Les hélices des trois moteurs continuent de tourner dans le silence, lentement. On aperçoit, par les hublots de l'avion, des hommes en uniforme S.S. qui s'avancent Le mécanicien de l'appareil débloque de l'intérieur la porte et l'ouvre brutalement sur la lumière blanchâtre, grisâtre, sans joie, couleur de plâtre et de ciment sur l'aube hésitante du dernier jour de juin.
Troisième partie
« JUSQU'A BRULER LA CHAIR VIVE... » (Hitler)
Du samedi 30 juin 1934 (4 heures du matin)
au lundi 2 juillet 1934 (vers 4 heures du matin)
1
SAMEDI 30 JUIN 1934
Munich, entre 4 heures et 6 heures
MUNICH-OBERWIESENFELD, 4 heures.
L'aube. C'est le Führer qui paraît le premier à la porte du Junkers. Il descend rapidement l'échelle métallique, puis il se met à marcher vers les voitures ; les membres du Parti, les chefs S.S. qui l'attendent ont peine à le suivre : il fait de grandes enjambées nerveuses, le chapeau à la main, le bras rageusement secoué. Il n'a salué personne : il va et Goebbels, loin derrière déjà, tente de le rejoindre de sa démarche maladroite de boiteux.
L'aube, à peine commencée. Un peu en retrait, presque dissimulés parce que leurs masses grises se confondent avec les zones d'ombre, deux véhicules blindés que le général commandant le Wehrkreis VII, la région militaire de Munich, a fait placer sur le terrain pour protéger le Führer. Un camion militaire stationne aussi, près des voitures. Les soldats, le fusil serré entre les genoux, casqués, attendent depuis plus d'une heure. Le camion et les véhicules blindés doivent suivre le cortège officiel et en assurer la couverture militaire. L'officier commandant le détachement s'avance vers le Führer. Il a à ses côtés un officier de l'Abwehr. Hitler les salue rapidement. Tout est brusque en lui et révèle la nervosité, la détermination. Il écoute le rapport des deux officiers de la Reichswehr, puis un officier des S.S. fait une analyse de la situation à Munich. Les S.A. qui avaient manifesté dans les rues sont tous rentrés chez eux. Ils attendent les ordres. Hitler semble à peine entendre. Il commence à parler : la voix est sourde, les mots se bousculent. Il ne veut pas de couverture militaire : il remercie la Reichswehr mais elle doit rester étrangère à cette action, ne pas se mêler de cela. Il insiste, répète les mots : ne pas se mêler de cela et d'un geste de la main il appuie sa volonté. Tourné vers l'officier de l'Abwehr, Hitler ajoute : « C'est le jour le plus dur, le plus mauvais de ma vie. Mais, croyez-moi, je saurai faire justice. Je vais me rendre à Bad Wiessee. » Il brandit son poing gauche, déjà il fait quelques pas, puis conclut : « Avertissez immédiatement de nos intentions le général Adam. »
Adam commande le Wehrkreis VII. Les messages se sont succédé à son Etat-major car la région de Munich joue un rôle capital dans le déroulement de l'action. Le lieutenant colonel Kübler, le chef d'Etat-major d'Adam, est d'ailleurs resté à son bureau toute la nuit, attendant les ordres. Peu après 4 heures, il a reçu de la Bendlerstrasse confirmation de la mise en état d'alerte de plusieurs unités (artillerie, génie, transmissions, train). Le 19eme régiment d'infanterie doit être maintenu sous les armes, en état de marche afin de pouvoir éventuellement rétablir l'ordre sur une ligne qui joint Bad Tölz aux deux lacs de Schliersee et de Tegernsee. A 4 h 15, des coups de sifflets retentissent dans la caserne centrale de Munich. Les hommes qui ont déjà revêtu leur uniforme, courent dans les couloirs, le casque à la main. Le lieutenant-colonel Kübler est dans la cour, écoutant le bruit familier des centaines de lourds souliers qui dévalent les escaliers, des commandements qui claquent. Bientôt les carrés des compagnies s'ordonnent et le silence se rétablit, cependant que le lieutenant-colonel Kübler passe ses hommes en revue.
L.'aube a vite gagné tout le ciel, mais les objets, les silhouettes, les arbres restent enveloppés d'un halo d'ombre. C'est une lumière qui donne une impression de froid et d'incertitude. Le Führer a près de lui Wagner, le ministre de l'Intérieur, Gauleiter de Bavière. Sur le visage massif du nazi, rond, pâle, se lisent la tension, l'inquiétude, la fatigue. Depuis hier soir, chaque heure a apporté un élément nouveau : les coups de téléphone qui se sont succédé de Berlin, de Godesberg, les consignes de Himmler. Les choix qu'il faut faire et qui peuvent coûter la vie. Wagner debout près d'une voiture expose son point de vue sur la situation à Munich. Tout est calme. L'Obergruppenführer S.A. Schneidhuber doit encore se trouver consigné au ministère de l'Intérieur. Hitler écoute, puis donne quelques ordres brefs : la police politique bavaroise, rouage que Heydrich et Himmler ont mis au point, la fameuse Bay Po Po doit entrer en action, arrêter les chefs S.A., surveiller avec les S.S. la gare de Munich où vont arriver les invités de Rœhm et de Hitler et les empêcher de se rendre à Bad Wiessee.
Enfin les portières claquent et les voitures s'ébranlent. Les deux officiers de la Reichswehr saluent. Après quelques minutes de route, ce sont déjà les premiers immeubles de Munich, la Ville du nazisme. C'est ici que Hitler a commencé, ici qu'en 1923 a eu lieu le premier putsch, que les balles de la police fidèle au gouvernement ont sifflé près de Hitler cependant que tombait Gœring à ses côtés. Rœhm, en ce temps-là, était au centre de l'action, ayant occupé le ministère de la Guerre. Hitler alors avait marché dans les rues de Munich le revolver au poing, dans l'étroite Residenzstrasse vers l'Odeonplatz, vers ce ministère de la Guerre où Rœhm attendait. Puis, la police avait refusé d'ouvrir ses barrages, Hitler criait : « Rendez- vous ! » et les coups de feu avaient éclaté. Hitler avait rapidement fui vers la queue de la colonne, s'engouffrant dans une voiture jaune qui stationnait sur la Max-Josef-Platz. Hitler ne peut que se souvenir de ces 8 et 9 novembre 1923, son coup d'Etat de brumaire avorté. Maintenant, il passe dans les mêmes rues sans arbres, vallées grises aux parois de béton. Tout est désert : les volets sont clos, les magasins fermés. C'est l'aube. A un carrefour quelques groupes de S.A. bavardent, les uns assis sur les trottoirs, d'autres palabrant au milieu de la chaussée. « Nous n'aperçûmes plus, racontera Goebbels, que les derniers restes des formations S.A. qui, trompées, l'esprit flottant, paraissaient ne plus attendre pour se disperser qu'un mot rassurant du Führer. »
Les voitures passent et ces hommes en chemises brunes ne distinguent pas Hitler et Goebbels, le destin de l'Allemagne et leur destin. Beaucoup ont bu depuis hier soir ; certains parlent fort dans ces rues calmes, chantent à tue-tête. Personne n'est intervenu. Depuis longtemps, la police est prudente et les Munichois savent qu'on ne peut pas contester les S.A. Ils sont là, à ce carrefour, dans la lumière grise de ce matin qui pour cela ressemble à ce 9 novembre 1923 alors que vers midi et demi dans une même lumière grise marchait vers l'Odeonplatz la colonne nazie. Certains des S.A. ont décidé de gagner la maison du Parti, la Maison Brune où tant de fois Hitler est venu commémorer les événements de 1923 ou la création du Parti. C'est le Quartier général de la Sturmabteilung et depuis hier soir il ne désemplit pas : on y boit, on y chante. Demain le Führer doit rencontrer Rœhm et tout sera éclairci entre la Sturmabteilung et le Parti. Certains S.A., les bottes enlevées, le baudrier défait, la chemise entrouverte dorment sur les bancs. Ces hommes corpulents qui recherchent la fraternité, l'illusion de solidarité que donne l'appartenance à un même groupe, le port du même uniforme, ces hommes, qui s'oublient dans les rites, les beuveries et les chants, sont, ce matin du 30 juin 1934, sans inquiétude. Les derniers qui entrent dans la Maison Brune après avoir traîné toute la nuit dans les brasseries de Munich ne remarquent même pas ces S.S. et ces policiers qui prennent position devant le bâtiment, sentinelles qui paraissent anodines. Ils ne savent pas que le ministre de l'Intérieur Wagner a reçu l'ordre de laisser tous ceux qui le veulent pénétrer dans la Maison Brune mais d'empêcher quiconque d'en sortir à partir de 5 heures du matin.
MUNICH. MINISTERE DE L'INTERIEUR.
Il n'est pas encore 5 heures. Les voitures qui conduisent Hitler, Goebbels, Lutze, Otto Dietrich, Schaub, Wagner, viennent de passer. Elles s'arrêtent devant le ministère de l'Intérieur. Hitler une fois encore descend le premier : il bondit presque. Maintenant que la partie est engagée, il sait qu'il faut jouer vite, abattre ses cartes sans laisser de répit à l'adversaire, abattre des hommes. Des S.S. sont là, devant le ministère, Emil Maurice avec son visage de boxeur marqué par les coups, Buch, Esser, les hommes fidèles que l'on a prévenus de l'arrivée de Hitler et qui attendent parfois depuis des années l'occasion de régler leurs comptes à d'anciens camarades. D'autres S.S. arrivent par petits groupes : ce sont les hommes de Himmler et de Heydrich que Wagner, avant de partir pour l'aéroport, a convoqués. Pour la plupart, ils savent que l'heure de l'action est venue et qu'ils sont avec Hitler.
Le Führer pénètre dans le ministère, Brückner est derrière lui, le visage fermé, les yeux soupçonneux. Les couloirs sont sombres, mal éclairés : il semble qu'on entre à nouveau dans la nuit. Des ordres retentissent, des hommes courent. Le bâtiment s'anime. Au deuxième étage, dans l'antichambre du bureau de Wagner, l'Obergruppenführer S.A. Schneidhuber, attend en somnolant. Quand il aperçoit le Führer, il esquisse un salut mais Hitler est sur lui, les mains ouvertes, comme pour l'agripper, Schneidhuber recule. Hitler crie : « Qu'on l'enferme. » Le visage du Führer est agité de tics, il hurle alors qu'on entraine déjà l'Obergruppenführer vers la prison de Munich-Stadelheim.
« Ce sont des traîtres » crie encore Hitler. Tout le monde se tait. Goebbels dresse avec Wagner, sur un coin du bureau, les listes d'hommes à arrêter. Il n'est pas encore 5 heures. Wagner lui-même téléphone au Gruppenführer S.A. Schmidt. L'ordre est précis : il doit se rendre immédiatement au ministère de l'Intérieur où le Führer l'attend. Hitler va et vient il ne parle pas : devant lui, les groupes s'écartent. Il y a maintenant quelques dizaines d'hommes aux visages résolus, nerveux, donnant à l'atmosphère une intensité difficile à supporter. Hitler s'approche de la fenêtre : dehors la ville est calme, déserte. Le ministère de l'Intérieur est un îlot d'activités, de nombreuses voitures sont rangées devant l'entrée.
Quelques instants plus tard, Schmidt entre dans le bureau. Hitler s'avance au-devant de lui et avant que le Gruppenführer ait pu parler, le Führer se précipite, lui arrache les galons. « Vous êtes arrêté. » « Traître, crie-t-il encore, vous serez fusillé. »
La stupéfaction se lit sur le visage de Schmidt Les témoins ont des sourires figés où se mêlent la joie d'être avec ceux qui l'emportent et aussi la peur. « Vous serez fusillé. » La sentence résonne encore cependant qu'on entraîne Schmidt vers la prison de Stadelheim.
Maintenant on ne peut plus sortir de la Maison Brune. Quelques S.A. qui voulaient rentrer chez eux, ont été refoulés fermement sans violences mais sans explications. La seule réponse des sentinelles armées a été : « Ordre du Führer. » Dans les vastes salles au plafond bas, enfumées, on réveille ceux qui dorment. Les conversations s'animent on ouvre les fenêtres. Le ciel a bleui au-dessus de Munich. Il n'est pas loin de 6 heures. Des garçons de magasins relèvent leurs rideaux de fer. Les S.A., le corps penché au-dessus des rambardes, aperçoivent les camions de la police et des S.S. : la Maison Brune est encerclée.
A peu près à la même heure, des camions de la Reichswehr se rangent dans les cours intérieures de la gare de Munich. Seuls les gradés sont autorisés à descendre des véhicules : les soldats ont été amenés là en renfort et ne doivent intervenir que si les S. S. ne suffisent pas. En effet, sur les quais de la gare, à la surprise des premiers voyageurs pour la plupart des travailleurs, qui portent presque tous le traditionnel petit cartable de cuir, des S.S. prennent position : ils doivent interpeller les chefs S.A. qui vont arriver.
D'autres S.S. se rassemblent devant le ministère de l'Intérieur. Certains, parfois par groupe de deux ou trois, accompagnés d'hommes de la Bay Po Po s'engouffrent dans des voitures qui démarrent rapidement : les équipes de tueurs commencent leur chasse.
Un peu avant 6 heures, le jour est levé : la lumière nette frappe le haut des immeubles sans rompre encore tout à fait l'obscurité grise qui s'accroche au fond des rues. Adolf Hitler sort du ministère de l'Intérieur. Son manteau de cuir serré à la taille est froissé, il garde toujours son chapeau à la main, ses mouvements sont brusques, il regarde dans la rue, à gauche et à droite, paraissant inquiet et anxieux. Goebbels est derrière lui, grimaçant, souriant nerveusement, pâle. Les S.S. saluent. Le Führer hésite quelques minutes puis monte dans la première voiture, à côté du chauffeur. Des S.S. réquisitionnent des taxis, d'autres s'installent dans les dernières voitures officielles. Hitler n'a pas encore donné le signal du départ Wagner reste au haut des marches du ministère, les bras croisés : sa mission est de demeurer à Munich pour contrôler la situation et prévenir toute action des S.A. Il doit notamment emprisonner ceux qui sont restés à la Maison Brune. Quelques minutes plus tard, le convoi s'ébranle, la voiture du Führer ouvrant la marche.
Les quartiers du centre commencent à s'animer. Les camions de la voirie circulent lentement et des concierges balaient devant les portes ; des laveurs de carreaux, leurs éponges au bout d'une longue perche, nettoient les vitrines, Brienerstrasse.
Les voitures roulent vite, sur la large avenue Thaï, abordant rapidement la courbe qui, après l'Isar-Thor-Platz conduit aux ponts sur l'Isar : les eaux, à cette époque de l'année, sont hautes, entraînées par un fort courant qui, contre les piles du Ludwigs-Brücke crée de petites vagues blanches. Les ponts franchis, s'ouvre la longue ligne droite de la Rosenheimer-strasse et, vers le Sud, à une soixantaine de kilomètres, il y a, au bord du lac de Tegernsee, la pension Hanselbauer où dorment Rœhm et ses camarades. Les voitures ont maintenant atteint la banlieue de Munich et la route débouche brusquement sur la campagne : au loin on aperçoit la masse sombre de la forêt encore enveloppée d'une brume grise.
Il va être 6 heures.
A Berlin, dans l'appartement de von Tschirschky, le téléphone sonne. Le secrétaire du vice-chancelier Papen décroche au bout de quelques instants, demande qui est à l'appareil : un déclic. A l'autre bout de la ligne on a raccroché sans répondre, comme si l'on voulait seulement s'assurer que Tschirschky était bien à son domicile.
Au n° 8 de la Prinz-Albrecht-Strasse, siège de la Gestapo, les communications se succèdent. Heydrich et Himmler malgré l'heure matinale sont arrivés depuis longtemps, peu de temps après que le Führer eut décollé de Bonn-Hangelar. Il y a quelques instants à peine, un coup de téléphone de Wagner les a avertis que Hitler était parti pour Bad Wiessee et qu'il réclamait la présence de Rudolf Hess à Munich.
2
SAMEDI 30 JUIN 1934 Bad Wiessee,
pension Hanselbauer, 6 heures 30 Munich, 10 heures
LA ROUTE DE BAD WIESSEE
Très vite la route s'élève au milieu des prés et la lumière rasante et brillante, avec des teintes dorées, se réfléchit sur les carrosseries des voitures. Munich, derrière, vers le nord n'est déjà plus que cet assemblage de cubes gris dressés dans la plaine et dont certains paraissent percer une zone d'ombre qui stagne sur la ville. Bientôt c'est la forêt, noire, les arbres tendus, pressés les uns contre les autres, entremêlant leurs branches, hêtres noirs prêts à s'avancer à nouveau, à se rejoindre en recouvrant la route et que seule une attention inquiète des hommes d'Allemagne semble maintenir, disciplinés, surveillés. La route passe entre les arbres et l'air humide et froid, venu des sous-bois obscurs enveloppe les voitures dont le bruit du moteur est étouffé. Le Führer est silencieux près du chauffeur dans la première voiture. Derrière lui, Joseph Goebbels parle, intarissable, refaisant l'histoire du complot de la Sturmabteilung. Hitler se tait. Voilà plus de 24 heures que le Führer n'a pas pris de repos : la nuit de veille à Bad Godesberg pèse sur lui, la nuit de l'hésitation et du choix, l'attente, la route, le vol, la route encore, cette route qui s'enfonce maintenant dans la forêt allemande. Sur le visage de Hitler, gonflé, avec les yeux enfouis sous les paupières bouffies se devinent la fatigue, l'irritation crispante que donne le manque de sommeil. Il a laissé la vitre baissée et le vent frais lui fouette le visage, soulevant ses cheveux. Il a relevé le col de son manteau et il reste ainsi dans l'air humide qui sent la forêt, frileusement enfoui dans son siège, les bras croisés, regardant droit devant lui la route qui conduit au capitaine Ernst Rœhm, son camarade. A une trentaine de kilomètres, le chauffeur prend, à droite, une route qui paraît entrer dans la forêt. Elle est étroite, les arbres au-dessus d'elle se rejoignent, voûte basse et irrégulière : parfois les branches frappent les voitures.
Au bout, il y a le lac : Tegernsee dans l'ombre encore, la nuit accrochée aux rives et à l'eau, les forêts des pentes se reflètent près des rives ; en haut, vers les sommets, la lumière règne déjà, éclatant parfois en un reflet aveuglant.
Le chauffeur a ralenti : la route longe le lac, sur la rive occidentale. Le bruit des moteurs résonne et, après le silence de la forêt, il paraît énorme, comme un avertissement lancé à la ronde. Le Führer s'est légèrement penché à la portière : le premier village, Gmund, avec ses maisons en bois apparaît. Ce n'est qu'un groupe de quelques habitations serrées autour d'une belle église, l'une de ces constructions orgueilleuses du XVIIeme siècle. Quelques paysans s'affairent devant les granges, une vieille conduit un troupeau de vaches. Déjà le village est traversé, une plaqué indique, à la sortie, que Bad Wiessee est à 5 kilomètres.
Dans la voiture du Führer, assis sur la banquette arrière, à côté de Goebbels, un officier de la Reichswehr, délégué par le Wehrkreis VII, écoute depuis Munich sans répondre, les bavardages passionnés du ministre de la propagande : l'officier représente le général Adam et l'Abwehr. Hitler se tourne vers lui : « Je sais, dit-il, que vous avez été longtemps le collaborateur du général von Schleicher. » L'officier n'a pas le temps de s'expliquer, le Führer parle vite : « Je dois, hélas ! vous dire, continue-t-il, que le gouvernement est obligé d'ouvrir une instruction contre lui car il est soupçonné d'être en contact avec Rœhm et une puissance étrangère. » Puis le Führer se tait à nouveau, se redressant quelque peu sur son siège.
A cette heure, alors que sur les bords du lac de Tegernsee, son nom est tout à coup lâché comme une proie à abattre, le général Schleicher se prépare comme tous les matins à faire quelques exercices de gymnastique. La Griebnitzseestrasse, à Potsdam, où se dresse sa villa cossue est calme, déserte. La journée s'annonce paisible, le général n'a aucune inquiétude, aucun pressentiment. La colline boisée de Babelsberg qu'il regarde de sa fenêtre est enveloppée d'une brume légère sous le ciel bleu de juin.
LA PENSION HANSELBAUER.
Et le ciel se reflète aussi dans les eaux sombres du lac de Tegernsee. Les voitures ont encore ralenti mais le bruit des moteurs résonne toujours, répercuté par les pentes qui entourent le lac. Voici les premières maisons de Bad Wiessee, la forêt s'est écartée, refoulée plus haut au-delà des pâturages. Un camion, portant des S.S. de la Leibstandarte Adolf-Hitler et leur chef Sepp Dietrich, attend au dernier tournant. La colonne des voitures ne s'arrête pas : maintenant chaque seconde compte. Devant la pension Hanselbauer, avant même que les voitures ne soient immobilisées, les hommes bondissent courant le revolver au poing vers le bâtiment dont les volets sont clos. L'herbe et la mousse étouffent leurs pas ; ils encerclent la grosse bâtisse blanche, des officiers S.S. commandent par gestes la manœuvre. Le silence, rendu encore plus perceptible par le gazouillis intarissable et joyeux des oiseaux. La paix.
Hitler est devant la porte principale, entouré de plusieurs S.S., Brückner est près de lui avec Emil Maurice, tous deux sont armés. Brusquement l'action se déchaîne : d'un coup de pied, la porte est ouverte, alors ce sont des cris gutturaux, les portes qui claquent des femmes de service qu'on bouscule et qu'on repousse dans l'entrée. Goebbels racontera plus tard : « Sans rencontrer de résistance, nous pouvons pénétrer dans la maison et surprendre la bande de conjurés encore plongée dans le sommeil et les mettre immédiatement en état d'arrestation. C'est le Füher lui-même qui procède aux arrestations. Un S.S. sans grade déclare : « Je voudrais qu'immédiatement les murs s'abattent et que le peuple allemand tout entier puisse être témoin de ces faits. Il comprendrait combien notre Führer a raison de demander des comptes impitoyablement et rigoureusement à ceux qui sont coupables. Combien il a raison de leur faire payer de leur vie le crime qu'ils ont commis envers la nation ».
Dans la pension Hanselbauer, tout le monde dort. Brutalement les portes sont ouvertes, certaines sont défoncées, les S.S. hurlent le revolver au poing. Ils courent dans les couloirs.
Dans cette demi-obscurité, des hommes ensommeillés, menacés de mort, puis avançant sous les coups et les cris, sont hébétés. Dans l'une des premières chambres, le comte Spreti, Standartenführer de Munich, n'a pas le temps de se lever : on l'arrache du lit à demi nu, on le pousse dans le couloir sous les insultes. Plus loin, Edmund Heines est surpris avec le jeune S.A. qu'il a gardé contre lui toute la nuit, dans son lit. Goebbels dira : « C'est une de ces scènes dégoûtantes qui vous donnent envie de vomir ». Heines insulté, arrêté, menacé d'être abattu immédiatement, tente de résister. Brückner l'étend de plusieurs coups de poing. Heines à demi assommé ne comprend pas. « Je n'ai rien fait, crie-t-il à Lutze, vous le savez bien, aidez-moi, je n'ai rien fait. » Lutze se contente de répéter : « Je ne peux rien ».
Dehors, dans le couloir, brusquement, le silence s'est fait. Hitler et de nombreux S.S. sont rassemblés devant une porte : c'est la chambre de Rœhm. Le Führer est là, le revolver au poing : derrière cette mince paroi de bois, il y a son camarade, le temps passé, tout un versant de sa vie qui va s'abolir. Un policier frappe à la porte, puis le Führer lui-même se met à heurter et quand Rœhm questionne, c'est lui qui répond, se nommant. Le chef d'Etat-major de la S.A. ouvre et le Führer se précipite : il insulte, il crie à la trahison, il menace, crie à nouveau à la trahison. Rœhm est torse nu, son visage est rouge, gonflé par la nuit écourtée ; on distingue sur ses muscles adipeux la trace des cicatrices. Il se tait d'abord, puis mal réveillé, comprenant lentement, il commence à protester. Hitler hurle, déclare qu'on lui manque de respect, et annonce qu'il met Rœhm en état d'arrestation. Et il court vers d'autres chambres cependant que des S.S. surveillent Ernst Rœhm dont la puissance vient de s'effondrer, en quelques minutes, et qui n'est plus qu'un homme corpulent qui s'habille avec difficulté sous les regards ironiques des S.S. Dans une autre chambre, on s'empare du Standartenführer Julius Uhl. Plus tard, Hitler commentant la liquidation des S.A. déclarera : « Un homme avait été désigné pour me mettre complètement hors du jeu : le Standartenführer Uhl a avoué, quelques heures avant sa mort, qu'il était prêt à exécuter un ordre pareil sur ma personne ».
Les prisonniers sont, au fur et à mesure, poussés vers la cave, placés sous bonne garde : des S.S., des agents de la Bay Po Po, les surveillent l'arme au poing. Bientôt Hitler, Goebbels, Lutze, Brückner, Maurice, Dietrich, ressortent dans le jardin. Face à eux, le lac, coupé maintenant par une bande claire de lumière, est à peine ridé par une brise douce. La paix, les grands arbres, la mousse et l'herbe humide de rosée. Goebbels rit et des S.S. eux aussi parlent fort, avec la joie de ceux qui l'ont emporté plus facilement qu'ils ne l'escomptaient Hitler est entouré : il ne parle pas, il paraît écouter ses hommes qui commentent les quelques instants qu'ils viennent de vivre. Il se tait. Il a joué et gagné. Autour de lui la détente : dans les voix, dans les gestes. Mais Hitler sait qu'une partie n'est gagnée que lorsqu'elle est finie, que les adversaires sont morts.
Brusquement, un bruit de moteur. Goebbels raconte : « A ce moment, la Stabswache, la garde personnelle de Rœhm, arrive de Munich. Le Führer lui ordonne de faire demi-tour. » Deux phrases, deux courtes phrases pour marquer que le destin a hésité, ce matin-là, au bord du lac de Tegernsee. Les S.A. de la Stabswache sont des fidèles de Rœhm, à toute épreuve. Ils sautent du camion, lourdement armés. Leurs officiers regardent avec surprise les S.S., la pension Hanselbauer. Leur chef est ce Julius Uhl dont ils ignorent qu'il n'est plus, comme Rœhm, qu'un prisonnier. Ils hésitent, incertains, et les S.S., face à eux, tout à coup silencieux, les observent. Tout peut basculer. Hitler fait quelques pas. Il est entre ces hommes armés, seul à vouloir, seul à pouvoir. Les officiers S.A. le saluent. Il commence à parler, sa voix s'affermit : je suis le chef responsable, votre Führer, vous devez retourner à Munich, attendre mes ordres. Les officiers S.A. se consultent du regard, puis remontent dans le camion avec leurs hommes et le véhicule démarre lentement, passant le portail de la pension Hanselbauer. Pendant quelques minutes on entend encore le bruit du moteur puis c'est à nouveau le silence, la paix.
Personne ne commente l'incident, mais les rires ont cessé. Tout le monde se tait ; seuls quelques ordres, des hommes — Uhl, Spreti, Rœhm, leurs camarades — sont poussés vers les voitures, les portières claquent, le camion chargé des S.S. de la Leibstandarte se range en queue du convoi. Le Führer est dans la première voiture, il a repris sa place à côté du chauffeur et c'est lui qui donne le signal du départ.
UN CONVOI VERS MUNICH
Maintenant le jour règne : le lac est presque entièrement pris dans sa lumière. La brise est déjà tombée et les eaux sont lisses, sans une ondulation ; l'air paraît lui-même immobile comme cela arrive souvent, l'été, durant quelques heures, le matin, en montagne, peu après le lever du soleil, avant que la chaleur n'ait mis en mouvement la nature tout entière. Les voitures longent à nouveau le lac, mais le Führer d'un geste a changé de route : on rentre à Munich par le sud, en faisant le tour du Tegernsee. Hitler est un homme prudent et le départ de la garde personnelle de Rœhm ne l'a pas tout à fait rassuré. Les S.A. peuvent se reprendre, revenir à la pension Hanselbauer, croiser le convoi. En passant par le sud, on augmente les chances de les éviter. Effectivement les officiers S.A. sont inquiets, incertains. Tout leur paraît anormal, imprévu : la présence matinale de Hitler, les S.S. armés et la pension Hanselbauer qui semblait vidée de ses occupants. Ils décident de faire arrêter le camion entre Wiessee et Gmund. Mais la colonne de Hitler passe sur l'autre rive.
Wiessee, Rottach-Egern, Tegernsee : des petites villes s'éveillent. Il est un peu plus de 7 heures et, en les traversant, le convoi a dû ralentir parce que des camionnettes de livraison stationnent dans les rues étroites. Le contraste est grand entre cette colonne noire dirigée par le Chancelier du Reich en personne, cette colonne composée d'hommes armés qui en conduisent d'autres à la mort, cette colonne qui est l'histoire en train de s'écrire et ces autres hommes croisés sur le seuil de leurs boutiques en train de décharger des caisses, de confectionner des paquets, de prendre un déjeuner sous les arbres, ces hommes qui ne savent pas que passent devant eux le Führer et leur destin. Ils ne voient pas Hitler, ils ne l'imaginent pas surgissant ici, parce qu'ils sont enfermés dans leur ignorance, leurs illusions et leur vie quotidienne, un au jour le jour recommencé chaque matin, vie lente et semblable, où l'on fait les mêmes gestes, souvent en ne rêvant même plus qu'ils pourraient être autres. Et Hitler ne les voit pas non plus ces hommes isolés, anonymes, grains inconnus du peuple allemand. Il est tout entier dans cette action brutale où se ramasse sa vie et dont dépend son sort. Et il s'est engagé personnellement. Comme en ces jours de novembre 1923 quand, le soir du 8, revolver au poing, il avait interrompu le discours de von Kahr, président du Conseil de Bavière, avait bondi sur une chaise et tiré un coup de feu en l'air en criant : « La révolution nationale est commencée ».
Mais la partie avait alors été perdue et Gustav von Kahr avait habilement manœuvré. Aujourd'hui, 11 ans plus tard, Chancelier du IIIeme Reich, comme autrefois alors qu'il n'était que le chef d'un parti naissant, Hitler n'a pas hésité à intervenir, le revolver à la main, à agir comme un soldat du rang, comme un aventurier qui serait aussi à la tête de l'Etat.
Et revoici le village de Gmund, à l'extrémité du lac, et revoici la route qui pénètre dans la forêt et conduit à l'embranchement avec la grande voie qui se dirige vers Munich. Hitler fait ralentir le convoi : il est en effet probable que l'on va croiser les chefs de la Sturmabteilung qui se rendent à Bad Wiessee, auprès de Rœhm, pour la confrontation prévue avec le Führer. Il s'agira de les intercepter en cours de route. Certains des véhicules de la colonne se déportent vers la gauche de façon à rendre obligatoire un arrêt des voitures qui vont vers Wiessee. Goebbels racontera : « Au fur et à mesure de leur rencontre, les voitures étaient invitées à stopper et leurs occupants étaient interrogés. S'ils étaient reconnus coupables ils étaient immédiatement faits prisonniers, et remis aux S.S. du convoi. Dans le cas contraire, ils recevaient l'ordre de se joindre à la caravane et de revenir avec elle vers Munich ».
Ces interpellations dans l'air frais de la forêt, avec ces courses des S.S de l'escorte, l'arme à la main, vers la voiture immobilisée, tout cela ressemble moins à l'action de police d'un grand Etat moderne qu'au coup de main d'une bande de reîtres et de lansquenets qui, dans une Allemagne de légende, agit avec la brutalité de ces troupes qui, au temps des Grandes Compagnies, ravageaient le pays. L'une des premières voitures arrêtées est celle de Peter von Heydebreck. Brückner et Hitler lui-même, puis des S.S. se précipitent vers Heydebreck. Cet Obergruppenführer de la S.A. est un homme maigre, osseux, il a perdu un bras durant la guerre, animé les corps francs, combattu en Silésie et dès 1922, il est entré au Parti. C'est un soldat-aventurier, un homme de guerre. Et Hitler, au début du mois de juin 1934 a, en son honneur, donné le nom de Heydebreck à un village situé près de la frontière polonaise : dans ces bois, en 1919, les chasseurs de Heydebreck, ces volontaires, ont livré contre les Polonais, pour empêcher l'application du diktat de Versailles, une dure bataille. Heydebreck est entouré par les S.S. : il regarde les armes pointées vers lui. Le Chancelier le questionne : est-il du côté de Rœhm ? Heydebreck répond par l'affirmative. Aussitôt on le désarme, on l'injurie, on le pousse vers une des voitures où déjà Uhl et Spreti sont gardés, Spreti défait, hagard, Uhl dont le visage grimace un sourire amer et désespéré, tous deux sachant que la mort les attend. Peter von Heydebreck brusquement comprend. Il se laisse pousser sans mot dire.
Tout au long de la route, d'autres voitures sont arrêtées : parfois les occupants sont simplement invités à suivre le convoi, le plus souvent ils sont arrêtés et désarmés. Sur la route, près de Munich, on croise aussi des camions de la Reichswehr. Les soldats casqués appartiennent au 19eme régiment d'infanterie et font mouvement vers Tegernsee et Bad Tölz. Les camions avancent lentement, ils patrouillent, mais tout est calme.
A l'entrée de Munich, la circulation est grande. Il est un peu plus de 8 heures. Dans le soleil qui se réfléchit en mille paillettes sur les eaux de l'Isar, les tramways filent, chargés d'employés, vers le centre de la ville. Les piétons sont nombreux, patientant en longues files aux arrêts. Il y a aussi les cyclistes, pressés, attendant le signal de l'agent pour s'élancer aux carrefours. La ville, malgré l'heure matinale, est recouverte déjà d'une brume chaude faite de fumées. Le convoi ralentit, puis s'arrête. Un officier S.S. court vers la voiture du Führer. Personne parmi les passants ne semble remarquer Adolf Hitler. Les Munichois passent, à peine tournent-ils la tête. Ils savent déjà que souvent il ne faut pas voir. L'arrêt a duré quelques secondes. Le S.S. repart avec les voitures qui ferment la marche et où s'entassent les chefs S.A. prisonniers. Ils vont être dirigés vers la prison de Stadelheim. Le Führer et les chefs nazis se dirigent vers le Hauptbanhof, la gare centrale de Munich. Le train de Berlin chargé d'officiers de la Sturmabteilung a dû arriver. Le Führer veut être sur place. Comme un chef de bande, un aventurier ou un chef d'Etat, il sait qu'il est des actions qu'il faut contrôler soi-même.
AU HAUPTBANHOF DE MUNICH.
Le Hauptbanhof est un immense bâtiment grisâtre situé près du Palais de Justice, au cœur de Munich, dans ces quartiers anciens que les voies de chemin de fer ont éventrés à la fin du XIXeme siècle. Les voitures du convoi se rangent dans l'une des cours intérieures, sur le côté nord de la gare. Les camions de la Reichswehr sont toujours là avec leurs hommes : certains soldats ont rejeté leur casque en arrière, d'autres somnolent. Des S.S. se précipitent vers les voitures. Hitler descend : le visage est toujours tendu. On lui annonce que Hess est arrivé de Berlin et qu'il attend le Führer dans le bureau de la direction de la gare. Le groupe suivi de Goebbels se dirige vers l'intérieur escorté par les S.S. armés. La haute silhouette de Brückner domine le groupe. On entend le haut-parleur qui, dans la rumeur bourdonnante de la gare, invite les chefs S.A. à se présenter au contrôle situé au bureau n° 1, pour recevoir des ordres les concernant. Sur tous les quais, des S.S. scrutent les voyageurs. Quand le train de Berlin est entré en gare, des officiers S.S. ont sauté sur les marchepieds, contrôlant un à un tous les passagers et visitant les wagons. Les S.A. ont été priés de suivre les S.S., Standartenführer et Oberführer ont accepté sans hésitation : ils ignorent tout ce qui les guette, ils imaginent que ces S.S. doivent les conduire à Bad Wiessee où Rœhm et Hitler attendent leur arrivée. Ils ne s'inquiètent pas. Demain, ils seront en congé pour un mois. La plupart sont encore à demi endormis après une nuit passée dans le train, ils marchent pesamment aux côtés des S.S., au milieu des voyageurs que ne surprend plus cette débauche d'uniformes noirs, bruns. Ainsi sont pris les Obergruppenführer von Krausser, Hayn, ainsi est pris le Gruppenführer Georg von Detten et Hans Joachim von Falkenhausen et beaucoup d'autres. Quand ils interrogent, veulent protester, il est trop tard : ils sont entourés, désarmés, conduits déjà vers les voitures noires qui attendent ; encadrés par des S.S. ou des hommes de la Bay Po Po, ils sont invités à monter dans ces voitures dont les chauffeurs sont des S.S., poussés s'ils refusent et les voitures se dirigent maintenant rapidement dans l'indifférence de la grande ville animée, vers la prison de Stadelheim.
Le directeur de la prison, le docteur Robert Koch, est un fonctionnaire modèle : s'il est nazi, c'est comme beaucoup d'Allemands, sans excès. Respectueux des règlements et des ordres, cette journée du samedi 30 juin 1934 va être pour lui l'une des plus difficiles de sa carrière. Vers 6 heures on lui a passé une communication téléphonique du ministère de l'Intérieur. Le ministre Wagner, lui-même, indiquait qu'il allait recevoir — et il fallait les placer sous bonne garde — de nombreux officiers S.A. accusés de complot. Robert Koch a immédiatement consulté un état des cellules libres, puis il a attendu. Mais sa surprise au cours de la matinée est allée croissant : après Schneidhuber et Schmidt, quelques heures plus tard, escortés par des S.S., sont arrivés : Roehm, Heines, Spreti, Heydebreck, toute l'élite de la Sturmabteilung. Le Standartenführer Uhl paraît le plus amer, regrettant devant le docteur Robert Koch de ne pas avoir cette nuit, alors qu'il avait encore son revolver, abattu Hitler. Puis sont amenés d'autres S.A., de moindre importance, cueillis à la gare. Vers 9 heures, les cellules sont pleines et après avoir consulté les officiers S.S., Koch installe les prisonniers dans la cour de la prison. Les S.S. montent une garde sévère : déjà, à leur attitude, on comprend que ces hommes en chemises brunes, ces officiers de la S.A. arborant le brassard nazi et de nombreuses décorations, ces glorieux Alte Kämpfer, hier encore des camarades respectés, ne sont plus que des hommes vaincus, prisonniers, abandonnés. Quand un groupe de Führer S.A. fatigués par l'attente sous le soleil dans la cour réclame à boire, proteste, les S.S. sans un mot, mais avec détermination, l'arme à la main, les repoussent vers le milieu de la cour.
Certains parmi les S.A. se sont assis à même le sol, profitant de l'ombre des hauts murs de la prison de Stadelheim et somnolent, écrasés par la fatigue du voyage, la surprise, pris par le fatalisme fréquent chez les hommes de guerre, habitués à l'action et qui savent qu'il est des moments où il faut attendre avec passivité sans essayer de penser et de prévoir. D'autres s'insurgent, s'interrogent. Certains parlent d'un putsch de l'armée et des éléments conservateurs ; d'autres encore espèrent en Hitler qui ne peut qu'avoir été trompé et qui va ouvrir les yeux. Ceux qui ont vu Hitler à la pension Hanselbauer se taisent : ils savent que le Führer les a abandonnés et ils ne comprennent plus. L'homme dont ils ont fait la fortune politique, l'homme qui les connaissait personnellement, qu'ils avaient côtoyé fraternellement à la Maison Brune, avec qui ils avaient parlé familièrement, l'homme qui écrivait à Rœhm une lettre de félicitations, Hitler, était venu le revolver au poing les arrêter.
Alors que parmi les S.A. emprisonnés la peur et la colère impuissante commencent à naître, le Führer est à la gare, il écoute les rapports des S.S. et du ministre Wagner. Hess, Goebbels, Lutze, sont avec lui. Tout se déroule normalement, sans aucune difficulté. Ces S.A. qu'on accusait de préparer un putsch sont sans méfiance : ils se laissent arrêter sans réagir. Goebbels répète de temps à autre comme pour en convaincre les présents, que le putsch S.A. est écrasé dans l'œuf mais en fait il est clair que le prétexte n'a plus aucune importance. L'action a désormais sa propre justification puisqu'elle est commencée et qu'elle semble réussir. Le général von Epp, Statthalter de Bavière, vieil officier de la Reichswehr au profil d'aigle, au visage émacié et qui a, dès le début, rallié le parti nazi, confirme par téléphone au Führer que tout est calme : les troupes restent en état d'alerte mais il est vraisemblable qu'elles n'auront pas à intervenir. Elles sont à la disposition du Chancelier du Reich.
COLIBRI.
Le Führer décide alors de rejoindre la Maison Brune. Elle est située à quelques centaines de mètres de la gare dans la Briennerstrasse. Le cortège de voitures s'ébranle à nouveau quittant le Hauptbanhof peu avant 10 heures. Dans les rues, tout est calme, la foule est dense, vêtue de couleur claire : les hommes sont le plus souvent sans veste, en chemise blanche, tout le centre de Munich avec les jardins, les magasins de luxe, les brasseries, les monuments, a un air de fête, l'air de l'été. Les voitures passent devant la statue de l'électeur Maximilien I", ce chef de la Ligue catholique pendant la grande tourmente de la Guerre de Trente ans, quand la guerre comme une épidémie sanglante ravageait l'Allemagne. Et maintenant un autre chef de Ligue, le Chancelier Hitler, descend devant la Maison Brune, Briennerstrasse. L'immeuble est gardé par des S.S. et dans les rues avoisinantes stationnent des soldats de la Reichswehr. Les trottoirs sont dégagés par le service d'ordre, et les passants sont refoulés sur l'autre côté de la rue.
Il est 10 heures précises, ce samedi 30 juin. Hitler entre dans le siège du Parti. Après une brève conversation avec le Führer qu'il suit comme son ombre, Goebbels demande une communication avec le quartier général de Gœring à Berlin. Le ministre de la Propagande du Reich ne prononce qu'un mot : « Colibri ».
Colibri : trois syllabes pour dire qu'à Berlin aussi les tueurs peuvent agir.
3
SAMEDI 30 JUIN 1934
Berlin, dans la matinée
TSCHIRSCHKY ET PAPEN CHEZ GŒRING.
C'est vers 7 heures du matin que Tschirschky inquiet du coup de téléphone reçu dans la nuit, avec cet interlocuteur mystérieux qui avait immédiatement raccroché, s'est rendu à la vice-chancellerie. Berlin est encore assoupi : une journée d'été commence, chaude, lumineuse. Les arroseuses municipales passent lentement dans un bruit régulier, l'eau gicle dans le soleil. Tout parait calme. Tschirschky note pourtant autour des bâtiments officiels des voitures de police qui stationnent. Depuis deux ou trois jours, en fait, les observateurs ont remarqué ce renforcement des mesures de sécurité. La police de Berlin a été mise en état d'alerte, mais en fin de journée, par deux fois déjà, on l'a déconsignée. Hier soir la mesure d'alerte a été maintenue. Et ce matin, les voitures sont toujours là ; les rondes aussi, régulières. Deux ou trois voitures noires qui avancent lentement dans les rues presque désertes. Parfois, passent des véhicules de l'armée transportant des S.S. impassibles. Tschirschky tente de se renseigner mais le ministère de l'Intérieur du Reich ignore tout des mises en alerte de la police. Le directeur des services de police du ministère, Daluege, n'a même pas été consulté par Gœring qui a pris directement la décision. Tous ces éléments préoccupent Tschirschky qui sait que dans les milieux bien informés on attend un événement. Les signes avant-coureurs n'ont pas manqué et le coup de téléphone de cette nuit n'a au fond, même pas surpris Tschirschky. Cette fois-ci nous y sommes, a-t-il pensé et c'est pourquoi il est là, à la vice-chancellerie, arpentant les couloirs déserts, gagnant son bureau.
Or, à peine est-il installé depuis quelques instants qu'il reçoit une communication téléphonique : Gœring lui-même demande à voir le vice-chancelier Franz von Papen d'extrême urgence. Désormais pour Tschirschky, il n'y a plus de doutes : des événements graves se produisent ou vont se produire. Ce que tout le monde attend depuis le début de juin, sans savoir vraiment ce que cela va être, est là, prêt à déferler sur la capitale allemande ensoleillée et endormie.
Chaque jour Franz von Papen se rend à son bureau à la vice-chancellerie vers 9 heures, avec la régularité méthodique de l'officier prussien élevé à l'école des cadets de Lichterfelde. Tschirschky pourtant n'hésite pas et, racontera Papen plus tard « il m'appela de la vice-chancellerie pour me demander de venir aussi vite que possible... En arrivant à mon bureau, j'appris que Gœring voulait me voir de toute urgence ». Il est à peine 8 h 30. Berlin s'anime pourtant. Dans le quartier des ministères, c'est l'heure des employés qui sortent en vagues sombres des bouches de métro.
Sur la Wilhelmplatz, le vendeur de cigares tire nonchalamment la petite carriole qui lui sert d'étalage pour gagner l'angle de la place où, chaque jour, il s'installe devant le palais du Prince-Léopold, attendant tout ce monde des ministères qui, à l'heure du déjeuner, descend la Wilhelmstrasse et vient flâner dans le petit square de la Wilhelmplatz, devant les colonnes du Kaiserhof ou les statues des héros de la guerre de Sept ans.
Il fait déjà chaud quand Papen et Tschirschky traversent le square venant de la vice-chancellerie pour se rendre à ce qu'on n'appelle plus que le palais de Gœring, situé Leipzigerplatz, en retrait, derrière de grandes grilles de fer forgé hautes et dorées ouvrant sur un jardin qui protège le bâtiment des regards de la rue. Jusqu'à quelques dizaines de mètres du palais, rien ne parait anormal, mais brusquement, on découvre des groupes de policiers et de S.S. « Toujours sans la moindre idée de ce qui se passait, écrit Papen, je filai à l'appartement de Gœring, dans les jardins du ministère de l'Air. A ce moment là, seulement, je fus frappé de voir que les alentours grouillaient de S.S. armés de mitrailleuses ». Dans la cour, policiers et S.S. vont et viennent lourdement armés. Sur les toits, des hommes sont allongés et pointent vers l'entrée des fusils mitrailleurs ; sur les balcons, des S.S. sont en position de tir. Pour pénétrer dans le grand hall de réception, il faut franchir de nombreux barrages. Les sentinelles S.S. arrogantes, surveillent les allées et venues. Le vice-chancelier Papen et Tschirschky sont interpellés à plusieurs reprises. Enfin, ils peuvent accéder au cabinet de travail du ministre-président Hermann Gœring. Dans la pièce encombrée de bibelots, il règne une atmosphère fébrile : les messages se succèdent ; des aides de camp, des S.S., des hommes de la Gestapo entrent et sortent en courant Gœring est là, avec Himmler. Un témoin, Gisevius, se souvient parfaitement de Hermann Gœring, pérorant ce matin-là, les cheveux en désordre, faisant penser avec « sa blouse blanche, sa culotte militaire gris-bleu, des bottes noires dont les genouillères montent au-dessus d'un corps bouffi... au chat botté ou à quelque personnage extravagant de conte de fées. » Himmler, au contraire, est discret, réservé comme à son habitude, mais le regard derrière les fines lunettes dit la détermination, la patience rusée. Gœring accueille Papen avec une condescendance ironique : le ministre-président de Prusse, l'ancien pilote, le morphinomane joue enfin un rôle à sa mesure dans la passion et la violence. Il parle avec la suffisance de celui qui sait qui est au cœur de l'action. « Il m'apprit, explique Papen, que Hitler avait dû partir en avion pour Munich afin d'étouffer une révolte fomentée par Rœhm, et que lui-même avait reçu pleins pouvoirs pour réprimer l'insurrection dans la capitale. »
Gœring s'interrompt souvent pour lire des messages qu'on lui apporte du central téléphonique du ministère. Pilli Kœrner, le secrétaire d'Etat de Gœring à la présidence ministérielle, vient d'arriver avec un gros dossier que Gœring commence à consulter. Papen s'avance. « Je protestai immédiatement, dit-il, c'était seulement à moi, le vice-chancelier, que Hitler pouvait déléguer ses pouvoirs. »
Cela, c'est la lettre du droit, mais Gœring écoute à peine Franz von Papen. Et le vice-chancelier devrait savoir que ce qui compte depuis des mois en Allemagne, depuis que les nazis y font la loi, ce ne sont pas les articles de la Constitution mais bien la force des armes. Il suffit à Papen et à Tschirschky pour s'en convaincre de regarder autour d'eux, de voir ces sentinelles, ces S.S., ces policiers, innombrables, ces voitures qui quittent la résidence de Gœring pour conduire dans la capitale des équipes d'hommes en armes et que protège aussi la loi. Et naturellement Gœring refuse de céder la place à Papen, comme il refuse la suggestion du vice-chancelier d'alerter le président Hindenburg, de proclamer l'état d'urgence et de remettre à la Reichswehr le soin de rétablir l'ordre. La Reichswehr d'ailleurs, aux mains des généraux Blomberg et Reichenau, n'est-elle pas complice ? Papen est un naïf ou un homme bien mal informé. Et Gœring balaie d'un geste les arguments du vice-chancelier, puis il lit les derniers messages qu'on vient de lui apporter ne s'occupant même plus de son pourtant illustre interlocuteur. « Je fus bien obligé de m'incliner, ajoute alors Papen. Disposant de la police et des forces de l'armée de l'Air, Gœring avait certainement une position plus solide que la mienne ». Comme Papen insiste à nouveau pour qu'on prévienne Hindenburg, Gœring hautain, irrité, veut mettre fin à l'entretien. « Inutile, dit-il, de déranger Hindenburg », grâce aux S.S., lui, Gœring est parfaitement maître de la situation.
Dans le hall, l'agitation est toujours aussi grande. Les sonneries du central voisin retentissent sans arrêt. Himmler est sorti du cabinet de travail de Gœring, pendant que Papen continue de protester contre les violations du droit. Tschirschky, entré dans l'antichambre, observe le Reichsführer S.S. qui, l'air absorbé et résolu, téléphone longuement. Himmler parle à voix basse mais le secrétaire de Papen entend une phrase : « Et maintenant il faut y aller, vous pouvez nettoyer cela ». Ne s'agit-il pas de la vice-chancellerie, considérée par la Gestapo comme un repaire d'opposants ? Tschirschky essaie de prévenir Papen en rentrant dans le cabinet de travail sur les talons de Himmler, mais Gœring hurle presque : « Vous feriez mieux de penser à votre sécurité personnelle, rentrez chez vous immédiatement et restez-y, n'en sortez pas sans m'en avoir prévenu ».
Himmler fait alors passer à Gœring un message cependant que Papen s'insurge une nouvelle fois : « Je veillerai tout seul à ma sécurité, je n'ai pas du tout l'intention d'accepter une arrestation à peine déguisée » insiste-t-il. Mais cette fois-ci Gœring refuse et ne répond plus : il ignore définitivement Papen comme si le message de Himmler avait encore pesé sur son attitude déjà méprisante pour Papen. Tschirschky faisant part à son chef de ses inquiétudes, les deux hommes quittent la pièce. Dans l'antichambre, le visage caché dans ses mains, un officier de la S.A., attend, effondré sur une chaise, gardé par un S.S. C'est le Gruppenführer Kasche qu'on à pris dans la rue alors qu'il sortait de chez lui et qu'on a amené ici sans qu'il comprenne pourquoi. Maintenant, il a peur.
Dehors, dans la cour, le soleil de cette magnifique journée d'été oblige après la demi-obscurité du cabinet de travail de Gœring à fermer les yeux pour s'habituer de nouveau à la lumière. Papen et Tschirschky traversent la cour bruyante : des policiers attendent les ordres, des voitures partent. Le service de protection paraît encore renforcé. Quand les deux hommes se présentent à la grille pour quitter le ministère, un officier S.S. et deux sentinelles leur barrent le passage. Ils ont le visage fermé et dur de ceux qui ont reçu des ordres qu'ils ne discuteront jamais.
— Personne n'a le droit de sortir, dit sèchement l'officier de l'Ordre noir.
Il fait face à Tschirschky. Les mains derrière le dos, ses deux hommes placés à un pas de part et d'autre, il représente la force brutale. Tschirschky n'a pas l'habitude de se laisser intimider :
— Qu'est-ce qui se passe ? Monsieur von Papen a sans doute le droit de sortir d'ici ?
Le ton est cassant, méprisant. L'officier ne bouge pas, imperturbable.
— Il est interdit à qui que ce soit de sortir d'ici, répète-t-il.
Les lèvres du jeune officier S.S. ont à peine remué. Les yeux sont immobiles et ce visage coupé par le rebord du casque, cerné par la jugulaire est anonyme, l'un de ces visages sans réalité qui semblent vidés de toute personnalité, de toute particularité comme s'ils n'exprimaient plus un homme mais une force diffuse incarnée passagèrement dans une forme vivante.
— Avez-vous peur qu'on nous descende ? lance Tschirschky.
Mais la question n'appelle même pas de réponse. Le secrétaire de Papen, nerveusement, s'élance dans le bâtiment. Il croise alors qu'il traverse le hall l'aide de camp de Gœring, Karl Bodenschatz qui s'étonne :
— Comment, vous revenez déjà ?
Autour d'eux, c'est toujours la même atmosphère de tension, de violence. Les ordres, les claquements des talons, les sonneries du central téléphonique, tout cela crée un climat presque insupportable.
— Ils ne nous laissent pas sortir, dit simplement Tschirschky.
Dans la cour, sous le soleil, Papen attend et l'officier S.S. lui fait toujours face dans son immobilité de statue. Le vice-chancelier a un sourire amer et méprisant Bodenschatz se met à crier, il ordonne d'ouvrir la grille.
— Nous verrons bien qui commande ici, hurle-t-il, le Premier ministre ou les S.S.
Finalement après qu'un S.S. est allé chercher des ordres, la lourde grille est poussée par les S.S. et Papen et Tschirschky se retrouvent dans la rue.
N'était la présence de quelques groupes de policiers, la journée paraîtrait se poursuivre paisiblement. Wilhelmplatz, le vendeur de cigares s'est assis à l'ombre de son étalage. Ses boîtes ouvertes sont bien rangées sous les auvents de la carriole. Il n'y a pas encore de clients. Il lit le journal qui décrit longuement la visite de Hitler dans les camps de travail de Westphalie.
AU MINISTERE DE L'INTERIEUR
Il est un peu plus de 9 heures. Des fenêtres du ministère de l'Intérieur du Reich, on aperçoit les feuilles des tilleuls et des marronniers d'Unter den Linden légèrement froissées par la brise qui glisse le long de l'avenue depuis la porte de Brandebourg vers la Spree. Gisevius, fonctionnaire du ministère, regarde la magnifique avenue.
Il est arrivé très tôt ce matin au ministère. Il sait lui aussi, que la police, hier soir, n'a pas été déconsignée et son ami Nebe l'a averti de cette mission de surveillance et de protection dont Gœring l'a chargé. Nebe devait lui téléphoner dans la soirée : il ne l'a pas fait. Il se passe donc quelque chose d'anormal. Et comme Tschirschky s'est rendu à la vice-chancellerie, Gisevius a gagné son ministère, Unter den Linden. Maintenant tout en regardant les tilleuls et les marronniers, il écoute son «chef Karl Daluege lui faire part de son indignation : Gœring a alerté par trois fois la police de Prusse sans même l'en avertir, dit Daluege, c'est là une très grave offense. Il est décidé à s'en plaindre à ce dernier ; en qualité d'Alte Kämpfer, il lui dira une bonne fois ce qu'il pense. Comme Gisevius approuve son chef, la sonnerie du téléphone retentit : Daluege est convoqué chez Gœring.
Gisevius se retrouve seul en proie à ses interrogations. Le ministère maintenant a retrouvé son activité. Les plantons sont à leur poste, on entend le crépitement régulier des machines à écrire : le rouage central de la police du Reich semble fonctionner parfaitement et efficacement et pourtant tout se déroule en dehors de lui; Goebbels, Gœring, Himmler, Heydrich, la Gestapo, les S.S., le S.D. ont monté un piège en dehors de tout contrôle des autorités traditionnelles et maintenant que Hitler a donné le signal de l'action, le piège a commencé à broyer ses victimes. Et le ministère tourne à vide, tranquillement.
Karl Daluege rentre bientôt au ministère et Gisevius l'aperçoit, le visage « blanc comme un linge ». Il n'est pas encore 10 heures. C'est le moment où Hitler a quitté le Hauptbanhof de Munich pour se rendre à la Maison Brune. Daluege parle rapidement: un putsch S.A. devait être déclenché cette nuit, « on va, en tout cas, conclut-il, vers une épuration sanglante des S.A. » Et sa voix dit, au-delà des mots prononcés, que lui aussi a peur. Daluege veut mettre le secrétaire d'Etat Grauert au courant des faits qu'il ignore, Grauert aussi a peur parce qu'une machine s'est mise en route qui peut écraser n'importe qui car elle ne respecte aucune loi. Daluege et Grauert décident alors d'avertir le ministre Frick. Gisevius se joint à eux. Il faut sortir, remonter Unter den Linden prise dans la chaleur encore douce d'une matinée d'été radieuse, lumineuse. Marchant rapidement les trois hommes se taisent, sur la Pariserplatz des voitures noires de la Gestapo stationnent, contrôlant ainsi Unter den Linden, la Wilhemstrasse qui part, longue et légèrement oblique, quadrillant tout ce quartier central de Berlin où sont concentrés les ministères. Au-delà de la porte de Brandebourg, commence le Tiergarten, ses massifs, ses allées tranquilles, ses promeneurs ignorants qui regardent passer ces trois messieurs graves le long de la Friedensallee, vers la Königsplatz. En ce samedi matin, les provinciaux, les visiteurs sont nombreux autour de la Siegsaeule, l'immense colonne de la Victoire. Une petite queue s'est formée pour monter à son sommet : où domine tout Berlin de plus de soixante mètres du haut de cette colonne de bronze, de grès et d'or, élevée pour célébrer la victoire de la Prusse et la création de l'Empire. En ce jour d'été alors que tout paraît quotidien, habituel, un autre empire se fonde dans le sang et la violence, un empire pour mille ans, ce IIIeme Reich qui détruit ce même jour ses fondateurs, les S.A.
Le bureau de Frick est situé près de la Kœnigsplatz. Le ministre lui non plus n'a pas été tenu au courant. Gisevius n'est pas admis dans son bureau, mais très vite, Grauert et Frick ressortent pour se rendre chez Goering aux nouvelles. Daluege rejoint Gisevius et tous deux regagnent à pied Unter den Liden. Il est un peu plus de 10 heures.
Il y a quelques minutes que Goebbels a téléphoné depuis la Maison Brune de Munich à la résidence de Gœring. Il a prononcé les trois syllabes c Colibri ».
LE TEMPS DES ASSASSINS
Heydrich, au 8 de la Prinz-Albrecht-Strasse, a aussitôt été averti du signal et immédiatement il le répercute sur ses hommes qui dans les différentes villes et régions du Reich sont dans l'attente, impatients d'agir comme des chiens dressés que l'on retient. Les voici lâchés. Ils ont reçu depuis plusieurs jours leurs enveloppes cachetées et ce matin, enfin, ils brisent les sceaux marqués de l'aigle et de la croix gammée, ils relisent les noms de leurs anciens camarades avec qui ils ont livré bataille et qu'ils sont chargés d'arrêter ou de liquider. Ils découvrent le nom de telle ou telle personnalité, aujourd'hui encore respectée, couverte de titres ou d'honneurs et qu'ils doivent conduire dans un camp de concentration ou faire disparaître dans un bois ou une région marécageuse. Ils partent en chasse, ils lancent leurs équipes de tueurs qui vont par deux ou trois, implacables et anonymes, frappant aux portes comme des représentants modestes mais tirant à bout portant, sans explication ni regret. Et ils sont bien les représentants du nouveau Reich, ces S.S., ces hommes du S.D., efficaces et sans remords.
A Berlin, les agents de la Gestapo reçoivent des listes où il n'y a que des numéros d'ordre conventionnels qui renvoient au nom de telle ou telle personnalité. Dix-huit S.S. dirigés par l'Hauptsturmführer Gildisch, un ancien officier de police, sont chargés de s'occuper de celles qui doivent être immédiatement et sans autre forme de procès abattues.
Himmler, Heydrich ou Gœring donnent les ordres précis, Gœring de son cabinet de travail de la Leipzigerplatz condamne ainsi à une exécution sommaire tel ou tel opposant. Il a convoqué Gildisch et il a simplement dit : « Trouvez Klausener et abattez-le ». Et l’Hauptsturmführer S.S. a claqué les talons et s'en est allé vers le ministère des transports à la recherche du président de l'Action catholique. Cependant des valets de pied en livrée apportent à Gœring et à Himmler des sandwichs et des boissons ; en même temps des hommes de la Gestapo déposent sur la table, près des bouteilles de bière, de petites fiches blanches qui comportent un ou plusieurs noms d'hommes arrêtés, conduits à l'Ecole des Cadets de Lichterfelde et Gœring lance avec joie et violence : « A fusiller, à fusiller ».
Gisevius qui arrive à ce moment avec Daluege dans le palais de Gœring à la Leipzigerplatz est saisi par l'atmosphère qui y règne. « Une angoisse soudaine me prend à la gorge, se souvient-il. Je respire une atmosphère de haine, de nervosité, de tension, de guerre civile et surtout de sang, de beaucoup de sang. Sur tous les visages, de celui des sentinelles à celui du dernier planton, on lit qu'il se passe des choses terribles ».
Dans l'antichambre même de Gœring, des hommes arrêtés viennent s'ajouter à Kasche qui continue de trembler. Un officier S.A. claque des dents sous le regard froid d'un S.S. : convoqué par téléphone, le S.A. est arrivé tranquillement et Goering l'a insulté en le qualifiant de « cochon homosexuel et lui a annoncé qu'on allait le fusiller ». Anxieux, Nebe et Gisevius se rencontrent près du cabinet de travail de Gœring. « Nous nous saluons, raconte Gisevius, avec le signe conventionnel que nous avons adopté, un serrement de mains et un battement de paupières. » En quelques phrases d'apparence anodine, Nebe dit ce qu'il sait : les premiers hommes abattus, ceux qu'on a expédiés dans les camps ou dans les caves de la Gestapo. Déjà, au ministère, Gisevius a appris que la plupart des grands chefs S.A. ont été arrêtés ou vont l'être : « Mademoiselle Schmidt », l'aide de camp de Heines, puis Gehrt, Sander, Voss ; les hommes de Karl Ernst ont été pris les premiers. Maintenant ils sont à Lichterfelde et peut-être déjà sont-ils abattus, leurs corps gisant sur les pavés usés par les générations de jeunes cadets qui ont formé les rangs sous les cris des sous-officiers prussiens.
Gisevius écoute et regarde. Tous ceux qui ne sont pas directement dans l'action aux côtés des tueurs ne peuvent qu'être inquiets car, ce matin, commence le grand règlement de comptes et Gisevius a déjà eu maille à partir avec Heydrich et la Gestapo. « Je flaire le danger, dit-il, j'estime prudent en des journées aussi chaudes de ne pas me lancer seul dans des explorations et de rester en compagnie de gens qui, dans de telles circonstances, peuvent me sauver. Je préfère donc me tenir dans le voisinage de Daluege... » Mais Karl Daluege aussi a peur et Nebe aussi « qui ne croit pas impossible qu'on l'abatte comme complice à la fin de cette journée ».
Et Papen aussi a peur et sans doute Tschirschky, car c'est le temps des assassins. Lorsqu'ils arrivent à la vice-chancellerie le bâtiment est occupé par les S.S. et des agents de la Gestapo. Les deux hommes comprennent qu'on les a convoqués et retenus chez Gœring pour mieux permettre l'investissement des lieux. Pour accéder au bureau de Papen, il faut traverser celui de Tschirschky : tout est bouleversé, les tiroirs sont ouverts, les papiers dispersés sur le sol. La perquisition a été brutale et les hommes de Himmler sont encore là, arrogants. Ils ont même mis une mitrailleuse en batterie. Un employé a réussit à glisser à Papen que l'Oberregierungsrat Bose, l'un des plus proches collaborateurs du vice-chancelier, l'un de ceux qui, avec Jung, a participé à l'élaboration du discours de Marburg a été abattu, il y a quelques instants à peine. Deux hommes vêtus de noir ont demandé à le voir et quand il s'est présenté, sans dire un mot, ils ont tiré. Puis ils ont laissé son corps dans le bureau et un S.S. s'est installé devant la porte interdisant l'entrée à quiconque. Quand Papen pose une question, on lui répond que Bose a résisté à l'action de la police.
Tout à coup on entend le grondement d'une explosion : ce sont les hommes de la Gestapo qui font sauter les portes des coffres-forts situés dans les caves du bâtiment (qui autrefois avait été le siège d'une banque) espérant découvrir des documents compromettants. Peu après, des agents du S.D. séparent Papen de Tschirschky : ce dernier est décrété en état d'arrestation. Il serre longuement la main du vice-chancelier puis escorté de deux S.S. il s'éloigne. C'est le troisième collaborateur de Papen à être appréhendé. Dans l'escalier de la vice-chancellerie, Tschirschky suivi par les S.S. descend nonchalamment quand deux nouveaux policiers l'interpellent : ce sont des hommes de Gœring.
— C'est déjà fait, dit Tschirschky en montrant les S.S., messieurs mettez-vous d'accord entre vous.
Et il attend la décision, un sourire méprisant sur les lèvres.
Finalement ce sont les S.S. qui l'emportent et c'est dans leur voiture que Tschirschky est conduit au siège de la Gestapo, mais les inspecteurs de Gœring suivent dans une deuxième voiture. Ainsi dans cette répression si longuement calculée subsistent l'improvisation, les chevauchements, les incertitudes, les sauvetages in extremis ou les exécutions dues au hasard. Parce que chacune des têtes de la conjuration a ses intérêts, ses victimes désignées mais aussi ses protégés, conservés en vie parce qu'ils peuvent préserver l'avenir. Sait-on jamais ?
Aussi Gœring défend Papen. Le vice-chancelier est reconduit jusqu'à son domicile gardé par un détachement de S.S. « Le téléphone était coupé, raconte Papen, et dans mon salon, je trouvai un capitaine de police chargé spécialement d'appliquer la consigne de mon isolement complet. Il me signifia l'interdiction absolue de tout contact avec l'extérieur et de toute visite. » En fait, cet officier a pour mission d'empêcher les hommes de Himmler de liquider Papen. L'officier ne doit livrer le vice-chancelier que sur un ordre formel et personnel de Gœring. Durant trois jours Papen va demeurer enfermé avec son fils dans sa maison cernée par les S.S. qui se relaient et interdisent qu'on approche la villa. Mais Papen reste en vie. Gœring — en échange des loyaux services rendus et parce que Papen a l'audience de Hindenburg — l'a mis à l'abri. Papen le reconnaît : « Un seul homme s'était interposé entre moi et le poteau d'exécution, Gœring » dira-t-il.
Mais rares sont ceux qui peuvent ainsi remercier Gœring Ce matin-là, l'attention du ministre-président signifie au contraire pour des dizaines d'hommes une condamnation à mort qui s'abat sur eux, par surprise et comme une fatalité antique, inéluctable et aveugle. Gœring liquide tous ceux qui l'ont gêné ou dont la vie peut sembler une menace. Himmler, Heydrich font de même et les corps criblés de balles s'ajoutent aux corps. Il ne sert à rien d'avoir abandonné la vie politique, d'avoir renoncé à toute ambition, la vengeance nazie ne pardonne pas. Et les chefs du Reich ne veulent pas prendre de risques, ils savent que, contrairement aux légendes pieuses des idéalistes, mieux vaut un adversaire mort que vivant.
Gregor Strasser qui fut le compagnon intime de Hitler, Gregor Strasser qui a créé le Parti, déjeune chez lui, ce samedi vers midi, avec sa famille. Il est depuis des mois en marge de toute réelle activité même si son nom, à plusieurs reprises, a été ces dernières semaines prononcé et si l'on murmure qu'il a rencontré vers la mi-juin Hitler. Tout cela le condamne. On sonne au portail. Il se présente. Huit hommes sont là, revolver au poing. Un mot : Gestapo. On l'entraîne avant même qu'il ait pu saluer ses proches. Ils ne le reverront plus. Tchirschky encadré par les S.S., conduit à l'interrogatoire avant de partir pour Dachau, le croisera au siège de la Gestapo, Prinz-Alhrecht-Strasse, en cette fin de matinée.
UNE BALLE DANS LA TETE.
Il est environ 13 heures. Sur la Wilhelmplatz le vendeur de cigares est debout près de son étalage : le moment est favorable. Les employés des ministères sont sortis et vont et viennent à petits pas dans le square. Bientôt ce sera le moment du cigare, la détente paisible, cette euphorie du tabac dans la pleine journée d'été. On parle de soi, du temps qu'il va faire demain. Beaucoup ne travaillent pas ce samedi après-midi mais ils traînent un peu avant de rentrer.
Au ministère des Transports à quelques centaines de mètres de là, le Hauptsturmführer S.S. Gildisch demande où se trouve le bureau du Ministerialdirektor Klausener. Les plantons hésitent puis s'inclinent et renseignent le S.S. Il monte lentement et dans le couloir, il croise Klausener qui vient de se laver les mains. Klausener regarde Gildisch et sans doute a-t-il compris la menace. Dans son bureau à l'étage supérieur, un coup de téléphone, inattendu à cette heure, retentit et fait sursauter le Ministerialdirigent le docteur Othmar Fessier. Klausener est au bout du fil, sa voix est anxieuse : « Voulez- vous venir me voir tout de suite, s'il vous plaît. » Puis il raccroche. Fessier s'apprête à descendre un peu surpris, mais il est déjà trop tard. Gildisch est entré dans le bureau de Klausener et quand le dirigeant de l'Action catholique, après s'être étonné d'être placé en état d'arrestation comme le lui annonce le S.S., s'est tourné vers un placard pour prendre son chapeau et suivre l'officier S.S., Gildisch a tiré : une seule balle, dans la tête. Du bureau même, alors que le sang lentement se répand, Gildisch téléphone à Heydrich, rend compte sobrement en policier stylé et demande des ordres. Ils sont simples. Simuler un suicide. Le Hauptsturmsfûhrer place son revolver dans la main droite de Kausener, puis téléphone à nouveau, pour convoquer les S.S. qui l'ont accompagné et sont restés en bas, dans l'entrée du ministère ; quelques instants plus tard, deux jeunes miliciens noirs montent la garde devant le bureau de Klausener, condamnant la porte. Gildisch s'éloigne calmement, sans même se retourner, écoutant sans doute l'huissier qui, d'une voix terrorisée répond à Fessier qui l'interroge : « Monsieur le Directeur s'est suicidé, il vient de se tuer d'un coup de revolver. » Impassibles devant la porte, immobiles, les deux S.S. paraissent ne même pas entendre, ne même pas voir.
Il est à peine 13 h 15. Le Hauptsturmführer S.S. Gildisch est un homme efficace et rapide et à peine a-t-il terminé sa besogne qu'il regagne la résidence de Gœring pour se charger d'une nouvelle mission. L'atmosphère est encore tendue. Gœring hurle : « Tirez dessus », et le major de police Jakobi traverse la salle en courant, criant lui aussi des ordres pour essayer de faire prendre un ami de Strasser, Paul Schulz, l'un des plus anciens membres du parti, qu'on n'arrive pas à retrouver alors qu'il est sur les listes d'hommes à abattre. Les aides de camp, dans l'antichambre, ne cessent de passer, allant du central téléphonique au cabinet de travail de Gœring. A cette heure, dans Berlin, on commence à se douter qu'il se passe quelque chose d'anormal et les ministères, les ambassades, les journalistes étrangers, déjà, demandent des précisions.
Depuis 11 heures, les habitants du quartier cossu de Berlin qui s'étend entre la Tiergartenstrasse et la Kônigin-Augusta-Strasse, cette avenue qui longe un canal tranquille et pittoresque, sont inquiets. Le quartier en effet est en état de siège : des hommes de la police de Gœring ont même installé des mitrailleuses à l'angle de la Tiergartenstrasse et de la Standartenstrasse, et cette rue est interdite à la circulation. C'est une rue tranquille, qui s'ouvre en son milieu sur une place paisible, au centre de laquelle se dresse la jolie Matthäikirche.
Il y a quelques mois encore, la rue s'appelait la Matthäistrasse, mais à son extrémité nord, vers le Tiergarten, se trouve l'Etat-major de la Sturmabteilung. Et cet immeuble est assiégé et investi, fouillé par la Gestapo, les S.S., les hommes de Gœring.
Dans la même rue, se dressent aussi, derrière de petits jardins, la maison de Rœhm, le siège de l'Association des Casques d'acier, le consulat de France et l'ambassade d'Italie. Le consul de France s'interroge sur les mesures qu'il constate, il essaye d'avoir des renseignements, téléphone à l'ambassade mais André François-Poncet est en vacances à Paris depuis le 15 juin. Des télégrammes urgents partent vers la France. Dans l'immeuble voisin, on est aussi préoccupé car les diplomates fascistes peuvent apercevoir depuis les fenêtres de l'ambassade d'Italie, sur les trottoirs de la petite rue, devant la maison de Rœhm, des mitrailleuses en batterie. Madame Cerruti, la femme de l'ambassadeur, ne cesse de poser des questions : elle donne une réception au début de l'après-midi. Comment ses invités pourront-ils franchir les barrages ? Elle questionne le ministère des Affaires étrangères du Reich, mais ni le secrétaire d'Etat aux Affaires Etrangères, Monsieur de Bulow, ni le chef du Protocole, Monsieur de Bassewitz, ne peuvent fournir d'indications. Ils ne savent rien. Et maintenant ce sont les journalistes étrangers qui interrogent : certains affirment qu'on a vu des policiers fouiller la maison de Rœhm, que Papen lui-même serait arrêté, que de hauts fonctionnaires auraient été abattus dans leurs ministères. Les journalistes se tournent vers Aschmann, le chef du service de presse du ministère, mais lui non plus ne sait rien. Devant ce flot de nouvelles et de questions, les diplomates de la Wilhelmstrasse sont bien contraints d'admettre qu'il se passe quelque chose de grave, que vient une tourmente sanglante dont on ne peut encore prévoir les limites et les objectifs mais dont on sent qu'elle est brutale, impitoyable, qu'aucune loi ne peut la freiner, que seule la volonté de ses instigateurs la limitera et qu'elle peut s'abattre sur tous ceux que leur bon plaisir désignera, frappant sans distinction de clan les opposants et qu'elle balaie déjà les S.A. et les conservateurs.
« OUI, C'EST MOI SCHLEICHER »
Il devait être 11 h 30.
Le général Kurt von Schleicher est à son bureau au rez-de-chaussée. De sa place, il aperçoit non seulement la perspective de la Griebnitzseestrasse mais aussi, le vaste plan d'eau du Griebnitzsee qui fait le charme du quartier de Neu-Babelsberg. Sur le lac, les embarcations sont nombreuses ce samedi matin. Les voiles blanches et orange font des taches de couleur, points vifs sur le vert des prés et des jardins. Car ici à Neu-Babelsberg ce ne sont encore qu'espaces verts devant les villas cossues appartenant à des directeurs d'entreprises, de hauts fonctionnaires, demeures d'hommes arrivés à la fortune et au pouvoir. Et Kurt Schleicher est bien cela, lui qui, ancien chancelier, a été l'éminence grise de la Reichswehr, le familier du Reichspräsident Hindenburg avec qui il a servi dans le même régiment. Ecarté après l'arrivée de Hitler au pouvoir, il est un peu en marge mais avec sa jeune femme, depuis son retour de vacances il y a quelques jours, il a donné déjà des soirées mondaines, « seulement mondaines », précise-t-il à ceux qui s'inquiètent de le voir à nouveau se plonger, alors qu'il est à découvert dans le monde de la politique. Mais Kurt von Schleicher est un joueur et puis quand on a goûté au pouvoir comment oublier la griserie que donnent la puissance, le respect les intrigues ? Et Schleicher est flatté quand on murmure qu'il est en « réserve de la nation ». Pourtant les avertissements, les conseils de prudence n'ont pas manqué. Hier soir encore, 29 juin, un camarade de promotion a téléphoné. A la Bendlerstrasse, a-t-il dit, on parle beaucoup d'intrigues qu'aurait nouées Schleicher avec Rœhm. C'est très dangereux, en ce moment a précisé l'officier.
A sa femme préoccupée, Schleicher a répondu qu'il ne voyait plus Rœhm depuis des mois, que ces ragots n'avaient aucune importance.
Maria Güntel, la gouvernante, s'est souvenue parfaitement de l'insouciance du général ; elle avait ouvert la lourde porte coulissante à deux battants, qui permettait de passer de la salle à manger au bureau-bibliothèque du général. Schleicher et sa femme s'étaient assis sur le divan de cuir et Maria Güntel avait servi les liqueurs écoutant Kurt von Schleicher plaisanter à propos des bavardages et des peurs de ces officiers de la Bendlerstrasse, prudents et timides comme des jeunes filles.
C'était hier soir.
Ce matin, Schleicher est assis à son bureau regardant la Griebnitzseestrasse que le soleil prend de plein fouet, un soleil chaud d'été. A son dernier bulletin d'information, la radio a annoncé 30° sur Berlin et le speaker a lu aussi de longs extraits de l'article du général Blomberg affirmant la fidélité de la Reischswehr au Führer. Ils ont mécontenté Schleicher. Il n'aime pas Gummilöwe, ses manières douces de courtisan de Hitler. La façon dont il a peu à peu chassé de la Bendlerstrasse les amis de Schleicher.
A ce moment-là, le téléphone retentit. C'est un ancien compagnon d'armes qui veut souhaiter la bienvenue à Schleicher rentré il y a quelques jours de ces voyages dictés par la prudence. Ils bavardent un long moment. Schleicher raconte l'accident d'automobile dont il est sorti indemne. Par miracle, dit-il. Il s'interrompt un instant : on sonne à la porte, explique-t-il à son interlocuteur.
Dans l'antichambre, Maria Güntel ouvre une petite fenêtre qui se trouve à côté de la porte d'entrée. Cinq hommes vêtus de longs imperméables sont là, immobiles. Dehors, arrêtée devant le portail, une voiture noire.
— Nous voudrions parler au général Schleicher, dit l'un d'eux.
La voix est autoritaire, elle exprime, comme la silhouette de l'homme, la force officielle qui n'admet pas de réplique. La gouvernante entrouvre la porte, un peu hésitante, une brusque poussée et Maria Güntel, avant même qu'elle ait réalisé, est collée contre le mur par l'un des hommes. Les autres, comme s'ils connaissaient parfaitement les lieux, se dirigent vers le bureau.
Au bout du fil, dans son écouteur, l'interlocuteur de Schleicher entend un choc, sans doute le bruit de l'appareil que l'on pose, puis éloignée mais distincte la voix du général qui dit :
— Oui, c'est moi le général von Schleicher.
Immédiatement c'est le fracas des détonations avant que quelqu'un ne raccroche le téléphone.
Fascinée et terrorisée, Maria Güntel s'est avancée, Schleicher est couché sur le tapis, légèrement recroquevillé, une blessure au cou, à droite, est nettement visible et d'autres, à gauche, dans le dos. Il est sur le ventre comme si, dans un sursaut, après avoir répondu à ses visiteurs, il avait compris et avait voulu fuir. Brusquement, un cri retentit : Frau von Schleicher sort de la salle à manger attenante, elle crie à nouveau. Les hommes ont toujours le revolver à la main, la jeune femme avance vers eux les bras levés regardant le corps de son mari, elle crie encore mais sa voix se brise dans le déchirement sec de la détonation. Et elle tombe, abattue elle aussi. Maria Güntel est pétrifiée, sur le seuil du bureau. L'un des tueurs s'est approché d'elle :
— Mademoiselle, n'ayez pas peur, vous, on ne vous tuera pas.
Les autres fouillent rapidement le bureau du général puis, sans un mot, ils quittent la villa, sans même avoir refermé la porte du bureau, laissant Maria Güntel sur le seuil, les yeux exorbités fixant Frau Schleicher et Kurt von Schleicher qui baignent dans leur sang sur le tapis aux ors sombres.
C'est une femme de chambre qui s'est blottie au premier étage qui trouvera la gouvernante immobile se tenant le visage à deux mains. Elle téléphonera à la police.
Le préfet, lui-même, se rend sur les lieux. Des enquêteurs recueillent les dépositions. Au ministère de l'Intérieur, Gisevius est averti par le préfet. Daluege interroge Gœring et Himmler, mais quand il revient vers Gisevius un nouveau coup de téléphone de Potsdam a déjà indiqué que le Préfet a reçu des instructions lui permettant de rédiger son rapport : le général Kurt Schleicher, compromis dans le complot de Rœhm, a résisté aux hommes de la Gestapo qui venaient l'arrêter. Il y a eu complot et le général et sa femme ont été abattus. L'enquête est close. Déjà les enquêteurs placent les scellés sur la porte du bureau de l'ancien chancelier du Reich. La villa est silencieuse. Un policier est resté en faction dans l'entrée et il observe cette gouvernante qui demeure assise, prostrée. Elle est le seul témoin.
Quelques mois plus tard, on découvrira son corps sans vie. Le désespoir, la peur, dira-t-on. De toute façon un suicide dont la presse ne parlera pas. Dans le IIIeme Reich, personne n'a intérêt à connaître de tels événements, ou à se souvenir de la mort violente du général Kurt von Schleicher et de sa jeune femme, un matin du samedi 30 juin 1934, dans leur villa cossue et tranquille de Neu-Babelsberg.
4
SAMEDI 30 JUIN 1934
Munich, 10 heures - 10 heures
IL N'Y A PAS DE MORTS INUTILES...
A Munich, comme à Berlin, il fait chaud et à Munich aussi, comme à Berlin, on tue. Dans les rues du centre, les voitures noires foncent, grillant les feux aux carrefours. D'autres S.S. ouvrent rapidement les portières, sortent puis tirent, sans sommation. Et tombent des officiers S.A. ou des conservateurs, ou de vieux adversaires.
Deux voitures s'arrêtent devant la villa du Ritter von Kahr : voilà des années qu'il a abandonné toute activité politique. Il n'est plus que l'ombre de l'homme qui, en novembre 1923, a réussi à duper Hitler, à filer entre ses mains et à cause de lui le putsch de Munich a échoué. C'était il y a plus de dix ans. On carillonne à sa porte. Il est à peine 10 heures ce samedi matin. Von Kahr est encore en robe de chambre. Les trois hommes sont là, à le regarder ; sans un mot, ils l'entraînent vers l'une des voiture et leur détermination est telle que Kahr proteste à peine. Ce ne sont pas des mains qui le saisissent, mais la violence vindicative du nazisme victorieux. Les passants s'écartent, essayant de ne pas regarder ces hommes qui en poussent un autre dans une voiture. Il fait beau sur Munich, le soleil, est chaud : ce samedi après-midi les trains lourdement chargés conduiront des familles joyeuses vers les lacs de Bavière. Pourquoi faudrait-il se soucier de ce Ritter von Kahr, un vieillard de 73 ans dont on va retrouver le corps, dans quelques jours, un corps mutilé à coups de pioche et enfoncé dans la terre boueuse de Dachau ?
A quelques centaines de mètres, dans la même terre on découvrira un autre cadavre ; il a trois balles dans la région du cœur : le calibre des projectiles est de 7,65 mm. L'arme des S.S. Et sa colonne vertébrale est brisée. La police l'identifie facilement : les assassins n'ont même pas retiré les papiers de la victime. Il s'agit du père Bernhard Stempfle qui a eu le malheur d'être proche de Hitler. C'était en 1924-1925 et Stempfle avait la plume facile et l'antisémitisme vigoureux. Il rédigeait un petit hebdomadaire, à Miesbach, qui s'en prenait aux juifs. Et le nazisme l'avait attiré. Il avait revu les épreuves de Mein Kampf, récrit certains passages, amélioré le style, affiné la pensée. Mais comment le Führer pourrait-il pardonner cela maintenant que le livre est devenu la bible du régime ? Stempfle a connu aussi certaines des passions amoureuses du Führer. Il sait que Hitler a idolâtré la jeune Geli Raubal, l'une des filles de sa demi-sœur, qu'il la terrorisait avec sa jalousie obsessionnelle, et qu'un matin du 17 septembre 1931 Geli s'était suicidée. Hitler avait alors traversé une longue crise dépressive puis peu à peu il s'était repris et l'on avait dissimulé à l'opinion les circonstances de la mort de Geli. Stempfle a été au courant. Il a pénétré trop de secrets. Cet ancien membre de l'Ordre des Hiéronymites a compris le danger. Il a cherché à disparaître dans l'oubli. En vain. Les tueurs en ce samedi matin l'ont retrouvé et traîné à Dachau. Hitler et les chefs nazis ont la mémoire longue. Et ils veulent effacer leur passé trouble, faire disparaître les témoins qui ne sont pas restés des complices. Un homme mort vaut mieux qu'un vivant, telle est leur loi. Une erreur vaut mieux qu'un oubli, un mort inutile qu'un adversaire manqué. Frau Schmidt le sait désormais.
C'est elle qui a ouvert ce samedi matin quand la sonnette a retenti. Quatre messieurs ont demandé à voir son mari. Elle s'étonne, elle ne connaît pas ces messieurs qui ne ressemblent pas aux visiteurs habituels, des musiciens, des journalistes, des universitaires. Wilhelm Eduard Schmidt est en effet un critique musical connu que les milieux berlinois eux-mêmes tiennent en grande estime. Gœring, dit-on, apprécie ses articles du Münchener Neuste Nachrichten. Les trois enfants se sont rapprochés de leur mère. On entend, venant du salon, le violoncelle de Schmidt L'un des messieurs insiste. Frau Schmidt va chercher son mari. Le voici, souriant, prêt à demander ce dont il s'agit. Il est immédiatement encadré, entraîné : sa femme regarde, stupéfaite, cette irruption de l'histoire et de la politique dans leur vie tranquille, tournée vers les arts et la culture. Jamais Wilhelm Eduard Schmidt ne s'est soucié des affaires politiques. Mais elles viennent de l'écraser parce que les S.S. et la Gestapo recherchent un médecin de Munich, ami d'Otto Strasser, le docteur Ludwig Schmitt et comme ils ne le trouvent pas, à tout hasard on arrête M. Wilhelm Schmidt et l'on expédie quelques jours plus tard à Frau Schmidt un cercueil contenant son mari, tué à Dachau. Les S.S. proposeront à Frau Schmidt une pension pour effacer l'erreur commise. On comprendra mal qu'elle la refuse. Qu'est-ce qu'un homme de plus ou de moins pour l'Ordre noir ?
Et un mort inutile vaut toujours mieux qu'un adversaire oublié. Ainsi, à Munich, passe la dernière matinée de juin 1934.
A LA MAISON BRUNE
Pendant que les S.S. traquent dans Munich leurs victimes, Hitler est toujours à la Maison Brune, Briennerstrasse. C'est là qu'il apprend la nouvelle de la mort de Schleicher. Il a alors un brusque mouvement de recul. L'un des S.S. de son escorte se souvient bien de cette réaction inquiète, marquée aussi sur le visage. Puis il a recommencé à parler. Cela fait déjà un long moment qu'il le fait, s'adressant aux S.A. rassemblés autour de lui et qui l'écoutent avec un regard de bêtes désemparés. Rœhm, Heydebreck, Heines, Spreti, les chefs auxquels ils hurlaient leur foi, auxquels ils avaient prêté serment de fidélité, les voici, abattus, emprisonnés, insultés, traités de cochons d'homosexuels. Et ils doivent subir, lâchement. Car ces hommes aux poses viriles, qui gonflent leurs poitrines sous les chemises brunes, qui arborent brassards, décorations, armes, ont peur. Ils ont depuis trop longtemps combattu sans grand péril des adversaires traqués et sans défense, ils ont terrorisé des Allemands paisibles qui ne pouvaient réagir, pour avoir conservé le goût du combat. Ils ont peur. Ils baissent la tête. Et cet homme qui leur parle frileusement enveloppé dans son long imperméable mastic n'est-il pas précisément leur Führer ?
Alors ils approuvent et la Maison Brune retentit de cris enthousiastes « Sieg Heil», « Sieg Heil », « Heil Hitler ». Rudolf Hess s'avance vers eux, il a les gestes brusques, le visage sévère, de celui qui est la justice. « Vous êtes tous suspects, dit-il. Ceux qui sont innocents devront souffrir quelques jours par la faute des autres. Tant que l'enquête n'aura pas déterminé le rôle de chacun, vous êtes tous prisonniers. »
Un officier S.S. se tient derrière Rudolf Hess, il prend la parole à son tour. Chaque S.A. doit être fouillé, dit-il, puis si le Führer en prend la décision, ils seront autorisés à rentrer chez eux. Un à un les S.A., sans une protestation, se présentent devant les S.S. qui les fouillent minutieusement La défaite et l'humiliation des membres de la Sturmabteilung sont totales. Les S.S. sont méticuleux et le silence dans la longue file de S.A. qui s'est formée est complet. L'heure n'est plus — ou pas encore — aux chants de triomphe : il faut chercher simplement à sauver sa vie.
Le Führer s'est retiré dans l'une des salles de la Maison Brune. Les fenêtres sont largement ouvertes mais la Briennerstrasse est aujourd'hui une rue calme. Les soldats de la Reichswehr continuent d'assurer le service d'ordre qui isole l'immeuble du Parti. Hitler marche de long en large dans la pièce : la fatigue s'est encore accumulée sur lui, la mauvaise fatigue nerveuse de l'insomnie et de la tension. Lutze, Goebbels, le juge du Parti Buch, Martin Bormann, Sepp Dietrich, Rudolf Hess, Wagner, Max Amann, l'éditeur de Mein Kampf et directeur des éditions du Parti, sont là à le regarder, à l'écouter et leur présence pousse Hitler à l'intransigeance car ces hommes sont tous des adversaires de longue date des S.A. et de Rœhm. Maintenant leur détermination, alors que le Führer a décidé de sévir est, leur semble-t-il, la garantie de leur sécurité et de leur puissance futures. Ils seront ceux qui ont aidé le Führer à écraser l'ennemi en ces heures tragiques.
Et Hitler continue de marcher dans la pièce, multipliant les insultes à rencontre de Rœhm, des chefs S.A., déclarant qu'il ne saurait y avoir de clémence. Viktor Lutze, le moins engagé dans le complot, se tient un peu en retrait surpris par la violence même des scènes auxquelles il assiste. Il n'imaginait pas que la mort de Rœhm et des siens serait la conclusion de cette journée. Or c'est de cela qu'il s'agit et uniquement de cela. Rudolf Hess et Max Amann réclament chacun l'honneur d'abattre Ernst Rœhm de leurs propres mains. Le Führer fait un geste pour les faire taire puis il dicte à Lutze d'une voix saccadée, la nouvelle charte de la Sturmabteilung.
« Je veux, dit-il, que les officiers de la S.A. soient désormais des hommes et non plus des singes grotesques et repoussants. Je veux que le chef de la S.A. et le plus humble des simples membres de la Sturmabteilung m'obéissent aveuglément. Je n'admets pas que les chefs S.A. offrent de coûteux dîners ou acceptent des invitations.»
La voix monte d'un degré, les insultes se multiplient, « On a jeté du Champagne par les fenêtres pendant ces orgies » crie Hitler. Tous les ragots, toutes les informations transmises par les agents de Heydrich reparaissent brusquement à sa mémoire. « Ils gaspillaient l'argent du parti », s'écrie-t-il.
« Je défends désormais à tous les chefs S.A. de sortir dans des voitures luxueuses, de prendre part à des dîners diplomatiques. » Lutze, sans commentaire, note sous la dictée, puis il relit l'ensemble au Führer qui paraphe le texte.
Il y a un moment de silence, mais Buch, le grand juge, auquel Rœhm avait échappé en 1932, pose à nouveau la question du sort des chefs S.A. emprisonnés à Stadelheim. « Il faut fusiller ces chiens » s'écrie Hitler. Il prend une liste que lui tend Wagner, le ministre de l'Intérieur, et d'un geste rageur il fait une croix devant une série de noms. Parfois il hésite, puis la main dessine les deux nouveaux traits qui signifient la mort. Tout le monde se tait et on entend crisser la plume sur le papier. Quand il a terminé, le Führer donne la liste à Sepp Dietrich :
« Rendez-vous immédiatement à la prison de Stadelheim dit-il. Prenez six sous-officiers et un officier S.S. et faites exécuter ces chefs S.A. pour haute trahison. »
La liste des prisonniers est celle qu'a établie le directeur de la prison, le docteur Koch. Six noms d'officiers supérieurs de la Sturmabteilung ont été marqués d'une croix. Sepp Dietrich lit lentement
— Edmund Schmidt, Gruppenführer S.A., cellule 497
— Hans Joachim von Spreti-Weilbach, Standartenführer, cellule 501
— Hans Peter von Heydebreck, Gruppenführer S.A., cellule 502
— Hans Hayn, Gruppenführer, cellule 503
— August Schneidhuber, Obergruppenführer S.A., préfet de police de Munich, cellule 504
Le Führer ajoute sèchement : « J'ai gracié Rœhm, en raison des services rendus. »
Au dernier moment, Hitler a donc hésité encore : habileté politique ou scrupule, machiavélisme pour conserver un atout contre les autres clans ou souvenir du capitaine Rœhm qui l'avait aidé à accomplir ses premiers pas de politicien à Munich ? Quoi qu'il en soit, la consternation apparaît sur les visages de Buch, de Goebbels, de Bormann : Rœhm leur échappe encore et tant qu'il vivra un retournement du Führer ne sera pas impossible. Seule la mort de Rœhm peut les mettre à l'abri. Et ils veulent l'obtenir, coûte que coûte. Mais pour l'heure, il faut céder à Hitler, se contenter de ne pas laisser Rœhm s'enfuir, le tenir et avertir à Berlin, Gœring, Himmler et Heydrich. Il faut attendre et prendre aujourd'hui ce qu'accorde le Führer, les condamnations des six Führer de la S.A. enfermés à Stadelheim.
A LA PRISON DE STADELHEIM.
Dans les cellules, les chefs S.A. attendent. Malgré les hurlements du Führer, les coups reçus parfois, les insultes, le mépris des S.S., ils ne peuvent pas croire, imaginer qu'ils vont mourir alors que le régime de Hitler est toujours en place, qu'ils portent encore ces uniformes recouverts de grades et d'insignes qui attestent qu'ils étaient le pouvoir, qu'ils étaient eux, les S.A., la puissance et la force. Et puis il y a ce soleil d'été qui pénètre dans les cellules. Pourquoi mourir ? Quelle est cette histoire de fou ?
Vers 17 heures, Sepp Dietrich arrive à la prison de Stadelheim. Les ordres brefs qu'il donne sont immédiatement exécutés ; déjà alors qu'il atteint à peine le premier étage du bâtiment, six sous-officiers S.S. se rassemblent dans la cour qui à cette heure se trouve à l'ombre des hauts murs de pierres grises. Un officier de l'Ordre noir leur fait vérifier le fonctionnement de leurs armes et les aligne à dix mètres de l'un des murs. Dietrich pendant ce temps est introduit dans le bureau du directeur Koch et lui remet la liste des prisonniers condamnés à mort. Koch hésite, ses lèvres tremblent : depuis ce matin, il a peur, le monde bascule, il sent que la vie des hommes aujourd'hui, est fragile, menacée. Il a peur de prendre une décision, peur d'accepter et de refuser. Néanmoins il proteste, au nom du respect des règles : la liste n'est pas signée, dès lors, dit Koch, il ne peut remettre les prisonniers à Sepp Dietrich. Le Gruppenführer n'a pas un mot de commentaire : il reprend la liste et quelques minutes plus tard sa voiture file vers la Maison Brune. Peut-être lui aussi préfère-t-il être couvert par une autorité supérieure. C'est le ministre Wagner qui, à la Maison Brune, signe sans hésiter et le sursis accordé aux officiers S.A. s'achève.
Le peloton est rangé dans la cour déserte. Sepp, escorté de deux S.S., va vers la première cellule et le bruit sec des serrures fait sursauter le prisonnier qui se lève. Dietrich salue : « Vous avez été condamné à mort par le Führer pour haute trahison. Heil Hitler. » Les deux S.S. s'avancent et le prisonnier, hier l'un de ceux qui détenaient le pouvoir et qui pesaient sur la vie des hommes, les suit dans le couloir vers la cour, bientôt il est le dos au mur regardant peut-être jouer la lumière du soleil dans les vitres des bureaux du premier étage, pendant que retentissent les commandements. « Le Führer l'exige, crie l'officier S.S. qui dirige le peloton. En joue. Feu ». Et le corps tombe.
Dans les autres cellules on entend les salves et le cauchemar devient réalité.
Quand Dietrich se présente devant l'Obergruppenführer Schneidhuber, celui-ci lui crie : « Camarade Sepp, mais c'est de la folie, nous sommes innocents. » Et le Gruppenführer répète seulement : « Vous avez été condamné à mort par le Führer pour haute trahison ; Heil Hitler ! »
Mais la détermination de Sepp Dietrich n'empêche pas qu'il est saisi par la nausée que donnent ces exécutions à répétition. Le S.S. dira plus tard : « Juste avant le tour de Schneidhuber, j'ai filé, j'en avais marre. » Plusieurs fois encore retentit dans la cour le commandement sinistre : « Le Führer l'exige. En joue. Feu ». Un nouveau prisonnier s'écroule. Le crépuscule descend sur Munich.
« HEIL HITLER l »
Sepp Dietrich est rentré à la Maison Brune pour faire son rapport. « Les traîtres ont payé », dit-il simplement à Hitler. Celui-ci qui s'était enfermé dans un long silence paraît sursauter. Il semble avoir brusquement retrouvé sa colère rageuse et son assurance depuis que Dietrich l'a assuré que ses adversaires sont bien morts. Il va, dit-il, parler aux S.A. A l'annonce de l'arrivée de Hitler, les S.A. se rassemblent dans l'une des grandes salles et à son arrivée ils poussent des hourras. Le Führer est dur et habile : « Vos chefs trahissaient votre confiance, lance-t-il ; vous demeuriez en première ligne et vos officiers passaient leurs nuits à festoyer, à vivre dans le luxe, à dîner en ville ».
Les S.A. se taisent, ils devinent que le Führer leur donne le moyen de se disculper en abandonnant leurs chefs. « S.A., continue-t-il, il s'agit maintenant de savoir si vous êtes avec moi ou avec ceux qui se jouaient de vous et profitaient seulement de votre dévouement pour édifier leurs fortunes personnelles. Acclamez votre nouveau chef, Lutze, et attendez mes ordres qu'il vous transmettra ».
Lutze s'avance et lance un Heil Hitler ! énergique. Toute la salle reprend le cri puis avec Lutze entonne le Horst Wessel Lied, pendant que le Führer, les bras croisés, le buste en avant, fixe cette foule de visages, ces hommes qui viennent de renier une partie de leur passé. Alors que Hitler se retire, Lutze précise que les S.A. sont désormais libres de quitter la Maison Brune. « Vous allez, continue-t-il, regagner isolément et directement vos demeures et y abandonner vos uniformes. Vous n'interviendrez plus dans une affaire quelconque avant d'avoir reçu l'avis que la S.A. est réorganisée et réunie à nouveau ».
A l'exception de quelques S.A. retenus à la Maison Brune, tous les autres peuvent regagner leurs domiciles. Un à un, en silence ils s'éloignent dans les rues de Munich encore inondées de soleil. Des passants se retournent, regardant passer ces S.A. qui n'ont plus l'allure martiale et provocatrice des jours de victoire, mais la démarche lourde des vaincus qui cherchent à se dissimuler au plus vite. Du haut de leurs camions les soldats de la Reichswehr et leurs officiers qui font les cent pas devant le siège du parti paraissent ne même pas voir passer ces miliciens en chemise brune qui prétendaient un jour organiser et commander l'éternelle et invincible armée allemande.
Quelques minutes plus tard, un ordre est donné et la Reichswehr lève le siège de la Maison Brune : la Briennerstrasse est à nouveau complètement ouverte à la circulation. Seuls quelques groupes de S.S. continuent de stationner à proximité de l'immeuble du parti. Ils resteront en place jusqu'aux environs de 19 h 30 : c'est l'heure à laquelle le Führer accompagné de Goebbels, de Hess, de Sepp Dietrich, quitte Munich pour Berlin par avion. Il n'a plus rien à accomplir dans la capitale bavaroise : la Sturmabteilung est brisée, ses hommes sont à genoux, ses chefs abattus. Il ne reste, dans une cellule de la prison de Stadelheim que le vieux camarade Ernst Rœhm, désarmé, couché torse nu sur un lit de camp, sa poitrine couverte de cicatrices soulevée par une respiration difficile. Rœhm en sursis protégé simplement par une hésitation du Führer que tant de chefs nazis ont intérêt à lever.
MUNICH-OBERWIESENFELD
Dans les voitures qui roulent à toute vitesse dans les rues qui commencent à s'éclairer, Hitler et les chefs nazis sont silencieux. Il semble à tous que des années se sont écoulées depuis cette aube hésitante : il y a seulement une quinzaine d'heures quand, sur l'aérodrome de Munich-Oberwiesenfeld vers lequel ils se dirigent ce soir, se posait dans le vrombissement de ses trois moteurs, le Junkers du Führer. Et maintenant sur le terrain qu'éclaire le crépuscule, c'est le même bruit de moteurs, les mêmes silhouettes qui s'avancent vers l'appareil. Tout, à l'exception de la rougeur du ciel, paraît semblable, jusqu'à la brise fraîche qui couche l'herbe rase et drue entre les pistes. Mais rien en fait ne sera plus pareil dans ce IIIeme Reich qui se voudrait millénaire. Des hommes sont morts, d'autres attendent pour mourir. Il a suffi de ces quelques heures pour trancher des vies. Wilhelm Eduard Schmidt n'écrira plus d'articles de critique musicale et von Kahr, à l'heure où le Junkers du chancelier du Reich s'envole, n'est plus qu'un corps disloqué enfoui dans la boue. L'histoire a, dans ces quelques heures, fait un nouveau bond, la violence a franchi dans le Reich un nouveau degré.
Et, à 20 heures, alors que l'appareil du Führer survole la ville de Nuremberg avant d'obliquer vers l'est, vers Berlin, le bureau de presse du parti national-socialiste à Munich publie un communiqué qui donne la version officielle des événements. Diffusé par la radio, le texte va surprendre les Munichois. A l'exception de quelques-uns d'entre eux intrigués par les mouvements de troupe ou les barrages de la Briennerstrasse, ils n'ont rien soupçonné et maintenant le speaker d'une voix grave annonce : « Depuis plusieurs mois des éléments isolés ont essayé de fomenter une opposition entre les Sections d'Assaut et l'Etat. Le chef d'Etat-major Rœhm, investi de la confiance toute particulière du Führer, n'a pas cherché à s'opposer à ces tendances et les a favorisées sans aucun doute. Ses penchants malheureux et bien connus pesaient si lourdement sur la situation que le Führer se trouvait en présence d'un grave conflit de conscience... Cette nuit, à 2 heures du matin, le Führer s'est rendu à Munich et a ordonné la dégradation et l'emprisonnement immédiat des chefs les plus compromis. Lors de l'emprisonnement eurent lieu des scènes si pénibles au point de vue moral qu'il n'y avait plus de place pour la pitié. Un certain nombre de ces chefs des Sections d'Assaut avait avec eux des garçons de mœurs spéciales : l'un d'entre eux fut surpris et arrêté dans une situation absolument répugnante. »
Le speaker observe un temps d'arrêt, puis continue avec emphase :
« Le Führer a donné l'ordre de crever sans pitié cet abcès pestilentiel. Il ne veut plus tolérer que des millions de gens convenables soient compromis par quelques êtres aux passions maladives. Le Führer a donné l'ordre au ministre-président de la Prusse, Gœring, d'exécuter à Berlin la même action et de se saisir en particulier des alliés réactionnaires de ce complot politique. »
Les gens convenables de Munich écoutent avec gravité. Ils se taisent ou s'insurgent contre ces pervertis qui déshonorent le Reich allemand. Ils félicitent leur Führer perspicace et décidé qui sait rompre avec de tels hommes, fussent-ils de vieux camarades. Les gens convenables sont rassurés : ils préparent leurs valises. Demain ler juillet, commencement des vacances. A Dachau, on cloue le cercueil de Wilhelm Eduard Schmidt, critique musical. A Stadelheim on rassemble les corps des officiers S.A. abattus. Les gens convenables ignorent tout cela. Ils écoutent les chœurs de la Hitler Jugend chanter, à la radio, le Horst Wessel Lied.
5
SAMEDI 30 JUIN 1934
Munich, Gleiwitz, Breslau, Brème...
LES MORTS NE RACONTENT PAS L'HISTOIRE.
La soirée à Munich s'annonce douce et légère. Dans les grands jardins, l'Englischer Garten, l'Alter Botanischer Garten, près du Hauptbahnhof, les promeneurs sont plus nombreux que d'habitude. Les jeunes gens vont vers le concert que donne l'ensemble folklorique bavarois, on boit, on rit. Les Bierkeller du vieux Munich sont, comme toujours en été, pleines. On chante dans les Bierhallen et les cris des serveurs lançant leurs commandes de bière dominent à peine le tumulte chaud des salles enfumées. Une tache sombre sur la Frauenplatz qui intrigue les passants : la façade de la Bratwurstglöckl. Une affiche indique que la célèbre brasserie est exceptionnellement fermée ce soir. Deux agents de police font circuler ceux qui s'attardent, mais ils ne sont pas nombreux. Si la Bratwurstglöckl est fermée on peut aller au Donisl, ou au Peterhof. Il y a aussi la Ratskeller dans l'Hôtel de Ville. Ce ne sont pas les brasseries qui manquent, ni la bière ni la joie de vivre, en cette soirée d'un samedi d'été. Personne ne sait qu'au début de l'après-midi, les agents de la Gestapo sont venus chercher M. Zehntner, propriétaire de la Bratwurstglöckl, son maître d'hôtel et un serveur. Depuis on n'a plus revu les trois hommes et la police a fermé la brasserie. Mais il y a beaucoup d'autres brasseries à Munich et il est des événements qu'il vaut mieux ne pas connaître. Personne, ainsi, sauf Zehntner et ses employés, ne sait que Rœhm a rencontré Goebbels à la Bratwurstglöckl un soir de juin. Zehntner, son maître d'hôtel et le serveur ne s'en souviendront plus longtemps, ils sont à Stadelheim.
Dans beaucoup d'autres villes du Reich, des hommes et des femmes, témoins involontaires, s'efforcent d'oublier ce qu'ils ont vu. Car, dans de nombreuses cités, les hommes de main de Himmler et de Heydrich sont, depuis ce samedi matin 10 heures, entrés en action. Et partout des silhouettes qui se ressemblent, hommes aux visages immobiles, aux longs imperméables, aux chapeaux enfoncés sur les yeux, tirent sur d'autres hommes saisis dans une attitude familière.
A Gleiwitz à 160 kilomètres de Breslau, les voitures sont arrivées vers midi alors que les ouvriers sortent des usines métallurgiques. L'équipe de tueurs officiels demande à voir le préfet de police Ramshorn. Il est membre de la Sturmabteilung, député du Parti, héros de la Guerre mondiale. Les agents de la Gestapo bousculent les huissiers et font feu sur Ramshorn qui venait à peine de quitter sa table de travail. Il s'effondre sur le tapis de son bureau comme Schleicher s'est effondré à Berlin, ou Bose, ou Klausener.
A Stettin, les envoyés de Himmler se sont d'abord arrêtés à la brasserie Webersberger, sur la Paradeplatz au bout de l'une des plus grandes avenues de la ville du Nord. Ils ont bu calmement de la bière, en silence. Puis ils sont allés au siège de la Gestapo et ils ont arrêté Hoffmann, le chef local, tortionnaire sans scrupules dont le Reichsführer S.S. veut se débarrasser.
A Kœnigsberg, dans le jour bleu pâle de la Baltique, d'autres agents se saisissent d'un chef S.S., le comte Hohberg. En Silésie c'est le frère de Heines qui est abattu. Ailleurs ce sont des S.S., des hommes tranquilles ou des chefs S.A. Peu importe, le jour est favorable. On tue ceux qui vous gênent, S.A., S.S., il suffit d'être sur les listes dressées par ceux qui mènent l'action pour mourir, plus ou moins vite, abattu dans un bois, au bord d'une route ou brûlé dans un four crématoire. Parfois l'un de ces hommes pourchassés, auquel on dit de courir à travers bois cependant qu'on le vise, réussit véritablement à fuir, blessé — ce sera le cas de Paul Schluz — dans les bois de Potsdam. Parfois les régions sont à peine troublées : en Thuringe, la police et les S.S. se contenteront d'arrêter quelques S.A.-Fuhrer qu'on enverra, pour quelques semaines, en prison ou à Dachau et qui reviendront la tête rasée, amaigris, les yeux enfoncés où passent encore les éclats de la peur.
De Berlin, Heydrich relance ses limiers et ses tueurs ; on sent qu'il veut profiter de l'occasion pour nettoyer le Reich de ses adversaires. Il téléphone, insiste, multiplie les ordres. Il reste en permanence au siège de la Gestapo Prinz-Albrecht-Strasse, contrôlant personnellement les opérations, établisssant les petites fiches blanches que des agents apportent à Gœring et à Himmler, Leipziger-Platz. Un numéro, un mot : « fusillé » ou « arrêté » ou « en cours » pour signaler aux deux grands chefs nazis le sort de tel ou tel de leurs anciens camarades. Et le central téléphonique de la Gestapo ne cesse d'appeler les sièges locaux : Heydrich ne laisse aucune trêve à ses tueurs. Un homme n'a pas fini de mourir que déjà il faut en traquer un autre. Du samedi 30 juin au lundi 2 juillet, le n° 8 de la Prinz-Albrecht-Strasse lance ainsi 7 200 appels téléphoniques. Un réseau d'ordres qui recouvre le Reich de sa toile. Il arrive pourtant que l'une des victimes désignées réussisse à s'échapper : le banquier Regendanz qui avait organisé la rencontre Rœhm-François-Poncet et qui a depuis quelques années appris à piloter, est averti par des voies mystérieuses de ce qui va se dérouler et le samedi matin il s'envole pour l'Angleterre dans son avion personnel.
Mais, le plus souvent, la Gestapo et les S.S. sont efficaces : abattu l'avocat berlinois Glaser qui avait eu l'audace de plaider contre Max Amann ; abattu le docteur Erwin Villain, Standartenführer des S.A. qui était le rival d'un médecin S.S. ; abattus, les S.S. Toifl et Sempach qui ont eu maille à partir avec Himmler. Parfois les victimes tentent de se défendre. A Breslau, les S.A. ouvrent le feu sur les S.S. de l'Oberabschnittsführer Udo von Woyrsch, ce fils d'un général de la Reichswehr, devenu membre de l'Ordre noir. Cette résistance de courte durée provoque immédiatement l'intervention de l'armée. Sur le Ring, autour des grands bâtiments du Rathaus et du Stadthaus, les camions de la Reichswehr ont pris position. Les soldats sont casqués et portent leurs armes de guerre. Sur les plates-formes les lourdes mitrailleuses ont déjà les bandes engagées et les servants, assis sur les caisses de munitions, sont prêts à tirer. Il semble que l'on revive le temps des corps francs et la menace révolutionnaire des années 1919 1921. Mais les mitrailleuses n'auront pas à entrer en action. Von Woyrsch et Brückner, le Gauleiter du Parti, liquident la résistance S.A. et leur vieux camarade le chef de brigade S.A. von Wechmar est fusillé sur leur ordre. Woyrsch et Brückner rivalisent d'ailleurs pour ne pas risquer d'être accusés de complicité avec la Sturmabteilung : et ce sont les juifs qui font les frais de cette concurrence. Pourchassés, battus, torturés, leurs corps et ceux d'autres victimes seront jetés dans l'Oder du haut des ponts. Dans la soirée du dimanche 1er juillet, le chef S.S. de Breslau déclare encore : « Il faut liquider tous les cochons. » Et l'on continue donc à tuer. Non seulement ceux qui sont inscrits sur les listes depuis longtemps mais aussi leurs femmes. Les corps, quelques jours plus tard, remonteront à la surface des eaux noires de l'Oder. Peu importe : les morts ne racontent pas l'histoire.
On va tuer les adversaires jusque dans les prisons où, parfois depuis des mois, ils croupissent sous les insultes et les coups. Les S.S. se font ouvrir les portes des cellules, ils entrent dans les camps de concentration, ils choisissent, ils frappent, torturent, tuent. Ainsi meurt l'écrivain Erich Muhsam qui avait participé à la République des Conseils, un temps victorieuse à Munich avant que la Reichswehr ne l'écrase. Elle était morte un 1er mai de 1919 : 15 ans plus tard, Muhsam meurt à son tour de la main des S.S. que la Reichswehr protège.
Et l'on passe de la liquidation d'un adversaire politique à la suppression d'un rival : l'Oberabschnittsführer S.S. Erich von dem Bach Zelewski fait abattre par deux S.S. le Reiterführer S.S. Anton Freiherr von Hoberg und Buchwald. Qu'importe si ce vieux combattant nazi n'a rien à voir avec la Sturmabteilung, qu'importe si le meurtre se déroule sous les yeux horrifiés du jeune fils du Freiherr : ce qui compte c'est la place ainsi libérée pour l'ambitieux Zelewski. L'arrestation de l'Obergruppenführer de la S.A. Karl Ernst aussi va permettre à un S.S. aux dents longues d'accéder à de nouveaux pouvoirs.
LE DEPART POUR MADERE.
Ernst ne s'est douté de rien. Il rêve à son voyage de noces à Madère. A Bremerhaven, avec l'enchantement d'un enfant et d'un parvenu devant qui s'ouvre l'aventure enivrante de la richesse il a visité le paquebot Europa, l'orgueil de la flotte allemande. Il est accompagné de sa jeune femme, de camarades des S.A. On boit, on festoie à Brème durant toute la nuit du vendredi au samedi. A midi, ce 30 juin, un grand banquet se déroule à l'Hôtel de Ville et le préfet de police de Brème souhaite aux jeunes mariés « une longue vie pour le bonheur de l'Allemagne ». Horst Wessel Lied.
Il est environ 15 heures : un petit avion se pose sur l'aéroport de Brème. Il arrive de Berlin et son passager a eu dans la capitale une matinée occupée : il s'agit de l'Hauptsturmführer S.S. Gildisch auquel Gœring a confié une nouvelle mission. A la sortie du banquet, un S.A. tente d'avertir Karl Ernst : il faut fuir. Ernst dans l'euphorie de sa puissance, du banquet, des discours et des chants, hausse les épaules. A son hôtel pourtant, Gildisch est là, avec des hommes de la Gestapo. Ils s'avancent vers Ernst : Gildisch lui annonce qu'il est arrêté et a ordre de le conduire à Berlin. Ernst proteste, demande à téléphoner, s'écrie « qu'on va lui faire manquer son bateau» exige d'être conduit chez Gœring, son camarade Gœring ; chez son ami le prince August Wilhelm de Hohenzollern, que lui, Ernst, appelle familièrement le prince Auwi. N'est-il pas comme lui S.A., député au Reichstag, ils sont assis au même banc, côte à côte. Mais Gildisch est impénétrable et Ernst sent qu'il n'y a rien à faire pour le moment. A Berlin, par contre, tout doit s'arranger car seul un fou imaginerait qu'il puisse, dans ce IIIeme Reich, arriver quoi que ce soit de déplaisant à Karl Ernst ami personnel de Rœhm, du prince Auwi, député au Reichstag et Obergruppenführer S.A. Ernst se laisse passer les menottes. Gildisch lui désigne une voiture : il y monte sans protester et bientôt prenant la route qui longe la Weser qu'éclaire le soleil couchant la voiture se dirige vers l'aéroport de Brème. L'avion qui a conduit Gildisch est là, prêt au départ. Ernst monte la petite échelle de fer : lui aussi, comme le Führer qui vient de décoller de Munich, s'envole vers Berlin.
Sur toute l'Allemagne, de la vieille forteresse orgueilleuse de Königsberg aux châteaux rêveurs de la vallée rhénane, des landes sableuses du Brandebourg aux lacs sombres de Bavière, l'interminable crépuscule rouge d'une journée d'été commence.
6
SAMEDI 30 JUIN 1934
Berlin. Fin de d'après-midi
LE CREPUSCULE SUR BERLIN-TEMPELHOF.
Le soleil rouge éclaire les pistes de l'aérodrome de Berlin-Tempelhof [4]. C'est un disque immense aux contours nets, irréel pourtant, qui disparaît à l'horizon et il semble que tous les bruits sont étouffés, que la vie est suspendue jusqu'à ce que ce soleil se soit enfoui, hostie sanglante qu'engloutit la terre. Les S.S. sont partout, noirs, bardés d'acier, l'acier des casques et des armes. Ils sont le long des pistes, devant les hangars, sur le toit de la tour de contrôle et leurs silhouettes se détachent sur le ciel. Des compagnies appartenant à la nouvelle aviation du Reich, encore clandestine, sont rangées en carré : les soldats inaugurent l'uniforme gris-bleu que Gœring a spécialement choisi. Peu à peu arrivent les officiels : Gœring, Himmler, Pilli Kœrner, Daluege, Frick et de nombreux officiers des S.S., des hommes du S.D. et de la Gestapo. Gisevius et Nebe sont présents aussi, un peu à l'écart, échangeant des informations, observant la scène : Gœring qui s'avance vers les troupes de l'armée de l'air puis qui, « les jambes écartées, puissamment campé... se place au milieu du carré et leur parle de la fidélité des soldats et de l'esprit de camaraderie ».
Ce soir où les nazis s'entre-déchirent, où les camarades de combat se dévorent, où un piège s'abat sur des hommes surpris et tranquilles appartenant au même parti, le discours de Hermann Gœring ne manque pas d'humour. « Soldats, continue-t-il, vous devez être fiers de devenir une troupe officielle en un jour aussi mémorable. »
« Chacun, écrit Gisevius, devine que cette scène hypocrite, irréelle, n'a été improvisée que pour tuer le temps, pour détendre les nerfs. Il n'y a ni les projecteurs habituels, ni les photographes, ni les haut-parleurs. Ce discours incohérent se poursuit dans le crépuscule et personne, pour ainsi dire, ne l'écoute. » Mais Gœring doit parler pour briser le silence car, après cette journée de tension, l'attente inactive est insupportable. Et Gisevius et Nebe font de même. Tous ceux qui à Berlin ont vécu dans l'action, soit qu'ils l'aient animée, soit qu'ils aient compris ce qui se déroulait ont hâte que la nuit vienne, comme si l'obscurité pouvait apaiser un peu cette tourmente qui souffle sur le Reich depuis l'aube.
LA RUMEUR
Car peu à peu, au fil des heures le nombre des personnes informées a augmenté. C'est au début de l'après-midi que les détails ont commencé à filtrer dans les milieux autorisés de la capitale. Les bars où se réunissent les journalistes, près de Leipziger-Platz connaissent pour un samedi après-midi d'été une affluence exceptionnelle. Tout le monde vient aux nouvelles car de différents côtés on murmure que Rœhm, Papen, Schleicher sont arrêtés et peut-être même exécutés. Des journalistes ont eu du mal à gagner le quartier des ministères : sur la Charlottenbourg Chaussee qui traverse en son milieu le Tiergarten et qui aboutit à la porte de Brandebourg, il est difficile de circuler. Des barrages de police, des camions de l'armée qui stationnent et enfin le flot des voitures que l'on contraint à emprunter cette voie — la Tiergartenstrasse étant interdite — font qu'on avance au pas. On se rend compte ainsi que des soldats occupent le Tiergarten dans sa partie sud. Il est clair qu'une large opération est en cours et tous ceux qui habitent dans l'ouest de Berlin, dans le quartier qui s'étend entre Unter den Linden, la Wilhelmstrasse et la Bendlerstrasse ne peuvent ignorer les perquisitions des S.S., les arrestations, les meurtres, les mouvements des troupes. Les fonctionnaires des ministères — ainsi Gisevius — bien que ne réussissant pas à faire un tableau complet de la situation et de ses causes, commencent à entrevoir l'ampleur de la purge qui touche tous les opposants.
Les circonstances désormais connues de tel ou tel incident permettent bribe par bribe de reconstituer un moment de la journée. On sait, par exemple, qu'un ancien ministre de Brüning et du général Schleicher, Gottfried Reinhold Treviranus, leader de la fraction du parti nationaliste qui avait refusé de se plier en 1929 aux exigences de Hitler et de Hugenberg, a réussi à échapper miraculeusement aux assassins. Les S.S. se sont présentés trop tard chez lui et quand, dans le courant de l'après-midi, ils retrouvent sa piste au Tennis Club de Wannsee, Treviranus qui est en train de disputer une partie les aperçoit Ils sont quatre S.S. qui parlementent à l'entrée du club. Treviranus comprend immédiatement que c'est lui qu'ils viennent arrêter et, franchissant les barrières, passant par les jardins, il réussit à gagner les bois de Grunewald. Hébergé par un ami, il pourra quelques jours plus tard gagner la Grande-Bretagne.
La plupart n'ont pas de chance. Gregor Strasser que Tschirschky a croisé dans les couloirs de la Gestapo a été immédiatement enfermé avec les autres S.A. Nul besoin de l'interroger : ce qui compte pour Gœring, Himmler et Heydrich c'est de le tenir. Les S.A. prisonniers entourent celui qui a été l'un des grands du parti : sa présence les rassure. Que pourra-t-il leur arriver puisque Strasser est là, en vie, avec eux ? A 17 heures, un S.S. convoque Strasser qui est placé dans une cellule individuelle comportant une large lucarne. Peu après Strasser a sans doute deviné une ombre qui se penche, un pistolet dirigé vers lui par la lucarne. Il a tenté de se dérober, quand le coup de feu a claqué, mais il est blessé. Trois S.S. pénétrent dans la cellule pour l'achever. Son sang se répand et il va râler longtemps. Heydrich, averti, aurait déclaré: « Il n'est pas encore mort ? Laissez donc saigner ce pourceau. » Ainsi finit dans une des caves de la Gestapo l'un des premiers nazis, celui peut-être auquel Hitler devait le plus car il avait été l'organisateur du Parti, un homme qui avait de vastes perspectives, une tête politique ; un homme qui ne mâchait pas ses mots et qui avait devant Hitler maintes fois condamné Himmler, Gœring et ce Goebbels qui autrefois avait été son secrétaire, qu'il avait formé et qui l'avait abandonné. Et Gregor Strasser agonise. La thèse officielle sera celle du suicide. Et cela n'étonne même plus les habitants du IIIeme Reich de Hitler.
Parfois d'ailleurs une victime se livre aux tueurs choisissant ainsi délibérément de mourir. Quand, vers 16 heures, ce samedi, le général von Bredow, ancien de la Bendlerstrasse, intime du général Schleicher et évincé depuis peu de temps, après son chef, de ses fonctions au ministère de la Guerre, pénètre dans le hall de l'hôtel Adlon, les présents, pour la plupart de hauts fonctionnaires ou des diplomates, s'étonnent de le voir encore vivant. Le bruit de la mort de Schleicher court en effet avec de plus en plus d'insistance. Or Bredow est ici, en plein cœur de la souricière dans ce grand hôtel qui donne sur Unter den Linden où patrouillent les S.S. et les hommes de la Gestapo. A un ami qui lui demande s'il est au courant des nouvelles, Bredow répond : « Je me demande même comment il se fait que ces cochons ne m'aient pas encore tué ». Plusieurs personnes viennent lui serrer la main ou s'asseoir à sa table et il y faut du courage quand on sait que tous les garçons de cet hôtel fréquenté par des personnalités politiques ou diplomatiques travaillent pour les services de Himmler et de Heydrich.
Un attaché militaire étranger après une hésitation lui propose une invitation à dîner chez lui, façon habile de le soustraire aux menaces, au moins pour quelques heures. Le général Bredow lui serre la main.
« Je vous remercie, dit-il. J'ai quitté mon domicile de fort bonne heure ce matin. Je désire y retourner maintenant que j'ai eu le plaisir de revoir mes amis. »
On essaie en vain de le dissuader mais une immense lassitude a saisi le général von Bredow. C'est pour lui le temps amer du dégoût et du désespoir. « Ils ont assassiné Schleicher, explique-t-il, il était le seul homme à pouvoir sauver l'Allemagne. Il était mon chef. Il ne me reste rien ».
Et saluant simplement, offrant un gros pourboire au garçon servile qui s'apprête à renseigner la Gestapo, le général von Bredow quitte l'hôtel Adlon et gagne Unter den Linden qui connaît l'animation des fins d'après-midi. On ne le reverra plus vivant. Dans la soirée, les tueurs ont sonné à sa porte et ouvert le feu.
LA CONFERENCE DE PRESSE DE GŒRING
C'est le deuxième général de la Reichswehr abattu dans la journée. Pourtant quand Gœring, vers 17 heures, se présente aux journalistes réunis à la chancellerie du Reich, l'inquiétude que lui et Himmler avaient eu un instant à l'annonce de la mort de Kurt von Schleicher paraît les avoir complètement abandonnés. Il y a, serrés dans la pièce, impatients, les correspondants étrangers et les rédacteurs en chef des grands journaux allemands. Mêlés à eux, un certain nombre de personnalités politiques plus ou moins bien informées et qui veulent savoir.
La chaleur est étouffante et Gisevius qui est présent, note que règne une « tension effroyable ». « Gœring arrive, écrit-il, il est en grand uniforme, il parade et monte majestueusement à la tribune. Après une longue pause d'un grand effet, il se penche un peu en avant, appuie la main au menton, roule les yeux comme s'il avait peur des révélations qu'il doit faire. Il a sans doute étudié devant sa glace cette attitude néronienne. Puis il fait sa déclaration. Il parle sur un ton lugubre, d'une voix sourde comme un professionnel des oraisons funèbres ».
Il est hautain. Un communiqué sera rédigé, dit-il, il sera remis le lendemain aux journalistes, pour l'instant il n'a pas le temps de fournir des détails car l'action continue et il la dirige par décision du Führer. « Depuis des semaines, continue-t-il, nous observions, nous savions qu'une partie des chefs de la Sturmabteilung s'étaient largement écartés des buts du mouvement et faisaient passer au premier plan leurs propres intérêts, leurs ambitions et en partie leurs penchants malheureux et pervers». Gœring multiplie les pauses : il va et vient, les poings sur les hanches. « Ce qui nous semble le plus condamnable, ajoute-t-il, c'est que la direction suprême de la S.S. évoquait le fantôme d'une deuxième révolution, dirigée contre la réaction alors qu'elle avait partie liée avec celle-ci. L'intermédiaire principal était l'ancien chancelier du Reich, le général von Schleicher qui avait mis Rœhm en relation avec une puissance étrangère... »
Une nouvelle pirouette de Gœring, une mimique satisfaite.
« J'ai élargi ma mission, en portant un coup sévère, à ces mécontents ».
Puis Gœring s'apprête à quitter la pièce. Un journaliste étranger se lève alors et commence une phrase où il est question du sort réservé au général Schleicher. Gœring s'arrête, sourit, fait demi-tour.
« Oui, dit-il, je sais que vous aimez les gros titres, vous autres journalistes. Eh bien, écoutez-moi, le général von Schleicher a comploté contre le régime. J'ai ordonné qu'il soit arrêté. Il a commis l'imprudence de résister. Il est mort ».
Gœring, satisfait de la surprise, observe un instant les journalistes puis il quitte la salle. Un officier de la Reichswehr distribue alors le texte d'un communiqué officiel du général von Reichenau qui exprime le point de vue officiel de la Bendlerstrasse et donc de la Reichswehr. Ce texte prouve que Reichenau et son chef Blomberg font cause commune avec les tueurs S.S., avec la Gestapo et qu'ils sont décidés à couvrir toutes les violations du droit et toutes les atteintes aux prérogatives de l'Offizierskorps : Schleicher qui avait été le général le plus écouté de l'armée est abandonné, calomnié. Cela va peser lourd sur l'avenir du Reich et de l'armée allemande.
Reichenau, ce digne officier de tradition, portant monocle et guindé dans un uniforme impeccable, n'hésite pas à écrire : « Soupçonné d'avoir trempé dans le complot fomenté par Rœhm, deux hommes de la S.S. ont été chargés d'arrêter le général von Schleicher. Ce dernier ayant opposé une vive résistance, les policiers ont été contraints de faire usage de leurs armes. Au cours de l'échange de coups de feu, le général et son épouse, survenue à l'improviste, ont été mortellement blessés ».
A LICHTERFELDE
On comprend l'assurance de Gœring. Dans les rue de Berlin tout est d'ailleurs redevenu normal. Unter den Linden, les promeneurs sont nombreux et aux terrasses des cafés de la Kurfürstendamm c'est l'affluence du samedi soir quand il fait beau et chaud, comme dans ce dernier crépuscule de juin. Les barrages ont été retirés du Tiergarten et les jeunes couples ont repris leurs promenades dans les allées qui convergent vers la Floraplatz. Les éditions du soir des grands journaux se contentent d'annoncer que l'Obergruppenführer Lutze remplace désormais Rœhm à la tête de la Sturmabteilung, encore la nouvelle est-elle donnée en quatrième page. Il n'y a pas trace des déclarations, venues trop tard, de Gœring et de Reichenau.
Pourtant, dans des conversations à voix basse les noms de Lichterfelde et du Colombus Haus reviennent : ce sont les deux lieux de détention des personnes prises dans la journée.
Mais c'est à l'Ecole militaire de Lichterfelde qu'on fusille. Là, on a obligé le capitaine d'aviation Gehrt, ancien de l'escadrille de Gœring, chevalier de l'ordre du Mérite, à arborer ses décorations pour que Gœring puisse les lui arracher. Là, les pelotons d'exécution sont composés d'hommes de la Leibstandarte, les S.S. de Sepp Dietrich, les camarades de ceux qui ont exécuté les officiers S.A. à la prison de Stadelheim à Munich. Là, les salves se succèdent à partir du début de l'après-midi et l'on entend des cris, parfois un Heil Hitler! Un condamné ne comprend pas pourquoi il meurt et lance un salut à celui en qui il a cru et croit encore. Ce sera le cas de Karl Ernst.
Sur l'aéroport de Tempelhof, alors qu'ils attendent toujours l'avion du Führer, les officiels voient se poser en bout de piste un Junkers monomoteur. L'avion roule lentement vers la tour de contrôle. Dès qu'il est immobilisé, l'Hauptsturmführer Gildisch saute à terre, puis encadré par deux S.S., c'est au tour de l'Obergruppenführer S.A. Karl Ernst. Ils arrivent de Brème. Ernst paraît toujours confiant. « Le gaillard semble être de très bonne humeur, note Gisevius. Il passe en sautillant de l'avion à l'auto. Il sourit de tous côtés comme s'il voulait montrer à tout le monde qu'il ne prend pas son arrestation au sérieux ». Sans doute n'a-t-il pas encore compris ce qui se passe réellement. Il va mourir à Lichterfelde, criant sa confiance en Hitler, victime d'il ne sait quel complot persuadé probablement de mourir pour le Führer.
C'est peu de temps après l'arrivée d'Ernst qu'apparaît l'appareil de Hitler. Il s'agit du même gros trimoteur avec lequel il a accompli le voyage de Bonn-Hangelar à Munich. Le Junkers survole lentement le terrain, s'éloigne et enfin revient se poser, roulant jusqu'à s'arrêter non loin de la garde d'honneur S.S.
Le moment est exceptionnel : voilà des jours que le Führer fuyait Berlin. Maintenant le voici de retour, ayant frappé à coup sûr : tout le monde le guette. Gisevius a longtemps été marqué par cette arrivée et les détails sont restés gravés dans sa mémoire.
« BRAVO ! ADOLF. »
Gœring, Himmler, et les autres personnalités s'avançant vers l'avion, Hitler paraissant le premier, les claquements de talons, les saluts, puis derrière lui Brückner, Schaub, Sepp Dietrich, et enfin affichant son sourire sinistre, Goebbels. Hitler semble marcher « péniblement, à pas lourds, d'une flaque à l'autre, on a à tout instant l'impression qu'il va s'enfoncer... Tout est sombre sur sa personne, chemise brune, cravate noire, manteau de cuir, hautes bottes d'ordonnance. La tête nue, le visage blanc comme un linge, mal rasé, les traits à la fois creusés et bouffis, les yeux éteints au regard fixe, à moitié dissimulés sous les mèches pendantes ». Et Gisevius ajoute « pour être tout à fait franc il m'inspire une sorte de dégoût ».
Himmler et Gœring entourent le Führer. Le groupe des trois hommes s'arrête et à distance, respectant l'intervalle, les autres personnalités s'immobilisent. « Himmler a tiré de sa manche une longue liste chiffonnée, remarque Gisevius. Hitler en prend connaissance tandis que les deux hommes ne cessent de lui parler à l'oreille. On voit Hitler suivre sa lecture du doigt, s'arrêter de temps à autre un peu plus longuement sur un nom... Tout à coup, continue Gisevius, Hitler rejette la tête en arrière d'un geste de si profonde émotion, pour ne pas dire de révolte que tous les assistants le remarquent. Nous nous regardons d'un air significatif Nebe et moi. Nous avons eu la même pensée, ils viennent de lui signaler le « suicide » de Strasser. »
Toute la scène est violente, symbolique comme un finale de tragédie ou d'opéra avec, rappelle Gisevius, ce « crépuscule rouge sombre à la Wagner ». Et ne manque même pas, alors que s'éloignent les personnalités vers les voitures, un cri isolé parti du haut d'un hangar où se sont agglutinés des ouvriers qui observent l'arrivée du Führer, le cri inattendu, résonnant dans le silence « Bravo ! Adolf ». Il retentit une autre fois, « Bravo ! Adolf », salut populaire et déplacé, un contrepoint comme dans un drame shakespearien, épisode presque bouffon comme pour rappeler à ces hommes puissants, vainqueurs, au terme de cette journée sanglante, le dérisoire et le provisoire de leur condition.
7
NUIT DU SAMEDI 30 JUIN 1934
DU DIMANCHE Ier JUILLET AU
LUNDI 2 JUILLET, VERS 4 HEURES DU MATIN
Les voitures officielles ont quitté Tempelhof et les unités des S.S. et de l'armée de l'air commencent à embarquer dans les camions. Des commandements brefs et gutturaux résonnent dans le silence du champ d'aviation déserté : le soleil à l'horizon a disparu et il ne reste plus qu'un embrasement rouge-gorge barré de traînées grises.
Gisevius, avant de retourner au ministère de l'Intérieur, dîne rapidement dans un petit restaurant de la Kurfurstendamm où se retrouvent des fonctionnaires des différents services. Là, discrètement assis à une table au fond de la salle, il remarque le colonel Hans Oster, l'un des chefs de l'Abwehr, déjà réticent à l'égard du nazisme. Gisevius s'installe face à Oster, puis les deux hommes, tout en dînant, échangent discrètement leurs informations et, écrit Gisevius : « Je me rends compte qu'on ignore encore au ministère de la Guerre la plupart des fusillades. » En fait si certains officiers sont restés en dehors des événements, Reichenau et Blomberg les ont préparés et favorisés. Mais naturellement, Oster est de ceux qu'on a tenu dans l'ignorance ; maintenant il s'indigne avec Gisevius des méthodes du Reichsführer Himmler et de Heydrich. Gisevius l'approuve et en se séparant les deux antinazis concluent : « Les gens de la Gestapo seront appelés à rendre des comptes pour avoir au vrai sens du mot dépassé la cible. »
Mais le règne de la Gestapo ne fait pourtant que commencer et pour Himmler et Heydrich la journée n'est qu'une étape cruciale de l'irrésistible ascension des forces qu'ils contrôlent. Les deux hommes, ce samedi dans la nuit, sont à la Chancellerie du Reich avec le Führer et Hermann Gœring. Heydrich est en retrait et au bout de quelques instants, il laissera Hitler seul avec les deux chefs nazis. Ils parlent d'abondance, ils font état des succès remportés ; ces hommes exécutés avant même d'avoir compris ce qui leur arrivait, ils les exhibent comme des preuves de leur détermination. Puis, Gœring, le premier, a parlé de Rœhm : Rœhm toujours vivant dans sa cellule de Stadelheim. L'hésitation du Führer les inquiète : ne va-t-il pas en tirer argument contre eux, se présenter comme l'arbitre aux mains pures et laisser le sang retomber seulement sur leurs têtes ? Il faut qu'ils l'entraînent à accomplir l'acte décisif qui, pour toujours, liera son destin aux leurs. Alors ils rappellent les responsabilités de Rœhm, ses mœurs dissolues, comment chaque jour éclatait un nouveau scandale ; la malle que le chef d'Etat-major avait oubliée dans l'escalier d'une maison de rendez-vous et tous les subterfuges qu'il avait fallu employer pour éviter que l'opinion internationale ne soit avertie de l'affaire. Il y a aussi l'armée qui réclame sa tête : hier, il était exclu par Blomberg de l'Offizierskorps, aujourd'hui que Schleicher a été abattu, comment la Reichswehr accepterait-elle que Rœhm survive ? Il ne saurait y avoir d'exception dans la justice. Le mot remplit la bouche de Gœring : au nom de la justice, Rœhm doit mourir. Hitler hésite encore et quand Gœring et Himmler quittent la Chancellerie du Reich, rien encore n'est décidé pour le chef d'Etat-major de la Sturmabteilung qui somnole péniblement dans la chaleur lourde de sa cellule.
LA PEUR
Il est entre 23 heures et minuit, ce samedi 30 juin 1934. A Lichterfelde, les exécutions sont suspendues : les habitants des résidences voisines de l'Ecole militaire des Cadets peuvent enfin cesser de vivre dans l'angoisse de ces salves ponctuées de commandements et de cris qui ont troué le silence de ce quartier éloigné toute la journée. Dans le centre de Berlin, les cafés se vident peu à peu : des familles tranquilles qui sont allées se promener jusqu'à la porte de Brandebourg redescendent Unter den Linden et passent devant le ministère de l'Intérieur du Reich. Tout paraît calme dans le grand bâtiment. Et pourtant de hauts fonctionnaires y ont peur. Daluege, chef de la police prussienne, général, converse avec Gisevius et Grauert : ils font le bilan des événements de la journée, établissant un rapport Puis Daluege annonce que, compte tenu de la situation, il va faire dresser un lit de camp dans son bureau pour y passer la nuit Gisevius décide alors de faire de même et de choisir un bureau appartenant à un collègue absent : qui aura l'idée de le trouver au ministère et derrière une porte qui arbore un nom différent ? Avant de s'installer, il bavarde avec l'aide de camp de Daluege : « Je lui fais entendre, raconte-t-il, quelle belle preuve de zèle montre notre chef en passant la nuit dans son bureau. " Quoi ? me réplique ce loyal aide de camp, du zèle ? du zèle ? " Il devient soudain rouge à éclater et sa voix tremble. " Il a la trouille, il a la trouille, c'est pour ça qu'il ne rentre pas chez lui. "
Dans toutes les villes du Reich, des hommes sont ainsi saisis par la peur : dans les cellules de Stadelheim, de Lichterfelde, du Colombus Haus ou dans les caves de la Prinz-Albrecht-Strasse, ils guettent le pas des S.S. qui peuvent d'un instant à l'autre venir les abattre ou les conduire devant le peloton d'exécution. Ils écoutent la nuit pour y repérer le pas des soldats qui se rangent en file et le bruit des fusils qu'on arme. Ils ont peur et leur terreur est encore plus grande de ne rien savoir de leur sort et des raisons qui font qu'ils sont là, soumis au bon vouloir d'une institution et d'un régime qu'ils connaissent comme impitoyables. Car ils étaient ce régime, et leur désarroi d'avoir été frappés par lui ajoute à leur peur. Dans des appartements étrangers dans des vêtements d'emprunt, sous des identités de circonstance d'autres hommes tentent dans l'angoisse de fuir les tueurs ; des blessés, échappés miraculeusement aux recherches, marchent courbés dans les bois qui entourent Berlin, la peur et la douleur déformant leurs traits. Et d'autres hommes qu'apparemment rien ne menace puisqu'ils sont du côté des tueurs, avec eux, ont peur aussi parce qu'ils éprouvent que l'arbitraire règne souverainement sur le Reich, et qu'ils peuvent être demain, tout à l'heure, dans ce dimanche 1er juillet qui commence, les prochaines victimes désignées.
La peur, la terreur, l'angoisse sont ainsi pour des milliers d'hommes, la marque de cette courte nuit. Et à 7 heures du matin, le dimanche, alors que la lumière claire et joyeuse inonde l'Allemagne, la voix métallique et exaltée de Joseph Goebbels entre dans les foyers, porteuse d'insultes, de menaces et de mort. Goebbels, à la radio, raconte la Nuit des longs couteaux et accable les victimes, ses anciens camarades.
« Ils ont, dit-il, discrédité l'honneur et le prestige de notre Sturmabteilung. Par une vie de débauche sans pareille, par leur étalage de luxe et leurs bombances, ils ont porté atteinte aux principes de simplicité et de propreté personnelle qui sont ceux de notre mouvement. Ils étaient sur le point d'attirer sur toute la direction du Parti le soupçon d'une anomalie sexuelle honteuse et dégoûtante. »
Des dizaines de milliers de familles allemandes avant de partir pour l'église ou le temple s'indignent calmement de cette débauche honteuse : heureusement Hitler, le père juste et sévère, a puni : « On avait cru, continue Goebbels, que l'indulgence du Führer à leur égard était de la faiblesse... Les avertissements avaient été accueillis avec un sourire cynique. La bonté étant inutile, la dureté devenait nécessaire ; de même que le Führer peut être grand dans la bonté, il peut l'être dans la dureté... »
Les enfants se lèvent : ils écoutent. Les mères préparent le déjeuner et dans les campagnes par les fenêtres ouvertes entre l'odeur têtue des foins. L'Allemagne vit, tranquille, docile, respectueuse : la Nuit des longs couteaux semble être passée en dehors d'elle.
« Des millions de membres de notre Parti, des S.A. et des S.S., se félicitent de cet orage purificateur. Toute la nation respire, délivrée d'un cauchemar », poursuit Goebbels.
Et il est vrai que beaucoup d'Allemands se sentent soulagés en ce dimanche matin. Ils achètent les journaux et ils y découvrent la liste des six Obergruppenführer de la S.A. fusillés, ils lisent que Lutze remplace Rœhm : les S.A. sont donc mis à la raison. Et cesseront sans doute ces ripailles, ces beuveries, ces rixes, ces scandales qui troublaient les petites villes : l'ordre enfin, cet ordre pour lequel les Allemands ont voté en faveur des nazis, le voici qui s'annonce. Ils n'ont pas eu tort de faire confiance au Führer. Comme l'a dit Goebbels à la radio : « Le Führer est résolu à agir sans pitié quand le principe de la convenance, de la simplicité, et de la propreté publique est en jeu et la punition est d'autant plus sévère que celui qu'elle atteint est plus haut placé».
Les lecteurs respectables de la respectable Deutsche Allgemeine Zeitung sont rassurés. On ne parlera plus, en Allemagne, de seconde révolution comme le faisaient les S.A. « Un gouvernement énergique a frappé au bon moment, lisent-ils dans leur journal. Il a frappé avec une précision ahurissante. Il a fait le nécessaire pour qu'aucun patriote n'ait plus à craindre quoi que ce soit... Nous avons maintenant un Etat fort, consolidé, purifié. Nous ne nous attarderons pas ici aux détails répugnants qui auraient constitué l'arrière-plan d'une pseudo-révolution politique ».
Ainsi se rassurent des millions d'Allemands à la lecture de leurs journaux avant de partir pour les promenades le long des avenues ensoleillées, bavarder sur les places des villages ou faire du canotage sur le Griebnitzsee, face à la villa aux volets fermés du général Kurt Schleicher.
Tout est donc tranquille. Berlin resplendit dans cette matinée d'été, les jardins sont pleins d'enfants joyeux. L'ambassadeur américain Dodd circule lentement en voiture, il passe à deux reprises devant la résidence du vice-chancelier Franz von Papen, mais à l'exception d'un véhicule de la police qui stationne à proximité, tout semble normal. L'agence officielle D.N.B. multiplie depuis ce matin les communiqués que la radio retransmet et qui paraissent confirmer que la situation en Allemagne est parfaitement normale.
« En Silésie, dit un premier communiqué, les actions rendues nécessaires pour mettre fin à la révolution se sont déroulées dans le calme et une tranquillité parfaite. L'ensemble de la S.A. se tient derrière le Führer. La nuit du samedi au dimanche a été également très tranquille dans toute la Silésie. La S.A. a adressé un télégramme de fidélité au Führer. Le Gauleiter a télégraphié à Adolf Hitler pour affirmer le calme et la fidélité de la Silésie. » Le S.A.-Führer Wilhelm Scheppmann commandant les groupes Niederrhein et Westphalie télégraphie : « Nous continuons de marcher sur la voie qui nous a été tracée et vers le but que nous a désigné le Führer et nous sommes sûrs d'être ainsi au service du peuple. » Le Gauleiter de Hambourg, Kaufmann, assure que tout est calme et jure fidélité au Führer ; Loeper, Reichsstatthater du Braunschweig-Anhalt, réaffirme son obéissance aveugle au Führer ; Marschler, Gauleiter de Thuringe, jure fidélité au Führer : « Le Führer et son œuvre sont intouchables », écrit-il. Streicher, Gauleiter de Franconie déclare que les éléments nuisibles ont été arrêtés : « Le Führer a triomphé, nous lui jurons fidélité. »
Il n'est pas un chef d'organisation nazie qui n'adresse son télégramme de soumission : et les officiers de la Sturmabteilung sont les premiers à le faire. Ils survivent, qu'importe si c'est à genoux. La victoire du Führer est donc totale dès ce dimanche matin. Et la Reichswehr à son tour le félicite. Il est vrai qu'elle vient — en apparence — de l'emporter. Dans son ordre du jour dicté à Lutze, Hitler n'indiquait-il pas que, « avant toutes choses, chaque chef S.A. règle sa conduite à l'égard de l'armée dans un esprit de franchise, de loyauté et de fidélité parfaites ? » Ainsi, c'en est bien fini des ambitions de Rœhm qui voulait faire de la S.A. la base de la nouvelle armée du Reich. Les armes accumulées par les Sections d'Assaut sont livrées à la Reichswehr. Inspectant (le 5 juillet) les dépôts de la Sturmabteilung, le général Liese, chef du Waffenamt, pourra s'écrier : « Je n'ai plus besoin, pendant longtemps, d'acheter des fusils. » Pour prix de ces concessions, Hitler reçoit ce dimanche 1er juillet, la proclamation que le général Blomberg adresse aux troupes. Elle sera affichée dans les casernes, lue dans les mess d'officiers et devant les soldats rangés au garde-à-vous.
« Avec une détermination toute militaire et un courage exemplaire, écrit Blomberg, le Führer a attaqué et écrasé lui-même les traîtres et les rebelles. L'armée qui porte les armes de la nation tout entière, se tient en dehors des luttes politiques intérieures. Elle exprime sa reconnaissance par son dévouement et sa fidélité. Le Führer demande qu'il existe de bonnes relations entre l'armée et les nouvelles Sections d'Assaut. L'armée s'appliquera à cultiver ces bonnes relations dans la pleine conscience de l'idéal commun. »
Le Führer l'a donc emporté : le voici désigné sur le front des troupes par le général-ministre de la Défense, comme l'exemple même du soldat le modèle à suivre. Le sang des généraux Schleicher et Bredow a vite séché : tout semble terminé. Et pourtant quand l'ambassadeur Dodd essaye de téléphoner à von Papen, le numéro ne répond pas : la ligne est toujours interrompue. Dans le quartier de Lichterfelde, brutalement, ont éclaté au milieu de la matinée de nouvelles salves : les exécutions ont repris à l'Ecole militaire. Régulièrement, toutes les vingt minutes, on entend hurler le commandement avant que les coups de feu ne retentissent, puis isolé, séparé par quelques secondes, le claquement sec du coup de grâce. Pour les familles d'officiers qui habitent la caserne, la tension est telle que beaucoup abandonnent leur appartement pour se réfugier chez des parents en ville.
DIMANCHE 1er JUILLET, 13 HEURES.
Malgré les apparences, l'affaire continue donc et comment d'ailleurs pourrait-elle être achevée alors que Ernst Rœhm vit toujours ? Himmler et Gœring sont retournés en fin de matinée à la Chancellerie au mât de laquelle flotte le pavillon à croix gammée du Führer. Des Berlinois, badauds endimanchés, applaudissent les voitures officielles : personne parmi ces employés qui soulèvent leurs enfants pour leur permettre d'apercevoir le général Gœring et le Reichsführer S.S. ne se doute que les deux hommes vont essayer d'obtenir de Hitler la mort de Rœhm. La discussion est ardue. Hitler, reposé par une longue nuit, résiste. Il ne peut pas avouer que Rœhm vivant est une arme contre Gœring et Himmler, alors il évoque les années passées, les services rendus, mais ce sont de piètres arguments car ils auraient pu jouer pour Heydebreck ou Ernst, pour le général Schleicher ou pour Strasser. Hitler recule pas à pas, et un peu avant 13 heures, ce dimanche 1er juillet, il cède. Gœring se lève, marche dans le salon, satisfait, rayonnant, et Himmler, modeste, parait méditer, dissimulant la joie dure qui le saisit. Quelques instants plus tard, le Führer entre en communication avec le ministère de l'Intérieur à Munich. Le bâtiment est devenu le Quartier général de la répression. Les officiers de la S.S. Leibstandarte Adolf-Hitler y ont établi leur quartier : là se trouve aussi l'Oberführer Theodore Eicke, le commandant de Dachau, qui a été l'un des premiers avertis par Heydrich de ce qui se préparait. Maintenant il attend les ordres de Berlin. Ils sont précis et émanent directement de Hitler. Supprimer Rœhm en l'invitant, si cela est possible, à se suicider. Immédiatement Eicke choisit deux S.S. sûrs, le Sturmbannführer Michael Lippert et le Gruppenführer Schmauser et tous trois, après avoir vérifié leurs armes, se rendent à la prison de Stadelheim.
Il est 13 heures. Devant les hautes portes de la Chancellerie à Berlin une foule nombreuse attend : les enfants crient joyeusement, échappent à la surveillance de leurs pères. Les S.S. du service d'ordre, débonnaires, se laissent bousculer, les enfants blonds passant sous leurs bras. Dimanche 13 heures : la relève de la garde de la Chancellerie du Reich est une des plus courues parmi les attractions de Berlin. Voici d'ailleurs les unités de la relève qui arrivent, mannequins de chair, avançant au pas de parade et faisant claquer en cadence leurs talons ferrés sur l'asphalte. Un immense tambour-major fait pirouetter un étendard muni de clochettes et la fanfare joue le Horst Wessel Lied, puis, pendant que les soldats manœuvrent, elle continue avec le Deutschland Lied puis le Badenweiler marsch. C'est alors que le Führer apparaît à la fenêtre de la Chancellerie, au premier étage, cette fenêtre où tant de fois déjà, et d'abord dans les jours qui ont suivi son investiture il a salué les foules enthousiastes ou les porteurs de torches. On l'aperçoit et des cris de joie s'élèvent de la foule. Le Führer apparaît, reposé, les cheveux soigneusement peignés, il parle avec animation au général Litzmann, commandant la garde, et au ministre Frick. Il salue de la main et se retire lentement comme à regret. La foule l'acclame encore, puis pendant que les soldats commencent leur quadrille minutieusement réglé, elle se disperse et beaucoup de promeneurs se dirigent avec leurs enfants vers le Tiergarten, ses allées fraîches, alors que l'après-midi berlinois s'annonce brûlant et lourd.
14 h 30 : Eicke, Lippert, Schmauser arrivent à la prison de Stadelheim. Le bâtiment est endormi. Les S.S. de garde saluent leurs officiers qui, rapidement, gagnent le bureau du docteur Koch, le directeur. Celui-ci n'a pratiquement pas pris de repos depuis hier : sur son visage quelconque, la fatigue et la peur ont laissé des traces. Quand il fait entrer l'Oberführer Eicke et que celui-ci lui demande de livrer Rœhm, l'accablement paraît écraser Koch. Alors, comme il l'a déjà fait avec Sepp Dietrich, il demande un ordre écrit : consulté par téléphone, le ministre de la Justice Frank, l'approuve. Eicke proteste, tempête, parle à Frank et finalement Koch cède : un gardien est chargé de conduire les trois officiers S.S. à la cellule de Rœhm : elle porte le numéro 474. Rœhm, toujours torse nu, semblant avoir perdu toute volonté, regarde entrer Eicke qui pose sur la table de la cellule un exemplaire du Völkischer Beobachter où sont indiqués la destitution de Rœhm et les noms des S.A. exécutés et, en même temps, il laisse un revolver chargé d'une seule balle. Puis Eicke se retire.
A Berlin, cet après-midi du dimanche 1er juillet, le Führer donne un thé dans les jardins de la chancellerie du Reich. Réunion mondaine à laquelle assistent les diplomates, les ministres, les officiers supérieurs de la Reichswehr. Dans les vastes salles, les valets en tenue offrent toutes sortes de boissons, on rit et les enfants de Goebbels courent dans les couloirs. On entend la foule qui, massée devant la Chancellerie, réclame le Führer. Qui sait que, à Lichterfelde, régulièrement, toutes les vingt minutes, les salves des pelotons d'exécution retentissent encore et qu'à Stadelheim, Rœhm a le droit de choisir de mourir de sa main ? Hitler, rayonnant, s'approche de la fenêtre et salue la foule qui hurle. Gisevius est là, ayant suivi son chef Daluege, auquel la mort de Ernst a valu d'être nommé chef des S.A. de Berlin, du Brandebourg et de Poméranie. Hitler qui vient de serrer la main des deux S.S. aperçoit Gisevius : « Il fait un pas de côté, puis lève la main pour me saluer dans la même attitude immobile que je lui ai vu prendre par deux fois et me regarde comme si j'étais à moi seul une foule admirative. J'aurais plutôt envie de rentrer en moi-même sous l'insistance de ce regard césarien, l'idée me vient qu'il pourrait lire mes pensées et me faire fusiller. Mais il ne semble me vouloir aucun mal. Il tient seulement à jouer complètement son rôle. »
Puis Hitler regagne le centre de la pièce et Gisevius qui l'a observé conclut : « J'ai compris au moment de cette rencontre, combien cet homme était crispé ce jour-là et qu'il essayait d'échapper à son trouble intérieur en se réfugiant dans la pose qui est devenue, dès lors, son arme la plus efficace. » Au milieu de la salle, entouré de femmes élégantes qui rient à ses moindres propos, Hitler esquisse presque quelques pas de danse : enjoué, on le sent heureux de cette attention déférente qu'on lui témoigne, et avec sa chemise blanche, sa large veste d'uniforme sur laquelle il porte la Croix de fer et le brassard à croix gammée, ses gestes détendus, il semble être autre que l'homme qui à grandes enjambées nerveuses, avançait sur la piste de Munich-Oberwiesenfeld, hier samedi à 4 heures du matin.
« RŒHM, TENEZ-VOUS PRET. »
Pourtant, tout cela n'a pas été qu'une vision tragique ou un simple cauchemar. Rœhm est bien là dans sa cellule et il n'a pas bougé. Au bout d'une dizaine de minutes, les S.S. Lippert et Eicke ouvrent la porte. « Rœhm, tenez-vous prêt », crie Eicke. Lippert, dont la main tremble, tire deux coups de feu, Rœhm a encore le temps de murmurer « Mein Führer, mein Führer », puis une nouvelle balle l'achève.
A Berlin, Hitler au milieu des hourras de la foule apparaît une nouvelle fois à la fenêtre de la Chancellerie. Quand il s'écarte un officier S.S. lui tend un message : il annonce la mort de Rœhm. Hitler retourne vers ses invités, plus lentement, quelques minutes plus tard il se retirera dans ses appartements. Himmler et les S.S. viennent de remporter une victoire. Les Gœring, les Heydrich, les Goebbels, les Borman, les Buch, tous les complices peuvent désormais, sans craindre le désordre de la rue et les violences des S.A., dominer l'Allemagne dans l'organisation et la tranquillité. Le temps des demi-solde, des revendications tumultueuses, est révolu. La S.A. est décapitée, Rœhm gît dans une mare de sang. Hitler a une fois de plus choisi l'ordre et tranché avec son vieux camarade. Rares sont ceux qui, comme le ministre Frick, oseront dire à Hitler : « Mon Führer, si vous n'agissez pas aussi radicalement avec Himmler et les S.S. qu'avec Rœhm et ses S.A. vous n'aurez fait que remplacer le diable par Belzébuth. »
Mais il sera plus difficile de se débarrasser des S.S. que des S.A. D'ailleurs, en ce dimanche 1er juillet, il n'est encore question que d'en finir avec Rœhm et les siens. La radio annonce que le Gruppenführer von Obernitz, chef de la S.A. de Franconie, ordonne :
1) que sur les poignards d'honneur le nom de Rœhm soit limé ;
2) que partout les portraits de Rœhm soient retirés ;
3) que le Ernst-Rœhm Haus soit rebaptisé et porte désormais le nom de Service administratif du groupe S.A. de Franconie.
Dans les maisons d'édition des livres du Parti, déjà la décision est prise, les photos de Rœhm, son souvenir même, doivent disparaître. Quant aux S.A., il leur est répété qu'ils sont en congé : « Le congé, dit un communiqué, accordé à tous les S.A., sera sur l'ordre du chef d'Etat-major Lutze respecté intégralement afin que les membres de la S.A. après un an et demi de service rigoureux aient enfin l'occasion de se reposer et de vivre de nouveau au sein de leur famille. » La mort de Rœhm signifie en fait la fin de la Sturmabteilung en tant que force autonome. Et la mort de Rœhm signifie aussi dans cette nuit du dimanche 1er juillet au lundi 2 juillet la mort d'un certain nombre de S.A. jusque-là épargnés ou même, un temps, graciés par le Führer et qu'on vient chercher dans les cellules de l'école de Lichterfelde ou dans celles du Colombus Haus.
Les S.S., baïonnette au canon, accompagnent les condamnés jusqu'au mur puis c'est le bref commandement « Le Führer l'exige. En joue. Feu ! » Parfois ceux de Colombus Haus sont conduits en voiture jusqu'à Lichterfelde et exécutés, là-bas, dans la cour de l'Ecole des cadets. C'est le sort qui est promis au Gruppenführer S.A. Karl Schreyer. Mais au moment de l'emmener à Lichterfelde on se rend compte que la voiture n'est pas encore arrivée. Quand enfin Schreyer va être poussé dans la voiture, une grosse Mercedes noire surgit à toute vitesse et freine devant Colombus Haus. Il est autour de 4 heures du matin, le lundi 2 juillet 1934. Le Standartenführer qui bondit de la voiture en criant « Halte ! halte » annonce que le Führer vient d'ordonner la fin des exécutions. Peut-être Hitler a-t-il jugé que le nombre des victimes — au moins une centaine, mais qui peut réellement affirmer qu'elles ne sont pas un millier ? — suffisait et qu'il devait pour garder tout son prestige aux yeux des survivants jouer au modérateur, juste et magnanime. Peut-être aussi a-t-il craint une réaction du vieux maréchal Hindenburg.
Certes, le Reichspräsident est complètement isolé à Neudeck dans sa vaste propriété, et pour plus de précautions des S.S. ont pris position au milieu des arbres du parc, contrôlant les visiteurs. D'ailleurs, le chambellan, le comte Schulenburg, fait respecter scrupuleusement la consigne : quand un ami de Hindenburg, le comte d'Oldenburg-Januschau, un Junker voisin alerté par Papen, demande à voir le Président du Reich, pour l'avertir de ce qui se passe à Berlin, il est éloigné : Hindenburg serait malade et ne pourrait recevoir de visites. Pourtant Hitler ne veut pas prendre de risques et puisque la S.A. est brisée, ses chefs décimés, et de vieux adversaires liquidés, pourquoi poursuivre ? Quelques tracts signés de S.A. révolutionnaires sont sans doute distribués à Berlin dans la nuit du 1er au 2 juillet, mais leur appel « camarades S.A., ne vous laissez pas désarmer, cachez vos armes, ne devenez jamais les bourreaux de la classe ouvrière » n'entraîne personne. Tout est calme, plié, soumis. La population, les élites, l'armée, le Parti, applaudissent.
Le Reich ignore, approuve ou se tait. Et puisque les principales victimes ont été exécutées, la clémence est possible. Elle intervient ce lundi 2 juillet à 4 heures.
Quarante-huit heures plus tôt Rœhm, Spreti, Heines et son jeune S.A. reposaient dans les petites chambres de la pension Hanselbauer. Schleicher, Bredow, Schmidt Kahr, dormaient ou travaillaient chez eux, paisiblement. Tant d'autres comme eux, innocents ou coupables de nombreux forfaits, qui allaient être abattus sans jamais être jugés au cours de ces quarante-huit heures d'un bel été et qui ne sont qu'une longue nuit, la Nuit des longs couteaux.
Épilogue
« CETTE FOIS, NOUS ALLONS LEUR RÉGLER LEUR COMPTE »
(Hitler, nuit du 20 au 21 juillet 1944)
« UN ENORME TRAVAIL. »
Le lundi 2 juillet 1934 vers 8 heures du matin, un motocycliste du ministère de l'Intérieur de Bavière, s'arrêtait devant un logement bourgeois de la banlieue de Munich et remettait un pli à l'une des locataires. Il s'agissait d'un long télégramme en provenance du siège de la Gestapo à Berlin et son auteur, un membre du S.D., avait participé à toutes les actions — arrestations, exécutions — de ces dernières quarante-huit heures. L'épouse put en lire le texte à ses enfants :
« Ma chérie, nous avons eu un énorme travail par suite de la mutinerie Rœhm. Nous avons travaillé jusqu'à 3 et 4 heures du matin et après cela toutes les dix minutes des coups de téléphone. On est fatigué à tomber raide et pourtant on est comme libéré d'un cauchemar. Je vous embrasse.
Votre Papa »
Sans doute, l'agent de la Gestapo dormait-il à l'heure où sa famille était informée de ses activités, heureuse de savoir qu'il était sain et sauf après le devoir accompli, et lui, heureux de pouvoir enfin se reposer. La mauvaise conscience n'est pas répandue chez les nazis.
La fatigue, ce lundi matin, écrase tous ceux qui ont vécu intensément la Nuit des longs couteaux. Il leur faut recommencer à vivre comme si rien ne s'était passé et pourtant ils savent : les épouses des victimes sont là, à hanter les ministères, à réclamer des nouvelles de leurs maris, parfois à demander qu'on leur donne au moins le corps pour lui procurer une sépulture décente. Mais, le plus souvent, on les renvoie, on les bouscule : elles ne doivent pas exister puisque les morts eux-mêmes, à l'exception de la dizaine dont les journaux ont parlé n'existent pas ou existent seulement dans l'imagination de la presse étrangère ou des organisations d'émigrés qui lancent au peuple allemand des appels qu'il ne peut et ne veut pas entendre. Le parti social-démocrate en exil déclare ainsi dans un manifeste :
« La bande de criminels qui s'est jetée sur l'Allemagne sombre dans la boue et dans le sang. Hitler lui-même accuse ses collaborateurs les plus intimes, les mêmes hommes qui l'ont porté au pouvoir, des dépravations morales les plus éhontées... Mais c'est lui qui a fait appel à eux pour la terreur, pour l'assassinat... Il a toléré et approuvé leurs atrocités, il les a nommés ses camarades... Aujourd'hui, il laisse assassiner ses complices non point à cause de leurs crimes, mais pour se sauver lui-même... Cent mille satrapes en chemise brune se sont rués comme une nuée de sauterelles sur le Reich... »
Ce texte, les citoyens du Reich l'ignorent. En ce lundi matin 2 juillet, comme à l'habitude, ils vont à leur travail dans la discipline. Les bouches de métro déversent sur la Wilhelmstrasse ou Unter den Linden les employés des ministères ; les équipes de jour de Krupp pénètrent au son de la sirène dans les hangars : tout continue comme si rien d'exceptionnel ne s'était déroulé entre le samedi 30 juin 4 heures et l'aube de ce lundi où les activités reprennent. Dans le métro de Berlin, dans les rues de Munich, à Francfort les Allemands lisent seulement dans leurs journaux les communiqués officiels annonçant par exemple que « le traître Rœhm renonçant à tirer lui-même les conséquences de ses actes a été exécuté. La Kreuz-Zeitung écrit qu'il « ne nous sera jamais possible de nous acquitter entièrement de notre dette de reconnaissance envers le Führer ». Et tous les journaux, avec quelques nuances parfois, imperceptibles à la plupart de leurs lecteurs, approuvent la répression. La Gazette de Francfort, la plus réservée pourtant, écrit : « Chaque Allemand ressent intimement qu'à la sévérité sans précédent du châtiment doit correspondre un crime sans précédent ».
La vie continue donc : rien ne s'est passé, les crimes ne doivent pas laisser de traces. Gisevius se « retrouve le lundi matin complètement épuisé, dans son bureau du ministère ». On lui apporte un message qui est parvenu par erreur au ministère du Reich. Il lit :
« Le ministre-président de Prusse et chef de la police secrète d'Etat à toutes les autorités policières. Par ordre supérieur, tous les documents relatifs à l'action des deux jours précédents doivent être brûlés. Rendre compte immédiatement après exécution. »
— Devons-nous également brûler nos radiogrammes ? demande le planton, un brigadier de police, à Gisevius.
Il présente tout un paquet de petites fiches blanches où sont notés les appels, les informations parvenues de tous les points d'Allemagne. Heure par heure, les traces des événements ont ainsi été relevées.
— Bien entendu, il faut les détruire tout de suite, réplique Gisevius.
« Un peu rudement, explique-t-il, je lui arrache le paquet. Il n'a pas franchi la porte que j'enferme la liasse dans le tiroir de mon coffre-fort ».
Ainsi il y aura quelques traces et Gisevius, pour l'histoire, témoignera. Mais les Allemands ignorent cela. Et souvent ils refusent de voir alors même que la vérité perce parce qu'un collègue disparu ou un voisin — Tschirschky par exemple — reparaît, la tête rasée ; que l'épouse de Bose, mère de deux jeunes enfants, a une crise nerveuse en apprenant que son mari est mort et qu'on lui donne simplement une urne contenant quelques cendres : un corps même mort parle et dit comment il a succombé. Les cendres sont muettes. On peut, si les familles insistent et si elles ont des appuis, remettre aux proches ces petites urnes grises. Celle de la veuve de l'Oberführer Hoffmann porte le n° 262 et celle contenant les cendres de Gregor Strasser est marquée du n° 16.
« VOUS AVEZ SAUVE LE PEUPLE ALLEMAND. »
Mais le conformisme et la terreur pèsent sur l'Allemagne et personne ne veut savoir. Les prisonniers eux-mêmes se taisent, portant l'effroi sur leur visage, et quand ils parlent, c'est pour louer la Gestapo, ses prisons, ses méthodes, le Führer juste et magnanime. Les proches du Reichspräsident Hindenburg eux-mêmes ont peur : le fils du secrétaire général Meissner, volontaire S.S., a été, au cours des événements placé délibérément par ses chefs dans une unité chargée de la répression. Le fils de Hindenburg a été soumis à des pressions. Et, ce lundi 2 juillet, la presse rend public un télégramme qui est daté de Neudeck et signé du maréchal Hindenburg :
« Au Chancelier du Reich, le Führer Adolf Hitler,
D'après les rapports qui m'ont été présentés, il apparaît que grâce à la fermeté de votre décision et grâce au courage dont vous avez fait preuve, payant de votre personne, les tentatives de haute trahison ont été étouffées. Vous avez sauvé le peuple allemand d'un grave danger. Je dois vous en exprimer mes profonds remerciements et toute ma reconnaissance.
Le Président du Reich, Maréchal Hindenburg »
La plus haute autorité du Reich, le plus grand des militaires vivants, ce vieillard de 87 ans, symbole de toute la tradition germanique, approuve donc toutes les violations du droit, les assassinats, les exactions commises dans la longue nuit, et Hitler se voit sacré sauveur du peuple allemand. Le même jour, Hindenburg remercie aussi Hermann Goering :
« Je vous exprime, écrit-il, ma gratitude et ma reconnaissance pour votre action énergique et couronnée de succès, lors de l'écrasement de la tentative de haute trahison. Avec mes salutations de camarade.
Von Hindenburg »
Peut-être ces messages n'ont-ils pas été rédigés par Hindenburg lui-même. Plus tard, en 1945, alors que sont réunis Papen, Gœring et le maréchal Keitel dans une cellule de Nuremberg, durant le procès fait par les Alliés aux criminels de guerre, Papen veut en avoir le cœur net : « Quand je demandai à Gœring, raconte-t-il, si à son avis, Hindenburg avait vu le télégramme de félicitations envoyé en son nom à Hitler, il cita une boutade de Meissner, secrétaire d'Etat à la présidence. A plusieurs reprises, Meissner parlant de ce télégramme, s'était enquis, avec un sourire entendu : « A propos, Monsieur le Premier ministre, étiez-vous satisfait de la teneur du message?"»
Mais ce qui compte, ce 2 juillet 1934, c'est que, par ce message, le lien soit établi entre le vieux maréchal, le général Gœring et l'homme de main que celui-ci a dirigé. De Hindenburg à l'Hauptsturmführer Gildisch qui tire dans le dos d'hommes sans défense, la chaîne de la complicité est tendue et c'est la conscience des Allemands qui, ce lundi matin, vaquent tranquillement à leurs habituelles occupations, la conscience d'un peuple qu'elle emprisonne dans le nazisme. Ainsi la journée du lundi 2 juillet apporte-t-elle de nouveaux succès au Führer : la voie vers la présidence du Reich est ouverte, royale, il n'y a plus qu'à attendre la mort du vieil Hindenburg.
« ALLEMANDS, PAVOISEZ ! »
Et la vie continue. Les bureaux sont pleins d'employés qui ont bronzé le samedi après-midi et le dimanche sur les rives du Havel ou du Tegelsee ou de l'un quelconque de ces lacs aux eaux froides qui entourent Berlin. Ils retrouvent leurs collègues, leurs sièges, leurs papiers et parfois un huissier leur murmure — comme au ministère des Transports ou à la vice-chancellerie — que deux ou trois personnes ne reviendront pas, qu'elles ont disparu, samedi. Personne ne pose de questions. La machine a recommencé à tourner sans à-coups. Comme l'écrit Gisevius : « Le 2 juillet, la loi et la bureaucratie reprennent leurs droits ; du jour au lendemain tout doit suivre à nouveau sa marche régulière. Des gens appliqués essayent de faire cadrer avec les règlements et les prescriptions légales, même ce qui s'est passé la veille ».
Les parades aussi ont recommencé. A Essen, à partir de 19 heures, la police fait circuler ou enlever les voitures en stationnement. Des véhicules de la municipalité et du Parti, avec des S.S. sur les marchepieds, et un haut-parleur sur le toit, parcourent lentement les rues de la ville toujours recouverte du brouillard gris que le soleil de juillet irise. Il fait très lourd comme si un gros orage allait éclater mais ce n'est que la chape des fumées industrielles, des poussières en suspension qui écrase la ville, alourdit l'atmosphère. Inlassablement, les haut-parleurs répètent la proclamation à la population.
« Habitants d'Essen, Allemands du IIIeme Reich, la ville d’Essen célébrera la victoire sur le soulèvement criminel, la haute trahison et la réaction en décorant d'une manière massive la ville avec des drapeaux. C'est pourquoi : pavoisez ! »
L'injonction n'admet pas de réplique et peu après le passage des voitures, des équipes distribuent des drapeaux à croix gammée qui bientôt vont pendre, immenses, le long des façades. A 20 h 45, les sirènes retentissent : il fait encore jour et l'on distingue les couleurs des uniformes, le rouge des brassards. Les unités de S.A. se sont regroupées sur les différentes places de la ville et la S.A.-Standarte 219 est même rassemblée sur le terrain de sports en direction de la Kopfstadtplatz. Mais la gloire revient aux S.S. et à l'organisation du Parti qui sont réunis sur l'Adolf-Hitler Platz. Et la foule aussi est là, innombrable, disciplinée, moins vive qu'à Berlin, plus passive : mais elle est présente, employés des firmes métallurgiques, ouvriers, femmes, enfants se pressant derrière les S.S. et les S.A. A 20 h 45 précises, le Gauleiter Terboven monte à la tribune dressée sur l'Adolf-Hitler Platz. Terboven grave, les mâchoires serrées, fier, hautain, transformé depuis que le Führer a assisté à ses noces, précisément quelques heures avant de réduire dans sa poigne de fer les traîtres. Maintenant il parle et son discours est retransmis sur les cinq places d'Essen de la Kopfstadtplatz à la Pferdemarktplatz et l'on entend les applaudissements de la foule qui viennent parfois à contretemps.
« La fidélité est quelque chose de fondamental, déclare Terboven, l'abcès a été vidé, il existe des éléments corrompus comme il en existe partout. Mais ce qui compte, c'est de savoir comment on réagit contre la gangrène ».
La foule de temps à autre interrompt Terboven pour applaudir et quand il lance le Sieg Heil ! un immense cri repris par les unités de S.S. et de S.A. roule de place en place. D'autres responsables s'avancent et parlent, à leur tour, puis c'est le défilé qui commence cependant que la musique S.S. impressionnante, ses musiciens vêtus de noir frappant en cadence les tambours drapés d'emblèmes à tête de mort, joue Im Ruhrgebietnmarschiere wir (nous marcherons dans la Ruhr). Passent les unités S.S. et la foule qui les regarde, la foule qui ne sait rien de précis, à les voir ainsi en tête du cortège objet de toutes les attentions officielles, devine qu'ils sont le nouveau visage du régime hitlérien. Dans d'autres villes d'Allemagne, partout les S.S. sont à l'honneur. Dans la chaude nuit d'été, la foule se disperse silencieuse et les unités S.S., acclamées et flattées, regagnent leurs cantonnements. Les hommes de l'Ordre noir, officiers ou soldats sentent qu'ils ont, au terme de cette Nuit des longs couteaux, gagné la partie.
LE FUHRER ET LA JUSTICE SUPREME
Ce même soir, Frau Papen et ses filles regagnent Berlin. Elles sont inquiètes : Frau Tschirschky les a prévenues que son mari avait été arrêté et elles ne savent pas quel a été le sort réservé au vice-chancelier. Devant la villa, la voiture de police stationne toujours et le capitaine chargé de la surveillance est encore présent, installé dans l'entrée. Mais Franz von Papen est vivant, hors de lui, maudissant les nazis et cette mise à l'abri forcée qu'on lui a imposée. Pourtant le lendemain, mardi 3 juillet, sa ligne téléphonique est rétablie et le premier appel vient de Hermann Gœring : « Il eut l'impudence de me demander pour quelle raison je n'assistais pas à la réunion du cabinet qui allait commencer, explique Papen. Pour une fois, je répliquais d'un ton nettement trop vif pour un diplomate. Gœring exprima sa surprise d'apprendre que j'étais toujours plus ou moins aux arrêts et me pria d'excuser cette omission. Un peu plus tard, en effet, les hommes qui me gardaient furent retirés et je pus me rendre à la Chancellerie. »
Dans la vaste salle où se tiennent les conseils des ministres, le Chancelier Hitler va de l'un à l'autre. Il paraît détendu, au mieux de sa forme. Aujourd'hui, alors que plus de vingt-quatre heures se sont écoulées depuis les dernières salves, que le général Blomberg et le maréchal Hindenburg l'ont félicité, que les foules allemandes ont accepté passivement les assassinats, il est sûr d'avoir vaincu. Une nouvelle fois. Sûr d'avoir eu cet œil d'aigle qui permet de faire au moment opportun, ni trop tôt ni trop tard, les choix importants : quand il faut décider de briser, en un seul coup, l'adversaire. La Providence l'a protégé, il est le Führer. Autour de lui, la soumission, l'exaltation de sa personne se confirment Carl Schmitt, le juriste nazi qui refait le droit et l'adapte selon les circonstances, n'hésitera pas à écrire, évoquant les événements des jours précédents : « L'acte accompli par le Führer est un acte de juridiction pure. Cet acte n'est pas soumis à la justice, il est lui-même la justice suprême. » Le Führer peut donc tout. Pour le Conseil des ministres du 3 juillet, le ministre de la Justice a préparé une loi dont l'adoption est certaine. Son article unique précise : « Les mesures exécutées le 30 juin, le 1er et le 2 juillet 1934 pour réprimer les atteintes à la sécurité du pays et les actes de haute trahison sont conformes au droit en tant que mesures de défense de l'Etat. »
Il n'est donc plus nécessaire de juger. Il suffit, si le Führer le veut, de tuer n'importe comment.
Quand le vice-chancelier est introduit dans la salle, Hitler se dirige vers lui, amical. « Comme il m'invitait à prendre ma place habituelle, raconte Papen, je lui déclarai qu'il n'en était même pas question et lui demandai un entretien entre « quatre yeux ». Les deux hommes passent dans une pièce voisine. Hitler semble compréhensif, bienveillant. Comme chaque fois qu'il a obtenu ce qu'il voulait, il paraît prêt à toutes les concessions et se présente comme l'homme de conciliation. Que lui importe puisque ses adversaires sont morts et que la Gestapo, avec réticence, rend aux familles ce qui reste d'eux : quelques cendres ?
« Je lui appris de façon fort sêche, continue Papen, ce qui s'était passé à la vice-chancellerie et chez moi et réclamai une enquête immédiate sur les mesures prises à l'encontre de mes collaborateurs ».
Le Führer se tait. Son silence peut tout signifier : qu'il ne savait pas, qu'il est prêt à ordonner une enquête, qu'il se moque de Papen ou qu'il approuve ses propos. Mais quand le vice-chancelier annonce qu'il démissionne, qu'il veut que l'on rende cette démission publique immédiatement Hitler s'insurge et refuse nettement.
« La situation n'est déjà que trop tendue, dit-il. Je ne pourrai annoncer votre démission que lorsque tout sera rentré dans le calme. En attendant ce moment voulez-vous au moins me faire le plaisir d'assister à la prochaine séance du Reichstag, où je rendrai compte de mon action ? »
Papen refuse à son tour. « Je ne vois pas la possibilité pour moi de m'asseoir au banc ministériel » dit-il.
Le Führer pourtant sur le point essentiel de la démission du vice-chancelier a obtenu ce qu'il désirait : la démission restera secrète. L'opinion ne saura rien des divergences entre le Chancelier et le vice-chancelier. L'unité du gouvernement du Reich, de Hindenburg à Papen, de Blomberg à Rudolf Hess, parait complète : Rœhm et les autres victimes ont été égorgés dans l'unanimité. C'est cette façade qui importe au Führer. Si Papen n'est pas à la séance du Reichstag, assis à son banc avec les autres membres du cabinet, il sera toujours temps d'aviser. La séance est fixée au 13 juillet à l'Opéra Kroll ; dans une dizaine de jours le sang aura séché.
LE CONSEIL DES MINISTRES DU 3 JUILLET.
Hitler rentre donc seul et tranquille dans la salle du Conseil des ministres. Le général Blomberg, Hess, Gœring, tous les ministres ont pris place autour de la longue table rectangulaire et Hitler, debout, les poings appuyés sur son dossier, va présenter sa version des événements.
Au fur et à mesure qu'il parle, la violence s'empare de lui. « Sous l'égide de Rœhm, dit-il, s'était formée une coterie unie par l'ambition personnelle et des prédispositions particulières... » La voix est chargée de mépris, de colère. Le Führer parle et comme chez tous les visionnaires, chez tous les hommes habitués à tromper souvent, il se pénètre peu à peu de sa vision, il finit par croire à ce qu'il dit, dont il a su pourtant qu'il s'agissait d'une supercherie. « Rœhm m'avait donné sa parole d'honneur à maintes reprises, continue-t-il, je l'avais constamment protégé et il m'a trahi, il a perpétré la plus horrible des trahisons à mon égard, moi, le Führer ». Rœhm assassiné ne peut être que coupable, il doit l'être, il l'est. « Rœhm avait des dispositions funestes... » Tout cela, Hitler le savait depuis de longues années, mais voici que c'est devenu insupportable. « Rœhm s'était entouré de gardes qui tous avaient subi de lourdes peines infamantes... » Le sang de Rœhm, en coulant, purifie le nazisme. « Et Rœhm voulait aussi trahir son pays... Des liaisons avaient été établies entre lui, Schleicher, M. von Alvensleben, Gregor Strasser et un diplomate français...» Hitler martèle les noms, les mots, il tue une seconde fois. En conséquence, conclut-il, lui, le Führer, a décidé une intervention immédiate dont le détail et les succès sont connus des membres du gouvernement.
Hitler s'assied. Son visage est couvert de sueur. Il vient de revivre la Nuit des longs couteaux, de jouer la scène du Justicier punissant la trahison, de répéter le grand discours à la Nation qu'il prépare. C'est le général Blomberg qui se lève pour lui répondre. L'officier est grave, digne, posé, calme. Il inspire, dans son uniforme sobre, avec ses décorations discrètes, le respect que l'on doit aux guerriers nobles et généreux, à la Reichswehr qui a le sens du devoir et de l'honneur.
« Je remercie, au nom du gouvernement, annonce Blomberg, le Chancelier qui, par son intervention décidée et courageuse, a évité au peuple allemand la guerre civile».
Une pause de Blomberg. Tous les visages sont tournés vers lui, et le Führer, les yeux fixes, regarde dans sa direction mais le voit-il ?
« Homme d'Etat et soldat, continue Blomberg, le Chancelier a agi dans un esprit qui a suscité chez les membres du gouvernement et dans l'ensemble du peuple allemand la promesse solennelle d'accomplir de grands exploits, de rester fidèles et de faire preuve de dévouement en cette heure si grave. »
Puis, c'est le ministre de la Justice qui souligne que le Führer a protégé le droit contre les pires abus, qu'il créait le droit de façon immédiate en vertu de son pouvoir de Führer et de juge suprême.
Le Führer paraît absent : il écoute, semble-t-il, un vague sourire sur les lèvres, ironique et méprisant. Ces généraux, ces juristes, ces aristocrates, tous ces hommes au col empesé, bourgeois, monarchistes, juges, professeurs, Junkers, diplomates, ils sont là, autour de lui, à l'approuver, à l'encenser dans leurs journaux. Et jusqu'à ce Monsieur Franz von Papen qui proteste et s'incline. Lui, Führer, il est d'une autre trempe, il sait, à l'aube, prendre un avion, frapper à la porte d'un ancien camarade, le revolver au poing. Il sait agir lui-même, et il s'emparera du pouvoir suprême, il remplacera le Vieux devant lequel il s'est incliné tant de fois humblement. Ce maréchal qui agonise et qui lui télégraphie ses remerciements.
Le Conseil des ministres du 3 juillet se termine et Hitler reconduit ses ministres jusqu'à la porte, respectueux des usages, en Chancelier du Reich qui estime ses collaborateurs.
Quelques heures plus tard, il reçoit Hermann Rauschning, ce président du Sénat de Dantzig, avec qui il aime à parler, à soliloquer. Là, dans son salon, avec quelques intimes, il se libère, évoque la mort prochaine du maréchal Hindenburg, le vieux. Les mots déferlent comme un torrent de violence, de détermination et de mépris.
« Ils se trompent.. Ils croient que je suis au bout de mon rouleau, commence Hitler. Ils se trompent tous. Ils ne me connaissent pas. Parce que je viens d'en bas, parce que je suis sorti de la « lie du peuple » comme ils disent parce que je manque d'éducation, parce que j'ai des manières et des méthodes qui choquent leurs cervelles d'oiseau. »
Hitler part d'un rire sonore. Ils : ce sont les Papen, les Blomberg, les Hindenburg, les autres, tous ces Junkers, ces élèves des Ecoles des Cadets, ces membres du Herrenklub. « Ah, si j'étais des leurs, je serais un grand homme, dès aujourd'hui. Mais je n'ai pas besoin qu'ils viennent me certifier ma capacité et ma grandeur. L'insubordination de mes S.A. m'a déjà coûté de nombreux atouts. Mais j'en ai encore d'autres en main. Je saurais encore m'en tirer si les choses allaient mal. »
Et le monologue continue, fascinant : Rauschning note mentalement et son effroi au fur et à mesure que le Führer parle augmente. Voilà des années qu'admis dans l'intimité de Hitler, considéré comme un allié inconditionnel il découvre le mécanisme d'un esprit en proie à la passion du pouvoir, que rien n'arrête et que chaque succès pousse plus avant dans la voie des certitudes et du mépris d'autrui. Hitler s'est levé, sa diatribe gagne encore en violence. « Ils n'ont pas la moindre vision des réalités, ces arrivistes impuissants, ces âmes de bureaucrates et d'adjudants ! »
Tous ces officiers supérieurs de la Reichswehr, ces membres hautains de l'Etat-major que leurs voitures officielles déposent ponctuellement devant les bâtiments gris de la Bendlerstrasse, les voici qualifiés d'un mot « adjudants » !
« Avez-vous remarqué, ajoute Hitler, comme ils tremblent comme ils s'humilient devant moi ? »
La satisfaction du Führer est intense : celle du parvenu qui tient à sa botte les hommes issus des lentes sélections hiérarchiques.
« J'ai bousculé leurs combinaisons. Ils s'imaginaient que je n'oserais pas, que je serais lâche. Ils me voyaient déjà pris dans leurs filets. J'étais déjà, pensaient-ils, leur instrument. Et derrière mon dos, ils se moquaient de moi, ils pensaient que j'étais fini, que j'avais perdu jusqu'à l'appui de mon parti. »
Et la joie éclate encore, qui plisse le visage en un sourire vengeur :
« Je leur ai donné une volée de bois vert dont ils se souviendront. Ce que j'ai perdu dans la purge des S.A., je le regagne en me débarrassant de ces conspirateurs féodaux, de ces aventuriers, des Schleicher et consorts. »
Ainsi, lucidement, le Führer tire parti de la situation : il a sacrifié des hommes qui avaient fait sa force — Rœhm, Strasser, et les S.A. —, mais il s'est débarrassé d'une autre menace venue de certains conservateurs : ces morts à « droite » et à « gauche », lui permettent de monter vers le pouvoir absolu.
« Le plan de ces beaux messieurs ne réussira pas, lance-t-il. Ils ne pourront pas, pour la succession du Vieux passer pardessus ma tête... Avancez donc, Messieurs Papen et Hugenberg, je suis prêt pour le round suivant. »
LE ROUND SUIVANT.
Papen sent ce mépris et devine les intentions du Führer derrière la façade respectueuse. Aussi essaie-t-il de lutter, de freiner. Après avoir annoncé à Hitler qu'il démissionnait, il s'est fait conduire à la Bendlerstrasse. Le ministère de la Guerre est toujours sévèrement gardé comme si un coup de main était à craindre : les chevaux de frise sont en place dans la cour et les sentinelles sont nombreuses et lourdement armées. Dans les couloirs, le vice-chancelier croise l'aide de camp du général Fritsch « une vieille relation de l'époque heureuse où je courais en obstacles, raconte Papen. Il avait l'air d'avoir vu un fantôme :
« — Seigneur ! s'exclama-t-il, que vous est-il arrivé ?
« — Comme vous voyez, je suis toujours bien vivant, grondai-je. Mais il va falloir mettre fin à cette Schweinerei (saloperie) ».
Le vice-chancelier est introduit auprès de Werner von Fritsch qui est son ami, mais le général ne peut que répéter ce qui s'est passé : l'assassinat de Schleicher et de sa femme. Pour le reste, que faire ?
« Fritsch admit, raconte Papen, que tout le monde désirait en effet l'intervention de la Reichswehr mais que Blomberg s'y était catégoriquement opposé ; quant à Hindenburg, chef suprême des forces armées, on ne pouvait arriver à le joindre. D'ailleurs, le Président était certainement mal informé de la situation. »
En fait Fritsch ne devait sûrement pas ignorer que des camions, des armes et des casernes de la Reichswehr avaient été prêtés aux S.S. Qu'à Munich, la Reichswehr avait encerclé la Maison Brune et les S.A., et que dans les mess d'officiers on avait, dans la nuit du lundi 2 juillet, sablé le Champagne pour célébrer la fin de Rœhm. Le Generalmajor von Witzleben avait même regretté, disait-on, que l'armée n'ait pu intervenir contre la racaille de la Sturmabteilung. « J'aurais voulu être de la partie », aurait-il lancé en levant son verre à l'avenir de l'armée allemande.
Les conservateurs de la Reichswehr ne peuvent donc rien, ils ont choisi l'alliance avec Hitler quand il était faible, et se félicitent de l'évolution de la situation. Papen peut bien écrire des lettres au Führer pour protester, demander la libération de ses collaborateurs arrêtés. Il peut le rencontrer : Hitler ne recule pas. Au contraire, le 13 juillet, face au Reichstag, dit-il au vice-chancelier, « j'assumerai devant la nation la responsabilité entière des événements. » Et Papen ne peut qu'écrire encore pour avertir le Führer qu'il n'assistera pas à la séance. Mais qu'importe ? L'Opéra Kroll est plein de tous les députés nazis : ceux qui ont été inquiétés, ceux qui ont eu peur sont là parmi les premiers, scandant d'applaudissements frénétiques le discours du Führer.
A côté de la place laissée vide par Karl Ernst, qui jamais ne verra Madère, le prince August Wilhelm de Hohenzollern, qui a été soumis à de rudes interrogatoires, qui a été Führer des S.A. et l'ami de Ernst, est là, dans son uniforme, manifestant l'enthousiasme le plus sincère. Il s'est dressé à plusieurs reprises quand Hitler a lancé — et la nation tout entière est à l'écoute et le Tiergarten est rempli d'une foule dense : « J'ai donné l'ordre de fusiller les principaux coupables et j'ai donné l'Ordre aussi de cautériser les abcès de notre empoisonnement intérieur et de l'empoisonnement étranger, jusqu'à brûler la chair vive. J'ai également donné l'ordre de tuer aussitôt tout rebelle qui, lors de son arrestation, essaierait de résister. »
Le prince Auwi applaudit à tout rompre et c'est à sa vie préservée qu'il applaudit et c'est la peur qui l'étreint qu'il exprime. Et combien comme lui sur les fauteuils rouges de la salle brillamment illuminée de l'Opéra Kroll ce 13 juillet ? Combien comme lui qui se renient, abandonnent jusqu'à la mémoire de leurs camarades abattus et s'inclinent devant la force triomphante du Führer ! Comment Hitler ne mépriserait-il pas de tels hommes prêts à de tels abandons ? Il les croit capables de tout, même si parfois il se trompe ou agit trop tôt.
Franz von Papen reçoit aussi dans cette première quinzaine de juillet la visite du docteur Lammers. C'est le secrétaire d'Etat du Chancelier, la discussion s'engage, courtoise. Lammers, de la part du Führer, propose à Papen le poste d'ambassadeur au Vatican. Naturellement, précise Lammers, si le montant des émoluments ne parait pas suffisant, Papen pourra lui-même fixer le chiffre qu'il jugera conforme à ses capacités. L'intention est claire, Hitler traite les hommes brutalement. Mais Papen, souffleté par la proposition, explose :
— Est-ce que le Führer et vous, croyez que l'on puisse m'acheter ? crie-t-il. C'est bien l'impudence la plus grossière que j'aie jamais entendue ! Allez dire cela à votre Hitler.
Et Papen montre la porte à l'envoyé de Hitler. Mais, moins d'un mois plus tard, il sera ambassadeur du IIIeme Reich à Vienne.
D'AUTRES MEURTRES.
Ce n'est pas l'or qui a séduit Papen. Une nuit, à la fin de juillet, le 26, des coups violents ébranlent la porte de sa villa. Trois S.S. sont là, menaçants dans l'ombre et depuis la Nuit des longs couteaux, Papen sait à quoi s'en tenir sur le respect des lois. Son fils, revolver au poing, va ouvrir. Mais les S.S. ne sont pas, cette nuit-là, des tueurs : ils annoncent seulement que le Führer qui est à Bayreuth, demande à Papen de l'appeler au téléphone d'urgence. Il est à peine 2 heures du matin. Tout cela paraît étrange. Papen est inquiet. « Ne s'agissait-il pas de quelque stratagème destiné à nous faire entrer dans la cabine téléphonique afin de nous expédier ensuite quelques rafales de mitraillette ? » s'est-il demandé.
Mais l'heure n'est pas encore venue pour Papen. Le Führer est au rendez-vous téléphonique.
— Herr von Papen, dit-il d'une voix nerveuse, il faut que vous partiez immédiatement pour Vienne comme mon ministre plénipotentiaire. La situation est alarmante. Vous ne pouvez refuser.
Papen ignore encore tout dans cette nuit de juillet de ce qui s'est déroulé à Vienne et qui n'est qu'une autre Nuit des longs couteaux. Les nazis autrichiens, dirigés par l'inspecteur du Parti nazi Habicht, viennent d'essayer de s'emparer du pouvoir et, comme c'est leur habitude, ils ont tué : le chancelier Dollfuss a été abattu sans hésitation.
25 juillet 1934 : moins d'un mois après les assassinats d'Allemagne, d'autres meurtres. A-t-on voulu forcer la main de Hitler ? Car il est étonnant, alors que le IIIeme Reich vient d'enregistrer la secousse de la liquidation de Rœhm, que le Führer engage, dans la lancée, l'entreprise risquée de l'Anschluss ? En fait, tout est curieux dans ces semaines où la Nuit des longs couteaux est encadrée par la rencontre avec Mussolini et l'assassinat de Dollfuss. A moins qu'il ne s'agisse d'un moyen imaginé par quelques Machiavels d'un clan politique ou militaire pour profiter d'une difficulté internationale afin de se débarrasser du Führer ou peut-être, tout simplement, se trouve-t-on en présence d'une action prématurée, aventureuse, de quelques nazis locaux ? C'est le plus probable.
Mais le putsch échoue et Mussolini rassemble des troupes sur la frontière des Alpes. Hitler doit reculer. Il apprend la nouvelle de l'assassinat de Dollfuss, alors que, dans l'extase, il écoute l’Or du Rhin à Bayreuth.
« Après la représentation, raconte Friedelind Wagner, qui était à ses côtés, le Führer était au comble de l'énervement... C'était terrible à voir. Bien qu'il pût à peine déguiser son exultation, Hitler prit soin de commander le dîner au restaurant comme les autres jours. "Je dois paraître en public, me montrer pendant une heure, dit-il, ou les gens croiront que je suis pour quelque chose dans tout ceci." »
Au fur et à mesure que les nouvelles arrivent de Vienne, le Führer s'assombrit. Quand il téléphone à Papen, il semble être un homme aux abois : « Nous sommes en présence d'un deuxième Sarajevo », crie-t-il d'une voix hystérique. Et pour sauver l'Allemagne d'un désastre il demande à Papen de le rejoindre à Bayreuth.
Là, Papen rencontre Hitler qui est entouré de Gœring, de Goebbels et de Hess. Les chefs nazis sont anxieux. Hitler « maudit la stupidité et la brutalité des nazis autrichiens qui l'ont placé dans une situation terrible ». Il supplie Papen d'accepter, pour l'Allemagne, le poste d'envoyé du Führer à Vienne. Et Papen s'incline et sert le nazisme. « En accédant à la requête de Hitler, écrit Papen, pour se justifier, je pouvais encore très probablement rendre un service à mon pays, à la condition toutefois d'obtenir au préalable des garanties précises ». Naturellement Hitler les accorde : il sait faire la part du feu. Ainsi ce n'est pas l'or qui a séduit Papen, mais une fois de plus l'idée que servir le Führer c'est aussi servir l'Allemagne. Déjà, en janvier 1933, au moment de la prise du pouvoir, le patriotisme avait été la grande excuse : en juillet 1934, elle sert à nouveau. Et pourtant, le Reichstag a brûlé, et pourtant les baraques de bois des camps de concentration ont été construites à Dachau et à Buchenwald, pourtant Schleicher, Jung, Bose et Klausener ont été assassinés et dans la Nuit des longs couteaux le visage du nazisme est apparu sans masque. Visage brutal de tueur implacable. Et Papen n'ignore rien de cela.
Tschirschky est rentré de Dachau avec sa tête rasée et Papen, au cimetière, a prononcé devant Frau Bose et ses enfants un éloge de son collaborateur, abattu sans sommation comme le font les gangsters. Mais Papen s'incline et sert le Führer parce qu'il veut croire servir l'Allemagne. Il sait aussi que partir à Vienne — et plus tard il partira comme ambassadeur de Hitler à Ankara — c'est se mettre à l'abri. Et, dans le comportement de chaque Allemand il y a, comme chez Papen, ce mélange de peur et d'illusion qui fait finalement la force du Führer et du nazisme.
LA REICHSWEHR NAZIE.
Pour Papen, le sang de Bose ou de Jung a donc séché vite. Comme a séché vite, pour la Reichswehr, le sang des généraux Schleicher et Bredow.
Le 15 juillet, se déroulent, dans la campagne épanouie au nord de Berlin, les grandes manœuvres de l'armée. Les nouvelles unités se montrent particulièrement efficaces, bien entraînées, équipées d'un matériel neuf. L'attaché militaire français est impressionné, l'armée allemande redevient rapidement une force. Surtout, elle se rallie en bloc, sans réticence, à Hitler. « Les sentiments qu'ont montrés les officiers allemands qui étaient avec nous, écrit à Paris l'attaché militaire, aussi bien ceux du ministère avec qui nous vivions que ceux de la troupe que nous avons pu interroger semblaient unanimes : c'était une approbation nette de l'action conduite par Hitler. On les sentait pleinement satisfaits du triomphe de la Reichswehr. »
Car, pour eux, la Nuit des longs couteaux c'est cela : la victoire du général von Blomberg sur Rœhm. Ils veulent oublier le rôle des S.S., exécuteurs des basses besognes. Sans doute pensent-ils qu'ils ont habilement réussi à utiliser l'Ordre noir pour vaincre un adversaire et qu'ils sont restés ainsi, intégres, fidèles au code de l'honneur de la Reichswehr. Après tout, ce ne sont pas des soldats qui ont abattu Schleicher ou Rœhm ! Les officiers sont définitivement séduits : Hitler les flatte. Hitler a plié ce qui reste de la S.A. à leur autorité et c'est le général Reichenau qui, sur le plan militaire, est chargé de réorganiser les Sections d'Assaut Alors, ils se rallient à Hitler.
« Un officier de la Reichswehr dont je connais bien les sentiments antinationaux-socialistes, écrit l'attaché militaire français, m'a dit et a répété à plusieurs de mes collègues : "L'an dernier, la Reichswehr était peut-être nazie à 60 % ; il y a quelques semaines, elle ne l'était sans doute que pour 25 % ; aujourd'hui elle l'est à 95 %". »
Et les soldats, endoctrinés par leurs officiers, par les proclamations de von Blomberg suivent et même vont au-delà des sentiments de leurs officiers. Vers la mi-juillet Hitler qui assiste à une phase des manœuvres, remonte en voiture le long d'une colonne de fantassins. C'est le plein été. La voiture du Führer est découverte. Les soldats, sous leur casque lourd, transpirent. Tout à coup des rangs de la troupe en marche, des cris d'enthousiasme s'élèvent ; on a reconnu le Führer, et de file en file les acclamations se prolongent rudes et viriles, issues de cette jeunesse en armes. Après avoir évoqué cet épisode avec des officiers de la Reichswehr, l'attaché militaire français conclut : « Cette manifestation spontanée d'enthousiasme n'est pas habituelle dans l'armée allemande, elle a frappé les officiers eux-mêmes. »
LA MORT DE HINDENBURG.
Hitler l'emporte donc dans le cœur même des hommes : la jeunesse le suit, l'armée l'approuve, il tient le Parti, les S.S., les S.A. Il gagne. Et bientôt, couronnement, commence l'agonie du Reichspräsident, le maréchal Hindenburg. Ainsi, dans cet été 1934, les événements se succèdent rapidement, comme si l'histoire changeait de rythme, rapprochant symboliquement les faits, sans pour autant réussir à ouvrir les yeux des hommes qui — à Berlin, à Paris ou à Londres — ne veulent pas voir. L'agonie commence et le testament que Hindenburg a rédigé — sous l'influence de Papen — et qui doit conduire à une restauration de la monarchie est lettre morte avant même que ne s'achève la vie de Hindenburg.
A la hâte, un Conseil de cabinet se réunit à la Chancellerie le 1er août, sous la présidence de Hitler. Et il donne son accord à la proclamation d'une loi — dès le décès du Vieux — qui prévoit le cumul des fonctions de Président et de Chancelier. Frémissant de ce triomphe enfin si proche Hitler se rend à Neudeck. Le silence enveloppe les vastes bâtiments et la brise est tombée. Les visages disent la mort qui vient, inéluctable. Le vieux monsieur est allongé sur son lit dur et austère de soldat prussien. Le Führer est introduit auprès de l'agonisant par Oskar von Hindenburg.
— Père, voici le Chancelier, répète le fils du maréchal.
— Pourquoi n'êtes-vous pas venu plus tôt ?
Hindenburg ouvrant les yeux reconnaît dans la personne du Chancelier, Hitler. « Probablement, écrit Papen, il avait cru jusqu'à ce moment-là, que le chancelier arrivé de Berlin, s'appelait von Papen. » Mais peu importe au Führer l'humiliante méprise. Hindenburg va mourir et rien ne pourra empêcher que le nouveau président du Reich soit le Führer.
Le 2 août des salves d'artillerie, tirées régulièrement annoncent que vient de s'éteindre, à 9 heures du matin, le combattant de Sadowa et de Sedan. Ce vieux Prussien qui avait assisté, dans la galerie des Glaces à Versailles, à la proclamation de l'Empire d'Allemagne, le Maréchal Hindenburg, Président du Reich. Papen se rend immédiatement à Neudeck et, laissé seul dans la chambre mortuaire, il se recueille devant le vieux maréchal qui « reposait sur un lit de camp Spartiate, les mains jointes sur une bible, le visage empreint de la sagesse, de la bonté, de la résolution que j'avais tant vénérées. »
Quelques heures à peine après l'annonce de la mort alors que déjà s'organisent au mémorial de Tannenberg les funérailles, que le nazisme va ainsi utiliser la mort du Président pour mettre en scène l'une de ces cérémonies de masse, impressionnantes, où les foules communient et abdiquent leur autonomie, la loi accordant au Führer les prérogatives du Président est promulguée. Et quand Papen apporte au Führer la lettre de Hindenburg qui fait figure de testament du vieux Président, Hitler déclare : « Notre regretté Président m'a destiné cette lettre à moi personnellement. Je déciderai plus tard, si, et à quel moment je puis autoriser sa publication ». Papen ne peut que supplier, plaider pour une publication immédiate, puis finalement s'incliner. Que pourrait-il faire d'ailleurs ? Le président Hindenburg est mort à 9 heures le 2 août ; la loi faisant de Hitler son successeur a été, en fait adoptée dès le 1er août au soir et à 9 h 30 la Reichswehr a prêté serment au nouveau chef de l'Etat.
Ainsi le scénario peut-être réglé sur le croiseur Deutschland, dans les brumes de la Baltique, a-t-il été respecté : Rœhm est mort et Hindenburg mort Hitler remplace le Président du Reich. Les journaux du soir paraissent encadrés de noir. Ils donnent les états de service du Maréchal défunt et souvent ils répètent le premier vers du beau chant du souvenir de l'armée allemande :
« Ich hatt' einen Kameraden ! »
Les officiers publient des études sur le passé héroïque de leur chef disparu et, en même temps, les journaux communiquent le texte du nouveau serment que le général von Blomberg impose à tous les membres de la Reichswehr.
« Je fais, devant Dieu, le serment sacré d'obéissance absolue au chef du Reich et peuple allemand, Adolf Hitler, chef suprême de la Wehrmacht. Je jure de me conduire en brave soldat et d'être toujours prêt à sacrifier ma vie plutôt que de rompre ce serment »
Ce même 2 août dans toutes les unités, les officiers et les soldats ont commencé de prêter serment. Tendant le bras, la main ouverte, ils jurent, leurs officiers d'abord, puis par groupes, la fidélité au Führer. Les cours de casernes retentissent du claquement des talons des soldats, des phrases solennelles répétées avec la voix sonore des commandements militaires.
Les jeunes soldats impressionnés, la gorge serrée, mêlent leurs mains au-dessus des étendards. Pour eux, pour beaucoup d'officiers qui ont grandi dans la conviction que la parole donnée est intangible, ce serment est un lien qu'ils ne sauront jamais briser. Ou derrière lequel ils s'abriteront pour continuer d'obéir aveuglément.
Ainsi Hitler a-t-il gagné le deuxième round comme il le prédisait à Rauschning et quand, le 2 août au soir, il reçoit le télégramme de Blomberg lui annonçant que « les officiers, sous-officiers, et soldats de toute la Wehrmacht ont solennellement prêté serment au Führer et chancelier du Reich, devenu chef suprême de la Wehrmacht » il sait qu'il l'a définitivement emporté. Qu'il a eu raison, dans cette nuit rhénane, de décider, seul, de s'envoler pour Munich, qu'il a eu raison de frapper, revolver au poing, contre la porte de Rœhm et de laisser abattre ses vieux camarades.
Il ne lui reste plus qu'à présider les obsèques de Hindenburg, qu'à marcher derrière le cercueil du vieux soldat sur lequel s'inclinent les centaines de drapeaux et de bannières de tous les régiments du Reich, qu'à proclamer dans une langue prophétique que Hindenburg va entrer au « Walhalla », qu'à organiser le plébiscite pour faire approuver par 88 % des Allemands, le 19 août, la loi — déjà en vigueur ! — qui fait de lui le chef de l'Etat. Le 20 août, il peut enfin adresser au général Blomberg une lettre de remerciements. L'armée a tenu parole en lui prêtant serment. Elle n'a pas affaire à un ingrat.
« De même que les officiers et soldats, écrit Hitler, se sont engagés vis-à-vis du nouvel Etat représenté par moi, je considérerai toujours comme mon devoir le plus sacré de défendre l'existence et l'intangibilité de la Wehrmacht et, pour exécuter le testament de feu le maréchal et rester fidèle à ma propre volonté, d'ancrer solidement l'armée dans son rôle unique d'organisme militaire de la Nation. »
Le Führer peut alors savourer son triomphe et c'est à Nuremberg, le 4 septembre, qu'a lieu sa célébration. Les morts, les assassinés de la Nuit des longs couteaux sont bien oubliés. Au Luitpold Hall de Nuremberg, dans l'immense salle décorée de milliers de drapeaux à croix gammée, Hitler avance dans l'allée centrale ; les musiques jouent le Badeniveilermarsch, les mains se dressent pour le salut nazi, les cris montent : Heil Hitler ! Heil Hitler ! Sieg Heil ! Le Fhrer marche lentement vers l'estrade ; qui se souvient de cette aube grise de Munich-Oberwiesenfeld, des forêts traversées pour gagner Bad Wiessee ? Adolf Wagner peut-être, dans le bureau de qui, le samedi matin 30 juin 1934, Hitler avait insulté, bousculé, envoyé à la mort Schneidhuber ? Mais Wagner est ici, aux côtés de Hitler. C'est lui qui lit la proclamation qui ouvre le Congrès du Parti nazi :
« La forme de vie allemande est définitivement fixée pour les mille ans à venir. L'âge des nerfs du XIXeme siècle s'est clos avec nous. Il n'y aura pas d'autre révolution en Allemagne pendant les mille ans à venir. »
Et, pour la première fois, le haut commandement de la Reichswehr, les Etats-majors des grandes unités sont là, présents, aux côtés du Führer, à ce Congrès du Parti. Dizaines et dizaines d'officiers de tradition, raides dans leurs uniformes, impassibles, assistant au Congrès du Parti, à la journée qui, au sein de ce congrès est consacrée à une revue et à des exercices militaires ; l'armée officiellement liée au Parti. L'armée qui croit, après la Nuit des longs couteaux, avoir gagné la première place dans le IIIeme Reich, le Reich millénaire de Adolf Hitler. Dans Nuremberg pavoisée, les officiers supérieurs regagnent leurs hôtels ou les casernes où certains d'entre eux sont hébergés. Le soir alors que retentissent dans les rues les chants de jeunesses hitlériennes, ils boivent à l'Allemagne éternelle et à la nouvelle Wehrmacht qui, dans le nouveau Reich, comme jadis, l'armée de Prusse, reste l'âme inaltérable de la patrie.
CES MEMES HOMMES, UNE AUTRE NUIT.
30 juin 1934. 20 juillet 1944.
Autre temps, autre nuit, dix ans à peine. Aux corps de Rœhm, de Schleicher, de l'innocent critique musical de Munich, Wilhelm Eduard Schmidt, tant d'autres corps, des millions, se sont ajoutés ! La Gestapo et les S.S. ne remettent plus les cendres de leurs victimes aux familles. Elles s'envolent dans le ciel bas de Dachau, de Buchenwald ou d'Auschwitz. Autre temps, autre nuit : Hitler, depuis son quartier général, la Wolfsschanze, sa tanière de loup, Hitler parle à la nation allemande :
« Je m'adresse aujourd'hui à vous, d'abord pour que vous entendiez ma voix et sachiez que je suis indemne et en bonne santé, ensuite pour vous apprendre le crime le plus monstrueux de l'histoire allemande. Une petite clique d'officiers ambitieux, aussi irresponsables que stupides, a formé un complot pour m'éliminer, moi et le haut commandement des forces armées. La bombe placée par le comte von Stauffenberg a explosé à deux mètres de moi... Je n'ai reçu que quelques égratignures, contusions et blessures. Je considère cela comme une confirmation de la tâche que m'a confiée la Providence... Cette fois, nous allons leur régler leur compte de la façon qui nous est coutumière, à nous nationaux-socialistes ! »
Et c'est une nouvelle Nuit des longs couteaux : dans le Reich en ruine, on traque et on tue. 4980 personnes au moins sont exécutées. Des milliers sont envoyées dans les camps de concentration. S.S., Gestapo, S.D., ces forces qui avaient surgi dans la nuit du 30 juin 1934, elles sont toujours là, cent fois plus puissantes, nourries de l'expérience de tant de crimes. Et leurs victimes ce 20 juillet, ce sont les officiers qui avaient cru vaincre le 30 juin 1934.
Voici le maréchal du Reich Erwin von Witzleben. Il avait, dans la nuit du 2 au 3 juillet 1934 célébré la victoire de la Reichswehr sur les S.A. et regretté de ne pas avoir participé à l'action. Maintenant il est dans le box des accusés. Il n'a même pas droit à une ceinture pour retenir son pantalon. Et le juge du Parti, Freisler, lui crie : « Ne tiraillez donc pas sans cesse votre pantalon, Witzleben. C'est dégoûtant. Ne pouvez-vous pas le tenir ? »
Witzleben, Hoepner, Stieff, Hagen, Hase, Bernardis, Klausing, York von Wartenburg, tous officiers de la Wehrmacht, généraux, commandants en chef ou lieutenants, tous promis au bourreau, au supplice. Pendus avec une corde à piano qui serre lentement, tue en sept ou douze minutes parce que le supplicié est étranglé comme au garrot Et les opérateurs sont là qui filment sur l'ordre du Führer cette interminable agonie. Un drap noir dissimule les visages, mais on a laissé les jambes visibles pour que les spectateurs puissent assister aux soubresauts des victimes. Tous officiers de la Reichswehr.
Ces mêmes hommes qui avaient laissé, un 30 juin 1934, assassiner d'autres hommes, Schleicher, Bredow, Klausener, qui avaient prêté serment à Hitler et qui, révoltés d'une autre nuit, dix ans plus tard, alors que gisaient sur toutes les terres d'Europe des millions de victimes, connaissaient à leur tour la mort « de la façon qui nous est coutumière, à nous nationaux-socialistes » avait dit le Führer.
Ils avaient cru, dans cette Nuit des longs couteaux, gagner la partie, comme d'autres — les Papen, les Hindenburg — avaient cru la gagner le 30 janvier 1933 oubliant que le nazisme ne pouvait se tenir à bout de bras comme un épervier docile et aveuglé, qui une fois lâché et accomplie sa chasse, sa nuit de meurtres, revient se poser sur le poing. Ils n'avaient pas compris que le nazisme, nourri de tous les ferments anciens, puisant sa force destructrice dans les mythologies violentes, cherchant et utilisant dans chaque homme la zone sombre où se terrent les instincts refoulés, que le nazisme, cet ordre nouveau, avec ses emblèmes, ses cris, ses parades, ses tueurs, était la barbarie surgie du passé millénaire et décuplée par les inventions du siècle. Et que la barbarie n'a d'autre fin qu'elle-même.
Paris-Nice 1969-1970
ANNEXES
I — EXTRAITS DU DISCOURS DU MINISTRE D'ÉTAT ET CHEF D'ÉTAT-MAJOR ERNST RŒHM AU CORPS DIPLOMATIQUE ET A LA PRESSE ÉTRANGÈRE A BERLIN, LE 18 AVRIL 1934
La nouvelle Allemagne nationale-socialiste sous le signe de la croix gammée n'a pas que des amis dans le monde. On a beaucoup parlé, on a beaucoup écrit à son sujet... Dans leur ensemble ou presque les étrangers n'ont compris ni le sens ni la nature de la révolution allemande. On oublie presque toujours qu'il ne s'agit pas d'un changement de main du pouvoir politique. Non ! C'est le surgissement d'une nouvelle conception du monde.
... La révolution nationale-socialiste signifie la rupture spirituelle avec la pensée de la grande révolution française de 1789.
Cette pensée, qui ne tient compte que des éléments mesurables et dénombrables, a vu se dresser contre elle dans le national-socialisme une nouvelle forme de l'idéalisme devant lequel la démocratie n'éprouve que désarroi, parce que par une nécessité naturelle elle est incapable d'en saisir le principe intérieur.
A la place des valeurs de la démocratie, le national-socialisme a mis des forces que l'on ne peut mesurer avec l'aune et la balance, que l'on ne peut comprendre uniquement par raison et calcul, les forces de l'âme et du sang.
L'univers moral du national-socialisme et celui de la démocratie se situent donc à deux niveaux conceptuels différents...
Je vais vous parler de la S.A. La S.A. est l'héroïque incarnation de la volonté et de la pensée de la révolution allemande. On ne peut comprendre la nature et la tâche de la S.A. que si l'on comprend la nature et les buts de la révolution nationale-socialiste...
La révolution allemande a commencé par détruire les formes intérieures de la République de Weimar. A la place du système rouge et noir de novembre, elle a institué le régime national-socialiste dont elle a fait l'incarnation de l'autorité politique de l'Etat.
Mais comme conception du monde — et le but premier et dernier de notre combat durant toutes ces années a été d'imposer intégralement une nouvelle conception du monde — le national-socialisme n'est pas un problème constitutionnel et il n'existe pas entre lui et la forme terrestre de l'Etat, quel qu'il soit, de rapport causal...
La S.A., répétons-le, est l'incarnation héroïque de la volonté et de la pensée de la révolution nationale-socialiste.
La révolution nationale-socialiste est un processus de pédagogie morale. Il y a longtemps qu'il a commencé et il ne sera terminé que lorsque le dernier Allemand représentera et confessera, par ses actes et ses pensées, le national-socialisme.
Lorsque Hitler a commencé son combat c'était un soldat... Le combat, le combat et encore le combat voilà ce qui a marqué sa vie. Aussi, il allait de soi que dans cette lutte il soumette ses auxiliaires à des impératifs militaires.
Pour garantir l'exécution cohérente de la ligne politique de sa volonté, il a ainsi édifié l'armée brune de la révolution sur deux piliers solides : l'autorité du chef et la discipline.
Une seule décision du S.A. est volontaire : celle d'entrer dans les rangs des troupes d'assaut de la rénovation allemande. Dès l'instant où il revêt l'uniforme brun, il se soumet sans restriction à la loi de la S.A.
Celle-ci est :
« Obéissance jusqu'à la mort au chef suprême de la S.A. : Adolf Hitler. Mes biens et mon sang, ma force et ma vie, tout ce que j'ai appartient à l'Allemagne. »
Dès le début Hitler n'a pas lutté pour des buts mesquins... Dès le premier jour, quand sept hommes sans nom, sans alliés, sans journaux, sans argent songèrent à relever l'Allemagne de ses ruines, ce qui était en jeu, c'était le pouvoir tout entier.
Dans ce combat, son arme fut la SA.
Ce n'est pas une bande de conjurés intrépides mais une armée de croyants et de martyrs, d'agitateurs et de soldats qu'il lui fallait dans cette lutte gigantesque dont l'enjeu était l'âme du peuple allemand.
Comme ces tâches l'exigeaient, Adolf Hitler a créé un type nouveau de combattant: le soldat d'une idée politique. A ses soldats politiques, il a donné le drapeau rouge à croix gammée, symbole nouveau de l'avenir allemand, il a donné la chemise brune que revêt le S.A. dans le combat, les honneurs et dans la mort.
Par l'éclat de la couleur, la chemise brune distingue pour tous le S.A. de la masse. C'est dans ce fait qu'elle trouve sa justification : elle est le signe distinctif du S.A. ; elle permet à l'ami comme à l'ennemi de reconnaître au premier coup d'œil celui qui professe la conception du monde national-socialiste.
... La S.A. est l'incarnation du national-socialisme. A coups de poing, la S.A. a ouvert à l'idée nationale-socialiste la voie qui mène à la victoire. Et dans sa marche, la S.A. a entraîné les sceptiques, les hésitants au milieu de cette prodigieuse levée en masse de la nation.
L'assaut de la vague brune sous le signe de la croix gammée ne cessait de crier aux attentistes : Viens avec nous, camarade !
Des centaines de milliers de travailleurs n'auraient pas retrouvé le chemin de la patrie s'il n'y avait pas eu la S.A... C'est la S.A. qui les a enlevés à la rue, à la faim, et au chômage. Les bataillons bruns ont été à l'école du national-socialisme. Car dans leurs rangs il n'y a ni privilège de naissance, de rang ou de fortune : seuls comptent l'homme et les services qu'il a rendus au mouvement.
Aujourd'hui, l'Etat national-socialiste repose sur des bases solides. Par millions, les soldats politiques du national-socialisme veillent sur le nouvel Etat qui est leur Etat.
... Malheureusement à la suite de la révolution nationale-socialiste des cercles réactionnaires se sont accrochés à nos chausses. Certes, ils se sont « alignés », ils ont même piqué à leurs revers la croix gammée en affirmant vivement qu'ils avaient toujours été des nationaux.
Mais nous n'avons pas fait une révolution nationale, mais une révolution nationale-socialiste et nous mettons l'accent sur le mot socialiste... Par une inconcevable clémence, le nouveau régime, quand il a pris le pouvoir, n'a pas éliminé impitoyablement tous les représentants de l'ancien système et de celui qui l'avait précédé... Nous leur tordrons le cou et sans le moindre mouvement de pitié s'ils osent mettre en pratique des convictions réactionnaires.
Réactionnaires, conformistes bourgeois, spécialistes du dénigrement, tous par disposition naturelle d'esprit, considèrent la révolution comme une monstruosité. Il est vrai en revanche que nous avons envie de vomir lorsque nous pensons à eux.
Mais, rempart inébranlable de la révolution, la S.A. se dresse contre la réaction, le dénigrement et le conformisme. En elle est incarné tout ce qui fait l'esprit de la révolution.
Dans les années de lutte, la chemise brune était costume d'apparat. Elle était aussi linceul. Après la victoire, elle est devenue le symbole de l'unité nationale-socialiste, elle est devenue le costume de l'Allemand et le restera.
L'ordre et la discipline de la S.A. ont été tout d'abord une nécessité. C'est la S.A. qui faisait l'unité des forces révolutionnaires qui, à l'origine, ne constituaient qu'un agrégat mal lié. Plus tard, la S.A. est devenue un instrument d'éducation et le ciment de la communauté nationale qui ne peut subsister si l'individu ne se soumet en tout.
Aujourd'hui, elle est l'expression du nouveau style de vie allemand. Ayant son origine dans la S.A., il s'impose à toutes les formes de la vie en Allemagne.
La S.A. c'est la révolution nationale-socialiste !
II — EXTRAITS DU DISCOURS PRONONCÉ PAR LE CHANCELIER HITLER DEVANT LE REICHSTAG A L'OPÉRA KROLL LE 13 JUILLET 1934 A 20 HEURES
Députés,
Hommes du Reichstag allemand,
A la demande du gouvernement, votre président, Hermann Gœring, vous a convoqués aujourd'hui pour me donner la possibilité devant ce forum le plus qualifié de la nation, de donner au peuple des éclaircissements sur des événements qui, je le souhaite, demeureront, pour l'éternité, dans notre histoire, un souvenir aussi plein d'enseignements qu'il l'est de tristesse.
Par suite d'une série de circonstances et de fautes personnelles, de l'insuffisance de certains hommes, des dispositions de certains autres, une crise a éclaté au sein de notre jeune Reich ; elle n'aurait pu avoir que trop facilement, dans un avenir assez rapproché, des suites véritablement destructrices. Exposer devant vous, et ainsi devant la nation, la naissance et le développement de cette crise est le but de mon discours. Mon exposé sera franc et sans ménagement. Il faudra toutefois que je m'impose certaines réserves — et ce seront les seules — celles qu'impose le souci de ne pas franchir les limites tracées par le sentiment de la pudeur.
Lorsque le 30 janvier 1933, le Maréchal Président du Reich von Hindenburg me confia la direction du nouveau gouvernement allemand qui venait d'être constitué, le Parti national-socialiste prenait la charge d'un Etat qui, aussi bien au point de vue politique qu'au point de vue économique, était en pleine décadence. Toutes les formations politiques de l'époque passée avaient contribué à cette décadence et en portaient donc leur part de responsabilité. Depuis que l'empereur et les princes allemands avaient été congédiés, le peuple allemand s'était trouvé livré à des hommes qui, en tant que représentants du monde des partis, avaient sciemment provoqué cette décadence, ou l'avaient acceptée par faiblesse. Des révolutionnaires marxistes aux nationalistes bourgeois, en passant par le centre catholique, tous les partis et leurs chefs avaient démontré leur incapacité à gouverner l'Allemagne.
Le 30 janvier 1933 n'a donc pas marqué la simple transmission de pouvoirs d'un gouvernement à un autre gouvernement mais la liquidation définitive, à laquelle toute la nation aspirait, d'un état de choses insupportable.
Préciser ces faits est nécessaire parce que (les événements l'ont montré) dans certaines têtes il semble avoir été oublié que l'on a eu jadis toute possibilité de manifester ses capacités politiques. Personne en Allemagne ne pourrait reprocher au mouvement national-socialiste d'avoir barré le chemin à des forces politiques dans lesquelles on pouvait encore placer de l'espoir.
Pour des raisons impénétrables, le destin a condamné notre peuple à servir pendant quinze ans de champ d'expérience et de cobaye aux politiciens de toutes sortes.
Il fut peut-être intéressant et amusant pour notre entourage de suivre ces expériences, mais, pour le peuple allemand, elles furent aussi douloureuses qu'épuisantes. Que l'on se rappelle cette époque et l'on évoquera tous ceux qui tour à tour se succédèrent comme chanceliers du Reich. Nous, nationaux-socialistes, avons le droit de ne pas figurer dans leur série. Le 30 janvier 1933 l'on n'a pas formé comme tant de fois auparavant, un nouveau ministère ; un nouveau régime, à cette date, a rejeté de côté une époque périmée.
Cet acte historique que fut la liquidation de la période la plus triste qui nous ait précédés dans la vie de notre nation a été légitimé par le peuple allemand lui-même. Car nous n'avons pas, comme les hommes de novembre 1918, pris possession du pouvoir en usurpateurs ; nous l'avons pris par les moyens légaux. Nous n'avons pas, comme des anarchistes sans scrupules, fait une révolution, mais, comme exécuteurs de la volonté de la nation, nous avons rejeté le régime que nous avait donné une émeute. Nous n'avons pas cru devoir assurer notre pouvoir grâce aux baïonnettes ; nous l'avons ancré dans les coeurs de nos compatriotes.
Si aujourd'hui je lis dans un certain journal étranger que je suis plein de préoccupations, et, surtout actuellement très inquiet de la situation économique, je n'ai à donner qu'une réponse à ce barbouilleur de papier : oui, j'ai des soucis mais j'en ai depuis toujours ; c'est parce que nous avions souci de notre peuple que nous l'avons défendu lorsque lui fut imposée une guerre dont il n'était en rien responsable; plus tard, après le désastre, ce sont des préoccupations encore plus graves qui ont fait de nous des révolutionnaires. Et enfin, quand après quinze ans nous avons pris la direction du pays, nos soucis et nos préoccupations ne nous ont pas abandonnés. Au contraire. On doit me croire quand je déclare que je n'ai encore jamais eu souci de moi-même, mais que depuis que la confiance du Maréchal m'a placé là où je suis, je sens tout le poids du souci que me donne la vie présente et l'avenir de notre peuple. Car le 30 janvier nous n'avons pas pris possession d'un Etat sain et en ordre mais d'un chaos économique et politique que ceux-là mêmes qui me critiquent aujourd'hui considéraient et proclamaient alors irréparables. Quant à nous, nous avons osé engager la lutte sur tous les terrains contre un destin qui paraissait inexorable.
L'enseignement d'une année et demie de gouvernement national-socialiste est significatif et clair. Celui qui veut être juste doit comparer notre réussite avec ce qui serait arrivé si nous n'avions pas vaincu. Car c'est seulement celui qui voit encore où allait le pays avant le 30 juin qui peut mesurer la grandeur de notre œuvre ; non contents d'arrêter le cours du destin, nous avons pu le redresser dans tous les domaines.
Lorsque que je me suis installé comme Chancelier à la Wilhelmstrasse, l'autorité gouvernementale n'était plus qu'un mythe... Aujourd'hui le Reich allemand n'est plus seulement une région géographique mais aussi une entité politique. Nous avons engagé le destin de notre peuple dans une voie qui, il y a deux ans, paraissait impossible à atteindre. Et, de même qu'à l'intérieur nous avons solidement assuré l'unité et par là même l'avenir du peuple allemand, nous avons à l'extérieur su faire valoir ses droits.
Mais il ne nous a pas suffi d'arracher le peuple à ses déchirements politiques. Après six mois de régime national-socialiste, notre vie politique ancienne, nos querelles de partis étaient oubliées. Chaque mois, le peuple allemand s'éloignait davantage de cette époque qui nous est devenue incompréhensible. Je n'ai pas besoin d'insister ; chaque Allemand s'en rend compte aujourd'hui : la simple pensée d'un retour au régime des partis est aussi inconcevable qu'absurde.
En face de cette Allemagne positive, de cette incarnation de toutes les valeurs qui y existent, il y avait, naturellement aussi quelque chose de négatif.
A l'œuvre d'assainissement et de relèvement de l'Allemagne ne prennent aucune part :
1) La petite équipe des désagrégateurs internationaux qui, en leur qualité de champions du communisme doctrinal politique et économique, luttent contre tout ce qui est ordonné et s'efforcent de provoquer le chaos. Nous voyons autour de nous les preuves qui rendent manifeste l'action de cette conjuration internationale. Çà et là, de pays en pays, montent les flammes de l'insurrection. Des incidents de rue, des combats de barricades, des paniques ou l'intervention de la propagande individuelle dans un but de destruction troublent aujourd'hui presque tous les pays du monde.
En Allemagne aussi quelques fous ou criminels isolés essayent encore de développer leur activité néfaste. Depuis la disparition du Parti communiste, nous enregistrons, bien qu'elles deviennent de plus en plus faibles, une tentative après l'autre de fonder et de rendre agissantes des organisations communistes à caractère plus ou moins anarchisant.
La méthode est toujours la même. Alors qu'ils présentent notre destin actuel comme insupportable, ils font l'éloge du paradis communiste de l'avenir et n'aboutissent, en réalité, qu'à faire combattre pour un enfer. Car les conséquences de leur victoire dans un pays comme l'Allemagne seraient plus destructives que tout. Heureusement le peuple allemand est maintenant si bien renseigné sur leur compte que l'immense majorité des ouvriers allemands s'est débarrassée de ces juifs internationaux « bienfaiteurs de l'humanité ». Si c'est nécessaire, l'Etat national-socialiste livrera une guerre intérieure de cent ans pour extirper et exterminer les derniers restes d'un mouvement qui répand dans le peuple le poison et la folie.
2) Le second groupe de mécontents est composé de ces chefs politiques qui ont vu le 30 janvier mettre fin à leurs perspectives d'avenir et qui n'ont pas pu se résigner à admettre que ce fait était irrévocable. Plus le temps passe leur apportant la grâce de l'oubli, plus ils se croient en droit de se rappeler peu à peu au souvenir de la nation. Mais comme leur incapacité n'était pas due seulement aux circonstances, qu'elle était innée chez eux, ils sont incapables aujourd'hui encore, de démontrer leur valeur en effectuant un travail utile ; ils croient leur tâche remplie quand ils se sont livrés à une critique aussi perfide que mensongère. L'Etat national-socialiste ne peut vraiment être ni menacé ni gêné, en quelque manière, par ces gens-là.
3) Un troisième groupe d'élements destructeurs est constitué par cette espèce de révolutionnaires qui, en 1918, ont perdu leur situation et n'ont trouvé d'autre situation que d'être révolutionnaires. Installés dans la révolution, ils voudraient en faire un état permanent. Nous avons tous souffert de ces heures tragiques pendant lesquelles nous autres soldats disciplinés et fidèles à leur devoir, nous sommes trouvés en présence de mutins qui prétendaient être devenus l'Etat. Tous nous avions été élevés dans le respect des lois et habitués à obéir aux représentants de l'Etat... Mais nous ne pouvions tenir compte de ces usurpateurs. Notre honneur nous commanda de leur refuser l'obéissance et ainsi nous sommes devenus des révolutionnaires mais, même comme révolutionnaires, nous ne nous considérions pas comme libérés de l'obligation de respecter les lois naturelles imposées par la puissance souveraine de notre peuple. Et lorsque, enfin, nous avons été légitimés par la confiance de ce peuple et que nous avons tiré les conséquences de nos quatorze années de lutte, il ne s'agissait pour nous que de créer un ordre nouveau, meilleur que l'ancien... Pour nous la révolution n'était pas un état permanent.
Parmi les innombrables documents que j'ai dû lire la semaine passée, j'ai trouvé le journal d'un homme qui, en 1918, a été amené à résister à des lois et qui, depuis lors, vivait dans un monde où c'était la loi, quelle qu'elle fût, qui semblait l'objectif à détruire. C'est là un document troublant qui révèle un état d'esprit de conspirateur éternel et qui ouvre des aperçus sur la mentalité des gens, qui, sans se l'avouer, étaient devenus des nihilistes.
Incapables de collaborer, décidés à prendre position contre tout ordre établi, haineux à l'égard des autorités quelles qu'elles fussent, beaucoup parmi ces aventuriers, conspirateurs-nés, furent avec nous jadis, dans notre lutte contre les gouvernements passés, la plupart d'entre eux avaient, d'ailleurs, bien avant le 30 janvier, été écartés d'un mouvement dont la discipline était la caractéristique. Ces indisciplinés n'avaient qu'un trait commun : ils ne pensaient jamais au peuple allemand, mais uniquement à lutter contre les institutions et contre l'ordre...
L'enquête a montré que dans les rangs de quelques chefs supérieurs de la S.A. s'étaient fait jour des tendances qui ne pouvaient que provoquer les plus graves inquiétudes.
On fit d'autres constatations sans déceler encore clairement leur connexion entre elles :
1) Contrairement à mon ordre exprès et aux déclarations que m'avait faites l'ancien chef d’Etat-major Rœhm, les Sections d'Assaut s'étaient remplies d'éléments qui risquaient de détruire l'homogénéité de cette organisation.
2) L'instruction de nouveaux miliciens dans les principes du national-socialisme passait de plus en plus à l'arrière-plan des préoccupations de certaines autorités supérieures.
3) Les relations naturelles entre le Parti et les milices se relâchaient lentement. On a pu établir qu'il y avait une tendance systématique à détourner de plus en plus les Sections d'Assaut de la mission que je leur avais assignée pour les employer à d'autres tâches ou les mettre au service d'autres intérêts.
4) Les promotions des chefs de la S.A. ont été trop souvent dictées par la prise en considération de qualités purement extérieures. La grande masse des vétérans fidèles était de plus en plus négligée dans ces promotions tandis que la classe 1933, qui n'avait jamais été particulièrement estimée dans le Parti, était avantagée d'une manière incompréhensible. Souvent, il a suffi d'appartenir depuis quelques mois seulement à la S.A. pour obtenir des postes importants qu'un vieux chef de S.A. ne pouvait atteindre après des années...
La décision de la direction du Parti de mettre fin aux excès dont je viens de parler a provoqué une réaction très vive de la part du chef d'Etat-major. Des vétérans de nos luttes dont certains combattaient depuis quinze ans avec nous et dont certains représentaient le Parti dans de hautes fonctions de l'Etat furent déférés devant les tribunaux d'honneur composés partiellement de membres très jeunes du Parti ou même de gens n'y appartenant pas du tout.
Il en est résulté de graves discussions entre Rœhm et moi. C'est alors que, pour la première fois, j'ai conçu des doutes sur la loyauté de cet homme...
A partir du mois de mai, il était hors de doute que le chef d'Etat-major Rœhm s'occupait de plans ambitieux qui, s'ils étaient réalisés, ne pouvaient qu'amener les changements les plus graves.
Si j'ai hésité, pendant ces mois, à prendre une décision, ce fut pour deux raisons :
1) Je ne pouvais pas, sans nouveaux indices, m'habituer à l'idée que des relations que j'avais édifiées sur la confiance mutuelle reposaient sur un mensonge.
2) J'avais toujours le secret espoir d'épargner au mouvement et à mes Sections d'Assaut la honte d'une telle explication et de limiter les dégâts sans avoir à combattre...
Peu à peu, trois groupes se sont formés au sein de la direction de la S.A. D'abord un petit groupe d'éléments que rapprochaient leurs dispositions ou leurs vices et qui, prêts à tout, étaient complètement entre les mains de Rœhm. C'était en premier lieu les chefs de S.A. Ernst à Berlin, Heines en Silésie, Hayn en Saxe, Heydrebreck en Poméranie. A côté d'eux se trouvait un second groupe de chefs qui, en réalité, n'appartenaient pas à cette secte, mais qui se considéraient comme obligés d'obéir à Rœhm par sentiment de discipline. Opposé à ces deux groupes en existait un troisième ; les chefs qui en faisaient partie ne cachaient pas leur aversion pour ce qui se passait : pour cette raison, ils se trouvaient écartés des postes à responsabilité et, dans bien des cas, complètement laissés de côté. A la tête de ce groupe se trouvaient Lutze, le chef d'Etat-major actuel, et le chef de la S.S. Himmler.
Sans me mettre jamais au courant, sans que j'en aie eu jamais la moindre idée, le chef d'Etat-major Rœhm était entré en relations avec le général von Schleicher par l'entremise d'un aventurier totalement corrompu, M. von Alvenleben Schleicher fut l'homme qui donna une forme concrète aux intentions de Rœhm. II décida que :
1) Le régime allemand actuel ne pouvait plus durer.
2) L'armée et les organisations nationales devaient être placées sous les ordres d'un même chef.
3) Le seul homme qualifié pour être ce chef était Rœhm.
4) M. von Papen devait être éloigné et lui-même prendrait sa place à la Chancellerie, ce qui supposait d'autres changements importants dans le gouvernement..
J'ai toujours affirmé depuis quatorze ans que les Sections d'Assaut étaient des organisations politiques qui n'avaient rien à voir avec l'armée. C'eût été à mes yeux un désaveu de mes affirmations antérieures et de toute ma politique que de placer un officier à la tête de l'armée et non pas celui qui était le chef de la S.A., le capitaine Gœring...
Le chef suprême de l'armée est le maréchal von Hindenburg, Président du Reich. En tant que chancelier, je lui ai prêté serment Sa personne nous est sacrée...
Il n'y a dans l'Etat pour porter les armes que l'armée et pour penser politiquement que le Parti national-socialiste. Le plan de Rœhm fut conçu de manière à forcer la résistance :
1) On devait tout d'abord créer les conditions psychologiques favorables à une seconde révolution. Les services de propagande de la S.A. répandirent le bruit dans les sections que la Reichswehr voulait leur dissolution, et qu'elle m'avait, malheureusement acquis à ce projet qui était un mensonge forgé de toutes pièces.
2) Pour parer à cette attaque, les S.A. devaient faire une seconde révolution, se débarrasser des réactionnaires d'une part et prendre eux-mêmes le pouvoir.
3) Grâce aux quêtes effectuées sous des prétextes de charité, Rœhm avait réussi à amasser douze millions pour réaliser ses desseins.
4) Pour pouvoir mener sans scrupules ni hésitations les batailles décisives, on avait formé des groupes spéciaux de mercenaires prêts à tout sous le nom de « Gardes d'Etat-major »...
La préparation politique de l'action sur le plan intérieur fut confiée à M. von Detten tandis que le général von Schleicher s'en chargeait sur le plan extérieur, agissant personnellement et aussi par l'entremise de son courrier, le général von Bredow. Gregor Strasser fut entraîné dans le complot
Au début de juin, je fis une dernière tentative auprès de Rœhm. Je le fis venir et eus avec lui un entretien qui dura près de cinq heures. Je lui dis avoir acquis l'impression que des éléments sans conscience préparaient une révolution nationale-bolcheviste, révolution qui ne pouvait amener que des malheurs sans nom. Je lui dis aussi que le bruit m'était parvenu que l'on voulait mêler l'armée à cette action, Je déclarai au chef d'Etat-major que l'opinion selon laquelle la SA. devait être dissoute était absolument mensongère, que je ne pouvais m'opposer à la diffusion de ce mensonge, mais qu'à toute tentative d'établir du désordre en Allemagne, je m'opposerais immédiatement moi-même et que quiconque attaquerait l'Etat devrait d'emblée me compter comme ennemi...
Si l'on pouvait encore épargner un malheur, ce ne pouvait être qu'en agissant avec la promptitude de l'éclair. Seule une répression féroce et sanglante pouvait étouffer la révolte dans l'œuf. Et il ne pouvait être question de se demander s'il valait mieux anéantir une centaine de mutins, de traîtres et de conspirateurs ou laisser tuer d'un côté de la barricade dix mille innocents S.A. et de l'autre côté dix mille autres innocents. Car si le mouvement du criminel Ernst avait pu se déclencher à Berlin, les conséquences en eussent été incalculables. Comme les mutins s'étaient servis de mon nom, ils avaient réussi entre autres à obtenir d'officiers de police sans défiance la livraison de quatre auto-mitrailleuses...
A 1 heure dans la nuit j'avais reçu les dernières nouvelles. A 2 heures du matin, je volais vers Munich. Le ministre-président Gœring avait entre-temps reçu l'ordre d'agir, de son côté, à Berlin et en Prusse. Avec son poing d'acier, il a brisé l'attaque contre l'Etat national-socialiste avant même que cette attaque ait eu lieu.»
Les mutineries se jugent par leurs propres lois. Si quelqu'un me demande pourquoi nous n'avons pas eu recours aux tribunaux réguliers, je lui répondrai ceci : à cette heure, j'étais responsable de la nation allemande et en conséquence, c'est moi qui, pendant ces vingt-quatre heures, étais, à moi seul, la Cour suprême de justice du peuple allemand. Dans tous les temps d'ailleurs on a décimé les mutins. Un seul pays n'a pas fait usage de cette disposition de son code militaire et c'est pourquoi ce pays a été brisé et vaincu, ce pays c'est l'Allemagne. Je ne voulais pas exposer le jeune Reich au destin de l'ancien.
J'ai donné l'ordre de fusiller les principaux coupables et j'ai donné l'ordre aussi de cautériser les abcès de notre empoisonnement intérieur et de l'empoisonnement étranger, jusqu'à brûler la chair vive. J'ai également donné l'ordre de tuer aussitôt tout rebelle qui lors de son arrestation, essaierait de résister. La nation doit savoir que son existence ne peut être impunément menacée par personne et que quiconque lève la main contre l'Etat, en meurt. De même chaque national-socialiste doit savoir qu'aucune situation ne le mettra à l'abri de ses responsabilités et par conséquent du châtiment..
Un diplomate étranger déclare que sa rencontre avec Schleicher et Rœhm était de nature tout à fait inoffensive. Je n'ai à discuter avec personne cette question. Les opinions sur ce qui est inoffensif ou ne l'est pas ne pourront jamais coïncider en politique. Mais, quand trois hommes coupables de haute trahison organisent une rencontre en Allemagne avec un homme d'Etat étranger, rencontre qu'ils qualifient eux-mêmes de rencontre de « service », quand ils écartent les domestiques et donnent des ordres rigoureux pour que je ne sois pas tenu au courant de cette rencontre, je fais fusiller ces hommes, même s'il est exact que dans ces conversations si secrètes l'on n'ait parlé que du beau temps, de vieilles monnaies et d'autres choses semblables.
La rançon de ces crimes a été sévère : 19 chefs supérieurs des Sections d'Assaut, 31 chefs des Sections d'Assaut et membres de ces sections ont été fusillés. De même 3 chefs des Sections Spéciales de protection (S.S.) qui avaient participé au complot 13 chefs des Sections d'Assaut ou des civils ont perdu la vie en essayant de résister lors de leur arrestation. 2 autres se sont suicidés. 5 membres du Parti qui n'appartenaient pas à la S.A. ont été fusillés pour leur participation au complot. Enfin, furent encore fusillés trois S.S. qui s'étaient rendus coupables de mauvais traitement envers des prisonniers.
L'action est terminée depuis le dimanche 1er juillet dans la nuit. Un état normal est rétabli. Une série d'actes de violence qui n'avaient rien à voir avec cette action seront déférés aux tribunaux normaux...
J'espérais qu'il ne serait plus nécessaire de défendre cet Etat les armes à la main. Puisqu'il n'en a pas été ainsi, nous nous félicitons tous d'avoir été assez fanatiques pour avoir maintenu dans le sang ce qui avait été acquis par le sang de nos meilleurs camarades...
BIBLIOGRAPHIE SOMMAIRE
Outre les archives allemandes, divers témoignages oraux et les différents journaux de l'époque, nous avons consulté de nombreuses publications dont :
I) DOCUMENTS
Archives de l'Institut für Zeitgeschichte de Munich.
Forschungsstelle zur Geschichte des Nationalsozialismus, Hambourg.
Tribunal militaire international de Nuremberg : Procès des grands criminels de guerre. Baden-Raden, 1947-1949.
Protokoll des Schwurgerichts in dem Strafverfahren gegen, Josef Dietrich und Michael Lippert (Munich, 6-14 mai 1967).
Weissbuch über die Erschiessungen des 30 juin 193k, Paris, 1934.
Norman H. Raynes : The speeches of Adolf Hitler 1922-1939, Oxford, 1942.
Charles Bloch : La Nuit des longs couteaux (présentation de documents dont certains sont inédits), collection Archives, Paris, 1964.
II) MEMOIRES ET TEMOIGNAGES
André François-Poncet : Souvenirs d'une ambassade à Berlin, Paris, 1946.
Ruth Andreas-Friedrich : A Berlin sous les nazis, Paris, 1946.
H.B. Gisevius : Jusqu'à la lie, Paris, 1948, Où est Nebe ? Paris, 1967.
Joseph Goebbels : My part in Germany fight, Londres, 1935.
Adolf Hitler : Mein Kampf, Paris, 1938.
Franz von Papen : Mémoires, Paris, 1953.
Hermann Rauschning : Hitler m'a dit, Paris, 1939.
Ernst Rohm : Die Memoiren des Stabschefs Rohm, Sarrebruck, 1934.
Die Geschichte eines Hochverrâters, 1934.
Ernst von Salomon : Les Réprouvés, Paris, 1931.
Les Cadets, Paris, 1969. Otto Strasser : Hitler et moi, Paris, 1940.
III) ETUDES DIVERSES
William Sheridan Allen : Une petite ville nazie, Paris, 1967.
Gilbert Badia : Histoire de l'Allemagne contemporaine, Paris, 1962.
H. Bennecke : Die Reischswehr und der Röhm-Putsch, 1957.
Hitler und die SA., 1959.
J. Benoist-Méchin : Histoire de l'armée allemande, Paris, 1938.
D. Bracher : Die nationalsozialistische Machtergreifung, Cologne, 1960.
Alan Bullock : Hitler ou Les mécanismes de la tyrannie, Paris, 1963.
Georges Castellan : Le Réarmement clandestin du Reich, Paris, 1954. L'Allemagne de Weimar, Paris, 1969.
Jacques Delarue : Histoire de la Gestapo, Paris, 1962.
Jean François : L'affaire Röhm-Hitler, Paris, 1939.
Walter Hofer : Die Diktatur Hitlers bis zum Beginai deszweiten Weltkrieges, 1960. Heinz Höhne : L'Ordre noir, histoire de la SJS., Paris, 1968.
Roger Manvell et Heinrich Franckel : Hermann Gœring, Paris, 1962.
Gœbbels, Paris, 1964. William L. Shirer : Le Troisième Reich, Paris, 1961.
Otto Strasser : Die deutsche Bartholomaùsnacht, 1935.
J.W. Wheeler-Bénnett : Le drame de l'armée allemande, Paris,
ACHEVÉ D'IMPRIMER
LE 8 FÉVRIER 1974
SUR LES PRESSES DE
L'IMPRIMERIE HÉRISSEY
A ÉVREUX (EURE)
N° ISBN : 2-245-00062-5
Dépôt légal : 1er trimestre 1974
N° d'imprimeur : 14602
N° d'éditeur : 1811
[1] André François-Poncet, Souvenirs d'une ambassade à Berlin, Paris, 1946.
[2] André François-Poncet : Souvenirs d'une ambassade à Berlin. Paris, 1946.
[3] n sera rétabli par Hitler en octobre 1933.
[4] Essentiellement pour les scènes concernant l'arrivée de Hitler à Tempelhof nous utilisons Gisevius, Jusqu'à la lie, Paris, 1948, tome I, page 183 et suivantes.