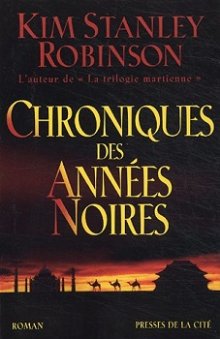
Quelle aurait été l’histoire du monde si l’Europe chrétienne avait disparu au Moyen Age, ravagée par la peste ? L’Islam et la Chine seraient devenus les civilisations dominantes, découvrant l’Amérique, se faisant la guerre, inventant le chemin de fer et l’atome, cherchant à l’emporter, à imposer la foi de Mahomet, Bouddha ou Confucius…
A travers les destins de trois personnages — un sentimental, un révolté et un intellectuel —, Kim Stanley Robinson dépeint de façon étonnamment réaliste sept cents ans de l’histoire d’un univers foisonnant, où les aventures individuelles se mêlent à la trame historique et se répondent à travers les siècles et les continents. D’abord simple soldat dans l’armée de Tamerlan, Bold rencontrera Kyu, un jeune eunuque noir, et I-Chi, une restauratrice chinoise en quête des plats les meilleurs. Incendies, inondations, épidémies, guerres, révoltes, le destin va jouer avec ces personnages et les entraîner, au fil des siècles et de leurs diverses réincarnations, dans des aventures fascinantes.
A la fois roman d’initiation et vrai-faux roman historique, est un livre profondément original, une somme impressionnante d’érudition et d’imagination ainsi qu’un merveilleux plaidoyer pour la paix dans le monde et la beauté de la vie.
Kim Stanley Robinson
Chroniques des années noires
TRIPITAKA : Sommes-nous loin, Singe, du Paradis de l’Ouest où réside le Bouddha ?
SUN WU KONG : Tu pourrais marcher du début de ta jeunesse jusqu’à la fin de ton âge et encore après, dans ta nouvelle jeunesse ; tu pourrais recommencer ainsi mille fois que tu n’arriverais pas à l’endroit où tu veux aller. Mais quand, à force de volonté, tu percevras la nature du Bouddha en toute chose, quand chacune de tes pensées retournera vers cette source dans ta mémoire, alors là, tu arriveras à la Montagne des Esprits.
CHRONOLOGIE
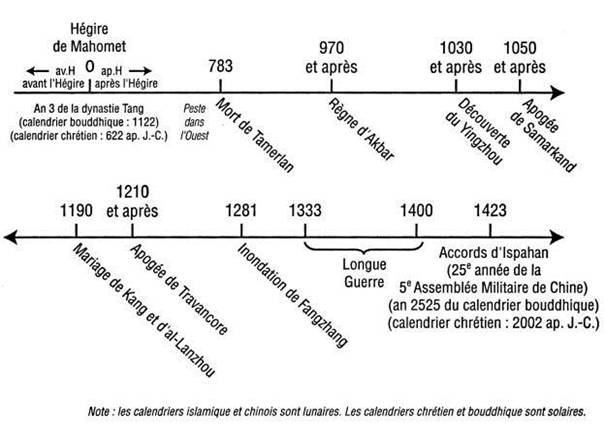
LIVRE 1
ÉVEIL AU VIDE
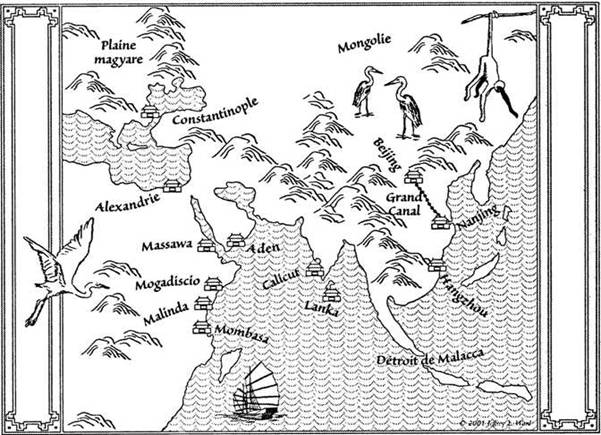
1
Autre voyage vers l’ouest ; Bold et Psin arrivent dans une contrée vide ; Tamerlan se fâche ; et le chapitre connaît une fin tumultueuse
Le Singe ne meurt jamais. Il revient toujours nous aider dans les moments difficiles, comme il aida Tripitaka à vaincre les périls lors de son premier voyage vers l’ouest, quand il rapporta le bouddhisme d’Inde en Chine.
Il s’était à présent incarné en un Mongol de petite taille appelé Bold Bardash, cavalier dans l’armée de Tamerlan. Fils d’un marchand de sel tibétain et d’une aubergiste mongole pleine d’entrain, c’était donc un voyageur avant même sa naissance, allant de-ci de-là, par monts et par vaux, par-delà les montagnes et les fleuves, les déserts et les steppes, parcourant en tous sens le cœur du monde sans jamais s’arrêter. Au début de notre histoire, il était déjà vieux : la face carrée, le nez crochu, la natte toute grise, comme ses quatre poils au menton. Il savait que ce serait la dernière campagne de Tamerlan, et peut-être aussi la sienne.
Un soir, au crépuscule, un petit groupe d’éclaireurs parti en reconnaissance à l’avant de l’armée quitta le couvert des sombres collines. Bold n’était jamais tranquille à la tombée du jour, quand le silence s’établissait sur toute chose. Bien sûr, tout n’était pas vraiment silencieux : les forêts étaient des endroits bruyants par rapport aux steppes ; un fleuve, plus loin, mêlait son grondement aux frôlements des branches agitées par le vent. Mais quelque chose manquait. Le chant des oiseaux, peut-être, ou bien un autre son que Bold n’identifiait pas encore. Les chevaux hennissaient doucement tandis que les hommes les conduisaient à petits coups de genoux. Les caprices du ciel n’arrangeaient rien. Des nuages pareils à de longues queues de jument orange, de soudaines sautes de vent dans l’air moite annonçaient un orage. Sous les gigantesques cieux des steppes ç’eût été évident. Ça ne l’était pas autant à l’orée de ces collines boisées, où le ciel se voyait moins et où les vents étaient hachés. Mais les signes étaient là.
Longues chevauchées dans les champs délaissés,
Lourds épis ployant, accablés,
Vergers endeuillés aux branches noires de fruits,
Sombres mares des pommes tombées à terre.
La route est de poussière sans trace aucune,
De pas, de roues, de sabots. Le soleil vaincu,
Une lune difforme hésite sur l’horizon.
Une chouette s’abat. Un souffle d’air.
Comme le monde paraît grand quand le vent se lève !
Les chevaux sont nerveux, le Singe aussi.
Ils franchirent un pont sans rencontrer âme qui vive, dans un vacarme de sabots ébranlant les planches. Puis ils atteignirent des bâtiments de bois au toit de chaume. Pas un feu, pas une lampe. Plus loin, entre les arbres, d’autres maisons apparurent. Mais, là encore, personne. Tout était noir et vide.
Psin leur dit de se dépêcher. En descendant des collines, la route s’élargit. Elle décrivait une large courbe dans la plaine. Les maisons se rapprochaient. Soudain apparut une immense cité, noire et silencieuse. Pas une lumière, pas un cri ; seulement le vent dans les branches qui caressaient le long ruban noir et luisant du fleuve. La ville était vide.
On naît et on renaît. Plusieurs fois. Bien sûr. On remplit son corps. Comme l’air dans une bulle. Et quand la bulle éclate, on s’en va, plus loin, dans le bardo. Errant, en attendant d’être projeté dans une nouvelle vie. Quelque part, dans le monde. Cette pensée avait souvent réconforté Bold quand il tombait, épuisé, sur des champs de bataille, après le combat, parmi les corps désarticulés, abandonnés comme autant de dépouilles vides.
Mais c’était autre chose que d’arriver dans une ville où il n’y avait pas eu de bataille, et de n’y trouver que des morts. Morts depuis longtemps. Des corps desséchés ; dans la pâle lumière du crépuscule ou à la lueur de la lune, leurs os brillaient, nettoyés par les loups et les corbeaux. Bold se répéta tout bas le soutra du Cœur. « La forme est le vide, le vide est la forme. Parti, parti, parti au-delà, parti complètement au-delà. Bodhi Svâhâ, complet éveil ! Ainsi soit-il ! »
Ils retinrent leurs chevaux à l’entrée de la ville. En dehors des clapotis et des chuintements du fleuve, tout était calme. L’œil torve de la lune tomba sur une façade de pierre, au beau milieu des maisons de bois. Un immense bâtiment de pierre, entre d’autres plus petits.
Psin leur ordonna de se couvrir le visage avec leur vêtement, de ne toucher à rien, de ne pas descendre de selle et de retenir leur cheval fermement par la bride. Lentement, ils s’engagèrent dans les rues étroites, bordées de maisons de bois d’un ou deux étages, appuyées les unes contre les autres comme dans les villes chinoises. Les chevaux avancèrent en renâclant.
Ils arrivèrent à une grande place pavée, non loin du fleuve, et s’arrêtèrent devant le grand bâtiment de pierre. Il était énorme. Bon nombre des habitants de la ville étaient venus y mourir. Leur lamaserie, certainement, mais sans toit, offerte au ciel – comme inachevée. On aurait dit que ces gens avaient retrouvé la foi peu avant de mourir, mais trop tard, l’endroit était un ossuaire. Parti, parti, parti au-delà, parti complètement au-delà. Rien ne bougeait, et Bold se dit que le col qu’ils avaient franchi dans la montagne n’était peut-être pas le bon, mais celui qui menait vers cet autre royaume de l’Ouest, au pays des morts. Pendant un court instant, il se remémora quelque chose, une parcelle d’une autre vie, une ville bien plus petite que celle-ci, un village balayé par un cataclysme qui avait envoyé tout le monde dans le bardo. Des heures dans une pièce, à attendre la mort ; c’était pourquoi il avait si souvent l’impression de reconnaître les gens qu’il rencontrait. Leur vie était un destin partagé.
— La peste, dit Psin. Partons d’ici.
Une lueur brilla dans ses yeux quand il regarda Bold. Il avait un visage si dur. Il ressemblait à ces statues de soldats, dans les tombeaux des empereurs.
— Je me demande pourquoi ils sont restés…, dit Bold en frissonnant.
— Peut-être n’avaient-ils nulle part où aller.
La peste avait déjà frappé l’Inde. Les Mongols l’avaient rarement eue, à part peut-être un bébé, de temps en temps. Les Turcs et les Indiens y étaient plus sensibles, et bien sûr il y en avait dans l’armée de Tamerlan, ainsi que des Perses, des Mongols, des Tibétains, des Tadjiks, des Arabes et des Géorgiens… La peste pouvait les tuer tous, ou seulement quelques-uns. Si c’était bien ce qui avait tué ces gens. On ne pouvait pas savoir.
— Retournons prévenir les autres, dit Psin.
Ses camarades approuvèrent, heureux de sa décision. Tamerlan les avait envoyés en reconnaissance dans la plaine magyare et au-delà, à quatre jours de cheval. Il n’aimait pas que les détachements d’éclaireurs reviennent au camp sans avoir rempli leur mission, même s’ils étaient composés de ses plus vieux qa’uchin. Mais Psin lui expliquerait.
Ils galopèrent donc à la lueur de la lune, s’arrêtant brièvement pour bivouaquer quand les chevaux n’en pouvaient plus. Ils repartaient dès l’aube, passant par le large défilé dans la montagne que les premiers éclaireurs avaient appelé la porte de Moravie. Ils ne virent de fumée dans aucun village ni dans aucune hutte. Ils chevauchèrent à bride abattue toute la journée.
Comme ils descendaient la longue pente vers la steppe à l’est, un énorme mur de nuages les rattrapa, couvrant la moitié du ciel, derrière eux.
… Telle Kali tirant le dais de la nuit,
La déesse de la mort les chassa de son pays.
Ventre d’encre ondoyant, fluctuant,
Tresses noires et vibrants hameçons vrillant l’air,
Lourde menace. Les chevaux ploient l’encolure,
Et les hommes s’évitent du regard.
Ils approchèrent du vaste campement de Tamerlan, et l’orage plongea le reste du jour dans des ténèbres pareilles à celles de la nuit. Bold sentit ses cheveux se hérisser sur sa nuque. Quelques grosses gouttes s’écrasèrent sur le sol, et le tonnerre gronda comme de grandes roues de fer. Ils se recroquevillèrent sur leur selle et talonnèrent leurs chevaux, rechignant à repartir sous un pareil orage avec de telles nouvelles. Tamerlan y verrait un mauvais présage, tout comme eux. Tamerlan disait souvent qu’il devait tous ses succès à un asura qui lui avait rendu visite et l’avait guidé. Bold avait été témoin d’une de ses visites : il avait vu Tamerlan engager la conversation avec un être invisible, puis révéler ensuite aux gens leurs pensées et leur avenir. Un nuage aussi noir était forcément mauvais signe. Le mal était à l’ouest. Quelque chose de terrible s’y était passé, quelque chose de pire que la peste, peut-être, et Tamerlan devrait renoncer à conquérir les Magyars et les Francs. Il y était contraint par la déesse de la mort elle-même. Il était difficile de se l’imaginer abandonnant, mais là, sous cet orage surnaturel, alors que tous les Magyars étaient morts…
De la fumée montait des braseros du gigantesque camp, faisant penser à quelques feux sacrificiels, l’odeur à la fois familière et distante – comme celle d’un foyer qu’ils avaient déjà quitté pour toujours. Psin regarda les hommes autour de lui, ordonna la halte, puis se tourna vers Bold.
Bold sentit la peur le traverser.
— Suis-moi.
Bold déglutit et hocha la tête. Il n’était pas courageux, mais il avait le stoïcisme des qa’uchin, les plus vieux des guerriers de Tamerlan. Psin devait également savoir que, du point de vue de Bold, ils étaient entrés dans un nouveau royaume : tout ce qui leur arriverait désormais serait à la fois inexorable et des plus étranges. Ils n’échapperaient pas à leur karma.
Psin se rappellerait aussi certainement un certain incident de leur jeunesse, quand ils avaient été tous deux capturés par une tribu de chasseurs de la rivière Kama. Ils avaient réussi à s’échapper après avoir poignardé le chef des chasseurs, couru à travers un feu de joie et fui dans la nuit.
Les deux hommes passèrent les premières sentinelles, puis celles qui gardaient la tente du khan. Des éclairs crevaient le ciel noir, au nord et à l’ouest. Aucun des hommes ici présents n’avait jamais vu pareil orage de toute sa vie. Bold en avait la chair de poule. L’air crépitait comme si des fantômes affamés, des prêtas, se massaient pour voir Tamerlan quitter sa tente. Il avait fait tant de morts…
Les deux hommes mirent pied à terre et attendirent. Des gardes sortirent de la tente, écartèrent les rabats et se mirent au garde-à-vous, l’arc au côté. Bold avait la gorge tellement sèche qu’il ne pouvait avaler, et il lui sembla qu’une lueur bleue brillait à l’intérieur de la grande yourte du khan.
Tamerlan parut alors, pareil à un géant, assis sur une litière que des hommes portaient sur leurs épaules. Il était pâle et transpirait à grosses gouttes. Le blanc de ses yeux formait un cercle autour de ses prunelles. Il toisa Psin.
— Pourquoi es-tu revenu ?
— Khan, la peste a frappé les Magyars. Ils sont tous morts.
Tamerlan dévisagea son général. Il ne l’aimait pas.
— Pourquoi es-tu revenu ?
— Pour vous le dire, khan, répondit Psin, impavide.
Il affronta le farouche regard de Tamerlan sans ciller. Tamerlan n’était pas content. Bold déglutit ; rien ici ne ressemblait à ce qu’ils avaient connu, Psin et lui, quand ils avaient échappé aux chasseurs. Rien de ce qu’ils avaient accompli alors ne leur serait utile cette fois. Seule l’idée qu’ils pouvaient recommencer demeurait.
Ce fut comme si quelque chose cédait à l’intérieur de Tamerlan. Bold vit que c’était à présent son asura qui parlait par sa bouche, et que c’était une torture. Pas son asura, peut-être, mais son nafs, l’esprit animal qui vivait en lui.
— Ils ne s’en tireront pas aussi facilement ! lança Tamerlan d’une voix rauque. Ils me le paieront ! Ils auront beau faire, ils ne m’échapperont pas ! Allons, lança-t-il avec un geste du bras, regagnez votre détachement !
Puis, quand ils se furent suffisamment éloignés, il murmura à ses gardes :
— Tuez-les, eux, leurs hommes et leurs chevaux. Faites un bûcher, brûlez-les et déplacez notre camp de deux jours à l’est.
Il leva la main.
Le monde explosa.
Ils avaient été frappés par la foudre. Bold se retrouva assis par terre, abasourdi. En regardant autour de lui, il vit que tout le monde était aussi hébété que lui. La tente du khan était en feu et la litière de Tamerlan renversée. Ses porteurs se tordaient de douleur, et le khan lui-même avait un genou en terre, les mains crispées sur la poitrine. Certains de ses hommes coururent vers lui. Un nouvel éclair s’abattit sur eux.
Bold se releva à tâtons et s’enfuit. Il regarda par-dessus son épaule et aperçut des images résiduelles vertes, palpitantes, vit le nafs noir de Tamerlan s’échapper de sa bouche en longues traînées sombres qui se fondirent dans la nuit. Tamerlan, le Boiteux de Fer, était abandonné, à la fois par son asura et par son nafs. Son écorce vide tomba à terre, sous la pluie. Bold courut vers l’est, dans les ténèbres. Nous ne savons pas dans quelle direction Psin alla, ni ce qu’il advint de lui. Quant à Bold, nous verrons cela au chapitre suivant.
2
Au royaume des fantômes affamés erre un singe aussi seul qu’un nuage
Toute cette nuit-là Bold courut vers l’est, se frayant un passage dans la forêt luxuriante sous une pluie battante, gravissant les collines les plus escarpées qu’il trouvait, pour échapper aux cavaliers qui auraient pu le suivre. Personne ne devait être trop impatient de poursuivre un pestiféré en puissance, mais on pouvait toujours le tirer à l’arc, comme un lapin, et il voulait disparaître de leur monde à tout jamais. Sans cette tempête surnaturelle, il serait certainement mort, en route vers une nouvelle existence : il l’était maintenant, de toute façon. Complètement. Parti, parti, parti au-delà, parti complètement au-delà.
Il marcha tout le lendemain, et la nuit suivante. L’aube du deuxième jour le trouva en train de franchir précipitamment la Porte de Moravie. Il sentait que personne n’oserait l’y suivre. Une fois dans la plaine magyare, il prit vers le sud, vers une forêt de gros chênes. Dans la lumière humide du matin, il trouva un arbre couché à terre et s’insinua profondément entre ses racines pour passer le reste de la journée à l’abri.
La pluie cessa dans la nuit, et le matin du troisième jour, quand il ressortit de sa cachette, il mourait de faim. Il trouva rapidement des oignons sauvages, puis chercha quelque chose de plus substantiel à se mettre sous la dent. Il y aurait peut-être de la viande séchée encore accrochée dans les granges des villages déserts, ou du grain dans les greniers. Il y aurait peut-être aussi un arc et des flèches ; il n’avait pas envie d’approcher de ces villages dévastés par la peste, mais cela semblait être le meilleur moyen de trouver de la nourriture, et c’était tout ce qui comptait.
La nuit suivante, il dormit mal. Les oignons lui avaient donné des gaz. Le lendemain matin, il repartit vers le sud en suivant le grand fleuve. Toutes les fermes, tous les villages étaient abandonnés. Il ne voyait que des morts, par dizaines, étendus çà et là. C’était horrible, mais il n’y pouvait rien. Il se sentait comme mort lui aussi, une sorte de fantôme très affamé en vérité. Vivant au jour le jour, sans nom, sans compagnon, il commença à se replier sur lui-même, comme au cours de ses campagnes les plus pénibles dans les steppes. Il devenait de plus en plus animal, son esprit se recroquevillait telles les cornes d’un escargot quand on les touche. Pendant plusieurs nuits d’affilée, il ne pensa pas beaucoup, sauf au soutra du Cœur. La forme est le vide, le vide est la forme. Il ne s’était pas appelé pour rien Sun Wu Kong, Éveil au Vide, dans une incarnation antérieure. Le Singe dans le vide.
Il arriva dans un village qui avait l’air intact, et en fit le tour. Dans une écurie vide, il trouva un vieil arc et un carquois de flèches, aussi primitifs et médiocres l’un que l’autre. Quelque chose bougeait dans le pâturage au-dehors. Bold sortit et siffla une petite jument noire. Il l’attira avec des oignons et lui apprit très vite à le prendre sur son dos.
Il franchit à cheval un pont de pierre qui enjambait le vaste fleuve, et traversa lentement les reliefs du paysage, montant, descendant, en haut, en bas. Tous les villages étaient vides, toutes les réserves de nourriture pourries ou dévorées par les animaux, mais au moins, maintenant, il pouvait se nourrir du lait et du sang de la jument, de sorte qu’il était moins urgent de trouver à manger.
C’était l’automne, aussi commença-t-il à vivre comme les ours, se nourrissant de baies, de miel et de lapins tirés avec son arc rudimentaire. Peut-être avait-il été fait par un enfant ? Il n’arrivait pas à croire qu’un adulte ait pu bricoler un objet pareil. C’était un vulgaire bout de bois, probablement du frêne, en partie sculpté, de toute façon mal abouté ; pas d’encoche pour la flèche, pas de rainure pour l’ajuster. Quant à la corde, on avait en la tendant l’impression de lever un drapeau de prière. Son vieil arc était fait de houx et d’érable laminés, assemblés à la colle de tendon et gainé de cuir bleu. Sa détente était douce, mais il était assez puissant pour percer une armure à plus d’un li de distance. Il ne l’avait plus. Lui aussi était complètement parti au-delà ; il l’avait perdu comme tout ce qu’il possédait. Quand il tirait ces pauvres brindilles avec cet arc fait d’une seule branche et qu’il manquait sa cible, il secouait la tête et se demandait si cela valait seulement la peine d’essayer de retrouver la flèche. Pas étonnant que ces gens soient morts…
Dans un petit village, cinq maisons blotties au-dessus du gué d’un fleuve, la maison du chef se révéla disposer d’un lardoir fermé à clé, encore plein de gâteaux de poisson parfumés avec une épice que Bold ne reconnut pas, et qui lui retourna l’estomac. Mais, après avoir avalé cette étrange nourriture, il se sentit ravigoté. Dans une écurie, il trouva des sacs de selle pour sa jument et les remplit de nourriture séchée. Il continua sa route, en faisant plus attention désormais au paysage qu’il traversait.
Arbres crayeux, aux branches noires dressées,
Pins et cyprès à la crête inaltérée de vert.
Oiseau rouge, oiseau bleu, perchés aile à aile
Dans le même arbre. Et tout est possible.
Tout, sauf le retour à sa vie antérieure. Non qu’il ait encore le moindre ressentiment à l’égard de Tamerlan ; Bold aurait fait pareil, à sa place. La peste, c’était la peste, et il ne fallait pas la prendre à la légère. Et cette peste était manifestement pire que les autres. Elle avait tué presque tout le monde dans la région. D’habitude, chez les Mongols, la peste tuait quelques bébés, rendait peut-être malades quelques adultes. On tuait les rats et les souris à vue, et si les bébés avaient la fièvre et des bubons, leur mère les abandonnait à leur destin au bord des fleuves. On disait que c’était pire dans les villes indiennes, qu’il y avait beaucoup de morts. Mais ça n’avait jamais été aussi grave. Ils étaient peut-être morts d’autre chose ?
Lente errance dans la contrée déserte.
Nuages brumeux, lune décroissante et gelée.
Ciel de givre, regard glacé.
Vent perçant. Terreur soudaine.
Mille arbres rugissent dans la forêt décimée :
Collines chauves – un singe crie sa solitude.
Mais la terreur le parcourut et s’estompa, comme des filets de pluie, laissant l’esprit aussi vide que la Terre elle-même. Tout était extraordinairement calme. Parti, parti, complètement parti.
Pendant un moment, il eut envie de revenir en arrière. Quitter cette région désolée, retrouver des gens. Et puis il arriva à une rangée de collines noires, déchiquetées, et vit une grande ville en dessous. Il n’en avait jamais vu d’aussi grande. Les toits couvraient tout le fond de la vallée. Mais elle était vide. Pas une fumée, pas un bruit, aucun mouvement. Au centre, un autre temple de pierre géant était ouvert au ciel. En le voyant, il sentit la terreur l’envahir à nouveau, et il repartit dans la forêt pour fuir le spectacle de tous ces gens balayés comme les feuilles d’automne.
Bold savait vaguement où il était, bien sûr. Au sud de cet endroit, il finirait par arriver aux domaines des Turcs Ottomans, dans les Balkans. Il pourrait leur parler ; il serait de retour dans le monde, mais hors de l’empire de Tamerlan. Alors quelque chose recommencerait pour lui, une nouvelle façon de vivre.
Il continua vers le sud. Mais il n’y avait, encore une fois, que des villages peuplés de squelettes. La faim au corps, il talonnait trop brutalement sa jument, ne s’arrêtant que pour lui prendre chaque fois plus de sang.
Et puis, une nuit, alors que la lune perçait à grand-peine les ténèbres, une meute de loups hurlants fondit rageusement sur eux. Bold n’eut que le temps de couper la longe de la jument et de se réfugier dans un arbre. La plupart des loups pourchassèrent sa monture, mais certains restèrent à grogner, haletants, sous son arbre. Bold s’installa aussi bien que possible, et se prépara à attendre leur départ. Quand la pluie vint, ils s’éclipsèrent. Il se réveilla pour la dixième fois à l’aube, et descendit tant bien que mal. Il longea le fleuve vers l’aval et trouva le cadavre de sa jument. Il n’en restait plus que la peau, des os épars et un peu de chair sanguinolente. Ses sacs avaient disparu.
Il continua à pied.
Un jour, trop affaibli pour marcher, il s’allongea près d’un cours d’eau et tira une biche avec l’une de ses pauvres flèches. Il fit un feu et mangea à sa faim, engloutissant des masses de cuissot rôti. Il dormit près de la carcasse, espérant en reprendre. Les loups ne pouvaient pas grimper aux arbres, mais les ours, si. Il vit un renard, et, comme la renarde avait été le nafs de sa femme, autrefois, se dit que c’était bon signe. Le lendemain matin, il fut réveillé par le soleil. Manifestement, la biche avait été emportée par un ours, mais il se sentait ragaillardi maintenant qu’il s’était rassasié de sa viande, et il poursuivit sa route.
Il marcha plusieurs jours vers le sud, restant autant que possible sur les crêtes désertes et dénudées. Au-dessous de lui s’étendait une plaine nettoyée par l’eau jusqu’à la pierre, cuite à blanc par le soleil. À l’aube, il chercha du regard s’il n’y avait pas de renardes dans les vallées, se désaltéra à des sources et fouilla les villages morts, à la recherche de bribes de nourriture. Il avait de plus en plus de mal à en trouver et, pendant un instant, en fut réduit à mâcher la courroie de cuir d’un harnais – une vieille astuce de Mongol qui remontait aux moments les plus durs des campagnes dans les steppes. Mais il lui semblait que ça marchait mieux en ce temps-là, dans ces plaines infinies, tellement plus faciles à traverser que ces collines blanches, torturées, recuites.
Au bout d’une journée, alors qu’il était depuis longtemps habitué à vivre seul, parcourant le monde comme le Singe lui-même, il entra dans un petit bouquet d’arbres pour faire du feu et eut un choc en voyant qu’il y en avait déjà un, dont s’occupait un homme.
L’homme était petit, comme Bold. Ses cheveux étaient aussi rouges que les feuilles d’érable, sa barbe broussailleuse de la même couleur, sa peau pâle et tachetée comme celle d’un chien. Tout d’abord, Bold pensa que l’homme était malade, et se tint à distance. Mais les yeux de l’homme, de couleur bleue, étaient clairs. Il avait peur, lui aussi ; il paraissait prêt à faire n’importe quoi. Ils se regardèrent en silence, de part et d’autre de la petite clairière.
L’homme fit un signe en direction de son feu. Bold hocha la tête et s’approcha prudemment.
Il faisait cuire deux poissons. Bold tira de son manteau un lapin qu’il avait tué le matin même. Il le dépouilla et le nettoya avec son couteau, sous le regard approbateur de l’homme qui retourna ses poissons sur le feu et fit de la place dans les braises pour le lapin. Bold l’embrocha sur un bout de bois et le mit dessus.
Quand la viande fut cuite, ils mangèrent en silence, assis sur des troncs d’arbre, de part et d’autre du petit feu. Ils observaient les flammes, ne se jetant que de brefs coups d’œil, comme hésitant à se regarder, intimidés. Après toute cette solitude, ce n’était pas évident de parler à un autre être humain.
Finalement, ce fut l’homme qui lui adressa la parole. D’abord de façon saccadée, puis plus longuement, avec plus d’aisance. Il employait parfois un mot qui paraissait familier à Bold, mais pas autant que ses gestes autour du feu. Bold avait beau faire des efforts, il ne comprenait rien à ce qu’il disait.
Bold essaya à son tour, d’abord quelques phrases simples, sentant l’étrangeté des mots dans sa bouche, pareils à du gravier. L’homme l’écoutait attentivement, ses yeux bleus brillant à la lumière du feu qui réchauffait la peau pâle de son visage maigre ; mais il n’avait l’air de comprendre ni le mongol, ni le tibétain, ni le chinois, ni le turc, ni l’arabe, ni le chagataï, ni aucune des autres formules de salutation que Bold avait apprises au fil du temps passé dans la steppe.
À la fin de la litanie de Bold, le visage de l’homme se crispa et il se mit à pleurer. Puis il essuya ses larmes, laissant de grandes coulées claires sur son visage sale, se leva et dit quelque chose en gesticulant frénétiquement. Il pointa le doigt sur Bold comme s’il était en colère, recula, se rassit sur son tronc d’arbre et fit semblant de pagayer – tel est du moins ce que comprit Bold. Il ramait en tournant le dos à l’endroit où il allait, à la façon des pêcheurs de la mer Caspienne. Par gestes, il fit mine de pêcher, d’attraper un poisson, de le nettoyer, de le mettre à cuire et de le donner à manger à de petits enfants. Il évoqua ainsi, avec beaucoup de tendresse, tous ceux qu’il avait nourris, ses enfants, sa femme, les gens avec qui il avait vécu.
Puis il leva le visage vers les frondaisons éclairées par le feu et se remit à pleurer. Il remonta sa pelure sur ses bras, serra les poings et les enfouit sous ses aisselles en gémissant. Bold hocha la tête et sentit son estomac se nouer quand l’homme mima la maladie et la mort de tous les siens, en se couchant par terre et en geignant comme un chien. Ils étaient tous morts, sauf lui. Il se releva, se mit à tourner autour du feu et montra le sol jonché de feuilles en entonnant des paroles, peut-être des noms. Tout cela était tellement clair.
Ensuite l’homme expliqua comment il avait brûlé son village mort et s’était éloigné en barque. Assis sur son rondin, il rama pendant longtemps, tellement longtemps que Bold pensa qu’il avait oublié l’histoire ; et puis il s’arrêta et se laissa tomber dans son bateau. Il se releva, regarda autour de lui avec une feinte surprise, se mit à marcher. Il marcha une douzaine de fois autour du feu, faisant mine de manger de l’herbe et des brindilles, hurlant comme un loup, se blottissant sous son tronc d’arbre, recommençant à marcher, recommençant à ramer. Encore et encore, il répétait les mêmes choses, « Dea, dea, dea, dea », hurlant vers le ciel étoilé cerné par les branches, en mugissant au firmament.
Bold faisait oui de la tête. Il connaissait cette histoire. L’homme se lamentait, émettait des bruits de gorge, presque animaux, et traçait des dessins sur le sol avec un bâton. À la lumière du feu, ses yeux étaient rouges comme ceux d’un loup. Bold reprit du lapin, puis offrit le reste à l’homme, qui le dévora. Ils restèrent assis là, à regarder le feu. Bold se sentait à la fois seul et content de ne pas l’être. Il regardait l’homme, qui avait mangé ses deux poissons et commençait à somnoler. Celui-ci eut un sursaut, marmonna quelque chose, se roula en boule et s’endormit. Bold tisonna précautionneusement le feu, s’allongea de l’autre côté et essaya de dormir. Lorsqu’il se réveilla, le feu était éteint et l’homme avait disparu. C’était l’aube, il faisait froid et Bold était trempé de rosée. La piste de l’homme menait vers une prairie, puis une vaste courbe du fleuve, où elle disparaissait. Pas moyen de savoir où il avait pu aller.
Les jours passèrent et Bold continua vers le sud, l’esprit vide de toute pensée. Il se contentait de scruter les environs, de chercher à manger, d’observer le ciel en fredonnant parfois un mot ou deux Éveil au vide. Un jour, il arriva à une source près d’un village.
Vieux temples épars dans le vaste monde,
Colonnes brisées lacérant le ciel.
Silence, silence.
Qui a fâché ces dieux contre leur peuple ?
Que pourraient-ils encore faire
De cette âme solitaire
Errant après la fin du monde ?
Tambours de marbre blanc renversés çà et là :
Un oiseau pépie dans le vide, désolé.
Comme il n’avait pas envie de provoquer qui que ce fut, il fit le tour des temples en entonnant : « Om mani padme oum, om mani padme oum, ooouum. » Il prit soudain conscience qu’il parlait souvent tout seul, qu’il fredonnait sans s’en apercevoir, spectateur de lui-même, écoutant sans l’entendre le vieillard qui radotait à côté de lui.
Il continua vers le sud, légèrement vers l’est, bien qu’il eût oublié pourquoi. Il fouillait les maisons le long des routes à la recherche de nourriture. Il marchait sur des chemins vides ; c’était un vieux pays ; des oliviers difformes, noirs, chargés de fruits immangeables, le narguaient. En vérité, une personne seule était condamnée à mourir de faim. D’ailleurs, il était de plus en plus affamé, et manger devenait son seul but, jour après jour. Il passait devant des ruines de marbre, des fermes qu’il fouillait. Une fois, il tomba sur une grande jarre d’argile pleine d’huile d’olive, et il resta là quatre jours, le temps de la vider. Puis le gibier devint plus abondant. Il revit plusieurs fois la renarde. Comme il avait appris à mieux utiliser son arc ridicule, il réussit à ne pas mourir de faim. Il faisait de plus grands feux toutes les nuits et, une ou deux fois, se demanda ce qu’était devenu l’homme qu’il avait croisé. Le fait d’avoir rencontré Bold l’avait-il amené à prendre conscience qu’il serait toujours seul, quoi qu’il arrive ? S’était-il tué pour retrouver sa jati ? Et s’il avait glissé dans le fleuve en y buvant ? Ou s’il y était entré pour empêcher Bold de le suivre ? Bold ne le saurait jamais, mais il n’arrêtait pas de repenser à lui, surtout à la clarté avec laquelle ils s’étaient compris.
Les vallées étaient orientées vers le sud et l’est. Bien que son parcours s’inscrivît nettement dans son esprit, il se rendit compte qu’il ne se rappelait pas suffisamment les semaines passées pour être sûr de l’endroit où il était par rapport à la porte de Moravie ou au khanat de la Horde d’Or. À partir de la mer Noire, ils avaient chevauché pendant une dizaine de jours vers l’ouest, non ? C’était comme s’il essayait de se souvenir d’une vie passée.
Cela dit, il se pouvait qu’il aille vers l’empire byzantin, approchant de Constantinople par le nord. Assis, le dos rond, devant son feu comme tous les soirs, il se demanda si Constantinople serait morte, elle aussi. Si la Mongolie était morte, si tout le monde sur Terre était mort. Le vent soufflait dans les buissons en mugissant comme un fantôme. Bold sombra dans un sommeil agité. Il se réveilla au beau milieu de la nuit pour s’assurer que les étoiles étaient toujours là, et remit du bois sur son feu. Il avait froid.
Au petit matin, le fantôme de Tamerlan était planté de l’autre côté du feu, la lueur des flammes dansant sur son visage sévère. Ses yeux étaient si noirs qu’on aurait dit de l’obsidienne et que des étoiles y brillaient.
— Alors, fit sombrement Tamerlan. Tu as réussi à te sauver.
— Oui, murmura Bold.
— Qu’est-ce qui ne va pas ? Tu ne veux pas reprendre la chasse ?
C’était une chose qu’il avait dite à Bold, autrefois. À la fin, Tamerlan était si fatigué qu’il avait fallu le transporter sur une litière, mais il ne lui serait jamais venu à l’idée de s’arrêter. Lors de son dernier hiver, il avait envisagé soit d’aller vers l’est au printemps, attaquer la Chine, soit vers l’ouest, attaquer les Francs. Au cours d’un gigantesque festin, il avait soupesé les avantages et les inconvénients de chacun des deux plans de campagne. Puis il avait regardé Bold. Quelque chose, sur son visage, avait amené le khan à élever sa voix puissante, encore forte malgré la maladie, le faisant sursauter.
« Qu’est-ce qui ne va pas, Bold ? Tu ne veux pas reprendre la chasse ? »
Cette fois-là, Bold avait répondu :
« Toujours, grand khan. J’étais là quand nous avons conquis le Ferghana, le Khorasan, le Sistan, le Kharezm et le Gulistan. Je suis d’accord pour repartir à la conquête. »
Tamerlan avait éclaté d’un rire furieux.
« Mais vers où, cette fois, Bold ? Vers où ? »
Bold, qui n’était pas tombé de la dernière pluie, avait haussé les épaules.
« Pour moi, grand khan, c’est pareil. Et si vous jouiez ça à pile ou face ? »
Ce qui lui avait valu un nouveau rire, une place au chaud dans l’écurie, cet hiver-là, et un bon cheval pour faire campagne. Puis, au printemps de l’année 784, ils s’en étaient allés vers l’ouest.
À présent, de l’autre côté du feu, aussi réel que s’il avait été vivant, le fantôme de Tamerlan regardait Bold d’un air de reproche.
— J’ai joué à pile ou face, comme tu me l’avais conseillé, Bold. Mais la pièce a dû tomber du mauvais côté.
— La Chine aurait peut-être été pire, répondit Bold.
Tamerlan ricana méchamment.
— Je ne vois pas comment ç’aurait pu être pire ! Tué par la foudre ? Qu’aurait-il pu m’arriver de pire ? C’est ta faute, Bold. La tienne et celle de Psin. C’est vous qui avez amené la malédiction de l’Ouest avec vous. Vous n’auriez jamais dû revenir. Et j’aurais dû partir pour la Chine.
— Peut-être.
Bold ne savait pas comment se débarrasser de lui. Les fantômes en colère devaient être affrontés autant qu’apaisés. Mais ces yeux d’un noir de jais, aussi brillants que des étoiles…
Soudain, Tamerlan se mit à tousser. Il porta la main à sa bouche et cracha quelque chose de rouge. Il regarda sa main puis la tendit vers Bold pour lui montrer : un œuf rouge.
— C’est à toi, dit-il en le lançant par-dessus les flammes dans sa direction.
Bold se tortilla pour l’attraper et se réveilla. Il eut un gémissement. Il était clair que le fantôme de Tamerlan n’était pas heureux. Errant entre les mondes, rendant visite à ses vieux soldats comme n’importe quel prêta… D’une certaine façon, c’était pathétique, mais Bold n’arrivait pas à chasser sa peur. L’esprit de Tamerlan recelait un grand pouvoir, dans quelque royaume qu’il fût. Il pouvait tendre la main dans ce monde et attraper le pied de Bold à tout moment.
Ce jour-là, Bold s’aventura vers le sud dans un brouillard de souvenirs, voyant à peine la campagne devant lui. La dernière fois que Tamerlan lui avait rendu visite, dans les écuries, cela avait été pénible, parce que le khan ne pouvait plus monter à cheval. Il avait regardé une solide jument noire comme s’il s’était agi d’une femme, lui avait caressé le flanc et avait dit à Bold :
« Le premier cheval que j’ai volé ressemblait exactement à celui-ci. J’ai commencé dans la misère. La vie était dure. Dieu a placé un signe sur moi. Mais il aurait quand même pu me faire mourir à cheval. »
Il avait braqué son regard intense sur Bold, un œil légèrement plus haut et plus grand que l’autre, comme dans le rêve. Sauf que, dans la vie, il avait les yeux marron.
La faim obligeait Bold à continuer la chasse. Mais Tamerlan, ce fantôme affamé, n’avait plus besoin de manger ; contrairement à Bold. Tout le gibier fuyait vers le sud, le long des vallées. Un jour, du haut d’une crête, il vit une nappe d’eau, couleur de bronze. Un grand lac, ou une mer. De vieilles routes le menèrent par un autre col, dans une autre ville.
Là encore, il n’y avait que des morts. Tout était immobile, silencieux. Bold s’aventura dans des rues vides, entre des bâtiments vides, sentant les mains froides des prêtas courir le long de son dos.
Sur la colline, au centre de la cité, se dressaient les ruines de temples blancs, pareils à des os blanchis par le soleil. En les voyant, Bold décida qu’il avait trouvé la capitale de ce pays mort. Il avait marché depuis les villes périphériques de pierre grossière jusqu’aux temples de marbre blanc, lisse, de la capitale, pour s’apercevoir qu’il n’y avait pas de survivants. Un brouillard blanc emplissait sa vision, il erra dans les rues crayeuses, gravit la colline du temple pour plaider sa cause auprès des dieux locaux.
Sur le plateau sacré, trois petits temples en flanquaient un plus grand, une splendeur rectangulaire avec des doubles rangées de colonnes lisses sur les côtés, soutenant un toit de marbre étincelant. Sous les avancées du toit, des silhouettes sculptées se battaient, défilaient, volaient, gesticulaient, dans un grand tableau de pierre décrivant le peuple disparu, ou ses dieux. Bold s’assit sur le socle de marbre d’une colonne à long chapiteau et leva les yeux vers les sculptures de pierre, regardant ce monde pétrifié.
Pour finir, il entra dans le bâtiment en priant à haute voix. Tout compte fait, contrairement aux grands temples de pierre du Nord, ce n’était pas un lieu de réunion ; il n’y avait pas de squelettes à l’intérieur. En vérité, il paraissait abandonné depuis de nombreuses années. Des chauves-souris étaient accrochées aux poutres, et l’obscurité était trouée par des rayons de soleil filtrant à travers les tuiles cassées du toit. À l’autre extrémité du temple, une sorte d’autel avait été érigé en hâte. Une unique chandelle s’y consumait dans un pot d’huile. Leur dernière prière, qui brûlait encore, longtemps après leur mort.
Bold n’avait rien à offrir en sacrifice, et le grand temple blanc se dressait, silencieux, au-dessus de lui.
— Parti, parti, parti au-delà, parti complètement au-delà. Complet éveil ! Ainsi soit-il !
Mais les colonnes seules entendirent ses paroles et se les répétèrent à l’infini.
Il ressortit en titubant dans l’aveuglante clarté de l’après-midi et vit, au sud, l’eau qui miroitait. C’est par là qu’il irait. Il n’y avait rien, ici, pour le retenir ; les hommes et leurs dieux étaient morts.
La mer s’avançait entre les collines. Le port, au bout de la baie, était vide, en dehors de quelques petites barques frappées par les vagues, ou retournées sur la plage de galets qui se perdait dans la lagune. Mais il ne connaissait rien aux bateaux et n’osa pas en prendre un. Il avait vu le lac Issyk Kul et celui de Qinghai, la mer d’Aral, la Caspienne et la mer Noire, mais il n’avait jamais pris de bateau, hormis les bacs qui permettaient de traverser les fleuves. Il n’avait pas envie de commencer.
Longue route sans voyageurs,
Nuit solitaire, horizon veuf de bateau,
Rien ne bouge dans ce port,
Tout est mort.
Sur la plage, il puisa de l’eau dans sa main en coupe, la but, et la recracha : elle était salée, comme la mer Noire ou les sources du bassin de Tarim. C’était drôle de voir une telle étendue d’eau saumâtre. Il avait entendu dire que la Terre était entourée d’eau. Il était peut-être au bout du monde. À sa limite ouest, ou sud ? Peut-être les Arabes vivaient-ils au sud de cette mer ? Il ne savait pas. Pour la première fois depuis le début de son errance, il avait vraiment l’impression de ne pas savoir où il se trouvait.
Il dormit sur le sable chaud d’une plage, rêvant des steppes, essayant de maintenir Tamerlan hors de son rêve par la seule force de sa volonté. Soudain, il fut secoué par des mains vigoureuses qui le firent rouler sur le ventre et lui attachèrent les jambes et les bras dans le dos. On l’obligea à se relever.
Un homme dit « Qu’est-ce que c’est que ça ? » ou quelque chose de similaire. Il parlait un sabir qui ressemblait à du turc. Bold n’en connaissait pas beaucoup de mots, mais c’était un genre de turc, et il arrivait généralement à en saisir le sens. Les hommes, autour de lui, avaient l’air de soldats, ou peut-être de brigands, de gros ruffians aux mains rudes, qui portaient des boucles d’oreilles en or et des vêtements de coton sale. En les voyant, il se mit à pleurer tout en souriant comme un idiot ; il sentit son visage se crisper et ses yeux le brûler. Ils le regardaient avec méfiance.
— Un fou, risqua l’un des hommes.
Bold secoua la tête.
— Je… je n’ai vu personne, dit-il en turc.
Mais il avait l’impression d’avoir les lèvres engourdies. En dépit de ses babillages avec lui-même et avec les dieux, il avait oublié comment parler aux gens.
— Je croyais que tout le monde était mort, reprit-il tant bien que mal avec un geste de la tête en direction du couchant.
Ils n’avaient pas l’air de le comprendre.
— Tuez-le, dit l’un d’eux, aussi expéditif que Tamerlan.
— Tous les chrétiens sont morts, répondit un autre.
— Tuez-le, allez ! Les bateaux sont pleins.
— Amenez-le, dit l’autre. Les marchands d’esclaves nous en donneront bien quelque chose. Il ne fera pas couler la barque ; il n’a que la peau sur les os, ajouta-t-il.
Ou quelque chose dans ce goût-là. Ils le tirèrent au bout d’une corde jusqu’à la plage. Bold devait se dépêcher pour ne pas tomber, et l’effort lui faisait tourner la tête. Il n’avait pas beaucoup de forces. Les hommes sentaient l’ail, ce qui réveillait sa faim, bien que ce fut une mauvaise odeur. Mais s’ils avaient l’intention de le vendre au marché aux esclaves, ils devraient lui donner à manger. Bold en avait tellement l’eau à la bouche qu’il salivait comme un chien. Son visage était baigné de larmes et son nez coulait. Ayant les mains attachées dans le dos, il ne pouvait s’essuyer.
— Ce qu’il bave ! On dirait un cheval.
— Il est malade.
— Il n’est pas malade. Amenez-le. Allez ! fit l’homme à l’intention de Bold. N’aie pas peur. Là où on t’emmène, même les esclaves vivent mieux que vous autres, chiens de barbares.
Puis on le poussa par-dessus le bord d’une barque échouée sur le sable. Il y eut de brutales secousses, et on la mit à l’eau, où elle se balança violemment. Il roula aussitôt sur le côté, contre la paroi de bois.
— Lève-toi et assieds-toi là, esclave ! Sur ce rouleau de corde !
Il s’assit pendant qu’ils travaillaient. Quoi qu’il puisse arriver, c’était toujours mieux que le désert qu’il venait de traverser. Rien que de voir bouger des hommes, de les entendre parler, le comblait. C’était comme de regarder des chevaux courir sur la steppe. Il les observa avidement hisser une voile, puis le bateau eut un soubresaut si violent qu’il s’écrasa le nez sur le pont. Ce qui fit rugir de rire l’équipage. Bold eut un sourire penaud et désigna la grande voile latine :
— Il faudrait un peu plus de vent que ce soupir pour nous faire chavirer.
— Allah nous protège !
— Allah nous protège !
Des musulmans !
— Allah nous protège, dit poliment Bold, en arabe. Au nom de Dieu, le miséricordieux, le très miséricordieux.
Pendant les années qu’il avait passées dans l’armée de Tamerlan, il avait appris à être aussi musulman que n’importe qui. Bouddha se fichait de ce qu’on pouvait dire par politesse. Bien sûr, ça ne l’empêcherait pas de finir en esclavage, mais ça lui vaudrait peut-être un peu de nourriture. Les hommes le considéraient avec curiosité. Il regardait défiler la côte. Ils lui détachèrent les bras et lui donnèrent un peu de pain et de mouton séché. Il essaya de mâcher chaque bouchée une centaine de fois. Ces saveurs familières lui rappelaient toute sa vie. Il mangea, et but l’eau fraîche d’une tasse qu’ils lui tendirent.
— Loué soit Allah. Merci, au nom de Dieu, le miséricordieux, le très miséricordieux.
Ils longèrent une vaste baie, et prirent le large. La nuit venue, ils mouillèrent l’ancre à l’abri d’un cap. Bold se pelotonna sous un rouleau de corde et dormit d’un sommeil agité. Il se réveilla souvent, se demandant où il était.
Le matin, ils repartirent, toujours vers le sud. Un jour, enfin, ils franchirent un long défilé et se retrouvèrent en pleine mer, ballottés par les vagues. Le roulis du bateau lui rappelait la démarche du chameau. Bold fit un geste interrogateur en direction de l’ouest. Les hommes lui dirent un nom, que Bold ne comprit pas.
— Ils sont tous morts, lui dirent-ils.
Quand le soleil se coucha, ils étaient toujours au large. Pour la première fois, ils passèrent la nuit en pleine mer. Ils ne dormirent pas. Chaque fois que Bold se réveillait, il les voyait observer les étoiles en silence. Pendant trois jours, ils voguèrent sans voir la terre, et Bold se demanda combien de temps ça durerait. Mais le matin du quatrième jour, le ciel au sud devint blanc, puis brun.
Une brume sèche, poudreuse,
Comme venue du Gobi. Terre !
Terre à l’horizon. La mer et le ciel
Se fondent dans un même brun.
Surgit une tour de pierre,
Puis une grande jetée, devant un port.
L’un des marins lança joyeusement : « Alexandrie ! » Bold avait entendu ce nom, mais n’en savait pas davantage. Nous non plus. Et si vous voulez savoir comment tout cela continue, vous n’avez qu’à lire le chapitre suivant.
3
En Égypte, notre pèlerin est vendu comme esclave ; à Zanj, nouvelle rencontre avec les inévitables Chinois
Ses ravisseurs naviguèrent jusqu’à une plage, amarrèrent leur barque à l’aide d’une pierre attachée à une corde, ligotèrent Bold et le laissèrent à bord, sous une couverture.
C’était une plage pour les petits bateaux, non loin d’un immense quai, de l’autre côté de la digue, où mouillaient de plus gros navires. À leur retour, les hommes étaient soûls et se disputaient. Ils tirèrent Bold de la barque, lui délièrent les jambes et, sans lui adresser la parole, le poussèrent vers la muraille de la ville, que Bold trouva bien vieille et poussiéreuse, blanchie par les vents marins et puant au soleil comme un poisson mort – on en voyait d’ailleurs de grandes quantités pourrir çà et là. Sur les quais, devant un immense bâtiment, se trouvaient des balles de tissus, des caisses, des jarres en terre ; puis un étal de poissons, qui lui fit venir l’eau à la bouche en même temps que son estomac se mettait à gargouiller.
Ils arrivèrent au marché aux esclaves. C’était une place carrée avec une estrade au milieu, qui ressemblait un peu à celles des écoles de lamas. Trois esclaves furent vendus rapidement. Les femmes mises en vente suscitaient le plus d’intérêt et de commentaires dans la foule. Elles étaient nues, à l’exception de cordes et de chaînes, d’ailleurs inutiles. Elles se tenaient là, l’air absentes ou abattues. La plupart étaient noires, quelques-unes hâlées. On se serait cru à la fin d’une vente aux enchères, quand on brade le rebut. Avant Bold, une gamine émaciée de dix ans fut achetée par un gros homme habillé de robes de soie sales. La transaction se fit dans une sorte d’arabe, et elle partit pour quelques pièces d’or, dans une monnaie dont Bold n’avait jamais entendu parler. Il aida ses ravisseurs à lui retirer ses vieux habits.
— Inutile de m’attacher, essaya-t-il de leur dire en arabe.
Mais ils ne l’écoutèrent pas et lui entravèrent les chevilles.
Il marcha jusqu’à l’estrade, dans la chaleur cuisante du soleil. Il sentait mauvais, et il se rendit compte que son séjour dans la contrée vide l’avait laissé aussi amaigri que la petite fille qu’on venait de vendre. Il n’avait plus que la peau sur les os. Il se redressa, regarda le soleil tandis que les enchères commençaient et se récita le soutra du Lapis Lazuli : « Les démons étrangers de la méchanceté parcourent la Terre. Parti, parti ! Le Bouddha renonce à l’esclavage ! »
— Est-ce qu’il parle arabe ? demanda quelqu’un.
Un de ses ravisseurs lui flanqua un coup de coude, alors Bold lança, en arabe :
— Au nom de Dieu le miséricordieux, le très miséricordieux, je parle arabe, et aussi turc, mongol, ulu, tibétain et chinois.
Puis il commença à réciter la première sourate du Coran ou du moins ce qu’il en savait encore, jusqu’à ce qu’on tire sur sa chaîne, ce qu’il interpréta comme l’ordre de se taire. Il avait très soif.
Un petit Arabe fluet l’acheta pour vingt quelque chose. Ses ravisseurs eurent l’air contents. Ils lui tendirent ses vêtements alors qu’il descendait de l’estrade, lui flanquèrent une tape dans le dos et s’en allèrent. Il s’apprêtait à remettre son vieux manteau crasseux lorsque son nouveau propriétaire l’arrêta et lui tendit une sorte de drap de coton propre.
— Enroule-toi là-dedans et laisse tes vieux vêtements ici.
Surpris, Bold regarda par terre les vestiges de son ancienne vie. Ce n’étaient que de vieilles hardes, mais elles l’avaient suivi jusqu’ici. Abandonnant le couteau caché dans sa manche, il récupéra son amulette, mais son nouveau maître la lui prit et la jeta sur sa défroque.
— Allons, je connais un marché à Zanj où je peux vendre un barbare comme toi trois fois le prix que je t’ai payé. En attendant, tu peux m’aider à préparer notre voyage jusque là-bas. Tu comprends ? Aide-moi, et tout ira mieux pour toi. Je te donnerai plus à manger.
— Je comprends.
— Tu as intérêt. N’essaye même pas de t’échapper. Alexandrie est une ville superbe. Les mamelouks y font régner une loi encore plus dure que la charia. Il n’y a pas de pardon pour les esclaves en fuite. Ce sont des orphelins ramenés ici des confins de la mer Noire, des hommes dont les parents ont été tués par des barbares comme toi.
En fait, Bold avait lui-même tué quelques-uns des hommes de la Horde d’Or, aussi hocha-t-il la tête sans faire de commentaires.
— Les Arabes les ont élevés selon les préceptes d’Allah, et ce sont maintenant plus que des musulmans, dit son maître avec un sifflement suggestif. On les a entraînés à diriger l’Égypte sans se préoccuper des détails, à n’être fidèles qu’à la charia. Crois-moi, tu n’aimerais pas tomber sur eux.
— Je comprends, acquiesça Bold.
Traverser le Sinaï rappelait à Bold ses voyages en caravane, dans les déserts du cœur du monde, si ce n’est que, cette fois, il marchait en compagnie des esclaves, au milieu des nuages de poussière, dans le sillage des chameaux. Ils avaient rejoint le haj de l’année. Un nombre incroyable de chameaux et de pèlerins avaient foulé cette route dans le désert, et maintenant c’était une large piste poussiéreuse passant au pied de collines rocailleuses. Ils croisèrent quelques groupes, plus petits, qui montaient vers le nord. Jamais Bold n’avait vu autant de chameaux.
Le caravansérail était une vieille bâtisse aux murs lépreux, couverts de salpêtre. On n’ôtait jamais les cordes qui attachaient les esclaves les uns aux autres, et ils dormaient en rond par terre. Les nuits étaient plus douces que celles auxquelles Bold était habitué, ce qui compensait la canicule des journées. Leur maître, qui s’appelait Zeyk, leur donnait suffisamment à boire et à manger, matin et soir, les traitant en cela aussi bien que ses chameaux. Un commerçant prenant soin de ses marchandises et qui faisait de son mieux pour que la cordée d’esclaves dépenaillés reste en forme, se disait Bold, qui approuvait cette attitude. Si tous avançaient du même pas, la marche n’en était que facilitée. Une nuit, il leva les yeux et vit que l’Archer le regardait, du haut du ciel. Cela lui rappela les nuits qu’il avait passées seul dans la campagne vide.
Fantôme de Tamerlan,
Dernier survivant d’un peuple de pêcheurs,
Temples de pierre vides offerts au ciel,
Jours de disette, petite jument,
Arc et flèches ridicules,
Oiseau rouge, oiseau bleu, perchés aile à aile.
Arrivés à la mer Rouge, ils montèrent à bord d’un bateau trois ou quatre fois plus long que celui qui les avait amenés à Alexandrie, et qu’ils nommaient indifféremment boutre ou sambouk. Ils suivaient la côte occidentale au plus près, par fort vent d’ouest, leur grande voile latine gonflée comme le ventre du Bouddha. Ils avançaient à vive allure. Zeyk nourrissait de mieux en mieux son lot d’esclaves. Il les engraissait pour le marché. Bold ingurgitait avec plaisir sa ration supplémentaire de riz et de concombres, et constatait que les plaies de ses chevilles commençaient à cicatriser. Pour la première fois depuis longtemps, la faim le laissait tranquille. Il avait l’impression de sortir du brouillard ou d’un rêve, de s’éveiller un peu plus chaque jour. Bien sûr, il était esclave, mais ce ne serait pas toujours le cas. Il arriverait forcément quelque chose.
Après une escale dans un port sec et brun appelé Massawa, l’une des haltes sur le chemin du pèlerinage, ils mirent la voile vers la mer Rouge, à l’est, bordèrent le cap rouge, bas sur l’horizon, qui marquait la fin de l’Arabie, et descendirent vers Aden. C’était une grande oasis en bord de mer, en fait le plus grand port que Bold ait jamais vu, une ville extrêmement riche, pleine de citronniers, de palmiers qui dansaient au-dessus des toits de céramique et d’innombrables minarets. Zeyk ne débarqua ni ses marchandises ni ses esclaves, et, après avoir passé la journée à terre, revint l’air soucieux.
— Mombasa, dit-il au capitaine du navire.
Il lui redonna quelques pièces, et ils remirent le cap vers le sud, empruntèrent le détroit, contournèrent la corne de l’Afrique, laissèrent Ras Hafun derrière eux, et longèrent la côte de Zanj. Bold n’était jamais descendu si loin au sud. Dans le ciel sans nuages, le soleil brillait du matin au soir, les cuisant cruellement le midi, quand il était au zénith. L’air était brûlant comme dans un four. La côte passait sans transition d’un brun terne à un vert vibrant. Ils s’arrêtèrent à Mogadiscio, Lamu, Malindi, autant de prospères ports de commerce arabes, mais Zeyk ne s’y attarda pas.
En arrivant à Mombasa, le plus grand port où ils avaient fait escale depuis leur départ, ils virent une flotte de navires gigantesques, d’une taille inimaginable pour Bold. Chacun d’eux était aussi grand qu’une petite ville, avec une longue rangée de mâts au milieu. Une vingtaine de bateaux plus petits avaient mouillé l’ancre au milieu d’une dizaine de ces puissantes nefs.
— Fort bien, dit Zeyk au capitaine et propriétaire du sambouk. Les Chinois sont là.
Les Chinois ! Bold n’aurait jamais imaginé qu’ils puissent avoir une flotte pareille. D’un autre côté, ce n’était pas étonnant. Leurs pagodes, leur muraille : ils aimaient construire grand.
La flotte ressemblait à un archipel. Tous à bord du sambouk regardaient, stupéfaits, intimidés, les navires extraordinaires, comme s’ils avaient contemplé des dieux marins. Les immenses navires chinois étaient aussi longs qu’une douzaine de boutres, et Bold compta neuf mâts sur l’un d’eux. Zeyk surprit son regard et dit, avec un mouvement du menton :
— Observe-les bien. L’un d’eux sera bientôt ta nouvelle demeure, si Dieu le veut.
Le propriétaire du sambouk profita de la brise qui soufflait du large pour les amener à terre. Le port était entièrement occupé par les chaloupes qui débarquaient les arrivants et, après quelques discussions avec Zeyk, le propriétaire du sambouk décida d’accoster juste au sud du front de mer. Zeyk et son associé relevèrent le bas de leur robe et s’avancèrent dans l’eau, pour aider la longue file d’esclaves à gagner la terre. L’eau verte était aussi chaude que du sang, plus chaude même.
Bold reconnut quelques Chinois vêtus, malgré la chaleur, de leur épais manteau de feutre rouge. Ils parcoururent le marché, touchant les marchandises sur les éventaires et jacassant, marchandant à l’aide d’un traducteur que Zeyk connaissait. Zeyk s’approcha de lui et le salua avec effusion, demandant à traiter directement avec les Chinois. Le traducteur le présenta à quelques-uns des Chinois, qui se montrèrent polis, voire affables, à leur manière. Bold se mit à trembler légèrement, peut-être de chaleur et de faim, peut-être de voir ces Chinois, après toutes ces années, à l’autre bout du monde, commerçant comme toujours. Comme si de rien n’était.
Zeyk et son assistant menèrent les esclaves à travers le marché. C’était une effusion d’odeurs, de couleurs et de sons. Des gens noirs comme la poix, leurs dents blanches ou jaunes contrastant fortement avec leur peau, vantant leurs produits et marchandant joyeusement. Bold suivit les autres à travers des
Montagnes de fruits jaunes et verts,
De riz, de café, de poissons séchés et d’encornets,
De balles de coton et de tissus multicolores,
À pois ou à rayures, bleues et blanches.
À perte de vue, tout n’était que
Coupons de soie chinoise, tapis de prière,
Grosses noisettes brunes, casseroles de cuivre
Pleines de perles ou de joyaux colorés,
Boulettes d’opium à l’odeur douceâtre,
Nacre, cuivre, cornaline, vif-argent.
Dagues et épées, turbans et châles,
Défenses d’éléphants et cornes de rhinocéros,
Bois de santal et ambre gris,
Lingots et pièces, d’or et d’argent,
Toile blanche, brocart rouge et porcelaine…
Tout ce qu’offre le monde, éclaboussé de soleil.
Le marché aux esclaves était une enclave située non loin du marché principal, avec son podium central, si semblable à l’estrade des écoles de lamas.
Les autochtones étaient massés sur l’un des côtés pour une vente de gré à gré. La plupart étaient arabes, souvent vêtus de robes bleues et de babouches de cuir rouge. Derrière le marché, une mosquée et un minaret se dressaient au-dessus de bâtiments à trois, parfois quatre étages. La rumeur était forte, mais en étudiant la scène Zeyk hocha la tête et dit :
— Nous attendrons d’être reçus en privé.
Il donna des gâteaux d’orge aux esclaves et les conduisit vers l’un des grands bâtiments situés près de la mosquée. Quelques Chinois les rejoignirent, accompagnés de leur traducteur, et tous se rendirent dans une cour intérieure ombragée par des plantes à larges feuilles entourant une fontaine murmurante. Sur cette cour s’ouvrait une pièce aux murs garnis d’étagères où étaient harmonieusement disposés des bols et des statuettes. Bold reconnut des poteries de Samarkand, des figurines de Perse et des bols de porcelaine bleu de Chine, avec des motifs cuivrés et des incrustations de feuille d’or.
— Très joli, dit Zeyk.
Puis les discussions commencèrent. Les Chinois examinèrent les longues rangées d’esclaves que Zeyk avait amenées. Ils disaient quelque chose au traducteur, qui se tournait vers Zeyk. Lui parlant à l’oreille, hochant fréquemment la tête, Zeyk lui soufflait alors quelques mots. Bold se mit à transpirer bien qu’il fut transi de froid. On était en train de les vendre aux Chinois en un seul lot.
L’un des Chinois passa la rangée d’esclaves en revue et s’arrêta devant Bold.
— Comment t’es-tu retrouvé ici ? lui demanda-t-il en chinois.
Bold déglutit, fit un geste vers le nord.
— J’étais marchand, répondit-il dans un chinois un peu rouillé. La Horde d’Or m’a capturé et amené en Anatolie, puis à Alexandrie, et enfin ici.
Le Chinois hocha la tête et s’éloigna. Peu après, les esclaves furent reconduits vers le front de mer par des marins chinois en pantalons et maillots courts. Là, de nombreuses autres rangées d’esclaves attendaient. On les déshabilla, on les lava des pieds à la tête, à l’eau douce, fraîche. On leur donna des tuniques de coton écru, puis on les conduisit en barque vers l’un des gigantesques navires. Bold grimpa les quarante et une marches d’un escalier posé sur le flanc du navire, derrière un jeune et maigre esclave noir. On les fit descendre sous le pont principal, et on les mena vers une chambre, à l’arrière du navire. Ce qui se passa ensuite, nous ne vous le dirons pas ici, mais l’histoire n’aurait pas de sens si nous ne le faisions pas. Nous le verrons donc au chapitre suivant. Ces choses arrivèrent.
4
Après des événements consternants, un morceau du Bouddha apparaît ; puis la Flotte des trésors demande à Tianfei d’apaiser ses craintes
Le bateau était tellement énorme qu’on ne sentait pas le mouvement des vagues. On avait l’impression d’être sur une île. La pièce dans laquelle ils étaient gardés était vaste, basse de plafond, et s’étendait sur toute la largeur du bateau. Des grilles, des deux côtés, laissaient passer l’air et un peu de lumière, mais il faisait sombre. Un trou grillagé donnait sur le flanc du bateau et servait de lieux d’aisances.
Le garçon noir, osseux, se pencha au-dessus. Sans doute se demandait-il s’il pourrait fuir par là. Il parlait l’arabe mieux que Bold, bien que ce ne fût pas non plus sa langue natale ; il avait un accent guttural que Bold n’avait jamais entendu. « Y t’traitent kom d’la mird. » Il venait des collines de l’autre côté du Sahel, leur dit-il en regardant dans le trou. Il y mit un pied, puis l’autre. Il ne passerait pas par là.
Puis il y eut un bruit de serrure, alors il retira ses pieds du trou et recula d’un bond, comme un animal. Trois hommes entrèrent. Ils les firent se lever et se tenir debout devant eux. Des officiers mariniers, se dit Bold. Venus inspecter la cargaison. L’un d’eux examina attentivement le jeune Noir. Il fit un signe de tête aux autres, qui déposèrent par terre des bols de riz, ainsi qu’un grand bout de bambou creux contenant de l’eau. Puis ils repartirent.
Ils firent de même pendant deux jours. Le petit Noir, qui s’appelait Kyu, passait le plus clair de son temps à regarder par le trou qui servait de latrines, les yeux perdus dans le vague ou bien contemplant l’eau. Le troisième jour, on les conduisit sur le pont pour aider à charger le bateau. La cargaison fut montée à bord grâce à des cordes qui passaient sur des poulies accrochées aux mâts, puis descendue dans les soutes du navire. Les portefaix suivaient les instructions de l’officier de veille, généralement un grand Han au visage lunaire. La soute était divisée en neuf compartiments indépendants, tous plusieurs fois plus grands que les plus grands boutres de la mer Rouge. Les esclaves qui avaient déjà navigué disaient que, comme ça, le grand bateau ne pouvait pas couler ; si l’un des compartiments fuyait, on pouvait le vider et le réparer, ou on pouvait même le laisser se remplir d’eau ; les autres maintiendraient le navire à flot. En quelque sorte, cela revenait à se trouver sur neuf bateaux attachés ensemble.
Un matin, sur le pont, au-dessus de leur tête, retentit le martèlement des pieds des marins, et ils sentirent qu’on levait les deux ancres de pierre géantes. De grandes voiles furent hissées sur les espars, une par mât. Le bateau commença à se balancer lentement, régulièrement, sur l’eau, en s’inclinant légèrement.
C’était une vraie ville flottante. Des centaines d’individus vivaient à bord, déplaçant sacs et caisses, de soute en soute. Bold compta cinq cents personnes différentes, et il y en avait sûrement beaucoup plus. C’était stupéfiant, le monde qu’il pouvait y avoir à bord. Typiquement chinois, les esclaves étaient tous d’accord. Les Chinois ne voyaient pas à quel point le bateau était bondé ; pour eux, c’était normal. Ce n’était pas différent des autres villes dans lesquelles ils vivaient.
L’amiral de la grande flotte était sur leur vaisseau : Zheng He, un géant à la face plate. Un Chinois de l’Ouest, un hui, comme disaient tout bas certains esclaves. Sa présence leur valait un grouillement d’officiers, de dignitaires, de prêtres et de surnuméraires de toutes sortes sur le pont supérieur. Dans les cales, il y avait beaucoup de Noirs, de Zanjis et de Malais, qui faisaient les travaux les plus durs.
Cette nuit-là, quatre hommes entrèrent dans le quartier des esclaves. L’un d’eux, Hua Man, était le second de Zheng. Ils s’arrêtèrent devant Kyu et l’attrapèrent. Hua lui flanqua un coup sur la tête avec une courte matraque. Les trois autres remontèrent sa robe et lui écartèrent les jambes. Ils lui bandèrent étroitement les cuisses et la taille. Ils redressèrent le gamin à moitié inconscient, puis Hua tira un petit couteau incurvé de sa manche. Il attrapa le sexe du garçon et d’un seul coup de couteau le lui trancha, avec les bourses, au ras du corps. Le gamin gémit. Hua pinça la blessure qui saignait et glissa un lacet de cuir autour. Il se pencha, inséra un petit bout de métal dans la plaie, serra le lacet et le noua. Il s’approcha du trou à merde et jeta les parties génitales du garçon dans la mer. L’un de ses assistants lui tendit un tampon de papier humide qu’il colla sur la blessure, puis les autres le maintinrent en place avec des bandages.
Quand il fut bien attaché, deux des hommes prirent le gamin sous les bras et lui firent passer la porte.
Ils revinrent avec lui une ou deux gardes plus tard et l’allongèrent par terre. Apparemment, ils l’avaient fait marcher tout ce temps.
— Ne le laissez pas boire, dit Hua aux esclaves qui rentraient craintivement la tête dans les épaules. S’il boit ou s’il mange au cours des trois prochains jours, il mourra.
Le gamin gémit toute la nuit. Les autres esclaves se regroupèrent instinctivement de l’autre côté de la soute, trop terrorisés pour parler. Bold, qui avait châtré quelques chevaux en son temps, alla s’asseoir à son côté et ne le quitta plus. Le gamin avait peut-être dix ou douze ans. Son visage grisâtre avait quelque chose qui attirait Bold. Pendant trois jours, le gamin demanda de l’eau en gémissant, mais Bold ne lui en donna pas.
Le soir du troisième jour, les eunuques revinrent.
— Bon, c’est maintenant qu’on va voir s’il va vivre ou mourir, dit Hua.
Ils relevèrent le gamin, lui ôtèrent ses bandages et, d’un coup sec, Hua retira le bout de métal de la blessure. Kyu poussa un jappement et gémit pendant qu’un jet d’urine coulait de son entrejambe dans un pot de chambre en porcelaine que tenait le deuxième eunuque.
— Bien, fit Hua aux esclaves silencieux. Débrouillez-vous pour le laver. Rappelez-lui d’enlever la fiche pour se soulager et de la remettre tout de suite après, jusqu’à ce qu’il soit guéri.
Ils repartirent et fermèrent la porte.
Les esclaves abyssiniens consentirent alors à parler au gamin.
— Si tu gardes ça propre, ça cicatrisera comme il faut. L’urine le nettoie aussi, alors ça ira. Enfin, je veux dire, si tu te mouilles quand tu y vas.
— Une chance qu’ils ne nous l’aient pas fait à tous.
— Qui vous dit qu’ils ne vont pas le faire ?
— Ils ne le font pas aux adultes. Il en meurt trop. Il n’y a que les enfants qui peuvent supporter ça.
Le lendemain matin, Bold aida le gamin à s’approcher du trou à merde et à ôter le bandage pour qu’il puisse enlever la fiche et uriner. Puis Bold la lui remit et lui montra comment le faire lui-même, aussi délicatement que possible, pendant que le gamin gémissait.
— Il faut remettre la fiche, ou ça va se refermer et tu mourras.
Le gamin se recoucha sur sa chemise de coton. Il avait de la fièvre. Les autres essayèrent de ne pas regarder l’horrible blessure, mais il était difficile de ne pas la voir de temps à autre.
— Comment peuvent-ils faire une chose pareille ? demanda l’un d’eux en arabe, tandis que le gamin dormait.
— Ce sont eux-mêmes des eunuques, répondit l’un des Abyssiniens. Hua est un eunuque. L’amiral aussi est un eunuque.
— Ils devraient pourtant savoir, eux.
— Ils le savent, justement. Ils nous détestent, tous autant que nous sommes. Ils font marcher l’empereur de Chine à la baguette, et ils détestent tous les autres. Vous voyez ce qui va se passer, fit-il en indiquant l’immense vaisseau d’un geste du bras. Ils vont tous nous castrer. La fin est proche.
— Vous adorez dire ça, vous autres les chrétiens, mais jusque-là, ça n’a été vrai que pour vous.
— Dieu nous a pris les premiers pour abréger nos souffrances. Votre tour viendra.
— Ce n’est pas de Dieu que j’ai peur, c’est de l’amiral Zheng. Lui, l’Eunuque aux Trois Joyaux. L’empereur Yongle est son ami d’enfance, et pourtant, quand ils avaient treize ans, il a ordonné qu’il soit castré. Vous pouvez croire ça ? Maintenant, les eunuques le font à tous les jeunes garçons qu’ils font prisonniers.
Pendant les jours qui suivirent, la fièvre de Kyu empira et il n’avait plus que de rares moments de conscience. Bold resta assis à côté de lui et lui humecta les lèvres avec des chiffons humides, récitant des soutras dans sa tête. La dernière fois qu’il avait vu son propre fils, une trentaine d’années auparavant, celui-ci avait à peu près l’âge du jeune Noir. Ses lèvres étaient grises et parcheminées, sa peau noire était terne, sèche et brûlante. Tous ceux que Bold avait vus aussi fiévreux avaient fini par mourir, alors c’était probablement une perte de temps. Il eût certainement mieux valu laisser la pauvre créature asexuée s’en aller tranquillement. Mais il continuait à lui donner de l’eau quand même. Il se rappelait comment le gamin regardait partout dans le bateau, quand ils l’avaient fait monter à bord, son regard intense, scrutateur. Et maintenant, son corps gisait là, comme celui d’une pauvre petite Africaine, malade à crever d’une infection au bas-ventre.
Et puis la fièvre passa. Kyu mangea de mieux en mieux. Mais, même quand il fut sur pied, il parla peu par rapport à avant. Son regard avait changé. Il fixait les gens à la façon d’un oiseau, comme s’il n’arrivait pas à croire ce qu’il voyait. Bold se rendit compte que le garçon avait voyagé hors de son corps. Il était allé dans le bardo et celui qui était revenu n’était plus le même. Complètement différent. Le garçon noir était mort ; celui-ci repartait de zéro.
— Quel est ton nom, maintenant ? demanda-t-il.
— Kyu, répondit le gamin, pas surpris, comme s’il ne se rappelait pas avoir déjà parlé à Bold.
— Bienvenue dans cette vie, Kyu.
Voguer sur le vaste océan était une étrange façon de voyager. Les cieux défilaient au-dessus de leur tête, mais ils n’avaient pas l’impression d’avancer. Bold avait beau se demander ce que représentait une journée de mer pour la flotte, et s’ils allaient plus vite, au bout du compte, qu’à cheval, mais il n’y arrivait pas. Il ne pouvait que regarder filer les nuages et attendre.
Vingt-trois jours plus tard, la flotte arriva à Calicut, une ville bien plus grande que tous les ports de Zanj, aussi grande qu’Alexandrie, peut-être même plus.
Bulbes et tours de grès, murailles crénelées,
Envahies par une tempête de verts.
Si près du soleil, la vie jaillit vers le ciel.
Maisons de pierre au centre de la ville,
Maisons de bois tout autour, poussant dans la jungle,
Envahissant la côte, les collines,
Jusqu’à la montagne qui étreint la ville,
Aussi loin que porte le regard.
Malgré l’immensité de la ville, toute activité cessa à l’arrivée de la flotte chinoise. Bold, Kyu et les Éthiopiens regardèrent par leur grille la foule vociférante, bigarrée, agiter les bras en l’air, stupéfaite.
— Ces Chinois ! Ils vont conquérir le monde.
— Et puis les Mongols envahiront la Chine, répondit Bold.
Il vit Kyu observer les hordes massées sur le rivage. L’expression du gamin était celle d’un preta, qu’on aurait oublié d’enterrer. Certains masques de démon avaient ce regard, le vieux regard des prêtres Bon, celui du père de Bold quand il était en colère. Un regard qui plongeait dans l’âme et disait : J’emporte ça avec moi, vous ne pourrez pas me l’enlever, n’essayez même pas. Bold frémit en voyant ce regard dans les yeux d’un si jeune garçon.
Les esclaves déchargèrent la cargaison dans des barques, et chargèrent sur leur vaisseau les marchandises apportées par d’autres barques. Aucun d’eux ne fut vendu, et on ne les fit descendre qu’une fois sur le rivage, pour aider à dégrouper une pyramide de ballots de tissu puis à les transporter sur les longues pirogues qu’on utilisait pour transférer les marchandises des plages vers la Flotte des trésors.
Pendant ce travail, Zheng He descendit à terre sur sa barge personnelle, qui était peinte, dorée, incrustée de joyaux et de mosaïques de porcelaine, à la proue ornée d’une statue d’or. Zheng descendit la passerelle, vêtu d’une robe d’or brodée de rouge et de bleu. Ses hommes avaient déroulé pour lui un tapis sur la plage, mais il s’en écarta pour aller observer le chargement de la nouvelle cargaison. Il était vraiment immense, aussi large que haut, et se balançait d’avant en arrière en marchant. Son visage carré n’était pas celui d’un Han ; et c’était un eunuque. Il était tout ce que les Abyssiniens disaient qu’il était. Bold l’observa du coin de l’œil et remarqua que Kyu le regardait aussi, dressé comme un cobra, oubliant son travail, les yeux rivés sur Zheng He. Un faucon guettant sa proie. Bold l’empoigna et le remit au travail.
— Allez, Kyu, on est compagnons de chaîne, ici. Tu avances ou je t’assomme et je te traîne par terre. Je ne veux pas avoir d’ennuis. Tara sait ce qui pourrait arriver à un esclave qui s’attirerait des histoires avec ces gens-là.
En quittant Calicut, ils mirent le cap vers le sud et Lanka. Là, les esclaves furent laissés à bord du bâtiment, pendant que les soldats descendaient à terre, où ils disparurent pendant plusieurs jours. Le comportement des officiers restés à bord faisait penser à Bold que le détachement était en campagne. Ne cessant de les épier, il constata qu’ils étaient de plus en plus nerveux au fur et à mesure que les jours passaient. Il n’avait pas idée de ce qu’ils feraient si Zheng He ne revenait pas, mais il ne pensait pas qu’ils lèveraient l’ancre. En fait, les artificiers s’activèrent fébrilement, étalant leurs ressources incendiaires, pendant que la barge de l’amiral et les autres vaisseaux revenaient toutes voiles dehors du port intérieur de Lanka, leurs hommes remontant à bord en poussant des cris triomphants. Ils s’étaient sortis d’une embuscade tendue dans l’intérieur des terres, racontaient-ils, et avaient capturé l’usurpateur local, ce traître qui leur avait tendu l’embuscade. Ils avaient également capturé le roi légitime, pour faire bonne mesure, bien qu’à ce stade l’histoire semblât assez confuse quant à savoir qui était qui, et pourquoi ils avaient déposé le roi légitime en même temps que l’usurpateur. Le plus stupéfiant, c’est qu’ils disaient que le roi légitime avait en sa possession la relique la plus sainte de l’île, une dent du Bouddha appelée le Dalada. Zheng éleva le petit reliquaire d’or pour montrer la prise de guerre à tout le monde. Une canine, apparemment. L’équipage, les passagers, les esclaves, tous se mirent à hurler à s’en arracher la gorge.
— C’est une immense chance, dit Bold à l’oreille de Kyu quand le bruit eut un peu diminué.
Il joignit les mains et récita le soutra de la Descente à Lanka.
En réalité, c’était un tel coup de chance que ça l’effrayait. Et il n’y avait aucun doute que la peur entrait pour une bonne part dans les hurlements de l’équipage. Le Bouddha avait béni Lanka, c’était dorénavant un endroit à part. Une branche de l’arbre pipal poussait dans son sol, et ses larmes minéralisées coulaient encore sur les flancs de la montagne sacrée qui se dressait au centre de l’île ; la même que celle au sommet de laquelle se trouvait une empreinte de pied d’Adam. Il n’était sûrement pas bien d’enlever le Dalada de sa place légitime, qui était cette terre sacrée. Cet acte relevait indéniablement du blasphème.
Pendant qu’ils mettaient le cap à l’est, une histoire se mit à circuler à bord : le Dalada était la preuve que le roi déposé avait le droit de régner ; il serait restitué à Lanka quand l’empereur Yongle aurait déterminé les droits des uns et des autres dans cette affaire. Les esclaves furent rassurés par cette nouvelle.
— Alors, c’est l’empereur de Chine qui va décider qui doit régner sur cette île ? demanda Kyu.
Bold acquiesça. L’empereur Yongle était lui-même monté sur le trône à l’issue d’un violent coup d’État, et Bold ne voyait pas vraiment lequel des deux prétendants au trône de Lanka il fallait privilégier. En attendant, le Dalada était à bord.
— C’est bien, dit-il à Kyu après réflexion. En tout cas, rien de mauvais ne peut nous arriver pendant cette traversée.
C’est bien ce qui se passa. Les nuages noirs d’une tempête qui se dirigeait vers eux se dissipèrent mystérieusement juste au moment où ils allaient éclater. Des vagues géantes se dressaient sur l’horizon, d’énormes queues de dragon fouaillaient visiblement les vagues, alors qu’ils voguaient sereinement au centre, sur une mer d’huile qui se déplaçait sous eux. Ils passèrent même le détroit de Malacca sans être attaqués par les pirates de Palembanque ou, plus au nord, de Cham, ou encore par les Wakou japonais – bien que, comme le fit remarquer Kyu, aucun pirate doté d’un minimum de bon sens n’eût défié une flotte aussi énorme et puissante, dent du Bouddha ou non.
Puis, alors qu’ils voguaient dans le sud de la mer de Chine, quelqu’un vit le Dalada planer sur le vaisseau, la nuit, comme une petite flamme de chandelle.
— Comment sait-il que ce n’était pas la flamme d’une chandelle ? demanda Kyu.
Mais le lendemain matin, quand le soleil se leva, le ciel était rouge. De gros nuages noirs bouillonnaient à l’horizon, venant du sud en rangs serrés. Ils rappelaient fortement à Bold l’orage qui avait tué Tamerlan.
Une pluie battante s’abattit sur eux, poussée par un vent violent. La mer devint toute blanche. En montant et en descendant dans leur petite cale obscure, Bold se rendit compte que ce genre de tempête était encore plus terrifiant en mer que sur la terre ferme. L’astrologue du bord déclara qu’un grand dragon s’énervait dans les profondeurs de la mer, et que c’était lui qui agitait les eaux sur lesquelles ils voguaient. Bold rejoignit les autres esclaves cramponnés aux grilles et regarda par leurs minuscules ouvertures s’ils pouvaient voir la colonne vertébrale, les griffes ou le mufle du dragon, mais les embruns qui volaient sur les eaux blanches en brouillaient la surface. Pourtant, Bold crut entrevoir un bout de queue verte dans l’écume.
Vents hurlants dans les neuf mâts,
À sec de toile. Grand vaisseau couché sur les flots,
Roule et tangue. Petits vaisseaux
ballottés comme des coques de noix,
Apparaissent et disparaissent par la grille.
Quelle tempête ! Une seule chose à faire :
Se cramponner !
Bold et Kyu écoutent dans la tourmente
Crier les officiers et courir les matelots
Pour attacher les voiles
Et fixer la barre, solidement.
Peur dans les voix, peur dans les pas.
Paquets de mer, gifles d’eau,
Même à fond de cale ils sont trempés.
Sur le grand pont arrière, les officiers et les astrologues prenaient part à une cérémonie d’apaisement, et l’on entendait Zheng He en personne invoquer Tianfei, la déesse chinoise protectrice des marins.
— Que les dragons des eaux noires replongent dans l’océan et nous préservent des calamités ! Humblement, respectueusement, pieusement, nous offrons ce flacon de vin, l’offrons une fois et l’offrons encore, répandant ce bon vin odorant ! Que nos voiles se gonflent de vents favorables, que les routes de la mer soient paisibles, que les esprits-soldats des vents et des saisons qui voient tout et qui entendent tout, qui domptent les vagues et boivent la houle, les immortels qui voguent dans les airs, le Dieu de l’année et la protectrice de notre vaisseau, l’Épouse Céleste, la brillante, la divine, la merveilleuse, la sensible, la mystérieuse Tianfei nous sauvent !
En regardant par les fissures ruisselantes du pont, Bold voyait une image composite de matelots qui assistaient à la cérémonie, bouche bée, poussant des cris pour se faire entendre malgré les rugissements du vent. Leur garde hurlait : « Priez Tianfei ! Priez l’Épouse Céleste, la seule amie du marin ! Priez pour son intercession ! Vous tous ! Encore un peu de ce vent, et le vaisseau sera déchiqueté ! »
— Que Tianfei nous protège ! entonna Bold en pressant le bras de Kyu, l’incitant à faire de même.
Le jeune Noir l’ignora. Mais il indiqua les mâts visibles à travers la grille de l’écoutille. Bold leva les yeux et vit des filaments de lumière rouge danser entre les mâts : des boules de feu, comme les lanternes chinoises, mais sans le papier, ni le feu, qui brillaient à la pointe du mât et au-dessus, illuminant la pluie battante fouettée par le vent, et jusqu’au ventre noir des nuages qui filaient dans le ciel. Sa beauté surnaturelle tempérait l’épouvante qu’aurait dû lui inspirer cette vision ; Bold et tous les autres sortirent du royaume de la terreur. C’était un spectacle trop étrange et terrifiant pour qu’ils s’inquiètent plus longtemps de la vie ou de la mort. Les hommes hurlaient, priaient de toute la force de leurs poumons. Tianfei sortit de la lumière rouge, vacillante, sa silhouette illumina brièvement tout ce qui était au-dessus d’eux, et le vent tomba d’un seul coup. Les flots se calmèrent. Tianfei se perdit dans le berceau de sa lumière rouge, par-dessus le bastingage, et s’éleva dans les airs. À présent, leurs cris de gratitude couvraient le tumulte du vent. Les vagues coiffées d’écume poursuivaient leur danse frénétique, mais elles s’éloignaient d’eux, rejoignant l’horizon.
— Tianfei ! hurla Bold, avec les autres. Tianfei !
Zheng He, planté à la poupe, leva les deux mains dans la pluie devenue bruine. Il hurlait : « Tianfei ! Tianfei nous a sauvés ! » Et tous beuglaient avec lui, pleins de joie, de la même façon que l’air était plein de la lumière rouge de la déesse. Par la suite le vent se remit à souffler avec force, mais ils n’avaient plus peur.
Ce qu’il advint après n’est pas très important. Le reste de la traversée se fit sans encombre, et ils rentrèrent tranquillement au bercail. Quant à ce qui arriva ensuite, vous l’apprendrez en lisant le chapitre suivant.
5
Dans un restaurant de Hangzhou, Bold et Kyu rejoignent leur jati ; en un instant, l’harmonie de plusieurs mois se brise
Ballottée par l’orage, protégée par Tianfei, la Flotte des trésors mit le cap vers un estuaire immense. À terre, de l’autre côté du front de mer, se devinaient les toits d’une gigantesque cité. Le peu que Bold en voyait depuis le navire était plus grand que toutes les villes qu’il avait vues auparavant – tous les bazars d’Asie centrale, les villes indiennes rasées par Tamerlan, les villes fantômes du Franjistan, les blanches villes côtières de Zanj, de Calicut – toutes ensemble n’auraient occupé que le quart ou le tiers du territoire couvert par cette forêt, cette steppe de toits, qui s’étendait à perte de vue, jusqu’aux crêtes des collines visibles à l’ouest.
Les esclaves se tenaient sur le pont du grand bateau, silencieux au milieu des Chinois qui criaient « Tianfei, Épouse Céleste, merci ! » et « Hangzhou, mon pays, jamais je n’aurais cru te revoir ! », « Pays, femme, fête du nouvel an ! », « Nous sommes des hommes heureux, heureux d’être allés jusqu’au bout du monde et d’en être revenus ! », et ainsi de suite.
On jeta les lourdes ancres de pierre à la mer. Là où le Chientang se perdait dans l’estuaire, un puissant mascaret aurait entraîné n’importe quel navire mal ancré, l’échouant dans les eaux peu profondes ou le repoussant au large. Quand les navires furent bien amarrés commença le travail de déchargement. C’était une opération importante, et une fois, alors qu’il mangeait son riz entre deux tours au palan, Bold remarqua qu’il n’y avait ni chevaux, ni chameaux, ni buffles, ni mules, ni ânes pour aider à la tâche, que ce fut pour décharger le navire ou ailleurs dans la ville. Il n’y avait que d’interminables colonnes de travailleurs, qui y faisaient entrer la nourriture et les marchandises, et en faisaient sortir les ordures et les excréments. Les colonnes se croisaient, entrant et sortant de la ville, continuellement, surtout par le canal, entrant et sortant, comme si la ville était un monstrueux corps impérial étendu sur la côte, que des myriades de serviteurs s’activaient à nourrir et soigner.
Bien des jours se passèrent à décharger le navire. Bold et Kyu virent un peu le port de Kanpu, et même Hangzhou, en manœuvrant les barges vers les entrepôts d’État, sous l’enceinte de la colline sud qui était autrefois, des siècles auparavant, celle du palais impérial. À présent, ces bâtiments n’étaient plus occupés que par quelques fonctionnaires, des eunuques de haut rang et de petits nobles. Plus au nord se dressait la muraille de la vieille ville, encombrée par un entassement de bâtiments en bois, hauts de quatre, cinq et parfois même six étages. Bold et Kyu regardaient tout cela bouche bée, en déchargeant les barges le long du canal. Sur les balcons de ces vieilles constructions au toit envahi d’herbes, les habitants mettaient des graines à sécher au soleil.
Kyu les observait de son regard d’oiseau. Il n’avait l’air ni surpris, ni effrayé, ni même impressionné. « Il y en a quand même beaucoup », finit-il par concéder. Il demandait sans arrêt à Bold quels étaient les mots chinois pour telle et telle chose, et comme il voulait répondre à Bold en chinois, il apprit bon nombre d’autres mots par lui-même.
Une fois le déchargement des marchandises achevé, les esclaves de leur navire furent réunis et conduits à la Colline du Phénix, « la colline des étrangers », et vendus à un marchand local appelé Shen. Il n’y avait pas de marché aux esclaves, et cela se fit sans enchères, sans bruits. Ils ne surent jamais combien on les avait payés, ni pourquoi on les avait achetés, ni à qui ils avaient appartenu durant leur voyage en mer. Peut-être était-ce à Zheng lui-même.
Enchaînés l’un à l’autre par les chevilles, Bold et Kyu furent emmenés à travers la foule jusqu’à une maison située au bord d’un lac, à l’ouest de la vieille ville. Le rez-de-chaussée était un restaurant. C’était le quatorzième jour de la première lune de l’année, leur dit Shen, le début de la fête des Lanternes, aussi leur faudrait-il apprendre vite, parce que l’endroit était en pleine effervescence.
Tables sorties du restaurant
Dans la grande rue longeant le lac,
Chaises occupées du matin au soir,
Lac piqueté de bateaux,
Mouchetis des lanternes bigarrées,
Verres colorés ornés de personnages,
Ivoire et jade des pommes sculptées,
Lampions de papier brûlant le temps d’une étincelle,
Petites roues tournant à la flamme des bougies,
Jetée grouillante de porteurs de lanternes,
Reflets sur l’eau, rives fourmillantes.
Et c’est ainsi qu’à la fin du jour
Le lac et toute la ville en liesse,
Étincellent dans la nuit,
Étoiles de la fête.
Il est de ces moments, surprenants de beauté.
La plus vieille femme de Shen, I-Li, dirigeait l’établissement d’une main de fer. Bold et Kyu se retrouvèrent bientôt à transporter des sacs de riz d’ils ne savaient combien de tonnes des barges amarrées sur le canal, derrière le restaurant jusqu’aux cuisines ; à charger les ordures dans les barges prévues à cet effet ; à nettoyer les tables ; et à laver et récurer le sol. Ils rentraient et sortaient à toute allure, montaient à l’étage – où se trouvaient les appartements des propriétaires. C’était frénétique, mais ils étaient entourés par les femmes du restaurant, en longues robes blanches, des papillons de papier dans les cheveux, et par des milliers d’autres femmes, qui se promenaient sous les globes de lumière colorée, de telle sorte que même Kyu courait en tous sens, ivre d’images, d’odeurs – et des fonds de verre qu’il vidait en cachette. Ils buvaient des punchs au lychee, au miel et au gingembre, des jus de papaye et de poire, et du thé, noir ou vert. Shen servait également quinze sortes d’alcools de riz différents ; ils burent de tous jusqu’à la lie. Ils burent de tout sauf de l’eau, qu’on les invitait à ne jamais boire – pour ne pas mettre leur santé en danger.
Quant à la nourriture, qui, là encore, leur parvenait le plus souvent sous la forme de restes – eh bien, elle défiait toute description. On leur donnait une platée de riz le matin, à laquelle on ajoutait des rognons ou d’autres abats, après quoi ils étaient tenus de se débrouiller avec ce que les clients laissaient. Bold mangeait tout ce qu’il trouvait, ravi par la variété des mets. La fête des Lanternes était pour Shen et I-Li l’occasion de faire la démonstration de leurs talents culinaires, et c’est ainsi que Bold eut la chance de goûter au chevreuil, au daim rouge, au lapin, à la perdrix, à la caille, aux palourdes cuites dans le vin de riz, à l’oie farcie aux abricots, à la soupe aux graines de lotus, au potage de moules au piment, au poisson farci aux prunes, aux beignets, aux soufflés, aux raviolis, aux tartes, aux cakes à la farine de mais. À tous les types de nourriture en fait, à l’exception du bœuf et de la vache ; curieusement, les Chinois n’avaient pas de troupeaux. Mais ils avaient dix-huit sortes de soja, disait Shen, dix de riz, onze d’abricots, huit de poires. C’était un festin chaque jour.
Une fois la folie de la fête des Lanternes passée, I-Li prit le temps – comme elle aimait à le faire – de sortir de sa cuisine, et d’aller voir dans les autres restaurants de la ville ce qu’ils avaient à offrir. En revenant, elle disait à Shen et aux cuisiniers qu’ils devaient faire une soupe à la sauce de soja doux, par exemple, comme celle qu’elle avait trouvée sur la place du marché ; ou bien un cochon cuit dans les cendres, comme au Palais de la Longévité et de la Compassion.
Elle commença à emmener Bold avec elle, tous les matins, aux abattoirs, à l’est du cœur de la vieille ville. C’est là qu’elle choisissait ses travers de porc, ainsi que les foies et les rognons pour les esclaves. C’est là que Bold apprit pourquoi il ne fallait surtout pas boire l’eau de la ville : les abats et le sang des animaux tués étaient déversés dans le canal qui se jetait dans le fleuve ; mais bien souvent la marée repoussait les ordures en amont du canal, et plus loin dans le réseau d’adduction d’eau de la ville.
Un jour, alors qu’il rentrait en poussant une brouette de travers de porc derrière I-Li, et qu’il s’était arrêté pour laisser sortir neuf femmes en blanc complètement soûles, Bold se dit soudain qu’il était dans un autre monde. De retour au restaurant, il en parla à Kyu :
— On vient de renaître, et on ne l’avait même pas remarqué.
— Toi, peut-être. Tu es comme un bébé ici…
— Tous les deux ! Regarde autour de toi ! C’est…
Mais il ne sut comment le dire.
— Ils sont riches, dit Kyu en regardant autour de lui.
Puis ils se remirent au travail.
Il se passait toujours quelque chose au bord du lac. Fête ou non – et il y avait des fêtes à peu près tous les mois – la rive était l’un des principaux endroits où les habitants de Hangzhou se retrouvaient. Toutes les semaines, des réceptions privées étaient intercalées entre les fêtes, si bien que l’endroit était en liesse quasi permanente, à des degrés divers, bien sûr ; et bien qu’il y eût énormément de travail au restaurant, il restait toujours à boire et à manger sur les tables, ou à chiper aux cuisines. Bold et Kyu n’en avaient jamais assez, et ils se gavèrent tant qu’ils grossirent. Kyu grandit tellement qu’on aurait dit un géant au milieu de ces Chinois.
Bientôt, ils eurent l’impression de n’avoir jamais eu d’autre vie que celle-ci. Bien avant l’aube, on frappait avec des maillets sur des gongs de bois en forme de poisson, et les guetteurs de temps criaient du haut de leur tour de garde : « Il pleut ! Il va y avoir de l’orage aujourd’hui ! »
Bold et Kyu étaient réveillés en même temps qu’une vingtaine d’autres esclaves et conduits hors de leur dortoir, au canal de service qui venait des faubourgs, où ils déchargeraient des barges de riz. Les mariniers s’étaient levés plus tôt encore – leur travail s’effectuait la nuit, commençant à minuit, en aval. Tous ensemble, ils soulevaient les sacs pour les déposer sur des brouettes, puis les esclaves les poussaient dans les rues étroites de la ville, jusqu’au restaurant.
Balayer le restaurant,
Allumer les fourneaux, dresser les tables,
Laver bols et baguettes, couper les légumes,
Les faire cuire, porter mets et provisions
Sur les deux bateaux d’agrément de Shen,
Et quand l’aube paraissait,
Quand les gens peu à peu arrivaient
Sur la rive, prendre leur commande,
Aider les cuisiniers, faire le service,
Nettoyer les tables – tout ce qu’il fallait,
Absorbés par leur travail,
car leur travail était comme d’habitude le plus dur, puisqu’ils étaient les derniers esclaves arrivés. Malgré tout, même le travail le plus dur n’était pas si dur, et avec tout ce qu’ils avaient à manger, Bold trouvait que cette situation était plutôt une aubaine ; l’occasion de se mettre un peu de chair sur les os, de parfaire sa connaissance du dialecte local, et des us et coutumes chinois. Kyu prétendait ne s’apercevoir de rien, et faisait même celui qui ne comprenait pas ce qu’on lui disait ; Bold savait bien qu’en fait il s’imprégnait de tout, comme une éponge, qu’il observait et faisait semblant de ne rien voir, mais regardant toujours. Kyu était ainsi. Il savait même, à présent, plus de chinois que Bold.
Le huitième jour de la quatrième lune eut lieu une autre grande fête, en l’honneur d’une divinité qui était le saint patron de nombreuses guildes de la ville. Les guildes organisèrent une procession, descendirent l’ancienne avenue impériale qui séparait la ville du nord au sud, puis se rendirent au lac de l’Ouest pour des joutes maritimes, l’un des nombreux plaisirs auxquels on s’adonnait d’habitude au bord du lac. Chaque guilde avait son masque et son costume, brandissait un même parapluie, drapeau ou bouquet, et défilait en carrés compacts, en hurlant : « Dix mille années ! Dix mille années ! »
Comme elles le faisaient depuis toujours, comme si l’empereur était encore en vie et pouvait entendre leurs vœux de longévité.
Éparpillés le long du rivage à la fin du défilé, ils regardèrent une centaine de jeunes eunuques danser en cercle, l’une des manifestations typiques de cette fête. Kyu n’arrivait pas à quitter ces enfants du regard.
Plus tard, ce même jour, Bold et lui furent affectés à l’un des bateaux d’agrément de Shen, qui étaient en fait les extensions flottantes de son restaurant.
— Aujourd’hui, nous donnons une superbe fête pour nos invités, cria Shen lorsqu’ils se présentèrent à bord. Nous servirons les Huit Délicatesses : les foies de dragon, la moelle de phénix, les pattes d’ours, le balbuzard bouilli, les fœtus de lapin, la queue de carpe, les lèvres de singe et même du kumiss.
Bold sourit à l’idée que le kumiss, qui n’était autre que du lait de jument fermenté, fut inclus dans les Huit Délicatesses ; c’était ce dont il s’était nourri, dans sa jeunesse, quasi exclusivement.
— Certaines sont plus faciles à obtenir que d’autres, dit-il.
Ce qui fit bien rire Shen, qui l’invita à monter à bord du bateau d’un coup de pied au derrière.
Une fois sur le lac, ils ramèrent.
— Comment se fait-il que tes lèvres soient toujours sur ton visage ? dit Kyu dans le dos de Shen, qui se trouvait hors de portée de voix.
— Les Huit Délicatesses, dit Bold en riant. Qu’est-ce qu’ils n’iraient pas inventer !
— Ils adorent les nombres, acquiesça Kyu. Les Trois Purs, les Quatre Empereurs, les Neuf Luminaires…
— Les Vingt-huit Constellations…
— Les Douze Signes du Zodiaque, les Cinq Anciens des Cinq Régions…
— Les Cinquante Esprits des Étoiles…
— Les Dix Péchés Impardonnables…
— Les Six Mauvaises Recettes…
Kyu gloussa brièvement.
— Ce ne sont pas les nombres qu’ils aiment, ce sont les listes. La liste de toutes les choses qu’ils ont.
Une fois sur le lac, Bold et Kyu purent admirer les magnifiques décorations des bateaux dragons de la cérémonie : les fleurs, les plumes, les drapeaux colorés et les grelots. Sur chaque bateau des musiciens jouaient de toutes leurs forces, soufflant à n’en plus pouvoir dans des trompettes, tapant comme des fous sur des tambours, afin d’étouffer le bruit que faisaient les autres, tandis que des jouteurs se dressaient à la proue des navires pour faire tomber leurs concurrents à l’aide de palettes rembourrées.
Dans ce joyeux tumulte, des cris d’un genre différent attirèrent l’attention des fêtards, qui regardèrent à terre et virent qu’il y avait le feu. Aussitôt les jeux s’arrêtèrent et tous les bateaux filèrent vers la côte, s’entassant sur cinq rangées parallèles. Les gens les traversèrent précipitamment, courant droit vers l’incendie, ou vers leurs quartiers d’habitation. Comme ils se ruaient vers le restaurant, Bold et Kyu virent pour la première fois des pompiers. Chaque quartier avait les siens, avec son propre équipement, et tous suivaient les signaux émis par les drapeaux des guetteurs disposés autour de la ville, noyant les toits des quartiers menacés par les flammes ou s’efforçant d’éteindre le foyer. Les bâtiments de Hangzhou étaient tous en bambou ou en bois, et la plupart des quartiers ayant déjà brûlé au moins une fois, les manœuvres à suivre étaient devenues routinières. Bold et Kyu coururent derrière Shen jusqu’à leur quartier en feu, au nord et face au vent, de sorte qu’ils se trouvèrent environnés par les flammes.
Des milliers d’hommes et de femmes faisaient la chaîne du canal jusqu’à l’incendie. Ils se passaient des seaux qui étaient portés en courant aux étages supérieurs, afin d’y être déversés sur les flammes. Il y avait aussi des hommes avec des bâtons, des piques et même des arbalètes, tandis que d’autres, chassés par les flammes, fuyaient leurs maisons en s’interpellant. Soudain, ces derniers réduisirent en charpie l’un de ceux qu’ils interrogeaient, là, au milieu de ceux qui se battaient contre le feu. « Un pillard », dit quelqu’un. Des détachements de l’armée arriveraient bientôt pour en capturer d’autres, et les tuer sur place, après les avoir torturés si l’on avait le temps.
Malgré cela, Bold vit des gens qui ne portaient pas de seau entrer et sortir en courant des bâtiments en flammes. La lutte contre les pillards était aussi intense que celle contre l’incendie ! Kyu les vit aussi, alors qu’il aidait à convoyer des seaux de bambou ou de bois, observant tout sans se cacher.
Les jours passèrent, chacun plus frénétique que le précédent. Kyu s’obstinait à faire le muet, la tête toujours basse, telle une bête de somme ou une serpillière, incapable d’apprendre le chinois – du moins les gens du restaurant le croyaient-ils. À peine humain, en fait, ce qui correspondait à l’idée que les Chinois se faisaient des esclaves noirs.
Bold travailla de plus en plus souvent pour I-Li. Il sembla qu’il était bien celui qu’il lui fallait pour ses sorties, et il fit de son mieux pour ne pas la décevoir, en poussant sa brouette dans les rues encombrées de la ville. Elle était toujours en train de courir, le plus souvent à la recherche de quelque nouveau plat. Elle voulait absolument tout essayer. Bold voyait bien que si le restaurant avait un tel succès c’était grâce à elle. Shen lui-même était plus une charge qu’une aide. Il avait du mal à compter malgré son boulier, ne se souvenait jamais de rien – surtout pas de ses dettes –, battait ses esclaves et ses entraîneuses.
Bold était donc très content de travailler avec I-Li. Ils se rendirent au restaurant de la Mère Sung, de l’autre côté de la Porte de la Monnaie, afin de goûter sa soupe de soja blanc. Ils regardèrent Wei Grand Couteau faire bouillir du porc, au Pont du Chat, et Chou Numéro Cinq faire ses beignets au miel, en face du Pavillon des Cinq Travées. De retour aux cuisines, I-Li essayait de reproduire chacun de ces plats à l’identique, en remuant la tête d’un air mauvais. Parfois, elle se retirait dans sa chambre pour réfléchir et, de temps à autre, faisait monter Bold afin de lui ordonner d’aller chercher tel ou tel ingrédient qui lui manquait, et dont elle pensait qu’il l’aiderait pour son plat.
Sa chambre avait une table juste à côté du lit, couverte de produits de beauté, de bijoux, de sachets de parfum, de miroirs, et de petites boîtes en bois laqué, en jade, en or, en argent. Des cadeaux de Shen, sûrement. Bold les regardait discrètement pendant qu’elle s’asseyait pour réfléchir.
Petit pot de fond de teint blanc,
À la surface encore lisse et brillante,
Lilas profond d’un fard gras,
Pour des joues carminées de couperose.
Boîte de pétales de roses
Pilés dans l’alun, pour teindre les ongles,
Et ressembler à toutes ces femmes au restaurant.
Ongles d’I-Li, rongés jusqu’au sang,
Maquillage oublié, bijoux jamais portés,
Miroir vide.
Regard en partance.
Un jour, elle s’était passé les paumes des mains au fard rose et en avait enduit tous les chiens et les chats de la cuisine. Juste pour voir, pour autant que Bold avait pu en juger.
Mais elle s’intéressait à tout ce qui arrivait en ville. Quand elle était dehors, elle passait le plus clair de son temps à bavarder et à poser des questions. Une fois, elle revint troublée :
— Bold, ils disent qu’ici les gens du Nord vont dans des restaurants où l’on sert de la chair humaine. « Des moutons à deux pattes », as-tu entendu parler de ça ? De plats aux noms différents selon qu’il s’agit de vieillards, de femmes, de jeunes filles ou d’enfants ? Y a-t-il vraiment des monstres pareils chez nous ?
— Je ne crois pas, dit Bold. Ça ne me dit rien.
Elle n’était pas entièrement rassurée. Elle voyait souvent des fantômes affamés dans ses rêves, et il fallait bien qu’ils viennent de quelque part. Parfois, ils se plaignaient d’avoir été dévorés. Il lui semblait logique de les voir rôder aux alentours des restaurants, à la recherche de quelque compensation. Bold hocha la tête. Il comprenait, bien que ce fut difficile à croire, que dans une ville aussi peuplée on puisse trouver de tout, y compris des cannibales. Pourtant, se disait-il, il y avait tellement mieux à manger que de la chair humaine…
Comme les affaires marchaient bien, I-Li fit faire des travaux dans le restaurant. Elle fit percer les murs extérieurs pour y mettre des fenêtres, munies d’un treillage en métal garni de papier huilé, qui, selon l’heure du jour et le temps, illuminait ou ombrageait le restaurant. Elle ouvrit la façade sur la promenade du lac et carrela entièrement le rez-de-chaussée de dalles vernissées. Tout l’été, elle fit brûler des herbes pour chasser les moustiques, qui pullulaient. Elle fit creuser de petites niches le long des murs, dans lesquelles elle plaça des autels pour toutes sortes de divinités, même mineures – dieux locaux, esprits animaux, démons et fantômes affamés –, et même – à la demande de Bold – un pour Tianfei, l’Épouse Céleste, bien qu’elle suspectât que sous ce nom se cachait Tara, qu’on adorait déjà dans de nombreux coins et recoins de la maison. De toute façon, disait-elle, si cela contrarie Tara, c’est sur Bold que cela retombera.
Un jour, elle rentra à la maison en racontant l’histoire de nombreuses personnes qui étaient revenues à la vie peu après leur mort, parce que au ciel des scribes peu scrupuleux avaient mal écrit leur nom. Bold sourit. Les Chinois imaginaient qu’au ciel régnait une bureaucratie tout aussi compliquée et incompétente que la leur.
— Ils sont revenus en sachant sur leurs proches des choses qu’ils n’auraient jamais pu connaître étant morts, n’est-ce pas extraordinaire ?
— C’est proprement incroyable, sourit Bold.
— Oui, des miracles arrivent tous les jours, ajouta I-Li.
Pour elle, le monde était peuplé de fantômes, de revenants, de démons, de génies et autres créatures fantastiques ; il y en avait pour tous les goûts. Comme on ne lui avait jamais parlé du bardo, elle ne connaissait pas les six niveaux de réalité qui régissaient l’univers ; et Bold ne se sentait pas en position de les lui expliquer. Aussi en resta-t-elle au niveau des fantômes et des démons. Les plus malveillants des esprits pouvaient être tenus à l’écart par toutes sortes de moyens – pétards, trompettes, gongs, toutes ces choses les chassaient. On pouvait aussi les frapper avec une baguette, ou bien brûler de l’armoise – une coutume du Sichuan qu’I-Li pratiquait quelquefois. Elle acheta également des mantras tracés sur de minuscules morceaux de papier ou des cylindres d’argent, et mit des carreaux de jade blanc au fronton de chaque porte, pour faire fuir les mauvais esprits. Et comme le restaurant et la maisonnée se portaient de mieux en mieux, I-Li se dit qu’elle avait bien fait.
À force de la suivre plusieurs fois par jour dans tout Hangzhou, Bold apprit énormément de choses sur la ville. Il apprit que les meilleures peaux de rhinocéros venaient de chez Chien, qui se trouvait en descendant le canal de service jusqu’au petit lac Chinghu ; que les meilleurs turbans s’achetaient chez Kang Numéro Huit, rue de la Pièce en Poche, ou chez Yang Numéro Trois, sur le canal, après les Trois Ponts. Les livres les plus rares se dénichaient chez les bouquinistes, sous les grands arbres près de la maison d’été du Jardin de l’Oranger. Les cages en rotin pour les oiseaux ou les criquets pouvaient s’acheter allée des Ferronniers, les peignes d’ivoire chez Fei, les éventails peints au Pont à Charbon. I-Li adorait ce genre d’endroit, même si ce qu’elle achetait n’était jamais pour elle, mais pour faire des cadeaux à ses amies ou à sa belle-mère – une bien étrange personne d’ailleurs. Bold avait toutes les peines du monde à la suivre. Un jour, dans la rue, alors qu’elle débitait comme d’habitude une de ses histoires à toute allure, elle s’interrompit soudain, le regarda dans les yeux, l’air surprise, et lui dit :
— Je veux tout savoir !
Pendant ce temps, Kyu avait continué à observer, l’air de rien. Une nuit, pendant la grande marée de la huitième lune, alors que le Chientang se gonflait de hautes vagues et que les visiteurs affluaient dans la ville, une heure avant qu’on ne frappe sur les gongs de bois et que les guetteurs de temps ne lancent leurs cris, Bold fut réveillé. On lui tiraillait l’oreille, une main posée sur sa bouche.
C’était Kyu. Il lui montra la clé de leur chambre.
— Je l’ai volée !
Bold repoussa la main de Kyu.
— Que fais-tu ? murmura-t-il.
— Dépêche-toi, dit Kyu en arabe, comme s’il parlait à un chameau récalcitrant. On s’en va !
— Quoi ? Qu’est-ce que tu dis ?
— On s’en va, je te dis.
— Mais où ?
— Loin d’ici. Au nord de Nanjing.
— Mais on est bien, ici !
— Tu parles ! On n’est rien, ici. J’ai déjà tué Shen.
— Tu as quoi ?!
— Chut ! Il faut qu’on foute le feu avant que les autres se réveillent.
Abasourdi, Bold se leva d’un bond, en marmonnant :
— Pourquoi, pourquoi, pourquoi, pourquoi ? Ici tout allait bien, tu aurais dû me demander avant si je voulais partir ou non !
— Je veux m’en aller, dit Kyu, et pour ça j’ai besoin de toi. Il me faut un maître pour m’en sortir.
— T’en sortir, mais de quoi ?
Bold suivit Kyu dans la demeure silencieuse, sans hésiter dans le noir, tant il avait appris à connaître cette maison, la première dans laquelle il avait jamais vécu. Il aimait ça. Kyu l’emmena aux cuisines et prit une branche qui dépassait de l’un des fours allumés. Il avait dû l’y mettre avant d’aller réveiller Bold, car son extrémité était maintenant incandescente.
— On va au nord, vers la capitale, dit Kyu par-dessus son épaule tout en menant Bold au-dehors. Je vais tuer l’empereur.
— Quoi !
— Je t’en dirai plus après, dit Kyu.
Il appliqua le bout de son brandon incandescent contre un ballot de joncs, un monceau de petits bois et quelques boules de cire qu’il avait très probablement placées là un peu auparavant, dans un coin de la pièce. Une fois le feu parti, il se précipita dehors, et Bold le suivit, quelque peu effrayé. Kyu alluma un autre tas de joncs placé contre la porte de la maison voisine, puis jeta son tison contre le mur d’une troisième maison. Durant tout ce temps, Bold suivit Kyu, trop effaré pour parler ou penser. Si Kyu n’avait pas déjà tué Shen, il aurait empêché le garçon d’agir, mais il était trop tard. Sa tête et celle de Kyu seraient mises à prix ; ficher le feu au quartier était peut-être la seule chance qu’ils avaient de s’en tirer, l’incendie faisant disparaître les traces du meurtre. De toute façon, on penserait que les esclaves auraient tous brûlé, puisqu’ils étaient enfermés dans leur chambre.
— Heureusement, ils mourront tous, dit Kyu, comme en écho à cette idée.
La tournure prise par les événements nous choque autant que vous, et nous ne savons pas plus que vous ce qui va arriver. Fort heureusement, le prochain chapitre va nous l’apprendre.
6
En suivant le Grand Canal, nos pèlerins échappent à la justice ; à Nanjing ils implorent l’aide de l’Eunuque aux Trois Joyaux
Ils s’enfuirent vers le nord en remontant les sombres ruelles parallèles au canal de service. Derrière eux, l’alarme avait déjà été donnée, des gens poussaient des cris, on sonnait le tocsin, le vent frais de l’aube soufflait du lac de l’Ouest.
— Tu as de l’argent ? demanda Bold.
— Tout un tas de cordes, répondit Kyu.
Il en avait un plein sac sous le bras.
Il fallait qu’ils s’éloignent le plus loin possible, le plus vite possible. Avec un Noir comme Kyu, ils auraient du mal à passer inaperçus. Kyu serait évidemment un jeune esclave noir, et Bold son maître. Bold parlerait pour eux deux ; voilà pourquoi Kyu l’avait emmené et ne l’avait pas assassiné en même temps que le reste de la maisonnée.
— Et I-Li ? Tu l’as tuée, elle aussi ?
— Non. Sa chambre avait une fenêtre. Elle s’en sortira.
Bold n’en était pas si sûr. La vie était dure pour les veuves. Elle finirait comme Wei Grand Couteau, qui faisait la cuisine sur un brasero, dans la rue, pour les passants. Enfin, pour elle, ce serait mieux que rien…
Partout où il y avait beaucoup d’esclaves, il y avait généralement quelques Noirs. Les bateaux qui voguaient sur le canal étaient souvent manœuvrés d’un bout à l’autre du pays par des esclaves, qui poussaient sur les barres des cabestans ou tiraient sur des cordages, comme des mules ou des chameaux. Ils pourraient peut-être se fondre dans ce rôle tous les deux ; il pourrait se faire lui-même passer pour un esclave – mais non, les esclaves avaient besoin d’un maître qui parle pour eux. Si seulement ils pouvaient se joindre à une corde de halage… Il n’arrivait pas y croire ! Lui qui, hier encore, débarrassait les tables du meilleur restaurant de la ville, se retrouver à haler un navire ! Il en voulait tellement à Kyu qu’il en sifflait entre ses dents.
En plus, Kyu avait besoin de lui. Bold pourrait le laisser tomber, il aurait une bien meilleure chance de se perdre dans la masse, entre les nombreux négociants, moines bouddhistes et mendiants qui grouillaient sur les routes de Chine. Même leur fameuse bureaucratie de yamens et de fonctionnaires ne pouvait suivre à la trace tous les pauvres gens qui rôdaient dans les collines et l’arrière-pays. Alors qu’avec ce jeune Noir, il était aussi repérable qu’un clown de foire avec son singe.
Mais il n’abandonnerait pas Kyu. Il ne pouvait pas. Alors il se contentait de siffler entre ses dents. Et ils couraient dans les faubourgs de la ville, Kyu tirant Bold par la main de temps en temps, le pressant en arabe d’avancer.
— Tu sais, c’est ce que tu voulais vraiment… Tu es un grand guerrier mongol, n’est-ce pas, un barbare des steppes, redouté de tous… Tu faisais seulement semblant de t’en fiche d’être un esclave aux cuisines, hein ? Tu es doué pour ne pas réfléchir, pour ne pas voir les choses, mais c’était un numéro… Tu savais évidemment depuis toujours, tu faisais seulement semblant de ne pas savoir, tu avais envie de t’enfuir depuis le début…
Bold était stupéfait qu’on puisse à ce point se méprendre à son sujet.
Les faubourgs de Hangzhou étaient beaucoup plus verts que le vieux quartier central, pas une propriété sans son arbre, ou son petit verger de mûriers. Derrière eux, le tocsin réveillait toute la ville. La journée commençait dans la panique. D’une petite hauteur, ils regardèrent par-delà les maisons et virent le front du lac qui s’était embrasé ; sous l’effet d’un bon vent d’ouest bien régulier, toute la zone avait pris feu aussi facilement que les petites boules de cire et les fagots de Kyu. Bold se demanda si Kyu avait attendu une nuit de vent pour tenter sa chance ; cette pensée le glaçait. Il savait que le gamin était malin, mais il n’avait jamais soupçonné qu’il fût à ce point impitoyable, malgré l’air de prêta qu’il avait parfois, et qui rappelait à Bold celui de Tamerlan ; un regard intense, étrange et fascinant. Sans doute celui du nafs tapi en lui. Chacun était, fondamentalement, son propre nafs, et Bold avait déjà conclu que celui de Kyu était un faucon, encapuchonné et entravé. Celui de Tamerlan était un aigle volant haut dans le ciel, fondant sur le monde pour le déchiqueter.
Il avait donc reçu un signe et eu une idée. Et puis, il y avait le côté renfermé de Kyu… cette impression qu’il donnait d’être à mille lis de là, depuis qu’on l’avait castré. Bien sûr, il y avait eu des conséquences. Le Kyu d’avant avait disparu, laissant le nafs agir à sa place.
Ils traversèrent précipitamment la sous-préfecture la plus au nord de Hangzhou et sortirent par la porte du dernier mur d’enceinte. La route serpentait à travers les collines de Su Tung-po, d’où ils eurent une vue plongeante sur le quartier du lac. Les premières lueurs de l’aube faisaient pâlir les flammes, et l’incendie se voyait surtout à cause de ces importants nuages de fumée noire, qui projetaient en ce moment même leurs flammèches vers l’est, étendant le foyer.
— Le feu va tuer beaucoup de gens ! s’exclama Bold.
— Ce sont des Chinois, rétorqua Kyu. Il y en aura toujours assez.
Avançant à marche forcée vers le nord, longeant le Grand Canal sur sa rive ouest, ils virent à nouveau combien la Chine était peuplée. Là-haut, tout un pays de rizières et de villages nourrissait la grande ville de la côte. Les fermiers étaient au travail, dans la lumière du matin,
Repiquant le riz dans les champs inondés,
Un homme marche, plié en deux,
Derrière un buffle d’eau.
Misère noire, luisante de pluie,
Petites fermes, villages délabrés aux carrefours,
Quel contraste,
Après la splendeur bigarrée de Hangzhou !
— Je me demande pourquoi ils ne vont pas tous à la ville, remarqua Kyu. Moi, j’irais.
— Ils n’y pensent pas, répondit Bold, émerveillé que Kyu puisse croire que les autres raisonneraient comme lui. Et puis leurs familles sont ici.
Ils apercevaient le Grand Canal à travers les rangées d’arbres qui le bordaient, deux ou trois lis à l’est. Des monticules de terre et des rondins de bois se trouvaient à côté, signalant des travaux divers. Ils gardaient leurs distances, préférant éviter les détachements de soldats ou de fonctionnaires susceptibles de patrouiller le long du canal en ce triste jour.
— Tu veux un peu d’eau ? demanda Kyu. Tu crois qu’on peut la boire, ici ?
Il était plein de sollicitude, constata Bold ; cela dit, maintenant, il était bien obligé. Près du Grand Canal, la présence de Kyu pouvait passer pour normale, mais Bold n’avait pas de papiers, et les préfets locaux ou les fonctionnaires du canal pourraient très bien les lui demander. Aussi ne seraient-ils jamais totalement en sécurité, ni le long du Grand Canal ni dans la campagne environnante. Au cours de leur fuite, ils devraient s’en approcher ou s’en éloigner en fonction des circonstances. Il se pourrait même qu’ils soient obligés de marcher la nuit, ce qui était encore plus dangereux et les ralentirait. Cela dit, il paraissait peu probable, vu le nombre de gens qui circulaient au bord du canal, qu’on demande leurs papiers à tous, ou que tous en aient, d’ailleurs.
Alors ils se mêlèrent à la foule qui longeait le canal. Kyu transportait son balluchon, chaînes aux pieds, allait chercher de l’eau pour Bold, et feignait d’ignorer les ordres, sauf les plus simples. Il faisait si bien l’idiot que c’en était terrifiant. Des groupes de haleurs tiraient des barges, ou tournaient des volants afin de relever et d’abaisser les écluses qui ponctuaient le canal à intervalles réguliers. Les hommes allaient souvent par deux, maître et serviteur ou esclave. Bold donnait des ordres à Kyu, mais était trop inquiet pour y prendre plaisir. Comment savoir quels ennuis Kyu pourrait encore lui attirer dans le Nord ! Bold ne savait pas ce qu’il éprouvait, ça changeait d’une minute à l’autre. Il n’arrivait pas à croire que Kyu lui avait imposé cette évasion. Il sifflait entre ses dents ; il avait le pouvoir de vie ou de mort sur le gamin, et pourtant il continuait d’avoir peur de lui.
Sur une jolie petite place pavée, à côté d’une écluse refaite avec des rondins fraîchement coupés, un yamen local et ses adjoints arrêtaient un groupe sur quatre ou cinq. Tout à coup, ils firent signe à Bold, qui poussa Kyu devant lui, désemparé. Un yamen lui demanda ses papiers. Il était flanqué d’un fonctionnaire de plus haut rang, un préfet portant sur sa robe un écusson brodé représentant des éperviers entrelacés. Les symboles de la fonction du préfet étaient simples à déchiffrer – le rang inférieur arborait une caille picorant le sol, le plus élevé, des grues planant au-dessus des nuages. C’était donc un personnage de haut rang, peut-être à la recherche de l’incendiaire de Hangzhou. Bold réfléchissait déjà à des mensonges, se préparant à fuir, lorsque Kyu fouilla dans son sac et lui remit une liasse de papiers attachée avec un ruban de soie. Bold dénoua le ruban et tendit le paquet au yamen en se demandant ce qu’il contenait. Il connaissait les lettres tibétaines qui disaient « Om Mani Padme Oum » – d’ailleurs comment ne pas les connaître alors qu’elles étaient sculptées sur toutes les roches de l’Himalaya ? – mais, en dehors de ça, il était illettré, et l’alphabet chinois ressemblait à des empreintes de pattes de poule, chaque lettre étant différente des autres.
Le yamen et le fonctionnaire à l’épervier lurent les deux papiers du dessus et les tendirent à Bold, qui les rattacha et les rendit à Kyu sans les regarder.
— Faites attention du côté de Nanjing, dit l’épervier. Il y a des bandits dans les collines, juste au sud.
Quand ils furent hors de vue de la patrouille, Bold flanqua un bon coup à Kyu pour la première fois.
— Qu’est-ce que c’est que ça ! Pourquoi ne m’as-tu pas parlé des papiers ! Comment veux-tu que je sache quoi dire aux gens ?
— J’avais peur que tu les prennes et que tu me laisses.
— Qu’est-ce que tu me racontes ? S’ils disent que j’ai un esclave noir, alors il me faut un esclave noir, non ? Qu’est-ce que ça dit ?
— Ça dit que tu es un marchand de chevaux rattaché à la Flotte des trésors, qui va à Nanjing pour affaires. Et que je suis ton esclave.
— Où tu les as eus ?
— C’est un type sur un bateau de riz qui me les a faits.
— Alors il connaît nos plans ?
Kyu ne répondit pas, et Bold se demanda si le bateau de riz n’avait pas flambé lui aussi. Ce gamin était capable de tout. De se procurer une clé, des faux papiers, de préparer les petites boules de feu… Si par malheur Kyu pensait un jour ne plus avoir besoin de Bold, celui-ci se réveillerait un matin la gorge tranchée. Il serait sûrement plus en sécurité tout seul.
Il ruminait cette pensée alors qu’ils passaient le long du chemin de halage. Il pouvait abandonner le gamin à son sort. Kyu finirait alors ses jours comme esclave, ou serait mis à mort sur-le-champ, comme fugitif, ou bien exécuté, un peu plus tard, comme criminel et incendiaire. En tout cas, Bold pourrait repartir vers le nord-ouest, vers la grande muraille et les steppes qui se trouvaient au-delà, et rentrer chez lui.
À la façon dont Kyu évitait son regard et se faufilait derrière lui, il était évident qu’il savait plus ou moins ce qu’il pensait. C’est ainsi que, pendant un jour ou deux, Bold lui donna des ordres sur un ton sec, et que Kyu sursautait à chacune de ses paroles.
Mais Bold ne l’abandonna pas, et Kyu ne lui trancha pas la gorge. En réfléchissant, Bold devait bien admettre que son karma était, d’une façon ou d’une autre, lié à celui du gamin. Il en faisait pour ainsi dire partie. Il était très possible qu’il soit là pour l’aider.
— Écoute, dit un jour Bold. Tu ne peux pas aller à la capitale tuer l’empereur. Ce n’est pas raisonnable. Et à quoi ça servirait, de toute façon ?
Le gamin répondit en arabe, sur un ton morne, le dos rond :
— À leur faire mettre genou à terre.
Encore un terme de chameliers.
— Pourquoi ?
— Les arrêter.
— Mais même si tu tuais l’empereur cela n’y changerait rien. Ils se contenteraient de le remplacer par un autre, et tout continuerait comme avant. Les choses sont ainsi.
Ils poursuivirent un moment, puis Kyu demanda :
— Ils ne se battraient pas pour choisir le nouvel empereur ?
— Une guerre de succession ? Ça arrive parfois. Ça dépend de celui qui est censé monter sur le trône. Mais je ne sais plus qui c’est. Cet empereur, le Yongle, est un usurpateur. Il s’est emparé du trône qui aurait dû revenir à son neveu, ou à son oncle. Mais d’habitude, c’est le fils aîné qui succède à son père. À moins que l’empereur ne désigne un autre successeur. De toute façon, la dynastie continue. Il est rare qu’il y ait un problème.
— Mais ça pourrait arriver ?
— Ça se pourrait, et ça ne se pourrait pas. En attendant, ils passeraient leurs nuits à réfléchir à la meilleure façon de te torturer. Ce qu’ils t’ont fait sur le bateau ne serait rien à côté. Les empereurs Ming ont les meilleurs bourreaux du monde, tout le monde le sait.
Ils poursuivirent. Un peu plus tard :
— Ils ont tout ce qui se fait de mieux au monde, se lamenta le gamin. Les meilleurs canaux, les meilleures villes, les meilleurs bateaux, les meilleures armées. Ils voguent sur les mers et partout, tout le monde s’incline bien bas devant eux. Ils touchent terre, ils voient la dent du Bouddha et ils la prennent avec eux ; ils installent un roi qui les servira et ils repartent, et ils font la même chose partout où ils vont. Ils vont conquérir le monde entier, châtrer tous les garçons, et tous les enfants seront les leurs et le monde entier finira par être chinois.
— Peut-être, répondit Bold. C’est possible. Ils sont très nombreux, c’est certain. Et la Flotte des trésors est très impressionnante, il n’y a pas de doute. Mais on ne peut pas aller en bateau au cœur du monde, dans les steppes d’où je viens. Et les gens de là-bas sont beaucoup plus coriaces que les Chinois. Ils ont déjà conquis la Chine. Alors ça devrait aller. Et écoute-moi : peu importe ce qui arrivera, tu n’y peux rien.
— On verra ça à Nanjing.
C’était dingue, évidemment. Le gamin se faisait des illusions. Enfin, il avait cette lumière dans le regard – inhumaine, totémique, comme si son nafs regardait les choses par ses yeux –, un regard qui donnait à Bold le frisson, le long du premier chakra, celui qui arrivait derrière les testicules. En dehors du nafs parasite avec lequel Kyu était né, il y avait quelque chose de terrifiant dans sa haine, quelque chose d’impersonnel et d’étrangement inquiétant. Bold avait la certitude de voyager avec une puissance surnaturelle, un enfant sorcier africain, ou un shaman, un tulku qui avait été capturé dans la jungle et châtré, ce qui avait démultiplié son pouvoir, maintenant voué à la vengeance. Se venger des Chinois ! Il était sûr que le gamin était dingue, mais il était encore plus curieux de voir ce que ça pouvait donner.
Nanjing était bien plus grande que Hangzhou. Bold dut renoncer à s’émerveiller. C’était aussi le port d’attache de la grande Flotte des trésors. Une ville entière de constructeurs de navires avait poussé le long de l’estuaire du Yang-Tsé. Les chantiers navals comprenaient sept énormes cales sèches perpendiculaires au fleuve. Des soldats en gardaient les portes, pour empêcher les sabotages. Des milliers d’artisans, charpentiers, menuisiers et voiliers, vivaient dans des quartiers situés derrière les cales sèches, et cette ville tentaculaire, appelée Longjiang, comprenait des dizaines et des dizaines d’auberges pour les ouvriers de passage et les matelots descendus à terre. Les discussions, le soir, dans ces auberges, tournaient surtout autour du sort de la Flotte des trésors et de Zheng He, qui s’occupait, ces temps-ci, de construire un temple dédié à Tianfei, tout en préparant une autre grande expédition vers l’ouest.
Bold et Kyu n’eurent aucun mal à s’introduire dans le décor, se faisant passer pour un petit marchand et son esclave. Ils louèrent des coins pour dormir sur les matelas de l’Auberge de la mer du Sud. Là, le soir, ils entendirent parler de la construction d’une nouvelle capitale à Beiping, projet auquel l’empereur Yongle consacrait beaucoup de sa fortune et de son attention. Beiping, avant-poste de la province du Nord, sauf durant les dynasties mongoles, avait été le lieu d’où Zhu Di exerçait son pouvoir avant d’usurper le Trône du Dragon, devenant l’empereur Yongle. Il la remerciait à présent en y installant la nouvelle capitale impériale, changeant son nom de Beiping (« paix du Nord ») en Beijing (« capitale du Nord »). Des centaines de milliers d’ouvriers avaient été envoyés de Nanjing vers le nord pour construire un palais absolument énorme. À vrai dire, tous les avis concordaient : la ville entière était transformée en une sorte de palais – le Grand Intérieur, comme on disait, interdit à quiconque sauf à l’empereur, à ses concubines et à ses eunuques. Hors de cette précieuse cité devait se trouver une ville impériale plus vaste, toute nouvelle également.
On disait que la bureaucratie confucéenne, qui dirigeait le pays pour le compte de l’empereur, était opposée à toutes ces constructions. La nouvelle capitale, comme la Flotte des trésors, constituait une dépense énorme, une extravagance impériale qui déplaisait vivement aux fonctionnaires, parce qu’elle vidait les caisses du pays. Ils n’avaient pas dû voir les trésors rapportés par la Flotte, ou estimaient qu’ils ne permettaient pas des travaux si somptuaires. Ils ne croyaient qu’en Confucius, pour qui la fortune de l’empire, comme le voulait la tradition, devait provenir du travail intensif de la terre, et de l’assimilation des populations vivant aux frontières. Toutes ces innovations, ces chantiers navals et ces expéditions, ne reflétaient pour eux que la puissance croissante des eunuques impériaux, dont ils jalousaient l’influence grandissante. Dans l’auberge, les conversations étaient souvent très animées. Les matelots étaient généralement favorables aux eunuques – les marins étant loyaux envers la flotte, Zheng He, et les autres amiraux eunuques –, alors que les fonctionnaires, eux, n’étaient pas d’accord.
Bold regarda comment Kyu intervenait dans les conversations, n’hésitant pas à poser des questions. Il était à Nanjing depuis quelques jours à peine et connaissait déjà toutes sortes de racontars qui avaient échappé à Bold : l’empereur avait été renversé par un cheval que lui avaient donné les émissaires de Tamerlan, un cheval qui avait naguère appartenu à Tamerlan lui-même (Bold se demanda de quel cheval il pouvait s’agir ; c’était bizarre de penser qu’un animal avait pu vivre aussi longtemps. Après réflexion, il se rendit compte que Tamerlan était mort depuis deux ans seulement). La foudre était tombée sur le nouveau palais de Beijing, qui avait complètement brûlé. L’empereur avait publié un édit s’accusant lui-même de cette défaveur du ciel, provoquant la peur, la confusion et la critique. Dans le sillage de ces événements, certains fonctionnaires avaient ouvertement condamné les dépenses somptuaires engagées pour la nouvelle capitale et la Flotte des trésors, asséchant les finances au moment même où la famine et la rébellion dans le Sud requéraient toute l’attention et l’aide de l’empire. Très vite, l’empereur Yongle s’était lassé de ces critiques et avait fait exiler de Chine l’un des principaux détracteurs, et bannir les autres dans les provinces.
— Ce n’est pas bon, dit un marin qui avait le vin mauvais. Mais le pire de tout, pour l’empereur, c’est qu’il a soixante ans. Et contre ça il n’y a rien à faire, même quand on est l’empereur. Il se pourrait même que ce soit pire pour lui.
Tout le monde hocha la tête.
— Mauvais, très mauvais.
— Il ne pourra pas empêcher les eunuques et les fonctionnaires de se battre.
— Il se pourrait que ce soit bientôt la guerre civile.
— À Beijing, dit Kyu à l’oreille de Bold.
Mais, avant leur départ, Kyu insista pour qu’ils montent jusque chez Zheng He, une demeure décrépite dont la porte était sculptée en forme de proue de bateau – la proue d’un des vaisseaux de la Flotte des trésors, en fait. On disait qu’à l’intérieur la décoration des pièces (soixante-deux, d’après les marins) évoquait différents pays musulmans, et qu’à l’extérieur des jardins paysagés rappelaient le Yunnan.
Bold se lamenta pendant toute la montée de la colline.
— Il ne voudra jamais recevoir un pauvre marchand et son esclave. Ses serviteurs vont nous chasser à coups de pied, c’est ridicule !
Tout se passa comme Bold l’avait prévu. Le gardien de la porte les empoigna et leur dit de déguerpir.
— C’est bon, fit Kyu. Allons au temple de Tianfei.
C’était un grand ensemble de bâtiments construits par Zheng He en l’honneur de l’Épouse Céleste, pour la remercier de les avoir miraculeusement sauvés de la tempête.
Le cœur du temple est une pagode
À huit côtés et neuf étages,
Carreaux de porcelaine blanche, bleu de cobalt persan,
Rapportés par la Flotte des trésors.
Pour complaire à Tianfei, chaque étage
Doit avoir le même nombre de tuiles,
Qui sont alors de plus en plus petites,
Et montent vers le ciel en un pic gracieux,
Plus haut que les arbres. Belle offrande
En hommage à une déesse très miséricordieuse.
Bold et Kyu trouvèrent, quelque part dans le chantier, parlant avec des hommes qui n’avaient pas l’air mieux lotis qu’eux, Zheng He en personne. Il regarda approcher Kyu et prit le temps de lui parler. Bold secoua la tête en voyant ainsi se révéler le pouvoir du garçon.
Zheng acquiesça lorsque Kyu lui expliqua qu’ils avaient pris part à sa dernière expédition.
— Il me semblait bien vous avoir déjà vus.
Mais il fronça les sourcils quand Kyu lui expliqua qu’ils voulaient servir l’empereur à Beijing.
— Zhu Di est en campagne dans l’Ouest. À cheval, avec ses rhumatismes, fit-il avec un soupir. Il doit comprendre que la façon dont la flotte mène ses conquêtes est la meilleure. Arriver en bateau, commencer à faire du commerce, mettre en place un chef local compréhensif, et pour le reste, les laisser vivre, tout simplement. Commercer avec eux. Veiller à ce que le chef reste amical. Depuis les débuts des voyages de la Flotte, ce sont pas moins de seize pays qui rendent hommage à l’empereur. Seize !
— Pas facile de faire aller la flotte en Mongolie, remarqua Kyu.
Bold frémit. Mais Zheng He éclata de rire.
— Oui, le Grand Vide est haut et sec. Nous devons convaincre l’empereur d’oublier les Mongols et de s’intéresser à la mer.
— Absolument, répondit Kyu avec le plus grand sérieux. À Beijing, nous nous ferons les avocats de cette cause chaque fois que nous en aurons l’occasion. Voulez-vous nous donner des introductions pour aller voir les fonctionnaires eunuques du palais ? Je pourrais me joindre à eux, et mon maître, ici présent, ferait merveille dans les écuries impériales.
Zheng He parut amusé.
— Ça ne servira à rien, mais je vous aiderai, en souvenir du bon vieux temps, et je vous souhaite bonne chance.
Il écrivit une lettre d’introduction en secouant la tête. Il tenait son pinceau comme un petit balai miniature. Ce qui lui arriva par la suite, on le sait : il fut assigné à terre, l’empereur lui ayant confié un commandement militaire, et il passa la fin de ses jours à faire construire la pagode de porcelaine à neuf étages en hommage à Tianfei. On imagine que voguer sur les sept mers du monde devait lui manquer. On ne peut en être sûr. Mais ce qu’on sait c’est ce qui est arrivé à Bold et à Kyu. Et c’est ce que nous vous raconterons au chapitre suivant.
7
Nouvelle capitale, nouvel empereur ; certaines intrigues touchent à leur fin ; un garçon contre la Chine ; devinez qui gagne
Beijing était à l’état brut, dans tous les sens du terme ; le vent était humide et froid, le bois des bâtiments encore vert et suintant de sève, et partout ça sentait le goudron, la terre retournée et le ciment frais. Ça grouillait de monde, mais pas autant qu’à Hangzhou ou Nanjing. Bold et Kyu s’y sentaient en terrain conquis, à la fois cosmopolites et raffinés, comme s’ils étaient bien au-dessus de cet immense chantier de construction. Beaucoup de gens partageaient cette façon de voir.
Ils se rendirent à la clinique pour eunuques mentionnée dans la lettre d’introduction de Zheng He, juste au sud de la Porte du Méridien, l’entrée sud de la Cité Interdite. Kyu présenta sa lettre. On les laissa tout de suite entrer dans la clinique, afin d’y rencontrer l’eunuque qui la dirigeait.
— Avec une lettre d’introduction de Zheng He, vous irez loin dans le palais, leur dit cet eunuque, même si Zheng a personnellement des problèmes avec les fonctionnaires impériaux. Je connais le Maître de Cérémonie du palais, Wu Han, je le connais même très bien, je vous le présenterai. C’est un vieil ami de Zheng, et il a besoin d’eunuques au Pavillon des Profondeurs Littéraires pour transcrire des textes. Mais, attendez, vous ne savez pas écrire, n’est-ce pas ? Heureusement, Wu s’occupe aussi des prêtres eunuques chargés de veiller au bien-être spirituel des concubines.
— Mon maître, ici présent, est un lama, dit Kyu en montrant Bold. Il m’a initié à tous les mystères du bardo.
L’eunuque jeta un coup d’œil sceptique à Bold.
— Que vous sachiez écrire ou non, de toute façon, la lettre de Zheng vous permettra d’entrer. Il vous a recommandé en très haut lieu. Mais vous aurez besoin de votre pao, bien sûr.
— Mon pao ? fit Kyu. Mes précieuses ?
— Vous savez bien, dit l’eunuque en faisant un geste vers le bas-ventre de Bold. Vous devrez faire la preuve de ce que vous êtes, même quand je vous aurai examiné et que j’aurai certifié que vous l’êtes bien… De même, encore plus important peut-être, quand vous mourrez, il faudra qu’on vous le mette sur la poitrine à votre enterrement, pour tromper les dieux. Vous ne voudriez pas être réincarné en mule, n’est-ce pas ?
Il jeta un regard intrigué vers Kyu.
— Vous n’avez pas le vôtre ?
Kyu fit signe que non.
— Eh bien, vous n’aurez qu’à en choisir un ici, parmi ceux que des patients nous ont laissés en mourant. Je doute qu’on puisse distinguer celui d’un Noir de celui d’un Chinois après son séjour dans le vinaigre !
Il rit et les emmena dans un couloir.
Il s’appelait Jiang, dit-il. C’était autrefois un marin du Fukian qui s’étonnait sans cesse que des gens jeunes et en bonne santé puissent quitter la côte pour se rendre à Beijing.
— Mais, noir comme vous l’êtes, vous serez comme cet animal étrange que la Flotte a rapporté la fois dernière pour l’empereur, cette espèce de licorne tachetée au long cou. Qui venait aussi de Zanj, je crois. Vous le saviez ?
— C’était une grande flotte, dit Kyu.
— Je vois. Bon, Wu et les autres eunuques du palais adorent les créatures exotiques, l’empereur aussi d’ailleurs. Vous serez bien. Restez tranquille, ne vous mêlez à aucun complot, et ça ira.
Dans la chambre froide d’un entrepôt, ils virent plusieurs pots hermétiquement fermés et des bocaux en verre, et trouvèrent un pénis noir que Kyu emporta. L’eunuque en chef inspecta ensuite personnellement Kyu, afin de s’assurer qu’il était bien ce qu’il disait, dressa son certificat d’un coup de pinceau à même la lettre d’introduction de Zheng, et apposa son sceau par-dessus, à l’encre rouge.
— Certains essayent de tricher, bien sûr, mais s’ils se font prendre, on les leur sert sur un plateau, après quoi ils n’ont plus besoin de faire semblant, vous comprenez ? Au fait, j’ai remarqué qu’ils ne vous avaient pas mis de tuyau de plume quand ils vous l’ont coupé. Vous devriez en avoir un pour que ça reste ouvert, et puis vous mettrez une petite fiche dedans. C’est bien mieux ainsi, beaucoup plus agréable. Ils auraient dû vous le faire sur le coup.
— Je me trouve très bien sans, dit Kyu.
Il leva le pot de verre dans la lumière, regardant de près son nouveau pao. Bold frémit, et fut le premier à quitter la pièce.
Alors qu’on finissait de régler les dernières formalités au palais, on donna à Kyu un lit au dortoir, et Bold fut conduit dans une chambre de la clinique pour hommes.
— Temporairement, vous comprenez. À moins que vous ne souhaitiez nous rejoindre au bâtiment principal. Ce qui vous offrirait de grandes chances d’avancement…
— Non merci, répondit Bold poliment.
Mais il voyait bien que de nombreux hommes venaient ici se faire opérer, désespérés de trouver du travail. Quand la famine sévissait dans les campagnes, on ne manquait jamais de candidats. Il y en avait même trop, et il fallait les renvoyer. Comme partout ailleurs en Chine, de nombreux fonctionnaires s’occupaient de tout, ici. Plusieurs milliers d’eunuques travaillaient au palais, et quelques-uns seulement à la clinique.
Ainsi commença leur séjour à Beijing. En fait, les choses prenaient une telle tournure que Bold se demanda, comme lors de leur voyage vers le nord, si Kyu, n’ayant plus besoin de lui, ne l’abandonnerait pas – pour s’en aller à la Cité Interdite, et disparaître de sa vie. L’idée le rendait, malgré tout, un peu triste.
Mais Kyu, après avoir été assigné au service des concubines de Zhu Gaozhi, le fils aîné des enfants légitimes de l’empereur et Premier Héritier du trône, demanda à Bold de le rejoindre et de se présenter aux écuries, où il servirait d’homme à tout faire.
— J’ai toujours besoin de ton aide, dit-il simplement, ressemblant au garçon qu’il avait été jadis, quand ils étaient montés à bord du bateau de la Flotte des trésors.
— Je ferai de mon mieux, dit Bold.
Kyu fut en mesure de demander la faveur d’un entretien avec le maître des écuries de Zhu Gaozhi. Bold se présenta à lui, montra ce qu’il savait faire en matière d’entretien des chevaux – et obtint le poste tant convoité. Les Mongols étaient chez eux aux écuries comme les eunuques au palais.
C’était plutôt un travail facile, pensa Bold. Le Premier Héritier était un homme assez paresseux, qui montait rarement à cheval. Les garçons d’écurie devaient donc souvent mener les chevaux à l’exercice, au manège, ou dans les nouveaux jardins des terrains attenants au palais. Les chevaux étaient tous blancs et très grands, mais lents et peu endurants. Bold comprit pourquoi les Chinois ne pouvaient aller au-delà de leur Grande Muraille et s’attaquer efficacement aux Mongols, en dépit de leur impressionnante multitude. Les Mongols vivaient sur leurs chevaux, et de leurs chevaux : ils faisaient leurs vêtements et leurs abris avec leur peau et leurs poils, ils buvaient leur lait, leur sang, et les mangeaient quand il le fallait. Les chevaux mongols étaient tout pour ce peuple, la vie, le vent, la mort ; alors que ces pauvres carnes, avec leur force et leur caractère, n’étaient bonnes qu’à faire tourner inlassablement la pierre d’une meule, des œillères sur les yeux.
Il se trouva que Zhu Gaozhi rendait fréquemment visite à sa mère, l’impératrice Xu, à Nanjing, où il avait grandi. Alors, au fur et à mesure que les mois passaient, Bold et Kyu firent plusieurs fois le trajet entre les deux capitales, en barge sur le Grand Canal, ou bien le longeant à cheval. Zhu Gaozhi préférait Nanjing à Beijing pour des raisons évidentes de climat et de culture. Tard dans la nuit, après avoir ingurgité d’incroyables quantités de vin de riz, on pouvait l’entendre déclarer que, le jour même où son père mourrait, il referait de Nanjing la capitale qu’elle n’aurait jamais dû cesser d’être. De sorte que tous trouvaient très étrange la profusion de travaux qu’ils voyaient à Beijing quand ils y revenaient.
Ils allèrent de plus en plus souvent à Nanjing. Kyu travaillait au harem de l’héritier, et y passait le plus clair de son temps. Il ne disait jamais rien à Bold de ce qu’il y faisait, sauf l’une des nombreuses fois où il vint le trouver aux écuries, tard dans la nuit, légèrement soûl. Ce fut d’ailleurs à peu près la dernière fois que Bold le vit, et il regretta bientôt ces visites nocturnes, même si elles le rendaient nerveux.
À cette occasion, Kyu expliqua que, ces derniers temps, sa tâche principale consistait à trouver un mari aux concubines ayant atteint la trentaine et n’ayant jamais eu de relations avec l’empereur. Zhu Di les envoyait à son fils, avec pour instruction de les marier vite fait.
— Aimerais-tu te marier ? demanda malicieusement Kyu à Bold. À une vierge de trente ans, experte en toutes choses ?
— Non merci, dit Bold, mal à l’aise.
Il avait déjà conclu un arrangement avec une des servantes du complexe de Nanking, et il eut beau se dire que Kyu plaisantait, cela lui fit bizarre.
Souvent, quand Kyu lui rendait visite la nuit aux écuries, il avait l’air plongé dans de profondes pensées. Il n’entendait rien de ce que Bold lui disait, ou répondait à côté, comme à une autre question. Bold avait entendu dire que le jeune eunuque était apprécié, connaissait beaucoup de monde au palais et avait les faveurs de Wu, le Maître des Cérémonies. Mais il n’avait aucune idée de ce qu’ils étaient tous en train de tramer dans les quartiers des concubines pendant les longues nuits d’hiver à Beijing. Souvent, Kyu se présentait aux écuries, empestant le vin et le parfum, parfois l’urine, une fois même le vomi. « Puer comme un eunuque », cet adage revint à Bold en ces occasions, avec une force désagréable. Il vit combien les gens se moquaient de la démarche efféminée des eunuques, leurs tout petits pas, les pieds recroquevillés. Y étaient-ils physiquement obligés, ou bien se donnaient-ils un genre ? Bold n’aurait su le dire. On les appelait « corbeaux » à cause de leur voix de fausset – et ce n’était qu’un des nombreux surnoms qu’on leur donnait ; mais toujours dans leur dos. Et tous s’accordaient à dire qu’au fur et à mesure qu’ils grossissaient et que leur façon d’être s’étrécissait, ils finissaient par ressembler à de vieilles femmes ratatinées.
Kyu était toujours jeune et beau ; et bien qu’il fut le plus souvent ivre et hirsute, la nuit, quand il venait rendre visite à Bold, il n’avait pas l’air mécontent de lui.
— Fais-moi savoir quand tu auras besoin d’une femme, dit-il. Nous en avons plus qu’il n’en faut là-bas.
Au cours de l’une de leurs visites à Beijing, Bold put voir un bref instant l’empereur avec son fils, alors qu’il leur apportait leurs chevaux, parfaitement pomponnés, depuis la Porte de la Pureté Céleste, afin qu’ils puissent monter ensemble dans les jardins du parc impérial. Sauf que l’empereur voulut sortir de l’enceinte pour chevaucher plus au nord de la ville, apparemment, et dormir sous la tente. Ce qui était franchement pour déplaire au Premier Héritier, comme aux dignitaires qui accompagnaient l’empereur. Finalement, il renonça à son projet et se limita à une promenade de jour, mais en dehors de l’enceinte du palais, le long du fleuve.
Comme ils chevauchaient côte à côte, il dit à son fils :
— Il faut que tu apprennes à proportionner le châtiment au crime ! Le peuple doit sentir que ta décision est juste ! Quand le Bureau des Châtiments condamna Xu Pei-yi à mourir de mort lente, les mâles de sa famille à mort, et ses femmes et ses enfants à l’esclavage, je me suis montré miséricordieux ! J’ai commué sa sentence en une simple décapitation et épargné ses proches. Aussi dirent-ils : « L’empereur a le sens de la mesure, il comprend les choses. »
— C’est normal, acquiesça mollement l’héritier.
L’empereur le foudroya du regard, et ils continuèrent leur promenade.
Sur le chemin du retour, plus tard ce même jour, il faisait toujours la morale à son fils, paraissant encore plus irrité qu’à l’aller.
— Si tu ne connais que la cour, tu ne pourras jamais régner ! Le peuple attend de l’empereur qu’il le comprenne, et qu’il sache aussi bien monter à cheval et tirer à l’arc que l’Envoyé Céleste ! Pourquoi tes gouverneurs t’obéiraient-ils s’ils te trouvent efféminé ? Ils ne feront que feindre de t’obéir, et dans ton dos se moqueront de toi et n’en feront qu’à leur tête !
— C’est logique, dit l’héritier, détournant les yeux.
L’empereur lui lança un regard furieux.
— Descends de cheval ! tonna-t-il d’une voix terrible.
L’héritier soupira et mit pied à terre. Bold prit les rênes et calma le cheval d’une main preste, tout en le menant vers la monture de l’empereur, pour la prendre elle aussi, alors que l’empereur descendait de selle, s’exclamant :
— Obéis !
L’héritier tomba à genoux et se perdit en courbettes.
— Tu crois que les gouverneurs ont peur de toi ? cria l’empereur. Pas du tout ! Ta mère se trompe là-dessus, comme sur tout le reste d’ailleurs ! Ils ont leurs idées, et ne t’aideront pas le moins du monde en cas de problème. Tu dois avoir des hommes à toi.
— Ou des eunuques, dit l’héritier, tête basse.
L’empereur Yongle le dévisagea.
— Oui. Mes eunuques savent qu’ils sont à la merci de mon bon vouloir. Personne d’autre ne les soutiendra. Ce sont les seules personnes au monde qui te soutiendront.
Aucune réponse du fils aîné, toujours prostré. Bold se détourna et, se tenant à quelques pas, l’air de rien, risqua un regard derrière lui. L’empereur, secouant la tête gravement, s’éloignait, laissant son fils à genoux.
— Il se pourrait que tu aies misé sur le mauvais cheval, dit Bold à Kyu lorsqu’il le revit, au cours d’une de ses visites de plus en plus rares aux écuries. L’empereur ne sort plus qu’avec son second fils maintenant. Ils montent à cheval, ils chassent, ils rient. Un jour, ils ont tué trois cents biches que nous avions enfermées. Alors qu’avec le Premier Héritier, l’empereur passe son temps à crier, essayant de le faire sortir de ses appartements, ce qu’il arrive parfois à faire, et du palais, ce qui semble impossible, et le fait crier encore plus. Ce dont l’héritier se moque bien, quasi ouvertement. Il n’ose faire plus, pour le moment. Et l’empereur le sait parfaitement. Je ne serais pas étonné s’il changeait de Premier Héritier.
— Il ne peut pas, dit Kyu. Il aimerait bien, mais il ne peut pas.
— Pourquoi ça ?
— L’aîné est le fils de l’impératrice. Le puîné n’est que le fils d’une courtisane, et encore, même pas d’une courtisane de haut rang.
— Mais l’empereur peut faire ce qu’il veut, non ?
— Faux. Ça ne marche que si tous, quels qu’ils soient, suivent les lois. Si l’un enfreint la loi, cela pourrait entraîner une guerre civile, la fin de la dynastie.
Bold savait que cela s’était produit après la mort de Gengis Khan, lors des guerres de succession qui avaient duré plusieurs générations. De même, on disait qu’à présent les fils de Tamerlan se battaient sans arrêt entre eux, après s’être partagé l’empire du khan en quatre, sans aucun espoir de réunification.
Mais Bold savait aussi qu’un dirigeant suffisamment fort pouvait s’en accommoder.
— Tu ne fais que répéter ce que tu as entendu chez l’impératrice, l’héritier et leurs courtisans. Mais ce n’est pas aussi simple. Les gens font les lois, et parfois, ils les changent. Ou les ignorent. Et s’ils ont des épées, c’est réglé.
Kyu resta silencieux pendant un long moment, pensant à ce que Bold venait de lui dire. Puis il déclara :
— On raconte que les campagnes sont en plein désarroi. Famine au Hunan, pirates sur les côtes, maladies au sud. Les fonctionnaires n’aiment pas ça. Ils pensent qu’en fait de trésors, la grande Flotte a rapporté la maladie et gaspillé d’importantes sommes d’argent. Ils ne comprennent rien à ce que le commerce peut rapporter, ils n’y croient pas. Ils ne croient pas non plus à la nouvelle capitale. Ils disent à l’impératrice et à son fils que nous devrions aider le peuple, que nous devrions nous remettre à l’agriculture, et cesser de dépenser autant pour des projets aussi extravagants.
Bold acquiesça.
— Ça ne m’étonne pas.
— Mais l’empereur persiste. Il fait ce qu’il veut, l’armée est avec lui, et il a ses eunuques. Les eunuques aiment le commerce avec l’étranger, parce qu’il les enrichit. De plus, ils aiment la nouvelle capitale, et tout ce qui s’ensuit. N’est-ce pas ?
Une fois de plus, Bold acquiesça.
— On dirait bien.
— Les fonctionnaires de la cour détestent les eunuques.
Bold lui lança un regard étonné.
— Tu l’as constaté par toi-même ?
— Oui. Même si ceux qu’ils détestent le plus, ce sont les eunuques de l’empereur.
— Certainement. Plus on se trouve près du pouvoir, plus on est craint et détesté par les autres.
À nouveau, Kyu se perdit dans un abîme de réflexions. Bold trouvait qu’il avait l’air heureux, mais il avait eu cette même impression autrefois à Hangzhou. C’est pourquoi, quand Kyu se mettait à sourire, de son petit sourire aux lèvres épaisses, Bold se sentait toujours un peu nerveux.
Peu après cette conversation, alors qu’ils se trouvaient tous à Beijing, survint un orage énorme.
Gouttes de pluie dans la poussière jaune,
Médailles de boue dorée.
Fines craquelures de bronze
Sabrant les paupières,
Raccommodant le ciel et la terre.
Au bout d’une heure, ce n’est qu’un cri :
Les nouveaux palais sont en feu !
Tout le centre de la Cité Interdite
Brûle comme plongé dans la poix,
Les flammes lèchent les nuages gonflés de pluies,
Immenses colonnes de fumée accrochées aux nuées,
Gouttes de pluie dans le vent brûlant,
Médailles de boue cendrée.
Courant çà et là au milieu des chevaux, puis avec des seaux d’eau, Bold restait aux aguets. Le combat était vain. Vers la fin, quand ils renoncèrent à lutter contre l’incendie, il vit Kyu, là, parmi les concubines impériales qu’on venait d’évacuer. Les gens du Premier Héritier paraissaient nerveux, agités, sauf Kyu, qui exultait, le blanc des yeux visible comme jamais. On aurait dit un shaman après un voyage réussi au pays des esprits. C’est lui qui a mis le feu, se dit Bold, comme à Hangzhou ; sauf que cette fois-ci il a attendu qu’il y ait un orage, pour que ça passe inaperçu.
La fois suivante, quand Kyu lui rendit visite aux écuries, Bold avait presque peur de lui parler.
Quoi qu’il en soit, il dit :
— C’est toi qui as mis le feu ?
Il avait murmuré sa question en arabe, même s’ils étaient seuls, à l’écart des écuries, et qu’ils ne risquaient pas d’être entendus.
Kyu se contenta de le fixer. Son regard disait oui, mais il ne répondit pas.
Pour finir, il lâcha :
— C’était une nuit terriblement excitante, n’est-ce pas ? J’ai sauvé l’une des armoires du Pavillon des Écritures, ainsi que plusieurs concubines. Les Robes Rouges se sont montrées des plus reconnaissantes pour leurs documents.
Il continua, parlant de la beauté du feu, de la peur panique des concubines, de la colère, et plus tard, de la peur de l’empereur, qui avait vu dans l’incendie le signe que les cieux désapprouvaient ses actions. C’était de très mauvais augure. Mais Bold avait du mal à suivre tout ce que le gamin disait, son esprit étant notamment habité par des images d’hommes condamnés à mourir de mort lente. Brûler un marchand à Hangzhou était une chose, mais l’empereur de Chine ! Le Trône du Dragon ! Il aperçut de nouveau, brièvement, cette chose que le gamin avait en lui, le nafs aux grandes ailes noires, tapi en son sein, et sentit grandir jusqu’à devenir infranchissable la distance qui les séparait.
— Calme-toi ! dit-il sèchement en arabe. Tu es complètement fou. Tu vas réussir à te faire tuer, et moi aussi.
Kyu eut un vilain sourire.
— J’aurais une vie meilleure, non ? Ce n’est pas ça que tu m’as appris ? Pourquoi devrais-je redouter la mort ?
Bold ne sut quoi répondre.
Après cela, ils se virent de moins en moins. Les jours passèrent, et avec eux les fêtes, les saisons. Kyu grandissait. Lorsque Bold le revit, c’était un jeune eunuque noir, grand et fin, magnifique et parfumé, qui se déhanchait en lançant des coups d’œil aguicheurs, et, une fois seulement, ce regard carnassier, alors qu’il observait des gens autour de lui. Pomponné, maquillé, couvert de bijoux, vêtu des robes de soie les plus chères, c’était à présent l’un des favoris de l’impératrice et du Premier Héritier, qui détestaient pourtant les eunuques, et en particulier ceux du harem. Kyu était leur mascotte, et peut-être même un espion de l’empereur. Bold avait aussi peur pour lui qu’il avait peur de lui. Le garçon semait la zizanie entre les concubines du harem du Premier Héritier et celles de l’empereur, disait-on jusque dans les écuries, où pourtant jamais personne n’aurait dû entendre parler de ces choses-là. La façon dont il se mouvait dans ce marécage était tout sauf subtile, il était en train de se faire de nombreux ennemis. Des coteries conspiraient contre lui pour le faire tomber. Il devait le savoir, et il devait le faire exprès. Mais il leur riait au nez, de façon à se faire détester plus encore. Et tout cela semblait le ravir. Mais la vengeance impériale portait loin. Si quelqu’un tombait, tous ceux qu’il avait connus tombaient avec lui.
Aussi, quand la nouvelle se répandit que deux des concubines de l’empereur s’étaient pendues, et lorsque l’empereur furieux demanda des comptes, et qu’on commença à prendre la mesure de la corruption et du complot qui se tramait autour de lui, la peur se répandit dans la cour comme la peste elle-même. Les mensonges impliquant de plus en plus de gens, près de trois mille concubines et eunuques se trouvèrent bientôt mis en cause dans cette affaire. Bold s’attendait à chaque instant à apprendre la nouvelle de la torture puis de la mise à mort lente de son jeune ami, à l’apprendre peut-être de la bouche même des gardes qui viendraient l’arrêter, lui.
Mais cela n’arriva pas. Kyu vivait comme s’il avait été protégé par un puissant sortilège jeté par un sorcier. C’était si évident que tous auraient dû le voir. L’empereur exécuta personnellement quarante de ses concubines, maniant l’épée avec vigueur, les coupant en deux ou les décapitant d’un seul coup, ou bien les frappant, encore et encore, jusqu’à ce que les marches de la nouvelle salle de l’Harmonie Suprême soient rouges de leur sang. Et Kyu se tint juste à côté, sans être menacé. En le voyant, tandis qu’elle se tenait nue devant tous, une concubine poussa même un cri inarticulé, puis elle maudit l’empereur en le regardant dans les yeux :
— C’est de ta faute, tu es trop vieux, ton yang est parti, les eunuques le font mieux que toi !
Et puis, schlac, sa tête alla rouler dans les mares de sang comme celle d’un mouton sacrificiel. Toute cette beauté gâchée ! Et pourtant, nul ne toucha Kyu. L’empereur n’osa même pas le regarder, et le jeune Noir observa tout cela, une étincelle dans les yeux, savourant le carnage, et le fait que les fonctionnaires le détestaient pour ça. La cour ressemblait à un abattoir, ils se nourrissaient désormais les uns des autres, et pourtant, aucun n’avait le courage de s’en prendre au sauvage eunuque noir.
La dernière fois que Bold le vit, ce fut peu avant d’accompagner l’empereur dans une expédition militaire à l’ouest, pour détruire les Tartares menés par Arughtai. Mais la cause était désespérée. Les Tartares étaient bien trop rapides, l’empereur bien trop malade. Rien de bon ne pouvait en sortir. Ils reviendraient avec l’hiver, dans quelques mois. C’est pourquoi Bold fut surpris que Kyu vienne lui dire au revoir dans les écuries.
Il avait l’impression de parler à un étranger, maintenant. Mais le jeune homme agrippa Bold par le bras, avec sérieux et affection, comme un prince s’adressant à un vieux serviteur.
— N’as-tu jamais eu envie de rentrer chez toi ? lui demanda-t-il.
— Chez moi ? demanda Bold.
— N’as-tu de famille nulle part ?
— Je ne sais pas. Cela fait si longtemps. Je suis sûr qu’ils me croient mort. Ils pourraient être… n’importe où…
— Oui, mais quelque part quand même. Tu pourrais les trouver.
— Sans doute.
Bold regarda Kyu, intrigué.
— Pourquoi me demandes-tu cela ?
Kyu ne répondit pas tout de suite. Il serrait toujours étroitement le bras de Bold. Pour finir, il dit :
— Connais-tu l’histoire de l’eunuque Chao Kao, qui fit tomber la dynastie Chin ?
— Non. Tu ne penses quand même plus à cela, j’espère ?
Kyu sourit.
— Non.
Il sortit de sous sa manche une petite gravure. Elle représentait la moitié d’un tigre, taillé dans du bois de fer, ses rayures finement gravées en creux. La faille qui courait en son milieu était à mortaises ; il s’agissait de la moitié d’un sceau, comme ceux qu’utilisaient les officiels afin d’authentifier leurs correspondances avec la capitale, quand ils se trouvaient en province.
— Prends ça avec toi quand tu t’en iras. Je garderai l’autre moitié. Cela t’aidera. Nous nous retrouverons.
Bold le prit, effrayé. C’était pour lui comme le nafs de Kyu, même si celui-ci ne pouvait être donné.
— Nous nous retrouverons. Au moins dans nos vies à venir, comme tu me le disais toujours. Tes prières pour les morts leur donnent des instructions à suivre pour se guider dans le bardo, c’est ça ?
— C’est ça.
— Je dois y aller.
Kyu l’embrassa sur la joue et disparut dans la nuit.
Comme prévu, l’expédition visant à conquérir les Tartares fut un lamentable échec, et par un soir d’orage l’empereur Yongle mourut. Bold ne se coucha pas de toute la nuit, maniant les soufflets pour attiser le feu où les officiers jetteraient tous leurs gobelets en fer-blanc, afin de fondre le cercueil dans lequel l’empereur reviendrait à Beijing. Il plut tout le long du chemin du retour. Le ciel pleurait. Ce n’est qu’une fois rentrés à Beijing que les officiers révélèrent la nouvelle.
Le corps impérial resta en l’état dans un cercueil approprié durant cent jours. La musique, les mariages et toutes les cérémonies religieuses furent interdits pendant ce temps-là, et tous les temples du pays durent faire sonner leurs cloches trente mille fois.
Pour les funérailles, Bold se joignit aux dix mille hommes de l’escorte.
La tombe de l’empereur, au nord-ouest de Beijing.
Soixante lis à pied, trois jours à zigzaguer
Pour semer les esprits malins, qui voyagent en ligne droite
Le complexe funéraire se trouve loin sous terre,
Empli des plus beaux atours et des biens les plus précieux de l’empereur,
Au bout d’une galerie longue de trois lis,
Bordée de serviteurs de pierre à ses ordres.
Combien de vies humaines leur faudra-t-il attendre ?
Seize de ses concubines ont été pendues,
Et enterrées autour de son cercueil.
Le jour où le Premier Héritier s’assit sur le Trône du Dragon, son premier édit fut lu partout à haute voix, dans le Grand Intérieur comme dans le Grand Vide. Vers la fin de l’édit, celui qui en donnait lecture proclama pour tous ceux qui se trouvaient assemblés devant la salle de l’Harmonie Suprême :
— Tous les voyages de la Flotte des trésors sont suspendus. Tous les bateaux mouillant à Hangzhou doivent rentrer à Nanjing, et toutes les marchandises se trouvant à bord de ces bateaux devront être envoyées au Département des Affaires Internes où elles seront stockées. Les officiels en voyage à l’étranger doivent rentrer à la capitale sur-le-champ ; et ceux qui avaient l’intention de partir à l’étranger doivent rester chez eux. La construction et la réparation des navires de la Flotte des trésors sont suspendues. Il n’y aura plus d’autorisations officielles pour partir à l’étranger, et ceux qui sont à l’étranger pour commercer doivent rentrer à la capitale.
Quand le lecteur eut fini son travail, le nouvel empereur, qui venait à l’instant de se nommer l’empereur Hongxi, s’adressa en personne à la foule :
— Nous avons fait trop de dépenses extravagantes. La capitale reviendra à Nanjing, et Beijing sera sa capitale auxiliaire. Les ressources impériales ne seront plus gâchées. Le peuple souffre. Le sortir de la misère doit être considéré comme une tâche aussi importante que sauver les gens du feu, ou de la noyade. Il n’y a pas à hésiter.
Bold vit le visage de Kyu de l’autre côté de la grande cour, petite figure noire aux yeux brillants. Le nouvel empereur se tourna vers les gens de la suite de son père, dont la plupart étaient des eunuques.
— Pendant des années, vous, les eunuques, n’avez pensé qu’à vous-mêmes, aux dépens de la Chine. L’empereur Yongle croyait que vous étiez avec lui. Mais ce n’était pas le cas. Vous avez trahi la Chine tout entière.
Kyu parla avant que ses compagnons ne puissent l’interrompre :
— Votre Grandeur, ce sont les fonctionnaires qui trahissent la Chine ! Ils essayent de vous imposer leur pouvoir, et de vous réduire à l’état d’empereur enfant pour toujours !
Avec un rugissement, un groupe de courtisans se précipita sur Kyu et quelques-uns des autres eunuques, sortant une arme de leur manche tout en courant. Les eunuques se battirent ou s’enfuirent, mais la plupart furent taillés en pièces sur place. Quant à Kyu, ils le poignardèrent plus d’un millier de fois.
L’empereur Hongxi s’approcha pour regarder, silencieux et immobile. Quand tout fut terminé, il dit :
— Prenez leurs corps et pendez-les dehors, à la Porte du Méridien. Que tous les eunuques sachent, et me craignent.
Plus tard, dans les écuries, Bold s’assit, la gravure du tigre dans les mains. Il avait bien cru qu’on le tuerait lui aussi, et avait honte de la façon dont cette idée l’avait occupé alors même qu’on massacrait Kyu sous ses yeux. Mais personne ne lui avait prêté la moindre attention. Il était fort possible que personne ne se souvienne qu’il connaissait Kyu.
Il savait qu’il s’en irait, mais il ne savait pas où. S’il allait à Nanjing, et aidait à brûler la Flotte des trésors, ainsi que les quais et les entrepôts, il contribuerait certainement à la réalisation des projets de son jeune ami. Mais de toute façon, cela disparaîtrait.
Bold se rappela leur dernière conversation. Il était peut-être temps de rentrer chez lui, de commencer une nouvelle vie.
C’est alors que des gardes apparurent à la porte. Nous savons ce qui se passa ensuite, et vous allez le savoir aussi. Alors, poursuivons.
8
Dans le bardo, Bold explique à Kyu la véritable nature de la réalité ; ayant retrouvé leur jati, ils sont renvoyés dans le monde
Au moment de mourir, Kyu vit une lumière blanche, aveuglante. Elle était là, partout, baignant le vide proprement dit, et il en faisait partie, et la chantait dans le vide.
Une éternité plus tard, il se dit : C’est pour ça qu’on se bat.
Et c’est ainsi qu’il en ressortit, reprenant conscience de lui-même. Ses pensées roulaient une orgie de monologues incessants, même après la mort. Incroyable mais vrai. Peut-être n’était-il pas encore mort. Mais son corps était là, réduit en morceaux, sur le sable de la Cité Interdite.
Il entendait la voix de Bold, dans ses pensées, qui disait une prière.
Kyu, mon garçon, mon beau garçon,
Le moment est venu pour toi de chercher le chemin.
Cette vie est terminée. Tu es maintenant
Face à face avec la lumière éclatante.
J’ai dépassé ce stade, se disait Kyu. Et après ? Mais Bold ne pouvait pas savoir où il irait cette fois. Les prières pour les morts n’étaient d’aucune utilité pour ça.
Tu es sur le point de faire l’expérience de la réalité
Dans toute sa pureté. Toute chose est le vide.
Tu seras comme un ciel clair,
Vide et pur. Ton esprit nommé
Sera comme l’eau calme et claire.
J’ai dépassé ce stade. À la prochaine étape !
— Utilise l’esprit pour interroger l’esprit. Ne dors pas à ce moment crucial. Ton âme doit quitter ton corps éveillé, et sortir par le trou de Brahma.
Les morts ne dorment pas, songea Kyu, agacé. Et mon âme a déjà quitté mon corps.
Son guide était loin derrière lui. Mais ça avait toujours été comme ça, avec Bold. Kyu devrait trouver sa propre voie. Le vide environnait toujours l’unique fil de ses pensées. Certains des rêves qu’il avait faits pendant sa vie venaient de cet endroit.
Il cligna de l’œil, ou dormit, et puis il se retrouva dans un vaste tribunal. L’estrade du juge était sur un large pont, un plateau dans une mer de nuages. Le juge était une énorme divinité au visage noir, assise, le ventre rond, sur l’estrade. Ses cheveux étaient de feu, et brûlaient ardemment sur sa tête. Derrière lui, un homme à la peau noire tenait un toit de pagode qui aurait pu venir tout droit du palais de Beijing. Au-dessus du toit flottait un petit Bouddha assis, d’un calme rayonnant. À sa gauche et à sa droite se trouvaient des divinités paisibles, assises, des présents dans leurs bras ; mais elles étaient toutes très loin, et pas pour lui. Les morts vertueux gravissaient de longues routes qui montaient dans le vide vers ces dieux. Sur le pont qui entourait l’estrade, les morts moins bien lotis étaient hachés menus par des démons aussi noirs que le Seigneur de la Mort, mais plus petits et plus agiles. Sous le pont, d’autres démons torturaient d’autres âmes. C’était une scène très tourmentée, et Kyu était ennuyé. C’est mon jugement, et on se croirait dans un abattoir au petit matin ! Comment veut-on que je me concentre ?
Un être qui ressemblait à un singe s’approcha de lui et leva la main.
— Jugement ! dit-il d’une voix profonde.
La prière de Bold retentit dans son esprit, et Kyu se rendit compte que Bold et ce singe étaient liés, d’une façon ou d’une autre.
— Rappelle-toi : ce que tu endures à présent résulte de ton karma, disait Bold. C’est le tien ; il n’est à personne d’autre. Implore le pardon. Un petit dieu blanc et un petit démon noir vont apparaître, et compter les cailloux blancs et les cailloux noirs de tes actions, bonnes et mauvaises.
Et c’est ce qui arriva. Le diablotin blanc, blanc comme un œuf, et le diablotin noir, noir comme l’onyx, arrachaient du sol des monceaux de pierres noires et blanches, qui paraissaient, à la grande surprise de Kyu, s’équilibrer. Il ne se souvenait pas d’avoir jamais accompli la moindre bonne action.
— Vous serez effrayé, terrifié, impressionné.
Mais non ! Ces prières étaient pour une autre sorte de morts, pour les gens comme Bold.
— Tu essaieras de mentir, de dire que tu n’as commis aucune mauvaise action.
Je ne dirai jamais une chose aussi ridicule.
Soudain, le Seigneur de la Mort, sur son trône, remarqua Kyu, et malgré lui, Kyu flancha.
— Apportez le miroir du karma, dit le dieu avec un horrible sourire grimaçant, les yeux luisants comme des charbons ardents.
— N’aie pas peur, fit la voix de Bold, dans sa tête. Ne dis pas de mensonges, ne sois pas terrifié, ne crains pas le Seigneur de la Mort. Le corps dans lequel tu es à présent n’est qu’un corps mental. Tu ne peux pas mourir dans le bardo, même s’ils te déchiquètent en morceaux.
Merci, songea Kyu, mal à l’aise. C’est tellement réconfortant.
— Voici venu le moment du jugement. Cramponne-toi, aie de bonnes pensées ; rappelle-toi : tous ces événements sont tes propres hallucinations, la vie qui t’attend dépend de tes pensées en cet instant. Un unique moment d’existence peut faire une grande différence. Ne te laisse pas distraire quand les six lumières apparaîtront. Considère-les avec compassion. Contemple le Seigneur de la Mort sans crainte.
Le dieu noir leva un miroir et le dirigea si adroitement vers Kyu que celui-ci y vit son propre visage, aussi noir que celui du dieu. Il vit que le visage était l’âme nue elle-même, et que la sienne était aussi noire et terrible que celle du Seigneur de la Mort. C’était le moment de vérité ! Et il devait se concentrer, ainsi que Bold le lui rappelait. Pendant ce temps, le charivari frénétique se poursuivait, hurlant, grinçant, tonitruant, autour de lui. Toutes les punitions et toutes les récompenses possibles étaient distribuées en même temps, et il ne pouvait s’empêcher d’en être contrit.
— Pourquoi le noir est-il le mal et le blanc le bien ? demanda-t-il au Seigneur de la Mort. Je n’ai jamais vu les choses comme ça. Si tout cela est le reflet de ma pensée, alors pourquoi est-ce ainsi ? Pourquoi mon Seigneur de la Mort n’est-il pas un grand marchand d’esclaves arabe, comme dans mon village ? Pourquoi vos agents ne sont-ils pas des lions et des léopards ?
Mais le Seigneur de la Mort était un marchand d’esclaves arabe, il le voyait à présent ; un minuscule Arabe gravé en creux sur le front noir du dieu regardait Kyu et lui faisait de grands signes. Celui qui l’avait capturé et emmené jusqu’à la côte ; et parmi les cris des malheureux déchiquetés rugissaient des lions et des léopards qui dévoraient avidement les entrailles des victimes encore vivantes.
Rien que mes propres pensées, se rappela Kyu, qui sentait la peur monter dans sa gorge. Ce royaume était comme le monde des rêves, mais plus solide ; plus concret, même, que le monde éveillé de la vie qu’il venait de vivre ; démesurément plein de lui-même, de sorte que les feuilles des buissons (dans des pots de céramique !) sourdaient comme des feuilles de jade, pendant que le trône de jade du dieu palpitait d’une consistance qui dépassait de beaucoup celle de la pierre. De tous les mondes, le bardo était celui de la réalité ultime.
Le blanc visage de l’Arabe sur le front noir riait et piaulait, « Condamné ! », et l’énorme visage noir du Seigneur de la Mort rugissait, « Condamné à l’enfer ! ». Il lança une corde autour du cou de Kyu et le traîna à bas de l’estrade. La corde lui arracha la tête, lui arracha le cœur, les entrailles, le vida de son sang, dénuda ses os ; et pourtant Kyu ne mourait pas. Le corps en mille morceaux, il revivait toujours. Et tout recommençait, tout cela dans une douleur intense. Torturé par la réalité. La vie est une chose d’une extrême réalité ; la mort aussi.
Les idées sont implantées dans l’esprit de l’enfant comme des graines ; elles peuvent pousser jusqu’à régner sur la vie.
La défense : Je n’ai rien fait de mal.
La souffrance se décomposa en angoisse, regret, remords ; nausée devant ses vies passées et le peu qu’elles lui avaient valu. En cette heure terrible, il les sentait toutes sans pouvoir vraiment se les rappeler. Mais elles avaient eu lieu ; oh, sortir de la roue sans fin du feu et des larmes. Le chagrin et la douleur qu’il éprouvait alors étaient pires que le supplice de l’écartèlement. La solidité du bardo s’effrita et il fut assailli par la lumière qui explosait dans ses pensées, à travers laquelle le palais du jugement ne pouvait être vu que comme une sorte de voile, ou une peinture dans l’air.
Mais Bold était là, et il était jugé à son tour. Bold, le singe à la tête rentrée dans les épaules, la seule personne qui avait eu une quelconque importance pour Kyu depuis sa capture. Kyu réprima le désir de l’appeler à l’aide ; il ne voulait pas distraire son ami en ce moment précis, ce moment entre tous, le dernier, dans l’infinité des moments, où il avait besoin d’être distrait. Néanmoins, quelque chose avait dû échapper à Kyu, un gémissement de l’esprit, une pensée angoissée ou un appel au secours, parce qu’une furieuse bande de démons à quatre bras entraînèrent Kyu, l’emmenèrent à un endroit d’où il ne voyait pas le jugement de Bold.
Puis il se retrouva bel et bien en enfer, et la souffrance fut le moindre de ses tourments, aussi superficielle que des piqûres de moustique par rapport à la souffrance profonde, océanique, de sa déréliction. L’angoisse de la solitude ! Explosions colorées, mandarine, citron vert, vif argent, chaque teinte, plus acide que la précédente, lui brûla la conscience d’une angoisse chaque fois plus profonde. J’erre dans le bardo, sauve-moi ! Sauve-moi !
Et Bold se retrouva là, avec lui.
Ils étaient dans leur propre corps et ils se regardaient. La lumière devint plus claire, moins pénible pour les yeux ; un unique rayon d’espoir troua les profondeurs du désespoir de Kyu, comme une lanterne de papier solitaire entrevue de l’autre côté du lac de l’Ouest. Tu m’as retrouvé, dit Kyu.
Oui.
C’est un miracle que tu m’aies retrouvé ici.
Non. On se retrouve toujours, dans le bardo. Nos chemins se croiseront tant que les six mondes tourneront dans ce cycle du cosmos. Nous faisons partie d’une jati karmique.
Qu’est-ce que c’est ?
La jati ? Ta sous-caste, ta famille, ton village. Elle se manifeste diversement. Nous sommes tous arrivés ensemble dans le cosmos. De nouvelles âmes naissent dans le néant, mais pas souvent, surtout à ce stade du cycle, parce que nous sommes dans le Kali-yuga, l’Âge de la Destruction. Quand de nouvelles âmes apparaissent, ça arrive comme une graine de pissenlit, des âmes comme des graines, portées par le vent du dharma. Nous sommes tous des graines de ce que nous pourrions être. Mais les nouvelles graines flottent de concert et ne s’éloignent jamais de beaucoup ; c’est mon avis. Nous avons déjà traversé bien des vies côte à côte. Notre jati a été particulièrement unie depuis l’avalanche. Le destin nous a liés. Nous montons ou nous tombons ensemble.
Mais je ne me rappelle pas les autres vies. Et je ne me rappelle personne de cette vie passée, en dehors de toi. Je ne reconnais que toi ! Où sont les autres ?
Tu ne m’avais pas reconnu non plus. C’est nous qui t’avons retrouvé. Tu ne cessais de t’éloigner de la jati depuis bien des réincarnations, maintenant, toujours plus bas, plus bas en toi seul, dans des lokas de plus en plus bas. Il y a six lokas : ce sont les mondes, les royaumes, de la renaissance et de l’illusion. Le ciel, le monde des devas ; puis le monde des asuras, ces géants toujours en conflit ; puis le monde humain ; puis le monde animal ; puis le monde des prêtas, ou des fantômes affamés ; puis l’enfer. Nous nous déplaçons entre eux au gré des changements de notre karma, vie après vie.
Combien sommes-nous dans cette jati ?
Je ne sais pas. Une douzaine peut-être, ou une demi-douzaine. Les contours du groupe sont un peu flous. Certains s’en vont et ne reviennent que beaucoup plus tard. Nous étions un village, en ce temps-là, au Tibet. Mais il y avait des visiteurs, des marchands. De moins en moins chaque fois. Les gens se perdent, ou tombent. Comme toi. Quand le désespoir frappe.
Rien que de l’entendre, ce mot envahit Kyu : désespoir. Bold devint transparent.
Bold, aide-moi ! Que dois-je faire ?
Aie de bonnes pensées. Écoute, Kyu, écoute – nous sommes pareils à nos pensées. Tels nous pensons, tels nous sommes. Tout le temps comme partout. Parce que les pensées sont des choses, mères de toutes les actions, bonnes ou mauvaises. Tel nous semons, tel nous récolterons.
J’aurai de bonnes pensées, ou j’essaierai, mais que dois-je faire ? Que dois-je chercher ?
Les lumières te mèneront. Chaque monde a sa propre couleur ; la lumière blanche des devas, la verte des asuras, la jaune des humains, la bleue des animaux, la rouge des fantômes, et celle, couleur de fumée, de l’enfer. Ton corps apparaîtra de la couleur du monde dans lequel tu dois retourner.
Mais nous sommes jaunes ! fit Kyu en regardant sa main. Et Bold était aussi jaune qu’une fleur.
Ça veut dire que nous devons réessayer. Essayer et essayer encore, vie après vie, jusqu’à ce que nous parvenions à la sagesse du Bouddha et que nous soyons enfin libérés. Parfois, alors, certains décident de regagner le monde des humains, pour aider les autres sur le chemin de la libération. Ceux-là s’appellent les bodhisattvas. Il se pourrait que tu sois l’un d’eux, Kyu. Je vois en toi. Écoute-moi, maintenant. Tu devras bientôt fuir pour sauver ta vie. Des choses vont te pourchasser, et tu te cacheras. Dans une maison, une grotte, la jungle, une fleur de lotus. Autant de ventres maternels. Tu auras envie de rester dans ta cachette, pour échapper aux terreurs du bardo ; mais c’est là que se trouvent les prêtas, et tu deviendras un fantôme. Si tu veux t’en sortir, tu dois émerger à nouveau. Choisis ta porte, un ventre maternel, ni attirant ni repoussant. Les apparences peuvent être trompeuses. Va comme bon te semblera. Écoute ton cœur. Essaie d’abord d’aider d’autres esprits, comme si tu étais déjà un bodhisattva.
Je ne sais pas comment faire !
Apprends. Sois attentif et apprends. Tu dois suivre, ou tu perdras la jati pour de bon.
Puis ils furent attaqués par d’énormes lions à la crinière pleine de sang, qui rugissaient furieusement. Bold partit dans une direction et Kyu dans une autre. Kyu courut et courut, un lion sur les talons. Il tourna entre deux arbres, sur un chemin. Le lion continua tout droit, perdant sa trace.
À l’est, il vit un lac où glissaient des cygnes noirs et blancs. À l’ouest, un lac dans lequel se baignaient des chevaux ; au sud, un semis de pagodes ; au nord, un lac avec un château au milieu. Il prit vers le sud, vers les pagodes, avec la vague impression que ç’aurait été le choix de Bold ; sentant aussi que Bold et le reste de sa jati étaient déjà là-bas, en train de l’attendre, dans l’un des temples.
Il arriva aux pagodes. Il s’aventura d’un bâtiment au suivant, regardant par les portes, choqué par des visions de foules désemparées, se battant contre des gardes et des surveillants à tête de hyène, ou les fuyant ; un enfer de village, où chaque futur possible était catastrophique, terrifiant. La Mort y était née.
Beaucoup de temps passa dans cette horrible quête, et puis il vit, par les portes d’un temple, sa jati, sa cohorte, Bold et tous les autres, Shen, I-Li, Dem – sa mère –, Zheng He, tout le monde. Il les reconnut aussitôt – Oh, se dit-il, évidemment. Ils étaient nus, ruisselants de sang, néanmoins prêts à partir en guerre. Puis les hyènes se mirent à hurler, et Kyu fuit dans la lumière jaune, crue, du matin, à travers les arbres, sous le couvert des herbes à éléphant. Les hyènes erraient parmi les hautes herbes, et il continua entre les lames coupantes d’une touffe brisée pour s’y réfugier.
Pendant longtemps, il resta tapi dans l’herbe jusqu’à ce que les hyènes se dispersent, alors que les appels de sa jati l’imploraient de revenir. Il demeura caché là pendant une longue nuit pleine de sons affreux, de créatures massacrées et dévorées ; mais il était sain et sauf ; et le matin revint. Il décida de partir vers le nord et découvrit que la route était coupée. Les herbes tranchantes comme des lames avaient poussé, et il était encerclé par de longues épées dardées vers lui, qui le coupaient en grandissant. Ah, se dit-il, c’est un ventre maternel. J’en ai choisi un sans le vouloir, sans écouter Bold, séparé de ma famille, inconscient et apeuré. Le pire choix possible.
Et pourtant, rester là serait devenir un fantôme affamé. Il devait se soumettre. Il devait renaître. Il gémit à l’idée de cette malédiction, se maudit, se traita d’imbécile. Essaye d’avoir un peu plus de présence d’esprit, la prochaine fois, se dit-il, un peu plus de courage ! Ce ne serait pas facile ; le bardo était un endroit terrifiant. Mais maintenant qu’il était trop tard, il décida qu’il devrait essayer. La prochaine fois !
Et c’est ainsi qu’il réintégra le royaume humain. Ce qui leur arriva, à ses compagnons et à lui-même, la fois suivante, ce n’est pas à nous de le dire. Partis, partis, complètement au-delà ! Salut à tous !
LIVRE 2
LE HAJ AU CŒUR
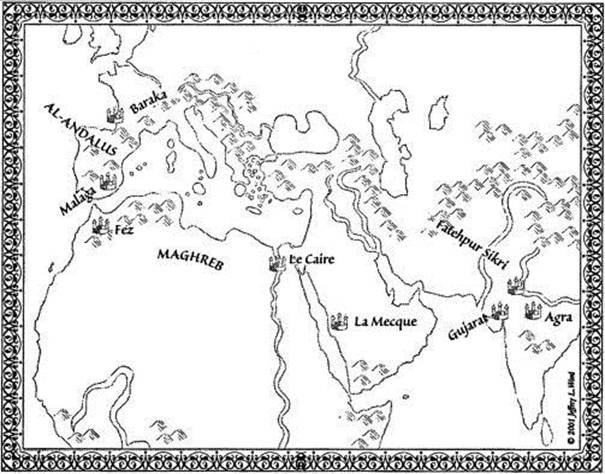
1. Le coucou du village
Il arrive parfois qu’il y ait une confusion, et que l’âme cherchant à se réincarner entre dans un ventre déjà occupé. Il y a alors deux âmes dans le même bébé, et c’est la bagarre. Une mère sent ce genre de chose, le bébé qui se roue de coups dans son ventre, en lutte avec lui-même. Puis il naît, et le choc de la naissance le fait se tenir tranquille pendant un moment, le temps pour lui d’apprendre à respirer, et de se faire à la vie. Ensuite, le combat des deux âmes pour la possession de ce petit corps reprend. C’est la colique.
Un bébé qui a la colique pleure comme si on le battait, se tord de douleur, en proie à de violentes convulsions, pendant des heures et des heures. Ce n’est pas une surprise, deux âmes se battent en lui, et pendant plusieurs semaines le bébé va pleurer, les entrailles torturées par ce conflit. Rien ne peut soulager sa détresse. C’est le genre de situation qui ne peut pas s’éterniser, car une telle souffrance est bien trop intense pour un si petit corps. Dans la plupart des cas, l’âme du coucou parvient à chasser la première, et le corps finit par retrouver la paix. Mais il arrive, parfois, que la première âme l’emporte sur celle du coucou, et que les choses se passent comme elles auraient dû se passer. Ou sinon, dans quelques rares cas, aucune des deux n’a suffisamment de force pour chasser l’autre, et la colique continue, pendant que le bébé grandit, personnalité divisée, confuse, erratique, déséquilibrée, sujette à la folie.
Kokila était née à minuit. La dai l’avait sortie du ventre de sa mère en disant :
— C’est une fille, pauvre petite chose !
Sa mère, Zaneeta, l’avait serrée fort sur son cœur, et avait dit :
— Ce n’est pas grave, on t’aimera quand même.
Elle avait à peine une semaine quand la colique commença. Elle vomit le lait de sa mère et pleura désespérément toute la nuit. Très vite, Zaneeta oublia ce que ce joyeux bébé avait été, une sorte de larve placide lui tétant le sein, découvrant le monde en gazouillant, émerveillée. En proie à la colique, le bébé pleurait, hurlait, gémissait, gigotait. C’était horrible à voir. Zaneeta ne pouvait rien faire ; que la prendre dans ses bras, et lui mettre une main sur le ventre, sentant les muscles du bébé se contracter, le plaçant tête en bas contre sa hanche. Il y avait quelque chose dans cette position, peut-être les efforts qu’elle faisait pour essayer de redresser la tête, qui la calmait. Mais cela ne marchait pas toujours, et jamais très longtemps. Alors les convulsions et les hurlements recommençaient, rendant Zaneeta quasi folle. Elle devait nourrir son mari, Rajit, et ses deux sœurs aînées. En outre, ayant donné naissance à trois filles les unes à la suite des autres, elle n’avait plus les faveurs de son mari, et ce dernier bébé était insupportable. Zaneeta essaya de dormir avec elle chez les femmes, mais, si gentilles qu’elles soient, quand elles avaient leurs règles, elles ne supportaient pas les cris du nourrisson. Elles aimaient bien rester entre elles. Ce n’était pas un endroit pour un bébé. Zaneeta fut bientôt contrainte de dormir avec Kokila dehors, contre le mur de la maison de sa famille, où elles finissaient par trouver quelques moments de sommeil, entre deux séances de cris.
Cela dura à peu près deux mois, puis cela s’arrêta. Ensuite, le bébé eut le regard changé. La dai qui l’avait mis au monde, Insef, lui pris le pouls, lui examina les yeux, goûta ses urines et déclara qu’une autre âme avait fini par s’emparer du bébé, mais que ce n’était pas bien grave, que cela arrivait à de nombreux bébés, et que c’était même un mieux – l’âme la plus forte l’ayant emporté.
Mais, après toutes ces épreuves, Zaneeta considérait Kokila avec appréhension ; et pendant toute son enfance, Kokila lui renvoya son regard, à elle et au reste du monde, avec une sorte de sauvagerie et de noirceur, comme si elle se demandait où elle était et pourquoi. C’était en fait une petite fille perturbée et souvent en colère, mais très habile à enjôler les autres, aussi câline que braillarde, et surtout, de toute beauté. Elle était également très forte, et rapide. Dès l’âge de cinq ans elle fut plus une aide qu’une charge pour la maisonnée. Entre-temps, Zaneeta avait eu deux autres enfants, dont le dernier était un garçon, leur soleil à tous – loués soient Ganesh et Kartik ! Avec tout le travail qu’il y avait, elle appréciait que Kokila soit si débrouillarde, si indépendante.
Bien sûr, le petit garçon, Jahan, était le centre de la maisonnée, et Kokila n’était que la plus douée des filles de Zaneeta. Elle était très occupée à grandir, et Zaneeta la connaissait beaucoup moins bien que Rajit ou Jahan – ce dernier mobilisant son attention.
Kokila put donc en faire à peu près à sa tête pendant quelques années. Insef disait souvent que l’enfance était le moment le plus agréable de la vie d’une femme ; une petite fille, ça n’avait pas vraiment affaire aux hommes, ça se contentait de donner un coup de main à la maison et aux champs. Mais la dai se faisait vieille. Elle tenait sur le mariage et sur l’amour des propos cyniques, ayant souvent constaté à quel point cela finissait mal, pour elle comme pour les autres. Kokila n’était pas plus disposée à l’écouter qu’une autre. Pour dire la vérité, il semblait qu’elle n’écoutait pas grand monde. Elle regardait les gens avec ce genre d’air effarouché que l’on voyait souvent dans les yeux des animaux surpris dans la forêt, et parlait peu. Elle avait l’air d’aimer travailler toute la journée au-dehors. Elle regardait son père sans rien dire, en ouvrant de grands yeux. Les autres enfants du village ne l’intéressaient guère, à l’exception d’une petite fille qu’on avait trouvée un matin chez les femmes alors qu’elle était encore tout bébé. Insef élevait cette orpheline pour être la prochaine dai. Elle l’avait appelée Bihari. Très souvent, Kokila passait au petit matin prendre Bihari dans la hutte de la dai avant de vaquer à ses travaux ménagers. Elle ne lui parlait guère plus qu’aux autres, mais lui montrait les choses et, surtout, prenait la peine de l’emmener partout, ce qui étonnait Zaneeta. L’orpheline n’avait rien d’extraordinaire après tout, ce n’était qu’une petite fille comme les autres. Mais c’était encore un des mystères de Kokila.
Dans les mois précédant la mousson, le travail de Kokila et de la maisonnée s’accrut pendant plusieurs semaines. Se réveiller à l’aube et garnir le feu. Traverser le village à la fraîcheur du matin, dans l’air encore vierge de toute poussière. Aller chercher Bihari à la petite hutte de la dai, dans les bois. Descendre aux feuillées, se laver, puis retour au village pour y prendre les cruches, et remonter la rivière. Passer aux mares, où les femmes étaient déjà en train de faire la lessive, et continuer jusqu’au trou d’eau. Remplir les cruches et les trimballer de nouveau, énormes et lourdes, vers le village, en s’arrêtant souvent pour se reposer. Puis nouvelle expédition dans la forêt à la recherche de bois pour le feu. Cela pouvait prendre toute la matinée. Ensuite, retour aux champs, à l’ouest du village, où son père et ses frères avaient des terrains, pour y semer l’orge et le blé. Ils étalaient les semailles sur quelques semaines, de telle sorte que les grains mûrissaient pendant tout le mois des récoltes. La rangée de cette semaine était rabougrie, les épis petits, mais Kokila lança ses graines dans la terre labourée sans penser à rien ; puis, dans la chaleur du jour, elle alla s’asseoir avec les autres femmes. Ensemble, elles mélangèrent les graines pilées avec de l’eau pour en faire de la pâte à pain, tournèrent les chapatis, en cuirent quelques-uns. Après cela, elle alla voir leur vache. Quelques mouvements du doigt dans son rectum provoquèrent un jaillissement de bouses qu’elle recueillit encore chaudes dans ses mains, et dont elle fit des pâtés auxquels elle adjoignit un peu de paille avant de les mettre à sécher, et de les poser sur le mur de pierre et de tourbe qui délimitait le champ de son père. Après cela elle emporta quelques pâtés de bouse séchée à la maison, en plaça dans le feu et descendit à la rivière pour se laver les mains et nettoyer les vêtements sales : quatre saris, des dhotis, des draps. Puis, dans la lumière déclinante du jour, la chaleur et la poussière dorant toute chose, retour à la maison, pour faire cuire des chapatis et du daal bhat sur le petit poêle en argile près du foyer.
Peu après la tombée de la nuit, Rajit rentrait chez lui. Zaneeta et les filles l’entouraient d’attentions, et ce n’est qu’après avoir mangé le daal bhat et les chapatis qu’il commençait à se détendre. Si la journée s’était bien passée, il en parlait un peu à Zaneeta. Sinon, il se taisait. Mais d’ordinaire il parlait des transactions concernant les terres et les animaux. Les familles du village mettaient les jeunes animaux dans les champs les plus proches, par sécurité. Leur père s’occupait de faire du courtage de vaches et de veaux, essentiellement entre Yelapur et Sivapur. Il s’occupait également d’arranger les mariages de ses filles, ce qui n’était pas une sinécure, car il en avait beaucoup ; mais il leur donnait une dot chaque fois qu’il le pouvait, et n’hésitait pas à les marier en dessous de leur condition. En fait, il n’avait pas le choix.
À la fin de la soirée, ils déroulaient les matelas sur le sol pour dormir, près du feu, à cause de sa chaleur si la nuit était froide, de sa fumée si la nuit était chaude et qu’il y avait des moustiques. Une autre nuit passait.
Un soir, après le repas, quelques jours avant la fête de Durga Puja qui marquait la fin des moissons, son père dit à sa mère qu’il avait arrangé pour Kokila, dont c’était le tour de se marier, un mariage possible avec un homme de Dharwar, le village commerçant juste de l’autre côté de Sivapur. Le mari envisagé était un Lingayat, comme la famille de Rajit et la plupart des habitants de Yelapur, et se trouvait être le troisième fils du chef du village de Dharwar. Cela dit, il s’était disputé avec son père, ce qui l’empêchait de se montrer trop exigeant quant à la dot, disait Rajit. Il ne pouvait probablement plus se marier à Dharwar, se dit Kokila, mais qu’importe, elle était tout excitée. Zaneeta eut l’air contente et dit qu’elle rencontrerait le postulant lors de Durga Puja.
D’habitude, la vie était rythmée par les fêtes, chaque fois différentes, et qui donnaient aux jours leurs couleurs, leurs saveurs. C’est ainsi que la fête des chars de Krishna, pendant la moisson, fournissait un curieux contraste de couleurs et de gaieté avec la grisaille des jours. Des garçons soufflaient dans des feuilles de palmier en guise de trompette comme s’ils avaient voulu chasser la pluie par la seule force de leur souffle, et tout le monde s’énervait très vite si par malheur leurs efforts ne réduisaient pas assez rapidement leur trompette à l’état de feuilles de palmier. Puis le Dolatsaba, en l’honneur de Krishna, avait lieu à la fin de la moisson, avec ses éventaires où l’on pouvait acheter plein de choses superflues comme des cithares et des tambours, mais aussi de la soie, des toques brodées, des chaises, des tables, des commodes. Quant à l’Id, le ramadan, sa date changeait chaque année ; ce qui en faisait une fête très humaine, affranchie de la terre et des dieux, durant laquelle tous les musulmans se rendaient à Sivapur pour assister à la parade des éléphants.
Ensuite, Durga Puja marquait les moissons, le point culminant de l’année, honorant la déesse mère et toutes ses œuvres.
Au premier jour de la fête, les femmes se rassemblaient et préparaient une fournée de pâte de bindi vermillon tout en buvant un peu du chang rougeoyant de la dai, après quoi, elles se séparaient, maquillées et gloussantes. Lors du défilé d’ouverture, elles suivaient les joueurs de tambour musulmans en criant :
« À la victoire de Mère Durga ! »
La statue aux yeux bridés de la déesse, faite d’argile et revêtue de papiers blancs et de dorures, avait un air vaguement tibétain. À côté se dressaient quatre statues décorées de façon similaire : celles de Laksmi et de Saraswati, et de leurs fils Ganesh et Kartik. Deux chèvres étaient attachées l’une après l’autre à des piquets sacrificiels placés aux pieds des statues, pour y être décapitées. Leur tête, ruisselante de sang, roulait alors dans la poussière, les yeux tournées vers le ciel.
Le sacrifice d’un buffle était quelque chose d’encore plus exceptionnel ; un prêtre spécial venait à cette occasion de Bhadrapur, avec un grand cimeterre affûté pour la circonstance. C’était très important, parce que si le cimeterre ne parvenait pas à décapiter le buffle d’un seul coup, cela voulait dire que la déesse était mécontente et refusait l’offrande. Les garçons passaient la matinée à frotter le dessus du cou du buffle avec du beurre, pour l’assouplir.
Cette fois-ci, le prêtre assena au buffle un coup si puissant que sa tête tomba net. Les convives poussèrent de grands cris et se ruèrent sur le corps de l’animal pour en détacher de minuscules boulettes de poussière et de sang, qu’ils se jetèrent à la figure, en hurlant.
Une ou deux heures plus tard, l’ambiance avait radicalement changé. L’un des vieillards se mit à chanter :
— Le monde est souffrance, c’est un fardeau trop lourd pour nos épaules !
Les femmes reprirent alors son chant de plus belle, car il était dangereux pour les hommes qu’on les entende mettre en cause la déesse mère ; les femmes durent même pendant la chanson se faire passer pour des démons blessés.
— Qui est-Elle, Elle qui marche dans les plaines comme la Mort, Elle qui se bat et fond comme la Mort ? Une mère ne tuerait pas son enfant, Sa propre chair, la joie de la création, et pourtant nous voyons la Tueuse regarder çà et là…
Plus tard, alors que la nuit tombait, les femmes rentrèrent chez elles et mirent leur plus beau sari, puis revinrent et s’alignèrent sur deux rangées, tandis que les garçons et les hommes criaient :
« Victoire à la Grande Déesse ! »
La musique commença, sauvage, déchaînée, la foule dansant et discutant autour des bûchers, paraissant à la fois terriblement belle et inquiétante dans sa parure de feu.
Alors, les habitants de Dharwar arrivèrent, et la danse gagna en sauvagerie. Les parents de Kokila la prirent par la main et lui firent quitter la danse, pour la présenter aux parents de son promis. Apparemment, une réconciliation avait eu lieu en vue de cet événement. Le père, qu’elle avait déjà rencontré, le chef de Dharwar, s’appelait Shastri ; la mère, qu’elle n’avait jamais vue, parce que le père, bien qu’il ne fut pas vraiment riche, l’avait contrainte au purdah, l’isolant du regard de la société.
La mère observa attentivement Kokila, sans hostilité. De la pâte de bindi lui coulait le long des sourcils. Elle était en sueur à cause de la chaleur de la nuit. Elle ferait peut-être une belle-mère correcte. Puis on lui présenta le fils, Gopal, le troisième enfant de Shastri. Kokila hocha la tête non sans raideur, le regardant de travers, ne sachant quoi penser. Il avait le visage fin, le regard intense, et respirait la jeunesse, peut-être un peu nerveux – elle n’aurait su le dire. Elle était plus grande que lui. Mais cela pourrait s’arranger.
On les renvoya chacun de son côté, sans qu’ils aient échangé un mot, que cet unique regard un peu fébrile. Elle ne devait plus le revoir pendant trois ans. Cependant, elle n’oublia jamais qu’ils devaient se marier, et que c’était bien, puisque son cas était désormais réglé. Son père pourrait arrêter de se faire du souci pour elle, et lui parler sans s’énerver.
Elle n’avait jamais remarqué qu’il y avait autant d’échanges entre les deux villages. Mais maintenant que c’était important pour elle, elle commençait à s’y intéresser. Avec le temps, grâce aux ragots des femmes, elle en apprit un peu plus sur la famille où elle allait entrer. Shastri était un chef impopulaire. Son dernier méfait avait été d’exiler le forgeron de Dharwar pour être allé voir l’un de ses frères dans les collines sans lui demander la permission d’abord. Il n’avait pas non plus réuni le panchayat. En fait, depuis quelques années, depuis qu’il avait succédé à son père comme chef du village, il n’avait jamais réuni le panchayat, prenant toutes ses décisions seul. Pourquoi ? les gens se le demandaient bien. En fait, le chef et son fils aîné dirigeaient Dharwar comme s’ils en étaient les zamindars !
Kokila écoutait tout cela sans trop se sentir concernée, et passait autant de temps que possible avec Bihari. Celle-ci apprenait à se servir des herbes que la dai utilisait. C’est pourquoi, quand elles partaient ramasser du bois, Bihari cherchait dans la forêt toutes sortes d’herbes pour la dai : la morelle douce-amère, dans les coins ombragés et humides, l’asclépiade tubéreuse, là où il y avait du soleil, la graine de castor, dans les racines de saal, et bien d’autres. De retour à leur hutte, Kokila aidait à piler les plantes séchées, ou bien à les préparer, dans l’huile ou dans l’alcool. Insef s’en servait principalement dans son travail de sage-femme : pour stimuler des contractions, détendre le ventre, apaiser les douleurs, ouvrir le col de l’utérus, stopper une hémorragie, et ainsi de suite. Il y avait toute une tripotée de plantes et de parties d’animaux dont la dai voulait leur apprendre à se servir.
— Je suis vieille, disait-elle. J’ai trente-six ans, et ma mère est morte à trente. C’est sa propre mère qui lui avait tout appris. La dai qui inculqua ces choses à ma grand-mère était originaire d’un village dravidien, plus au sud, où les noms et les propriétés de chaque ingrédient étaient transmis de femme en femme. Elle avait appris à ma grand-mère tout ce que les Dravidiens savaient et ont jamais su depuis qu’il y a des dais, en remontant jusqu’à Saraswati, la déesse du savoir elle-même. On ne peut pas laisser ce savoir se perdre. Vous devez l’apprendre et l’inculquer ensuite à vos filles, de façon à soulager autant que faire se peut les mères qui enfantent, les pauvres choses, et à en garder le plus grand nombre possible en vie.
Les gens disaient que la dai avait un mille-pattes dans la tête. Cette expression signifiait que vous étiez un peu excentrique, même si, au sens littéral du terme, les mères vous regardaient les oreilles quand vous aviez passé trop de temps allongé par terre, la tête dans l’herbe, et vous rinçaient parfois les oreilles à l’huile, parce que les mille-pattes détestent l’huile. Elle parlait très souvent à une vitesse incroyable, plus vite que n’importe qui, marmonnant des choses parfois incompréhensibles, souvent pour elle-même ; Kokila aimait bien l’écouter.
Il fallut peu de temps à Insef pour convaincre Bihari de l’importance de ces choses. C’était une petite fille vive et joyeuse, qui avait l’œil pour repérer les plantes dans la forêt et une excellente mémoire. De plus, elle était souriante, parlait gentiment aux gens, et avait toujours une parole aimable. En fait, on aurait même pu dire qu’elle était trop belle et joyeuse, parce que l’année où Kokila devait épouser Gopal, Shardul, son frère aîné, le premier-né des fils de Shastri, et qui devait bientôt être son beau-frère – l’un des membres de la famille de son mari qui auraient le droit de lui donner des ordres –, se mit à jeter des regards un peu trop appuyés sur Bihari. À partir de ce moment, elle eut beau faire, il la regardait. Cela ne pouvait mener à rien de bon puisque Bihari était une intouchable, et ne pouvait donc se marier. Insef faisait tout ce qu’elle pouvait pour la tenir à l’écart. Mais les fêtes amenaient les femmes et les hommes célibataires à se rencontrer, et la vie au village apportait maintes occasions de se croiser, même brièvement. Qui plus est, de toute façon, Bihari était intéressée, même si elle savait qu’elle ne pourrait jamais se marier. La dai avait beau la mettre en garde, elle avait trop envie d’être comme tout le monde.
Le jour où Kokila se maria avec Gopal et partit pour Dharwan arriva enfin. Il s’avéra que sa belle-mère était en fait une personne taciturne et irritable, et Gopal lui-même n’était pas un cadeau. C’était un homme de peu d’envergure, qui n’avait pas grand-chose à dire, totalement sous la coupe de ses parents, bien qu’il ne fut pas réconcilié avec son père. Il commença par essayer de dominer Kokila de la même façon que ses parents le dominaient lui, mais sans trop de conviction, notamment après qu’elle l’eut plusieurs fois rembarré. Il en avait l’habitude, et bien vite ce fut elle qui eut le dessus. Elle ne l’aimait pas beaucoup, et attendait impatiemment le moment de retourner voir Bihari et la dai, dans la forêt. Il n’y avait guère que le deuxième fils, Prithvi, qui présentât le moindre intérêt dans la famille du chef, mais il partait très tôt le matin, ayant avec sa famille aussi peu de rapports que possible, se tenant à l’écart, tranquille et calme.
Enfin, elle faisait aller. Elle prenait en secret une décoction que la dai lui avait préparée, pour l’empêcher de tomber enceinte. Elle avait quatorze ans, mais elle voulait attendre encore.
Bien vite la situation s’envenima. La dai souffrait de plus en plus de ses articulations enflées, et Bihari dut la remplacer plus tôt que prévu, ce qui fit qu’on la vit de plus en plus à Dharwar. Au même moment, Shastri et Shardul complotaient en secret. Ils allaient trahir leur village par intérêt, augmentant le montant des taxes, tout cela en accord avec l’agent du zamindar, qui y trouverait son compte – Shastri se servant au passage. En gros, ils s’entendaient pour faire passer Dharwar du système de taxes agricoles hindou au système musulman. Le système hindou, qui était d’inspiration religieuse et sacrée, n’autorisait pas à lever des taxes excédant le sixième des récoltes ; alors que le système musulman permettait de tout prendre. La part restant aux agriculteurs était sujette au bon vouloir du zamindar. En pratique, cela ne faisait pas tellement de différence, mais les redevances musulmanes variaient en fonction des récoltes et des circonstances. C’est là que Shastri et Shardul collaboraient avec le zamindar, en calculant le maximum de ce qu’on pouvait prendre sans affamer les villageois. Une nuit, Kokila entendit par une porte entrouverte Shastri et Shardul passer en revue les différentes possibilités.
— Le blé et l’orge, les deux cinquièmes s’ils sont irrigués naturellement, trois dixièmes s’ils sont irrigués artificiellement.
— Ça m’a l’air bien. Pour les dattes, les vignes, les cultures vivrières et les jardins, un tiers.
— Mais les récoltes d’été, un quart.
Finalement, pour leur faciliter la tâche, le zamindar éleva Shardul, qui était déjà un homme horrible, à la fonction de qanungo, c’est-à-dire d’inspecteur des contributions du village. Et il continuait de regarder Bihari. La nuit de la fête des chars, il l’emmena dans la forêt. D’après ce qu’elle en dit ensuite à Kokila, il était clair qu’elle n’en gardait pas un si mauvais souvenir, et qu’elle adorait en raconter les détails :
— J’avais le dos dans la boue, il pleuvait sur mon visage et il léchait les gouttes de pluie avec sa langue en répétant sans cesse « je t’aime, je t’aime, je t’aime ».
— Mais il ne t’épousera jamais, fit remarquer Kokila, inquiète. Et si ses frères l’apprennent, ils n’apprécieront pas.
— Ils ne l’apprendront jamais. Et c’était si romantique, Kokila, tu ne peux pas savoir.
Elle savait que Kokila n’avait pas peur de Gopal.
— Oui, oui. Mais cela risque de t’attirer des ennuis. Est-ce qu’une passion de quelques minutes en vaut la peine ?
— Oh que oui, crois-moi, oh que oui !
Pendant un instant elle fut heureuse, et se mit à chanter de vieilles chansons d’amour, et notamment l’une d’elles, très ancienne, qu’elles avaient l’habitude de chanter autrefois :
J’aime partager ma couche avec des hommes différents,
Souvent.
C’est mieux quand mon mari est dans un pays lointain,
Très lointain.
La nuit, il pleut, et le vent souffle dans les rues.
Mais il n’y a personne.
Malheureusement, Bihari tomba enceinte, malgré les décoctions de la dai. Elle essaya de garder le secret, mais, la dai étant infirme, il fallait bien qu’elle s’occupe des naissances, et donc les gens s’en aperçurent. Ils firent le lien entre ce qu’ils avaient vu ou entendu, et dirent que c’était Shardul qui l’avait engrossée. Et puis la femme de Prithvi donna naissance à un enfant, que Bihari aida à mettre au monde. Mais le bébé, un garçon, mourut quelques minutes seulement après sa naissance et, dès qu’elle sortit de la maison, Shastri frappa Bihari au visage, la traitant de sorcière et de putain.
Kokila entendit tout cela quand elle se rendit en visite à la maison de Prithvi, de la bouche même de sa femme. Elle disait que l’accouchement s’était déroulé beaucoup plus vite qu’il n’aurait dû, et qu’elle avait suspecté Bihari d’avoir fait quelque chose de travers. Kokila se précipita à la hutte de la dai et trouva la vieille femme ratatinée, haletante sous l’effort, entre les jambes de Bihari, s’efforçant d’en faire sortir le bébé.
— Elle fait une fausse couche, dit-elle à Kokila.
Alors Kokila prit le relais et fit ce que la dai lui disait de faire, oubliant sa propre famille jusqu’à ce que la nuit tombe. Puis, se la rappelant, elle s’exclama :
— Je dois y aller !
Bihari lui répondit :
— Va. Tout ira bien.
Kokila courut donc à travers la forêt jusqu’à Dharwar, où sa belle-mère l’attendait à la porte de la maison. Elle la gifla, devançant Gopal, qui lui donna un violent coup de poing au bras et lui interdit de jamais remettre les pieds dans la forêt ou à Sivapur, ce qui était vraiment un ordre ridicule étant donné ce qu’était leur vie. Elle faillit dire : « Comment irai-je te chercher l’eau, maintenant ? »
Mais elle se mordit les lèvres et se massa les bras, les regardant méchamment, jusqu’à ce qu’elle juge qu’ils étaient suffisamment effrayés. Pour éviter de se faire battre, elle abaissa son regard aussi noir que celui de Kali. Puis, elle débarrassa la table après leur dîner improvisé, que son absence avait désorganisé. Ils ne pouvaient même pas manger sans elle. Elle n’oublierait jamais leur colère.
Le lendemain matin, avant l’aube, elle se glissa dehors avec les cruches et courut à travers la forêt grise et humide. Il y avait des branches partout, du sol jusqu’à la cime des arbres. Elle parvint enfin à la hutte de la dai, hors d’haleine et craignant le pire.
Bihari était morte. Le bébé était mort, Bihari était morte, et même la vieille femme gisait étendue sur sa paillasse, haletant péniblement à chaque inspiration, comme si elle allait quitter ce monde d’une minute à l’autre.
— Ils sont partis il y a une heure, dit-elle. Le bébé aurait dû vivre, je ne sais pas ce qui s’est passé. Bihari a perdu trop de sang. J’ai essayé d’arrêter l’hémorragie, mais je n’ai pas pu.
— Apprends-moi un poison.
— Quoi ?
— Apprends-moi à me servir d’un bon poison. Je sais que tu en connais. Apprends-moi le plus terrible de tous, maintenant !
La vieille femme tourna la tête contre le mur, en larmes. Kokila l’obligea à la regarder, et cria :
— Apprends-moi ! Apprends-moi !
La vieille femme regarda longuement les deux corps étendus sous un sari, mais il n’y avait personne pour les entendre. Kokila s’apprêtait à lever la main pour la menacer, mais elle interrompit son geste.
— S’il te plaît, supplia-t-elle. Il faut que je sache.
— C’est trop dangereux.
— Pas aussi dangereux que de poignarder Shastri.
— Non.
— C’est ce que je ferai si tu ne me le dis pas, et ils me brûleront sur un bûcher.
— Ils le feront aussi si tu l’empoisonnes.
— Personne n’en saura rien.
— Ils penseront que c’est moi.
— Tout le monde sait bien que tu ne peux pas bouger.
— Peu importe. Alors ils penseront que c’est toi.
— Je prendrai mes précautions, crois-moi. Je serai chez mes parents.
— Peu importe. De toute façon c’est nous qu’ils accuseront. Et Shardul est aussi mauvais que Shastri, voire pire.
— Apprends-moi.
La vieille femme la regarda dans les yeux pendant un certain temps. Puis elle roula sur elle-même et ouvrit son panier à couture. Elle montra à Kokila une petite plante séchée, ainsi que quelques baies.
— C’est de la ciguë. Et ça ce sont des graines de castor. Si tu piles la ciguë tu obtiendras une pâte, tu n’auras plus qu’à ajouter les graines avant de l’utiliser. C’est amer, mais il n’en faut pas beaucoup. Une pincée dans un plat épicé suffit à tuer sans qu’on en remarque le goût. Mais il est impossible de faire passer cela ensuite pour une maladie, je te préviens. C’est un empoisonnement.
Kokila prépara son plan en douce. Shastri et Shardul continuaient à travailler pour le zamindar, se faisant chaque mois de nouveaux ennemis. On racontait aussi que Shardul avait violé une autre fille dans la forêt, la nuit de Gauri Hunnime, le festival de la femme, où l’on adore des statuettes en boue de Shiva et de Parvati.
Kokila connaissait leur emploi du temps dans les moindres détails. Shardul et Shastri commençaient leur journée par un petit déjeuner prolongé, puis Shastri donnait audience au pavillon situé à mi-chemin du puits et de chez eux, pendant que Shardul tenait les comptes à côté de la maison. À la chaleur de midi, ils faisaient une sieste et recevaient des visiteurs dans la véranda qui donnait au nord, sur la forêt. Presque tous les après-midi, ils prenaient une collation allongés sur des divans, comme de petits zamindars, puis se rendaient avec Gopal, voire un ou deux associés, au marché, où ils faisaient « des affaires » jusqu’au coucher du soleil. Ils rentraient alors au village, déjà soûls ou buvant encore, titubant joyeusement dans le crépuscule pour rentrer dîner chez eux. Cette routine se répétait inlassablement, aussi immuable que dans n’importe quel village.
Kokila échafauda un plan tout en allant chercher du bois. Elle en profita pour ramasser de la ciguë et des graines de castor, qui poussaient dans les parties les plus humides de la forêt, là où l’ombre se mêlait aux marécages et cachait toutes sortes de créatures dangereuses, des moustiques jusqu’aux tigres. Mais, au point du jour, la plupart de ces vermines dormaient ; en fait, durant les chauds mois d’été, la plupart des créatures vivantes dormaient à cette heure, même les plantes sensitives. Les insectes bourdonnaient mollement dans un silence cotonneux. Les deux plantes empoisonnées brillaient dans la faible lumière, telles deux petites lanternes vertes. Une prière pour Kali, et elle les cueillit, alors qu’elle saignait. Elle mit de côté quelques graines de castor, qu’elle dissimula dans les plis de son sari, avant de les cacher pour la durée de la nuit dans la forêt non loin des feuillées, la veille de Durga Puja. Cette nuit-là, elle ne dormit pour ainsi dire pas, mais fit quand même quelques rêves, très courts, où Bihari venait la voir et lui disait de ne pas être triste.
— De mauvaises choses arrivent dans chaque vie, disait Bihari. Il ne faut pas être fâchée.
Elle lui dit beaucoup plus de choses, mais, au réveil, tout s’était effacé. Kokila se rendit donc à la cachette et prit les plantes, broya rageusement les feuilles de ciguë dans une calebasse avec une pierre, puis jeta la calebasse et la pierre au loin dans un lit de fougères. Tenant la pâte au bout d’une branche, elle se rendit à la maison de Shastri, et attendit l’heure de la sieste. Ce fut un jour qui sembla durer toujours. Alors, elle ajouta les petites graines à la pâte et en mit une pincée sur les beignets préparés pour la collation de l’après-midi de Shastri et Shardul. Puis elle s’enfuit de la maison et partit dans la forêt, le cœur battant à tout rompre dans sa poitrine et semblant la devancer comme une biche effrayée – tout à fait comme une biche en fait, parce qu’elle courait de façon erratique, hantée par la peur de ce qu’elle avait fait, et qu’elle tomba. Elle tomba dans un piège à biche qu’elle n’avait pas vu, un piège tendu par un homme de Bhadrapur. Quand il la trouva, sonnée et commençant à peine à se dépêtrer des cordes qui la retenaient prisonnière, Shastri et Shardul étaient morts, Prithvi venait d’être nommé nouveau chef du village et avait déclaré que Kokila était une sorcière et une empoisonneuse. Il la fit tuer sur-le-champ.
2. Retour dans le bardo
De retour dans le bardo, Kokila et Bihari s’assirent l’une à côté de l’autre sur le fond noir de l’univers et attendirent leur tour d’être jugées.
— Tu ne piges pas, dit Bihari.
Et en même temps qu’elle, Bold, Bel, Borondi, et beaucoup, beaucoup d’autres incarnations précédentes, qui remontaient jusqu’à sa naissance, à l’aube de ce Kali-yuga, cet Âge de la destruction, le quatrième des quatre âges. Celui où, nouvelle âme, elle avait jailli du vide, éruption d’Être hors du Non-être, miracle inexplicable par les lois naturelles et qui révélait l’existence d’un royaume supérieur, un royaume au-dessus même de celui des devas qui les regardaient d’en haut, en ce moment présent, assis sur l’estrade. Le royaume vers lequel ils cherchaient tous instinctivement à retourner.
Bihari continua :
— Le dharma est une chose qui ne peut être changée à court terme. Il faut y aller pas à pas, en faisant de son mieux à chaque situation donnée. On ne peut, d’un bond, sauter jusqu’au ciel.
— Je chie sur tout ça, dit Kokila avec un geste obscène en direction des dieux.
Elle en aurait craché, tellement elle était enragée. Et encore terrifiée, aussi. Elle pleurait et s’essuyait le nez avec le dos de la main.
— Je veux bien être damnée si je coopère à une chose aussi horrible.
— Oui ! Tu n’as qu’à faire ça ! C’est pour ça que nous manquons sans arrêt de te perdre. C’est pour ça que tu ne reconnais jamais ta jati quand tu es dans le monde, et que tu n’arrêtes pas de faire du mal à ta famille. Nous montons et nous redescendons ensemble.
— Je ne vois pas ce que tu veux dire.
C’était au tour de Shastri d’être jugé, agenouillé, les mains jointes dans une attitude suppliante.
— Qu’on l’envoie en enfer ! hurla Kokila au dieu noir. Le niveau inférieur, le pire de l’enfer !
Bihari secoua la tête.
— Pas à pas, comme je le disais. De petits pas vers le haut et vers le bas. Et c’est toi qu’ils vont juger vers le bas, après ce que tu as fait.
— Ce n’était que justice ! s’exclama Kokila avec une véhémence teintée d’amertume. J’ai fait justice de mes propres mains parce que personne d’autre ne voulait le faire ! Et je le referais, d’ailleurs ! Justice ! hurla-t-elle en regardant le dieu noir. Justice, et merde !
— Chut ! fit Bihari d’un ton pressant. Tu auras ton tour. Tu ne veux pas être renvoyée sous la forme d’un animal.
Kokila la foudroya du regard.
— Nous sommes déjà des animaux, tu aurais tort de l’oublier.
Elle flanqua une tape sur le bras de Bihari et sa main passa au travers de son corps, ce qui nuisit quelque peu à son argumentation. Elles étaient dans le royaume des âmes, inutile d’essayer de le nier.
— Oublie ces dieux, dit-elle en montrant les dents. C’est de justice que nous avons besoin ! J’apporterai la révolte au cœur même du bardo s’il le faut !
— Chaque chose en son temps, répondit Bihari. Un pas après l’autre. Essaye seulement de reconnaître ta jati et prends soin d’elle, pour commencer. Ensuite, on verra.
3. La clémence du tigre
Kya, la tigresse, avançait dans les hautes touffes d’herbes, l’estomac plein et la fourrure chauffée par le soleil. L’herbe formait un mur de verdure autour d’elle, et lui frottait les flancs au passage. Au-dessus d’elle, la cime des herbes se balançait au vent, fouettant de vert le bleu du ciel. L’herbe poussait par gros bouquets évasés se recourbant vers le sol ; comme les touffes étaient très rapprochées, elle devait s’y frayer un chemin, écartant devant elle les tiges brisées. Elle arriva enfin à la limite de la prairie, qui bordait un maidan, une sorte de parc que les humains brûlaient chaque année pour que rien n’y pousse. C’est là que venaient paître en grand nombre les chitals et autres cerfs, cochons sauvages, antilopes, et surtout le nilgaut.
Ce matin-là, c’était une biche qui s’y trouvait, en train de mâchouiller de l’herbe. Kya pouvait imiter le bruit du cerf, et quand elle était en chaleur elle le faisait rien que pour le plaisir ; pour le moment, elle se contenterait d’attendre. La biche sentit quelque chose et s’éloigna un peu en bondissant. Mais un jeune gaur se trouvait dans les parages, de couleur marron foncé, avec le bout des pattes blanches. En le voyant approcher, Kya leva la patte avant gauche et tendit son corps vers l’avant, la queue fouettant l’air derrière elle avec vigueur, afin de se donner un nouvel équilibre. Puis elle releva la queue et s’élança en rugissant, traversant le parc en une série de bonds de six mètres. Elle lui flanqua un coup de griffe et l’assomma, puis lui mordit le cou jusqu’à ce qu’il meure.
Elle mangea.
Grroua-ouah !
Son kol-bahl, un chacal que son clan avait chassé et qui maintenant la suivait partout, montra sa face hideuse de l’autre côté du maidan, et aboya de nouveau. Elle lui grogna de s’en aller, et il regagna, la queue basse, le couvert des hautes herbes.
Une fois rassasiée, elle se releva et descendit lentement au bas de la colline. Le kol-bahl et les corbeaux finiraient le gaur.
Elle parvint au fleuve qui serpentait à travers cette partie du pays. Les endroits les moins profonds était semés d’îles, chacune étant une petite jungle avec ses grands saals et ses shishams. Beaucoup de ses congénères s’abritaient sous ces arbres, dans les sombres sous-bois encombrés de fourrés et de lianes ; ou bien à l’ombre des tamaris dont les branches surplombaient le sable chaud des berges du fleuve. La tigresse marcha précautionneusement sur les cailloux au bord de l’eau, assoiffée. Elle s’avança dans le courant et s’arrêta, sentant l’eau caresser la fourrure de ses flancs. L’eau était claire, chauffée par le soleil. Dans le sable au bord du courant se lisaient les empreintes de nombreux animaux, dont l’herbe gardait les odeurs ; des wapitis, des chevrotains, des chacals, des hyènes, des rhinocéros et des gaurs, des cochons, des pangolins ; tout le village en quelque sorte, mais personne en vue. Elle s’avança dans l’eau pour gagner l’une des îles, et s’étendit dans le tapis d’herbe de son lit, à l’ombre. Une sieste. Pas de petits cette année, pas besoin de chasser un jour ou deux de plus. Kya bâilla à se décrocher la mâchoire et posa la tête sur ses pattes de devant. Elle dormit dans le silence que font naître les tigres dans la jungle.
Elle rêva qu’elle était une petite fille à la peau brune, dans un village. Sa queue se tortilla quand elle sentit à nouveau la chaleur du feu dans la cuisine, le poids de l’homme sur son ventre, l’impact des pierres jetées sur la sorcière. Elle grogna dans son sommeil, ses babines découvrant ses crocs puissants. La peur qu’elle venait de ressentir la réveilla, et elle remua, cherchant à retomber dans un autre rêve.
Des bruits la rappelèrent au monde. Des oiseaux et des singes parlaient de l’arrivée de gens, venant de l’ouest, et qui avaient emprunté le gué en aval du fleuve. Kya s’élança d’un bond et quitta l’île pour se faufiler dans l’épaisseur des touffes d’herbe au bord de l’eau. Les gens pouvaient être dangereux, surtout quand ils étaient plusieurs. Seuls, ils étaient sans défense, il suffisait de choisir le bon moment et d’attaquer par-derrière. Mais quand ils étaient plusieurs ils pouvaient attirer les animaux dans des pièges ou dans des embuscades, qui avaient marqué la fin de tant de tigres, auxquels on avait pris la tête et la peau. Un jour elle avait vu un tigre appâté par de la viande accrochée à un piquet tomber dans une fosse invisible et s’empaler sur des pieux, au fond. Les gens faisaient ce genre de chose.
Mais il n’y avait aujourd’hui ni cris, ni cloches, ni tambours. À cette heure-là, les humains ne chassaient plus. Il devait plutôt s’agir de voyageurs. Kya se glissa en silence dans les hautes touffes d’herbe, humant l’air, l’œil aux aguets et attentive au moindre bruit, se dirigeant vers une grande clairière d’où elle pourrait dominer la courbe du fleuve en aval, et notamment le gué qu’ils avaient traversé.
Elle s’installa dans une touffe d’herbe écrasée pour les regarder passer. Elle se tenait là, les yeux mi-clos.
Il y avait d’autres humains là-bas ; elle les vit, se cachant comme elle, disséminés dans la forêt de saals, prêts à bondir sur les humains qui venaient de traverser le gué.
Au même moment, une colonne de gens atteignit le gué, et ceux qui s’étaient dissimulés jaillirent de leurs cachettes et se mirent à crier tout en tirant des flèches sur les autres. Une grande chasse, apparemment. Kya se tapit dans les herbes et regarda plus attentivement, les oreilles couchées. Elle avait déjà assisté à une scène similaire autrefois, et le nombre d’humains tués avait été surprenant. C’était à cette occasion qu’elle avait pour la première fois goûté à leur chair, parce qu’elle avait des jumeaux à nourrir cet été-là. C’étaient sûrement les bêtes les plus dangereuses de la jungle, les éléphants mis à part. Ils tuaient pour le plaisir, comme le faisait quelquefois son kol-bahl. Il y aurait sous peu de la viande là-bas, quoi qu’il arrive. Kya s’accroupit et écouta plus qu’elle ne regarda. Des cris, des hurlements, des rugissements, des appels, des vociférations, des sonneries de trompettes, un fracas macabre. C’était un peu comme la fin d’une de ses chasses, mais multipliée plusieurs fois.
Pour finir, tout se calma. Les chasseurs quittèrent les lieux. Longtemps après qu’ils furent partis, et quand la jungle retrouva son calme habituel, Kya se releva et regarda autour d’elle. L’air sentait le sang, et elle se mit à saliver. Des corps morts gisaient sur les deux côtés du fleuve, et avaient été arrêtés par les souches qui se trouvaient au bord de l’eau, ou bien le courant les avait entraînés dans les hauts-fonds. La tigresse s’avança parmi eux avec mille précautions, en tira un dans l’ombre et l’entama. Mais elle n’avait pas très faim. Un craquement la mit en fuite, et elle gagna rapidement le couvert des sous-bois, le poil hérissé, à la recherche de ce qui l’avait causé : une branche cassée. Lorsqu’un bruit de pas s’ajouta à ce dernier. Ha. Un humain, encore debout. Un survivant.
Kya retrouva son calme. Rassasiée, elle s’approcha de l’homme, sans autre motif que la curiosité. Il la vit et fit un bond en arrière. Elle fut surprise. Il avait sursauté sans même y penser. Il se tenait là, l’observant avec ce même regard qu’avaient parfois les animaux blessés, résignés, même si chez celui-ci il y avait aussi quelques mouvements des yeux, comme pour dire : Qu’est-ce qu’il va encore m’arriver ?, ou bien : Non, pas ça ! Cela ressemblait aux gestes de ces filles qui allaient chercher du bois dans la forêt, et qu’elle observait quand elle n’avait pas faim. Les chasseurs qui s’en étaient pris au groupe de cet homme se trouvaient toujours un peu plus loin sous les arbres. Sous peu, il serait pris et tué.
Il s’attendait à ce que ce soit elle qui le fasse. Les humains étaient tellement sûrs d’eux, tellement sûrs de comprendre le monde, et de le maîtriser. Et comme ils étaient aussi nombreux que des singes, et qu’ils avaient des flèches, ils avaient souvent raison. C’est pourquoi elle s’appliquait à les tuer chaque fois qu’elle pouvait. À vrai dire, ils ne représentaient guère plus qu’un maigre repas, ce qui n’était pas forcément un problème, bien sûr – bon nombre de tigres étaient morts parce qu’ils avaient voulu manger du porc-épic –, mais les humains avaient un drôle de goût. Avec ce qu’ils mangeaient, cela n’avait rien d’étonnant.
La chose la plus étonnante à faire aurait été de l’aider ; aussi s’approcha-t-elle de lui. Il se mit à trembler, et ses dents claquèrent à l’unisson de son corps. Il n’était plus du tout abasourdi, mais ne bougeait pas par principe. Elle approcha sa tête d’une de ses mains, et la releva, accueillant sa paume entre ses oreilles. Elle resta ainsi, sans bouger, jusqu’à ce qu’il lui caresse la tête. Alors, elle avança légèrement, de façon à lui permettre de la caresser entre les épaules, puis elle se trouva juste à côté de lui, regardant dans la même direction. Enfin, très doucement, elle commença à marcher, l’incitant par son allure à la suivre. Ce qu’il fit, sans jamais cesser de la caresser à chacun de leurs pas.
Elle le conduisit à travers la forêt de saals. Le soleil se voyait par intermittences entre les frondaisons. Il y eut un bruit et un fracas soudains, puis des voix vinrent de la piste entre les arbres. L’homme agrippa sa fourrure. Elle s’arrêta pour écouter. C’était la voix des chasseurs de gens. Elle grogna, gronda sourdement, puis émit un bref rugissement.
Un silence de mort se fit devant eux. À moins d’organiser une battue, aucun humain ne pourrait jamais la trouver. Le vent lui apporta les échos de leur débandade.
La voie était libre. La main de l’homme ne voulait pas lâcher sa fourrure, entre ses épaules. Elle tourna la tête et le poussa avec son museau. Il la lâcha. Il avait encore plus peur des autres hommes que d’elle. Ce qui se comprenait. On aurait dit un bébé sans défense, mais il était rapide. Sa mère autrefois l’avait tenue dans sa gueule en la prenant par ce même endroit, entre les épaules, par lequel l’homme l’avait tenue, y exerçant la même pression que celle jadis exercée par sa mère – comme s’il avait été autrefois une maman tigre, l’avait oublié, et appelait sa fille à l’aide.
Elle accompagna lentement l’homme au gué suivant, le traversa avec lui et l’emmena à la piste des biches. Les wapitis étaient plus grands que les hommes, et la piste n’était pas difficile à suivre. Elle le guida vers le grand nullah de la région, une gorge étroite, si abrupte et escarpée qu’on ne pouvait l’atteindre que par certains endroits précis. Mais elle y avait ses entrées. Elle conduisit l’homme jusqu’au bas de la gorge, puis longea le fleuve jusqu’à un village où les gens avaient la même odeur que son humain. L’homme devait se dépêcher pour la suivre, mais elle ne ralentit pas. Il n’y avait plus que quelques flaques d’eau au fond de la gorge tant il avait fait chaud ces derniers temps. Des sources perlaient sur les parois rocailleuses couvertes de fougères. Comme ils cheminaient, cahin-caha, le long du ravin, elle réfléchit et crut se rappeler une hutte, non loin du village vers lequel elle se dirigeait, et qui sentait exactement comme lui. Elle le guida dans la palmeraie qui poussait au fond du nullah, puis à travers une épaisse forêt de bambous. Des bouquets de pommiers-roses verdissaient les parois du ravin, mêlés à des touffes de jujubiers, piquetées de petits fruits orange acides.
Une trouée dans ces fourrés odorants montait hors du nullah. Elle flaira l’air autour d’elle. Un tigre avait récemment arrosé la sortie du nullah, marquant son territoire. Elle gronda, et l’homme agrippa de nouveau la fourrure entre ses omoplates pour s’aider à grimper tandis qu’elle escaladait la dernière pente.
Lorsqu’ils eurent regagné les collines boisées qui bordaient le nullah, elle dut, pour gravir la pente jusqu’au sommet, le pousser de l’épaule – parce qu’il voulait contourner la pente, ou bien descendre tout droit vers le village, au lieu de monter et d’en faire le tour. Après quelques coups de tête, il renonça à son idée et la suivit sans résister. Maintenant, il avait aussi un tigre à éviter, même s’il n’en savait rien.
Elle le conduisit à travers les ruines d’un ancien fort bâti au sommet de la colline, envahi par les bambous. C’était un endroit que les humains évitaient à présent, et dont elle avait fait sa tanière plusieurs hivers durant. Elle y avait donné naissance à ses petits, non loin du village des hommes et au milieu des ruines des hommes, afin qu’ils y soient à l’abri des tigres. L’homme reconnut l’endroit et se calma. Ils continuèrent vers l’arrière du village.
Pour lui, c’était un long chemin. Son corps paraissait désarticulé, et elle vit à quel point cela devait être dur de marcher sur deux pattes. Jamais un instant de repos, toujours en déséquilibre, tombant vers l’avant puis se rattrapant, comme s’il marchait perpétuellement sur quelque tronc d’arbre jeté en travers d’un ruisseau. Aussi tremblant sur ses jambes, aveugle et mouillé qu’un nouveau-né.
Ils arrivèrent tant bien que mal à la bordure du village, où un champ d’orge ondulait dans la lumière de cette fin d’après-midi, et s’arrêtèrent à la lisière des dernières touffes d’herbe sous les saals. Entre les rangées d’orge couraient des sillons de terre où les gens mettaient de l’eau, singes habiles qu’ils étaient, traversant la vie sur la pointe des pieds, dans leur perpétuel mouvement de balancier.
À la vue du champ, le bipède épuisé leva les yeux et regarda autour de lui. C’est lui qui menait à présent la tigresse autour du champ. Kya le suivit vers le village. Elle ne se serait jamais aventurée aussi près en d’autres circonstances, même si cette fin d’après-midi pleine d’ombres et de lumières lui offrait un excellent camouflage, la rendant presque invisible. Elle n’aurait été qu’une onde mentale dans le paysage, si elle s’était déplacée rapidement. Seulement, elle devait respecter l’allure chancelante du bipède. Ça exigeait un peu de courage, mais il y avait des tigres courageux et des tigres peureux, et elle faisait partie des courageux.
Enfin, elle s’arrêta. Une hutte se dressait juste devant eux, sous un arbre pipai. L’homme la lui montra du doigt. Elle flaira les odeurs alentour. Pas de doute, c’était chez lui. Il murmura quelque chose dans sa langue, pressa tendrement, une ultime fois, la peau entre ses deux épaules et se dirigea de son pas titubant, à travers les champs d’orge, vers sa maison. Il était à bout de forces. Quand il ouvrit la porte, des cris jaillirent de l’intérieur, une femme et deux enfants surgirent et se collèrent contre lui. C’est alors qu’à la surprise de la tigresse un homme plus vieux sortit à grands pas et se mit à lui flanquer de grands coups dans le dos.
La tigresse, immobile, regardait.
Le vieil homme ne voulait pas laisser entrer son protégé dans la hutte. La femme et les enfants durent donc lui apporter à manger dehors. Finalement, il s’allongea par terre, se roula en boule et s’endormit.
Les jours suivants, le vieil homme s’obstina à lui refuser l’entrée de la cabane. Il acceptait néanmoins qu’on lui donne à manger et qu’il travaille aux champs alentour. Kya continua de l’observer et vit à quoi ressemblait sa vie, aussi étrange qu’elle fut. Il paraissait en outre l’avoir oubliée, à moins qu’il n’eût peur de s’aventurer dans la jungle, à sa recherche. Ou bien, peut-être n’imaginait-il pas qu’elle pût encore se trouver là.
C’est pourquoi elle fut surprise quand un soir, au crépuscule, il apparut, tenant à deux mains devant lui la carcasse d’un oiseau, cuit, déplumé – et même, sembla-t-il, désossé ! Il marcha droit vers elle, et la salua avec beaucoup de calme et de respect, lui présentant son offrande. Il était timide, effrayé ; il ne savait pas que lorsque ses moustaches tombaient c’était parce qu’elle était détendue. L’amuse-gueule qu’il lui offrait avait cuit dans son propre jus, mais il y avait ajouté d’autres choses encore – de la lavande, des noix de muscade. Elle le mâcha tout en ronronnant, et l’avala. Il lui fit ses adieux et s’éloigna, retournant à la hutte.
Après cela, elle revint le voir de temps à autre dans la lumière horizontale du soleil levant, quand il partait au travail. Le temps passant, il s’avéra qu’il avait souvent un cadeau pour elle, des épluchures ou des restes, rien qui ressemblât à l’oiseau, mais bien meilleur, de simples morceaux de viande fraîche ; d’une certaine façon, il avait deviné. Il continuait à dormir à l’extérieur de la hutte, et une nuit, comme il faisait froid, elle s’approcha furtivement et s’enroula autour de lui pour le réchauffer, jusqu’à l’apparition du gris de l’aube. Les singes dans les arbres en étaient scandalisés.
Puis le vieil homme le battit encore, si brutalement qu’il le fit saigner d’une oreille. Kya s’en retourna alors à son fort, grondant et raclant le sol avec ses griffes. L’immense mahua de la colline perdait son volumineux manteau de fleurs, et elle mangea quelques-uns de leurs pétales charnus, empoisonnés. Elle s’en revint dans les parages du village et huma l’air à la recherche de l’odeur du vieil homme. Il était là, cheminant sur la route que beaucoup empruntaient pour se rendre au village voisin, situé plus à l’ouest. Il venait d’y retrouver plusieurs autres hommes, avec lesquels il s’était longuement entretenu, buvant des boissons fermentées et s’enivrant. Il riait comme son kol-bahl.
Alors qu’il s’en revenait chez lui, elle l’attaqua par-derrière et le tua en lui plantant ses crocs dans le cou. Elle mangea un bout de ses entrailles, sentant à nouveau tout ces goûts bizarres ; ils mangeaient des choses si curieuses qu’ils finissaient eux-mêmes par sentir drôle, riche et varié. Un peu comme la première offrande que lui avait apportée son jeune homme. Un goût acquis, et peut-être l’avait-elle acquis maintenant, elle aussi.
Des gens se ruaient à présent vers eux, alors elle disparut dans la forêt, entendant leurs cris derrière elle, d’abord choqués, puis consternés, avec ce je ne sais quoi dans leurs plaintes qu’elle entendait parfois dans les cris des singes en train de se raconter leurs malheurs, cette note de triomphe ou de joie qui disait que, quoi que ce fût, ce n’était pas à eux que c’était arrivé.
Personne ne se souciait de ce vieil homme, il quittait la vie aussi seul qu’un tigre, sans que même ceux de sa hutte le pleurent. Ce n’était pas sa mort qui émouvait les gens, mais la présence d’un tigre mangeur d’hommes si près de chez eux. Les tigres qui se mettaient à manger de la chair humaine étaient dangereux. Le plus souvent, il s’agissait d’une mère en quête de nourriture pour ses petits, ou d’un vieux mâle édenté. Ce qui voulait dire que cela pouvait recommencer. Ils ne tarderaient pas à organiser une battue pour l’éliminer. Mais elle ne regretta pas de l’avoir tué. Au contraire, elle bondit entre les ombres des arbres de la forêt comme une jeune tigresse enfin adulte, se pourléchant les babines et grondant. Kya, la Reine de la Jungle !
Lorsqu’elle rendit visite au jeune homme, la fois suivante, celui-ci lui apporta un morceau de chèvre et lui tapota gentiment le museau, en lui parlant très sérieusement. Il l’avertissait de quelque chose, et s’inquiétait de ce que les détails de son avertissement lui échappaient, ce qui était le cas. La fois d’après, il lui cria de s’éloigner, allant même jusqu’à lui jeter des pierres, mais il était trop tard ; elle heurta un filin tendu en travers de son chemin, celui-ci déclencha le tir de plusieurs arcs dont les flèches avaient été trempées dans du poison, qui la transpercèrent et la tuèrent.
4. Akbar
Quatre hommes s’échinèrent à transporter le corps de la tigresse au village, soufflant et transpirant sous son poids. Elle se balançait, attachée par les pattes à un solide bambou qui rebondissait sur leurs épaules. Bistami comprit que Dieu était en toute chose. Et que Dieu – puissent ses quatre-vingt-dix-neuf noms prospérer et tomber dans nos âmes – ne voulait pas de meurtres. Par la porte de la hutte de son frère aîné, Bistami hurla à travers ses larmes :
— Elle était ma sœur, elle était ma tante, elle m’a sauvé des rebelles hindous, vous n’auriez pas dû la tuer, elle nous protégeait tous !
Évidemment, personne ne l’écoutait. Personne ne nous comprend jamais.
Et c’était peut-être aussi bien, compte tenu du fait que cette tigresse avait tué son frère ; ce qui était indéniable. Mais il aurait donné dix fois la vie de son frère pour cette tigresse.
Il suivit la procession à contrecœur jusqu’au centre du village. Tout le monde buvait du rakshi, et les musiciens sortaient en courant de chez eux en tapant joyeusement sur leurs tambours.
— Kya Kya Kya Kya, laisse-nous seuls pour toujours et à jamais !
Il y aurait une célébration du tigre, et le reste de la journée et, peut-être, la journée du lendemain seraient consacrés à festoyer. Ils brûleraient ses moustaches pour être sûrs que son âme ne passerait pas chez un tueur, dans un autre monde. Ses moustaches étaient empoisonnées : il suffisait d’une moustache réduite en poudre et mélangée à de la viande de tigre pour tuer un homme ; et une moustache entière placée dans une tendre pousse de bambou donnerait à celui qui la mangerait des kystes, qui le mèneraient à une mort plus lente. C’était du moins ce qu’on disait. Ces Chinois hypocondriaques croyaient que presque tout avait des vertus médicinales, létales ou aphrodisiaques, y compris chaque partie du tigre, apparemment. Cette Kya serait débitée en morceaux, qui seraient conservés et emportés vers le nord par des marchands, il n’y avait aucun doute. La peau serait donnée au zamindar.
Bistami était assis tout seul, misérablement, dans la poussière, au centre du village. Il n’avait personne auprès de qui s’expliquer. Il avait fait tout ce qu’il pouvait pour prévenir la tigresse de s’éloigner, mais ça n’avait servi à rien. Il ne l’avait pas appelée Kya, mais Madame, ou Madame Trente : c’était le nom que les villageois donnaient aux tigres quand ils étaient dans la jungle, pour ne pas les offenser. Il lui avait apporté des offrandes et il avait vérifié que les marques sur son front ne formaient pas la lettre « s », ce qui aurait été le signe que la bête était un tigre-garou, et se changerait en être humain pour de bon à sa mort. Ce n’était pas arrivé, et en vérité, il n’y avait pas non plus de « s » sur son front. La marque ressemblait plutôt à un oiseau aux ailes déployées. Il n’avait pas baissé les yeux, comme on est censé le faire quand on tombe par hasard sur un tigre. Il était resté calme, et elle l’avait sauvé de la mort. En fait, toutes les histoires qu’il avait entendues à propos de tigres qui aidaient les hommes – celui qui avait ramené deux enfants perdus au village, celui qui avait embrassé sur la joue un chasseur endormi –, toutes ces histoires faisaient pâle figure à côté de la sienne. Mais elles l’avaient préparé à ce qui était arrivé. Elle avait été sa sœur, et maintenant, il était miné par le chagrin.
Les villageois commencèrent à la dépecer. Bistami quitta le village. Il ne pouvait pas voir ça. Sa brute de frère aîné était morte, et pas plus que lui les autres membres de sa famille n’appréciaient qu’il s’intéresse au soufisme. « Les grands airs sont pour les grands, ce qui leur permet de se voir entre eux de très loin. » Mais il n’y avait pas de sage à proximité, et il ne voyait rien du tout. Il se rappela ce que son maître soufi, Tustari, lui avait dit quand il avait quitté Allahabad : « Garde le haj dans ton cœur, et prends la route de La Mecque ainsi que le veut Allah. Vite ou lentement, mais toujours sur ta tariqat, la voie spirituelle. »
Il réunit ses quelques possessions en ce bas monde dans un balluchon. La mort de la tigresse commençait à s’apparenter à une destinée ; un message lui disant d’accepter le don de Dieu, de le mettre en application dans ses actions, et de ne rien regretter. Le moment était donc venu de dire « Merci mon Dieu, merci Kya, ma sœur », et de quitter pour toujours son village natal.
Bistami se rendit à pied à Agra, et y dépensa le reste de son argent pour acheter une robe de pèlerin soufi. Il demanda asile dans le logis soufi, un vieux bâtiment oblong, au sud de la vieille capitale, et il se baigna dans leur bassin, se purifiant l’intérieur comme l’extérieur.
Puis il quitta la ville et alla à pied à Fatehpur Sikri, la nouvelle capitale de l’empire d’Akbar. Il vit que la cité encore inachevée était la réplique en pierre des vastes campements de tentes des armées mongoles, jusqu’aux colonnes de marbre qui se dressaient à l’écart des murs, comme des piquets de tente. La ville était poussiéreuse, ou boueuse, et la pierre blanche dont elle était faite était déjà sale. Dans les jardins nouvellement plantés, les arbres étaient tout petits. Le long mur d’enceinte du palais impérial donnait sur la grande avenue qui séparait le nord et le sud de la cité, menant à une grande mosquée de marbre et au dargah dont Bistami avait entendu parler à Agra, la tombe du saint soufi Cheikh Salim Chishti. Vers la fin de sa longue vie, Chishti avait été le professeur du jeune Akbar, et on disait maintenant que son souvenir était le lien le plus fort d’Akbar avec l’islam. Le même Chishti était allé en Iran, dans sa jeunesse, et avait suivi l’enseignement de Shah Esmail, tout comme Tustari, le maître de Bistami.
Bistami s’approcha donc à reculons de la grande tombe blanche de Chishti, en récitant des sourates du Coran. « Au nom de Dieu le Miséricordieux, le très Miséricordieux. Sois endurant avec ceux qui prient leur Seigneur matin et soir, ils désirent Sa face. Ne regarde pas ailleurs par désir des charmes de cette vie. N’écoute pas celui dont nous distrayons le cœur de penser à nous, il suit ses passions et fait l’insolent[1]. »
À l’entrée, il se prosterna vers La Mecque et dit la prière de l’aube, puis il entra dans la cour murée qui entourait la tombe, et rendit hommage à Chishti. Les autres faisaient de même, évidemment, et quand il eut fini ses dévotions, il parla à certains d’entre eux, leur racontant son voyage en remontant jusqu’à l’époque où il était en Iran, éludant ses arrêts en cours de route. Pour finir, il répéta son histoire à l’un des oulémas de la propre cour d’Akbar, et insista sur la « relation maître à élève » qui unissait son maître à Chishti, et il reprit ses prières ; il revint à la tombe jour après jour, établissant un rituel de prières, de purifications, de réponses aux questions des pèlerins qui ne parlaient que persan, se liant avec tous ceux qui visitaient le tombeau. Ce qui amena finalement le petit-fils de Chishti à venir le trouver. Cet homme dit ensuite du bien de lui à Akbar, à ce qu’il crut comprendre. Il prenait son repas quotidien au logis des soufis, et persévéra, affamé, mais plein d’espoir.
Un matin, aux premières lueurs de l’aube, alors qu’il était déjà en train de prier dans la cour intérieure du tombeau, l’empereur Akbar vint en personne au mausolée, prit un simple balai et commença à balayer la cour. La fraîcheur de la nuit flottait encore dans l’air, et pourtant Bistami était en sueur lorsque Akbar finit ses dévotions. Puis le petit-fils de Chishti arriva et demanda à Bistami de venir, quand il aurait fini ses prières, pour le présenter à l’empereur.
— C’est un grand honneur, répondit Bistami.
Il se remit à prier, ânonnant machinalement, alors que dans sa tête tournaient à toute allure les choses qu’il allait pouvoir dire. Il se demandait combien de temps il devait attendre avant d’approcher l’empereur, pour bien montrer que la prière passait avant tout. La tombe était encore relativement fraîche et vide ; le soleil venait de se lever. Lorsqu’il fut complètement au-dessus des arbres, Bistami se redressa, s’approcha de l’empereur et du petit-fils de Chishti et s’inclina profondément. Salut, soumission, et puis il obéit à la requête polie de raconter son histoire à ce jeune homme attentif, vêtu de la belle robe impériale, dont le regard fixe ne quittait jamais son visage, ni même ses yeux, en vérité. Études en Iran avec Tustari, pèlerinage à Qom, retour à la maison, année passée à enseigner le Coran à Gujarat, voyage dans sa famille, embuscade des rebelles hindous, tigresse à la rescousse. Quand il eut terminé, Bistami vit que son histoire avait été appréciée par l’empereur.
— Sois le bienvenu, dit Akbar.
Toute la ville de Fatehpur Sikri était la preuve de sa dévotion, aussi bien que de sa faculté à susciter cette dévotion chez autrui. Aujourd’hui, il avait apprécié la dévotion de Bistami, illustrée sous toutes les formes de piété ; et alors qu’ils continuaient leur conversation, et que la tombe commençait à se remplir de visiteurs, Bistami réussit à amener la discussion sur un hadith, qu’il connaissait, et que Chishti avait amené en Iran, de sorte que son isnad, la chaîne de ceux qui l’avaient rapporté, le reliait à l’empereur.
— Je tiens de Tustari, qui le tenait de Shah Esmail, professeur de Cheikh Chishti, qui le tenait de Bahr ibn Kaniz al-Saqqa, qui le tenait d’Uthman ibn Saj, que Said ibn Jubair, la miséricorde de Dieu soit sur lui, a dit : « Salut à tous les musulmans, y compris les jeunes garçons et les adolescents. Quand Il arrivait en classe, Il empêchait ceux qui étaient assis de se lever pour Lui, puisque c’était l’un des fléaux de l’âme. »
Akbar fronça les sourcils, essayant de le suivre. Il passa par l’esprit de Bistami que ça pouvait être interprété comme s’il avait voulu laisser entendre que Lui, au moins, s’était abstenu de demander obéissance aux autres. Bistami se mit à transpirer dans la fraîcheur du matin.
Akbar se tourna vers l’un de ses suivants, qui attendait discrètement devant le mur de marbre de la tombe.
— Amène cet homme avec nous lorsque nous rentrerons au palais.
Au bout d’une autre heure de prière pour Bistami, et de consultations pour Akbar, qui était détendu, mais de plus en plus laconique au fur et à mesure que la matinée avançait et que la rangée de suppliants ne cessait de s’allonger, l’empereur ordonna qu’ils se dispersent et qu’ils reviennent plus tard. Après quoi il conduisit Bistami et sa suite à travers la cité en travaux, jusqu’à son palais.
La cité était construite autour d’une grande place, comme tous les campements militaires moghols – ce qui était en vérité la forme de l’empire lui-même, lui dit le garde de Bistami. Une sorte de quadrilatère protégé par les quatre villes de Lahore, Agra, Allahabad et Ajmer – de très grandes villes par rapport à la nouvelle capitale. Le garde de Bistami aimait particulièrement Agra, où il avait travaillé à la construction du grand fort de l’empereur, maintenant achevé.
— On y trouve plus de cinq cents bâtiments, dit-il, comme il devait le répéter chaque fois qu’il en parlait.
D’après lui, Akbar avait fondé Fatehpur Sikri parce que le fort d’Agra était presque achevé, et que l’empereur aimait lancer de grands projets.
— C’est un bâtisseur, celui-là. Il va refaire le monde avant d’en avoir fini, je vous l’assure. L’islam n’a jamais eu un serviteur comme lui.
— Ça doit être vrai, acquiesça Bistami en regardant le chantier tout autour.
Des bâtiments naissaient d’échafaudages plantés dans des mers de boue noire.
— Louanges à Dieu ! s’exclama-t-il devant tant de merveilles à venir.
Le garde, qui s’appelait Hussein Ali, regarda Bistami d’un air suspicieux. Les pèlerins pieux étaient sans nul doute une banalité. Il conduisit Bistami par la porte du nouveau palais, à la suite de l’empereur. Derrière la muraille se trouvaient des jardins qui donnaient l’impression d’avoir toujours été là : de grands pins dominaient des bosquets de jasmin et des parterres de fleurs, à perte de vue. Le palais lui-même était plus petit que la mosquée, ou que la tombe de Chishti, mais exquis dans le moindre détail. C’était un régal pour l’œil. Une tente de marbre blanc, large et basse, abritait une succession de pièces fraîches entourant une cour centrale et un jardin orné en son milieu d’une fontaine. L’aile entière, à l’arrière de la cour, consistait en une longue galerie dont les murs étaient ornés de peintures : des scènes de chasse, au ciel d’un turquoise immuable ; des chiens, des biches et des lions, des chasseurs en dhoti armés d’arcs ou de fusils à silex, tous peints avec un tel réalisme qu’il ne leur manquait que la vie. Face à ces scènes se trouvaient des successions de pièces aux murs blancs, achevées mais désertes. On en donna une à Bistami pour qu’il s’y installe.
Le repas, ce soir-là, fut un festin somptueux servi dans une longue salle ouverte sur la cour centrale. Au fur et à mesure de son déroulement, Bistami comprit que c’était tout simplement l’ordinaire du palais. Il mangea des cailles rôties, des concombres au yaourt, du porc au curry, et goûta de nombreux plats qu’il ne connaissait pas.
Ce festin inaugurait pour lui une période de rêve, au cours de laquelle il se sentit comme le Manjushri de la légende, qui était tombé vers le haut dans le royaume du lait et du miel. La nourriture dominait ses jours et ses pensées. Un soir, il reçut la visite d’un groupe d’esclaves noirs mieux vêtus que lui, qui l’amenèrent rapidement à leur niveau d’élégance et au-delà. Ils le parèrent d’une belle robe blanche qui avait fière allure mais pesait lourd sur ses épaules. Après cela, il eut une nouvelle audience avec l’empereur.
Cette audience, à laquelle assistèrent des conseillers au regard acéré, des généraux et des serviteurs impériaux de toute sorte, fut très différente de la rencontre matinale à la tombe, où deux jeunes gens sortis pour respirer l’air matinal, assister au lever du soleil, et chanter la gloire du monde d’Allah, s’étaient parlé à cœur ouvert. Et pourtant, dans tout cet équipage, c’était le même visage qui le contemplait – curieux, sérieux, intéressé par ce qu’il avait à dire. Se concentrer sur ce visage aidait Bistami à se détendre.
L’empereur dit :
— Nous vous invitons à vous joindre à nous et à partager votre connaissance de la loi. En échange de votre sagesse, et de votre jugement de certaines affaires et questions qui seront traitées devant vous, vous serez fait zamindar du domaine de feu Shah Muzzafar, qu’Allah honore son nom.
— Louanges à Dieu, murmura Bistami, les yeux baissés. Je demanderai l’aide de Dieu pour remplir cette immense tâche à votre satisfaction.
Même le regard rivé au sol, ou braqué à nouveau sur le visage de l’empereur, Bistami sentit que des courtisans étaient fort mécontents de cette décision. Mais, après coup, certains de ceux qui paraissaient les moins heureux s’approchèrent de lui, se présentèrent, lui parlèrent gentiment, lui firent faire le tour du palais, le sondèrent habilement sur son passé, ses origines, et lui en dirent plus long sur le domaine qu’il devait administrer. Lequel, apparemment, serait surtout géré par des assistants locaux. L’affaire se résumait principalement à une question de titre et de revenus. En retour, il devrait fournir, en cas de besoin, une centaine de soldats, avec leur équipement, aux armées de l’empereur, transmettre toute sa connaissance du Coran et arbitrer diverses querelles civiles confiées à son jugement.
— Il y a des querelles que seul un ouléma est apte à trancher, lui dit Raja Todor Mal, le conseiller de l’empereur. L’empereur a de grandes responsabilités. L’empire proprement dit n’est pas encore à l’abri de ses ennemis. Il y a une quarantaine d’années seulement que Babur, le grand-père d’Akbar, est venu du Penjab fonder ici un royaume musulman. Les infidèles nous attaquent encore au sud et à l’est. Tous les ans, il faut faire campagne pour les repousser. Tous les fidèles de son empire sont sous sa responsabilité, en théorie, mais le fardeau de ses devoirs fait, en pratique, qu’il n’a tout simplement pas le temps.
— Bien sûr que non.
— En attendant, il n’y a pas d’autre système judiciaire pour régler les querelles de personnes. La loi étant basée sur le Coran, les cadis, les oulémas et les autres saints hommes comme vous-même êtes le choix logique pour assumer cette tâche.
— Bien sûr que oui.
Au cours des semaines suivantes, Bistami se retrouva bel et bien à arbitrer des querelles qui lui étaient soumises par certains des assistants de l’empereur. Deux hommes revendiquaient la même terre ; Bistami demanda où leurs pères avaient vécu, et les pères de leurs pères, et décida que l’une des deux familles vivait dans la région depuis plus longtemps que l’autre. C’est de cette façon qu’il fondait ses jugements.
D’autres nouveaux vêtements lui furent fournis par des tailleurs ; une nouvelle maison, une suite complète de serviteurs et d’esclaves furent mises à sa disposition ; on lui donna un coffre d’au moins cent mille pièces d’or et d’argent. Et pour tout cela, on ne lui demandait que de consulter le Coran, de se rappeler les hadiths qu’il avait lus (très peu, en réalité, et moins nombreux encore étaient ceux qui s’appliquaient), et de rendre des jugements généralement évidents pour tout le monde. Quand ils n’étaient pas évidents, il faisait de son mieux, après quoi il se retirait à la mosquée et il priait, mal à l’aise, puis il assistait l’empereur et dînait à la cour. Il repartait seul, tous les jours, à l’aube, sur la tombe de Chishti, et c’est ainsi qu’il revoyait l’empereur dans les mêmes circonstances informelles que lors de leur première rencontre, une ou deux fois par mois peut-être, ce qui était suffisant pour que l’empereur, toujours très occupé, ait conscience de son existence. Il tenait invariablement prête l’histoire qu’il raconterait à Akbar ce jour-là, quand celui-ci lui demanderait ce qu’il avait fait ; chaque histoire était choisie pour ce qu’elle pourrait enseigner à l’empereur, sur lui-même, sur Bistami, sur l’empire ou sur le monde. Une leçon honnête et réfléchie, c’était assurément le moins qu’il pouvait faire pour l’incroyable bonté dont Akbar le comblait.
Un matin, il lui raconta l’histoire de la sourate XVIII – l’histoire de la ville qui avait renié Dieu. Dieu avait emmené ses habitants dans une caverne et les avait plongés dans un sommeil si particulier qu’ils avaient eu, en se réveillant, l’impression de n’avoir dormi qu’une seule et unique nuit ; mais, en sortant, ils avaient découvert que trois cent neuf années avaient passé.
— Ainsi, par vos travaux, puissant Akbar, nous projetez-vous dans l’avenir.
Un autre matin, il lui raconta l’histoire d’El-Khadir, le célèbre vizir de Dhoulkarnain, qui s’était désaltéré à la fontaine de la vie, dont la vertu était telle qu’il vivait encore et qu’il vivrait jusqu’au jour du jugement dernier, et qui apparaissait, vêtu de vert, aux musulmans en détresse, pour les aider.
— C’est ainsi que votre œuvre ici-bas, grand Akbar, ignorera la mort et continuera au fil des ans à aider les musulmans en détresse.
L’empereur paraissait apprécier ces conversations dans la fraîcheur de la rosée. Il invita Bistami à se joindre à lui lors de plusieurs chasses. Bistami et sa suite occupaient une grande tente blanche, et passaient les chaudes journées à cheval, galopant dans la jungle derrière des chiens hurlants et des rabatteurs ; ou, ce qui était plus du goût de Bistami, il s’asseyait dans le howdah d’un éléphant et regardait les grands faucons quitter le poing d’Akbar, prendre leur essor, très haut dans le ciel, puis décrire des plongeons effrayants sur un lapin ou un oiseau. Akbar vous fixait de son regard attentif exactement comme celui des faucons.
En fait, Akbar aimait ses faucons comme ses frères, et il était toujours de très bonne humeur pendant ces journées de chasse. Il faisait venir Bistami auprès de lui et appelait une bénédiction sur ces grands oiseaux à l’air farouche, dont le regard portait loin, par-delà l’horizon. Les rapaces s’envolaient, battant puissamment des ailes, et montaient rapidement vers les hauteurs d’où la chasse commençait. Lorsqu’ils planaient majestueusement dans les cieux, décrivant de larges cercles au-dessus de leurs têtes, on lâchait quelques colombes. Ces oiseaux partaient à tire-d’aile se mettre à couvert dans les arbres ou les buissons, mais n’allaient généralement pas assez vite pour fuir l’attaque des faucons. Leurs corps brisés étaient ramenés aux pieds de l’empereur par les rapaces qui retournaient se poser sur son poing, où ils étaient salués par un regard aussi fixe que le leur, et récompensés par des bribes de mouton cru.
C’est au cours de l’un de ces jours heureux que du sud leur parvint une mauvaise nouvelle. Un messager arriva en disant que la campagne d’Adham Khan contre le sultan de Malwa, Baz Bahadur, avait été couronnée de succès, mais que l’armée du khan avait entrepris de massacrer tous les prisonniers, hommes, femmes et enfants, de la ville de Malwa, et notamment de nombreux théologiens musulmans et même quelques sayyids, c’est-à-dire des descendants directs du Prophète.
Akbar devint écarlate. Seule une verrue, sur le côté gauche de son visage, brillait, pareille à un raisin blanc incrusté sur sa peau.
— Fini, dit-il à son faucon.
Puis il commença à donner des ordres. L’oiseau fut renvoyé à son fauconnier, et la chasse oubliée.
— Il croit que je n’ai pas encore l’âge…
Il partit au grand galop, laissant toute sa suite sur place, à l’exception de Pir Muhammad Khan, le général en qui il avait le plus confiance. Bistami entendit dire plus tard qu’Akbar avait personnellement relevé Adham Khan de son commandement.
Bistami eut la tombe de Chishti pour lui seul pendant un mois. Puis, un matin, il y retrouva l’empereur, l’air sombre. Adham Khan avait été également destitué de son poste de vakil, ministre principal, et remplacé par Zein.
— Ça va le mettre en rage, mais ça devait être fait, dit Akbar. Nous devrons le mettre aux arrêts.
Bistami hocha la tête et continua à balayer le sol frais et sec de la cour intérieure. L’idée qu’Adham Khan soit placé sous garde permanente, ce qui préludait généralement à une exécution, était dérangeante. Il avait beaucoup d’amis à Agra. Il pourrait tenter de se rebeller, par orgueil. Comme devait très bien le savoir l’empereur.
En vérité, deux jours plus tard, l’après-midi, alors que Bistami se trouvait non loin d’Akbar et de ses conseillers, au palais, il fut effrayé, mais pas surpris, de voir apparaître Adham Khan. Celui-ci montait l’escalier d’un pas lourd, armé, sanglant, hurlant qu’il avait tué Zein moins d’une heure auparavant, dans sa propre salle d’audience, pour le punir d’avoir usurpé ce qui lui revenait de droit.
Entendant cela, Akbar s’empourpra à nouveau, frappa brutalement le khan sur la tempe avec son hanap, l’attrapa par le collet et le tira à l’autre bout de la pièce. Si Adham avait opposé la moindre résistance il aurait signé son arrêt de mort immédiat. Les gardes qui se tenaient de chaque côté, sabre au clair, seraient aussitôt intervenus. Il se laissa donc conduire sur le balcon, d’où Akbar le fit basculer par-dessus la rambarde, dans le vide. Puis, plus rouge que jamais, Akbar se rua en bas des marches, se précipita auprès du khan à demi conscient, le prit par les cheveux, le traîna de ses propres mains en haut de l’escalier, avec sa lourde armure, sur le tapis, sur le balcon, d’où il le fit à nouveau basculer par-dessus la rambarde. Adham Khan s’écrasa une seconde fois sur le sol du patio, au-dessous, avec un choc sourd.
Ce coup-ci, il était bel et bien mort. L’empereur se retira dans ses appartements.
Le lendemain matin, Bistami balaya le mausolée de Chishti en proie à une tension extrême.
Akbar apparut, et Bistami sentit son cœur battre à tout rompre. Akbar semblait calme, mais distant. La tombe était un endroit qui aurait dû lui rendre une certaine sérénité. Mais le vigoureux balayage qu’il administrait au sol que Bistami avait déjà nettoyé contredisait le calme de ses paroles. C’est l’empereur, pensa soudain Bistami. Il peut faire ce qu’il veut.
Mais encore une fois, en tant qu’empereur musulman, il était au service de Dieu, et de la charia. Puissant et à la fois complètement soumis, tout cela en même temps. Pas étonnant qu’il ait eu l’air pensif au point de paraître hébété. Quand on le voyait ainsi balayer le mausolée au petit matin, il était difficile de l’imaginer fou de colère, comme un éléphant en musth, projetant un homme, de ses propres mains, vers la mort. Il y avait en lui un insondable puits de rage.
La rébellion de sujets manifestement musulmans trouvait sa source au plus profond de ce puits. On annonça une nouvelle rébellion dans le Penjab, et une armée fut envoyée pour la réprimer. Les innocents de la région furent épargnés, même ceux qui avaient combattu au côté des rebelles. Mais ses meneurs, une quarantaine, furent amenés à Agra et placés au milieu d’un cercle d’éléphants de guerre qui avaient de longues lames pareilles à des sabres géants attachées à leurs défenses. Les éléphants furent lâchés sur les traîtres qui hurlèrent alors que les éléphants les écrasaient et, rendus fous par le sang, projetaient leur corps très haut en l’air. Bistami n’aurait jamais cru que des éléphants puissent être poussés à une telle folie sanguinaire. Akbar était perché dans un howdah en forme de trône sur le dos du plus grand de tous les éléphants, un éléphant qui resta immobile devant le spectacle. Ils observaient tous les deux le carnage, impavides.
Quelques jours plus tard, à l’aube, quand l’empereur revint au mausolée, Bistami trouva tout drôle de balayer la cour ombragée de la tombe avec lui. Il balayait assidûment, en essayant d’éviter le regard d’Akbar.
Pour finir, il dut bien manifester qu’il avait conscience de la présence du souverain. Akbar le regardait déjà.
— Tu as l’air troublé, dit Akbar.
— Non, puissant Akbar, pas du tout.
— Tu n’approuves pas l’exécution des traîtres à l’islam ?
— Mais si. Bien sûr que je l’approuve.
Akbar le regarda, à la façon d’un faucon.
— Mais ibn Khaldun n’a-t-il pas dit que le calife devait se soumettre à Allah de la même façon que le plus humble des esclaves ? N’a-t-il pas dit que le calife avait le devoir d’obéir à la loi musulmane ? Et la loi musulmane n’interdit-elle pas la torture des prisonniers ? N’est-ce pas la pensée de Khaldun ?
— Khaldun n’était qu’un historien, répondit Bistami.
Akbar se mit à rire.
— Et le hadith qui vient d’Abu Taiba, qui le tient de Murra ibn Hamdan, qui le tient de Sufyan al-Thawri, qui se l’est fait raconter par Ali ibn Abi Talaib (que le Messager de Dieu, que Dieu lui-même bénissent son nom pour toujours), et qui dit : « Tu ne tortureras pas les esclaves » ? Et les versets du Coran qui ordonnent aux dirigeants d’imiter Allah, et de faire preuve de compassion et de merci envers les prisonniers ? N’ai-je point trahi l’esprit de ces commandements, ô sage pèlerin soufi ?
Bistami étudia les dalles de la cour.
— Peut-être, grand Akbar. Vous seul le savez.
Akbar le regarda.
— Quitte la tombe de Chishti, dit-il.
Bistami se précipita vers la porte.
Lorsque Bistami revit Akbar, la fois suivante, c’était au palais, où on lui avait ordonné de se montrer. Il s’avéra que c’était pour répondre à une question :
— Pourquoi tes amis de Gujarat se rebellent-ils contre moi ? demanda-t-il froidement.
Bistami répondit, mal à l’aise :
— J’ai quitté Ahmadabad précisément à cause de tous ces combats. Les mirzas avaient toujours des problèmes. Le roi Muzzafar Shah Troisième du nom ne dirigeait plus rien. Vous savez tout cela. C’est pour cela que vous avez pris Gujarat sous votre protection.
Akbar hocha la tête comme s’il se rappelait la campagne.
— Mais Hussein Mirza est revenu du Deccan et de nombreux nobles de Gujarat l’ont rejoint dans la rébellion. Si la nouvelle se répand qu’on peut me défier si facilement, qui sait ce qui arrivera ensuite ?
— Gujarat doit être reprise, c’est certain, répondit Bistami d’un ton mal assuré.
Peut-être, comme la dernière fois, était-ce exactement ce qu’Akbar n’avait pas envie d’entendre. Ce qu’on attendait de lui n’était pas clair pour Bistami ; c’était un fonctionnaire de la cour, un cadi. D’habitude on ne le consultait que sur les questions religieuses, ou judiciaires. Or, le fait d’avoir autrefois vécu là où il y avait maintenant la révolte lui valait d’être apparemment sur la sellette ; et ce n’était pas un endroit où l’on avait envie de se trouver quand Akbar était en colère.
— Il se pourrait qu’il soit déjà trop tard, dit Akbar. La côte est à deux mois.
— Vraiment ? demanda Bistami. J’ai fait personnellement le trajet en dix jours. Peut-être que si vous preniez vos meilleurs hommes, sur des chamelles, vous pourriez surprendre les rebelles.
Akbar le gratifia de son regard de faucon. Il fit mander Raja Todor Mal, et les choses furent bientôt organisées comme l’avait suggéré Bistami. Une cavalerie de trois mille soldats, menée par Akbar, à laquelle Bistami était prié de se joindre, couvrit la distance entre Agra et Ahmadabad en onze longues et poussiéreuses journées. La cavalerie, aguerrie par cette marche forcée, écrasa une troupe de plusieurs milliers de rebelles – quinze mille selon le décompte de l’un des généraux, qui furent pour la plupart tués au combat.
Bistami passa cette journée à dos de chameau, suivant les charges principales sur le front, essayant de rester en vue d’Akbar, et, lorsqu’il n’y parvenait pas, aidant les blessés à se mettre à couvert. Même sans les grands canons de siège d’Akbar, le vacarme – essentiellement provoqué par les cris des hommes et des chameaux – avait de quoi ébranler. Il y avait dans l’air une odeur de poussière et de sang.
Plus tard, dans l’après-midi, désespérément assoiffé, Bistami se dirigea vers le fleuve. Des dizaines de blessés et de mourants étaient déjà là, teintant l’eau de rouge. Même en amont, il était impossible de boire une gorgée d’eau qui n’ait pas goût de sang.
Puis Raja Todor Mal et une bande de soldats arrivèrent parmi eux, exécutant au sabre les mirzas et les Afghans qui avaient mené la rébellion. L’un des mirzas aperçut Bistami et cria :
— Bistami, sauve-moi ! Sauve-moi !
L’instant d’après, il n’avait plus de tête, son corps se vidait de son sang sur la rive, par le cou. Bistami se détourna, Raja Todor Mal ne le quittant pas des yeux.
Il était clair qu’Akbar entendit parler de cela par la suite, parce que durant la lente marche de retour vers Fatehpur Sikri, malgré la nature triomphante de la procession et l’allégresse évidente d’Akbar, il ne fit pas venir Bistami à ses côtés, en dépit du fait que c’était Bistami qui avait eu l’idée de cet assaut foudroyant contre les rebelles. Ou bien peut-être à cause de cela ; Raja Todor Mal et ses compères ne pouvant s’en réjouir.
Ça sentait mauvais, et rien dans la grande fête de victoire qui marqua leur retour à Fatehpur Sikri, quarante-trois jours seulement après leur départ, ne permit à Bistami de se sentir mieux. Tout au contraire, il éprouvait une appréhension grandissante, alors que les jours passaient et qu’Akbar ne revenait pas à la tombe de Chishti.
Au lieu de cela, un matin, trois gardes apparurent. Ils avaient pour ordre de surveiller Bistami, à la tombe comme chez lui. Ils l’informèrent qu’il n’était plus autorisé à aller nulle part en dehors de ces deux endroits. Il était aux arrêts.
C’était le prélude habituel à l’interrogatoire et à l’exécution des traîtres. Bistami voyait dans les yeux de ses gardes que cette fois ne ferait pas exception. D’ailleurs, ils le regardaient déjà comme un homme mort. Il avait du mal à croire qu’Akbar s’était retourné contre lui ; il s’efforçait désespérément de comprendre. Sa peur grandissait tous les jours. L’image du corps décapité du mirza vomissant son sang lui revenait constamment. Chaque fois qu’il la revoyait, le sang de son propre corps palpitait en lui, avide de fuir telle une fontaine rouge, volcanique.
Il alla à la tombe de Chishti, par un de ces terribles matins, et décida de ne pas en repartir. Il envoya l’ordre à l’un de ses suivants de lui apporter à manger au coucher du soleil. Après avoir dîné devant la porte de la tombe, il dormait sur une natte dans un coin de la cour. Il jeûnait comme si c’était le ramadan, et passait les journées à réciter alternativement le Coran et des versets du Mathnawi de Mowlana Rumi et d’autres textes soufis en persan. Une partie de lui attendait, espérait, que l’un des gardes parle persan, de sorte que les paroles de Mowlana, grand poète et voix soufie, seraient comprises alors qu’elles coulaient hors de lui.
— « Voilà les signes miraculeux que tu attends, disait-il à voix haute, alors que tu cries dans la nuit et que tu te lèves à l’aube, demandant qu’en l’absence de ce dont tu te languis tes journées s’assombrissent, ton cou devienne aussi fin qu’un fuseau, que ce que tu donnes soit tout à toi, que tu sacrifies tous tes biens, ton sommeil, ta santé, ta tête, que tu t’asseyes souvent dans des flammes pareilles au feu du bois d’aloès et que tu sortes souvent, tel un casque ébréché à la rencontre de la lame. Quand les gestes d’impuissance deviennent l’habitude, c’est le signe. Tu cours en tous sens à l’écoute d’événements inhabituels, scrutant les visages des voyageurs. Pourquoi me regardes-tu comme un fou ? J’ai perdu un ami. Pardonne-moi je t’en prie. Une telle recherche ne peut échouer. Un cavalier viendra qui te touche de près. Tu défailles et balbuties. Le non-initié dit que tu feins. Comment pourrait-il savoir ? L’eau recouvre le poisson mort sur le rivage.
» Bénie soit l’intelligence dont le cœur entend du ciel l’appel : Viens plus près. L’oreille souillée n’entend pas ce son – seul le méritant obtient la récompense. Ne souille pas ton œil avec la joue et la verrue humaines, parce que l’empereur de la vie éternelle arrive ; et s’il a été souillé, lave-le avec des larmes, parce que le remède vient de ces larmes. Une caravane de sucre est venue d’Égypte ; un bruit de pas, le tintement d’une cloche. Ha, fais silence, car le roi dont les paroles compléteront l’ode, notre roi, est en route. »
Après des jours et des jours de cela, Bistami commença à réciter le Coran sourate après sourate, revenant souvent à la première, l’Ouverture du livre, la Fatiha, la Guérisseuse, que les gardes ne pouvaient manquer de reconnaître :
— « Au nom de Dieu le Miséricordieux, le très miséricordieux. Louange à Dieu le Seigneur des mondes, le Miséricordieux, le très miséricordieux, le maître du jour du jugement. C’est toi que nous adorons, c’est toi que nous implorons. Conduis-nous vers le droit chemin, le chemin de ceux que tu combles de bienfaits, non de ceux qui t’irritent ni de ceux qui s’égarent. »
Cette grande prière d’ouverture, si appropriée dans sa situation, Bistami la répétait des centaines de fois par jour. Parfois, il ne répétait que la prière : « Dieu est suffisant et excellent Protecteur » ; une fois, il la dit trente-trois mille fois d’affilée. Puis il changea pour « Allah est miséricordieux, soumets-toi à Allah, Allah est miséricordieux, soumets-toi à Allah », qu’il répéta à en avoir la bouche desséchée, la voix rauque, et les muscles du visage crispés par la douleur et l’épuisement.
Et pendant ce temps, il balayait impeccablement la cour, et toutes les pièces du mausolée, l’une après l’autre, et il remplissait les lampes, et il raccourcissait les mèches, et il recommençait à balayer, regardant le ciel qui changeait tout au long de la journée, et il répétait ces mêmes choses, encore et toujours, et il sentait le vent passer à travers lui, regardait palpiter les feuilles des arbres autour du mausolée, chacune dans sa propre lumière, légère, transparente. L’arabe, c’est apprendre, mais le persan, c’est le sucre. Il goûtait sa nourriture, au coucher du soleil, comme s’il n’avait jamais goûté de nourriture auparavant. Et pourtant, il lui devenait facile de jeûner, peut-être parce que c’était l’hiver et que les jours étaient un peu plus courts. La peur le poignardait souvent encore, faisant rugir son sang dans ses veines comme un torrent phénoménal, et il priait tout haut à chaque moment d’éveil, rendant sans doute ses gardes fous d’ennui par son bourdonnement incessant.
Pour finir, le monde entier se contracta autour de la tombe, et il commença à oublier les choses qui lui étaient arrivées avant, et tout ce qui arrivait probablement à chaque instant dans le monde autour du mausolée. Il les oubliait. Son esprit s’éclaircissait ; en vérité, tout dans le monde semblait devenir léger, transparent. Il voyait dans les feuilles, et parfois à travers, comme si elles étaient de verre ; il voyait dans le marbre blanc et l’albâtre de la tombe ; et il voyait aussi dans sa propre chair. Tout cela brillait, vivant dans le crépuscule. Et pourtant. « Tout, sauf la face de Dieu, doit périr un jour. À Lui nous retournerons. » C’étaient les paroles du Coran incluses dans le beau poème de la réincarnation de Mowlana Rumi :
Je suis mort comme minéral et revenu plante,
Je suis mort comme plante et revenu animal,
Je suis mort comme animal et j’étais Homme.
Pourquoi devrais-je avoir peur ? Quand ai-je été moins proche de la mort ?
Et pourtant, encore une fois, je mourrai comme Homme pour m’élever
Avec les anges bénis ; mais de l’angélisme même
Je dois poursuivre : « Tout, sauf la face de Dieu, doit périr un jour. »
Quand j’aurai sacrifié mon âme angélique,
Je deviendrai ce qu’aucun esprit jamais n’a conçu.
Oh, laisse-moi ne pas être ! car la non-existence
Proclame d’une voix d’orgue : « À Lui nous devons
retourner. »
Il répéta ce poème un millier de fois, chuchotant toujours la dernière partie, de crainte que les gardes ne racontent à Akbar qu’il se préparait à la mort.
Les jours passèrent ; les semaines passèrent. Il avait de plus en plus faim, et il devenait hypersensible à toutes les saveurs, à toutes les odeurs, et même à l’air et à la lumière. Il percevait les nuits encore chaudes et lourdes, comme des couvertures qui l’emmaillotaient, et dans la brève fraîcheur de l’aube il marchait en balayant et en priant, regardant le ciel au-dessus des arbres feuillus qui allaient en s’éclaircissant ; et puis, un matin alors que l’aube montait, tout commença à se changer en lumière. « Ô lui, ô lui qui est Lui, ô Lui qui n’est que Lui ! » Encore et encore il cria ces paroles dans le monde de lumière, et même les paroles étaient des échardes de lumière jaillissant de sa bouche. La tombe devint une pure lumière blanche et la fontaine déversa son eau de lumière dans l’air lumineux, et les parois de la cour étaient des briques de lumière, et tout était lumière, légèrement palpitante. Il voyait à travers la Terre, et remontait le temps, par-dessus une passe de Khyber faite de dalles de lumière jaune, remontant jusqu’au moment de sa naissance, le dixième jour de Moharram, le jour où l’imam Hussein, le seul petit-fils vivant de Mahomet, était mort en défendant la foi, et il vit que, Akbar pouvait toujours le faire tuer, il continuerait à vivre, parce qu’il avait déjà vécu de nombreuses fois, et qu’il ne disparaîtrait pas à la fin de sa vie. « Pourquoi devrais-je avoir peur ? Quand ai-je jamais perdu quelque chose en mourant ? » Il était une créature de lumière, comme tout le reste, et il avait été jadis une villageoise, une autre fois un cavalier dans les steppes, une autre fois le serviteur du Douzième Imam, de sorte qu’il savait comment et pourquoi l’Imam avait disparu, et quand il reviendrait sauver le monde. Sachant cela, il n’avait aucune raison de craindre quoi que ce soit. « Pourquoi devrais-je avoir peur ? Ô lui, ô lui qui est Lui, Dieu est suffisant et excellent Protecteur, Allah le miséricordieux, le bienfaisant ! » Allah, qui avait fait venir Mahomet à Lui, au cours de l’isra, puis du miraj. Bistami poursuivait à présent ce même voyage, vers le Paradis, vers la lumière, la lumière ultime, absolue, éternelle.
Comprenant cela, Bistami regarda à travers les murs transparents, et les arbres, et la terre, vers Akbar, à l’autre bout de la ville, dans son palais transparent, vêtu de lumière, comme un ange, un homme déjà plus qu’à demi angélique, un esprit angélique qu’il avait connu dans ses vies antérieures, et qu’il connaîtrait à nouveau dans ses vies futures, jusqu’à ce qu’ils se retrouvent tous au même endroit et qu’Allah sonne la chute de l’univers.
Sauf que cet Akbar de lumière tourna la tête et regarda à travers l’espace baigné de lumière qui les séparait, et Bistami vit que ses yeux étaient des billes noires, noires comme de l’onyx ; et il dit à Bistami : Nous ne nous sommes jamais rencontrés, je ne suis pas celui que tu cherches ; celui que tu cherches est ailleurs.
Bistami tituba, tomba au coin de deux murs.
Lorsqu’il revint à lui, le monde était toujours de verre coloré, Akbar se tenait devant lui en chair et en os, et il balayait la cour avec le balai de Bistami.
— Maître, dit Bistami, qui se mit à pleurer. Mowlana.
Akbar se dressa au-dessus de lui, le regarda.
Finalement, il posa la main sur la tête de Bistami.
— Tu es un serviteur de Dieu, dit-il.
— Oui, Mowlana.
— « Maintenant Dieu nous a comblés », récita Akbar en arabe. « Quiconque est fidèle et endurant, eh bien, Dieu ne perd pas le salaire de ceux qui agissent bien. »
C’était un extrait de la sourate XII, l’histoire de Joseph et de ses frères. Bistami, encouragé, voyant toujours à travers les choses, y compris Akbar, sa main et son visage lumineux, telle une créature de lumière palpitante à travers les vies comme les jours, récitait des versets de la fin de la sourate suivante, « Le tonnerre » :
— « Leurs devanciers aussi tramaient, mais Dieu est maître de tous les stratagèmes. Il sait ce que fait chacun. »
Akbar hocha la tête, regarda la tombe de Chishti, perdu dans ses pensées.
— « On ne vous reproche rien aujourd’hui », marmonna-t-il, citant les paroles que Joseph prononça alors qu’il pardonnait à ses frères. « Dieu vous pardonnera, il est le plus miséricordieux des miséricordieux. »
— Oui, Mowlana. Dieu nous donne toute chose, Dieu le miséricordieux, le très miséricordieux, il est qui Il est. Ô lui qui est qui Il est, ô, lui qui est Lui, ô lui qui est Lui… »
Il dut faire un effort sur lui-même pour s’arrêter.
— Oui, dit Akbar en baissant à nouveau les yeux sur lui. Maintenant, quoi qu’il ait pu arriver à Gujarat, je ne veux plus en entendre parler. Je ne crois pas que tu aies eu quoi que ce soit à voir avec la rébellion. Cesse de pleurer. Mais Abul Fazl et Cheikh Abdul Nabi le croient, et ils figurent au nombre de mes principaux conseillers. Je leur fais confiance pour la plupart des choses. Je suis loyal envers eux, comme ils sont loyaux envers moi. Je ne puis donc ignorer leur avis et leur ordonner de te laisser en paix, mais même si je le faisais, ta vie ici ne serait pas aussi confortable qu’elle l’était auparavant. Tu comprends.
— Oui, maître.
— Alors je vais t’envoyer au loin…
— Non, maître !
— Silence ! Tu vas effectuer le haj.
Bistami en resta bouche bée. Après tous ces jours passés à parler interminablement, il se retrouva la mâchoire pendante comme une porte brisée. Une lumière blanche emplissait toute chose, et il eut un moment de défaillance.
Puis les couleurs revinrent et il recommença à entendre :
— … tu iras à Surat à cheval, et tu prendras mon vaisseau pèlerin, l’Ilahi, pour traverser la mer d’Arabie vers Jeddah. Le wakf a rapporté beaucoup d’argent, et j’ai désigné Wazir mir haj pour vous mener. Votre groupe comprendra ma tante, Bulbadan Begam, et ma femme, Salima. J’aimerais y aller moi-même, mais Abul Fazl insiste pour que je reste, disant qu’on a besoin de moi ici.
Bistami hocha la tête.
— Vous êtes indispensable, Maître.
Akbar le regarda longuement.
— Ce qui n’est pas ton cas.
Il retira sa main de la tête de Bistami.
— Mais le mir haj peut toujours utiliser un autre cadi. Et je veux établir une école timouride permanente à La Mecque. Tu pourras y contribuer.
— Mais… et je ne reviendrai pas ?
— Pas si tu accordes du prix à ton existence.
Bistami baissa les yeux. Il se sentit soudain glacé.
— Viens, maintenant, dit l’empereur. Pour un érudit aussi assidu que toi, la vie à La Mecque devrait être pure joie.
— Oui, maître. Bien sûr.
Mais sa voix s’étrangla sur ces mots.
Akbar éclata de rire.
— C’est mieux que d’être décapité, tu dois bien l’avouer ! Et qui sait ? La vie est longue. Peut-être reviendras-tu un jour.
Ils savaient tous les deux que c’était peu probable. La vie n’était pas si longue.
— Si Dieu le veut, murmura Bistami en regardant autour de lui.
Cette cour, cette tombe, ces arbres qu’il connaissait pierre par pierre, branche par branche, feuille par feuille – cette vie qui avait rempli une centaine d’années au cours du mois écoulé était terminée. Tout ce qu’il connaissait si bien passerait hors de lui, y compris ce beau jeune homme tant aimé. C’était drôle de penser que chaque vie durait si peu d’années – qu’on pouvait vivre plusieurs vies au cours de chaque réincarnation. Il dit :
— Dieu est grand. Nous ne nous reverrons plus jamais.
5. En route pour La Mecque
Du port de Jeddah à La Mecque, les chameaux des pèlerins formaient une caravane continue d’un horizon à l’autre. Elle paraissait même se prolonger indéfiniment au-delà, et faire le tour du monde. Les profondes vallées rocailleuses autour de La Mecque étaient pleines de campements, et une odeur de mouton grillé montait dans la fumée des feux de camp, vers le ciel clair du couchant. Nuits froides, journées chaudes, jamais un nuage dans le ciel blanc-bleu, et tous ces milliers de pèlerins, qui effectuaient dans l’euphorie les derniers tours du pèlerinage. Tout le monde dans la ville participait au même rituel extatique, habillé de blanc, rehaussé du vert des turbans des sayyids, qui se disaient les descendants directs du Prophète : une grande famille, à en juger par la quantité de vert. Et tous récitaient des versets du Coran, suivaient les gens devant eux, qui suivaient ceux devant eux, et ceux devant eux, et ainsi de suite, en une longue file qui remontait neuf siècles en arrière.
Au cours de son voyage vers l’Arabie, Bistami avait jeûné comme jamais dans sa vie, même à la tombe de Chishti. Il se laissait à présent porter par le courant qui dévalait les rues de pierre de La Mecque, léger comme une plume, regardant en l’air les palmiers balancer leur tête verte, ébouriffée, dans le ciel ; se sentant si aérien dans la grâce de Dieu qu’il avait parfois l’impression de voir les palmiers d’en haut, ou depuis les alentours de la Kaaba. Il devait alors baisser les yeux pour voir où il mettait les pieds, retrouver son équilibre, et reprendre conscience. Il avait l’impression que ses pieds étaient de distantes créatures dotées d’une vie propre, s’élançant l’une après l’autre, encore et encore. Ô Lui, ô Lui qui est Lui…
Il avait quitté le groupe de Fatehpur Sikri parce que la famille d’Akbar lui rappelait trop son ancien maître. Avec eux c’était toujours Akbar ceci, Akbar cela, et sa femme Salima (une seconde épouse, pas l’impératrice) prenait plaisir à se plaindre sans arrêt, tandis que sa tante l’asticotait. Non. Les femmes avaient de toute façon leur propre pèlerinage, mais les hommes de la suite du Moghol ne valaient guère mieux. Et Wazir, le mir haj, étant un proche d’Adul Fazl, se méfiait de Bistami, lui cédant tout jusqu’au mépris. Il n’y aurait pas de place pour Bistami dans l’école du Moghol, si tant est qu’il s’en construisît une un jour, tout ce qu’ils faisaient pour le moment revenant en fait à dilapider les aumônes et les richesses de la ville pour se distraire plutôt que pour accomplir ses devoirs de pèlerin ; du reste, cela ne tarderait pas à se voir très bientôt. De toute façon, Bistami ne serait pas le bienvenu chez eux, c’était clair.
Enfin, c’était l’un de ces moments bénis où l’on ne se souciait pas de l’avenir, où le futur et le passé étaient tous deux absents du monde. C’est ce qui frappa le plus Bistami, même en cet instant, même alors qu’il flottait comme par magie au-dessus de la file des croyants, pèlerin en robe blanche parmi des millions d’autres venus de tout le Dar al-Islam, du Maghreb à Mindanao, de la Sibérie aux Seychelles – tous là, présents en cet endroit, le ciel et la ville resplendissant de leur présence, pas aussi transparents qu’à la tombe de Chishti, mais pleins de couleurs, de toutes les couleurs du monde. Tous les peuples du monde n’étaient qu’un.
Cette sainteté irradiait de la Kaaba vers l’extérieur. Bistami avançait avec cette file d’humanité en direction de la plus sainte des mosquées. Il dépassa la grosse masse de pierre lisse et noire, encore plus noire que de l’ébène ou du jais, noire comme une nuit sans étoiles, comme un rocher en forme de trou noir, en réalité. Il sentit son corps et son âme battre à l’unisson de la file et du monde. Toucher la pierre noire était comme toucher de la chair. Elle semblait tourner autour de lui. L’image des yeux noirs d’Akbar lui revint à l’esprit, et il la chassa en frémissant, conscient qu’elle cherchait à le distraire, d’autant qu’Allah condamnait les représentations de la vie. La pierre était tout et ce n’était qu’une pierre, un bloc noir de réalité, rendu solide par Dieu. Il garda sa place dans la file et sentit l’esprit des gens devant lui s’élever alors qu’ils s’éloignaient de la place, comme s’ils gravissaient un escalier qui montait au Paradis.
Dispersion ; retour au camp ; premières gorgées de soupe et de café à la tombée du jour ; tout cela dans le soir doux et silencieux, à la lueur des étoiles. Tous étaient si paisibles. Lavés de l’intérieur. Regardant les visages autour de lui, Bistami se dit : Oh, pourquoi ne vivons-nous pas ainsi tout le temps ? Qu’y a-t-il donc de si important pour nous éloigner de cet instant ? Visages éclairés par le feu, nuit étoilée, échos des chants, rires doux, et paix, paix : nul n’avait l’air de vouloir dormir, mettre un terme à ce moment, se réveiller le lendemain, revenir au monde sensible.
La famille et le pèlerinage d’Akbar formèrent une caravane afin de regagner Jeddah. Bistami se rendit dans les faubourgs de la ville pour assister à leur départ ; la femme d’Akbar et sa tante lui dirent au-revoir, juchées sur le dos d’un chameau. Les autres avaient déjà commencé le long voyage qui les ramènerait à Fatehpur Sikri.
Après cela, Bistami resta seul à La Mecque, une ville d’étrangers. La plupart repartaient maintenant, en une interminable succession de caravanes. C’était un spectacle étrange, lugubre : des centaines de caravanes, des milliers de gens, heureux mais vidés, leur blanche robe empaquetée, ou bien souillée de poussière, le bas maculé de terre. Ils étaient si nombreux à partir qu’on aurait dit la population d’une ville fuyant à l’approche de quelque cataclysme, comme cela avait déjà dû se produire quelquefois, en temps de guerre, de famine ou de peste.
Et puis, une semaine ou deux plus tard, La Mecque montra enfin son vrai visage, celui d’une ville aux murs blanchis à la chaux, poussiéreux, de quelques milliers d’habitants. Beaucoup étaient des religieux, des érudits, des soufis, des cadis, des oulémas ou des réfugiés d’un genre ou d’un autre, venus chercher asile dans la ville sainte, la plupart, cependant, étaient des marchands ou des commerçants. Dans l’apocalypse du pèlerinage, on les voyait épuisés, sans force, presque hébétés, prompts à disparaître dans leur tanière aux murs nus, laissant les étrangers restés en ville se débrouiller seuls pour un mois ou deux. Quant aux religieux et aux étudiants, on aurait dit qu’ils avaient dressé le camp au beau milieu du cœur vide de l’islam, l’emplissant de leurs dévotions, faisant cuire sur des feux, au bord de la ville, au crépuscule, de la nourriture qu’ils échangeaient avec les nomades de passage. Beaucoup chantaient jusque tard dans la nuit.
Ceux qui parlaient persan, un groupe important, se massaient à la nuit tombée autour des feux de leur khitta, à l’est de la ville, où les canaux descendaient des collines. Ils étaient donc les premiers à voir la crue se déverser sur la ville après les orages du nord, qu’ils entendaient mais ne voyaient jamais. Un mur d’eau noire, fangeuse, rugissait dans les canaux et s’épandait dans toutes les rues, charriant des troncs de palmiers et des roches comme autant d’armes vers la ville haute. Après leur passage, tout était inondé, jusqu’à la Kaaba elle-même, qui était entourée d’eau jusqu’au cercle d’argent où était enchâssée la pierre.
Bistami se joignit avec allégresse à ceux qui nettoyaient les dégâts de l’inondation. Après l’expérience de la lumière dans la tombe de Chishti, puis l’expérience ultime du pèlerinage, il avait le sentiment de n’avoir plus rien à découvrir dans le domaine de la mystique. Il vivait désormais le contrecoup de ces événements, et se sentait profondément changé. Il ne rêvait plus à présent que de lire de la poésie persane pendant une heure dans la brève fraîcheur du matin, puis, l’après-midi, de travailler dehors à la chaleur du soleil hivernal, bas sur l’horizon. Dans la ville ravagée, où la boue montait parfois jusqu’à mi-corps, ce n’était pas le travail qui manquait. Prier, lire, travailler, manger, prier, dormir : telle était la chanson d’une bonne journée. Les jours s’enchaînaient dans cette heureuse succession.
Puis, vers la fin de l’hiver, il commença à suivre des cours dans une école de soufis tenue par des religieux venus du Maghreb, l’extrémité occidentale du monde qui devenait chaque jour plus puissante, s’étendant comme si elle était à la fois le Nord, avec la Franji et al-Andalus, et le Sud, avec le Sahel. Bistami et les autres étudiants lisaient et commentaient non seulement Rumi et Shams, mais aussi les philosophes ibn Sina et ibn Rachid, ainsi que le Grec de l’antiquité Aristote, et l’historien ibn Khaldun. Les Maghrébins de la madrasa n’aimaient pas tant contester des points de doctrine que se donner des nouvelles du monde ; ils connaissaient toutes sortes d’histoires narrant la réoccupation d’al-Andalus et de la Franji, et de chroniques de l’ancienne civilisation des Franjs. Ils étaient amicaux avec Bistami ; ils n’avaient pas d’opinion arrêtée à son sujet ; ils ne voyaient en lui qu’un Persan, et donc il était beaucoup plus agréable de se trouver en leur compagnie qu’en celle des Moghols de l’ambassade timouride, où on le regardait au mieux avec embarras. Bistami se dit que si rester à La Mecque pouvait être considéré comme une punition, une forme d’exil loin d’Akbar et du Sind, alors les autres Moghols qui avaient été envoyés ici devaient se demander s’ils n’étaient pas plutôt en exil qu’honorés pour leur dévotion religieuse. Voir Bistami leur rappelait cette possibilité, aussi était-il évité comme un lépreux. En conséquence de quoi il passa de plus en plus de temps à la madrasa maghrébine, et dehors, dans le khitta persan, maintenant établi un peu plus haut dans les collines au-dessus des canaux, à l’est de la ville.
L’année à La Mecque tourne presque uniquement autour du pèlerinage, de la même façon que l’islam tout entier se tourne, géographiquement, dans la direction de La Mecque. Les mois passant, tous commencèrent à se préparer, et à l’approche du ramadan, rien au monde ne compta plus que le pèlerinage. La plupart des efforts ne consistaient en rien d’autre qu’à nourrir les hordes qui déferleraient sur La Mecque. Tout un système s’était mis en place pour accomplir cet exploit formidable, impressionnant par sa taille et son efficacité, ici, dans ce coin perdu d’une péninsule désertique et à peu près sans vie. Même si, plus au sud, se trouvaient Aden et le Yémen, plus riches. Aucun doute, le système avait grandi au même rythme que le pèlerinage lui-même, pensa Bistami en cheminant le long des pâturages à présent pleins de moutons et de chèvres, tout en ressassant ses lectures d’ibn Khaldun. Il commençait à comprendre à quel point l’expansion avait été rapide : l’islam s’était étendu loin au-delà de l’Arabie dès le premier siècle après l’hégire. Al-Andalus avait été islamisée autour de l’année 100, les contrées lointaines des îles des Épices vers l’an 200, l’ensemble du monde connu avait été converti deux siècles seulement après que le Prophète eut reçu le Livre et l’eut donné au peuple de cette petite terre du milieu. Depuis, les gens venaient ici, sans cesse plus nombreux.
Un jour, Bistami et quelques autres jeunes étudiants firent à pied la route jusqu’à Médine, en récitant des prières, pour revoir la première mosquée de Mahomet. Ils passèrent devant d’innombrables enclos de chèvres et de moutons, fromageries, réserves de grains et champs de palmiers-dattiers ; puis traversèrent les faubourgs de Médine, qui se trouvait être, en dehors des périodes du haj, une bourgade délabrée, paisible et poussiéreuse. À l’ombre d’un carré de vieux palmiers, la petite mosquée aux murs blanchis à la chaux brillait comme une perle. C’est ici que le Prophète avait prêché durant son exil, et dicté la plupart des versets du Coran.
Bistami se promena dans le jardin de ce lieu saint, essayant de se représenter comment tout cela s’était passé. La lecture de Khaldun le lui avait fait comprendre ; en vérité, ces choses s’étaient produites : au début, le Prophète s’était tenu dans cette palmeraie, parlant en plein air. Plus tard, il avait pris appui contre un palmier pour parler, et quelques-uns de ses suivants lui avaient conseillé de s’asseoir sur une chaise. Il avait accepté, à la condition qu’elle fut assez basse pour qu’on ne pût pas dire qu’il revendiquait un privilège. Le Prophète, en homme véritablement parfait qu’il était, était modeste. Il avait accepté la construction d’une mosquée là où il avait enseigné, mais elle était restée sans toit pendant de nombreuses années. Mahomet avait déclaré qu’un croyant avait d’autres priorités. Ensuite, Mahomet et les siens s’en étaient retournés à La Mecque, et le Prophète avait mené lui-même vingt-six campagnes militaires : le jihad. Après cela, sa parole s’était rapidement répandue. Khaldun attribuait cette rapidité au fait que les gens étaient prêts à passer au stade de civilisation suivant, et au fait que le Coran était d’une vérité éclatante.
Pourtant, dans cette explication, quelque chose troublait Bistami. En Inde, les civilisations avaient grandi puis décliné, grandi puis décliné. L’islam avait d’ailleurs conquis l’Inde. Mais sous les Moghols les anciennes croyances indiennes avaient perduré, et l’islam lui-même avait évolué à leur contact. C’était devenu plus clair pour Bistami quand il avait étudié l’islam des origines dans la madrasa. Même si le soufisme pouvait être considéré comme autre chose qu’un simple retour aux sources – une étape, ou (pouvait-on le dire ?) une clarification, voire une amélioration. Une tentative de dépassement des oulémas. En tout cas, un changement. Il semblait qu’on ne pouvait pas l’empêcher. Tout changeait. Comme disait le soufi Junnaiyd à la madrasa, la parole divine tombe sur l’homme comme la pluie sur la terre, et donne de la boue, pas de l’eau pure. Après la grande inondation hivernale, cette image était encore plus forte et troublante. L’islam, se répandant dans le monde comme une coulée de boue, mélange d’homme et de Dieu. Cela ne ressemblait pas trop à ce qu’il avait connu dans la tombe de Chishti, ni au cours du pèlerinage, quand la Kaaba lui avait paru tourner autour de lui. Mais même son souvenir des événements changeait. Tout changeait dans ce monde.
Y compris Médine et La Mecque, dont la population augmentait rapidement à l’approche du haj, les bergers venant à la ville avec leurs troupeaux, les commerçants avec leurs marchandises – des vêtements, des articles de voyage pour remplacer ce qui avait été perdu ou cassé, des écrits religieux, des guides du haj, et ainsi de suite. Durant les derniers mois de préparation, les premiers pèlerins arrivaient, longues files de chameaux amenant des voyageurs poussiéreux et contents, le visage illuminé par ce même élan que Bistami se rappelait avoir ressenti l’année précédente, une année qui avait passé si vite – alors qu’en même temps son haj paraissait se trouver au-delà d’un profond abysse ouvert dans son esprit. Il n’arrivait pas à raviver en lui cette flamme qu’il voyait briller dans les yeux des pèlerins de cette année. Il n’était plus un pèlerin maintenant, mais un habitant, et il éprouvait un peu du ressentiment qui était celui des gens de la ville, à l’idée que son village d’habitude si paisible, une sorte de grande madrasa en fait, commençait à être envahi jusqu’aux limites de l’étouffement, comme si une grande famille de proches enthousiastes débarquaient tous en même temps. Ce n’était pas ainsi qu’il aimait à y penser, et Bistami, se sentant coupable, s’imposa une série complète de prières, de jeûne et d’aide aux arrivants, particulièrement à ceux qui étaient épuisés ou malades : il les menait aux khittas, aux kans et aux caravansérails, se lançant à corps perdu dans une sorte de routine dont il espérait qu’elle le rapprocherait de ce que vivaient les pèlerins. Mais de voir chaque jour leurs visages extatiques lui rappelait trop combien il en était loin. Ils rayonnaient d’une lumière divine, il était clair pour lui que c’était le reflet de leur âme, comme autant de fenêtres ouvertes sur un monde plus profond.
Alors il espéra que le plaisir qu’il avait à accueillir les pèlerins de la cour d’Akbar se voyait aussi sur son visage. Mais Akbar lui-même n’était pas venu, ni aucun de ses proches parents, et pas un seul des membres de ce nouveau groupe ne semblait heureux d’être là, ni de voir Bistami. Les nouvelles qui venaient de chez lui étaient très inquiétantes. Akbar s’était mis à dénigrer son ouléma. Il recevait des rajahs des Indes, et prêtait une oreille attentive à leurs problèmes. Il avait même ouvertement commencé à adorer le soleil. Il se prosternait quatre fois par jour devant un feu sacré, s’abstenait de toute viande, d’alcool, et de relations sexuelles. C’étaient des pratiques hindoues. D’ailleurs, chaque dimanche, il y initiait douze des émirs travaillant pour lui. Les néophytes plaçaient leur tête directement aux pieds d’Akbar durant cette cérémonie – une forme extrême de révérence nommée sijdah, une forme de soumission à un autre être humain qui, pour les musulmans, était un blasphème. D’autre part, il ne s’était pas empressé de financer un nouveau pèlerinage ; en fait, il avait même fallu le convaincre pour que quelques-uns y aillent. Il y avait envoyé le cheikh Abdul Nabi et Malauna Abdulla, ce qui était en fait un exil déguisé, tout comme il avait envoyé Bistami l’année d’avant. Bref, il paraissait s’éloigner de la foi. Akbar, loin de l’islam !
Et, dit brutalement Abdul Nabi à Bistami, nombreux étaient à la cour ceux qui le blâmaient, lui, Bistami, le rendant responsable de tous ces changements. Mais c’était aussi, en fait, une façon de sauver la face, et Abdul Nabi le rassura :
— Faire des reproches à quelqu’un de loin est plus facile pour tout le monde, vois-tu. Mais à présent ils croient que tu as été envoyé à La Mecque dans l’idée de te réformer. Tu n’arrêtais pas de parler de la lumière, de la lumière, alors on t’a exilé. Et maintenant, Akbar adore le soleil à la façon des zoroastriens ou des païens des temps anciens.
— Alors je ne peux pas encore rentrer, dit Bistami.
Abdul Nabi hocha la tête.
— Non seulement tu ne peux pas rentrer, mais il faut que tu le saches, même ici tu n’es pas en sécurité. Si tu t’attardes trop, les oulémas t’accuseront d’hérésie, et viendront te prendre pour te ramener et te juger. Ou même te jugeront ici.
— Tu veux dire que je devrais partir ?
Abdul Nabi hocha de nouveau la tête, lentement, gravement.
— Il existe sûrement d’autres endroits plus intéressants pour toi que La Mecque. Un cadi comme toi peut trouver un bon travail dans n’importe quel endroit dirigé par un musulman. Rien n’arrivera pendant le haj, bien sûr. Mais une fois qu’il sera fini…
Bistami l’approuva et remercia le cheikh pour son honnêteté.
De toute façon, il voulait partir. Il ne voulait pas rester à La Mecque. Il voulait retrouver Akbar, ses heures hors du temps à la tombe de Chishti, et y finir sa vie. Mais si cela n’était pas possible, il lui faudrait recommencer son tariqat, et continuer à chercher quelle était sa vraie vie. Il se rappela ce qui était arrivé à Shams quand les disciples de Rumi en avaient eu assez de voir comment il s’était entiché de ses amis. Peut-être que les gens de Fatehpur Sikri pensaient qu’Akbar avait trouvé son Shams en la personne de Bistami – ce que Bistami trouva frappant après coup. Mais ils avaient passé beaucoup de temps ensemble, plus que de raison ; et personne ne savait ce qu’ils s’étaient dit au cours de ces entretiens, à quel point c’était en fait Akbar qui donnait des cours à son maître. C’est toujours au maître d’apprendre le plus, pensa Bistami, ou bien rien de fondamental n’a eu lieu pendant l’échange.
Le reste de ce haj fut étrange. La foule paraissait énorme, inhumaine, possédée. C’était une pestilence consumant des centaines de moutons par jour, et leurs oulémas étaient des bergers, qui organisaient le cannibalisme. Bien sûr, personne ne pouvait parler de ces choses-là. On ne pouvait que répéter certaines des phrases qui leur brûlaient si profondément l’âme. Ô Lui qui est Lui, ô Lui qui est Lui, Allah le miséricordieux, le très miséricordieux. Pourquoi avoir peur ? Dieu fait se mouvoir toute chose. Il ne faisait aucun doute qu’il devrait continuer son tariqat et trouver quelque chose de plus. Après le haj, on était censé avancer.
Les religieux maghrébins étaient les plus sympathiques de tous ceux qu’il connaissait, portant l’hospitalité soufie à son summum, et exerçant une curiosité aiguë à l’égard de toute chose sur terre. Il pouvait toujours repartir vers Ispahan, bien sûr, mais il se sentait attiré plus vers l’ouest. Purifié comme il l’avait été au royaume de la lumière, il n’avait que faire de revoir la richesse des jardins d’Iran. Dans le Coran le mot qui voulait dire « Paradis » et tous les mots que Mahomet employait pour décrire le paradis venaient du persan ; alors que le mot qui désignait l’enfer, dans les mêmes sourates, venait de l’hébreu, la langue du désert. C’était un signe. Bistami ne voulait pas le Paradis. Il voulait quelque chose qu’il ne pouvait pas définir, mais qui dépassait l’homme. Si l’humain était un mélange de matériel et de divin, et si l’âme divine continuait à vivre après la mort, alors ces voyages à travers le temps devaient avoir un but, permettre de se rapprocher de ces royaumes d’existence supérieure, de telle sorte que le modèle khaldunien de cycles de dynasties, allant sans fin de la vigueur de la jeunesse à la dégénérescence sénile de la vieillesse, devait être modifié pour inclure les affaires des hommes. La notion de cycle serait donc en fait un mouvement ascendant, où la possibilité d’ajouter une nouvelle dynastie, supérieure, à la précédente était à la fois admise et recherchée. C’était ce qu’il avait envie d’enseigner, c’était ce qu’il avait envie d’apprendre. À l’ouest, en suivant le soleil, il le trouverait, et tout serait bien.
6. Al-Andalus
Où qu’il aille, il avait toujours l’impression d’être au centre du monde. Quand il était jeune, Ispahan semblait être la capitale de partout ; ensuite, cela avait été Gujarat, puis Agra, puis Fatehpur Sikri ; enfin La Mecque et la pierre noire d’Abraham, qui était le vrai cœur de toute chose. Maintenant, Le Caire lui faisait l’effet d’être la métropole ultime, d’une ancienneté impossible, poussiéreuse et immense. Les mamelouks marchaient dans les rues pleines de monde, leurs serviteurs à la remorque, des hommes puissants portant des casques à plumets, sûrs de dominer Le Caire, l’Égypte et la majeure partie du Levant. Quand Bistami les voyait, il les suivait généralement un moment, comme bien d’autres, et il s’aperçut que s’ils lui rappelaient la pompe d’Akbar, en même temps il était frappé par le fait que les mamelouks formaient une jati qui revenait à la vie à chaque génération. Rien ne pouvait être moins impérial ; il n’y avait pas de dynastie ; et en même temps ils exerçaient sur la population un contrôle plus fort que celui d’une dynastie. Il se pouvait que tout ce que Khaldun avait dit sur les cycles dynastiques soit rendu caduc par ce nouveau système de gouvernance, qui n’existait pas à son époque. Les choses changeaient, de sorte que même les plus grands de tous les historiens ne pouvaient avoir le dernier mot.
Les journées passées dans la grande et vieille cité étaient très excitantes. Mais les érudits maghrébins étaient impatients de commencer leur long voyage de retour, et c’est ainsi que Bistami les aida à préparer leur caravane. Quand ils furent prêts, il se joignit à eux pour aller vers l’ouest, sur la route de Fez.
Cette partie de la tariqat les conduisit d’abord vers le nord, puis vers Alexandrie. Ils menèrent leurs chameaux dans un caravansérail et redescendirent jeter un coup d’œil au vieux port, avec sa longue jetée incurvée qui s’avançait dans les eaux pâles de la Méditerranée. En la regardant, Bistami fut frappé par un sentiment de déjà-vu. Il attendit que cette impression passe et suivit les autres.
Alors que la caravane traversait le désert de Libye, la conversation, le soir, autour des feux, porta sur les mamelouks et Soliman le Magnifique, l’empereur ottoman qui venait de mourir. Au nombre de ses conquêtes figurait la côte qu’ils longeaient à présent. Sauf que rien ne le montrait, si ce n’est le respect appuyé que les habitants des villes et des caravansérails où ils passaient témoignaient aux fonctionnaires ottomans. Ces gens ne les ennuyaient jamais ni ne prélevaient de taxe à leur passage. Bistami vit que le monde des soufis permettait, entre autres choses, d’échapper au monde matériel. Dans chaque région de la Terre, il y avait des sultans et des empereurs, des Soliman, des Akbar et des mamelouks, tous ostensiblement musulmans, et en même temps gens du monde, puissants, capricieux, dangereux. La plupart se trouvaient dans l’état khaldunien de corruption propre aux fins de règne. Et puis il y avait les soufis. Bistami regardait ses compagnons érudits autour du feu, à la nuit tombée, disputer avec intensité d’un point de doctrine, ou de l’isnad spécieuse d’un hadith, et de sa signification. Ils discutaient avec une minutie exagérée et très peu de ces plaisanteries et de ces rodomontades typiques de ce genre de débat. Tout en parlant, ils se versaient avec une attention solennelle du café bouillant, épais, dans de petites tasses de terre cuite vernissée. Leurs yeux brillaient, reflétant les flammes, pleins du plaisir de la conversation, et Bistami se disait : Ce sont les musulmans qui font que l’islam est bon. Ce sont les hommes qui ont conquis le monde et non les guerriers. Les armées n’auraient rien pu faire sans le verbe. Des gens du monde, mais pas puissants, dévots mais pas pédants (pour la plupart en tout cas) ; des hommes intéressés par la relation directe avec Dieu, sans aucune intervention de l’autorité humaine ; proches de Dieu, mais pas séparés des hommes.
Une nuit, la conversation porta sur al-Andalus, et Bistami écouta avec un surcroît d’intérêt.
— Il doit être étrange de revenir dans une terre aussi vide que celle-ci.
— Il y a des pêcheurs et des pirates zott sur ces côtes depuis longtemps, maintenant. Même si des Zott et quelques Arméniens se sont installés dans l’intérieur des terres.
— N’est-ce pas un peu dangereux ? La peste pourrait frapper à nouveau.
— Personne ne paraît affecté.
— Khaldun prétend que la peste est une conséquence de la surpopulation, dit ibn Ezra, qui, d’eux tous, connaissait le mieux l’œuvre de Khaldun. Dans son chapitre sur les dynasties, dans la Muqaddimah, section quarante-neuf, il dit que la peste résulte de la corruption de l’air provoquée par le surpeuplement, et par la putréfaction et les moisissures pernicieuses causées par le fait que les gens vivent entassés les uns sur les autres ; les poumons sont affectés, et c’est ce qui transmet la maladie. Il faisait remarquer le paradoxe selon lequel ces choses découlent de la réussite d’une dynastie ; et c’est ainsi que la bonne gouvernance, la tolérance, la sécurité et la légèreté des impôts mènent à la croissance, et donc aux épidémies. Il dit : « Par conséquent, la science a fait apparaître la nécessité de disposer entre les zones urbaines d’espaces libres et de régions désertes. Cela supprime la corruption et la putréfaction de l’air dues au contact avec les êtres vivants, et lui permet de circuler à nouveau, assaini. » S’il a raison, eh bien – la Franji est vide depuis longtemps et l’on pourrait s’attendre à ce que l’air y soit de nouveau sain. Il ne devrait plus y avoir de risque de peste, jusqu’à ce que vienne le moment où la région sera à nouveau fortement peuplée. Mais ce ne sera pas avant longtemps.
— C’était le jugement de Dieu, dit l’un des autres lettrés. Les chrétiens ont été exterminés par Allah pour avoir persécuté les musulmans et les juifs.
— Mais al-Andalus était terre musulmane au moment de la peste, objecta ibn Ezra. Grenade était musulmane, tout le sud de l’Ibérie était musulman. Et ils sont morts, eux aussi. Comme les musulmans des Balkans, ou du moins c’est ce que dit al-Gazzabi dans son histoire des Grecs. Ce serait une question de lieu, apparemment. La Franji a peut-être été frappée parce qu’elle était surpeuplée, comme dit Khaldun, ou peut-être parce qu’il y avait trop de vallées humides qui retenaient l’air vicié. Personne ne peut le dire.
— C’est le christianisme qui est mort. C’étaient des gens du Livre, mais ils ont persécuté l’islam. Ils ont fait la guerre à l’islam pendant des siècles, et ils ont torturé à mort tous les prisonniers musulmans. Allah les a éliminés pour cela.
— Mais al-Andalus est morte elle aussi, répéta ibn Ezra. Et il y avait des chrétiens dans le Maghreb, et en Éthiopie, qui ont survécu, et en Arménie aussi. Il y a encore de petites poches de chrétiens dans ces endroits, qui vivent dans les montagnes. (Il secoua la tête.) Je ne pense pas que nous sachions jamais ce qui est arrivé. Allah est seul juge.
— C’est ce que je dis.
— Alors al-Andalus est repeuplée, reprit Bistami.
— Oui.
— Et il y a des soufis ?
— Évidemment. Il y a des soufis partout. En al-Andalus, ils dirigeaient tout, à ce que j’ai entendu dire. Ils sont partis vers le nord dans une terre encore vide, explorant et exorcisant le passé, au nom d’Allah. Prouvant que la voie était sûre. Al-Andalus était un grand jardin, à l’époque. Un bon endroit, et vide.
Bistami regarda au fond de sa tasse, sentant en lui ces deux mots se heurter et s’assembler, créant des étincelles. Bon et vide, vide et bon. C’était comme ça qu’il se sentait à La Mecque.
Bistami eut l’impression qu’il était rejeté, un derviche soufi errant, sans foyer et en recherche. Sur sa tariqat. Il veillait à rester aussi propre que le permettait le Maghreb poussiéreux, sablonneux. Il se remémorait les paroles de Mahomet à propos des gestes sacrés : pour prospérer, il fallait se laver le visage et les mains, et surtout ne jamais manger d’ail. Il jeûnait souvent, et se sentait devenir léger comme l’air, sentait que sa vision s’altérait tous les jours, passant de la clarté vitreuse de l’aube au brouillard jaune de l’après-midi, jusqu’à la semi-transparence du coucher du soleil. À ce moment, les gloires de l’or et du bronze entouraient d’un halo chaque arbre, chaque roche, chaque horizon. Les villes du Maghreb étaient petites et belles, souvent placées à flanc de colline, plantées de palmiers et d’arbres exotiques qui faisaient de chaque ville, de chaque toit, un jardin. Les maisons étaient des blocs carrés, blanchis à la chaux, nichés dans les palmes, avec des patios sur les toits et, dans les cours intérieures, des jardins frais, verts, irrigués par des fontaines. Les villes avaient été fondées aux endroits où l’eau coulait à flanc de colline. La plus grande ville se révélait être celle qui avait les sources les plus importantes : Fez, le but de leur caravane.
Bistami resta au logis soufi de Fez, puis il retourna à dos de chameau avec ibn Ezra, vers Ceuta, au nord, où ils payèrent la traversée en bateau jusqu’à Malaga. Les vaisseaux étaient plus ronds, à cet endroit, que dans la mer de Perse, avec des coques à la poupe surélevée, de plus petites voiles et des gouvernes placées au milieu. La traversée de l’étroit chenal à l’extrémité ouest de la Méditerranée était difficile, mais ils purent voir al-Andalus à partir du moment où ils quittèrent Ceuta. Le puissant courant qui s’engouffrait dans la Méditerranée, combiné avec un fort vent d’ouest, les faisait rebondir comme un bouchon sur les vagues.
La côte d’al-Andalus se révéla escarpée. Au-dessus d’une indexation dans la falaise se dressait une énorme montagne rocheuse. Au-dessous, la côte s’incurvait vers le nord. Ils prirent la brise du large dans leurs petites voiles et allèrent vers Malaga en donnant de la gîte. À l’intérieur des terres, ils voyaient une chaîne de montagnes blanches, dans le lointain. Bistami, exalté par la rudesse de la traversée, se rappela les monts Zagros vus d’Ispahan, puis eut soudain un pincement au cœur en repensant à un foyer qu’il avait presque oublié. Mais là, rebondissant sur l’océan sauvage de sa nouvelle vie, il se sentait prêt à poser le pied sur une nouvelle terre.
Al-Andalus n’était qu’un immense jardin. Arbres verts tapissant les pentes des collines, montagnes enneigées au nord, grandes étendues de terres à blé sur les plaines littorales, ronds bosquets d’arbres verts, ronds fruits orange, à la saveur si douce. Le ciel était bleu dès le lever du jour, et même quand dans sa course le soleil embrasait l’air, dans les ombres la fraîcheur demeurait.
Malaga était une jolie petite ville, bâtie autour d’un fort de pierre rugueuse et d’une grande et vieille mosquée, en cours de rénovation. De larges rues ombragées par les arbres en partaient, comme les rayons d’une roue de charrette, montant jusqu’aux collines d’où l’on dominait la Méditerranée, dont le bleu azuré butait, au sud, sur les montagnes du Maghreb, d’une sécheresse d’ossements. Al-Andalus !
Bistami et ibn Ezra trouvèrent un petit refuge, une sorte de ribat, dans une bourgade à la limite de la ville, entre des champs et des plantations d’orangers. Au petit matin, ils sortaient aider les soufis dans les orangeraies et les vignes. Puis ils se rendaient dans les champs de blé, plus à l’ouest, où ils passaient le plus clair de leur temps. Le travail dans les orangeraies était facile :
— Nous taillons les arbres pour empêcher les fruits de toucher terre, leur dit, un matin, un travailleur du ribat appelé Zeya. Comme vous le voyez. J’ai essayé diverses longueurs d’élagage, pour voir ce que faisaient les fruits, mais les arbres qu’on laisse tranquilles poussent en forme d’olive, et si vous empêchez les branches de toucher le sol, alors les fruits ne seront pas contaminés par la pourriture qui vient de la terre. Ils sont assez sensibles aux maladies, je dois dire. Les fruits attrapent la pourriture verte ou noire, les feuilles deviennent cassantes, blanches, ou marron. L’écorce se couvre d’une croûte de champignons orange ou blancs. Les coccinelles nous aident bien. Sinon, on peut aussi enfumer les arbres avec des pots de fumigation. C’est ce que nous faisons pour les protéger pendant les gelées.
— Il fait si froid que ça, ici ?
— Parfois, oui, à la fin de l’hiver. Ce n’est pas le paradis, ici, vous savez.
— Je croyais que ça l’était.
L’appel du muezzin montait du ribat. Ils tirèrent leur tapis de prière et s’agenouillèrent vers le sud-est, direction à laquelle Bistami ne s’était pas encore habitué. Ensuite, Zeya les conduisit vers un fourneau de pierre où un feu était entretenu, et leur prépara une tasse de café.
— Ça n’a pas l’air d’une terre nouvelle, remarqua Bistami en savourant son café avec bonheur.
— Cette terre a été musulmane pendant des siècles et des siècles. Elle a été dirigée par les Omeyyades depuis le deuxième siècle, jusqu’à ce que les chrétiens prennent la région, et que la peste les tue.
— Des gens du Livre, murmura Bistami.
— Oui, mais corrompus. Des tyrans cruels, pour les hommes libres comme pour les esclaves. Et qui n’arrêtaient pas de se battre entre eux. C’était le chaos, à l’époque.
— Comme en Arabie, avant le Prophète.
— Oui, exactement comme ça. Et pourtant les chrétiens avaient eux aussi l’idée d’un Dieu. Ils étaient très étranges. C’étaient des querelleurs impénitents. Ils essayaient même de diviser Dieu en trois. C’est pourquoi l’islam a prévalu. Mais après quelques siècles, la vie ici était devenue tellement facile que les musulmans aussi se sont laissé corrompre. Les Omeyyades ont perdu la partie, et aucune dynastie vraiment puissante ne les a remplacés. Il y avait plus de trente États taïfas ; et ils n’arrêtaient pas de se battre. Puis les Almoravides d’Afrique les ont envahis au cinquième siècle, et au sixième siècle les Almohades du Maroc ont évincé les Almoravides et fait de Séville leur capitale. Les chrétiens, pendant ce temps-là, avaient continué à se battre dans le Nord, en Catalogne, et par-delà les montagnes de Navarre et de Franji. Ils sont revenus et ont repris la majeure partie d’al-Andalus. Mais jamais la plus méridionale, le royaume de Nasrid, qui comprend Grenade et Malaga. Ces terres restèrent musulmanes jusqu’à la fin.
— Elles sont mortes, elles aussi, dit Bistami.
— Oui. Tout le monde est mort.
— Je ne comprends pas. Ils disent qu’Allah a puni les infidèles pour avoir persécuté l’islam, mais si c’était vrai, pourquoi aurait-Il tué aussi les musulmans de cet endroit ?
Ibn Ezra secoua la tête d’un air résolu.
— Allah n’a pas tué les chrétiens. Les gens se trompent à ce sujet.
— Mais même s’Il ne l’a pas fait, reprit Bistami, Il a permis que ça arrive. Il ne les a pas protégés. Et pourtant Allah est tout-puissant. Je ne comprends pas.
Ibn Ezra haussa les épaules.
— Enfin, c’est encore une illustration du problème de la mort et du mal dans le monde. Ce monde n’est pas le Paradis, et Allah, lorsqu’il nous a créés, nous a donné le libre arbitre. Ce monde est à nous pour que nous nous révélions dévots ou corrompus. C’est très clair, parce que Allah n’est pas seulement puissant, Il est bon aussi. Il ne peut créer le mal. Et pourtant le mal existe. Il est clair que c’est nous qui le créons. Ainsi nos destinées ne peuvent être fixées ou prédéterminées par Allah. Nous devons les forger par nous-mêmes. Et parfois nous créons le mal, par peur, par avidité, ou par paresse. C’est notre faute.
— Mais la peste…, fit Zeya.
— Ce n’était ni Allah, ni nous-mêmes. Regardez, toutes les créatures vivantes se mangent les unes les autres, et souvent les plus petites dévorent les plus grandes. La dynastie s’achève et les petits guerriers la dévorent. Ce champignon, par exemple, mange l’orange tombée à terre. Le champignon est comme une armée d’un million de petits champignons microscopiques. Je peux vous la montrer avec un verre grossissant que j’ai en ma possession. Regardez l’orange – c’est une orange sanguine, vous voyez, rouge foncé à l’intérieur. Vous avez dû les croiser pour obtenir ça, hein ?
Zeya hocha la tête.
— Vous obtenez des hybrides, comme la mule. Mais avec les plantes, vous pouvez recommencer encore et encore, jusqu’à ce que vous ayez obtenu une nouvelle orange. C’est comme ça qu’Allah nous a faits. Les deux parents mélangent leur souche dans leurs rejetons. Tous les traits sont mélangés, j’imagine, mais il n’y en a que quelques-uns de saillants. Certains sont transmis, invisibles, à la génération suivante. Enfin, disons que certaines moisissures, dans leur pain, ou même dans leur eau, se sont mélangées avec d’autres, et ont donné naissance à une nouvelle pourriture, qui leur a été fatale. Elle s’est répandue, et, étant plus forte que ses parents, elle les a supplantés. Et c’est comme ça que les gens sont morts. Peut-être qu’elle était portée par l’air, comme le pollen au printemps ; peut-être qu’avant de les tuer, elle a dormi pendant des semaines chez ceux qu’elle allait empoisonner ; peut-être même qu’elle se transmettait en respirant, ou par le contact. Et puis, c’était un poison si violent qu’elle a fini par tuer toute sa nourriture. Et elle est morte d’elle-même, parce qu’elle n’avait plus rien à manger.
Bistami regarda les quartiers d’orange qu’il tenait toujours et se sentit un peu nauséeux. Les quartiers de chair rouge sang étaient comme le sourire éclatant de la mort.
Zeya le regarda en riant.
— Allez, mangez-les ! Nous ne pouvons pas vivre comme des anges ! Tout ça s’est passé il y a plus de cent ans, et les gens sont revenus vivre ici sans problème depuis longtemps. Maintenant, nous sommes débarrassés de la peste, autant que n’importe quel autre pays. J’ai vécu ici toute ma vie. Finissez donc votre orange.
Bistami s’exécuta, songeur.
— Alors ce n’était qu’un accident.
— Oui, répondit ibn Ezra. C’est ce que je pense.
— Allah ne devrait pas permettre ça. Je trouve.
— Toutes les créatures vivantes sont libres, dans ce monde. Et puis, il se pourrait que ce n’ait pas été complètement accidentel. Le Coran nous enseigne à vivre proprement, et il se pourrait que les chrétiens aient ignoré ces lois à leurs risques et périls. Ils mangeaient du cochon, ils avaient des chiens, ils buvaient du vin…
— Nous ne pensons pas, ici, que le vin ait été un problème, dit Zeya avec un petit rire.
Ibn Ezra eut un sourire.
— Mais s’ils vivaient dans leurs caniveaux, entre les taudis et les tanneries, s’ils mangeaient du porc, touchaient des chiens, s’entretuaient comme les barbares de l’Est, s’ils se torturaient, prenaient leur plaisir avec les garçons, laissaient les corps morts de leurs ennemis suspendus aux portes des villes – s’ils faisaient tout cela, alors peut-être qu’ils ont provoqué leur propre peste, vous comprenez ce que je veux dire ? Ils ont créé les conditions qui les ont tués.
— Mais étaient-ils tellement différents des autres ? demanda Bistami en pensant aux foules et à la saleté du Caire, ou d’Agra.
Ibn Ezra haussa les épaules.
— Ils étaient cruels.
— Plus cruels que Tamerlan, le Boiteux de Fer ?
— Je ne sais pas.
— Ont-ils conquis des cités et passé tout le monde au fil de l’épée ?
— Je ne sais pas.
— C’est ce que les Mongols ont fait, et ils sont devenus musulmans. Tamerlan était musulman.
— Alors ils ont changé de coutumes. Je ne sais pas. Mais les chrétiens étaient des bourreaux. Peut-être que c’était important, peut-être que non. Toutes les créatures vivantes sont libres. Enfin, elles sont parties, maintenant, et nous sommes là.
— Et en bonne santé, globalement, fit Zeya. Évidemment, de temps en temps, un enfant a de la fièvre et meurt. Et tout le monde finit par mourir, un jour ou l’autre. Mais la vie est douce, ici. Tant qu’elle dure…
Quand les récoltes d’oranges et les vendanges furent terminées, les jours raccourcirent. Bistami n’avait pas senti ce souffle frais dans l’air depuis ses années à Ispahan. Et pourtant, en cette saison, pendant les nuits les plus froides, alors qu’on approchait du solstice d’hiver, les orangers fleurissaient : de petites fleurs enneigeaient les boules vertes des arbres. Leur odeur lui rappelait leur goût, en plus lourd, et très sucré, presque écœurant.
Dans cet air qui donnait le vertige arrivèrent des cavaliers, qui menaient une longue caravane de chameaux et de mules, suivis, dans la soirée, d’une cohorte d’esclaves à pied.
C’était le sultan de Carmona, près de Séville, dit quelqu’un ; un certain Mawji Darya. Le sultan était le plus jeune fils du nouveau calife. Il s’était querellé avec ses frères aînés, à Séville, puis à al-Majriti, et avait décampé avec sa suite dans l’intention de remonter vers le nord, à travers les Pyrénées, et de fonder une nouvelle ville. Son père et ses frères aînés dirigeaient Cordoue, Séville et Tolède, et il avait l’intention de mener son groupe hors d’al-Andalus, jusqu’à la côte méditerranéenne, sur la vieille route de Valence, puis dans l’intérieur des terres jusqu’à Saragosse, où il y avait un pont, disait-il, sur l’Èbre.
Au début de cette « hégire du cœur », comme l’appelait le sultan, une douzaine ou plus de nobles qui pensaient comme lui les avaient rejoints. Et il était devenu clair, alors que la foule bigarrée entrait dans la cour du ribat, qu’avec les familles, les amis et les suivants du jeune noble sévillan, leurs rangs s’étaient trouvés renforcés de nombreux habitants des villages et des fermes qui avaient poussé dans la campagne entre Séville et Malaga. Des derviches soufis, des commerçants arméniens, des Turcs, des juifs, des Zott, des Berbères, tous étaient représentés ; on aurait dit une caravane de marchands, ou un haj de rêve dans lequel tous les mauvais auraient été en route vers La Mecque, tous ceux qui ne deviendraient jamais hajis. Ici, il y avait une paire de nains sur des poneys, derrière, un groupe d’ex-criminels à qui on avait coupé une main ou les deux, là, des musiciens, plus loin, deux hommes déguisés en femmes. Il y avait de tout dans cette caravane.
Le sultan tendit sa large main.
— On nous appelle « la caravane des fous », comme la Nef des Fous. Nous allons voguer par-delà les montagnes vers une terre de grâce, et être les fous de Dieu. Dieu nous guidera.
De la caravane surgit sa sultane, montée sur un cheval. Elle mit pied à terre sans un regard au grand serviteur qui s’était précipité pour l’aider à descendre et rejoignit le sultan alors que Zeya l’accueillait, ainsi que les autres membres du ribat.
— Ma femme, la sultane Katima, qui vient d’al-Majriti.
La Castillane était tête nue, petite, et avait les bras minces. Sa jupe d’amazone frangée d’or balayait la poussière. L’écume d’un rang de perles retenait ses longs cheveux brillants, qui coulaient sur son dos comme des vagues noires. Elle avait le visage fin, et ses yeux bleu pâle lui conféraient un étrange regard. Elle eut un sourire pour Bistami quand on le lui présenta, et plus tard elle sourit à la ferme, et aux roues du moulin, et aux plantations d’orangers. Elle s’amusait de petites choses qu’elle était seule à voir. Les hommes commencèrent à faire de leur mieux pour être agréables au sultan, et ne le quittaient pas, afin de pouvoir rester en sa présence à elle. Bistami fit de même. Elle le regarda et dit une chose sans conséquence, d’une voix semblable à celle d’un oboe, nasale, grave. En l’entendant, il songea à ce qu’Akbar lui avait dit pendant son immersion dans la lumière : Celui que tu cherches est ailleurs.
Ibn Ezra s’inclina bien bas quand il lui fut présenté.
— Je suis un pèlerin soufi, sultane, et un humble étudiant du monde. J’ai l’intention de faire le haj, mais j’aime beaucoup l’idée de votre hégire. J’aimerais voir la Franji de mes propres yeux. J’étudie les ruines antiques.
— Des chrétiens ? demanda la sultane en braquant son regard sur lui.
— Oui, mais aussi des Romains qui les ont précédés, bien avant le Prophète. Peut-être que je pourrais faire mon haj à l’envers.
— Tous ceux qui souhaitent nous rejoindre sont les bienvenus, dit-elle.
Bistami s’éclaircit la gorge et ibn Ezra le poussa doucement en avant.
— C’est mon jeune ami Bistami, un étudiant soufi du Sind, qui faisait son haj et qui continue à présent ses études dans l’Ouest.
La sultane Katima le regarda attentivement pour la première fois, et se figea, visiblement surprise. Ses sourcils noirs, épais, se froncèrent sous l’effet de la concentration au-dessus de ses yeux pâles, et soudain Bistami vit qu’ils formaient comme deux ailes d’oiseau, cette marque qui barrait le front de sa tigresse, et lui donnait toujours l’air légèrement surpris ou perplexe, comme chez cette femme.
— Je suis heureuse de vous rencontrer, Bistami. Nous cherchons toujours à apprendre quelque chose de ceux qui étudient le Coran.
Plus tard, ce même jour, elle envoya un esclave demander à Bistami de la rejoindre pour une audience privée, dans le jardin qui lui avait été attribué pour la durée de son séjour. Bistami y alla, en tripotant sa robe avec impuissance, crasseux au-delà de toute expression.
C’était le coucher du soleil. Les nuages brillaient dans le ciel, à l’ouest, entre les silhouettes noires des cyprès. Des fleurs de citronnier embaumaient l’air, et en la voyant debout, toute seule, à côté d’une fontaine murmurante, Bistami eut l’impression d’être entré dans un endroit qu’il avait déjà vu ; pourtant tout, ici, était disposé autrement. Des points de détail, mais surtout, étrangement, terriblement familiers, comme la sensation qui l’avait brièvement envahi à Alexandrie. Elle n’était pas comme Akbar, même pas comme la tigresse, pas vraiment. Mais c’était déjà arrivé. Il prit conscience de sa respiration.
Elle le vit debout sous les arabesques formées par les arches de l’entrée, et lui fit signe d’approcher. Bistami ne pouvait ôter son regard de ses magnifiques cheveux noirs. Elle n’avait pas de voile. Elle lui sourit.
— J’espère que ça ne vous dérange pas. Je ne le mettrai jamais. Le Coran ne parle pas du voile. Seule est faite l’obligation de cacher la poitrine. Ce qui va de soi. Quant au visage, Khadijah, la femme de Mahomet, ne porta jamais le voile. Et après sa mort, les autres femmes du Prophète ne le portèrent pas non plus. Tant qu’elle vécut, il lui fut fidèle, vous savez. Si elle n’était pas morte, il n’aurait jamais épousé une autre femme, il le dit lui-même. Alors si elle ne portait pas le voile, je ne vois pas pourquoi je le ferais. Le voile est apparu avec les califes de Bagdad, qui l’ont imposé pour se distinguer des masses et des kharijites. C’était un signe de pouvoir au sein du danger, une marque de crainte. Certaines femmes sont dangereuses pour les hommes, mais pas au point de devoir se voiler la face. En réalité, quand on voit les visages, on comprend mieux que nous sommes toutes pareilles devant Dieu. Pas de voile entre Dieu et nous, c’est ce que chaque musulman a gagné par sa soumission. Vous n’êtes pas d’accord ?
— Si, répondit Bistami, encore choqué par le sentiment de déjà-vu qui l’avait submergé.
Même les formes des nuages à l’ouest lui étaient familières, à ce moment.
— Et je ne crois pas que le Coran autorise les hommes à battre leurs femmes, pas vous ? La seule allusion possible à une chose pareille se trouve dans la sourate IV, 34, qui dit : « Quant à ces femmes dont vous craignez la désobéissance, exhortez-les, reléguez-les dans leur chambre », et si horrible que ce soit, « frappez-les ». Daraba, pas darraba – qui veut vraiment dire « battre ». Daraba, lui, signifie « molester », ou même « caresser avec une plume », comme dans le poème, ou même « exciter quand on fait l’amour », vous savez, daraba, daraba. Mahomet l’a dit très clairement.
Choqué, Bistami réussit à hocher la tête. Il sentit qu’il devait avoir l’air stupéfait.
Elle s’en aperçut et lui sourit.
— C’est ce que le Coran me dit, poursuivit-elle. La sourate II, 223, dit : « Votre femme est pour vous un labour. Alors traitez-la comme vous traiteriez votre ferme. » Les oulémas ont relevé ce passage comme s’il signifiait que l’on pouvait traiter les femmes comme la crotte que l’on a sous ses babouches ; mais ces docteurs de la loi, qui se dressent en intercesseurs superflus entre Dieu et nous n’ont jamais été des fermiers ; or les fermiers lisent bien le Coran, et voient dans leurs femmes leur nourriture, leur boisson, leur travail, le lit dans lequel ils se reposent la nuit, la terre même sous leurs pieds ! Oui, évidemment, vous traitez votre femme comme la terre sous vos pieds ! Rendez grâce à Dieu pour nous avoir donné le saint Coran et toute sa sagesse.
— Louanges à Dieu, dit Bistami.
Elle le regarda et éclata de rire.
— Vous pensez que je vais trop loin.
— Pas du tout.
— Oh, mais je vais loin, croyez-moi. Je vais très loin. Mais n’êtes-vous pas d’accord avec ma lecture du saint Coran ? N’ai-je pas été fidèle à la moindre de ses phrases, comme une bonne épouse est fidèle à chacun des mouvements de son mari ?
— C’est ce qu’il me semble, sultane. Je pense que le Coran… dit très clairement que nous sommes tous égaux devant Dieu, et donc, les hommes et les femmes aussi. Il y a des hiérarchies en toute chose, mais chaque membre de cette hiérarchie est égal devant Dieu, et cela seul compte. C’est ainsi que celui qui est en haut et celui qui est en bas, sur cette Terre, doivent avoir de la considération l’un pour l’autre, puisqu’ils partagent la même foi. Frères et sœurs dans la foi, peu importe que l’on soit calife ou esclave. D’où toutes les règles coraniques concernant la relation à l’autre, et les devoirs, même d’un empereur vis-à-vis du dernier de ses esclaves, ou de l’ennemi qu’il a capturé.
— Le saint livre des chrétiens contenait très peu de règles, dit-elle, suivant son propre train de pensées.
— Je ne le savais pas. Vous l’avez lu ?
— Un empereur vis-à-vis du dernier de ses esclaves, avez-vous dit. Il y a des règles même pour ça. Et pourtant, personne ne choisirait d’être esclave plutôt qu’empereur. Les oulémas ont déformé le Coran avec tous leurs hadiths, abondant toujours dans le sens de ceux qui avaient le pouvoir. Résultat : le message que Mahomet avait si clairement énoncé, sous la dictée de Dieu, a été inversé, et les bonnes musulmanes ont été à nouveau réduites en esclavage, voire pire. Pas tout à fait comme du bétail, mais déjà moins que des hommes. La femme est à son mari ce que l’esclave est à l’empereur, et non plus son féminin, son contre-pouvoir, son égale.
Elle était très animée à présent, et il voyait ses joues empourprées, même dans la maigre lueur de la fin du jour. Ses yeux étaient si pâles qu’on aurait dit de petits lacs tombés du ciel crépusculaire. Puis des serviteurs apportèrent des torches, ce qui accentua sa rougeur et embrasa ses yeux pâles. Il y lisait beaucoup de colère, une colère intense, mais Bistami n’avait jamais vu une telle beauté. Il la regardait, essayant de fixer ce moment dans sa mémoire, se disant : Tu n’oublieras jamais cet instant, tu n’oublieras jamais cet instant !
Après un long silence, Bistami comprit que s’il ne disait rien, la conversation serait terminée.
— Les soufis, dit-il, parlent souvent du rapport direct à Dieu. C’est une question d’illumination. J’ai… j’en ai personnellement fait l’expérience, dans un moment de paroxysme. Pour les sens, c’est comme se trouver dans la lumière ; pour l’âme, c’est l’état de baraka, la grâce divine. Et c’est valable pour tout le monde également.
— Mais quand ils disent « tout le monde », les soufis veulent-ils dire « les femmes » aussi ?
Il réfléchit à cela. Les soufis étaient des hommes, c’était vrai. Ils formaient une fraternité, ils voyageaient seuls et restaient dans des ribats ou des zawiyas, ces logis où il n’y avait pas de place pour les femmes ; s’ils étaient mariés, ils étaient soufis, et leurs femmes étaient femmes de soufis.
— Ça dépend de l’endroit où vous vous trouvez, temporisa-t-il. Et quel maître soufi vous suivez.
Elle le regarda avec un petit sourire, et il s’aperçut qu’il avait fait un mouvement sans s’en rendre compte, dans ce jeu destiné à lui permettre de rester auprès elle.
— Mais une femme ne saurait être un professeur soufi, dit-elle.
— Eh bien non. Parce qu’ils dirigent parfois les prières.
— Et une femme ne saurait diriger la prière ?
— Eh bien, fit Bistami, choqué. Je n’ai jamais entendu parler d’une chose pareille.
— De même qu’un homme n’a jamais enfanté.
— Exactement.
Gros soulagement.
— Mais les hommes ne peuvent avoir d’enfants, souligna-t-elle. Alors que les femmes pourraient très bien diriger les prières. Au harem, je les dirige tous les jours.
Bistami ne sut que répondre. Il était encore sous le choc de cette idée.
— Et les mères disent toujours à leurs enfants comment prier.
— Oui. C’est vrai.
— Avant Mahomet, les Arabes adoraient des déesses, vous savez.
— Des idoles.
— Enfin, c’était l’idée. Les femmes sont des puissances dans le royaume de l’âme.
— Oui.
— Ce qui est là-haut doit se retrouver ici-bas. C’est vrai en toutes choses.
Elle fit un pas vers lui, soudain, et mit la main sur son bras nu.
— Oui, dit-il.
— Nous avons besoin de spécialistes du Coran pour nous accompagner dans le Nord, pour nous aider à déblayer le Coran des toiles d’araignées qui l’obscurcissent et pour nous enseigner l’illumination. Voulez-vous venir avec nous ? Le ferez-vous ?
— Oui.
7. La caravane des fous
Le sultan Mawji Darya était presque aussi beau et raffiné que sa femme, et tout aussi enclin qu’elle à parler de ses idées, qui la plupart du temps tournaient autour de la convivencia. Ibn Ezra avait dit à Bistami que c’était un sujet très en vogue chez les jeunes nobles d’al-Andalus : recréer l’âge d’or du califat des Omeyyades du sixième siècle, à l’époque où les dirigeants musulmans avaient autorisé les juifs et les chrétiens à vivre et prospérer parmi eux, et où ils avaient, tous ensemble, créé la merveilleuse civilisation qu’avait été al-Andalus, avant l’Inquisition et la peste.
Alors que la caravane, dans sa splendeur fanée, quittait Malaga, ibn Ezra en dit plus long à Bistami sur cette période, dont Khaldun n’avait que brièvement parlé, et les religieux de La Mecque et du Caire pas du tout. Les juifs andalous, en particulier, avaient bien réussi, traduisant bon nombre de textes du grec ancien en arabe, en y incluant leurs propres commentaires, et en faisant d’intéressantes découvertes dans les domaines de la médecine et de l’astronomie. Les religieux musulmans andalous avaient utilisé ce qui leur était désormais accessible de la logique grecque, principalement d’Aristote, pour défendre la doctrine de l’islam avec toute la force de la raison – ibn Sina et ibn Rachid étant les deux plus importants d’entre eux. Ibn Ezra ne cessait de louer leurs travaux.
— J’espère les poursuivre à la mesure de mes maigres moyens, si Dieu le veut, en portant une attention toute particulière à la nature et aux ruines du passé.
Ils s’abandonnèrent au rythme de la caravane, qui leur était désormais familier. À l’aube : alimenter les feux de camp, moudre le café, nourrir les chameaux. Empaqueter et charger, faire avancer les chameaux. Leur colonne s’étirait sur plus d’une lieue, de nombreux groupes s’égrenant à l’arrière, les rattrapant, s’arrêtant, revenant ; la plupart avançaient lentement. L’après-midi, ils dressaient le camp ou s’arrêtaient à un caravansérail, même si, à mesure qu’ils montaient vers le nord, ils ne trouvaient le plus souvent que des ruines. C’est tout juste s’il y avait encore une route. Elle était envahie par des arbres plus que centenaires, aux troncs épais comme des tonneaux.
Le magnifique paysage qu’ils traversaient était bordé par des chaînes de montagnes, entre lesquelles s’étendaient de larges plateaux. Tout en avançant, Bistami sentit qu’ils se rendaient dans un espace supérieur, où les couchers de soleil projetaient de longues ombres sur un monde plus vaste, plus noir et plus venteux. Un soir, alors qu’un dernier éclat de lumière crevait les nuages bas et lourds, Bistami entendit quelque part dans le camp un musicien jouer de l’oboe, sculptant dans l’air une longue, une interminable mélodie, plaintive, poignante, qui s’enroulait sur elle-même. La chanson de ce plateau à la fin du jour, son âme même, aurait-on dit. La sultane se tenait à la limite du campement, écoutant avec lui, sa fine tête tournée comme celle d’un faucon, elle regardait le soleil se coucher. Il tombait à la vitesse exacte du temps lui-même. Toute parole était inutile dans ce monde chantant, si vaste, si noué. Aucun esprit humain ne pourrait jamais en faire le tour, même la musique ne faisait que l’effleurer, et encore, cet aperçu ils ne le comprenaient pas – ils ne faisaient que le sentir. L’univers tout entier était hors de leur portée.
Et pourtant, et pourtant, parfois, comme en cet instant, au crépuscule, dans le vent, nous avons, grâce à un sixième sens dont nous ignorons jusqu’à l’existence, des aperçus de ce monde plus vaste – larges pans de signification cosmique, un sens du sacré qui s’étend à tout, par-delà les sens, la pensée ou même les sentiments –, ce monde visible qui est le nôtre, illuminé de l’intérieur, vibrant de réalité.
La sultane eut un mouvement. Les étoiles brillaient dans le ciel indigo. Elle marcha jusqu’à l’un des feux. Elle l’avait choisi comme cadi, se dit Bistami, pour donner une dimension supplémentaire à ses propres idées. Une communauté comme la leur avait besoin d’un professeur soufi plutôt que d’un simple religieux. Elle avait été une élève studieuse, disaient les gens, et avait traversé des crises à peu près trois années auparavant. Elle en était sortie changée.
Bien, cela s’éclaircirait le moment venu. En attendant, la sultane ; le son de l’oboe ; le vaste plateau. Ces choses n’arrivent qu’une fois.
La force de cette sensation le frappa aussi violemment que le sentiment d’attente qu’il avait éprouvé dans le jardin du ribat.
Alors que les plateaux s’offraient à la chaleur du soleil, les fleuves creusaient de profonds ravins dans le sol, comme les wadis du Maghreb, mais s’écoulant toujours.
Les fleuves étaient larges, et les traverser n’était pas simple. La ville de Saragosse s’était développée autrefois grâce à son grand pont de pierre, qui permettait de franchir l’un des plus grands fleuves, appelé l’Èbre. Maintenant, la ville était à peu près déserte. On n’y croisait que des marchands ambulants, quelques vendeurs et bergers, regroupés près du pont, dans des maisons de pierre dont on aurait dit que le pont lui-même les avait bâties, dans son sommeil. Le reste de la ville avait disparu, envahi par les pins et les broussailles.
Mais le pont était toujours là. Il était fait de pierres levées, de gros blocs carrés, lisses, qu’on aurait dits biseautés, si étroitement joints qu’on n’aurait pu glisser une pièce, ou même l’ongle, entre eux. Les piliers campés sur chaque rive étaient de massives tours de pierre, reposant sur des lits de roche, dit ibn Ezra. Il les étudia avec beaucoup d’intérêt alors que la fin de la caravane le traversait pour aider à monter les tentes de l’autre côté. Bistami regarda le croquis qu’il en avait fait.
— C’est beau, n’est-ce pas ? On dirait une équation. Sept arches semi-circulaires, avec une plus grande au milieu, à l’endroit où le lit du fleuve est le plus profond. Tous les ponts romains que j’ai vus respectent l’harmonie du lieu où ils ont été bâtis. Ils ont très souvent ces arches semi-circulaires, qui donnent sa force à la structure, mais qui ne sont pas très longues. Et c’est pour cela qu’il y en a tant. Ils sont toujours appareillés en moellons – tu vois ces pierres carrées ? Ainsi, elles s’appuient les unes sur les autres, et rien ne peut les faire bouger. Il n’y a pas de magie là-dedans. Nous pourrions en faire autant, en nous creusant un peu la tête. Le seul véritable problème, c’est de protéger les fondations des crues. J’en ai vu quelques-uns de vraiment bien construits, avec des piles à sabot de fer, sombrer au fond du fleuve. Si quelque chose doit disparaître, c’est bien les fondations. Quand ils ont essayé de les monter plus vite, grâce à d’énormes quantités de pierres, ils pavèrent le lit du fleuve pour le préparer à recevoir les lourdes piles du pont.
— Là d’où je viens, les ponts s’affaissent comme un rien, dit Bistami. Les gens en construisent un autre, et voilà.
— Oui, mais ceux-ci sont bien plus beaux. Je me suis toujours demandé s’ils avaient écrit comment ils faisaient. Je n’ai jamais vu de livres sur leurs ponts. Les bibliothèques que l’on trouve par ici sont très mauvaises. Rien que des livres de comptes, avec l’inévitable rayon d’ouvrages pornographiques. Si jamais il y a eu quoi que ce soit d’autre, on s’en est servi pour allumer le feu. De toute façon, les pierres racontent l’histoire. Tu vois, elles ont été si bien taillées qu’ils n’ont pas eu besoin de mortier. Les agrafes de fer que tu vois çà et là ont sans doute servi d’amarres aux échafaudages.
— Dans le Sind, les Moghols sont de grands bâtisseurs, dit Bistami en pensant à la perfection avec laquelle se joignaient les pierres dans la tombe de Chishti. Mais ils font surtout des forts et des temples. Leurs ponts sont généralement en bambous, jetés sur des piles de pierre.
Ibn hocha la tête.
— On en voit beaucoup comme ça. Mais peut-être que ce fleuve ne déborde pas si souvent. Ce pays a l’air aride.
Dans la soirée, ibn Ezra leur montra une petite maquette des palans que les Romains avaient sûrement utilisés pour déplacer les plus grosses pierres : des cordes et des trépieds. Le sultan et la sultane constituaient son principal public, mais nombreux étaient ceux qui assistaient à sa démonstration, tandis que d’autres déambulaient à la lueur des torches. Ils posaient des questions à ibn Ezra, faisaient des commentaires ; ils se regroupèrent quand le chef de la cavalerie du sultan, Sharif Jalil, s’approcha du cercle avec deux de ses cavaliers, qui en encadraient un troisième, accusé de vol. Apparemment, pas pour la première fois. En entendant le sultan discuter de son cas avec Sharif, Bistami comprit que l’accusé avait une réputation sulfureuse, pour des raisons qu’ils connaissaient mais dont ils ne voulaient pas parler – sans doute aimait-il un peu trop les petits garçons. Une appréhension proche de la terreur saisit Bistami, qui se rappela quelques scènes de Fatehpur Sikri ; l’application stricte de la charia voulait que l’on coupât la main aux voleurs. Quant aux hommes convaincus de sodomie, ce vice infâme des croisés chrétiens, ils étaient mis à mort.
Mais Mawji Darya se contenta de s’approcher de l’homme et le fit s’agenouiller en le tirant par l’oreille, comme s’il punissait un enfant.
— Tu n’as que faire ici. Tu nous as rejoints à Malaga, et la seule chose qui te reste à faire, c’est de travailler honnêtement pour gagner ta place dans la cité.
La sultane hocha la tête en entendant ces paroles.
— Si nous le voulions, reprit le sultan, nous aurions le droit de te punir d’une façon que tu n’apprécierais probablement pas. Va demander à nos pauvres manchots, si tu ne me crois pas ! Ou bien nous pourrions simplement t’abandonner ici, on verrait bien comment tu te débrouillerais avec les autochtones. Les Zott n’aiment pas que les autres fassent comme eux. Ton cas serait vite expédié. À présent je t’avertis, c’est ce qui t’arrivera si Sharif te ramène encore une fois devant moi. Tu seras chassé de ta famille. Crois-moi (il regarda ostensiblement sa femme), tu le regretteras.
L’homme marmonna quelque chose d’une voix geignarde (Bistami vit qu’il était soûl) et ses gardes l’éloignèrent. Le sultan dit à ibn Ezra de continuer à leur parler des ponts romains.
Plus tard, Bistami rejoignit la sultane dans la grande tente royale, et vit à quel point leur cour était ouverte à tous.
— Pas de voiles, dit Katima sèchement. Pas d’izar, ni de hijab, le voile qui séparait le calife de son peuple. Le hijab a été le premier pas vers le despotisme du calife. Mahomet n’a jamais voulu ça, jamais. Il avait fait de la première mosquée une réunion d’amis. Tout le monde avait accès à lui, tout le monde parlait librement. Cela aurait pu durer toujours, la mosquée aurait pu devenir le lieu de… d’une autre voie. Où les hommes et les femmes auraient parlé tous ensemble. C’était ce que Mahomet avait commencé à construire, et qui sommes-nous pour changer ce qu’il avait entrepris ? Pourquoi suivre les traces de ceux qui construisent des barrières et deviennent des tyrans ? Mahomet voulait que ce soit le sentiment de groupe qui prédomine, et que la personne qui les mènerait ne soit guère plus qu’un hakam, un arbitre. C’était le titre qu’il aimait le plus et dont il était le plus fier, le savais-tu ?
— Oui.
— Mais à son départ pour le ciel, Muawya établit le califat et posta des gardes dans les mosquées pour se protéger. Depuis, c’est la tyrannie. L’islam est passé de la soumission au joug, et les femmes ont été bannies des mosquées et de la place qui leur revenait. C’est une perversion de l’islam !
Le rouge lui était monté aux joues, et elle avait parlé en s’efforçant de contenir son émotion. Bistami n’avait jamais vu une telle ferveur ni une telle beauté habiter un visage. Il arrivait à peine à penser ; ou plutôt, il était plein de pensées diverses et contradictoires, et, lorsqu’il cherchait à se concentrer sur l’une d’elles, le flot des suivantes l’assaillait et le laissait tout tremblant ; incapable de poursuivre la pensée affluente, à peine capable de laisser couler en lui tous les courants de ses pensées en même temps.
— Oui, dit-il.
Elle s’éloigna à grands pas vers le feu, et s’assit subitement en tailleur dans un grand remous de robes, parmi les manchots à qui l’on avait pour certains coupé les deux mains. Ils l’accueillirent joyeusement et lui offrirent à boire en lui tendant une coupe, qu’elle but avidement, avant de la reposer et de dire à l’un d’eux :
— Allons, il faut vraiment que je m’occupe de toi. Ça ne va pas du tout…
Ils poussèrent un tabouret dans sa direction. Elle s’assit, pendant que le manchot s’agenouillait devant elle, lui présentant son large dos. Elle prit le peigne qu’on lui tendait, une fiole d’huile, et commença à démêler les longs cheveux de l’homme. L’étrange équipage de leur nef des fous s’approcha d’elle, et l’entoura avec bonheur.
Au nord de l’Èbre, la caravane cessa de grossir. Il y avait moins de villes sur la vieille route du Nord, et elles étaient plus petites, composées de récentes colonies maghrébines, de Berbères qui avaient traversé la mer depuis Alger, ou même Tunis. Ils faisaient pousser de l’orge et des concombres, menaient paître les moutons et les chèvres dans la longue vallée fertile encadrée d’un côté de crêtes rocailleuses, et de l’autre par la Méditerranée. C’était la Catalogne, un très beau pays, avec de nombreuses forêts sur les collines. Ils avaient laissé les États taïfas derrière eux, au sud. Les gens d’ici étaient contents ; ils ne ressentaient pas le besoin de suivre un sultan soufi détrôné et sa caravane bigarrée, jusqu’aux Pyrénées, puis dans la Franji sauvage. De toute façon, ainsi que l’avait indiqué ibn Ezra, la caravane n’avait pas de quoi nourrir plus de monde, ni d’or ou d’argent pour acheter plus de vivres qu’ils n’en avaient déjà acheté au cours du voyage.
Ils continuèrent donc sur la vieille route et, au terme d’une longue vallée qui allait en s’étrécissant, atteignirent un vaste plateau sec et rocheux, menant vers les contreforts boisés d’une chaîne de montagnes formée d’une roche plus noire que celle de l’Himalaya. La route montait en serpentant sur la partie basse du plateau incliné, ouvrant une blessure dans les montagnes rocailleuses qui se dressaient devant eux. Juste au-dessous ruisselait un mince filet d’eau dans le lit d’une rivière presque à sec. À présent, ils ne rencontraient plus âme qui vive, ils campaient sous la tente ou à la belle étoile, et s’endormaient, bercés par le bruit du vent dans les arbres, le clapotement des ruisseaux, et les chevaux qui renâclaient, attachés par les harnais. Finalement, la route qui sinuait entre les rochers s’aplanit, traversa une première passe rocailleuse, une prairie entourée de pics, puis un col étroit bordé de hautes parois de granit, avant de redescendre. Par rapport à la passe de Khyber, ce n’était pas si difficile, pensa Bistami. Mais bien des gens dans la caravane tremblaient de peur.
De l’autre côté de la montagne, des éboulis de roches avaient recouvert à plusieurs reprises l’ancienne route, ne laissant, à chaque fois, qu’un étroit chemin pour les ânes, qui tournait à angles droits pour éviter les rochers. La route était difficile, et la sultane dut souvent mettre pied à terre, menant ses femmes sans complaisance ni pour les incapables ni pour celles qui se plaignaient. Elle savait trouver des mots cruels quand elle était énervée. Cruels et durs.
Ibn Ezra inspectait la route, le soir quand ils s’arrêtaient, et les éboulis, quand ils passaient tout près, faisant des croquis de tous les traits saillants du paysage : les terre-pleins, les corniches, les ravines.
— C’est typique des Romains, dit-il un soir auprès du feu alors qu’ils mangeaient du mouton rôti. Ils ont littéralement quadrillé les terres bordant la Méditerranée avec leurs routes. Je me demande si celle-ci était la route principale pour traverser les Pyrénées… Je ne crois pas, c’est beaucoup trop à l’ouest. Elle mène à l’océan de l’Ouest plutôt qu’à la Méditerranée. Mais c’est sûrement la route la plus commode. Il est difficile de ne pas croire que c’est la route principale. Elle est si large.
— Elles sont peut-être toutes comme ça, dit la sultane.
— Peut-être. Ils ont sans doute utilisé des objets comme ces chariots que l’on a retrouvés ; il fallait donc que leurs routes soient plus larges que les nôtres. Les chameaux, bien évidement, n’ont pas besoin de routes. Ou bien c’était vraiment leur route principale. C’était peut-être la route qu’Hannibal avait empruntée pour attaquer Rome, avec son armée de Carthaginois et ses éléphants ! J’ai vu ces ruines, au nord de Tunis. C’était une très grande ville. Mais Hannibal a perdu, Carthage a perdu, et les Romains ont saccagé leur ville et répandu du sel dans leurs champs, asséchant le Maghreb. Plus de Carthage.
— Alors les éléphants ont peut-être emprunté cette route, dit la sultane.
Le sultan considéra gravement la piste, secouant la tête d’un air songeur. C’était le genre de choses que l’un et l’autre aimaient savoir.
En redescendant de la montagne, ils atteignirent un pays plus froid. Le soleil de midi dégagea les pics des Pyrénées, mais à peine. C’était un pays gris et plat, et souvent drapé dans le brouillard. L’océan s’étendait à l’ouest, gris, sauvage et froid, niellé par les vagues.
La caravane atteignit un fleuve qui se jetait dans cette mer. Au bord de l’eau se dressaient les ruines d’une ancienne cité. En approchant, ils virent quelques bâtiments plus petits, nouveaux, des cabanes de pêcheurs apparemment, de part et d’autre d’un pont de bois récent.
— Voyez à quel point nous sommes moins adroits que les Romains, dit ibn Ezra tout en se dépêchant vers ce nouvel ouvrage pour l’observer de plus près.
— Il me semble que cette ville s’appelait Bayonne, dit-il à son retour. J’ai trouvé une inscription sur ce qui reste de la tour du pont, là-bas. La carte indique qu’il y avait une ville encore plus grande, un peu plus au nord, appelée Bordeaux. Au bord de la mer.
Le sultan secoua la tête.
— Nous sommes allés assez loin. Ça ira. De l’autre côté des montagnes, mais à une journée de marche seulement d’al-Andalus. C’est tout à fait ce que je voulais. Nous nous établirons ici.
La sultane Katima l’approuva, et la caravane entreprit le long processus de la colonisation.
8. Baraka
Dans l’ensemble, ils construisirent en amont, à partir des ruines de l’ancienne ville, récupérant les matériaux jusqu’à ce qu’il ne reste plus grand-chose des bâtiments originels, en dehors de l’église – une vaste grange de pierre, dépouillée de toutes ses idoles et de ses images. Ce n’était pas une très belle construction, comparée aux mosquées du monde civilisé. Ce n’était qu’un vulgaire rectangle, massif, trapu, mais de grande taille et situé en hauteur, au-dessus d’une anse du fleuve. C’est ainsi qu’après en avoir discuté avec tous les membres de la caravane, ils décidèrent d’en faire leur grande mosquée, ou mosquée du Vendredi.
Les modifications commencèrent immédiatement. Ce projet devint la principale tâche de Bistami, et il passa beaucoup de temps avec ibn Ezra, décrivant ce dont il se souvenait du mausolée de Chishti et des autres grands bâtiments de l’empire d’Akbar, se penchant sur les croquis d’ibn Ezra afin de voir ce qu’on pouvait faire pour que la vieille église ressemble davantage à une mosquée. Ils s’accordèrent à dire qu’il fallait ouvrir le toit, par lequel on voyait déjà le ciel en de nombreux endroits, et conserver les murs. Ceux-ci serviraient de base à une mosquée circulaire, ou plutôt en forme d’œuf, avec un dôme. La sultane voulait qu’on agrandisse la place sur laquelle donnait la cour de prière, en témoignage de la qualité universelle de leur version de l’islam. Bistami fit de son mieux pour lui complaire, bien que tout indiquât que cette région était pluvieuse, et qu’il y neigerait peut-être même en hiver. Ce n’était pas grave ; le lieu de culte se prolongerait de la grande mosquée sur une place, puis dans la cité au sens large et, par extension, dans le monde entier.
Ibn Ezra conçut joyeusement des échafaudages, des hottes de maçons, des charrettes, des entretoises, des étais, du ciment et ainsi de suite ; et il détermina, d’après les étoiles et les cartes dont ils disposaient, la direction de La Mecque, qui serait indiquée non seulement par le mirab, mais aussi par l’orientation de la mosquée elle-même. Le reste de la ville se déplaça vers la grande mosquée, toutes les pierres des vieilles ruines furent réutilisées pour la nouvelle construction alors que les gens s’installaient de plus en plus près. Les saupoudrages d’Arméniens et de Zott qui vivaient là, dans la ville dévastée, avant leur arrivée, se joignirent à leur communauté, ou s’en allèrent vers le nord.
— Nous devrions garder un espace près de la mosquée pour une madrasa, dit ibn Ezra. Avant que les habitations n’occupent tout le quartier.
Le sultan Mawji pensait que c’était une bonne idée, et il ordonna à ceux qui s’étaient installés près de la mosquée, alors qu’ils y travaillaient, de se déplacer. Certains des ouvriers protestèrent et refusèrent en bloc. Tout net. Lors d’une réunion, le sultan perdit son sang-froid et menaça d’expulser ce groupe de la ville, bien qu’en fait il n’eût sous ses ordres qu’une toute petite garde personnelle – à peine suffisante pour le défendre, d’après Bistami. Celui-ci se rappelait les immenses cavaleries d’Akbar, les soldats des mamelouks ; le sultan n’avait rien de comparable. Il avait affaire à une ou deux douzaines de mornes récalcitrants, dont il n’y avait rien à tirer. L’âme de la caravane, son esprit d’ouverture, était menacée.
Mais la sultane Katima arriva, montée sur sa jument arabe, se laissa glisser à terre et s’approcha du sultan. Elle posa la main sur son bras et lui dit quelque chose qu’il fut seul à entendre. Il eut l’air surpris, sembla réfléchir à toute allure. La sultane jeta un regard farouche aux récalcitrants. C’était une rebuffade tellement amère que Bistami se sentit frémir ; pour rien au monde il n’aurait pris le risque de s’attirer un regard pareil de sa part. Et en vérité, les mécréants blêmirent et baissèrent les yeux, honteux.
— Mahomet nous a dit que le savoir était ce que Dieu espérait de mieux pour l’humanité, dit-elle. La mosquée est le cœur de l’apprentissage, la maison du Coran. La madrasa est une extension de la mosquée. Il doit en être ainsi dans toute communauté musulmane, si l’on veut connaître Dieu plus intimement. Et il en sera de même ici. Évidemment.
Elle conduisit alors son mari à l’écart, vers le palais qui se trouvait de l’autre côté du vieux pont de la cité. Au milieu de la nuit, les gardes du sultan revinrent, sabre au clair, brandissant des piques, pour chasser les indésirables et les disperser ; mais la zone était déjà vide.
Ibn Ezra hocha la tête, soulagé, en apprenant la nouvelle.
— À l’avenir, nous devrons nous y prendre bien à l’avance si nous voulons éviter ce genre de conflit, dit-il tout bas à Bistami. Cet incident sert peut-être la réputation de la sultane, d’une certaine façon, mais à quel prix.
Bistami ne voulait pas y réfléchir.
— Au moins, maintenant, nous aurons une mosquée et une madrasa côte à côte.
— Ce sont les deux parties d’une même chose, comme disait la sultane. Surtout si l’étude du monde sensible fait partie du programme de la madrasa. Ce que j’espère. Je ne peux supporter qu’un tel endroit ne serve qu’à de simples dévots. Dieu nous a placés dans ce monde pour le comprendre ! C’est ce que nous pouvons faire de mieux pour Le remercier, comme disait ibn Sina.
Cette petite crise fut bientôt oubliée, et la nouvelle ville, que la sultane appela Baraka – ce qui voulait dire « grâce », ainsi que le lui avait dit Bistami –, prit forme comme si Dieu lui-même en avait dessiné les plans. Tout y était évident. Les ruines de la vieille ville disparaissaient sous les rues, les places, les jardins et les ateliers de la nouvelle cité ; l’architecture et le plan de la ville ressemblaient à ceux de Malaga et des autres villes de la côte d’al-Andalus, sauf que ses murs étaient plus hauts, et ses fenêtres plus petites, car les hivers y étaient plus froids, et qu’un vent âpre soufflait de l’océan en automne comme au printemps. Le palais du sultan était le seul bâtiment de Baraka aussi ouvert et élancé qu’une construction méditerranéenne. Cela rappelait aux gens leur origine et leur montrait que le sultan se trouvait au-dessus des contraintes de la nature. De l’autre côté du pont, les places, les rues et les ruelles étaient petites de sorte que, le long du fleuve, une médina ou une casbah se développa. C’était, comme dans toutes les villes maghrébines ou arabes, un véritable dédale de maisons, de deux étages pour la plupart et dont les fenêtres du haut se faisaient face par-delà des ruelles tellement étroites qu’on pouvait, comme on le disait partout, se passer le sel et le poivre d’une fenêtre à l’autre par-dessus la rue.
La première fois qu’il neigea, tout le monde se précipita sur la place de la grande mosquée, après avoir enfilé plusieurs couches de vêtements. Un grand feu de joie fut allumé, le muezzin appela à la prière, on se mit à prier, les musiciens du palais jouèrent, les lèvres bleuies, les doigts gourds, et les gens dansèrent comme des soufis autour du feu de joie. Des derviches tourneurs dans la neige : tout le monde rit à ce spectacle, sentant qu’ils avaient amené l’islam dans un nouvel endroit, un nouveau climat. Ils faisaient un nouveau monde ! Il y avait tout le bois qu’on voulait dans les forêts encore inexplorées, au nord, et du poisson et du gibier à profusion. Ils avaient chaud, ils avaient à manger. En hiver, la vie continuait, sous une mince couverture de neige fondante, humide, comme s’ils vivaient dans les montagnes les plus hautes. Le fleuve déroulait son long estuaire dans l’océan gris, les vagues déferlaient sur la plage avec une férocité implacable, dévorant en un instant les flocons de neige tombés dans les vagues. Ils étaient chez eux.
Un jour, au printemps, une autre caravane arriva, pleine d’étrangers et de tout ce qu’ils avaient en ce bas monde. Ils avaient entendu parler de Baraka, et voulaient s’y installer. C’était une autre nef des fous, partie de colonies arméniennes et zott établies en Castille et au Portugal, dont les tendances criminelles paraissaient évidentes, à voir le nombre important de mains coupées, d’instruments de musique, de marionnettistes et de diseuses de bonne aventure.
— Je suis surpris qu’ils aient réussi à franchir les montagnes, dit Bistami à ibn Ezra.
— La nécessité les a rendus inventifs, sans nul doute. Al-Andalus est un endroit dangereux pour ces gens-là. Il paraît que le frère du sultan est un calife des plus sévères, d’une pureté quasi almohade. La forme d’islam qu’il fait respecter est si pure que je ne crois pas qu’on en ait jamais vu de telle, même au temps du Prophète. Non, cette caravane est faite de gens en fuite. Comme l’était la nôtre.
— Un sanctuaire, dit Bistami. C’est ainsi que les chrétiens appellent un endroit où ils sont à l’abri. Généralement leurs églises, ou la cour d’un roi. Comme certains des ribats soufis, en Perse. C’est une bonne chose. Les braves gens viennent vous voir quand la loi devient trop dure.
C’est ainsi qu’ils vinrent. Certains étaient des apostats ou des hérétiques, et Bistami débattit avec eux dans la mosquée même, s’efforçant, tout en parlant, de créer une atmosphère dans laquelle toutes les questions pouvaient être discutées librement, sans que l’on ait l’impression qu’un danger planait au-dessus de votre tête – il existait, mais il était lointain, de l’autre côté des Pyrénées –, et sans que rien de blasphématoire envers Dieu ou Mahomet soit proféré. Peu importait que l’on soit sunnite ou chiite, arabe ou andalou, turc ou zott, homme ou femme ; ce qui comptait, c’était la dévotion, et le Coran.
Il était intéressant pour Bistami de constater que ce difficile exercice d’équilibre religieux devenait de plus en plus facile au fur et à mesure qu’il s’y livrait – comme s’il se livrait à un effort physique, sur une crête ou une haute muraille. Défi à l’autorité du calife ? Voir ce que le Coran en disait. Ignorer les hadiths qui avaient encroûté le saint Livre, et l’avaient si souvent déformé : couper à la source. Là, les messages pourraient être ambigus, ils l’étaient souvent ; mais le Livre était venu à Mahomet après bien des années, et les concepts importants y étaient généralement répétés, chaque fois de façon légèrement différente. Ils en effectuaient une lecture comparée, et commentaient les différences.
« Quand j’étudiais à La Mecque, les vrais lettrés disaient… » C’était là toute l’autorité que Bistami revendiquait : il avait entendu parler les vraies autorités. C’était la méthode du hadith, évidemment, mais avec un contenu différent : on ne pouvait se fier au hadith ; seulement au Coran.
« Je parlais de cette question avec la sultane… » C’était entre elle et lui toujours le même enjeu. De fait, il s’entretenait avec elle d’à peu près toutes les questions qui se présentaient, et systématiquement des problèmes relatifs aux femmes ou à l’éducation des enfants. En ce qui concernait la vie familiale, il s’en remettait à son jugement à elle, auquel il apprenait à se fier de plus en plus alors que les années passaient. Elle connaissait le Coran sur le bout des ongles, et avait mémorisé toutes les sourates qui étayaient son point de vue sur les excès de la hiérarchie, et la protection des plus faibles – qui était sa priorité. Elle parlait à l’œil et au cœur, où qu’elle aille, et à la mosquée plus que partout ailleurs. Personne ne mettait plus en cause son droit à s’y trouver, et même parfois à diriger la prière. Il aurait paru anormal, dans la mosquée d’une ville appelée Baraka, d’entraver la démarche d’une telle personne, si pleine de grâce divine. Comme elle le disait si bien : « N’est-ce pas Dieu qui m’a faite ? Ne m’a-t-Il pas donné un esprit et une âme aussi vastes que ceux de n’importe quel homme ? Les enfants des hommes ne sont-ils pas nés d’une femme ? N’accorderiez-vous pas à votre propre mère une place au ciel ? Quelqu’un qui n’aurait pas été admis dans la contemplation de Dieu ne pourrait-il quand même gagner son ciel ? »
Quiconque répondait par la négative ne restait pas longtemps à Baraka. D’autres villes s’installèrent en amont et au nord du fleuve, des villes peuplées d’Arméniens et de Zott, moins habités par la ferveur musulmane. Un bon nombre des sujets du sultan s’en allèrent au fil du temps. Néanmoins, il y avait toujours plus de monde à la grande mosquée. Ils en construirent de plus petites dans les faubourgs, qui ne cessaient de s’étendre, autour des mosquées de quartier habituelles – mais la mosquée du Vendredi restait toujours le lieu de rencontre de la cité. Toute la population se retrouvait sur la place et dans l’enceinte de la madrasa les jours fériés, pour les fêtes, pour le ramadan, et le premier jour de neige, tous les ans, quand on allumait le feu de joie de l’hiver. Baraka était alors comme une seule famille, dont la sultane Katima était la mère et la sœur.
La madrasa grandissait aussi vite que la ville, sinon plus. Tous les printemps, quand la neige avait fondu sur les routes de montagne, de nouvelles caravanes arrivaient, guidées par des montagnards. Dans chaque groupe, certains étaient venus étudier à la madrasa, qui était devenue célèbre pour les recherches d’ibn Ezra sur les plantes et les animaux, les Romains, les techniques de construction et les étoiles. Ceux qui venaient d’al-Andalus amenaient parfois avec eux les copies des livres qu’ibn Rachid ou Maïmonide venaient de retrouver, ou les nouvelles traductions arabes des Grecs anciens, et ils amenaient aussi le désir de partager leurs connaissances et d’en apprendre davantage. La convivencia avait son cœur à la madrasa de Baraka, et l’information se répandait.
Et puis, un jour funeste, à la fin de la sixième année de l’hégire de Baraka, le sultan Mawji Darya tomba gravement malade. Il avait beaucoup grossi depuis quelques mois, et ibn Ezra avait tenté de s’improviser son médecin, l’astreignant à un régime strict de lait et de céréales qui avait paru lui donner un regain d’énergie et meilleure mine. Mais, une nuit, il s’était senti mal. Ezra était allé tirer Bistami du lit :
— Viens ! Le sultan est tellement malade qu’il a besoin de prières !
Cette injonction d’ibn Ezra était mauvais signe en vérité, car il n’était pas du genre à inciter à prier pour un oui ou pour un non. Bistami le suivit en courant et rejoignit la famille royale dans son aile du palais. La sultane Katima était blême, et Bistami fut choqué de voir à quel point son arrivée la rendait malheureuse. Elle n’avait rien contre lui personnellement, mais elle savait pourquoi ibn Ezra était allé le chercher à cette heure. Elle se mordit la lèvre et détourna les yeux, le visage baigné de larmes.
Dans sa chambre, le sultan se tordait de douleur. Incapable de prononcer une parole. On n’entendait que sa respiration, lourde, haletante. Il avait le visage rouge brique.
— A-t-il été empoisonné ? demanda Bistami à l’oreille d’ibn Ezra.
— Non, je ne crois pas. Leur goûteur va bien, fit-il en indiquant le gros chat qui dormait, roulé en boule dans sa corbeille. À moins que quelqu’un ne l’ait piqué avec une aiguille empoisonnée. Mais je n’en vois aucun signe.
Bistami resta auprès du sultan malade, qui se tournait et se retournait dans son lit, et prit sa main brûlante. Le sultan n’eut pas le temps d’articuler un mot. Il poussa un faible gémissement, se cambra. Il avait cessé de respirer. Ibn Ezra lui croisa les bras sur la poitrine et appuya fortement dessus en grognant lui-même. En vain ; le sultan était mort, son corps encore noué par son dernier spasme. La sultane éclata en sanglots, essaya de le ranimer, l’appela, appela Dieu et implora ibn Ezra de poursuivre ses efforts. Il fallut aux deux hommes un certain temps pour la convaincre que tout était fini ; ils avaient échoué. Le sultan était mort.
Les rites funéraires de l’islam remontaient à une époque très reculée. Selon la tradition, les hommes et les femmes se réunissaient séparément pour la cérémonie, et ne se retrouvaient brièvement qu’au cimetière, pour l’inhumation.
Mais évidemment, comme c’étaient les premières funérailles d’un sultan de Baraka, la sultane mena elle-même la population sur la place de la grande mosquée, où elle avait ordonné que le corps restât exposé. Bistami ne pouvait faire autrement que de suivre la foule et de se tenir devant elle pour réciter les vieilles prières rituelles comme si elles avaient toujours dû être annoncées aux hommes et aux femmes, en même temps. Et pourquoi pas ? Certains passages n’avaient de sens que s’ils étaient lus à tous les membres de la communauté ; et soudain, en regardant les visages hâves, désolés, des habitants, il comprit que la tradition était mauvaise, qu’elle était évidemment dans l’erreur. Oui, il était cruel de couper la communauté en deux au moment même où elle aurait eu besoin de se voir réunie. Il avait toujours adhéré aux idées de la sultane, et n’avait jamais remis en cause le fait qu’elle avait toujours raison. Cependant, jamais encore il n’avait si puissamment pris conscience de la nature anticonformiste de ses sentiments, et cela l’ébranla. Là, devant le cercueil de son sultan bien-aimé, il rappela à la population que les heures où le soleil brillait sur nos vies étaient comptées. Il prononça les paroles de ce sermon impromptu d’une voix rauque, déchirante, qui lui fit l’impression de venir d’une autre gorge. La même que pendant ces éternelles journées d’une autre vie, où il récitait le Coran sous le nuage de la colère d’Akbar. C’était trop à la fois, et il se mit à pleurer, incapable de continuer à parler. Les gémissements reprirent. Tous, sur la place, pleuraient, et beaucoup se frappaient, se livrant au rituel d’autoflagellation qui permettait d’évacuer une partie de la douleur.
La ville entière suivit le cortège, la sultane Katima le menant sur sa jument baie. La foule rugissait son chagrin comme la mer roulait les galets de la plage. Ils enterrèrent le sultan de telle sorte qu’il dominât le vaste océan gris, et après cela, tout ne fut plus que cendres et crêpes noirs pendant de longs mois.
En fait, ils ne devaient plus jamais ressortir de cette année de deuil. Ce n’était pas que la mort de leur chef ; c’était aussi que la sultane continuait à régner, seule.
Bien sûr, Bistami et tous les autres auraient dit que la sultane Katima était la véritable souveraine depuis le début, et que le sultan n’était que son époux gracieux et bien-aimé. C’était vrai, sans aucun doute. Mais maintenant, quand la sultane Katima de Baraka entrait dans la grande mosquée et prononçait les prières du Vendredi, Bistami se sentait mal à l’aise et voyait que les gens de la ville l’étaient également. Katima avait ainsi parlé de nombreuses fois dans le passé, mais à présent tous ressentaient l’absence de l’aile protectrice de leur sultan bien-aimé, désormais de l’autre côté du fleuve.
Ce malaise se communiqua à Katima, évidemment, et ses discours devinrent plus stridents et plus plaintifs.
— Dieu veut l’égalité dans le mariage. Ce que le mari peut être, la femme peut l’être aussi : dans la période de chaos qui précédait l’an un, au moment zéro, les hommes traitaient les femmes comme des animaux domestiques. Dieu parla par l’intermédiaire de Mahomet et dit clairement que les femmes étaient des âmes égales à celles des hommes, et devaient être traitées comme telles. Elles reçurent de Dieu de nombreux droits spécifiques, en matière d’héritage, d’éducation des enfants, de divorce, de libre arbitre… Avant la première hégire, avant l’an un, au beau milieu de ce chaos tribal de meurtres et de vols, cette société de singes, Dieu dit à Mahomet de changer tout ça. Il dit : Oh oui, évidemment, vous pouvez épouser plus d’une femme, si vous le voulez – si vous pouvez y arriver sans querelles. Puis le verset suivant dit : Mais ça ne peut pas être fait sans querelles ! Qu’est-ce donc, sinon une condamnation de la polygamie en deux parties, énoncée sous la forme d’une énigme ou d’une leçon, pour des hommes qui sans cela n’y auraient jamais pensé par eux-mêmes ?
Mais à présent, il était tout à fait clair qu’elle essayait de changer la façon dont les choses marchaient, la façon dont l’islam marchait. Évidemment, ils avaient tous essayé, depuis le début – mais en secret, peut-être, sans l’avouer à personne, sans se l’avouer à eux-mêmes. Maintenant, ils étaient confrontés au changement, représenté sous les traits de leur seule dirigeante, une femme. Il n’y avait pas de reines dans l’islam. Aucun des hadiths ne s’appliquait plus.
Bistami, qui s’efforçait désespérément de l’aider, fit ses propres hadiths – en leur fournissant des isnads plausibles mais fallacieux, les attribuant à d’anciennes autorités soufies inventées de toute pièce, à leur sultan, Mawji Darya, ou encore à un vieux soufi persan dont il avait entendu parler. Parfois, même, il laissait entendre que c’étaient des éléments de sagesse trop communs pour avoir besoin d’être attribués à un auteur quelconque. La sultane en faisait tout autant, en suivant son exemple (croyait-il), mais elle s’abritait généralement derrière le Coran, retournant de façon obsessionnelle aux sourates qui étayaient ses positions.
Mais tout le monde savait comment les choses marchaient en al-Andalus, et au Maghreb, et à La Mecque, et de fait partout, d’un bout à l’autre du Dar al-islam, de la rive de l’océan occidental à celle de l’océan oriental (qui, disait à présent ibn Ezra, étaient les deux rives d’un même océan, occupant la majeure partie de la Terre, laquelle était un globe essentiellement couvert d’eau). Les femmes ne dirigeaient pas la prière. Quand la sultane le faisait, cela restait choquant, et triplement depuis que le sultan n’était plus là. Tout le monde le disait : si elle voulait continuer sur ce chemin, il fallait qu’elle se remarie.
Mais elle ne donnait pas l’impression d’y songer. Elle portait les voiles noirs du deuil, se tenait à l’écart de tout le monde, et n’avait pas d’échanges avec quelque personne de sang royal que ce soit. En dehors de Mawji Darya, l’homme en compagnie de qui elle avait passé le plus de temps était Bistami lui-même. Quand il comprit les regards que certains, en ville, lui jetaient, regards qui impliquaient qu’il pourrait éventuellement épouser la sultane et les tirer de ce mauvais pas, il se sentit comme ivre, la tête légère, presque nauséeux. Il l’aimait tant qu’il ne pouvait s’imaginer marié à elle. Ce n’était pas ce genre d’amour. Il ne pensait pas qu’elle puisse l’imaginer non plus, alors il n’était pas question d’avancer l’idée – idée qui était à la fois séduisante et terrifiante, et en fin de compte pénible à l’extrême. Une fois, elle parla à ibn Ezra en présence de Bistami, l’interrogeant sur sa théorie au sujet de l’océan au bord duquel ils étaient.
— Vous dites que c’est le même océan que celui que voient les habitants des Moluques et de Sumatra, de l’autre côté du monde ? Comment serait-ce possible ?
— Le monde est assurément un globe, répondit ibn Ezra. Il est rond comme la lune, ou comme le soleil. Une boule, une sphère. Nous sommes ici à l’extrémité occidentale du monde. De l’autre côté du globe se trouve le bout du monde oriental. Et cet océan couvre le reste, vous comprenez.
— Alors nous pourrions aller en bateau jusqu’à Sumatra ?
— En théorie, oui. Mais j’ai essayé de mesurer la taille de la Terre, en partant des calculs effectués par les Grecs anciens, par Brahmagupta, en Inde du Sud, et de mes observations du ciel. Je ne puis en être sûr, mais je crois qu’elle doit faire environ dix mille lieues de circonférence. Brahmagupta disait cinq mille yogandas, ce qui fait à peu près la même distance, si j’ai bien compris. Quant à la masse de terre émergée, du Maroc aux Moluques, je l’estime à cinq mille lieues. Donc, si cet océan que nous contemplons couvre la moitié du monde, il fait cinq mille lieues ou davantage. Aucun vaisseau ne pourrait effectuer la traversée.
— Vous êtes sûr qu’il est aussi vaste que ça ?
Ibn Ezra agita la main comme un bateau sur la mer en signe d’incertitude.
— Je n’en suis pas absolument certain, sultane. Mais je pense que ça doit faire à peu près ça.
— Et les îles ? Cet océan ne peut sûrement pas être complètement vide sur cinq mille lieues ! Il doit forcément y avoir des îles !
— Sans aucun doute, sultane. Je veux dire, ça paraît vraisemblable. Des pêcheurs, que des tempêtes ou des courants avaient entraînés loin vers l’ouest, ont rapporté être tombés sur des îles. Mais ils ne disent pas à quelle distance de la côte, ni dans quelle direction.
— Alors nous pourrions peut-être prendre la mer et trouver les mêmes îles, ou d’autres pareilles ? risqua la sultane, pleine d’espoir.
Ibn Ezra fit à nouveau voguer sa main sur un océan imaginaire.
— Eh bien ? dit-elle âprement. Ne pourrait-on pas construire un vaisseau capable de voguer aussi loin ?
— C’est possible, sultane. Mais l’armer pour un voyage aussi long… Nous ne savons même pas combien de temps il durerait.
— Ça, reprit-elle d’un ton sombre, il se pourrait que nous soyons obligés de le découvrir. Le sultan étant mort, et comme je n’ai personne avec qui me remarier… (elle jeta un coup d’œil à Bistami) il y aura en al-Andalus des méchants pour songer à nous prendre le pouvoir.
Cette nuit-là, Bistami se tourna et se retourna dans son lit en revoyant encore et encore ce bref regard. C’était un coup de poignard dans le cœur. Mais que pouvait-il faire ? Comment devait-il négocier une situation pareille ? Il ne ferma pas l’œil de la nuit.
Parce qu’un mari aurait été bien utile. L’harmonie avait quitté Baraka, et on avait sûrement eu vent de la situation de l’autre côté des Pyrénées, parce que, tôt au début du printemps suivant – alors que les fleuves étaient encore gros et les montagnes déchiquetées toutes blanches –, des cavaliers descendirent la route des collines au sud, amenant avec eux un froid orage, venu de l’océan : une longue colonne de cavaliers, en fait, avec des étendards de Tolède et de Grenade qui claquaient au vent, des épées et des lances au côté, luisant dans le soleil. Ils entrèrent à cheval sur la place de la mosquée, au centre de la ville, arborant toutes leurs couleurs sous les nuages qui s’amoncelaient. Ils pointèrent leurs lances devant eux. Leur chef était l’un des frères aînés du sultan, Said Darya. Il se dressa sur ses étriers d’argent, de sorte qu’il dominait le peuple assemblé, et dit :
— Nous réclamons cette ville au nom du calife d’al-Andalus, afin de la sauver de l’apostasie, et de la sorcière qui a jeté un sort sur mon frère et l’a tué dans son lit.
La foule, qui grossissait à chaque instant, regardait hébétée les cavaliers. Certains des villageois avaient la face rouge et les lèvres pincées, d’autres avaient l’air contents, la plupart semblaient troublés ou maussades. Une partie de la racaille de la Nef des Fous déterrait déjà les pavés de la place.
Bistami vit tout cela depuis l’avenue qui menait au fleuve, et, tout d’un coup, quelque chose dans cette vision le frappa vivement ; ces lances et ces arcs, pointés vers le centre de la place : c’était comme le piège à tigre, en Inde ; et ces gens étaient comme les Bagh-mari, le clan de tueurs de tigres professionnels qui parcourait le pays et débarrassait les gens des tigres qui leur posaient problème moyennant espèces sonnantes et trébuchantes. Il les avait déjà vus ! Et pas seulement avec la tigresse, mais avant cela, une autre fois. Il ne se souvenait plus quand, mais il s’en souvenait quand même : une embuscade, un piège mortel, les hommes poignardant Katima alors qu’elle était grande et qu’elle avait la peau noire – oui, tout cela était déjà arrivé !
Pris de panique, il traversa en courant le pont qui menait au palais. La sultane Katima se dirigeait vers son cheval pour aller affronter les envahisseurs, mais il s’interposa. Furieuse, elle tenta de l’écarter, alors il passa son bras autour de sa taille, aussi mince que celle d’une jeune fille, ce qui leur causa un grand choc à tous les deux, et il s’écria :
— Non, non, non, non, non ! Non, sultane ! Je vous en prie, je vous en supplie, n’y allez pas ! Ils vont vous tuer, c’est un piège ! J’ai déjà vu ça ! Ils vont vous tuer !
— Il faut que j’y aille, dit-elle, les joues empourprées. Le peuple a besoin de moi…
— Non, il n’a pas besoin de vous ! Il a besoin de vous vivante ! Nous pouvons encore partir, les nôtres pourraient nous suivre ! Ils nous suivront ! Nous devons laisser la ville aux envahisseurs, les bâtiments ne sont rien, nous pouvons partir pour le Nord, votre peuple nous suivra ! Écoutez-moi, écoutez-moi ! (Il la prit par les épaules et la serra très fort, la regardant droit dans les yeux.) J’ai déjà vu tout ça. Je sais. Nous devons fuir, ou nous allons nous faire tuer !
De l’autre côté du fleuve, ils entendaient des cris. Les cavaliers d’al-Andalus n’avaient pas l’habitude de voir résister une population sans armée, sans cavaliers, et ils chargeaient dans les rues la foule qui leur lançait des pierres en fuyant. Les Barakis étaient fous de rage. Il était évident que ceux à qui on avait coupé une main se battraient jusqu’à la mort pour leur sultane. Ce ne serait pas aussi facile que les envahisseurs le pensaient. La neige tourbillonnait dans l’air noir, les flocons fuyaient, portés par le vent qui tombait des nuages gris planant sur leurs têtes. Des incendies avaient éclaté dans la ville. Le quartier qui entourait la grande mosquée commençait à brûler.
— Venez, sultane ! Il n’y a pas de temps à perdre. J’ai déjà vu comment ça se passait, ils seront sans pitié, ils viennent vers le palais, nous devons partir tout de suite ! C’est déjà arrivé ! Nous pourrons bâtir une nouvelle cité dans le Nord, nous ne partirons pas seuls, nous formerons une caravane et nous recommencerons, nous nous défendrons comme il faut !
— Très bien ! s’écria soudain Katima en regardant la ville en flammes, de l’autre côté du pont.
Le vent soufflait par rafales, leur apportant les cris de la ville.
— Maudits soient-ils ! Maudits soient-ils ! Eh bien, prenez un cheval ! Venez, venez tous ! Nous avons une longue route à faire !
9. Encore une rencontre dans le bardo
Et c’est ainsi que, bien des années plus tard, après être allés au nord et avoir fondé la ville de Nsara, à l’embouchure de la Lawiyya, après l’avoir victorieusement défendue contre les sultans taïfas d’al-Andalus, et avoir jeté les prémices d’une puissance maritime qui s’en allait pêcher dans toutes les mers et commercer bien au-delà, ils se retrouvèrent dans le bardo. Bistami était tout content. Katima et lui ne s’étaient pas mariés, cette question n’ayant plus été évoquée, mais il avait été le principal ouléma de Nsara pendant de nombreuses années, et avait contribué grandement à l’instauration de la légitimité religieuse de cette nouveauté : une reine dans l’islam. Katima et lui avaient travaillé à ce projet quasiment tous les jours de leur vie.
— Je t’avais reconnue ! rappela-t-il à Katima. Au milieu de la vie, à travers le voile de l’oubli, quand il l’a fallu, j’ai vu qui tu étais, et toi – tu as vu quelque chose aussi. Tu as su qu’une réalité supérieure était à l’œuvre ! Nous avançons !
Katima ne répondit pas. Ils étaient assis sur les dalles de pierre d’un vaste endroit dégagé qui ressemblait un peu au tombeau de Chishti, à Fatehpur Sikri, sauf que la place était beaucoup, beaucoup plus grande. Les gens faisaient la queue pour entrer dans le mausolée et y être jugés. On aurait dit des hajis en route pour la Kaaba. Bistami pouvait entendre la voix de Mahomet à l’intérieur, qui en louait certains, en admonestait d’autres. « Tu dois essayer encore », dit à quelqu’un une voix comme celle de Mahomet. Tout était calme et atténué. C’était peu avant l’aube, il faisait froid et humide, l’air était plein de lointains chants d’oiseaux. Assis là, à ses côtés, Bistami voyait bien pourquoi Katima n’était pas comme Akbar. Akbar avait très certainement été renvoyé à quelque royaume inférieur, et devait à présent hanter la jungle à la recherche de sa nourriture, comme Katima dans sa précédente existence, quand elle était une tigresse, une tueuse qui était malgré tout devenue l’amie de Bistami. Elle l’avait sauvé des rebelles hindous, puis l’avait fait partir du ribat en al-Andalus :
— Tu m’avais également reconnu, dit-il. Et nous connaissions tous les deux ibn Ezra, qui inspectait en cet instant le mur de la cour, faisant glisser le bout de son ongle sur le joint entre deux blocs de pierre, admirant l’appareillage cyclopéen du bardo. Nous avançons vraiment, répéta Bistami. Nous arrivons finalement à quelque chose !
Katima lui jeta un regard sceptique.
— Tu appelles ça avancer ? Se retrouver acculés dans un trou perdu au bout du monde ?
— Mais qu’est-ce que ça peut faire, l’endroit où on était ? On s’est reconnus, tu n’as pas été tuée…
— Génial.
— C’était génial ! J’ai vu à travers le temps, j’ai senti le doigt de l’éternel posé sur moi. Nous avons construit un endroit où les gens pouvaient aimer le bien. De petits pas, vie après vie ; et à la fin, nous serons là pour de bon, dans la lumière blanche.
Katima fit un geste. Son beau-frère, Said Darya, venait d’entrer dans le palais du jugement.
— Regarde-le, quel pauvre type ! Et pourtant, il n’a pas été jeté en enfer, il n’est pas non plus devenu un ver, ou un chacal, comme il le méritait. Il va retourner dans le royaume des hommes et semer de nouveau la ruine et la désolation. Lui aussi fait partie de notre jati, tu l’as reconnu ? Tu savais qu’il faisait partie de notre petite troupe, comme ibn Ezra d’ailleurs ?
Ibn Ezra s’assit non loin d’eux. La file s’avança, et ils avancèrent avec elle.
— Les murs sont solides, dit-il. Très bien construits, en fait. Je ne vois pas comment nous pourrions nous échapper.
— Nous échapper ! s’écria Bistami. Fuir le jugement de Dieu ! Personne ne peut échapper à ça !
Katima et ibn Ezra échangèrent un regard. Ibn Ezra dit :
— Mon sentiment est que n’importe quelle avancée dans la teneur de l’existence devra être anthropogénique.
— Quoi ? s’écria Bistami.
— Cela ne dépend que de nous. Personne ne nous aidera.
— Je ne dis pas ça. Même si Dieu aide toujours ceux qui l’appellent à l’aide. Mais cela dépend de nous, c’est ce que je me tue à vous dire depuis le début, et nous faisons de notre mieux, nous avançons.
Katima n’était pas convaincue.
— On verra, dit-elle. Le temps le dira. Pour l’instant, et en ce qui me concerne, je réserve mon jugement.
Elle regarda la tombe blanche, se redressa telle une reine, et dit avec un sourire assez carnassier :
— Et personne ne me juge.
Elle eut un geste hautain de la main, en direction de la tombe.
— Ceci ne compte pas. Ce qui compte, c’est ce qui se passe sur Terre.
LIVRE 3
CONTINENTS OCÉANIQUES

Dans la trente-cinquième année de son règne, l’empereur Wanli tourna son œil enfiévré, perpétuellement insatisfait, vers Nippon. Dix ans plus tôt, le général nippon Hideyoshi avait eu l’audace de tenter la conquête de la Chine, et comme les Coréens lui avaient refusé le passage, son armée avait envahi la Corée en guise de préambule. Il avait fallu à une grande armée chinoise trois ans pour chasser l’envahisseur de la péninsule coréenne, et les vingt-six millions d’onces d’argent que cela avait coûté à l’empereur Wanli avaient sérieusement écorné son trésor ; suffisamment pour qu’il ne s’en remette jamais. L’empereur était enclin à venger cette agression injustifiée (jetant un voile pudique sur les deux assauts malheureux de Kublaï Khan sur Nippon), et à prévenir ainsi tout futur danger pouvant survenir de Nippon, en l’assujettissant à la souveraineté de la Chine. Hideyoshi était mort, et Ieyasu, le chef du nouveau shogunat Tokugawa, avait réussi à unir tous les territoires nippons sous son commandement, et donc fermé le pays aux étrangers. Les Nippons n’étaient pas autorisés à quitter le pays, et ceux qui le faisaient n’avaient pas le droit de revenir. La mise en chantier de navires capables de prendre la haute mer était également interdite. L’empereur Wanli constata amèrement que cela n’empêchait pas des hordes de pirates nippons de venir attaquer les longues côtes de la Chine, à bord d’embarcations plus petites. Il interpréta la retraite d’Ieyasu comme un signe de faiblesse et, en même temps, trouvait intolérable qu’un tel pays, véritable forteresse abritant de puissants guerriers, si près de ses côtes, échappât à son contrôle. Le Wanli avait envie de remettre ce bâtard de la culture chinoise à sa place, sous le contrôle du Trône du Dragon, aux côtés de la Corée, d’Annam, du Tibet, de Mindanao, et des îles des Épices.
Ses conseillers considéraient son plan avec scepticisme. D’abord, les caisses étaient vides. Ensuite, la cour Ming avait déjà été fortement affectée par de récents problèmes, comme la défense de la Corée, ou encore les terribles dissensions causées par la crise de la succession, momentanément réglée par la décision du Wanli de prendre son fils aîné comme successeur et de bannir son fils cadet dans les provinces. Mais tout cela pouvait changer d’un jour à l’autre. Par ailleurs, autour de cette situation hautement explosive, autant qu’une guerre civile en préparation, orbitaient tous les conflits et les manœuvres des puissants de la cour : la mère de l’empereur, l’impératrice, les hauts fonctionnaires, les eunuques et les généraux. Il y avait quelque chose dans le mélange d’intelligence et de tergiversation du Wanli, son mécontentement permanent et ses accès occasionnels de furie vengeresse, qui faisait de la fin de son règne un inextricable et éprouvant nœud d’intrigues. Ses conseillers, et plus particulièrement les généraux et les directeurs du Trésor, considéraient que la conquête de Nippon était tout sauf faisable.
Fidèle à lui-même, l’empereur insistait pour que cela soit fait.
Ses généraux en chef vinrent donc le trouver, pour lui proposer d’autres options, qui – espéraient-ils – étaient de nature à le satisfaire. Ils proposèrent que les diplomates de l’empereur signassent un traité avec de petits shoguns nippons, en l’occurrence avec les daïmios Tozawa, qui étaient tombés en disgrâce auprès d’Ieyasu parce qu’ils ne s’étaient ralliés à lui qu’après sa victoire militaire à Sekigahara. Le traité stipulerait que les petits shoguns inviteraient les Chinois à venir s’établir dans l’un de leurs ports, et l’ouvriraient en permanence au commerce. La marine chinoise viendrait alors s’installer dans ce port, qui deviendrait de facto territoire chinois, défendu par la puissante marine chinoise, qui avait beaucoup grandi durant le règne du Wanli, préoccupé par les nombreuses attaques des pirates. La plupart des pirates étaient originaires de Nippon, cette manœuvre comportait donc un semblant de justice. Cela fournissait en outre l’occasion de commercer avec Nippon. Après quoi, ce port pourrait servir de camp de base à une conquête par phases successives. Ce qui était envisageable.
Le Wanli s’offusqua de la façon dont ses conseillers répondaient à ses désirs. Il la jugeait par trop mesurée et couarde ; c’étaient de vraies manières d’eunuques. Mais ses plus fidèles conseillers plaidèrent si bien en faveur de ce plan que le Wanli finit par l’accepter. Un traité fut signé en secret avec un seigneur local, Omura, qui invita la Chine à s’installer et à commercer dans un village de pêcheurs aux eaux poissonneuses appelé Nagasaki. Les préparatifs de la force qui devait venir s’y installer commencèrent dans les chantiers navals de Longjiang, reconstruits non loin de Nanjing, également sur la côte cantonaise. Les énormes bateaux de la flotte des envahisseurs furent remplis d’assez de victuailles pour permettre aux troupes de débarquement de soutenir un long siège, et se rassemblèrent pour la première fois au large de la côte de Taiwan, sans que personne à Nippon, sauf Omura et ses conseillers, se doutât de rien.
La flotte était, sur ordre direct du Wanli, placée sous le commandement d’un certain amiral Kheim, un Annamite. Cet amiral avait déjà commandé une flotte pour l’empereur, quand il avait fallu soumettre Taiwan, quelques années plus tôt, mais il était toujours considéré par la bureaucratie et les militaires chinois comme un étranger, un spécialiste de la guerre contre les pirates, qui avait gagné ses galons dans sa jeunesse en étant pirate lui-même, pillant la côte du Fujian. L’empereur Wanli ne s’en préoccupait pas, et trouvait même que c’était un atout pour Kheim ; il avait besoin de quelqu’un qui obtienne des résultats, et s’il ne venait pas de la bureaucratie militaire, et si les manœuvres de la cour et des provinces lui étaient étrangères, eh bien tant mieux.
La flotte prit la mer dans la trente-huitième année du Wanli, au troisième jour du premier mois. Les vents printaniers soufflaient du nord-ouest depuis huit jours, et la flotte prit position dans le Kuroshio, « le Courant Noir », ce grand courant océanique de plus d’une centaine de lis de large, qui file jusqu’aux longues côtes sud des îles nippones.
C’était ce qui était prévu. Ils étaient en route lorsque les vents tombèrent. Pas un souffle d’air. On ne voyait pas un seul oiseau, et les voiles de papier de la flotte pendaient mollement, les vergues battant les mâts du seul fait des ondoiements du Kuroshio, qui les conduisit au nord-est, au-delà des principales îles nippones, au-delà d’Hokkaido, dans le désert immense du Dahai, le Grand Océan. Cette étendue de bleu sans terre à l’horizon était traversée par leur invisible mais puissant Courant Noir, qui les menait sans faillir vers l’est.
L’amiral Kheim ordonna à tous les capitaines des Huit Grands Navires et des Dix-Huit Plus Petits Bateaux de monter sans tarder à son bord, afin d’en débattre. Beaucoup des marins les plus expérimentés de Taiwan, d’Annam, du Fujian et de Canton se trouvaient parmi eux. Ils avaient la mine grave. Il était dangereux de se voir entraînés par le Kuroshio. Tous avaient entendu des histoires d’épaves prisonnières du courant, démâtées par un coup de vent ou qui avaient dû abattre leurs mâts pour éviter de chavirer, et qui avaient disparu pendant des années – neuf dans une histoire, trente dans une autre – au terme desquelles elles étaient revenues, dérivant, du sud-est, spectrales et vides, ou menées par des équipages de squelettes. Ces histoires, ainsi que le témoignage de première main du médecin du navire amiral, I-Chin, qui prétendait avoir parcouru l’intégralité du Dahai dans sa jeunesse à bord de l’épave d’un bateau de pêche malmené par un typhon, les conduisirent à se dire qu’il existait probablement un grand courant circulaire qui faisait le tour de la vaste mer, et que s’ils pouvaient rester assez longtemps en vie, ils rentreraient chez eux après l’avoir suivi tout du long.
Ce n’était pas une décision qu’ils auraient prise de gaieté de cœur, mais, au point où ils en étaient, ils n’avaient pas le choix. Les commandants étaient assis dans la cabine de l’amiral et se regardaient les uns les autres, mécontents. Beaucoup des Chinois, ici, connaissaient la légende de Hsu Fu, l’amiral de l’ancienne dynastie Han, qui était parti avec sa flotte à la recherche de nouvelles terres où s’établir, de l’autre côté du Dahai, et dont on n’avait plus jamais entendu parler. Ils connaissaient également l’histoire des deux tentatives d’invasion de Nippon par Kublaï Khan, toutes deux réduites à néant par de puissants typhons qui n’étaient pas de saison. Les Nippons en avaient retiré la conviction qu’un vent divin défendait leurs terres de toute attaque étrangère. Qui n’aurait été d’accord ? Car il semblait en plus tout à fait plausible que ce vent divin fût actuellement à l’œuvre – sorte de plaisanterie ou de retour paradoxal des choses –, sous la forme d’un calme divin alors qu’ils se trouvaient dans le Kuroshio, causant leur perte aussi efficacement que n’importe quel typhon. Après tout, ce calme était trop absolu, son minutage trop parfait, pour être normal ; peut-être étaient-ils dans les mains des dieux. Si c’était le cas, ils ne pouvaient que s’en remettre à leurs propres dieux, et espérer que les choses s’arrangeraient.
Ce qui n’était pas vraiment la façon dont l’amiral Kheim aimait régler les problèmes.
— Assez, dit-il sombrement, mettant fin à la réunion.
Il ne croyait pas au bon vouloir des dieux de la mer, et n’accordait aucun crédit à ces histoires de bonnes femmes, sauf quand il y avait du bon à prendre. Ils étaient englués dans le Kuroshio ; ils connaissaient un peu les courants du Dahai – qui au nord de l’équateur menait vers l’est, et au sud vers l’ouest. Ils savaient que les vents dominants suivaient à peu près les mêmes directions. Le docteur I-Chin avait déjà parcouru avec succès l’intégralité de ce grand cercle, l’équipage non préparé de son navire se nourrissant de poissons et d’algues, buvant de l’eau de pluie, et s’arrêtant pour ravitailler quand ils avaient la chance de passer près d’une île. Il y avait de quoi garder espoir. Et comme il n’y avait pas un souffle d’air, l’espoir était tout ce qu’il leur restait. Ce n’était pas comme s’ils avaient le choix. Leurs navires étaient piégés dans l’eau, et les plus grands ne pouvaient aller nulle part en ramant. En vérité, ils n’avaient d’autre choix que de faire avec.
C’est pourquoi l’amiral Kheim ordonna à la plupart des hommes de la flotte de se rendre à bord des Dix-Huit Plus Petits Bateaux, et commanda à la moitié d’entre eux de ramer vers le nord, et aux autres de ramer vers le sud, avec l’idée qu’ils pourraient échapper au Courant Noir, et retourner chez eux à la voile quand les vents reviendraient, afin d’informer l’empereur de ce qui s’était passé. Les Huit Grands Navires, manœuvrés par le Plus Petit Équipage Possible, avec le maximum des vivres dans leurs cales, se préparèrent à commencer leur grande traversée de l’océan sur les courants. Si les Plus Petits Bateaux parvenaient à rentrer en Chine, ils devraient dire à l’empereur de s’attendre, un jour futur, au retour des Huit Plus Grands, par le sud-est.
En quelques jours, les Plus Petits Bateaux disparurent sous l’horizon, et les Huit Grands Navires, attachés les uns aux autres, dérivèrent vers l’est dans un calme de mort, sortant des limites des cartes. Il n’y avait rien d’autre à faire.
Trente jours passèrent sans le moindre souffle de vent. Chaque jour, ils dérivaient un peu plus à l’est sur le courant.
Personne n’avait jamais rien vu de pareil. L’amiral Kheim interdit qu’on parlât de Calme Divin, même si, remarqua-t-il, le temps était devenu étrange ces dernières années, surtout plus froid : des lacs qui n’avaient jamais gelé se mettaient à geler, des vents bizarres, et notamment des tornades, soufflaient plusieurs jours d’affilée. Il y avait quelque chose d’étrange dans les cieux. Ce n’était rien d’autre que ça.
Quand les vents se remirent enfin à souffler, ce furent de forts vents d’ouest, qui les poussèrent plus loin encore. Ils mirent le cap au sud à travers les vents dominants, mais avec précaution maintenant, dans l’espoir de rester à l’intérieur de l’hypothétique courant circulaire, qu’ils supposaient être le moyen le plus rapide de faire le tour de l’océan et de rentrer chez eux. Au milieu de ce cercle se trouvait, disait-on, une importante zone de calme permanent, peut-être au centre même du Dahai, en fait non loin de l’équateur, et peut-être à mi-distance de l’est et de l’ouest, bien que personne ne pût l’affirmer. En tout cas, une zone de calme dont aucune épave ne pouvait se sortir. Ils devaient aller assez à l’est pour la contourner, mettre le cap au sud, puis, au-dessous de l’équateur, repartir vers l’ouest.
Ils ne virent aucune île. Quelques oiseaux de mer volaient parfois au-dessus d’eux. Ils en tirèrent certains à l’aide de leurs arcs, et les mangèrent pour se porter chance. Ils péchaient nuit et jour, attrapaient des poissons volants dans leurs voiles, ramenaient des paquets d’algues, qui se faisaient de plus en plus rares, et reconstituaient leurs réserves d’eau quand il pleuvait, en posant des entonnoirs pareils à des ombrelles renversées au-dessus de tonneaux. Ainsi, ils eurent rarement soif, et jamais faim.
Mais pas la moindre terre en vue. Le voyage se poursuivait, jour après jour, semaine après semaine, mois après mois. Les cordages et les gréements commencèrent à s’user. Les voiles devinrent transparentes. Leur peau même devint transparente.
Les marins marmonnaient. Ils n’approuvaient plus à présent le projet de naviguer autour du Grand Océan sur le courant circulaire ; mais ils ne pouvaient plus faire demi-tour, comme le leur fit remarquer Kheim. Alors ils laissèrent les grommellements derrière eux, comme on s’éloigne d’un orage. Kheim n’était pas le genre d’amiral qu’on avait envie d’affronter.
Ils passèrent à travers bon nombre de tempêtes, et sentirent bien des orages sous-marins chahuter leur coque. Tant de jours passèrent que leur vie d’avant le voyage devint lointaine et s’estompa ; Nippon, Taiwan, et même la Chine, commencèrent à ressembler aux rêves d’une autre vie. Naviguer devint toute leur vie : une vie d’eau, avec sa surface de vagues bleues sous un bol renversé de ciel bleu – rien d’autre. Ils ne cherchaient même plus la terre. Une masse d’algues était aussi étonnante pour eux qu’une terre aurait pu l’être autrefois. La pluie était toujours la bienvenue, parce que le rationnement et la soif leur avaient appris à quel point ils dépendaient douloureusement de l’eau douce. Elle venait surtout de la pluie, en dépit des petits alambics qu’I-Chin avait fait construire pour distiller l’eau de mer, et dont ils tiraient quelques seaux chaque jour.
Tout n’était plus qu’éléments. L’eau était l’océan ; l’air était le ciel ; la terre, leurs bateaux ; le feu, le soleil et leurs pensées. Les feux se couvraient. Certains jours, Kheim se réveillait, vivait, regardait le soleil se coucher, et comprenait qu’il avait oublié d’avoir une seule pensée de toute la journée. Et c’était l’amiral.
Un jour, ils frôlèrent la carcasse délavée d’une énorme épave, couverte de varech et blanchie par le guano, flottant à peine. Une autre fois ils virent un serpent de mer, plus à l’est, non loin de l’horizon, peut-être les y menant.
Et si le feu avait complètement abandonné leur esprit, et se trouvait tout entier dans le soleil, brûlant au-dessus d’eux à travers des jours sans pluie ? Quelque chose demeurait pourtant ; charbons gris, presque calcinés ; car quand la terre surgit à l’horizon, à l’est, tard un après-midi, ils crièrent comme si c’était là tout ce qu’ils avaient espéré chacun des cent soixante jours de leur voyage imprévu. Des montagnes aux flancs verts, plongeant abruptement dans la mer, apparemment désertes. Peu importe. C’était la terre. On aurait dit une île immense.
Le lendemain matin, elle était toujours là, devant eux. Terre ! Terre !
Une terre très abrupte en l’occurrence ; tellement escarpée qu’il n’y avait apparemment pas moyen d’accoster. Pas de baies, pas de rivières. Pas d’embouchure de fleuve de quelque taille que ce soit. Rien qu’un grand mur de collines vertes, s’élevant détrempées hors de l’eau.
Kheim leur ordonna de mettre cap au sud, pensant encore en cet instant rejoindre la Chine. Les vents leur étaient enfin redevenus favorables, ainsi que les courants. Ils naviguèrent vers le sud durant toute la journée et la journée suivante, sans voir une seule plage. Puis, un matin, alors que le brouillard se levait, en franchissant un cap, ils virent qu’il protégeait une avancée sableuse ; plus loin au sud, un passage s’imposa entre les collines, terriblement évident. Une baie. Une tache d’eau blanche et turbulente marquait l’entrée de ce détroit majestueux, mais ensuite l’eau était calme, propre à la navigation. La marée les aida à l’atteindre.
Alors ils entrèrent dans une baie comme aucun d’entre eux n’en avait jamais vu auparavant, dans aucun voyage. Une mer intérieure, en fait, avec trois ou quatre îlots rocheux, entourée de collines aux flancs couverts de forêts et au sommet dénudé. La plupart des côtes étaient bordées de marécages d’un vert limoneux, jauni de toutes les couleurs de l’automne. Magnifique terre, et vide !
Ils mirent cap au nord et mouillèrent l’ancre dans une crique peu profonde, protégée par un éperon rocheux qui s’avançait dans l’eau. Puis la vigie signala une colonne de fumée, qui s’élevait dans l’air du soir.
— Des gens, dit I-Chin. Mais je ne crois pas que cela soit l’extrémité ouest des terres musulmanes. Nous n’avons pas navigué assez loin pour ça, si Hsing Ho dit vrai. Nous ne devrions même pas en être près.
— Peut-être le courant est-il plus fort que tu ne crois ?
— Peut-être. Ce soir, je pourrai vérifier à quelle distance nous sommes de l’équateur.
— Bien.
Mais à quelle-distance-nous-sommes-de-la-Chine aurait été mieux, sauf que c’était très exactement le genre de calcul qu’ils ne pouvaient pas faire. Si une chose leur avait été impossible au cours de leur longue période de dérive, c’était bien d’estimer leur position. Et malgré les sempiternelles supputations d’I-Chin, Kheim ne pensait pas qu’ils puissent se repérer à moins d’un millier de lis près.
Quant à la distance-à-laquelle-nous-sommes-de-l’équateur, leur apprit I-Chin cette nuit-là, après avoir observé les étoiles, ce devait être à peu près la même que celle qui en séparait Edo ou Beijing. Ils se trouvaient en fait un peu plus haut qu’Edo, ou un peu plus bas que Beijing. I-Chin tapota son astrolabe, songeur.
— C’est la même distance de l’équateur que les pays hui de l’Extrême-Occident, comme le Fulan, où tant de gens sont morts. Si on peut se fier à la carte de Hsing Ho. Fulan, vous voyez ? Un port appelé Lisbonne. Mais je ne vois pas de Fulanais. Je ne crois pas que cela puisse être le Fulan. Nous avons dû toucher une île.
— Une grande île !
— Oui, une grande île, soupira I-Chin. Si seulement nous pouvions savoir à quelle-distance-nous-sommes-de-la-Chine !
Avec lui, c’était toujours la même complainte. Cela l’avait conduit à se passionner pour l’horlogerie. S’ils avaient eu une horloge suffisamment précise, à l’aide d’un almanach qui donnait l’heure des étoiles en Chine, et en chronométrant leur apparition ici, ils auraient pu calculer à quelle-distance-nous-sommes-de-la-Chine. L’empereur avait quelques magnifiques horloges dans son palais, disait-on. Mais ils n’en avaient aucune à bord de leurs navires. Kheim le laissa à ses ruminations.
Le matin suivant, en se réveillant, ils découvrirent un groupe d’autochtones – des hommes, des femmes, des enfants – portant des jupes de cuir, des colliers de coquillages et des parures de plumes, debout sur la plage en train de les regarder. Ils ne connaissaient apparemment pas le tissu, et ils n’avaient pas de métal non plus – en dehors de quelques morceaux d’or, de cuivre et d’argent travaillé. Les pointes de leurs flèches et les bouts de leurs pieux étaient d’obsidienne taillée, leurs paniers, tressés de roseaux et d’aiguilles de pin. Il y avait de grands tas de coquillages sur la plage, bien au-dessus de la limite des plus hautes eaux. De la fumée montait des masures en osier – de petits abris comme ceux que les fermiers pauvres en Chine utilisaient pour leurs cochons l’hiver.
Les marins se mirent à rire et à papoter entre eux, à la fois soulagés et étonnés. On ne pouvait pas avoir peur de ces gens-là.
Kheim n’en était pas si sûr.
— Ils ressemblent aux sauvages de Taiwan, dit-il. Nous avons eu de terribles combats avec eux quand nous avons pourchassé les pirates dans les montagnes. Il va falloir faire attention.
— Il y a aussi des tribus comme ça dans les îles des Épices, dit I-Chin. Je les ai vues. Mais même elles avaient plus de choses que ces gens-là.
— Pas de maisons de brique ou de bois, pas de fer, pour autant que je puisse en juger, c’est-à-dire pas de pistolets…
— Pas de champs, donc. Ils doivent manger du poisson et des coquillages, ajouta I-Chin en désignant les grands amas de coquilles. Et tout ce qu’ils peuvent chasser ou cueillir. Ce sont des pauvres gens.
— Cela ne nous laisse pas grand-chose…
— Ça non !
Les marins les saluaient du haut du bastingage. Bonjour ! Bonjour !
Kheim leur donna l’ordre de se tenir tranquilles. I-Chin et lui prirent place dans l’une des chaloupes du grand navire, avec quatre hommes, et souquèrent ferme vers le rivage.
Peu avant de toucher terre, Kheim se leva et salua les autochtones, les mains ouvertes, paumes tournées vers le ciel, comme on le faisait avec les sauvages des îles des Épices. Les autochtones ne comprirent rien de ce qu’il dit, mais ses gestes traduisaient clairement qu’ils venaient en paix, et ils parurent le comprendre. Après un instant, il débarqua, certain d’être accueilli pacifiquement, mais donnant l’ordre à ses marins de tenir leurs arbalètes et leurs mousquets sous les sièges, prêts à tirer, au cas où.
Sur la plage, il fut entouré par des gens curieux, babillant dans leur langue natale. Quelque peu distrait par la vue des seins des femmes, il salua un homme qui s’avança vers lui, leur chef, probablement, à en juger par sa coiffe multicolore, élaborée. Sur l’écharpe de soie de Kheim, passablement abîmée par le sel, était brodé un phénix. Kheim la dénoua et la donna à l’homme, en la tenant bien à plat pour qu’il puisse voir l’oiseau. La soie elle-même sembla plus intéresser l’homme que l’image.
— Nous aurions dû apporter plus de soie, dit Kheim à I-Chin.
— Nous étions partis pour envahir Nippon, répondit I-Chin en secouant la tête. Essayons plutôt d’apprendre quels noms ils donnent à ces choses.
I-Chin montra du doigt chaque chose qu’ils portaient, l’une après l’autre, leurs paniers, leurs épieux, leurs robes, leurs coiffes, leurs tas de coquillages ; répétant chacune de leurs paroles, les notant rapidement sur une ardoise.
— Bien, bien… Bien le bonjour… L’empereur de Chine et ses humbles serviteurs vous envoient leurs salutations.
À la pensée de l’empereur, Kheim sourit. Que ferait le Wanli, l’Envoyé Céleste, de ces pauvres mangeurs-de-coquillages ?
— Il va falloir apprendre à certains d’entre eux le mandarin, dit I-Chin. Peut-être à un jeune garçon, ils apprennent plus vite.
— Ou à une jeune fille.
— Évitons cela, dit I-Chin. Il va falloir que nous passions un peu de temps ici, à réparer nos navires et nous ravitailler. Nous ne voulons pas que leurs mâles nous cherchent noise.
Kheim mima leurs intentions à leur chef. Rester un peu – camper sur la plage, manger, boire, réparer les navires –, rentrer chez eux, de l’autre côté du couchant, à l’ouest. Il sembla finalement qu’ils comprirent presque tout ce qu’il leur dit. En retour, il comprit d’eux qu’ils mangeaient des glands et des courges, du poisson, des coquillages et des oiseaux, et de plus gros animaux – ils parlaient probablement des chevreuils. Ils chassaient dans les collines, là, derrière. Il y avait beaucoup à manger, et les Chinois étaient vivement encouragés à en profiter. Ils apprécièrent la soie de Kheim, et, s’il en avait plus, ils leur donneraient de beaux paniers et de la nourriture en échange. Leurs parures d’or venaient des collines à l’est, par-delà le delta d’un grand fleuve qui se jetait dans la baie de l’autre côté. Ils indiquèrent où il coulait, à travers une percée dans les collines, un peu comme celle qui donnait directement dans l’océan.
Comme ces informations géographiques intéressaient visiblement I-Chin, ils lui en donnèrent davantage à l’aide de moyens très ingénieux. Ils n’avaient ni papier, ni encre, ne pouvaient donc ni écrire ni dessiner, en dehors des motifs qui ornaient leurs paniers, mais ils lui firent une carte d’un genre particulier, dans le sable de la plage. Le chef et quelques-uns des autres notables s’accroupirent et modelèrent minutieusement le sable mouillé avec leurs mains, tassant et lissant la partie qui représentait la baie ; puis ils se lancèrent dans des conversations animées au sujet de la véritable forme des montagnes qui les séparaient de l’océan. Ils l’appelaient Tamalpi, et c’était apparemment, dirent-ils par gestes, une vierge endormie, une déesse, même s’il était difficile d’en être certain. À l’aide d’herbes, ils figurèrent une large vallée à l’intérieur des collines encadrant la baie à l’est. Ils mouillèrent le sable pour représenter un delta et deux fleuves, l’un qui arrosait le nord, l’autre le sud d’une grande vallée. À l’est de cette grande vallée, des collines montaient vers des montagnes bien plus hautes que la chaîne côtière, aux cimes enneigées (qu’ils représentèrent par des graines de pissenlits), abritant en leur sein un ou deux grand lacs.
Ils indiquèrent tout cela avec d’infinies palabres sur tel ou tel détail, en perfectionnant les creux avec les ongles, en repositionnant les brins d’herbe ou les branches de pins ; et tout ça pour une carte que la première marée emporterait. Mais quand ils eurent terminé, les Chinois surent que l’or de ces gens venait du pied des collines ; leur sel des rivages de la baie ; leur obsidienne et leurs turquoises du nord et d’au-delà des hautes montagnes, et ainsi de suite. Et tout cela sans langage commun, juste des choses placées pour en représenter d’autres, et ce modèle en sable de leur pays.
Et puis, les jours suivants, ils échangèrent des mots pour bon nombre d’objets courants et d’événements. I-Chin fit des listes, entreprit un glossaire et commença à apprendre sa langue à l’un des enfants locaux, une petite fille d’environ six ans qui était la fille du chef, et très éveillée ; un vrai moulin à paroles, que les marins chinois appelèrent Bouton d’Or, à la fois à cause de sa mine enthousiaste et parce qu’elle leur évoquait un soleil radieux. Elle adorait dire à I-Chin le nom de chaque chose, avec aplomb ; et, plus vite que Kheim ne l’aurait cru possible, elle parla le chinois comme si c’était sa propre langue, les mélangeant parfois, mais réservant généralement le chinois à I-Chin, comme si c’était son langage privé, et lui quelque être bizarre, ou un plaisantin invétéré, inventant sans arrêt de faux noms pour les choses – ni l’une ni l’autre de ces hypothèses n’étant très loin de la vérité. Ses aînés comprenaient certainement qu’I-Chin était un drôle d’étranger, leur prenant le pouls, leur tâtant l’abdomen, leur regardant la bouche, demandant à voir leurs urines (ce qu’ils refusèrent), et ainsi de suite. Ils avaient déjà eux-mêmes une sorte de docteur, qui les menait à des rituels de purification dans de simples bains de vapeur. Ce vieillard aux traits marqués et au regard fou n’était d’ailleurs pas un docteur au sens où l’entendait I-Chin, mais celui-ci prit beaucoup d’intérêt à consulter son herbier et à écouter ses explications, pour autant qu’I-Chin les comprenait, en se servant d’un langage des signes beaucoup plus élaboré, et du savoir grandissant qu’avait Bouton d’Or du chinois. Les gens appelaient leur langue le « miwok », qui était aussi le nom qu’ils se donnaient à eux-mêmes ; ce mot voulait dire « peuple », ou quelque chose d’équivalent. Ils firent comprendre aux Chinois avec leurs cartes que leur village contrôlait la zone irriguée par le fleuve qui se jetait dans la baie. D’autres Miwoks vivaient autour des cours d’eau tout proches de la péninsule, entre la baie et l’océan ; d’autres gens portant un autre nom vivaient dans d’autres endroits du pays, chacun avec leur propre langue, leur propre territoire. Les Miwoks pouvaient discuter de ces détails pendant des heures et des heures. Ils expliquèrent aux Chinois que le grand détroit qui menait à l’océan avait été créé par un tremblement de terre, et que la baie avait été pleine d’eau douce avant que le cataclysme n’y laisse pénétrer l’océan. Cela parut peu probable à I-Chin et Kheim, mais un matin, alors qu’ils s’étaient endormis sur la plage, ils furent réveillés par une puissante secousse, et le tremblement de terre se prolongea durant quelques battements de cœur. Il se reproduisit deux fois ce matin-là, et après ils ne furent plus aussi sûrs d’eux en ce qui concernait le détroit.
Ils aimaient tous les deux écouter parler les Miwoks, mais seul I-Chin était intéressé par la façon dont les femmes rendaient comestibles les glands amers des chênes aux feuilles lobées, en les broyant et en lavant la poudre obtenue sur des lits de feuilles et de sable. I-Chin trouva ce processus très ingénieux. Cette farine, ainsi que le saumon frais ou séché, composait la base de leur alimentation, qu’ils offraient volontiers aux Chinois. Ils mangeaient aussi du chevreuil, une espèce de chevreuil géant, du lapin, et toutes sortes d’oiseaux d’eau. En fait, alors que l’automne descendait doucement sur eux et que les mois succédaient aux mois, les Chinois finirent par comprendre que la nourriture était si abondante ici qu’ils n’avaient pas besoin de l’agriculture, telle qu’on la pratiquait en Chine. Pourtant, l’île était très peu peuplée. C’était l’un de ses mystères.
Les parties de chasse des Miwoks étaient d’importantes excursions dans les collines, cela durait toute la journée, et Kheim et ses hommes furent autorisés à s’y joindre. Les arcs dont se servaient les Miwoks étaient de mauvaise facture mais remplissaient parfaitement leur office. Kheim ordonna à ses marins de garder leurs arbalètes et arquebuses cachées sur le navire, tandis qu’on laissait les canons en vue, mais sans dire à quoi ils servaient, ce qu’aucun autochtone ne demanda.
Lors d’une des ces parties de chasse, Kheim et I-Chin remontèrent avec le chef, Ta Ma, et quelques-uns des Miwoks le fleuve qui traversait leur village, jusqu’en haut des collines et une haute prairie d’où on pouvait observer un magnifique panorama de l’océan à l’ouest. À l’est, ils pouvaient voir, par-delà la baie, des rangées de collines vertes.
La prairie était humide, marécageuse, pleine de hautes herbes, semée de bouquets de chênes et d’autres arbres. Il y avait un lac, en bas de la prairie, entièrement recouvert d’oies – un manteau neigeux d’oiseaux, cancanants, râleurs, dérangés par quelque chose. Puis tout le monde s’envola à grands coups d’ailes, formant dans les airs des groupes qui tournoyaient, se divisaient, se reformaient, volant en rase-mottes au-dessus des chasseurs, poussant de grands cris ou silencieusement concentrés sur leur vol, le claquement distinct de leurs puissantes ailes déchirant les cieux. Il y en avait des milliers et des milliers.
Les hommes regardèrent ce spectacle sans bouger, les yeux ronds. Quand les oies eurent toutes pris leur essor, ils virent pourquoi elles étaient parties ; un troupeau de cerfs géants était venu s’abreuver au lac. Les cerfs avaient d’énormes bois sur la tête. Ils regardèrent les hommes de l’autre côté du lac, vigilants mais impavides.
Pendant un instant, tout fut silencieux.
Pour finir, le cerfs géants s’en allèrent. La réalité s’était réveillée.
— Que des êtres conscients, dit I-Chin, qui n’avait cessé de marmonner ses soutras bouddhiques.
D’habitude, Kheim n’avait pas de temps à perdre avec de telles inepties, mais à présent, alors que la journée avançait et qu’ils marchaient dans les collines, ils apercevaient des troupes de paisibles castors, des cailles, des lapins, des renards, des mouettes, des corbeaux, des daims, une ourse et ses deux oursons, une bête qui chassait – une bête à la longue queue grise ondoyante, un peu comme un croisement de renard et d’écureuil –, et ainsi de suite. C’était un pays tout simplement plein d’animaux, vivant en harmonie sous un ciel bleu, silencieux, où rien ne bougeait : la nature dans toute sa splendeur, les hommes n’étant que quelques-uns de ses habitants. Kheim commença à se sentir bizarre. Il comprit qu’il avait longtemps pris la Chine pour la réalité elle-même. Taiwan, Mindanao et les autres îles qu’ils avaient vues étaient comme des petits morceaux de terre, des rebuts ; la Chine était pour lui le monde. Et la Chine c’était les gens. Construite, cultivée, domestiquée, c’était un monde si complètement humain que Kheim n’avait jamais pensé qu’il pût y avoir autrefois un monde naturel différent du sien. Mais il avait sous les yeux, ici, une terre sauvage, aussi riche que possible d’animaux en tous genres et, par ailleurs, apparemment bien plus grande que Taiwan ; plus grande que la Chine, plus grande que le monde qu’il avait laissé derrière lui.
— Où diable sur Terre pouvons-nous bien être ? demanda-t-il.
— Nous avons trouvé la source des fleurs de pêcher, répondit I-Chin.
L’hiver arriva, et pourtant il faisait encore chaud la journée, et frais la nuit. Les Miwoks leur donnèrent des capes taillées dans des peaux d’otarie cousues entre elles par des lacets de cuir, incroyablement douces à la peau, aussi luxueuses que les vêtements de l’Empereur de Jade. Quand le temps était à l’orage, il pleuvait et le ciel s’assombrissait, mais sinon il faisait toujours beau, et le soleil brillait. Et tout ceci à la même latitude que Beijing, d’après I-Chin, et à une époque de l’année où il devait y souffler un vent glacial, ce qui fit que les marins appréciaient d’autant plus ce climat. Kheim avait de la peine à croire les autochtones quand ils lui disaient que c’était comme ça tous les hivers.
Au solstice d’hiver, une journée chaude et ensoleillée comme les autres, les Miwoks invitèrent I-Chin et Kheim dans leur temple, une petite chose ronde comme une pagode pour nains, en contrebas dans la terre, entièrement recouverte de gazon, et dont le poids était supporté par quelques arbres se ramifiant comme pour former un nid. On se serait cru dans un œuf. Les flammes d’un petit feu et les rayons du soleil, passant par une ouverture pratiquée dans le toit et filtrés par la fumée, baignaient l’intérieur d’une douce lumière. Les hommes portaient leur coiffe à plumes cérémonielle et de nombreux colliers de coquillages qui brillaient à la lueur des flammes. Ils dansèrent autour du feu au rythme lancinant des tambours, chacun à leur tour à mesure que la nuit s’avançait, recommençant inlassablement, si bien que Kheim, stupéfait, se demanda s’ils s’arrêteraient jamais. Il lutta pour ne pas s’endormir, sentant l’importance de cette cérémonie pour ces hommes qui ressemblaient à s’y méprendre aux animaux dont ils se nourrissaient. Ce jour marquait le retour du soleil, après tout. Mais il était si dur de rester éveillé. Finalement, il se leva d’un bond et se joignit aux danseurs les plus jeunes, qui lui firent de la place, et il caracola de-ci de-là, ses jambes de marin agitées de mouvements désordonnés. Il dansa, et dansa, jusqu’à s’effondrer dans un coin. Il ne s’éveilla qu’à la toute fin de l’aube, sous un ciel baigné de lumière. Le soleil était sur le point de jaillir au-dessus des collines bordant la baie. Un groupe de jeunes femmes célibataires conduisit la joyeuse bande exténuée de danseurs et de musiciens jusqu’aux bains de vapeur. Dans son état de stupeur, Kheim fut frappé par la beauté de ces femmes. Il s’émerveillait du fait qu’elles étaient particulièrement fortes, aussi robustes que les hommes, qu’elles avaient les pieds nus, et qu’elles jetaient de leurs yeux non maquillés des regards impertinents. En fait, il était clair qu’elles se moquaient joyeusement des hommes épuisés qu’elles escortaient. Elles les aidèrent à retirer leurs parures de plumes et de coquillages, ne se privant pas, si Kheim comprenait bien, de lancer quelques commentaires égrillards, même s’il était toujours possible qu’il entende ce qu’il avait envie d’entendre. Mais l’air brûlant, la sueur évacuée par son corps, le saut maladroit et brutal dans l’eau de la rivière, le remirent brusquement d’aplomb, dans la lumière du matin ; tout cela ne fit qu’accroître à ses yeux la beauté de ces femmes, qui passait tout ce qu’il se souvenait d’avoir jamais connu en Chine, où un marin n’approchait, en guise de beauté, que les jeunes filles en fleurs des restaurants. L’émerveillement, la sensualité et le froid de la rivière eurent beau combattre sa fatigue, il s’endormit sur la plage au soleil.
Il était de retour sur le navire amiral quand I-Chin vint le voir, la mine sinistre.
— L’un d’eux est mort, hier soir. Ils me l’ont amené. C’était la variole.
— Quoi ? Tu es sûr ?
I-Chin hocha gravement la tête, aussi gravement qu’aux heures les plus sombres.
Kheim reprit aussitôt ses esprits.
— Il va falloir rester à bord du navire.
— Nous devrions partir, dit I-Chin. Je pense que c’est nous qui la leur avons apportée.
— Mais comment ? Personne à bord n’avait la variole.
— Aucun des habitants ici n’a de marques de variole. Je pense que c’est nouveau pour eux. Quelques-uns d’entre nous l’ont eue enfants, comme tu peux le voir. Li et Peng en gardent encore les traces, et Peng a couché avec l’une des femmes locales. C’est son enfant qui est mort. Et elle aussi est malade.
— Non…
— Si, hélas. Tu sais ce qui arrive aux sauvages quand une nouvelle maladie survient. J’ai vu ça en Aozhou. La plupart meurent. Ceux qui n’en meurent pas seront ensuite immunisés, mais ils peuvent également contaminer ceux qui ne le sont pas, je ne sais pas. En tout cas, c’est mauvais.
Ils pouvaient entendre la petite Bouton d’Or s’amuser sur le pont au-dessus d’eux, jouant à quelque jeu avec les marins. Kheim fit un geste vers le haut.
— Et elle ?
— Nous pourrions l’emmener, je pense. Si elle retourne sur le rivage, elle mourra sûrement, comme les autres.
— Mais si elle reste avec nous, elle risque aussi de l’attraper et de mourir.
— C’est vrai. Mais je pourrai toujours essayer de m’occuper d’elle.
Kheim fronça les sourcils, et dit enfin :
— Nous avons de quoi boire et manger. Va prévenir les hommes. Nous mettrons cap au sud, et nous prendrons nos dispositions pour retraverser l’océan au printemps, et regagner la Chine.
Avant de partir, Kheim emmena Bouton d’Or et rama jusqu’au rivage, mais resta bien éloigné du village. Le père de Bouton d’Or les aperçut et courut dans la mer. Il avait de l’eau jusqu’aux genoux, dans le calme de la marée descendante. Il dit quelque chose d’une voix grinçante. Kheim vit sur son visage les pustules de la variole. Kheim rama précipitamment vers le navire.
— Qu’a-t-il dit ? demanda-t-il à la fillette.
— Il a dit que les gens étaient malades. Qu’il y avait des morts.
Kheim déglutit.
— Dis-lui que c’est nous qui avons apporté cette maladie.
Bouton d’Or le regarda sans comprendre.
— Dis-lui que nous avons apporté la maladie avec nous. C’est un accident. Peux-tu le lui dire ? Fais-le.
Elle trembla dans le fond de l’embarcation.
Soudain en colère, Kheim cria au chef des Miwoks :
— Nous vous avons contaminés, c’est un accident !
Ta Ma le regarda.
— Bouton d’Or, s’il te plaît, dis-lui quelque chose. Dis quelque chose !
Elle leva les mains et cria quelque chose. Ta Ma fit deux pas dans l’eau, s’y enfonçant jusqu’à la taille. Kheim donna quelques coups de rames supplémentaires, en jurant. Il était en colère, et ne pouvait passer sa colère sur personne.
— On doit partir ! hurla-t-il. On s’en va ! Dis-le-lui, cria-t-il furieusement à Bouton d’Or. Dis-lui !
Elle appela Ta Ma, apparemment affolée.
Kheim se leva dans la barque, la faisant bouger. Il pointa du doigt son cou et son visage, puis Ta Ma. Il mima la détresse, le vomissement, puis la mort. Il désigna le village et fit un geste de la main signifiant qu’il serait balayé, d’un seul coup. Il désigna Ta Ma et lui dit qu’il devait partir, qu’ils devaient tous partir, se disperser. Pas dans les autres villages, mais dans les collines. Il se montra, lui, puis la fillette blottie dans la barque. Il mima qu’il ramait, puis qu’ils mettaient les voiles. Il pointa la fillette, la montrant joyeuse, jouant, grandissant – tout cela sans desserrer les dents.
Ta Ma ne parut pas comprendre la moindre bribe de cette charade. L’air ahuri, il dit quelque chose.
— Qu’a-t-il dit ?
— Il a dit : que faisons-nous ?
Kheim indiqua encore une fois les collines, lui signifiant de s’y éparpiller.
— Allez ! cria-t-il. Dis-lui ! Partez ! Dispersez-vous !
Elle dit quelque chose à son père, au bord des larmes.
Ta Ma répondit autre chose.
— Qu’a-t-il dit, Bouton d’Or ? Tu peux me le dire ?
— Il a dit adieu.
Les deux hommes se regardèrent. Bouton d’Or les regardait alternativement, l’un, puis l’autre, effrayée.
— Éparpillez-vous pour deux mois ! dit Kheim, se rendant compte que cela ne servirait à rien mais le disant quand même. Laissez ceux qui sont malades et allez-vous-en. Après, vous pourrez vous retrouver, et la maladie ne vous fera plus de mal. Partez ! Nous emmenons Bouton d’Or, nous prendrons soin d’elle. Nous la mettrons sur un navire où personne n’a jamais eu la variole. On s’occupera d’elle. Allez !
Il renonça.
— Répète-lui ce que je viens de dire, dit-il à Bouton d’Or.
Mais elle se contenta de gémir et de pleurnicher au fond de l’embarcation. Kheim rama jusqu’au navire et ils partirent ; sortirent de la grande embouchure de la baie en profitant de la marée descendante.
Bouton d’Or pleura souvent pendant les trois premiers jours de leur voyage, puis elle mangea comme une ogresse, après quoi elle se mit à parler exclusivement en chinois. Kheim était torturé par l’idée qu’il n’aurait peut-être pas dû l’emmener. Mais elle serait probablement morte, s’ils l’avaient laissée, lui rappela I-Chin. Kheim n’était pas sûr que, même ça, soit une raison suffisante. Et la vitesse à laquelle elle s’était adaptée à sa nouvelle vie ne faisait qu’accroître son malaise. Était-ce donc là ce qu’ils étaient, depuis toujours ? Des gens si insensibles, à la mémoire si courte ? Capables de se glisser dans la première vie qu’on daignait leur offrir, quelle qu’elle fût ? C’était si étrange.
L’un de ses officiers s’approcha de lui.
— Peng n’est à bord d’aucun des bateaux. Nous pensons qu’il a dû regagner le rivage à la nage et rester avec eux.
Bouton d’Or tomba malade elle aussi, et I-Chin l’enferma à la proue du vaisseau amiral, dans un espace bien aéré, sous le beaupré et au-dessus de la figure de proue – qui était une statue en or de Tianfei. Il passa de nombreuses heures à s’occuper de la fillette pendant les Six Stades de la maladie, qui allaient de la fièvre dévorante et du pouls filant du Grand Yang au Grand Yin, en passant par le Petit Yang et le Yang Lumineux – au cours duquel la fièvre alternait avec des frissons glacés. Il lui prenait le pouls à chaque changement de quart, vérifiait tous ses signes vitaux, creva certaines de ses pustules, lui administra des remèdes pris dans ses sacoches, et surtout une décoction appelée le Don du Dieu de la Variole, qui était composée de poudre de corne de rhinocéros, de vers de neige du Tibet, de jade et de perles pilées. Il dut aussi, quand il lui sembla qu’elle restait coincée – entre la vie et la mort – dans le Petit Yin, lui administrer quelques doses d’arsenic. Kheim ne reconnaissait pas dans ses symptômes ceux de la variole habituelle, mais les marins firent quand même les sacrifices rituels au Dieu de la vérole, en brûlant de l’encens et du papier monnaie sur un autel, dont on avait dressé en hâte une copie sur chacun des Huit Vaisseaux.
Plus tard, I-Chin reconnut s’être dit que le fait de se trouver en haute mer avait été crucial pour sa guérison. Son corps roulait dans son lit quand les vagues enflaient, et il avait remarqué que sa respiration et son pouls suivaient le rythme des flots : quatre respirations et six battements d’un pouls encore léger à chaque vague. Ce genre de convergence avec les éléments était très positive. En outre, l’air salé lui emplissait les poumons de ki, et elle avait la langue moins chargée. Il lui donnait même de petites cuillerées d’eau de mer à avaler, ainsi que toute l’eau douce, l’eau du fleuve de son village, qu’elle pouvait boire. Voilà comment elle se remit et, ensuite, elle alla très bien, ne conservant que de légères marques de variole sur le dos et le cou.
Pendant tout ce temps, ils voguèrent vers le sud, le long de la côte de la nouvelle île, en s’étonnant chaque jour un peu plus de ne pas en avoir déjà atteint l’extrémité. Un cap leur donna l’impression d’en être le terme, mais, au-delà, ils virent que la terre s’incurvait à nouveau vers le sud, derrière des îles vides, cuites par le soleil. Plus loin, toujours au sud, ils virent des villages sur les plages. Ils en savaient assez, à ce moment-là, pour identifier les temples en forme de nid. Tout en maintenant la flotte bien au large, Kheim laissa s’approcher une pirogue, et demanda à Bouton d’Or d’essayer de parler pour eux. Mais les gens de la pirogue ne la comprenaient pas, et elle ne les comprenait pas non plus. Kheim fit son numéro de sourd-muet, les prévenant de la maladie et du danger, et les indigènes s’éloignèrent rapidement, à grands coups de rames.
Ils commencèrent à naviguer contre un courant du sud, mais il n’était pas violent, et les vents soufflaient constamment de l’ouest. La pêche, à cet endroit, était excellente, et le temps clément. Les jours succédaient aux jours, identiques, en un cercle parfait. La côte s’enfonça à nouveau vers l’est, puis courut vers le sud, presque jusqu’à l’équateur, par-delà un grand archipel d’îles basses, où il était facile de mouiller l’ancre, où l’eau était bonne, et où il y avait des oiseaux de mer aux pattes bleues.
Ils arrivèrent enfin à une ligne de côtes qui montait presque à la verticale, avec de grands volcans enneigés dans le lointain, comme le Fuji, mais deux fois plus grands – au moins ! –, qui ponctuaient le ciel derrière une chaîne côtière abrupte, elle-même fort haute. Si quelqu’un avait encore pu conserver l’illusion que cet endroit était une île, ce gigantisme final y aurait mis fin.
— Tu es sûr que ce n’est pas l’Afrique ? demanda Kheim à I-Chin.
I-Chin ne savait pas trop.
— Peut-être. Peut-être que les gens que nous avons laissés au nord sont les derniers survivants du Fulan, retournés à l’état primitif. C’est peut-être la côte ouest du monde, et nous sommes passés devant l’entrée de leur mer du Milieu pendant la nuit, ou dans le brouillard. Mais je ne crois pas.
— Alors, où sommes-nous ?
I-Chin montra à Kheim, sur les longues bandes de leur carte, l’endroit où il pensait qu’ils étaient ; à l’est des dernières marques, là où la carte était toute blanche. Mais il indiqua d’abord la bande la plus à l’ouest.
— Tu vois, le Fulan et l’Afrique ressemblent à ça, du côté ouest. Les cartographes musulmans sont formels. Et Hsing Ho a calculé que le monde faisait près de soixante-quinze mille lis de circonférence. S’il a raison, nous n’avons fait que la moitié de la distance que nous aurions dû parcourir, ou même moins, à travers le Dahai vers l’Afrique et le Fulan.
— Alors, peut-être qu’il se trompe. Peut-être que le monde occupe une plus grande partie du globe qu’il ne le pense. Ou alors, c’est que la Terre est plus petite.
— Mais sa méthode était bonne. J’ai fait les mêmes calculs pendant notre voyage aux Moluques, et j’ai prouvé qu’il avait raison.
— Mais regarde ! fit Kheim en indiquant le pays montagneux. Si ce n’est pas l’Afrique, qu’est-ce que c’est ?
— Une île, j’imagine. Une grande île, loin dans le Dahai, où personne n’était jamais allé à la voile. Un autre monde, comme le vrai. Un monde de l’Est, comme le monde de l’Ouest.
— Une île où personne ne serait jamais allé ? Dont personne n’aurait jamais entendu parler ?
Kheim ne pouvait pas le croire.
— Alors ? fit I-Chin, qui ne pouvait accepter cette idée. Qui d’autre, avant nous, aurait pu venir ici et repartir pour en parler ?
Kheim admit l’argument.
— Nous ne sommes pas revenus non plus.
— Non. Et rien ne garantit que nous y arriverons. Se pourrait-il que Hsu Fu soit venu ici, ait essayé de revenir et ait échoué ? Nous trouverons peut-être ses descendants sur cette côte même.
— Peut-être.
En se rapprochant de l’immense terre, ils virent une ville, sur la côte. Rien d’impressionnant par rapport aux villes de chez eux, mais assez importante, par rapport aux petits villages du Nord. Elle était presque complètement couleur de boue, mais les toits de plusieurs grands bâtiments, à l’intérieur et à l’arrière de la ville, étaient recouverts d’or battu. Ce n’étaient pas des Miwoks !
Ils mirent donc à la voile vers la côte, prudemment, craintivement, les canons de leur vaisseau chargés et prêts à tirer. Ils furent surpris de voir sur la plage des embarcations primitives – des barques de pêche comme celles que certains d’entre eux avaient vues dans les Moluques, surtout des bateaux à deux proues, faits de fagots de roseaux. Nulle part ils ne voyaient d’armes, de voiles, de quais ni de port. Rien qu’une jetée de pierre qui semblait flotter, ancrée au large de la plage. Ça faisait drôle de voir la munificence terrestre des bâtiments aux toits d’or voisiner avec une telle pauvreté maritime. I-Chin dit :
— Ça devait être un royaume de l’intérieur des terres, au départ.
— J’imagine que si la dynastie Han n’était pas tombée, la côte de la Chine ressemblerait à ça.
— Oui, on a eu de la chance, à voir ces bâtiments.
Drôle d’idée. Mais le seul fait de parler de la Chine était un réconfort. Après ça, ils se montrèrent des endroits de la ville en disant : « C’est comme à Cham », ou « Ils faisaient des maisons comme ça à Lanka », et ainsi de suite. Et bien que ça ait encore eu l’air bizarre, il était évident, avant même qu’ils ne repèrent les gens qui les regardaient sur la plage, que cette ville serait habitée, et pas par des singes ou des oiseaux.
Ils n’avaient pas grand espoir que Bouton d’Or puisse se faire comprendre d’eux, mais ils l’emmenèrent quand même près du rivage, dans leur grand canot. Ils gardèrent les arbalètes et les mousquets cachés sous leurs bancs pendant que Kheim, planté à la proue, faisait les gestes de paix qui lui avaient concilié les bonnes grâces des Miwoks. Puis il demanda à Bouton d’Or de les saluer gentiment dans sa propre langue, ce qu’elle fit d’une voix haute, claire et pénétrante. Les gens sur la plage les regardaient. Certains, avec des coiffes qui ressemblaient à des couronnes de plumes, leur répondirent, mais ils ne parlaient pas la langue de Bouton d’Or, ni aucune langue qu’ils aient jamais entendue.
Ces coiffes compliquées faisaient à Kheim l’impression d’être vaguement militaires, et il dit à ses hommes de s’écarter un peu de la plage et de faire attention aux arcs, aux lances, ou à tout ce qui ressemblait de près ou de loin à une arme. Quelque chose, dans l’allure de ces gens, évoquait la possibilité d’un coup fourré.
Mais il n’arriva rien de tel. Au contraire, quand ils revinrent, à la rame, le lendemain, tout un contingent d’hommes portant des tuniques à carreaux et des coiffes de plumes se prosternèrent sur la plage. Un peu mal à l’aise, Kheim ordonna de débarquer, en restant aux aguets.
Mais tout se passa bien. À l’aide de gestes et de quelques rudiments de langage, la communication s’amorça, même si les indigènes semblaient prendre Bouton d’Or pour le chef du groupe de visiteurs, leur talisman, ou plutôt leur prêtresse – c’était impossible à dire. En tout cas, ils la vénéraient. L’échange se faisait surtout par gestes, et principalement avec un vieil homme portant, sur une frange qui lui tombait jusqu’aux yeux, une couronne de plumes surmontée tout en haut d’une sorte d’insigne. Les rapports étaient cordiaux, empreints de curiosité mutuelle et de bonne volonté. On leur offrit des gâteaux faits d’une sorte de farine lourde, qui tenait au corps, et de gros tubercules qu’il fallait cuire. Le tout était arrosé d’une bière aigre, légère, apparemment la seule boisson des indigènes. Enfin, on leur apporta une pile de couvertures finement tissées, très douces et chaudes, faites d’une laine tirée de moutons qui donnaient l’impression d’avoir été croisés avec des chameaux, mais qui étaient manifestement des créatures complètement différentes, inconnues dans le vrai monde.
Tout cela fit que Kheim se sentit suffisamment en confiance pour accepter une invitation à quitter la plage et à rendre visite au roi ou à l’empereur local, dans l’énorme palais au toit d’or qui se trouvait en haut d’une colline, de l’autre côté de la ville. Tout ça pour l’or…, se dit Kheim alors qu’il se préparait pour le trajet, encore un peu mal à l’aise malgré tout. Il chargea un petit mousquet et le mit dans un havresac qu’il coinça sous son bras, sous son manteau. Il laissa à I-Chin des instructions pour une éventuelle opération de sauvetage, si nécessaire. Et ils partirent, Kheim, Bouton d’Or et une douzaine des plus grands matelots du vaisseau amiral, escortés par un groupe d’indigènes en tuniques à damiers.
Ils suivirent une piste qui passait devant des champs et des maisons. Les femmes, dans les champs, portaient leurs bébés attachés à des planches, sur leur dos, et filaient la laine tout en marchant. Elles accrochaient leurs métiers à tisser à des cordes nouées dans les arbres, afin d’avoir la tension nécessaire pour tisser. Ils n’avaient pas l’air de connaître d’autres motifs que les damiers, généralement jaunes et noirs, ou rouges et noirs. Leurs champs étaient des buttes rectangulaires, qui émergeaient des terres au bord du fleuve. Ils étaient inondés, comme les rizières, mais ce n’en était pas. C’était probablement là qu’ils faisaient pousser leurs tubercules. Tout était semblable, et en même temps différent. Ici, l’or semblait aussi commun que le fer en Chine, sauf que nulle part on ne voyait de fer.
Le palais qui dominait la ville était énorme, plus gros que la Cité Interdite de Beijing, avec plein de bâtiments rectangulaires disposés en damiers. Tout était sur le même modèle que leurs tissus. Des colonnes de pierre, dans la cour, devant le palais, étaient sculptées de motifs étranges, d’oiseaux et d’animaux mélangés, peints de toutes les couleurs, si bien que Kheim avait du mal à les regarder. Il se demanda si les curieuses créatures qu’ils représentaient vivaient dans l’arrière-pays, ou si c’étaient leurs versions du dragon et du phénix. Il vit beaucoup de cuivre, de bronze et de laiton, mais surtout de l’or. Les gardes, debout en rang autour du palais, tenaient de longues lances à pointe d’or, et des boucliers, également en or. Décoratif, mais pas très pratique. Leurs ennemis ne devaient pas avoir de fer non plus.
À l’intérieur du palais, on les emmena dans une vaste pièce avec un mur ouvert sur une cour, les trois autres étant recouverts de filigrane d’or. Des couvertures étaient étalées par terre, et Kheim, Bouton d’Or et les autres Chinois furent invités à s’asseoir sur l’une d’elles.
L’empereur entra. Tout le monde s’inclina, et s’assit par terre. L’empereur prit place sur un tissu à carreaux près des visiteurs, et dit quelque chose, poliment. C’était un homme d’une quarantaine d’années, beau, avec de belles dents blanches, un front large, des pommettes hautes, proéminentes, des yeux marron clair, un menton pointu et un nez busqué. Il portait une couronne d’or, ornée de petits têtes d’or qui se balançaient dans des trous percés dans la coiffe, comme les têtes de pirates aux murailles de Hangzhou.
Cela aussi mit Kheim mal à l’aise. Il changea son pistolet de place sous son manteau, et regarda subrepticement autour de lui. Il ne vit rien d’autre de troublant. Évidemment, il y avait ces hommes au regard dur, manifestement les gardes de l’empereur, prêts à bondir au moindre signe de danger – ce qui paraissait normal quand il y avait des étrangers dans le coin. Mais en dehors de ça, rien.
Un prêtre portant une cape faite de plumes d’oiseau bleu cobalt entra et se livra à une cérémonie pour l’empereur. Ensuite, ils festoyèrent toute la journée. Ils mangèrent une viande qui ressemblait à de l’agneau, des légumes, et des purées que Kheim ne reconnut pas. En dehors d’un alcool vraiment fort, ils n’eurent à boire que de la bière légère. Kheim finit par se sentir un peu ivre, et il vit que ses hommes n’allaient pas mieux que lui. Bouton d’Or n’aima aucune des saveurs, et mangea et but très peu. Dans la cour, au-dehors, des hommes dansaient au rythme des tambours et des flûtes de roseau. Ils ressemblaient beaucoup aux musiciens coréens, ce qui surprit Kheim ; il se demanda si les ancêtres de ces gens avaient dérivé de Corée plusieurs années auparavant, emmenés par le Kuroshio. Peut-être ce pays tout entier avait-il été peuplé par quelques vaisseaux égarés, il y avait de nombreuse dynasties de cela. D’ailleurs, la musique réveillait des échos d’un autre âge. Comment savoir ? Il en reparlerait à I-Chin en remontant à bord.
Au coucher du soleil, Kheim manifesta le désir de regagner son bâtiment, justement. L’empereur se contenta de le regarder, fit un signe au grand prêtre et se leva. Tout le monde l’imita, puis s’inclina de nouveau. Il quitta la pièce.
Lorsqu’il fut parti, Kheim prit Bouton d’Or par la main et essaya de la ramener par le chemin qu’ils avaient suivi pour venir bien qu’il ne fut pas trop sûr de s’en souvenir ; mais les gardes les empêchèrent de sortir, leur barrant la porte avec leurs lances à pointe d’or, dans une attitude aussi cérémonielle que leurs danses, un peu plus tôt.
Kheim exprima, par gestes, son déplaisir, ce qui n’était pas très difficile, et indiqua que Bouton d’Or serait triste et en colère si on l’empêchait de retourner sur son bateau. Mais les gardes ne bougèrent pas.
Voilà. Ça devait arriver. Kheim se maudissait d’avoir quitté la plage avec des gens aussi étranges. Il pensa au pistolet sous son manteau. Il n’aurait droit qu’à un seul coup. Il n’avait plus qu’à espérer qu’I-Chin réussirait à les sauver. C’était une bonne chose qu’il ait insisté pour que le docteur restât en arrière ; il savait qu’I-Chin était le plus à même d’organiser une opération de sauvetage.
Les captifs passèrent la nuit blottis les uns contre les autres sur leur couverture, entourés de gardes qui ne dormirent pas mais passèrent leur temps debout, à mâcher de petites feuilles qu’ils tiraient de pochons cachés sous leurs tuniques à carreaux. Ils les regardaient, les yeux brillants. Kheim entoura Bouton d’Or de ses bras, et elle se lova comme une chatte contre lui. Il faisait froid. Kheim dit aux autres de se masser autour d’eux, la protégeant par leur seul contact, ou du moins la proximité de leur chaleur.
À l’aube, l’empereur revint, vêtu comme un paon gigantesque, ou un phénix, accompagné par des femmes portant des cônes d’or sur les seins, étrangement formés comme de vrais seins, avec des tétons en rubis. Elles encadraient un enfant, un garçon d’après Kheim, bien qu’il n’en fut pas sûr. En les voyant, Kheim fut pris de l’espoir absurde que tout irait bien. Puis, derrière eux, entrèrent le grand prêtre et un personnage portant un masque à damiers, dont la coiffe était ornée de petits crânes pendouillants. Une image de leur dieu de la mort, à n’en pas douter. Il était là pour les exécuter, pensa Kheim. Cela lui causa un tel choc qu’il fut plongé dans un état de conscience supérieure où l’or, plaqué de blanc par le soleil, et l’espace autour de lui gagnaient en profondeur et en densité. Les indigènes à carreaux y paraissaient aussi réels et vivants que des démons festoyant.
On les conduisit dehors dans la lumière rasante, brumeuse. Ils commencèrent à monter en direction du soleil levant. Ils montèrent toute la journée, et la journée du lendemain aussi, jusqu’à ce que Kheim se sente étouffer. Il s’arrêtait de temps en temps sur une corniche pour regarder, stupéfait, derrière lui, vers le bas, tout en bas, vers la mer, qui était une surface texturée, bleue, extrêmement plate et tellement loin, si LOIN. Il n’avait jamais imaginé pouvoir monter aussi haut au-dessus de l’océan. C’était comme s’il volait. Et pourtant, il y avait des monts encore plus hauts devant eux et, sur certaines crêtes de la chaîne de montagnes, des volcans blancs, massifs, comme des super Fuji.
Ils marchèrent vers ces montagnes. On les nourrissait bien, et on leur donnait à boire une infusion aussi amère que l’alun ; ensuite, au cours d’une cérémonie musicale, rituelle, on leur donna des sachets de feuilles de thé, les mêmes feuilles vertes, aux bords dentelés, que leurs gardes avaient mâchées la première nuit. Les feuilles étaient également amères. Elles lui engourdirent la bouche et la gorge, mais ensuite Kheim se sentit mieux. Les feuilles étaient un stimulant, comme le thé ou le café. Il dit à Bouton d’Or et à ses hommes qu’ils pouvaient mâcher les leurs, s’ils voulaient. La maigre force qui s’insinua en lui lui donna suffisamment de ki pour commencer à échafauder un plan d’évasion.
Il semblait peu probable qu’I-Chin puisse traverser la ville de boue et d’or pour les suivre, mais Kheim ne pouvait s’empêcher de l’espérer. C’était une sorte d’espoir démesuré, qu’il éprouvait chaque fois qu’il regardait le visage de Bouton d’Or, que ne flétrissait pas encore le doute ou la peur. Pour elle, ce n’était que la dernière étape d’un voyage déjà aussi étrange que possible. Cette partie était intéressante, en fait, avec ses couleurs de gorge d’oiseau, ses ors et ses montagnes. Elle ne semblait pas affectée par l’altitude à laquelle ils étaient montés.
Kheim commençait à comprendre que les nuages, qui s’étalaient à présent souvent en dessous d’eux, existaient dans un air plus froid et moins riche que la précieuse soupe salée qu’ils respiraient au niveau de la mer. Une fois, il crut respirer une bouffée d’air marin. Peut-être était-ce seulement le sel qui stagnait encore dans ses cheveux ? En tout cas, il en eut faim comme on a faim de nourriture. Avoir envie de manger de l’air ! Rien que de penser à quelle altitude ils étaient, il en avait le frisson.
Et pourtant, ils n’étaient pas au bout de leurs peines. Ils gravirent une crête enneigée. La piste était damée d’une matière blanche, dure. On leur donna des bottes à semelle molle, avec de la fourrure à l’intérieur, des tuniques plus lourdes et des couvertures avec des trous pour la tête et les bras, toutes ornées de motifs à damiers compliqués, avec des petites silhouettes dans les carrés. La couverture de Bouton d’Or était si longue qu’on aurait dit une robe de prêtresse bouddhiste. Elle était faite d’un tissu si fin que Kheim en fut soudain effrayé. Le petit garçon portait une cape, aussi belle que celle du grand prêtre.
Ils arrivèrent à un campement fait de roches plates, qui dépassaient de la neige. Ils firent un grand feu dans une fosse enfoncée dans cette plate-forme, et dressèrent autour un certain nombre de tentes. Leurs ravisseurs s’installèrent sur leur couverture et prirent un repas accompagné de nombreuses tasses de leur thé bouillant, de bière et de liqueur, après quoi ils firent une cérémonie en l’honneur du soleil couchant, qui sombrait dans les nuages massés sur l’océan. Ils étaient bien au-dessus des nuages, maintenant, et pourtant, au-dessus d’eux, à l’est, un grand volcan s’élevait dans le ciel indigo, ses flancs luisant d’un rose profond au moment même où le soleil jetait ses derniers feux.
La nuit fut glaciale. Kheim tint encore Bouton d’Or contre lui, la peur le réveillant chaque fois qu’elle bougeait. La fillette semblait même parfois cesser de respirer, puis recommençait, comme toujours.
On les réveilla à l’aube, et Kheim but avec reconnaissance le thé chaud qu’on leur distribua, avant un repas substantiel, puis d’autres petites feuilles vertes à mâcher ; bien que ces dernières lui soient données par le dieu exécuteur.
Ils recommencèrent à gravir le flanc du volcan alors que ce n’était encore qu’une pente de neige grise sous le ciel blanc de l’aube. L’océan, à l’ouest, disparaissait sous les nuages. Mais ils commençaient à se dissiper, et Kheim put voir, au loin, très loin en dessous, la grande étendue bleue qui était pour lui comme son village natal ou son enfance.
Le froid gagnait en intensité alors qu’ils montaient. Ils avaient de plus en plus de mal à marcher. La terre crissait sous leurs pas, et de petits morceaux de neige compacte tintaient et luisaient. Le sol était brillant, le reste, partout ailleurs, trop sombre ; la colonne de gens se fondait dans un ciel bleu-noir. Kheim pleurait, tellement il faisait froid. Les larmes roulaient sur ses joues et gelaient dans ses fines moustaches grises. Mais il avançait toujours, prenant bien soin de mettre ses pas dans les pas du garde qui le précédait, tendant autant que faire se pouvait la main dans son dos pour tenir celle de Bouton d’Or et la tirer.
Finalement, alors qu’il avait oublié de regarder vers le haut depuis un moment, ne s’attendant plus à ce que ça change jamais, la pente neigeuse s’atténua. Des roches noires, dénudées, apparurent, surgissant de la neige à droite et à gauche, et surtout devant eux, où il ne voyait rien de plus haut.
C’était bel et bien le sommet : une vaste étendue de roches dévastées pareille à de la boue gelée, déchiquetée, mêlée de glace et de neige. Au point le plus élevé de la masse torturée, quelques poteaux se dressaient. En haut flottaient des bandes de tissu et des drapeaux, comme dans les montagnes du Tibet. Peut-être venaient-ils du Tibet ?
Le grand prêtre, le dieu exécuteur et les gardes s’assemblèrent au pied de ces rochers. Les deux enfants furent emmenés vers le prêtre, des gardes retenant Kheim. Il recula, faisant mine d’abandonner, et mit les mains sous sa couverture comme s’il avait les doigts gelés ; en fait, à la recherche de son pistolet. L’ayant trouvé, il l’arma et le tira de sous son manteau, le gardant caché sous la couverture.
On donna encore un peu de thé chaud aux enfants, qu’ils burent de bon cœur. Le prêtre et ses acolytes se mirent à chanter, face au soleil, leurs tambours suivant le rythme du pénible pouls qui battait derrière les yeux à demi aveugles de Kheim. Il avait un affreux mal de tête, et tout semblait n’être que l’ombre de soi-même.
Derrière eux, sur la crête enneigée, des silhouettes montaient très vite. Elles portaient les couvertures locales, mais Kheim pensa qu’elles ressemblaient à I-Chin et à ses hommes. Beaucoup plus loin en dessous, un autre groupe s’échinait à leur poursuite.
Kheim avait déjà le cœur qui battait ; à présent, il grondait dans sa poitrine comme les tambours cérémoniels. Le dieu exécuteur prit un couteau d’or dans un fourreau de bois richement sculpté et trancha la gorge du petit garçon. Il recueillit dans un bol d’or le sang, qui se mit à fumer dans le soleil. Au son des tambours, des flûtes et des chants de prières, le corps fut enroulé dans un manteau fait du doux tissu à carreaux, et délicatement déposé au creux du pic, dans une faille entre deux grosses pierres.
L’exécuteur et le grand prêtre se tournèrent alors vers Bouton d’Or, qui se débattit vainement. Kheim sortit son pistolet de sous la couverture, vérifia le silex, visa à deux mains le dieu exécuteur, puis hurla quelque chose et bloqua sa respiration. Les gardes s’approchèrent de lui, et l’exécuteur le regarda. Kheim appuya alors sur la détente. Le pistolet claqua : il y eut un champignon de fumée, et Kheim recula de deux pas. Le dieu exécuteur tomba à la renverse et glissa sur une étendue de neige, le sang coulant à flots de sa gorge. Le couteau d’or tomba de sa main ouverte.
Tous regardèrent en ouvrant de grands yeux le dieu exécuteur, inanimé ; personne ne comprenait ce qui s’était passé.
Kheim garda le pistolet braqué sur eux, tout en fouillant dans son sac de ceinture à la recherche de la poudre, de la balle et de la bourre. Il rechargea le pistolet devant eux en hurlant, une ou deux fois, ce qui les fit sursauter.
Le pistolet rechargé, il visa les gardes, qui reculèrent. Certains se mirent à genoux, d’autres s’éloignèrent d’une démarche incertaine. C’est alors qu’il vit I-Chin et ses marins patauger dans la neige sur la dernière pente. Le grand prêtre dit quelque chose, puis Kheim le visa soigneusement avec son pistolet et tira.
De nouveau, le pistolet claqua avec un bruit assourdissant, un vrai coup de tonnerre ; de nouveau, le panache de fumée blanche monta du canon. Le grand prêtre vola en arrière comme s’il avait été frappé par un poing géant, dévala la pente et resta à gigoter dans la neige, sa cape tachée de sang.
Kheim marcha à travers la fumée vers Bouton d’Or. Il la souleva, l’arrachant à ses ravisseurs, qui frémissaient, comme tétanisés. Il descendit la piste en la portant dans ses bras. Elle n’était qu’à moitié consciente – le thé était très probablement drogué.
Kheim s’approcha d’I-Chin qui soufflait et haletait à la tête d’une bande de marins, armés jusqu’aux dents d’un fusil à pierre, d’un pistolet et d’un mousquet.
— On retourne aux bateaux ! ordonna Kheim. Au premier geste suspect, tirez !
La descente fut infiniment plus facile que la montée. En fait, cette impression de facilité était un danger en elle-même, parce que la tête leur tournait, qu’ils étaient à moitié aveuglés et si las qu’ils avaient tendance à déraper – d’autant plus que, la température se réchauffant, la neige se ramollissait et se collait à leurs semelles. En outre, comme Kheim portait Bouton d’Or, il ne voyait pas où il mettait les pieds, et il glissait souvent, parfois lourdement. Heureusement, deux de ses hommes marchaient à ses côtés, le retenant par les coudes. Dans l’ensemble, ils avançaient plutôt bien.
Une foule se massait chaque fois qu’ils approchaient de l’un des villages d’altitude. Kheim confiait alors Bouton d’Or à l’un de ses hommes, de façon à pouvoir lever son pistolet bien haut, pour que tout le monde le voie. Si les gens se mettaient en travers de leur route, il abattait celui qui avait la plus grande coiffe de plumes. La détonation semblait effrayer les indigènes plus encore que la chute soudaine et la mort sanglante de leurs prêtres et de leurs chefs. Kheim en déduisit que, chez eux, les potentats locaux étaient souvent exécutés pour un oui ou pour un non par les gardes de l’empereur.
Quoi qu’il en soit, les gens devant lesquels ils passèrent semblaient surtout pétrifiés par la façon dont les Chinois paraissaient commander au tonnerre – un grand coup de tonnerre, suivi d’une mort instantanée, comme si un éclair avait frappé, ce qui devait arriver assez souvent dans ces hautes montagnes pour leur donner une idée de ce que les Chinois avaient accompli. Un bâton de foudre.
Pour finir, Kheim confia Bouton d’Or à ses hommes et s’avança en conquérant à leur tête, rechargeant son pistolet et tirant sur ceux qui s’approchaient un peu trop, sentant monter en lui une étrange allégresse, éprouvant la force du pouvoir terrible qu’il avait sur ces pauvres sauvages qu’un simple pistolet suffisait à paralyser d’épouvante. Il était leur dieu exécuteur incarné, et il traversait leurs rangs comme s’ils étaient des marionnettes dont on aurait coupé les fils.
À la fin de la journée, ils s’arrêtèrent sur son ordre dans un village, où ils volèrent de la nourriture et mangèrent. Puis ils repartirent jusqu’à la tombée de la nuit. Ils firent halte dans un entrepôt, une immense grange aux murs de pierre et au toit de bois, bourrée jusqu’aux poutres de tissus, de grains et d’or. Kheim les obligea à ne prendre qu’un objet chacun – un bijou ou un unique lingot en forme de disque –, sans quoi ses hommes se seraient tués à porter une tonne d’or sur leur dos.
— Nous reviendrons tous un jour, leur dit-il. Et nous serons plus riches que l’empereur.
Il choisit, pour lui-même, un papillon qui butinait un bouton d’or.
Bien qu’épuisé, il eut du mal à s’empêcher de marcher, et même à se poser. Après un demi-sommeil ponctué de cauchemars, qu’il passa quasi assis à côté de Bouton d’Or, il réveilla tout le monde avant l’aube et ils repartirent vers le pied de la montagne, leurs armes à feu chargées et prêtes à tirer.
Alors qu’ils descendaient vers la côte, il devint évident que des coureurs les avaient précédés dans la nuit et avaient averti les indigènes, en bas, du désastre qui s’était produit au sommet. Une force d’hommes en armes occupait le carrefour juste au-dessus de la grande ville côtière, hurlant au son des tambours, brandissant des massues, des boucliers, des lances et des piques. Ils avaient manifestement l’avantage du nombre sur les Chinois, les hommes qu’I-Chin avait emmenés n’étant qu’une cinquantaine face aux quatre cents ou cinq cents guerriers locaux.
— Déployez-vous, leur ordonna Kheim. Descendez vers eux au milieu de la route en chantant « Encore Ivre Sur le Grand Canal ». Brandissez vos armes devant vous, et quand je vous dirai de vous arrêter, arrêtez-vous et visez leurs chefs – celui qui a le plus de plumes sur la tête. Quand je dirai « feu ! » vous tirerez tous ensemble et vous rechargerez. Rechargez aussi vite que vous le pourrez, mais attendez mon ordre pour tirer. Quand je vous le dirai, tirez et rechargez à nouveau.
Ils descendirent donc la route en chantant à pleins poumons la vieille chanson à boire, puis ils s’arrêtèrent et tirèrent une première salve. Leurs mousquets auraient aussi bien pu être une bordée de canons, parce qu’ils firent le même effet : beaucoup d’hommes tombèrent, foudroyés, couverts de sang, les survivants s’enfuyant à toutes jambes, paniqués.
Une salve avait suffi pour se rendre maîtres de la ville. Ils auraient pu la réduire en cendres, ils auraient pu la piller ; mais Kheim les fit marcher dans les rues aussi vite que possible, en chantant à tue-tête, jusqu’à la plage, où ils retrouvèrent leurs chaloupes. Ils étaient sains et saufs. Ils n’avaient même pas été obligés de tirer une seconde fois.
Kheim s’approcha d’I-Chin et lui serra la main.
— Mille mercis, lui dit-il solennellement devant tous ses hommes. Tu nous as sauvés. Sans vous, ils auraient sacrifié Bouton d’Or comme un agneau, et ils nous auraient tous tués comme des mouches.
Kheim pensait raisonnablement que les indigènes se remettraient bientôt du choc provoqué par les armes à feu, après quoi, ils étaient si nombreux qu’ils auraient l’avantage. Ils se massaient déjà à distance respectable, pour les observer. Alors, après avoir fait monter Bouton d’Or et la plupart des hommes sur les bateaux, Kheim s’entretint avec I-Chin et le cambusier, afin de voir ce dont ils avaient besoin pour retraverser le Dahai. Ensuite, il emmena un groupe de marins en armes sur le rivage, pour une dernière expédition. Les canons tirèrent une salve d’avertissement sur la ville, puis ses hommes et lui marchèrent tout droit sur le palais, au pas et en chantant, au rythme des tambours. Arrivés au palais, ils encerclèrent rapidement les murailles et se saisirent d’un groupe de prêtres et de femmes qui tentaient de fuir par-derrière. Pour faire bonne mesure, Kheim tua un prêtre d’un coup de fusil et demanda à ses hommes de ligoter les autres.
Ensuite, il se planta devant les prêtres et exprima ses exigences à l’aide de gestes. Il avait encore très mal à la tête, mais il planait, en proie à l’étrange exaltation de la mise à mort. Comme c’était facile de traduire par gestes une longue liste d’exigences ! Il se montra du doigt, montra ses hommes, indiqua l’ouest d’une main, et fit voguer l’autre sur le vent. Il leur montra des feuilles de thé, des sacs de nourriture, et leur fit comprendre que c’était ce qu’il voulait. Il mima leur transfert sur la plage. Il s’approcha du chef des otages, mima le fait de le détacher puis un au revoir. Si les marchandises n’arrivaient pas, alors… il pointa le canon de son arme vers chacun des otages. Mais si elles arrivaient, les Chinois libéreraient tout le monde et s’en iraient.
Il joua chaque étape de ce processus sans quitter les otages des yeux, ne parlant qu’en de très rares occasions, pour ne pas les distraire. Puis il ordonna à ses hommes de relâcher les femmes, quelques-uns des hommes qui n’avaient pas de coiffe de plumes, et les envoya, avec des instructions claires, chercher les marchandises requises. Il voyait, à leur regard, qu’ils avaient parfaitement compris ce qu’ils avaient à faire.
Après cela, il conduisit les otages vers la plage, et ils attendirent. L’après-midi même, des hommes apparurent dans l’une des rues principales de la ville. Ils croulaient sous des sacs qu’ils portaient sur le dos, attachés par des cordes passées autour de leur front. Ils déposèrent leurs fardeaux sur le sable, s’inclinèrent et repartirent, sans oser tourner le dos aux Chinois. De la viande séchée ; des gâteaux de céréales ; les petites feuilles vertes ; des disques d’or et des ornements – bien que Kheim ne leur ait rien demandé de pareil – ; des couvertures et des ballots de leur fameux tissu doux. En regardant ces offrandes étalées sur la plage, Kheim eut l’impression d’être un collecteur d’impôts, vorace et cruel. Mais il se sentait également soulagé, et comme habité d’une puissance souterraine, mystérieuse, venue d’un pouvoir qu’il ne comprenait pas, ou qu’il ne contrôlait pas. Par-dessus tout, il se sentait content. Ils avaient enfin ce qu’il leur fallait pour rentrer chez eux.
Il libéra lui-même les otages, leur fit signe de s’en aller. Il donna à chacun une balle de fusil, enroulant leurs doigts gourds autour.
— Nous reviendrons un jour, leur dit-il. Nous ou des gens pires que nous.
Il se demanda fugitivement s’ils attraperaient la variole, comme les Miwoks – ses marins ayant dormi sur les couvertures des indigènes, au palais.
Il n’avait aucun moyen de le savoir. Les indigènes s’éloignèrent en titubant, en serrant leur balle de fusil ou en la laissant tomber. Leurs femmes étaient plantées à distance raisonnable, heureuses de voir que Kheim avait tenu la promesse faite par gestes, heureuses de voir leurs hommes libérés. Kheim ordonna à ses marins de remonter dans les bateaux. Ils retournèrent à la rame aux bâtiments et s’éloignèrent de la grande île montagneuse.
Après toutes ces péripéties, retrouver les eaux du Grand Océan fut un vrai bonheur, à la fois paisible et familier. La ronde des jours reprit. Ils suivaient le soleil vers l’ouest, toujours vers l’ouest. La plupart du temps, il faisait chaud, le soleil brillait. Puis, un mois durant, les nuages se mirent à grossir tous les matins, pour crever dans l’après-midi en de longues averses grises. Mais l’orage se dissipait rapidement. Ensuite les vents se mettaient à souffler, venant du sud-est, gonflant leurs voiles. Les souvenirs de la grande île qu’ils laissaient derrière eux commencèrent à ressembler à des rêves, ou à ces légendes qu’ils avaient entendues sur le royaume des asuras. Sans Bouton d’Or, ils auraient eu du mal à croire à tout ce qui leur était arrivé.
Bouton d’Or s’amusait sur le navire amiral. Elle jouait dans le gréement comme un petit singe. Il y avait des centaines d’hommes à bord, mais la présence d’une simple petite fille changea tout : leur traversée s’en trouvait bénie. Les autres navires restaient près du vaisseau amiral dans l’espoir de l’apercevoir, ou bien de recevoir la bénédiction d’une éventuelle visite. La plupart des marins voyaient en elle la déesse Tianfei, voyageant avec eux pour leur sauvegarde. C’était pour ça que leur voyage de retour se déroulait beaucoup plus facilement que l’aller. Le temps était plus favorable, l’air plus chaud, il y avait plus de poissons. À trois reprises, ils passèrent près de petits atolls inhabités, et purent s’y ravitailler en noix de coco et en cœurs de palmier, et même une fois en eau douce. Plus important, sentit Kheim, ils filaient droit vers l’ouest. Ils rentraient chez eux. Cela ressemblait si peu à leur premier voyage qu’ils avaient peine à croire qu’il s’agissait de la même mer. Et dire que seule la direction avait changé ! Mais il était bien difficile de laisser le soleil derrière soi, et de quitter le monde…
Naviguer, jour après jour. Le soleil se levant à la poupe, se couchant à la proue, s’y noyant avec eux. Maintenant le soleil les aidait – peut-être même un peu trop –, c’était le septième mois, et il faisait une chaleur infernale ; puis le vent tomba pendant presque tout le mois. Ils prièrent Tianfei, en affectant de ne pas regarder Bouton d’Or.
Elle jouait dans les cordages, indifférente à leurs regards de côté. Elle parlait plutôt bien le chinois, maintenant, et avait appris à I-Chin tout le miwok dont elle se souvenait encore. I-Chin avait noté chaque mot dans un dictionnaire, en prévision des éventuelles futures expéditions vers la nouvelle île. C’était intéressant, disait-il à Kheim, parce que d’ordinaire il se contentait de choisir les idéogrammes ou combinaisons d’idéogrammes qui ressemblaient le plus au mot miwok prononcé devant lui, et rédigeait une définition aussi précise que possible du sens miwok, en fonction de la source d’information. Seulement voilà, en lisant les idéogrammes pour prononcer ce mot, il était impossible de ne pas entendre en même temps leur sens chinois, de telle sorte que le vocabulaire miwok devenait un ensemble d’homonymes supplémentaire à ajouter à la quantité déjà gigantesque de vocables chinois. De nombreux symboles littéraires ou religieux chinois reposaient sur des homonymies de pur hasard, qui produisaient d’heureuses connexions métaphoriques. Ainsi, par exemple, le dixième jour du mois, ski, était aussi l’anniversaire de la pierre, shi ; ou bien un dessin de héron et de lotus, lu et lian, formaient, par homonymie, le message « puisse votre route (lu) aller vers le haut (lian) » ; ou encore un signe tracé sur le dos d’un autre pouvait vouloir dire également « puissiez-vous être gouverneur de génération en génération ». À présent, pour I-Chin, le mot miwok qui voulait dire « rentrer à la maison » ressemblait à wu ya, cinq canards, tandis que le miwok « nager » ressemblait à Peng-zu, ce personnage de légende qui avait vécu huit cents ans. Alors il chantait « cinq canards rentrant à la maison, cela ne prend que huit cents ans », ou « je vais sauter par-dessus bord et devenir Peng-zu », et Bouton d’Or riait aux larmes. D’autres similarités dans le langage maritime des deux langues faisaient suspecter à I-Chin que l’expédition de Hsu Fu vers l’est avait peut-être réussi à atteindre le continent océanique du Yingzhou, et y avait laissé quelques mots chinois, à défaut d’autre chose ; à moins que les Miwoks ne fussent eux-mêmes les descendants de cette expédition.
Quelques hommes parlaient déjà de repartir vers cette nouvelle terre, généralement vers le royaume doré plus au sud, pour le soumettre par les armes et rapporter son or dans le vrai monde. Ils ne disaient pas : Nous le ferons, qui aurait pu leur porter malheur, évidemment, mais plutôt : Si quelqu’un devait le faire. Les autres les écoutaient d’une oreille distraite mais n’en pensaient pas moins, en se disant que si Tianfei leur permettait de rentrer chez eux, jamais rien ne pourrait les convaincre de repartir encore de l’autre côté du Dahai.
Puis ils furent pris dans une zone de calme, dans une partie de l’océan où il n’y avait pas de pluie, de nuage, de vent, ou même de courant. C’était comme si une malédiction s’était abattue sur eux, probablement parce qu’ils avaient parlé un peu légèrement de revenir piller l’or. Ils commencèrent à rôtir au soleil. Mais, comme des requins tournaient dans l’eau, ils ne pouvaient aller y nager pour se rafraîchir. Ils durent se contenter de tendre une voile entre deux des vaisseaux, et de la laisser tremper jusqu’à ce qu’il y ait assez d’eau à l’intérieur pour former un bassin, où ils plongeaient. Ils avaient de l’eau jusqu’à la taille. Kheim permit à Bouton d’Or de passer une chemise et d’y plonger elle aussi. Lui interdire quoi que ce soit aurait risqué de provoquer la colère et la furie de l’équipage. En fait, on s’aperçut qu’elle nageait comme une loutre. Les hommes la traitèrent comme la déesse qu’elle était, et elle rit de leurs jeux de garçons. Faire enfin quelque chose de différent était un réel soulagement, mais la voile ne put longtemps supporter leurs bonds, l’humidité, le poids de leurs pieds et celui de l’eau. Peu à peu, elle se déchira. Et ils ne le firent qu’une fois.
Tout était si calme qu’ils finirent par se trouver en danger. Ils seraient bientôt à court d’eau, puis de nourriture. Peut-être que de légers courants continuaient de les mener vers l’ouest, mais I-Chin n’était pas optimiste.
— On dirait plutôt que nous nous sommes aventurés dans le centre du grand courant circulaire, comme au cœur d’un tourbillon.
Il conseilla de mettre le cap le plus au sud possible, afin de revenir à la fois vers les vents et les courants, et Kheim l’approuva, sauf qu’il n’y avait pas de vent pour faire voile. Cela ressemblait plus au premier mois de leur expédition, mais sans le Kuroshio. Ils parlèrent encore une fois de mettre les chaloupes à la mer et de remorquer les grands navires derrière eux à la rame, mais les bâtiments étaient trop imposants pour pouvoir être déplacés par la seule force des rames, et I-Chin trouvait dangereux d’abîmer la paume des mains des marins alors qu’ils étaient déjà déshydratés. Ils ne pouvaient rien faire d’autre, de toute la journée, que d’entretenir leurs alambics, les laisser au soleil, continuer à pomper et rationner le peu d’eau qu’il leur restait en réserve. Bouton d’Or avait beau répéter qu’elle voulait faire comme tout le monde, ils lui donnaient à boire en quantité. Ils lui auraient donné leur dernière gorgée d’eau.
C’en était arrivé au point où I-Chin leur demanda de garder leur urine jaune foncé et de la mélanger à ce qu’il leur restait d’eau, lorsque des nuages noirs apparurent au sud, et qu’il devint évident que leur problème ne serait bientôt plus de n’avoir pas assez d’eau, mais d’en avoir trop. Le vent se mit à souffler par rafales, les nuages roulaient en grondant, et des trombes d’eau s’abattirent sur eux. Des entonnoirs furent déployés au-dessus des tonneaux, qui se remplirent instantanément. Puis il fallut sortir de l’orage. Seuls des vaisseaux aussi gros que les leurs étaient assez hauts et flexibles pour résister assez longtemps à un pareil assaut ; et même les Huit Grands Navires, desséchés au-dessus de leur ligne de flottaison comme ils l’avaient été dans la zone de calme, fuyaient de partout, cassant la plupart des cordes et des goupilles qui les reliaient les uns aux autres, de telle sorte que la sortie de l’orage devint bientôt un permanent, humide et frénétique exercice de colmatage de fuites, de réparations de cordes, de bridoles et d’espars cassés.
Pendant tout ce temps les vagues ne cessèrent de grossir, tant et si bien que les navires semblaient escalader et dévaler d’énormes collines bouillonnantes, roulant et tanguant du sud vers le nord à un rythme tourmenté mais inexorable, et parfois majestueux. Le navire amiral prit ces vagues de face, noyant le pont supérieur sous une mer d’écume, après quoi ils eurent un court moment la vision de ce chaos qui s’étendait d’un horizon à l’autre. Du bord, ils ne voyaient plus que deux ou trois navires, oscillant à des rythmes différents puis renvoyés dans les flots noirs et tumultueux. Globalement, il n’y avait rien d’autre à faire que de se terrer dans sa cabine, trempé et apeuré, incapable d’entendre son voisin parler tant la tempête faisait rage.
Au plus fort de la tourmente, ils entrèrent dans l’œil du cyclone, cette étrange et terrifiante zone de calme à l’intérieur de laquelle des vagues désordonnées bondissaient en tout sens, se rentrant l’une dans l’autre et projetant des lances liquides dans la nuit, tandis que tout autour de bas nuages noirs dévoraient l’horizon. C’était donc un typhon, ce qui ne surprit personne. Comme dans le symbole du yin et du yang, il y avait des parcelles de calme au sein du vent. Mais cela changerait bientôt, selon l’éternel mouvement de balancier.
Ils s’empressèrent donc de réparer les dégâts, sentant comme on le sent toujours qu’en avoir traversé la moitié, c’était pouvoir traverser l’autre. Kheim aperçut dans l’obscurité le navire le plus proche du leur, qui semblait en détresse. Les hommes se cramponnaient au bastingage, ne quittant pas des yeux Bouton d’Or, que certains appelaient en criant. Ils pensaient sans aucun doute que leurs malheurs provenaient du fait qu’elle n’était pas à leur bord. Leur capitaine cria à Kheim qu’il leur faudrait couper leurs mâts pour se sortir de la seconde moitié de la tempête et éviter de chavirer, et que les autres devraient venir les chercher, éventuellement, une fois sortis de l’orage.
Mais quand la seconde partie de la tempête s’abattit sur eux, la situation s’aggrava également pour le navire amiral. Une vague étrange propulsa Bouton d’Or contre le bastingage, où elle se blessa. La peur des hommes devint alors palpable. Ils perdirent les autres navires de vue. Le vent redoubla de force, soulevant de grandes vagues, les changeant en écume, dont les crêtes s’abattaient sur le navire comme pour le couler. La roue du gouvernail s’envola, ce qui fit d’eux, malgré leurs efforts pour essayer de la remplacer par une vergue, une épave, que chaque vague ébranlait. Alors que les hommes luttaient pour avancer quand même et sauver leur navire, quelques-uns passèrent par-dessus bord, tandis que d’autres se noyaient dans les haubans au passage des vagues énormes. I-Chin, lui, s’occupa de Bouton d’Or. Il cria à Kheim qu’elle s’était cassé un bras et apparemment quelques côtes. Kheim vit qu’elle était à bout de souffle. Il retourna aider ses hommes à ralentir leur allure, et ils parvinrent finalement à jeter une ancre flottante à la mer, qui les fit tourner dans le vent. Cela les sauva pendant un instant, mais les vagues qui passaient par-dessus la proue étaient gigantesques, et il leur fallut tous leurs efforts pour éviter que les écoutilles ne s’arrachent et que les compartiments du navire ne s’emplissent d’eau. Tout cela fut fait dans la plus grande angoisse pour Bouton d’Or, les hommes se reprochant amèrement de n’avoir pas mieux veillé sur elle, ce qui était inexcusable. Une chose pareille n’aurait jamais dû arriver. Kheim savait que la responsabilité lui en incombait.
Quand il put enfin souffler un instant, il alla la trouver, dans la plus haute cabine du pont, à l’arrière, et regarda d’un air suppliant I-Chin, qui ne dit rien pour le rassurer. Elle toussait, crachant une sorte de sang mousseux, très rouge. I-Chin dut quelquefois le lui retirer de la gorge à l’aide d’un tube qu’il enfonçait dans sa bouche.
— Une côte a percé un poumon, dit-il rapidement, les yeux rivés sur elle.
Elle restait là, les yeux grands ouverts, souffrant mais ne se plaignant pas. Elle dit seulement :
— Qu’est-ce qui m’arrive ?
Après qu’I-Chin lui eut une nouvelle fois nettoyé la gorge, il lui rapporta ce qu’il avait dit à Kheim. Elle haletait comme un chien, par petits coups brefs et rapides.
Kheim retourna au chaos mouillé qui ravageait les ponts supérieurs. Le vent et les vagues n’étaient pas pires que tout à l’heure, peut-être un peu plus calmes. Il y avait des tas de problèmes, petits et grands, dont il fallait s’occuper, et il s’y attela, furieusement, marmonnant pour lui-même ou insultant les dieux ; peu importait, de toute façon, on n’entendait rien sur les ponts du navire, à moins de le crier directement dans les oreilles.
— S’il te plaît, Tianfei, reste avec nous ! Ne nous abandonne pas ! Laisse-nous rentrer chez nous ! Permets-nous de revenir dire à l’empereur ce que nous avons trouvé pour lui. Laisse la fille vivre.
Ils se sortirent de l’orage, mais Bouton d’Or mourut le jour suivant.
Seuls trois navires se retrouvèrent sur la mer enfin calme. Ils enroulèrent le corps de Bouton d’Or dans une robe d’homme, y attachèrent deux des disques d’or de l’empire de la montagne, et la laissèrent glisser par-dessus bord, dans l’eau. Tous les hommes pleuraient, même I-Chin, et Kheim pouvait à peine prononcer les paroles de la prière funéraire. Qu’y avait-il à prier ? Il leur paraissait impossible qu’après tout ce qu’ils avaient traversé un simple orage puisse tuer la déesse de la mer. Elle était pourtant là, sous les flots, sacrifiée à la mer tout comme le petit garçon de l’île avait été sacrifié à la montagne. Le soleil ou le fond des océans, c’était pareil.
— Elle est morte pour nous sauver, dit-il aux hommes laconiquement. Elle a donné cet avatar d’elle-même au dieu des orages, pour qu’il nous laisse vivre. Maintenant nous devons avancer, pour l’honorer. Nous devons rentrer chez nous.
Alors ils réparèrent le navire de leur mieux, et endurèrent un autre mois de vie sans boire. Ce fut le plus long mois du voyage, de leur vie. Tout se cassait, s’abîmait, à bord du navire, de leur propre corps. Il n’y avait pas assez d’eau ni de nourriture. Leur bouche puis leur peau se couvrirent de plaies. Ils avaient très peu de ki, et pouvaient à peine manger la nourriture qui leur restait.
Les pensées de Kheim le quittèrent. Il s’aperçut que quand la pensée s’en allait, les choses se faisaient d’elles-mêmes. On n’avait pas besoin de penser pour faire.
Un jour il pensa : Une voile trop lourde ne peut être hissée. Un autre jour il pensa : Plus qu’assez c’est trop. Trop c’est moins. Alors le moins c’est le plus. Finalement, il vit ce que les taoïstes entendaient par cela.
Suis ta route. Respire, expire. Avance avec la houle. La mer ne sait rien des bateaux, les bateaux ne savent rien de la mer. Flotter se fait tout seul. Équilibre dans l’équilibre. Rester assis sans penser.
La mer et le ciel se fondirent. Bleu, si bleu. Personne ne faisait quoi que ce soit, rien ne se faisait. Ils avançaient, et c’était tout.
Ainsi, quand une vaste mer fut traversée, ce ne fut le fait de personne.
Quelqu’un leva les yeux et vit une île. C’était Mindanao, puis tout l’archipel, Taiwan, et toutes les terres habituelles de la mer Intérieure.
Les Trois Grands Navires qui restaient mirent le cap vers Nanjing, une vingtaine de mois après leur départ, surprenant tous les habitants de la ville, qui pensaient qu’ils avaient rejoint Hsu Fu au fond de l’océan. Ils étaient contents d’être de retour chez eux, pour ça oui, débordant d’histoires à raconter au sujet de ces îles géantes qu’ils avaient vues à l’est.
Mais à chaque fois que Kheim croisait le regard de ses hommes, il voyait de la douleur. Il voyait aussi qu’ils le rendaient responsable de la mort de Bouton d’Or. Aussi fut-il content de quitter Nanjing et de voyager avec un groupe de fonctionnaires le long du Grand Canal, vers Beijing. Il savait que ses marins allaient s’éparpiller le long de la côte, aller chacun de leur côté pour ne pas se croiser, ne pas se souvenir ; il leur faudrait des années avant d’avoir envie de se revoir, et de se rappeler une douleur devenue si pâle et ténue qu’elle leur manquerait, et qu’ils voudraient la ressentir pour se dire : Oui nous avons fait cela, oui la vie a permis que cela soit.
Mais pour l’instant ils ne pouvaient s’empêcher de penser qu’ils avaient échoué. Aussi, quand Kheim fut conduit dans la Cité Interdite, et mené devant l’empereur Wanli pour y recevoir les louanges de tous les hauts fonctionnaires présents, et les remerciements intéressés et gracieux de l’empereur lui-même, il dit, simplement :
— Quand une grande mer est traversée, ce n’est le fait de personne.
L’empereur Wanli hocha la tête, montra l’un des disques d’or qu’ils avaient rapportés avec eux, puis le gros papillon sur son bouton d’or, ses ailes et ses antennes parfaitement dessinées, avec une maîtrise et un talent exceptionnels. Kheim dévisagea l’Envoyé Céleste, s’efforçant de voir l’empereur à l’intérieur de l’empereur caché, l’Empereur de Jade qui se terrait en lui, et dit :
— Ce lointain pays est perdu dans le temps, ses rues sont pavées d’or, ses palais ont des toits en or. Vous pourriez le conquérir en un mois, diriger son immensité, et rapporter tous les trésors qu’il contient, ses forêts infinies et ses fourrures, ses turquoises et son or, plus d’or qu’il n’y en a actuellement dans le monde, et pourtant, cette terre a déjà perdu son plus grand trésor.
Pics enneigés, dominant une contrée noire. Le premier rayon de soleil, aveuglant, inonde tout de blanc. Il aurait pu le faire, alors – tout était si brillant –, il aurait pu se perdre dans le blanc absolu, et ne jamais revenir, emporté dans le Tout, pour l’éternité. Laisse-toi aller, laisse-toi aller. Il faut en avoir beaucoup vu pour souhaiter à ce point se laisser aller.
Mais cela passa, et il se retrouva dans le bardo, sur le plancher noir de la scène du Palais du Jugement, du côté chinois, un labyrinthe cauchemardesque de niveaux numérotés, de chambres d’accusation et de fonctionnaires établissant des listes d’âmes à renvoyer devant des bourreaux tatillons. Au-dessus de cette bureaucratie infernale se dressait l’habituel Tibet de l’estrade, occupé par sa ménagerie de dieux démoniaques, hachant menu les âmes condamnées et jetant leurs morceaux en enfer, ou dans une nouvelle vie, au royaume des bêtes ou des prêtas. La lueur blafarde, sinistre, l’estrade géante, pareille à la paroi d’une mesa, qui s’élevait au-dessus de lui, les dieux aux couleurs hallucinantes, rugissant et dansant, leurs épées lançant des éclairs dans l’air noir ; c’était le jugement – une activité inhumaine –, pas l’hôpital se moquant de la charité, non, le vrai jugement, par des autorités supérieures, les créateurs de l’univers. Ceux, après tout, qui avaient fait les hommes faibles, lâches et cruels – ce qu’ils étaient bien souvent. D’où l’impression que les dés étaient pipés, le destin imposé, et le karma acharné à saccager les plaisirs et les beautés fugaces que l’homme, ce misérable sous-dieu pensant, aurait pu concocter dans la boue de sa vie. Une vie honnête, menée contre vents et marées ? Tu revivras comme un chien ! Une vie de chien, obstinément vécue en dépit de tout ? Tu revivras comme un âne, comme un ver… Ainsi allaient les choses.
Et c’est à cela que songeait Kheim alors qu’il marchait dans le brouillard, en proie à une rage croissante, alors qu’il volait dans les plumes de ces bureaucrates, les assommait avec leur propre ardoise, leurs listes, leurs bouliers, jusqu’à ce qu’il aperçoive Kali et sa suite, plantées au milieu d’un hémicycle, accablant Bouton d’Or, la jugeant – comme si cette pauvre âme simple avait quoi que ce fut à se reprocher à côté de ces dieux meurtriers et des ères entières qu’ils avaient passées à faire le mal – un mal instillé au cœur même du cosmos, qu’ils avaient eux-mêmes créé !
Kheim rugissait, en proie à une fureur pour laquelle il n’y avait pas de mots. Il se jeta sur l’une des déesses de la mort et arracha une épée à l’un de ses six bras armés. Il lui en coupa quelques-uns d’un seul revers de la lame effilée. Les bras restèrent un moment par terre à se tortiller, le sang jaillissant de leurs artères sectionnées, et puis, à l’inexprimable consternation de Kheim, les mains se cramponnèrent aux planches du sol et se déplacèrent comme des crabes, à la force des doigts. Pire, de nouvelles épaules se mirent à pousser au bout des plaies, qui saignaient toujours abondamment. Kheim hurla, les jeta à bas de l’estrade à coups de pied, puis se retourna et coupa Kali en deux au niveau de la taille, ignorant les autres membres de sa jati qui étaient là, avec Bouton d’Or. Ceux-ci faisaient des bonds sur place en criant :
— Oh non, ne fais pas ça, Kheim, ne fais pas ça ! Tu ne comprends pas, tu dois respecter le protocole.
Même I-Chin, qui braillait de toute la force de ses poumons pour se faire entendre malgré les cris des autres.
— Au moins, nous pourrions concentrer nos efforts sur les supports de l’estrade, ou les fioles d’oubli, quelque chose d’un peu plus technique, d’un peu plus subtil !
En attendant, la partie supérieure du corps de Kali se déplaçait sur la scène à l’aide de ses poings, pendant que ses jambes et sa taille titubaient sur place, mais restaient debout. Et les moitiés manquantes repoussaient des sections sanguinolentes comme les cornes d’un escargot. Bientôt, ce furent deux Kali qui avancèrent vers lui, agitant leurs épées avec leurs douze bras.
Il sauta de l’estrade, et atterrit lourdement sur les planches nues du cosmos. Le reste de sa jati tomba à côté de lui, le choc de la chute leur arrachant des cris de douleur.
— Tu nous as attiré des ennuis, pleurnicha Shen.
— Ça ne marche pas comme ça, lui dit Bouton d’Or alors qu’ils s’enfonçaient ensemble en haletant dans les brumes. J’ai vu beaucoup de gens essayer. Ils se déchaînent furieusement et coupent les dieux hideux en morceaux – ils ne l’ont pas volé –, mais les dieux se relèvent d’un bond et se réincarnent en d’autres personnes. C’est l’une des lois karmiques de cet univers, mon ami. Comme la conservation du yin et du yang, ou la gravité. Nous vivons dans un univers gouverné par très peu de lois, mais l’une des principales est que la violence engendre la violence.
— Je n’y crois pas, répondit Kheim, qui s’arrêta le temps de pourfendre les deux Kali qui le poursuivaient à présent.
Il décapita la première d’un solide revers. Une autre tête repoussa prestement, bourgeonnant au milieu du sang qui jaillissait du corps noir, au niveau du cou. Les dents blanches toutes neuves de la nouvelle tête s’ouvrirent sur un grand rire tandis qu’elle le regardait de ses yeux rouge sang, flamboyants. Il comprit qu’il était mal parti ; elle allait le hacher menu. Pour avoir résisté à ces divinités maléfiques, injustes, absurdes et horribles, il allait être réduit en morceaux et renvoyé dans le monde sous la forme d’un âne, d’une mule, ou d’un vieux bonhomme estropié…
LIVRE 4
L’ALCHIMISTE
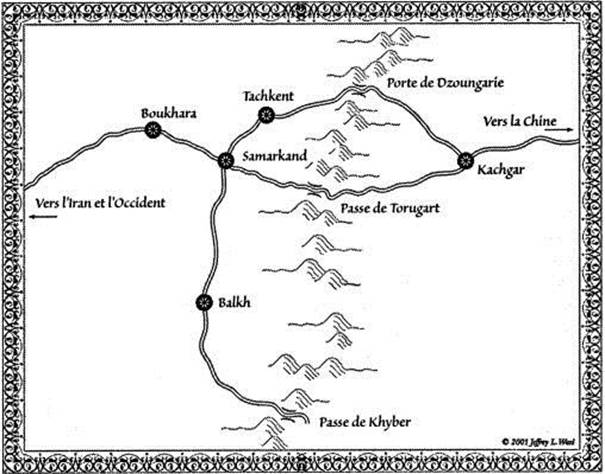
Transmutation
Un jour, alors qu’approchait l’heure où l’œuvre au rouge du maître alchimiste allait atteindre son point culminant – c’est-à-dire la transmutation de métaux ordinaires en or –, le gendre de l’alchimiste, un certain Bahram al-Boukhara, se fraya un chemin en courant à travers le bazar de Samarkand pour une course de dernière minute, ignorant les appels de ses nombreux amis et créanciers.
— Je ne peux pas m’arrêter ! leur cria-t-il. Je suis en retard !
— En retard pour payer tes dettes ! lança Divendi, le marchand de café dont l’éventaire était niché dans un recoin non loin de l’atelier d’Iwang.
— C’est vrai, dit Bahram, s’arrêtant quand même pour prendre un café. Toujours en retard, mais je ne m’ennuie jamais.
— Khalid te fait toujours galoper.
— Au sens propre du terme. Hier, le grand pélican s’est cassé au cours de la descension, et son contenu a giclé juste à côté de moi – du vitriol de Chypre mélangé à du sal ammoniac.
— Dangereux ?
— Oh mon dieu ! Il a éclaboussé mon pantalon, et il a fait des trous dedans. Et je ne te parle pas de la fumée ! J’ai dû me sauver en courant, sinon je serais mort !
— Pour changer.
— Tu as raison. J’en ai craché mes boyaux, et j’ai eu les yeux qui pleuraient toute la nuit. Je me serais cru en train de boire un de tes cafés !
— Je fais toujours le tien avec des détritus !
— Je sais, dit-il en en avalant la dernière gorgée pleine de marc. Alors tu viens demain ?
— Pour voir le plomb se changer en or ? Et comment !
L’atelier d’Iwang était dominé par une haute cheminée de brique.
Grésillements familiers et odeurs du feu bien-aimé, tintement des marteaux et lueurs de verre fondu, Iwang manipulant une tige avec précaution : Bahram salua le souffleur de verre et le forgeron.
— Khalid veut plus de loup.
— Khalid veut toujours plus de loup !
Iwang continua de tourner sa bulle de verre chaud. Grand, large d’épaules, le visage épais, tibétain de naissance mais installé depuis longtemps à Samarkand, c’était l’un des plus proches associés de Khalid.
— T’a-t-il donné de quoi payer, cette fois-ci ?
— Bien sûr que non. Il a dit de le mettre sur sa note.
Iwang retroussa ses lèvres.
— Elle s’est beaucoup allongée ces derniers jours.
— Tout sera payé après-demain. Il a fini la sept cent soixante-dix-septième distillation.
Iwang laissa son travail et se dirigea vers un mur encombré de boîtes. Il tendit à Bahram une petite bourse de cuir, lourde de nombreux morceaux de plomb.
— L’or pousse dans la terre, dit-il. Al-Razi lui-même n’a pas pu en faire pousser dans un creuset.
— Khalid ne serait pas d’accord. De toute façon, al-Razi a vécu il y a longtemps. Il ne pouvait pas obtenir les températures qu’on obtient maintenant.
— Peut-être.
Iwang était sceptique.
— Dis-lui de faire attention.
— De ne pas se brûler ?
— Que le khan ne le brûle.
— Tu viendras le voir ?
Iwang hocha la tête à contrecœur.
Le jour de la présentation arriva, et en guise de miracle, le grand Khalid Ali Abu al-Samarkandi paraissait nerveux. Bahram comprenait pourquoi. Si Sayyed Abdul Aziz Khan, chef du khanat de Boukhara, immensément riche et puissant, choisissait de financer les travaux de Khalid, alors tout irait bien ; mais c’était un homme qu’on n’avait pas intérêt à décevoir. Même Nadir Divanbegi, son secrétaire au trésor et plus proche conseiller, évitait à tout prix de l’offenser. Récemment, par exemple, Nadir avait ordonné la construction d’un nouveau caravansérail sur la partie est de Boukhara. Le khan avait été convié à la cérémonie d’inauguration, et, étant d’un naturel distrait, il les avait félicités d’avoir construit une si belle madrasa. Eh bien, au lieu de rectifier sur-le-champ, Nadir avait ordonné que l’on transformât le caravansérail en madrasa. Voilà quel genre de khan était Sayyed Abdul Aziz ; et c’était le khan devant qui Khalid allait faire la présentation de ses travaux. Bahram en avait l’estomac noué et le cœur qui battait la chamade. Et Khalid avait beau parler avec son autorité, son impatience et son apparente assurance habituelles, Bahram voyait bien qu’il était anormalement pâle.
Mais il avait travaillé sur cette projection pendant des années et des années, étudié tous les textes alchimiques qu’il avait pu trouver, dont de nombreux volumes achetés par Bahram au caravansérail hindou, comme Le Livre du terme de la quête, de Jildaki, Le Livre des balances, de Jabir, ainsi que Le Secret des secrets, qu’on avait longtemps cru perdu, et Le Livre de référence pour pénétrer la réalité, un ouvrage chinois. En outre, Khalid avait dans son vaste laboratoire les moyens techniques de répéter sept cent soixante-dix-sept fois les distillations requises à de très hauts degrés de pureté et de température. Deux semaines plus tôt, il avait déclaré que ses efforts avaient enfin porté leurs fruits, et que maintenant tout était prêt pour une présentation en public – qui, bien entendu, devait comprendre quelque témoins royaux pour que ça compte.
Alors Bahram s’était hâté vers le complexe de Khalid dans la partie nord de Samarkand, sur les rives du Zeravshan, qui alimentait en énergie les différents ateliers et fonderies. De grands tas de charbon attendaient d’être brûlés le long des murs du complexe, à l’intérieur duquel se dressaient de nombreux bâtiments, éparpillés autour de la principale zone de travail – une vaste cour envahie de cuves et de bains chimiques de toutes les couleurs. Plusieurs puanteurs différentes se combinaient pour former l’odeur entêtante et âcre propre au repaire de Khalid. Il était, entre autres choses, le principal métallurgiste et fabricant de poudre du khanat, et ces différentes activités concrètes finançaient l’alchimie, qui était sa vraie passion.
Bahram serpenta parmi le désordre, s’assurant que tout était prêt pour la présentation. Les longues tables des ateliers ouverts sur la cour étaient envahies par des appareils divers et variés, bien ordonnés. Aux murs des ateliers étaient accrochés des outils soigneusement rangés. L’athanor principal rugissait, rouge de chaleur.
Mais Khalid était introuvable. Les souffleurs de verre ne l’avaient pas vu ; Esmerine, la femme de Bahram et la fille de Khalid, ne savait pas non plus où il pouvait bien être. La maison, à l’arrière du complexe, semblait vide, et personne ne répondit aux appels de Bahram. Il commença à se demander si Khalid ne s’était pas enfui, effrayé.
C’est alors que Khalid sortit de la bibliothèque près de son bureau, seule pièce de la maison qui fermait à clé.
— Ah, tu es là ! fit Bahram. Viens, père, al-Razi et Marie la Juive ne te seront plus d’aucun secours à présent. Il est temps de montrer au monde la chose proprement dite, la projection.
Khalid, étonné de le voir, eut un brusque hochement de tête.
— Je faisais les derniers préparatifs, dit-il.
Il mena Bahram à la salle du fourneau, où la machinerie des soufflets, actionnée par la roue du fleuve, pompait l’air dans les feux ronflants.
Le khan et sa suite arrivèrent assez en retard ; l’après-midi était déjà bien entamée. Vingt cavaliers surgirent brusquement dans leur brillant apparat, suivis d’un long train d’une cinquantaine de chameaux, écumant d’avoir trop galopé. Le khan descendit de sa jument blanche et traversa le bâtiment, flanqué de Nadir Divanbegi, de nombreux officiels sur les talons.
Khalid tenta de l’accueillir comme il se devait, en lui offrant notamment l’un des livres alchimiques auxquels il tenait le plus, mais Sayyed Abdul Aziz coupa court à ces civilités.
— Venons-en au fait, commanda le khan en prenant le livre sans le regarder.
Khalid s’inclina.
— L’alambic que j’utilise est celui-ci. On l’appelle un pélican. Le matériau de base est en gros du plomb calciné, avec un peu de mercure. Ils ont été pulvérisés avec de continuelles distillations et redistillations, jusqu’à ce que l’ensemble du matériau soit passé sept cent soixante-dix-sept fois à travers le pélican. À ce moment-là, l’esprit du lion – ou, en termes profanes, l’or – se condense sous l’effet de la chaleur de l’athanor. Alors nous versons le loup dans ce récipient, et de là dans l’athanor, ensuite nous attendons plusieurs heures, sans cesser de l’agiter, que se produise la multiplication finale, pour réaliser la teinture.
— Montre-nous.
Le khan était visiblement irrité par tous ces détails.
Sans ajouter un mot, renonçant à lui parler de la projection de l’hydrolithe sophique dans le ferment, Khalid les conduisit à la salle du fourneau. Ses assistants ouvrirent la lourde porte renforcée de l’athanor, puis, après avoir autorisé les visiteurs à manipuler et regarder le creuset de céramique, Khalid prit une paire de pincettes et versa le liquide distillé dans le creuset, plaça le plateau dans l’athanor et le fit glisser dans la chaleur intense. L’air au-dessus de la fournaise trembla tandis que le mollah de Sayyed Abdul Aziz récitait des prières. Khalid surveillait la petite aiguille de sa meilleure horloge. Toutes les cinq minutes il faisait un geste aux souffleurs, qui ouvraient la porte et tiraient le chariot. Alors, Khalid tournait sa louche dans le métal liquide, maintenant orange vif, sept fois sept tours, et remettait le creuset à l’intérieur du four. Dans les dernières minutes de l’opération, les craquements du charbon furent les seuls sons que l’on entendit dans l’atelier. Les observateurs, en sueur, regardaient l’horloge égrener les dernières secondes de la dernière minute de la dernière heure dans un silence pareil à celui d’un soufi en transe. Muets, ou, pensa Bahram mal à l’aise, semblables à des vautours regardant le sol loin au-dessous d’eux.
Finalement Khalid fit un petit signe de tête aux souffleurs, il souleva lui-même le creuset du plateau avec une paire de grosses pinces et l’apporta sur une table dans la cour, que l’on avait débarrassée pour cette présentation.
— Maintenant, grand khan, il faut retirer les impuretés, dit-il en vidant le plomb fondu du creuset dans une vasque en pierre posée sur la table. Et au fond nous voyons, aaah…
Il sourit et s’essuya le front avec sa manche, montrant le creuset.
— Même fondu, il brille d’un éclat à nul autre pareil…
Au fond du creuset, le liquide était d’un rouge intense. Avec une spatule, Khalid ôta précautionneusement la dernière pellicule d’impuretés, et ils virent, tout au fond, une masse liquide d’or en train de refroidir.
— Nous pouvons la verser dans un moule en forme de barre tant qu’elle est encore liquide, dit Khalid non sans satisfaction. On dirait qu’il y en a dix onces, ce qui fera un septième de la quantité, comme prévu.
Le visage de Sayyed Abdul Aziz resplendissait comme l’or. Il se tourna vers son secrétaire, Nadir Divanbegi, qui étudiait de près le creuset de céramique.
Sans rien laisser paraître de ses pensées, Nadir fit signe à l’un des gardes du khan d’approcher. Les autres se ruèrent derrière l’alchimiste. Leurs lances étaient toujours pointées vers le haut, mais ils étaient maintenant prêts à intervenir.
— Emparez-vous des instruments, dit Nadir au chef des gardes.
Trois soldats l’aidèrent à prendre possession des outils qui avaient servi au processus, dont le grand pélican lui-même. Quand ils eurent tout réuni, Nadir s’approcha de l’un des gardes et prit la louche dont Khalid s’était servi pour touiller le métal liquide. D’un geste brusque, il en flanqua un coup sur la table. Elle sonna comme une cloche. Il regarda Sayyed Abdul Aziz, qui regardait son secrétaire, sans comprendre. Nadir fit un signe de tête à l’un des lanciers, puis posa la louche sur la table.
— Coupe-la.
La lance s’abattit brutalement, et la louche fut coupée en deux, juste au-dessus de la cuiller. Nadir ramassa le manche et la cuiller, et les regarda. Puis il les montra au khan.
— Voyez vous-même, le tube est creux. L’or se trouvait dans le tube à l’intérieur du manche, et quand il touillait, la chaleur chauffait l’or, qui sortait de la louche et venait se mélanger au plomb, dans le creuset. Il lui suffisait ensuite de continuer à tourner pour que l’or descende au fond.
Bahram regarda Khalid, ahuri, et vit que c’était vrai. Le visage de son beau-père était blanc comme neige et il ne transpirait plus du tout. C’était déjà un homme mort.
Le khan hurla des paroles incompréhensibles, puis bondit sur Khalid et le frappa à coups redoublés avec le livre qu’il lui avait offert. Khalid ne résista pas.
— Emmenez-le ! cria Sayyed Abdul Aziz à ses soldats.
Ils saisirent Khalid par les bras, le traînèrent à l’extérieur dans la poussière, sans lui permettre de se remettre debout, et le jetèrent sur le dos d’un chameau. Une minute plus tard, tout le monde avait quitté le complexe, laissant dans l’air un peu de poussière et de fumée, et des échos de cris.
La clémence du khan
Après ce désastre, personne ne s’attendait à ce que Khalid fut épargné. Sa femme, Fedwa, portait déjà son deuil, et Esmerine était inconsolable. Au complexe, tout le travail s’était arrêté. Bahram se tracassait dans l’étrange silence des ateliers vides, attendant qu’on leur annonce qu’ils pouvaient aller chercher le corps de Khalid. Bahram se rendit compte qu’il n’était pas assez savant pour diriger convenablement les recherches.
La nouvelle arriva enfin ; on leur ordonnait d’assister à l’exécution. Iwang fit avec Bahram le voyage jusqu’au palais de Boukhara.
— Il aurait dû me demander, s’il manquait à ce point d’argent. J’aurais pu l’aider, dit-il, à la fois triste et en colère.
Bahram fut un peu surpris, parce que la boutique d’Iwang n’était qu’un boui-boui dans le souk, et ne semblait pas très prospère. Mais il ne dit rien. On avait beau dire, on avait beau faire, il aimait son beau-père ; et le sombre chagrin qu’il éprouvait ne laissait que peu de place pour s’appesantir sur l’état des finances d’Iwang. La mort violente d’une personne aussi proche, le père de sa femme – elle serait folle de chagrin pendant des mois, des années peut-être –, un homme tellement plein d’énergie : cette idée le vidait de toute autre pensée, et le laissait malade d’appréhension.
Le lendemain, ils arrivèrent à Boukhara, vibrante dans la chaleur estivale, ses maisons de pierres brunes et sable couronnées par les dômes turquoise et bleu profond de sa mosquée. Iwang indiqua l’un des minarets et dit :
— La Tour de la Mort. Ils vont probablement le jeter de là-haut.
Bahram en était vraiment malade. Ils entrèrent par la porte est de la ville et trouvèrent le chemin du palais. Iwang expliqua ce qui les amenait. Bahram se demanda s’ils n’allaient pas être eux aussi pris et exécutés comme complices. Cette idée ne lui était pas venue plus tôt, et il tremblait de tous ses membres alors qu’on les conduisait dans une pièce qui donnait sur les jardins du palais.
Nadir Divanbegi arriva peu après. Il braqua sur eux son éternel regard fixe. C’était un homme élégant, pas très grand, avec un bouc noir, des yeux bleu pâle. Un vrai Sayyed, vraiment très riche.
— On dit que vous êtes un aussi grand alchimiste que Khalid, lança-t-il abruptement à Iwang. Vous croyez à la pierre philosophale, à la projection, à tout ce prétendu œuvre au rouge, comme on dit ? Les métaux de base peuvent-ils vraiment être transmutés en or ?
Iwang s’éclaircit la gorge et répondit :
— C’est difficile à dire, effendi. Je n’y suis jamais arrivé, et les adeptes qui prétendent l’avoir fait n’ont jamais dit précisément comment dans leurs écrits. Pas d’une façon dont on puisse se servir, en tout cas.
— Servir, répéta Nadir. J’adore quand les gens disent ça. Surtout les gens comme Khalid ou vous. Vous savez des choses dont le khan aimerait bien se servir. Des choses bien réelles, comme de la poudre à canon dont on pourrait se servir sans sauter avec. Ou des métaux plus solides, de meilleures pharmacopées. Ça pourrait être de réels avantages au quotidien. Gâcher un tel savoir pour tromper son monde… Le khan est très en colère, évidemment.
Iwang hocha la tête en regardant la pointe de ses babouches.
— Je lui ai longuement parlé de cette affaire, en lui rappelant combien Khalid était un armurier et un alchimiste distingués. Ses contributions passées en tant qu’armurier en chef. Les nombreux autres services qu’il avait rendus au khan. Et le khan, dans sa grande sagesse, a décidé de faire preuve envers lui d’une clémence que Mahomet lui-même aurait approuvée.
Iwang releva les yeux.
— Il aura la vie sauve, s’il promet de travailler pour le khanat sur des choses qui servent vraiment.
— Je suis sûr qu’il acceptera. C’est très miséricordieux, en vérité.
— Oui. Évidemment, il aura la main droite coupée pour avoir volé, comme l’exige la loi. Mais compte tenu du toupet avec lequel il a cherché à nous abuser, c’est un châtiment très magnanime en vérité. Ainsi qu’il l’a lui-même reconnu.
Le châtiment fut administré un peu plus tard, dans la journée, ce vendredi, après le marché et avant les prières, sur la grande place de Boukhara, à côté du bassin central. Une foule nombreuse s’était massée pour y assister. Elle était très remontée lorsque Khalid y fut conduit par des gardes du palais, vêtus de blanc comme en période de ramadan. Beaucoup des Boukharis crièrent des injures à Khalid, autant parce qu’il était de Samarkand que parce qu’il était un escroc.
Il s’agenouilla devant Sayyed Abdul Aziz, qui proclama la clémence d’Allah, de lui-même, et de Nadir Divanbegi pour avoir plaidé la cause du mécréant, demandant qu’il ait la vie sauve malgré son ignoble forfait. Le bras de Khalid, qui ressemblait, de loin, à la patte et à la griffe décharnées d’un oiseau, fut attaché au billot du bourreau. Puis un soldat souleva une grande hache au-dessus de sa tête et l’abattit sur le poignet de Khalid. Sa main tomba du billot et un flot de sang jaillit sur le sable. La foule poussa un rugissement. Khalid bascula sur le côté et le soldat le soutint pendant qu’on cautérisait le moignon avec de la poix brûlante prise à l’aide d’un bâtonnet au fond d’un chaudron qui chauffait sur un brasero.
Bahram et Iwang le ramenèrent à Samarkand, allongé à l’arrière du char à bœufs qu’Iwang avait fabriqué afin de transporter les masses de métal et de verre que les chameaux ne pouvaient charrier. La carriole rebondissait horriblement sur la route – une large piste brune, poussiéreuse, creusée dans la terre par des siècles de trajets de caravanes de chameaux entre les deux villes. Les grandes roues en bois tombaient dans toutes les ornières, rebondissaient sur chaque bosse, et Khalid gémissait à l’arrière. Il était à moitié conscient et respirait péniblement, sa main gauche pareille à une araignée blanche crispée sur son poignet droit, brûlé, noir, poisseux. Iwang lui avait fait avaler de force une potion opiacée. Sans ses gémissements, on aurait pu croire qu’il dormait.
Bahram regardait le nouveau moignon avec une fascination horrifiée. En voyant comment sa main gauche étreignait son poignet, il dit à Iwang :
— Il faudra qu’il mange avec la main gauche, maintenant. Il sera obligé de tout faire avec la main gauche. Il sera à jamais impur.
— Ce genre de pureté n’a pas d’importance.
L’obscurité les ayant surpris en rase campagne, ils durent dormir au bord de la route. Bahram resta assis à côté de Khalid et essaya de lui faire avaler un peu de la soupe d’Iwang.
— Allez, papa. Allez, mon vieux. Mange quelque chose, tu te sentiras mieux. Tu va voir, ça va aller.
Mais Khalid se contenta de gémir en se tournant et en se retournant. Dans l’obscurité, sous le grand champ d’étoiles, il sembla à Bahram que tout ce qu’ils avaient dans la vie était à jamais gâché.
Punition et conséquences
Mais au fur et à mesure que Khalid se remettait, il ne voyait pas les choses de cette façon. Il se vanta auprès de Bahram et d’Iwang de son attitude au moment de la punition :
— Je n’ai pas dit un mot, à personne, et j’avais testé mes limites en prison, pour voir combien de temps je pouvais retenir ma respiration sans m’évanouir. Alors, quand j’ai vu que l’heure arrivait, je me suis contenté de retenir ma respiration, et j’ai si bien calculé mon coup que je me suis évanoui au moment même où la hache a frappé. Je n’ai rien senti. Je ne me souviens de rien.
— Nous, si, dit Iwang en fronçant les sourcils.
— Mais c’est à moi que c’est arrivé, répondit sèchement Khalid.
— Parfait. Tu pourras recommencer quand ils te couperont la tête. Tu pourras même nous apprendre le truc pour le jour où ils nous jetteront du haut de la Tour de la Mort.
Khalid le dévisagea.
— Tu m’en veux, hein, c’est ça ? demanda-t-il brutalement, blessé dans son amour-propre.
Iwang dit :
— Tu aurais pu tous nous faire tuer. Sayyed Abdul n’aurait eu qu’un mot à dire. Sans Nadir Divanbegi, c’est ce qui serait arrivé. Tu aurais dû me parler. Ou parler à Bahram. Nous aurions pu t’aider.
— Pourquoi avais-tu tellement d’ennuis de toute façon ? demanda Bahram, enhardi par les reproches d’Iwang. Avec tout ce que tu fabriques ici, tu ne dois pas manquer d’argent.
Khalid soupira, passa son moignon sur sa tête chauve. Il se leva et alla vers une commode fermée, l’ouvrit et en retira un livre et une boîte.
— J’ai trouvé ça, il y a deux ans, au caravansérail hindou, dit-il en leur montrant les pages du vieux livre. C’est très ancien. Ce sont les écrits de Marie la Juive, une très grande alchimiste. Elle a vécu il y a très longtemps. Sa technique de projection paraissait convaincante. En tout cas c’est ce que j’ai pensé. Je n’avais besoin que d’un bon fourneau, de beaucoup de mercure et de soufre. Alors j’ai payé énormément pour le livre, et pour le matériel. Une fois qu’on a des dettes chez les Arméniens, les choses ne font qu’empirer. Après ça, j’ai eu besoin d’or pour financer l’or…
Il frémit, écœuré.
— Tu aurais dû nous en parler, répéta Iwang, considérant le vieux livre.
— Tu devrais toujours me laisser faire quand il s’agit de traiter avec le caravansérail, ajouta Bahram. Ils savent que tu veux vraiment les choses, alors que moi, l’ignorant, j’ai la force de l’indifférence.
Khalid fronça les sourcils.
Iwang tapota le livre.
— Ce n’est que du réchauffé d’Aristote. Je ne vois pas ce qui pourrait servir là-dedans. J’en ai lu des traductions faites à Bagdad et Séville, et pour moi, il a plus souvent tort que raison.
— Que veux-tu dire ? s’écria Khalid, indigné.
Même Bahram savait qu’Aristote était le plus sage des auteurs de l’antiquité, et qu’il faisait autorité pour les alchimistes.
— On se demande plutôt quand il n’a pas tort, renchérit Iwang avec dédain. N’importe quel médecin du fin fond de la Chine te sera plus utile que cet Aristote. Il croyait que la pensée se situait dans le cœur, il ignorait qu’il pompait le sang – il n’avait aucune idée de ce qu’étaient la bile ou les méridiens du corps, et il n’a jamais parlé ni du pouls ni de la langue. Il a bien fait quelques assez bonnes dissections d’animaux, mais n’a jamais disséqué d’homme pour autant que je sache. Viens avec moi au bazar, un vendredi, et je te montrerai cinq choses sur lesquelles il avait tort.
Khalid continuait de froncer les sourcils.
— As-tu lu L’Harmonie entre Aristote et Platon, d’al-Farabi ?
— Oui, mais c’est une harmonie impossible. Al-Farabi s’y est risqué parce qu’il n’avait pas la Biologie, d’Aristote. S’il avait connu cet ouvrage, il aurait vu que, pour Aristote, tout reste toujours matériel. Ses quatre éléments essayent tous d’atteindre leur niveau, et ce sont leurs efforts qui permettent à notre monde d’exister. Ce n’est évidemment pas si simple.
Il fit un geste qui englobait la poussière dans la lumière du jour, le vacarme de l’atelier de Khalid, les moulins, les systèmes hydrauliques qui actionnaient les grands fourneaux, tous ces rugissements, ces trépidations.
— Les platoniciens le savent. Ils savent que tout est mathématique. Les choses sont chiffres. On devrait les appeler « pythagoriciens », ce serait plus juste. Ils sont comme les bouddhistes en ce sens que, pour eux, le monde est vivant. Ce qui est évident. Une grande créature faite de plus petites créatures. Pour Aristote et ibn Rachid, cela tient plus de l’horloge cassée.
Khalid grommela, mais il n’était pas en position de discuter. Il avait été amputé de la philosophie en même temps que de la main.
Il avait souvent mal. Il fumait du haschich et buvait les potions opiacées d’Iwang pour endormir sa douleur, ce qui endormait son intelligence, et endormait aussi son humeur. Il n’avait plus l’énergie d’apprendre aux jeunes le bon usage des équipements, il ne pouvait plus serrer la main des gens, ni manger avec les autres. N’ayant plus pour lui que sa main impure, il était impur en permanence. Cela faisait partie de la punition.
Cette prise de conscience, ainsi que l’anéantissement de ses quêtes philosophique et alchimique, finit par le rattraper et le plonger dans un état mélancolique. Il sortait de sa chambre tard dans la matinée et allait ruminer dans les ateliers, regardant les autres travailler, fantôme de lui-même. Là, tout continuait comme avant. Les grandes roues à aubes des moulins tournaient toujours dans l’eau, faisant marcher les presses et les soufflets des fourneaux. Les équipes d’ouvriers arrivaient juste après la prière du matin, imprimaient leur marque sur les feuilles de présence où était indiqué le nombre d’heures qu’ils avaient passées à travailler, puis se répartissaient dans les ateliers pour pelleter le sel, tamiser le salpêtre, ou s’atteler à l’une des centaines de tâches qu’exigeaient les entreprises de Khalid, tout cela sous la supervision d’un groupe d’anciens artisans qui avaient aidé Khalid à organiser ces différents travaux.
Mais tout cela était connu, rodé, routinier, et ne signifiait vraiment plus rien pour Khalid. Il traînait çà et là, ou se réfugiait dans son bureau, au milieu de ses collections, telle une pie à l’aile cassée dans son nid. Il pouvait rester des heures le regard dans le vague, ou bien feuilleter ses manuscrits, al-Razi, Jalduki, Jami, en regardant dieu sait quoi. Il passait le doigt sur les merveilles qui autrefois le fascinaient tant – un gros morceau de corail, une corne de licorne, de vieilles monnaies indiennes, des polygones d’ivoire ou d’écaillé emboîtés les uns dans les autres, une timbale taillée dans une corne de rhinocéros plaquée or, des coquillages fossilisés, un fémur de tigre, une statue de tigre en or, un bouddha hilare taillé dans un matériau noir inconnu, des netsukes nippons, des fourchettes et des crucifix de la civilisation perdue des Franjs – tous ces objets, qui lui donnaient autrefois tant de plaisir, et dont il pouvait parler ad nauseam à ses proches, semblaient maintenant l’agacer. Il restait assis là au milieu de ses trésors, mais son esprit n’était plus en éveil – comme se plaisait naguère à le dire Bahram –, à la recherche de similitudes, échafaudant conjectures et spéculations. Bahram n’avait pas compris, jusque-là, à quel point c’était important pour lui.
Comme son humeur s’assombrissait, Bahram alla au ribat soufi du Registan, quêter les lumières d’Ali, le maître soufi en charge de l’endroit.
— Mowlana, il a été bien plus sévèrement puni qu’il ne l’a d’abord cru. Ce n’est plus le même homme.
— C’est la même âme, dit Ali. Ce que tu vois n’est qu’un autre aspect de lui. Il y a en chacun de nous une zone secrète que Gabriel ne connaîtra jamais même s’il essayait très fort. Écoute-moi bien. L’intellect découle des sens, qui sont limités, et viennent du corps. L’intellect lui-même est donc limité, et ne pourra jamais vraiment appréhender la réalité, qui est infinie et éternelle. Khalid a voulu connaître la réalité avec son intellect, or c’est impossible. Maintenant qu’il en a conscience, il est démoralisé. L’intellect n’a pas vraiment de courage propre, vois-tu, et à la première alerte, il se terre dans un trou. Mais l’amour est divin. Il vient du royaume de l’infini, et le cœur le reçoit comme un cadeau de Dieu. L’amour ne calcule pas. « Dieu t’aime » est la seule phrase possible. C’est donc l’amour qu’il te faudra suivre pour atteindre le cœur de ton beau-père. L’amour est la perle d’une huître vivant au fond de l’océan, au bord duquel réside l’intellect, qui ne sait pas nager. Rapporte l’huître, et couds la perle à ta manche pour que tous la voient ; elle donnera du courage à l’intellect. L’amour est le roi qui doit venir à la rescousse de son lâche esclave. Comprends-tu ?
— Je crois.
— Tu dois être sincère et ouvert, ton amour doit être aussi lumineux que l’éclair ! Alors son subconscient pourra le percevoir, et sortir de lui-même en un clin d’œil. Va, sens l’amour te traverser, et aller vers lui.
Bahram essaya ce stratagème. Se réveillant au lit avec Esmerine, il sentit l’amour grandir en lui, l’amour de sa femme et de son corps magnifique, l’enfant, après tout, du vieil homme mutilé qu’il considérait avec tant d’affection. Plein d’amour, il parcourait les ateliers ou la ville, sentant la fraîcheur de l’air printanier sur sa peau, tandis que les arbres autour des bassins brillaient doucement dans la poussière du jour, comme de grands joyaux vivants, et que les nuages d’un blanc intense accentuaient le bleu profond du ciel, auquel faisaient écho les tuiles turquoises et bleu cobalt des dômes des mosquées. Ville superbe, matin superbe, centre même du monde. Le bazar était ce chaos habituel de bruits et de couleurs, où les hommes venaient se retrouver tous ensemble, et pourtant aussi vide et vain qu’une fourmilière, sauf quand l’amour l’habitait. Tout le monde agissait pour l’amour des siens, jour après jour – tel est du moins ce que pensait Bahram ces matins-là, tandis qu’il faisait les sempiternelles courses de Khalid – et nuit après nuit, quand Esmerine l’enveloppait de ses bras.
Mais il n’arrivait pas à transmettre tout cela à Khalid. Le vieil homme se gaussait chaque fois qu’il lui parlait d’esprits supérieurs, et encore plus quand il s’agissait d’amour. Toutes les démonstrations d’affection l’agaçaient – pas seulement celles de Bahram, mais aussi celles de sa femme Fedwa, ou d’Esmerine, ou des enfants d’Esmerine et de Bahram, Fazi et Laïla, ou de n’importe qui d’autre. Pendant les longues journées au soleil, l’activité des ateliers les environnait de son vacarme et de ses puanteurs, car toutes les procédures du travail à la forge et à la poudrerie que Khalid avait établies se poursuivaient, comme dans une ronde géante, assourdissante. Bahram désignait tout ça d’un geste, et disait :
— C’est tellement plein d’amour !
Khalid haussait les épaules d’un air dédaigneux, et le rabrouait :
— Tais-toi ! Tu dis des bêtises !
Un jour, il sortit en courant de son bureau en tenant dans sa main valide deux de ses vieux livres d’alchimie, et les jeta dans la gueule d’un athanor rugissant.
— Quel ramassis de conneries ! lança-t-il amèrement à Bahram qui lui criait d’arrêter. Hors de mon chemin, je vais brûler tout ça !
— Mais pourquoi ? cria Bahram. Ce sont tes livres ! Pourquoi, pourquoi, pourquoi ?
Khalid prit un peu de cinabre poussiéreux, et agita sa main devant Bahram.
— Pourquoi ? Je vais te dire pourquoi ! Regarde ça ! Tous les grands alchimistes, de Jabir à al-Razi en passant par ibn Sina, s’accordent pour dire que les métaux sont tous des variations de soufre et de mercure. Iwang ajoute même que les alchimistes hindous et chinois adhèrent aussi à cette théorie. Mais quand on combine le soufre et le mercure les plus purs qui se puissent trouver, qu’est-ce qu’on obtient ? Ça, du cinabre ! Qu’est-ce que ça veut dire ? Que les alchimistes qui parlent actuellement de ces choses-là – et il y en a très peu, crois-moi – disent qu’en fait ils ne veulent pas vraiment parler des substances que l’on appelle soufre et mercure, mais plutôt d’éléments plus purs, tout à la fois moins secs et moins humides, proches du soufre et du mercure, mais plus purs ! Enfin !
Il jeta l’échantillon de cinabre dans le fleuve, à l’autre bout de la cour.
— À quoi ça sert ? Pourquoi même les nommer ? Pourquoi les croire, de toute façon ?
Il agita son moignon, balayant son bureau, son laboratoire d’alchimie, et tous les appareils encombrant la cour.
— Tout ça ne sert à rien. Nous ne savons rien. Ils n’ont jamais su de quoi ils parlaient.
— Très bien, père, c’est vrai, peut-être, mais ne brûle pas tes livres ! Ils pourraient peut-être encore servir à quelque chose. Tu devrais être plus sélectif. En plus, ils ont coûté cher.
Khalid montra les dents et fit mine de cracher par terre.
Bahram parla de cet incident à Iwang lorsqu’il retourna en ville, la fois suivante.
— Il a brûlé de nombreux livres. Je n’ai pas pu l’en dissuader. J’ai bien essayé de lui faire voir l’amour qu’il y avait en toute chose, mais il ne l’a pas vu.
Le grand Tibétain fit un vilain bruit avec ses lèvres, comme un chameau.
— Cette façon d’agir ne marchera jamais avec Khalid, dit-il. C’est facile pour toi d’être plein d’amour, d’être jeune et entier. Khalid est vieux et n’a qu’une main. Il est déséquilibré, son yin et son yang sont perturbés. L’amour n’a rien à voir là-dedans.
Iwang n’était pas un soufi.
Bahram soupira.
— Alors je ne sais plus quoi faire. Il faut que tu m’aides, Iwang. Il va brûler tous ses livres et détruire tous ses appareils, et après, qui sait ce qu’il adviendra de lui…
Iwang marmonna quelque chose d’inaudible.
— Quoi ?
— Je vais tâcher d’y penser. Laisse-moi un peu de temps.
— Mais le temps presse. La prochaine fois, il détruira son laboratoire.
Aristote avait tort
Le lendemain même, Khalid ordonna aux apprentis du forgeron de vider entièrement les ateliers alchimiques et de tout détruire. Il les regarda d’un œil noir, hagard, jeter son matériel dans la poussière du crépuscule. Les bassines de sable, d’eau, les fourneaux de descension, les alambics, les cornues, les flacons, les distillateurs, les creusets, les sublimatoires… tout cela était environné d’un brouillard de poussière millénaire. En voyant le plus gros alambic, qui avait été utilisé la dernière fois pour distiller de l’eau de rose, Khalid ronchonna :
— C’est la seule chose que nous ayons réussi à faire marcher. Et pour quoi ? De l’eau de rose !
Les mortiers et les pilons, les flacons, les bouteilles, les béchers et les bassines, les cristallisoirs, les brocs, les casseroles, les lanternes, les lampes à huile, les braseros, les spatules, les pinces, les cuillers, les cisailles, les marteaux, les aludels, les entonnoirs, les diverses lentilles, les filtres de tissu, de lin et de feutre : finalement, tout se retrouva en plein soleil. Khalid leva son moignon pour dire au-revoir à son ancienne vie.
— Brûlez tout, et si ça ne brûle pas, cassez-le et flanquez-le dans le fleuve !
C’est alors qu’Iwang arriva, avec un petit mécanisme de verre et d’argent. Il fronça les sourcils en apercevant le désordre.
— Tu pourrais au moins vendre certaines de ces choses, dit-il à Khalid. Tu n’as plus de dettes ?
— Je m’en fiche, répondit Khalid. Je ne vendrai pas de mensonges.
— Ce n’est pas le matériel qui ment, rétorqua Iwang. Une partie de ce matériel pourrait encore servir.
Khalid le foudroya du regard. Iwang décida de changer de sujet et montra ce qu’il tenait à Khalid.
— Je t’ai apporté un jouet qui donne tort à Aristote.
Surpris, Khalid examina l’objet. Deux sphères métalliques reposaient sur une armature qui pour Bahram évoquait, mais en miniature, l’un des marteaux mus par la roue à eau.
— Quand on verse l’eau, là, ça alourdit le balancier, ici, et les deux portes, qui sont solidaires, s’ouvrent en même temps. Un côté ne peut pas s’ouvrir avant l’autre. Tu vois ?
— Évidemment.
— Oui, c’est évident, mais réfléchis. Aristote dit qu’une masse plus lourde tombera plus vite qu’une masse plus légère, parce que la Terre l’attire avec plus de force. Mais regarde. Là, il y a deux boules de fer, une grosse et une petite, une lourde et une légère. Place-les sur les portes, ajuste le système à l’aide d’un niveau à bulle, en haut de ton mur extérieur, là où il y a une bonne distance de chute. Un minaret ferait mieux l’affaire ; la Tour de la Mort serait l’idéal, mais pour l’instant on se contentera de ton mur.
Ils firent ce qu’il suggérait, Khalid montant lentement à l’échelle pour inspecter le dispositif.
— Maintenant, verse de l’eau dans l’entonnoir et regarde.
L’eau remplit le bassin du bas jusqu’à ce que les portes s’ouvrent subitement. Les deux boules tombèrent et heurtèrent le sol en même temps.
— Ho ! fit Khalid.
Il dévala l’échelle pour récupérer les boules et réessayer, après les avoir soupesées, et même pesées avec précision sur l’une de ses balances.
— Tu vois ? lança Iwang. On peut le faire avec des boules de la même taille ou de tailles différentes, ça n’a aucune importance. Tout tombe à la même vitesse, sauf si c’est très large et très léger, comme une plume, qui flotte sur l’air.
Khalid refit l’essai.
— Au temps pour Aristote, dit Iwang.
— Mouais, fit Khalid en regardant les boules et en les prenant dans sa main gauche. Il pourrait avoir tort pour ça, mais raison pour d’autres choses.
— Certes. Mais ça veut dire qu’il faut vérifier tout ce qu’il avance, si tu veux mon avis, et comparer aussi avec ce que disent Hsing Ho, al-Razi et les Hindous. Il faut vérifier si c’est juste ou non, en toute connaissance de cause.
Khalid hocha la tête.
— Je dois bien reconnaître que ça me pose problème !
Iwang indiqua, d’un geste, le matériel alchimique étalé dans la cour.
— C’est comme tout ça. Tu pourrais regarder de plus près ce qui peut encore servir…
Khalid fronça les sourcils. Iwang regarda à nouveau tomber les boules. Les deux hommes laissèrent choir un certain nombre de choses différentes à l’aide de l’artefact, tout en bavardant.
— Regarde, il faut bien que quelque chose les attire vers le bas, dit Khalid à un moment donné. Quelque chose qui les déplace, qui les fasse descendre, qui les oblige à tomber, ce que tu veux.
— Évidemment, répondit Iwang. Il n’y a jamais d’effet sans cause. Une attraction peut être provoquée par un agent, agissant conformément à certaines lois. Quant à la nature de cet agent…
— Mais c’est vrai de tout, marmonna Khalid. Nous ne savons rien, voilà à quoi ça se résume. Nous vivons dans les ténèbres.
— Trop de facteurs conjoints, dit Iwang.
Khalid hocha la tête et prit un bloc de bois de fer sculpté.
— Tout ça me fatigue.
— Alors, on va faire des essais. Tu fais quelque chose, tu obtiens autre chose. Ça ressemble à une chaîne de cause à effet. Dont on peut rendre compte sous la forme d’une séquence logique, ou qu’on peut même mettre en équation. Alors, tu sauras enfin comment la réalité se manifeste. Sans trop t’inquiéter de la force dont il s’agit.
— La force, c’est peut-être l’amour, suggéra Bahram. La même attraction qu’entre les gens, qui s’étendrait aux choses d’une façon générale.
— Ça expliquerait la façon dont le membre se dresse au-dessus de la terre, fit Iwang avec un sourire.
Bahram lui rendit son sourire, mais Khalid dit seulement :
— Il plaisante. Ce dont je parle ne pourrait pas être plus éloigné de l’amour. C’est aussi constant que la place des étoiles, une force physique.
— Les soufis disent que l’amour est une force, qui remplit tout, et régit tout.
— Les soufis ! lança Khalid avec mépris. Ce sont les derniers sur Terre que je consulterais si je voulais savoir comment marche le monde. Ils rêvassent en parlant de l’amour, s’enivrent, et tournent sur eux-mêmes ! Bah ! l’islam était une discipline intellectuelle avant que les soufis ne viennent étudier le monde tel qu’il est. Il y a eu ibn Sina, ibn Rachid, ibn Khaldun et tous les autres, et puis les soufis sont arrivés et il n’y a plus eu un seul philosophe musulman, plus un lettré pour faire avancer d’un iota notre compréhension des choses.
— Ils sont bien obligés, dit Bahram. C’est eux qui nous ont fait voir à quel point l’amour était important dans le monde.
— L’amour. Ah oui, tout est amour, Dieu est amour, mais si tout est amour et si tout ne fait qu’un avec Allah, alors pourquoi faut-il qu’ils se soûlent tous les jours ?
Iwang se mit à rire.
— Ce n’est pas tout à fait ça, tu sais, dit Bahram.
— Mais si ! D’ailleurs leurs salles de réunions sont bourrées de frères à la recherche d’un bon moment, les madrasas se vident, les khans leur donnent toujours moins, et nous voilà, en 1020, en train de discuter des textes des anciens Franjs, sans la moindre idée de la raison pour laquelle les choses se passent comme elles le font. Nous ne savons rien ! Bien !
— Il faut commencer petit, argumenta Iwang.
— On ne peut pas commencer petit ! Tout est lié !
— Alors, nous n’avons qu’à isoler un groupe d’actions que nous pourrons observer et contrôler, les étudier, et nous verrons bien si nous arrivons à y comprendre quelque chose. Et nous partirons de là. Quelque chose comme cette chute, le plus simple de tous les mouvements. Si nous comprenons le mouvement, nous pourrons étudier son effet sur d’autres objets.
Khalid réfléchit. Il avait finalement cessé de faire tomber des objets avec l’artefact.
— Viens un peu avec moi, dit Iwang. Je voudrais te montrer quelque chose qui m’intrigue.
Ils le suivirent vers l’atelier où se trouvaient les gros fourneaux.
— Regarde comment tu obtiens des feux aussi chauds. L’eau actionne les soufflets plus vite que ne le feraient des souffleurs, si nombreux qu’ils puissent être, et la chaleur du feu n’a jamais été aussi forte. Maintenant, Aristote dit que le feu est piégé dans le bois, et libéré par la chaleur. Très bien, mais pourquoi un supplément d’air en élève-t-il la température ? Pourquoi le vent attise-t-il les feux de forêt ? Est-ce que ça veut dire que l’air est vital pour le feu ? Pourrions-nous le prouver ? Si nous construisions une chambre dans laquelle l’air serait aspiré par les soufflets au lieu d’y être introduit, le feu brûlerait-il moins bien ?
— Aspirer l’air d’une chambre ? répéta Khalid.
— Oui. On pourrait fabriquer une valve qui laisserait sortir l’air et l’empêcherait de rentrer. Pomper l’air qu’il y a à l’intérieur, et laisser l’air de remplacement au-dehors.
— Intéressant ! Mais que resterait-il dans la chambre, alors ?
Iwang haussa les épaules.
— Je ne sais pas. Un vide ? Une partie du vide originel, peut-être ? Il faudrait poser la question aux lamas, ou à tes soufis. Ou à Aristote. Ou simplement faire une chambre de verre, et regarder à l’intérieur.
— C’est ce que je vais faire, dit Khalid.
— Mais le plus facile à observer, c’est le mouvement, reprit Iwang. On peut faire toutes sortes d’essais avec le mouvement. On peut mesurer l’attraction des choses vers la Terre. On peut voir si la vitesse est la même dans les collines et dans les vallées. Les objets accélèrent quand ils tombent, et ça pourrait être mesurable aussi. La lumière elle-même devrait être mesurable. Ce qui est sûr, c’est que les angles de réfraction sont constants – je les ai déjà mesurés.
Khalid hocha la tête.
— D’abord, ce soufflet à l’envers, pour vider une chambre. Bien qu’il ne puisse sûrement pas en résulter un vrai vide. Le rien n’est pas possible dans ce monde, je pense. Il y aura quelque chose là-dedans, de plus petit que l’air.
— Ça ressemble plus à Aristote, dit Iwang. « La nature a horreur du vide. » Mais… et si ce n’était pas le cas ? Nous ne le saurons qu’après avoir essayé.
Khalid hocha la tête. S’il avait eu deux mains, il se les serait frottées.
Ils sortirent tous les trois vers le moulin à eau. Là, un canal détournait du fleuve un courant plus puissant qui miroitait dans le soleil du matin ; l’eau actionnait un moulin, qui faisait d’abord tourner des axes, entraînant une rangée de lourds marteaux, de presses à métaux, et les poignées des soufflets rotatifs qui faisaient ronfler les chaudières des fourneaux. C’était un endroit bruyant, plein du vacarme de l’eau, du concassage des pierres, du ronflement du feu et des crépitements de l’air ; tous ces éléments trépidaient sous l’effet de la transmutation, leur cassant les oreilles et laissant dans l’air une odeur de brûlé. Khalid resta un moment planté là à regarder le moulin à eau. C’était sa réussite, c’était lui qui avait su se servir du savoir-faire de chacun de ses artisans pour produire cette énorme machine, mille fois plus puissante que les gens ou les chevaux ne l’avaient jamais été. Ils étaient les gens les plus puissants de l’histoire du monde, se dit Bahram, et c’était grâce à Khalid. Mais, d’un geste de la main, Khalid envoya promener tout ça. Il voulait comprendre pourquoi ça marchait.
Il ramena les deux autres à l’atelier.
— On va avoir besoin de tes souffleurs de verre, de mes ferronniers et de mes tailleurs de cuir, dit-il. Ta valve, on pourrait peut-être la faire avec des intestins de mouton.
— Il faudrait que ce soit plus solide que ça, répondit Iwang. Une sorte de porte de métal, qui serait plaquée contre un joint de cuir par la succion du vide.
— C’est ça.
Pas de djinn dans cette bouteille
Khalid mit ses artisans au travail, pendant qu’Iwang soufflait le verre, et deux semaines plus tard ils avaient un appareil en deux parties : un globe de verre épais, et une puissante pompe pour y faire le vide. Il y eut tout un tas de fuites et de ruptures, et la valve céda souvent ; mais les vieux mécaniciens du complexe étaient ingénieux, et, en s’attaquant aux points faibles, ils finirent par fabriquer cinq versions tout à fait semblables de l’appareil, toutes très lourdes. La pompe était une chose massive, bardée de pistons, de tubes et de valves étroitement ajustés ; les globes étaient d’épais ballons de verre, au col encore plus épais, et garnis à l’intérieur de protubérances auxquelles on pouvait accrocher des objets, pour voir ce qui leur arriverait quand l’air serait évacué. Quand ils eurent résolu le problème des fuites, ils durent construire une crémaillère afin d’exercer assez de force sur la pompe pour qu’elle vide le globe de la plus infime trace d’air. Iwang leur conseilla quand même de ne pas chercher à créer le vide parfait, le genre de vide qui aurait aspiré la pompe, le complexe, et, qui sait, le monde lui-même, tel un djinn rentrant dans sa prison. Comme toujours, le visage de marbre d’Iwang ne leur permettait pas de savoir s’il était sérieux ou s’il plaisantait.
Quand ils eurent obtenu un appareil qui marchait à peu près correctement (de temps à autre, le verre de l’un d’eux se fendillait, quand ce n’était pas la valve qui se cassait), ils le fixèrent à une charpente en bois, et Khalid commença une série d’essais, insérant des choses dans le globe avant de le vider de son air, pour voir ce qui se passerait. Il se refusait à se poser toutes les questions philosophiques sur la nature de ce qui restait à l’intérieur du globe une fois qu’on en avait ôté l’air.
— Contentons-nous de voir ce qui arrive, disait-il. On verra après…
Il gardait de grands livres à pages blanches sur la table près de son appareil, et lui, ou l’un de ses secrétaires, y consignait dans les moindres détails le déroulement des opérations, prenant soin de chronométrer les événements avec la meilleure des horloges.
Après quelques semaines durant lesquelles Khalid se familiarisa avec l’appareil et fit divers essais, il demanda à Iwang et à Bahram d’organiser une petite fête, à laquelle il invita de nombreux cadis et professeurs des madrasas du Registan, et notamment les mathématiciens et astronomes de la madrasa de Sher Dor, qui étaient déjà plongés dans des discussions sur les auteurs de la Grèce antique et les classiques arabes traitant de la réalité physique. Le jour dit, quand tous ses invités se pressèrent dans l’espace ouvert de l’atelier non loin du bureau de Khalid, Khalid leur présenta l’appareil, leur expliqua comment il fonctionnait et leur montra ce qu’ils pouvaient tous voir : un réveil qu’il avait attaché à l’une des aspérités à l’intérieur du globe, de telle sorte qu’il se balançait doucement au bout d’un court fil de soie. Khalid abaissa une bonne vingtaine de fois la pompe de la crémaillère, mettant rudement son bras gauche à l’épreuve. Il leur dit que l’alarme du réveil avait été réglée pour sonner à la sixième heure de l’après-midi, peu après que les muezzins du minaret le plus au nord de Samarkand auraient fini de chanter la prière du crépuscule.
— Pour être sûr que l’alarme sonnera bien, leur dit Khalid, le battant a été exposé, afin que vous puissiez le voir frapper les petites cloches. Après, une fois que nous aurons vu ce que donnent les premiers résultats, je réintroduirai peu à peu de l’air dans le globe de façon à ce que vous puissiez l’entendre par vous-mêmes.
Il parlait d’un ton bourru et direct. Bahram vit qu’il voulait s’éloigner le plus possible du ton pompeux, ésotérique, qu’il avait affecté au cours de ses expériences alchimiques. Il ne fit pas de grande déclaration, aucune incantation. Le souvenir de sa dernière présentation, désastreuse, de sa supercherie, devait être présent à son esprit, tout comme il l’était dans celui de tous ici. Mais il se contenta d’un simple geste en direction du réveil, qui avançait vaillamment vers six heures.
C’est alors que le réveil commença à tournoyer au bout du fil, et que tous purent voir le battant frapper, un coup à droite, un coup à gauche, les petites cloches de bronze. Mais aucun son ne sortait du globe de verre. Khalid esquissa un geste.
— Vous pourriez croire que c’est le verre lui-même qui empêche le son de passer, mais quand j’aurai remis de l’air à l’intérieur, vous constaterez que ce n’est pas le cas. Pour commencer, je vous invite à venir poser votre oreille contre le ballon, pour que vous puissiez vérifier par vous-mêmes qu’on n’entend vraiment rien.
À tour de rôle, chacun s’exécuta. Alors Khalid tourna un robinet qui ouvrit une valve située sur l’un des flancs du ballon, et un court sifflement d’air se fit entendre, bientôt rejoint par une sonnerie qui devint perceptible et augmenta rapidement. De telle sorte qu’à la fin on eût dit une alarme sonnant dans la pièce voisine.
— Apparemment, le son n’existe pas s’il n’y a pas d’air pour nous le faire entendre, commenta Khalid.
Les visiteurs de la madrasa s’empressèrent d’examiner l’appareil, commencèrent à envisager toutes sortes d’essais pour étudier ses nombreux usages, et discutèrent de la nature de ce qui restait – s’il restait quelque chose – à l’intérieur du globe une fois qu’on en avait aspiré l’air. Khalid refusa catégoriquement d’entrer dans quelque polémique que ce fût à ce propos, préférant parler de ce que cette démonstration laissait supposer au sujet du son et de la façon dont il se propageait.
— Les échos pourraient permettre d’élucider autrement cette affaire, dit l’un des cadis.
Il ouvrait des yeux ronds, ravis, intrigués, comme tous les autres visiteurs.
— Quelque chose frappe l’air, le bouscule, et le son est un choc se déplaçant dans l’air – de la même façon que les vagues rident l’eau. Les sons rebondissent, comme des vagues qui reviendraient après avoir heurté un mur. Ce mouvement met un certain temps à parcourir l’espace – d’où l’écho.
— À l’aide d’une falaise faisant écho, dit Bahram, nous pourrions peut-être mesurer la vitesse du son.
— La vitesse du son ! s’exclama Iwang. Comme c’est beau !
— Une idée importante, Bahram, rectifia Khalid.
Il vérifia que son secrétaire notait bien tout ce qui se disait ou se faisait. Il ouvrit complètement le robinet d’arrêt et le retira, afin que tous puissent entendre la forte sonnerie pendant qu’il plongeait la main dans le globe pour l’arrêter. Le silence qui se fit alors leur parut des plus étranges. Khalid se frotta la tête avec son poignet droit.
— Je me demande, dit-il, si nous pourrions calculer la vitesse de la lumière selon le même principe…
— Comment reviendrait-elle ? demanda Bahram.
— Eh bien, peut-être que si nous visions un miroir lointain, mettons… une lanterne, une glace au loin… Avec une pendule qui donnerait l’heure de façon très précise, ou bien encore mieux, que l’on pourrait mettre en marche et arrêter, ou même…
Iwang secouait la tête.
— Le miroir devrait se trouver très loin pour laisser le temps aux savants d’enregistrer un intervalle. En outre, il faudrait attendre, pour faire la lumière, que le miroir soit placé selon le bon angle.
— Et si on mettait une personne à la place du miroir ? suggéra Bahram. Quelqu’un, sur une colline lointaine, verrait la lumière de la première lanterne, allumerait la sienne, et alors quelqu’un à côté de l’homme à la première lanterne noterait le moment auquel la seconde lumière apparaîtrait.
— Excellent, dirent plusieurs personnes en même temps.
— Ce ne sera peut-être pas assez rapide, ajouta Iwang.
— Cela reste à voir, dit Khalid avec entrain.
Sur ce, Esmerine et Fedwa poussèrent un chariot contenant un « assortiment de sharbats », ainsi que les appelait Iwang, sur lesquels la foule se précipita joyeusement, Iwang parlant du croassement ténu des goraks dans le haut Himalaya, où l’air lui-même était rare, et ainsi de suite.
Le khan face au vide
C’est ainsi qu’Iwang tira Khalid de sa noire mélancolie et que Bahram vit la sagesse avec laquelle Iwang s’occupait de son cas. Chaque jour, à présent, Khalid se réveillait, impatient de se mettre à l’ouvrage. La gestion du domaine fut laissée à Bahram et à Fedwa, les vieux ouvriers encadrant chacun un atelier. Quand on venait le consulter pour un problème d’intendance, Khalid ne répondait même pas. Il avait la tête ailleurs. Il passait son temps à concevoir, planifier et effectuer toutes sortes d’expériences avec la pompe à vide, notant scrupuleusement les résultats. Plus tard, avec de nouveaux appareils, ils étudièrent d’autres phénomènes.
C’est ainsi qu’ils allèrent à l’aube, quand tout était tranquille, vers le grand mur ouest de la ville, chronométrer le temps que mettait à leur parvenir le bruit de blocs de bois entrechoqués, puis le temps que mettait l’écho à leur revenir. Ensuite, ils mesurèrent la distance du mur avec une ficelle d’un tiers de li de long. Iwang fit les calculs, et déclara bientôt que la vitesse du son était de l’ordre de deux mille lis à l’heure, une vitesse dont tout le monde s’émerveilla.
— Près de cinquante fois plus rapide que le plus rapide des chevaux, fit Khalid en regardant joyeusement les chiffres d’Iwang.
— Et la lumière doit aller encore beaucoup plus vite, prédit Iwang.
— Nous le découvrirons.
En attendant, Iwang contemplait les chiffres, intrigué.
— Reste la question de savoir si le son ralentit au fur et à mesure qu’il se propage. Ou s’il accélère. Mais s’il change de vitesse, il est plus probable qu’il ralentisse, l’air opposant une résistance au choc.
— Le bruit devient plus faible au fur et à mesure qu’on s’éloigne, souligna Bahram. Plutôt que de ralentir, peut-être qu’il s’affaiblit.
— Mais pourquoi ferait-il ça ? demanda Khalid.
Puis ils se lancèrent, Iwang et lui, dans une grande discussion sur le bruit, le mouvement, les causes et l’action à distance. Très vite, Bahram fut dépassé, n’étant pas un philosophe. Et, à vrai dire, Khalid, n’aimant pas l’aspect métaphysique de la discussion, conclut, comme toujours ces derniers temps :
— Il faut faire des tests.
Iwang était d’accord. En ruminant les chiffres, il déclara :
— Nous aurions besoin de calculs qui pourraient rendre compte non seulement des vitesses fixes, mais de la vitesse à laquelle la vitesse change. Je me demande si les Hindous ont réfléchi à ça.
Il disait souvent que les mathématiciens hindous étaient les plus forts du monde, très loin devant les Chinois. Khalid le laissait depuis longtemps accéder à tous ses livres de mathématiques, et Iwang passait de nombreuses heures dans son bureau à lire, ou à faire d’obscurs calculs et des dessins à la craie sur des ardoises.
On apprit qu’ils avaient une pompe à vide, et ils rencontrèrent régulièrement, à la madrasa, des personnes que cela intéressait – généralement des professeurs de mathématiques et de sciences de la nature. Ces réunions étaient souvent conflictuelles, mais chacun conservait le style d’échange policé, ostentatoire, des débats théologiques à la madrasa.
Pendant ce temps, le caravansérail hindou accueillait souvent des marchands de livres, et ces hommes appelaient Bahram pour qu’il jette un coup d’œil à de vieux parchemins, des livres à couverture de cuir ou de bois, ou des boîtes contenant des pages non reliées.
— Le vieux Une-Main sera intéressé par la théorie de Brahmagupta sur la taille de la Terre, je vous assure, disaient-ils avec de grands sourires, sachant que Bahram était incapable d’en juger.
— Celui-ci contient la sagesse de cent générations de moines bouddhistes, qui ont tous été massacrés par les Moghols.
— Celui-ci renferme les connaissances compilées des Franjs disparus, d’Archimède et d’Euclide.
Bahram jetait un coup d’œil aux pages, comme s’il y comprenait quelque chose, et choisissait les volumes les plus lourds, les plus vieux, et ceux où apparaissaient le plus de chiffres, surtout les chiffres hindis, ou de ces virgules tibétaines qu’Iwang était le seul à pouvoir déchiffrer. S’il pensait que Khalid et Iwang seraient intéressés, il marchandait avec l’entêtement de l’ignare.
— Regardez, ce n’est ni de l’arabe, ni de l’hindi, ni du persan ni du sanskrit. Je ne reconnais même pas cet alphabet. Comment Khalid pourrait-il y comprendre quelque chose ?
— Oh, mais ça vient du Deccan. Les bouddhistes de partout peuvent lire ça. Votre Iwang sera très heureux de s’y plonger !
Ou bien :
— C’est l’alphabet des Sikhs. Leur dernier gourou leur a inventé un alphabet qui ressemble beaucoup au sanskrit, et leur langue est une forme de penjabi.
Et ainsi de suite. Bahram rentrait à la maison avec ses trouvailles, un peu inquiet d’avoir dépensé du bon argent pour acheter des volumes poussiéreux auxquels il ne comprenait rien. Ensuite, Khalid et Iwang les inspectaient, et soit ils les feuilletaient comme des vautours, auquel cas ils félicitaient Bahram pour son jugement et l’habileté avec laquelle il avait marchandé, soit Khalid le maudissait, le traitant d’imbécile, pendant qu’Iwang le regardait, s’émerveillant qu’il ne sache pas reconnaître un livre de comptabilité d’un armateur de Travancore (c’était le volume du Deccan que n’importe quel bouddhiste pouvait lire).
Leur dispositif suscitait d’autres attentions, dont ils se seraient bien passés. Un matin, Nadir Divanbegi se présenta à leur porte avec quelques gardes du khan. Paxtakor, le serviteur de Khalid, les escorta à travers le complexe, et Khalid, prudemment impassible et affable, demanda qu’on apporte du café dans son bureau.
Nadir était aussi amical qu’on peut l’être, mais il en vint bientôt au fait :
— J’ai dit au khan que ta vie devait être épargnée parce que tu étais un grand chercheur, un philosophe et un alchimiste, un bien précieux pour le khanat, un joyau de la grande gloire de Samarkand.
Khalid hocha la tête, mal à l’aise, en regardant sa tasse de café. Il fit un geste du doigt, comme pour dire « ça suffit », puis il marmonna :
— Je vous suis très reconnaissant, effendi.
— Oui. Il est clair, maintenant, que j’ai eu raison de plaider pour ta survie, avec tout ce que j’apprends de tes nombreuses activités et de tes merveilleuses recherches.
Khalid le regarda en se demandant s’il se moquait de lui, et Nadir leva les mains en signe de sincérité. Khalid baissa les yeux.
— Mais je suis venu te rappeler que, si tous tes essais sont vraiment extraordinaires, le monde est dangereux. Le khanat se trouve au centre de toutes les routes commerciales importantes, et il y a des armées aux quatre points cardinaux. Le khan se soucie de protéger ses sujets de toute attaque, or il existerait des canons capables d’abattre les murailles de notre cité en une semaine, voire moins. Le khan veut que tu l’aides à résoudre ce problème. Il est sûr que tu seras ravi de lui apporter une modeste partie des fruits de ton savoir, afin de l’aider à défendre le khanat.
— Tous les résultats de mes essais appartiennent au khan, répondit gravement Khalid. Mon souffle même appartient au khan.
Nadir hocha la tête en signe d’assentiment devant cette vérité.
— Et pourtant, tu ne l’as pas invité à assister à la démonstration de cette pompe qui crée un vide dans l’air.
— Je ne pensais pas qu’il serait intéressé par une si petite affaire.
— Le khan s’intéresse à tout.
Aucun d’eux ne pouvait dire, en regardant le visage de Nadir, s’il plaisantait ou non.
— Nous serions heureux de lui faire une démonstration de la pompe à vide.
— Parfait. Il appréciera. Mais rappelle-toi qu’il attend par-dessus tout que tu règles cette histoire de canons et de murailles.
Khalid hocha la tête.
— Nous honorerons son souhait, effendi.
Nadir parti, Khalid se mit à marmonner d’un air malheureux.
— Il s’intéresse à tout ! Comment peut-il dire ça sans rire ?
Il envoya néanmoins au khan un serviteur avec une invitation en bonne et due forme à venir voir le nouvel appareil. Et avant la visite, il mit tout le complexe au travail, préparant une nouvelle démonstration de la pompe qui impressionnerait le khan, du moins l’espérait-il.
Quand Sayyed Abdul Aziz et sa suite firent leur visite, le globe qui devait contenir le vide, cette fois, était fait de deux demi-globes dont les bords étaient mortaisés afin de s’emboîter parfaitement. Un fin joint de cuir huilé fut placé à la jonction avant que l’air ne soit aspiré, et de gros étriers d’acier furent fixés à chacun des deux globes, auxquels on pourrait attacher des cordes.
Sayyed Abdul était assis sur des coussins et inspectait soigneusement les deux moitiés du globe. Khalid lui expliqua :
— Quand l’air est enlevé, les deux moitiés du globe adhèrent l’une à l’autre avec une grande force.
Il plaça les moitiés ensemble, les sépara ; les replaça, fixa la pompe au trou prévu à cet office, et fit signe à Paxtakor d’actionner la pompe de façon répétée, une dizaine de fois. Puis il apporta le système au khan et l’invita à essayer de séparer les deux moitiés du globe.
Il n’y arriva pas. Le khan avait l’air ennuyé. Khalid emporta le système dans la cour centrale du complexe, où deux attelages de trois chevaux chacun attendaient. Les harnais furent accrochés de part et d’autre du globe, et les deux attelages éloignés l’un de l’autre jusqu’à ce que le globe se retrouve suspendu entre eux. Quand les chevaux s’immobilisèrent, les palefreniers eurent beau faire claquer leur fouet, et les chevaux piaffer, renâcler et tirer chacun de leur côté, ils dérapèrent, se déplacèrent de droite et de gauche, mais le globe resta suspendu aux cordes horizontales, frémissantes. Les deux moitiés restaient inséparables. Même les brusques départs de galop que les chevaux tentèrent se soldèrent par des arrêts brutaux, titubants.
Le khan regardait les chevaux avec intérêt, mais il paraissait indifférent au sort du globe. Au bout de quelques minutes d’efforts, Khalid fit s’arrêter les chevaux, décrocha le dispositif et l’apporta au groupe où se trouvaient le khan et Nadir. Lorsqu’il ôta le bouchon, l’air entra dans le globe en sifflant, et les deux moitiés se séparèrent aussi facilement que les quartiers d’une orange. Khalid arracha le petit joint de cuir écrasé.
— Vous voyez, dit-il. C’est la force de l’air, ou plutôt l’attraction du vide, qui retient si fortement les moitiés ensemble.
Le khan se leva comme s’il s’apprêtait à partir, et sa suite en fit autant. Il donnait l’impression d’être sur le point de s’écrouler de sommeil.
— Et alors ? dit-il. Je veux pulvériser mes ennemis, pas les maintenir ensemble.
Il eut un geste dédaigneux et s’en alla.
Dans la nuit, la lumière
Cette réaction si peu enthousiaste ennuya Bahram. Le khan ne s’intéressait absolument pas à cet appareil qui avait fasciné les érudits de la madrasa ; au lieu de quoi, il avait ordonné de mettre au point des fortifications et de nouvelles armes qui éclipseraient les recherches assidues des armuriers de tous les temps. S’ils échouaient, les punitions possibles n’étaient que trop faciles à imaginer. La main absente de Khalid semblait les narguer depuis son propre type de vide. Il contemplait son moignon, et disait :
— Un jour, je te ressemblerai tout entier.
Pour le moment, c’est à peine s’il jetait un œil sur le complexe.
— Dis à Paxtakor de se procurer de nouveaux canons chez Nadir pour des essais. Trois de chaque taille, et toute la poudre et les munitions nécessaires.
— Mais de la poudre, nous en avons.
— Je sais, répondit-il en foudroyant Bahram du regard. C’est juste que je veux voir quelle sorte de poudre ils ont, eux.
Les jours suivants, il passa en revue tous les vieux bâtiments du complexe, ceux que ses vieux ferronniers et lui avaient bâtis au tout début, quand ils se contentaient de fabriquer des canons et de la poudre pour le khan. À cette époque, avant que ses hommes et lui n’adoptent le système chinois et ne raccordent le moulin à leurs fourneaux, libérant ainsi pour d’autres travaux bon nombre des jeunes apprentis qui actionnaient les soufflets, tout était petit, rudimentaire. Le fer était plus cassant. Tout ce qu’ils faisaient était grossier, mal fini. Les bâtiments eux-mêmes en témoignaient. Aujourd’hui, les engrenages des moulins ronflaient de toute la puissance du fleuve. Des fumées jaune citron, vert acide, montaient des cuves de produits chimiques. Les souffleurs faisaient des colis, menaient des chameaux et déplaçaient des montagnes de charbon d’un endroit à l’autre du complexe. En voyant cela, Khalid secoua la tête et fit un geste résolu avec son poing fantôme.
— Il nous faut de meilleures pendules. Nous n’avancerons pas si nous ne savons pas mieux mesurer le temps.
Iwang retroussa les lèvres.
— Il faudrait surtout qu’on comprenne mieux ce qui se passe.
— Oui, oui, bien sûr. Nous pourrions discuter de tout ça dans ce monde misérable. Mais tout le savoir des anciens ne nous apprendra pas combien de temps il faut à la poudre-éclair pour faire partir la charge.
À la tombée du jour, le complexe redevenait silencieux et l’on n’entendait plus que le ronronnement de la roue à aubes sur le canal. Une fois que les ouvriers logés sur place avaient procédé à leurs ablutions, mangé et récité leurs prières, ils se rendaient à leurs appartements situés tout au bout du complexe, près du fleuve, et s’endormaient. Les ouvriers qui logeaient en ville rentraient chez eux.
Bahram se laissait tomber sur son lit près d’Esmerine, de l’autre côté de la pièce où dormaient leurs deux enfants, Fazi et Laïla. La plupart du temps, il s’endormait, exténué, au moment même où sa tête touchait la soie de son oreiller. Sommeil béni…
Mais souvent, Esmerine et lui s’éveillaient un peu après minuit, et quelquefois ils restaient comme ça, attentifs l’un à l’autre, respirant, se touchant, tenant à voix basse des conversations généralement brèves et décousues, d’autres fois les plus profondes et les plus longues qu’ils aient jamais eues ; et quand ils faisaient l’amour, maintenant que les enfants étaient là pour épuiser Esmerine, c’était en cet instant béni, dans le calme et la fraîcheur de ces heures nocturnes.
Parfois, ensuite, Bahram se levait et se promenait dans le complexe, pour voir les choses à la lumière de la lune et s’assurer que tout était en ordre, sentant l’écho de l’amour palpiter en lui ; et bien souvent, en cette occasion, il voyait de la lumière dans le bureau de Khalid. Il s’approchait doucement pour trouver Khalid assoupi sur un livre ouvert, ou bien écrivant de sa main gauche sur son écritoire, ou encore vautré sur son divan, en train de discuter à voix basse avec Iwang, chacun tenant le tuyau de pipe d’un narguilé, enveloppé des vapeurs odorantes du haschich. Si Iwang était là et qu’ils semblaient tous deux éveillés, alors Bahram, parfois, se joignait à eux pour un moment, avant de sentir de nouveau venir le sommeil, et de retourner vers Esmerine. Khalid et Iwang parlaient de la nature du mouvement ou de la vision, regardant à travers l’une des lentilles d’Iwang tout en devisant. Khalid affirmait que l’œil recevait de petites impressions ou des images des objets, qui voyageaient dans l’air jusqu’à lui. Il avait trouvé de très nombreux philosophes, de la Chine jusqu’au Franjistan, qui disaient la même chose, appelant la petite image « eidola », « simulacre », « espèce », « image », « idole », « fantasme », « forme », « intention », « passion », « similarité de l’agent » ou « ombre des philosophes » – nom qui faisait sourire Iwang. Il croyait, quant à lui, que l’œil projetait des émissions d’un fluide aussi rapide que la lumière elle-même, et qui lui revenaient en écho, avec les contours des objets et leurs couleurs exactes.
Bahram soutenait qu’aucune de ces explications n’était juste. La vision ne pouvait s’expliquer par l’optique, disait-il ; la vue était un état d’esprit. Les deux hommes l’écoutaient d’une oreille attentive, puis Khalid secouait la tête.
— Les lois de l’optique ne suffisent peut-être pas à l’expliquer, mais elles sont nécessaires pour un début d’explication. Tu comprends, c’est la partie du phénomène qu’on peut vérifier et décrire mathématiquement, si nous sommes assez futés.
Les canons du khan arrivèrent, et Khalid passa une bonne partie des jours suivants sur la butte dominant la courbe du fleuve, à tirer, en compagnie des vieux Jalil et Paxtakor ; mais il consacrait la majeure partie de son temps à réfléchir aux lois de l’optique et à des expériences à proposer à Iwang. Iwang rentra à son échoppe, pour y souffler de grosses bulles de verre avec des pans coupés, des miroirs, concaves et convexes, et de grosses baguettes triangulaires, parfaitement polies, auxquelles il vouait une vénération quasi religieuse. Iwang passait ses après-midis dans le bureau du vieux Khalid, la porte close. Ils avaient pratiqué dans le mur sud une petite ouverture qui laissait filtrer un mince rayon de lumière. Ils inséraient le prisme dans le trou, et un arc-en-ciel se formait directement sur le mur opposé, ou sur un écran qu’ils avaient placé devant. Iwang dit qu’il y avait sept couleurs, Khalid six, parce qu’il soutenait que le « violet » et le « lavande » d’Iwang étaient en fait les deux parties d’une même couleur. Ils se disputaient sans arrêt au sujet de ce qu’ils voyaient, en tout cas, au début. Iwang fit des diagrammes de leurs manipulations, indiquant l’angle précis sous lequel chacune des couleurs était déviée en passant par le prisme. Ils tinrent des boules de verre devant la lumière et se demandèrent pourquoi elle ne se divisait pas en passant au travers comme avec le prisme, alors que tout le monde pouvait voir, à la fin d’une averse, lorsque le soleil de l’après-midi éclairait le ciel plein de ces minuscules billes de verre – c’est-à-dire des gouttes de pluie –, se créer, à l’est de Samarkand, un très joli arc-en-ciel. À de nombreuses reprises, alors que de noirs orages passaient au-dessus de la ville, Bahram sortit, en compagnie des deux hommes, pour regarder quelques très beaux arcs-en-ciel, et même de doubles arcs-en-ciel, un plus pâle chevauchant le plus clair – et parfois même, un troisième arc-en-ciel, très pâle, au-dessus du deuxième. Pour finir, Iwang établit une loi de la réfraction qui, assura-t-il à Khalid, conviendrait à toutes les couleurs.
— Le premier arc-en-ciel est produit par la réfraction de la lumière qui entre dans la goutte, est réfléchie par la paroi opposée, et déviée une première fois à l’intérieur, puis une seconde fois en sortant. Le second arc est créé par la lumière qui se reflète deux ou trois fois à l’intérieur des gouttes de pluie. Maintenant, regarde, chaque couleur a son propre indice de réfraction, et en rebondissant à l’intérieur de la goutte de pluie, elle se sépare des autres couleurs, qui apparaissent donc à l’œil dans leur séquence exacte, mais renversée pour le deuxième parce qu’il y a un rebond de plus qui la fait s’inverser, comme dans mes dessins, tu vois ?
— Ainsi, si la structure des gouttes de pluie était cristalline, il n’y aurait pas d’arc-en-ciel.
— C’est exactement ça. La neige est pareille. Si tout était réflexion, alors le ciel étincellerait de partout, et crépiterait de lumière blanche, comme s’il était plein de miroirs. Parfois, c’est ce qu’on voit quand il y a une tempête de neige. Les gouttes de pluie étant rondes, l’angle d’incidence passe sans transition de zéro à quatre-vingt-dix degrés, étalant comme un éventail les rayons qui parviennent à l’observateur, ici, qui doit toujours se tenir à un angle de quarante à quarante-deux degrés du soleil. Le deuxième arc-en-ciel apparaît quand l’angle est compris entre cinquante degrés et demi et cinquante-quatre degrés et demi. Tu vois, la géométrie prédit les angles, et ensuite nous les mesurons, en nous servant de cette superbe lunette que Bahram a achetée pour toi au caravansérail chinois, et ça confirme, de façon très précise, la prédiction mathématique.
— Oui, bien sûr, dit Khalid, mais c’est un raisonnement induit. Tu obtiens tes angles d’incidence en regardant dans un prisme, puis tu confirmes les angles dans le ciel par d’autres observations.
— Mais dans un cas, c’étaient des couleurs sur le mur, dans l’autre des arcs-en-ciel !
— Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas !
C’était bien sûr l’un des truismes de l’alchimie. La remarque de Khalid comportait donc une sombre réminiscence.
L’arc-en-ciel qu’ils observaient était en train de se dissiper alors que dans le ciel, à l’ouest, un nuage passait devant le soleil. Les deux hommes ne le remarquèrent cependant pas, tout absorbés qu’ils étaient par leur discussion. Bahram resta seul à observer l’arche de couleurs vibrantes qui traversait le ciel, ce cadeau qu’Allah leur avait fait pour leur montrer qu’il n’inonderait plus jamais le monde. Les deux hommes s’affairaient autour du tableau noir d’Iwang et tripotaient les appareils à regarder le ciel de Khalid.
— On dirait que ça s’en va, dit Bahram.
Ils levèrent les yeux, légèrement agacés d’avoir été interrompus. Quand l’arc-en-ciel brillait, le ciel en dessous était nettement plus clair qu’au-dessus ; maintenant, les deux parties se fondaient dans le même ton bleu ardoise.
L’arc-en-ciel sortit du monde, et ils filèrent vers le complexe, Khalid s’émerveillant à chaque pas, marchant la plupart du temps dans les flaques parce qu’il n’arrivait pas à détacher les yeux de l’ardoise d’Iwang.
— Bon, bon, fort bien… Je dois admettre, c’est aussi net qu’une démonstration d’Euclide. Deux réfractions, peut-être trois – la pluie, le soleil, un observateur pour voir tout cela –, et le tour est joué ! Un arc-en-ciel !
— Et la lumière elle-même, qui se divise en bandes de couleurs, voyageant toutes ensemble hors du soleil, ajouta Iwang d’un ton songeur. C’est tellement clair ! Et quand elle touche une chose, elle rebondit dessus, finit par atteindre l’œil, s’il y a un œil pour regarder, et alors toutes les différentes couleurs, hmmm, voyons voir comment cela pourrait marcher… toutes les surfaces de la Terre étant arrondies, si on pouvait les regarder d’assez près…
— C’est un miracle que les choses ne changent pas de couleur au fur et à mesure de nos déplacements, dit Bahram.
Les deux autres se turent, puis Khalid éclata de rire.
— Un autre mystère ! Allah nous garde ! Il y en aura toujours, jusqu’à ce que nous soyons unis à Dieu !
Cette pensée semblait beaucoup lui plaire.
Il installa dans le complexe une chambre noire, toute drapée de noir, le moindre interstice recouvert d’une planche, jusqu’à ce qu’elle soit encore plus noire que son bureau ne l’avait jamais été, munie de fentes fermées par des volets dans le mur est de façon à laisser filtrer de fines raies de lumière. Il y passa de nombreuses matinées en compagnie de ses assistants, entrant ou sortant en courant, changeant un élément ou un autre de son installation. L’une d’elles lui plut suffisamment pour qu’il invite les savants de la madrasa de Sher Dor à venir la voir, parce qu’elle contredisait radicalement ibn Rachid, pour qui la lumière blanche était indivisible, et les couleurs un effet du prisme. Si c’était le cas, argumenta Khalid, alors la lumière déviée deux fois devrait changer deux fois de couleur. Pour en faire la démonstration, ses assistant laissèrent entrer un fin rai de lumière dans la pièce, et un premier effet de lumière décomposée s’étala sur un écran placé au centre. Khalid lui-même pratiqua un petit trou dans l’écran, suffisamment petit pour que seule la bande rouge du minuscule arc-en-ciel puisse passer, dans un nouveau bureau protégé de la lumière extérieure, où il frappait immédiatement un autre prisme, le rayon diffracté étant dirigé vers un nouvel écran, situé dans ce petit bureau.
— À présent, si la réfraction peut changer la couleur, alors la bande de lumière rouge étant réfléchie une seconde fois changera à nouveau de couleur. Or, observez : elle reste rouge. Chaque couleur reste stable quand on la fait passer une seconde fois à travers un prisme.
Il déplaça doucement l’ouverture devant chaque couleur, pour en faire la démonstration. Ses invités se massaient à la porte de son petit bureau, pour observer le phénomène.
— Qu’est-ce que cela veut dire ? demanda l’un d’eux.
— Eh bien, c’est ce que je vous demande de m’aider à comprendre, ou alors, demandez-le à Iwang. Je ne suis pas philosophe moi-même. Mais je crois que cela prouve que le changement de couleur n’est pas seulement dû à sa réflexion per se. Je crois que cela montre que la lumière du soleil, ou si vous préférez la lumière blanche, ou la pleine lumière, ou la lumière du jour, est composée de plusieurs couleurs indépendantes qui voyagent ensemble.
Les témoins approuvèrent. Khalid ordonna qu’on ouvrît la pièce, et ils se retrouvèrent, clignant des yeux, dans la lumière du soleil, où on leur servit du café et des gâteaux.
— C’est merveilleux, dit Zahhar, l’un des plus éminents mathématiciens de Sher Dor. Très lumineux, si vous me permettez cette expression. Mais que cela nous apprend-il au sujet de la lumière, à votre avis ? Qu’est-ce que la lumière ?
Khalid haussa les épaules.
— Dieu seul le sait, les hommes l’ignorent. Je crois seulement que nous avons mieux mis en lumière, si vous pardonnez cette façon de parler, quelques-uns des comportements de la lumière, justement. Et ce comportement possède quelques aspects que la géométrie peut nous aider à comprendre. On le dirait régi par les nombres, voyez-vous. Tout comme de nombreuses choses sur Terre. Allah semble apprécier les mathématiques, comme vous l’avez souvent répété, Zahhar. Quant à la substance de la lumière, quel mystère ! Elle se déplace vite. À quelle vitesse, nous l’ignorons ; et ce serait bien de le savoir. Nous savons aussi qu’elle est chaude. On le voit au soleil. Et qu’elle traverse le vide – si bien sûr il existe une chose comme le vide dans le monde –, alors que le son, lui, ne le peut pas. Il se pourrait que les Hindous aient raison, et qu’il y ait un autre élément en plus de la terre, du feu, de l’air et de l’eau, un éther si subtil que nous ne le voyons pas, qui remplirait complètement l’univers et serait l’élément naturel du mouvement. Peut-être que ce sont de petits corpuscules, qui rebondissent sur tout ce qu’ils rencontrent, comme sur un miroir, mais généralement moins directement. En fonction de ce qu’ils touchent, une bande particulière de couleur se réfléchit directement dans l’œil.
Il haussa de nouveau les épaules.
— Le mystère reste entier.
Les madrasas mettent la pression
Ces expériences sur les couleurs provoquèrent beaucoup de discussions et de débats dans les madrasas. Khalid apprit, à cette occasion, à ne jamais exprimer d’opinion quant aux causes premières et à ne surtout pas faire intrusion dans le domaine des religieux en évoquant la volonté d’Allah, ou un quelconque autre aspect de la nature de la réalité. Il se contentait de dire : « Allah nous a donné l’intelligence pour mieux comprendre la gloire de son œuvre », ou : « Le monde est régi par les mathématiques. Allah aime les chiffres, les moustiques au printemps, et la beauté. »
Les lettrés s’en allaient, amusés, ou irrités, mais, en tout cas, en proie à une profonde agitation philosophique. Le vieil observatoire d’Ulug Bek, les madrasas de la place du Registan, et de partout ailleurs dans la ville, bourdonnaient de cette nouvelle lubie qui consistait à vouloir faire toutes sortes d’expériences. D’ailleurs, l’atelier de mécanique de Khalid n’était pas le seul à pouvoir inventer et monter de nouvelles machines, toujours plus complexes. Les mathématiciens de Sher Dor, par exemple, fascinaient tout le monde avec une étonnante échelle à mercure, facile à fabriquer, scellée en haut mais pas en bas, et placée debout dans un bol de mercure. Le mercure du tube descendait jusqu’à un certain niveau, créant encore un vide mystérieux dans l’espace laissé libre en haut – le reste du tube demeurant plein d’une colonne de mercure. Les mathématiciens de Sher Dor affirmaient que c’était le poids de l’air du monde sur le mercure du bol qui faisait suffisamment pression dessus pour empêcher le mercure du cylindre de descendre complètement. D’autres prétendaient que c’était parce que le vide du haut du tube n’avait pas envie de grandir. Sur une suggestion d’Iwang, ils emmenèrent leur système au Zeravshan, en haut de la Montagne de Neige, à deux ou trois mille mains au-dessus du niveau de la ville. Là, tout le monde vit que le niveau du mercure avait chuté. Sûrement parce que l’air était moins lourd là-haut. Cela étayait considérablement la précédente théorie de Khalid selon laquelle l’air pesait sur eux ; de même que cela réfutait Aristote, al-Farabi et tous les Arabes aristotéliciens, pour qui les quatre éléments tenaient à rester à leur place, en haut ou en bas. Khalid ne se gênait pas pour se moquer de cette assertion, en privé du moins.
— Comme si les pierres ou le vent pouvaient vouloir être à un endroit plutôt qu’à un autre, comme un homme ! Ce n’est rien, encore une fois, qu’une définition circulaire. « Les choses tombent parce qu’elles ont envie de tomber », comme si elles pouvaient vouloir quelque chose ! Les choses tombent parce qu’elles tombent, c’est tout ce que ça veut dire. N’importe quoi ! Personne ne sait pourquoi les choses tombent, sûrement pas moi. Le mystère reste entier. Tout ce qui relève de l’action à distance demeure mystérieux. Nous sommes bien obligés de l’admettre. Il ne faut pas chercher de fausses solutions à de vrais mystères. À partir de là, il faut observer ce qui arrive et voir si cela nous permet d’échafauder des hypothèses quant au pourquoi et au comment.
Les savants soufis, eux, étaient d’avis d’extrapoler la nature ultime du cosmos à partir d’une expérience donnée, pendant que les mathématiciens étaient fascinés par les aspects purement numériques des résultats, la géométrie du monde telle qu’elle se révélait. Cette approche et d’autres se combinaient dans une frénésie d’activité, consistant en démonstrations, conversations, bricolages de systèmes nouveaux ou améliorés, et recherches solitaires sur des ardoises, que l’on couvrait d’obscures formules mathématiques. Certains jours, Bahram avait l’impression que Samarkand bruissait tout entière de ces investigations : le complexe de Khalid, celui des autres, les madrasas, les ribats, les bazars, les échoppes à café, les caravansérails, d’où les marchands diffuseraient les nouvelles dans le monde entier… Magnifique !
Le coffre de la sagesse
Loin de l’autre côté du mur ouest de la ville, à l’endroit où la vieille route de la Soie s’en allait vers Boukhara, les Arméniens jouissaient de la quiétude de leur caravansérail, qui se trouvait juste à côté de celui des Hindous, énorme et bruyant. Les Arméniens préparaient leur repas à la lueur du crépuscule. Leurs femmes marchaient tête nue, le regard fier, riant entre elles dans une langue qu’elles seules pouvaient comprendre. Les Arméniens étaient d’excellents commerçants, et malgré cela gardaient leurs secrets. Ils ne faisaient le commerce que des marchandises les plus chères, et semblaient savoir tout sur tout. Ils étaient les plus riches et les plus puissants de tous les peuples commerçants. À la différence des juifs, des nestoriens, ou des Zott, ils avaient une terre à eux, dans le Caucase, où la plupart retournaient de temps à autre. En outre, ils étaient généralement musulmans, ce qui leur donnait un avantage considérable dans le Dar al-Islam – c’est-à-dire partout dans le monde, sauf en Chine ou en Inde au sud du Deccan. Selon certaines rumeurs, ils n’étaient en réalité musulmans qu’en apparence – étant au fond restés chrétiens. Pour Bahram, ces rumeurs étaient clairement un coup de poignard donné par les autres marchands. Probablement par les malicieux Zott, qui avaient jadis été chassés d’Inde (d’Égypte, disait-on parfois) et parcouraient le monde, sans maison, et jalousaient la position privilégiée qu’occupaient les Arméniens sur tant de marchés et de produits lucratifs.
Bahram se promenait dans leur camp, entre leurs feux et leurs lanternes, s’arrêtant de temps à autre pour bavarder ou prendre un verre de vin avec une de ses connaissances, jusqu’à ce qu’un vieillard lui indiquât Mantuni, le marchand de livres. C’était un petit vieillard bossu, ratatiné, qui portait des lunettes derrière lesquelles ses yeux paraissaient aussi gros que des citrons. Il parlait un turc rudimentaire, teinté d’un fort accent. Bahram passa au persan, ce dont Mantuni le remercia en courbant profondément la tête. Le vieil homme lui montra, dans un coin, une caisse en bois, pleine à ras bord de livres qu’il avait acquis au Franjistan pour Khalid.
— Tu seras capable de la porter ? demanda-t-il, anxieux, à Bahram.
— Pas de problème, répondit Bahram.
Mais il avait ses propres préoccupations :
— Combien tout cela va-t-il coûter ?
— Oh, rien. C’est déjà réglé. Khalid m’avait payé d’avance, sinon je n’aurais pas été capable d’acheter tous ces livres. Ils viennent de la liquidation d’une succession à Damas, d’une très vieille famille d’alchimistes dont le dernier héritier, un ermite, est mort sans laisser de descendance. Regarde, Le Traité des instruments et des fourneaux, de Zosimo, imprimé il y a seulement deux ans, c’est pour vous. J’ai fait ranger le reste par date de parution, comme tu peux le constater. Et voici La Somme de la perfection, de Jabir, et ses Dix Livres de la Rectification, et, regarde, Le Secret de la création, rédigé par Apollonios le Grec.
Ce dernier était un épais volume relié en peau de mouton.
— L’un des chapitres est la célèbre Table d’émeraude, dit-il en caressant doucement la couverture. Ce chapitre à lui seul vaut au moins deux fois tout ce que j’ai payé pour tous ces livres, mais ils l’ignoraient. L’original de La Table d’émeraude a été trouvé par Sarah, la femme d’Abraham, dans une grotte non loin d’Hébron, peu après le déluge. Il était rédigé, en caractères phéniciens, sur une plaque d’émeraude, que Sarah trouva serrée entre les mains du corps momifié d’Hermès Trismégiste, le père de l’alchimie. Cela dit, d’après d’autres récits, ce serait Alexandre le Grand qui l’aurait découvert. En tout cas, le voici, dans une traduction arabe datant de l’époque du califat.
— Très bien, dit Bahram.
Il n’était pas sûr que Khalid serait toujours intéressé par tout cela.
— Vous y trouverez également La Biographie complète des Immortels, un volume plutôt mince, eu égard à son titre, et Le Coffre de la sagesse, ainsi qu’un livre d’un Franji, Bartholomé l’Anglais, De la propriété des choses. J’y ai inclus L’Épître du soleil au croissant de lune, Le Livre des poisons, qui peut toujours servir, Le Grand Trésor et Documents au sujet des trois similarités, en chinois…
— Iwang pourra lire ça, l’interrompit Bahram. Merci.
Il essaya de soulever la caisse. Elle aurait aussi bien pu être pleine de pierres, et il chancela.
— Es-tu sûr que tu pourras rapporter tout ça à la ville, sans problème ?
— Tout ira bien. Je vais les mettre chez Khalid, où Iwang a une pièce pour travailler. Merci encore. Je suis sûr qu’Iwang voudra en parler avec toi, et peut-être Khalid aussi. Combien de temps restes-tu à Samarkand ?
— Encore un mois, mais pas plus.
— Ils viendront t’en parler.
Bahram marcha tout le long du chemin, la caisse sur sa tête. De temps à autre il faisait une petite pause, pour souffler, et se redonner du cœur au ventre en buvant un peu de vin. Quand il arriva au complexe, il était tard, et il avait la tête qui tournait, mais il y avait encore de la lumière dans le bureau de Khalid. Bahram y trouva le vieil homme en train de lire. Il laissa tomber la caisse triomphalement à ses pieds.
— Voilà de la lecture ! dit-il.
Et il s’effondra sur une chaise.
La fin de l’alchimie
En secouant la tête devant l’ivrognerie de Bahram, Khalid commença à fouiller dans la boîte en sifflant et en babillant.
— Toujours les mêmes vieux trucs, dit-il à un moment, avant de prendre un livre et de l’ouvrir. Ah, fit-il. Un texte franj, traduit du latin en arabe, par un certain ibn Rabi, de Nsara. Écrit, à l’origine, par un certain Bartholomé l’Anglais, au sixième siècle. Voyons ce qu’il raconte… Hmm, hmm…
Il lisait en suivant avec l’index de sa main gauche tandis que ses yeux parcouraient rapidement les pages.
— Quoi ! Mais c’est copié d’ibn Sina !… Et ça aussi ! Les parties alchimiques sont directement pompées sur ibn Sina !
Il continua sa lecture et eut son petit rire bref, sans joie.
— Écoute ça ! Le vif-argent – c’est le mercure – a tellement de vertus et de pouvoirs que tu pourrais poser une pierre de cent livres sur deux livres de vif-argent, le vif-argent en supporterait le poids.
— Quoi ?
— Tu as déjà entendu des conneries pareilles ? S’il voulait parler de mesures de poids, il aurait pu avoir le bon sens de les comprendre.
Il poursuivit sa lecture.
— Ah, dit-il au bout d’un moment. Là, il cite ibn Sina directement : « Le verre, comme le dit Avicenne, est aux pierres ce que le fou est aux hommes, parce qu’il prend toute sortes de couleurs et de motifs. » C’est un homme qui en connaissait un rayon sur la folie qui vous le dit !… Ha… Écoute, voilà une histoire digne de notre Sayyed Abdul Aziz : « Il y a longtemps, quelqu’un créa un verre si souple qu’il pouvait être modifié et travaillé au marteau. Il apporta une flasque faite de ce verre à l’empereur Tibère, et la lança par terre. Elle ne se cassa pas, mais se plia et se comprima. Alors, il la répara à l’aide d’un marteau. » Fais-moi penser à demander à Iwang de nous en faire ! « Ensuite l’empereur ordonna qu’on lui coupe la tête, de peur que ses travaux ne viennent à être connus. Parce que l’or ne vaudrait guère plus que l’argile, et que tous les autres métaux ne vaudraient plus rien. Car assurément, si le verre ne cassait plus, il aurait alors beaucoup plus de valeur que l’or. » C’est une curieuse proposition. Je suppose que le verre était rare, à l’époque.
Il se leva, s’étira, poussa un soupir.
— Alors que des Tibère, on en a tant qu’on veut.
Il feuilleta rapidement la plupart des autres livres avant de les remettre dans la boîte. Il parcourut La Table d’émeraude page à page, réquisitionnant Iwang, et plus tard certains des mathématiciens de Sher Dor, pour l’aider à vérifier chacune des assertions qui s’y trouvaient, susceptibles d’être testées dans son atelier, ou d’avoir des répercussions dans le monde en général. Ils s’accordèrent à dire, pour finir, qu’il s’agissait surtout de fausses informations, et que le peu de vrai qu’il y avait dans tout ce fatras relevait des observations les plus banales dans le domaine de la métallurgie ou des comportements naturels.
Bahram pensa que ce serait une déception pour Khalid, mais en réalité, après tout ce qui était arrivé, ce dernier parut bel et bien soulagé, voire content, de ces résultats. Soudain, Bahram comprit : Khalid aurait été choqué s’il s’était produit quelque chose de magique, choqué et déçu, parce que ça aurait rendu irrégulier et tragique l’ordre qui, pour lui, régissait la nature. Khalid constatait avec une sinistre satisfaction l’échec de toutes les expériences, et mit le vieux livre qui renfermait la sagesse d’Hermès Trismégiste sur le plus haut rayon de son étagère, avec tous ses pareils. À partir de ce moment, il les ignora. Il ne se préoccupa plus désormais que de ses grands livres blancs, qu’il remplissait aussitôt après chaque démonstration, et ensuite, jusque tard dans la nuit ; il y en avait un peu partout, surtout sur les tables de son bureau, et même par terre.
Par une froide nuit, alors que Bahram était sorti faire un tour dans le complexe, il entra dans le bureau de Khalid et trouva le vieil homme endormi sur son divan. Il tira une couverture sur lui, éteignit la plupart des lampes, mais, à la lumière du dernier lumignon, il regarda les grands livres ouverts par terre ; l’écriture de Khalid – qui écrivait de la main gauche – était réduite à des pattes de mouches presque illisibles, un code secret. Mais les petits dessins esquissés étaient plutôt fins, même si ce n’étaient que des schémas : coupe d’un œil, grosse carriole, bandes de lumière, trajectoires de boulets de canon, ailes d’oiseau, engrenages, nombreuses variétés d’acier damasquiné, intérieurs d’athanors, thermomètres, altimètres, mécanismes d’horlogerie de toutes sortes, petites silhouettes au fusain – se battant à l’épée ou accrochées à des hélices géantes comme des graines de tilleul –, visages grimaçant de façon obscène, tigres couchés ou rampants, rugissant dans les marges en face des inscriptions.
Trop engourdi pour regarder les autres pages, Bahram observa le vieil homme endormi, son beau-père, dont le cerveau grouillait de tant de choses. C’est drôle, les gens qui nous accompagnent dans cette vie. Il retourna en titubant se coucher, retrouver la chaleur d’Esmerine.
La vitesse de la lumière
Les nombreux tests de décomposition de la lumière par un prisme réveillèrent chez Khalid la question de sa vitesse, et malgré les fréquentes visites de Nadir ou de ses séides, il n’arrivait pas à parler d’autre chose que de la déterminer. Finalement, il mit au point une expérience dans ce but : ils se sépareraient en deux groupes, lanterne à la main, et l’équipe de Khalid emporterait avec elle la plus précise de ses horloges, qu’on pouvait arrêter instantanément en appuyant sur un levier. Un test préliminaire avait permis de déterminer qu’à la nuit noire la lumière de la plus grosse des lanternes était visible depuis le sommet de la colline d’Afrasiab jusqu’à la crête de Shamiana, par-delà la vallée du fleuve, à une dizaine de lis à vol de corbeau. Avec plusieurs petits feux qu’ils auraient occultés ou dévoilés à l’aide de tapis, ils auraient très certainement pu augmenter la distance, mais Khalid ne pensait pas que ce serait nécessaire.
Ils se mirent donc en route un soir, vers minuit, lors de la première nouvelle lune. Bahram, Khalid, Paxtakor et de nombreux autres serviteurs partirent vers la colline d’Afrasiab ; Jalil, Iwang, et d’autres serviteurs, vers la crête de Shamiana. Leurs lanternes étaient munies de mécanismes qui s’ouvraient automatiquement à une vitesse qu’ils avaient précalculée. C’était le moyen de réaction le plus rapide qu’ils avaient pu imaginer. L’équipe de Khalid allumerait sa lanterne en même temps qu’elle mettrait en marche son chronomètre ; quand les hommes d’Iwang verraient la lumière, ils ouvriraient à leur tour leur lanterne, et quand l’équipe de Khalid verrait cette réponse lumineuse, elle arrêterait son chronomètre. Une expérience on ne peut plus simple.
Ils durent marcher longtemps pour atteindre la colline d’Afrasiab, derrière le vieux pont de l’est, au bout d’une piste qui traversait les ruines de l’ancienne cité d’Afrasiab, pâle mais visible à la lumière des étoiles. L’air sec de la nuit charriait des senteurs de verveine, de romarin et de menthe. Khalid était de bonne humeur, comme toujours avant une expérience. Il vit Paxtakor et les serviteurs prendre plusieurs gorgées d’une outre de vin, et leur dit :
— Vous sucez encore plus que notre pompe à vide. Faites attention, ou vous allez finir par aspirer le vide du Bouddha dans le monde, et nous nous retrouverons tous dans votre outre !
Au sommet dénudé de l’énorme colline, ils patientèrent, le temps que l’équipe d’Iwang atteigne la crête de Shamiana, dont on devinait la masse noire sous les étoiles. Le sommet de la colline d’Afrasiab, vu de Shamiana, était adossé aux montagnes de la chaîne du Dzhizak, de telle sorte qu’Iwang ne verrait, par-dessus la colline d’Afrasiab, aucune étoile susceptible de le faire se tromper, mais simplement l’austère fond sombre du Dzhizak.
Ils avaient laissé quelques bâtons-repères au sommet de la colline, pointant dans la direction de la station opposée, et à présent Khalid grognait d’impatience.
— Voyons s’ils sont arrivés, dit-il.
Bahram se tourna vers la crête de Shamiana, ouvrit le volet de sa lanterne et la balança d’avant en arrière. Un instant plus tard, ils virent la lueur jaune de la lanterne d’Iwang, parfaitement visible, juste en dessous de la ligne noire de la crête.
— Bien, dit Khalid. Maintenant, couvrez.
Bahram ferma le volet, et la lanterne d’Iwang s’éteignit elle aussi.
Bahram se tenait à la gauche de Khalid. Le chronomètre et la lanterne étaient posés sur une table de voyage, et solidarisés par une armature qui déclenchait au même moment le chronomètre et l’ouverture de la lanterne. L’index de Khalid était posé sur la touche qui permettait d’arrêter aussitôt le chronomètre. Khalid murmura :
— Maintenant !
Bahram, son cœur s’emballant soudain, pressa le bouton du dispositif, et la lumière de la lanterne d’Iwang apparut au même moment sur la crête de Shamiana.
— Qu’Allah nous garde ! s’exclama-t-il. Je n’étais pas prêt, recommençons !
Ils s’étaient préparés à faire vingt essais, aussi Bahram n’eut-il qu’un léger hochement de tête, tandis que Khalid étudiait le chronomètre à l’aide d’une seconde lanterne à œil de bœuf, et que Paxtakor notait l’instant auquel elle s’était arrêtée, à savoir deux battements un tiers.
Ils essayèrent encore une fois, et encore une fois la lanterne d’Iwang s’illumina au moment même où Bahram ouvrait la sienne. Une fois que Khalid se fut habitué à la vitesse des échanges, les essais durèrent moins d’un battement de cils. Pour Bahram, c’était comme s’ils ouvraient la porte de la lanterne de l’autre côté de la vallée ; Iwang était même si rapide que c’en était choquant, sans parler de la vitesse de la lumière ! Une fois, il fit même semblant d’ouvrir le volet de sa lanterne, le poussant tout doucement puis s’arrêtant, pour voir si le Tibétain ne lisait pas dans ses pensées.
— Très bien, dit Khalid au bout du vingtième essai. Heureusement que nous n’en faisons que vingt. Nous aurions fini par devenir si bons que nous aurions vu s’allumer la leur avant même d’avoir allumé la nôtre !
Tout le monde rit. Khalid, qui s’était montré cassant durant les essais, semblait maintenant content, et ils furent soulagés. Ils descendirent la colline et rentrèrent en ville, parlant bruyamment, buvant du vin – même Khalid, qui maintenant ne buvait presque plus jamais, alors que c’était autrefois l’un de ses plaisirs favoris. Ils avaient testé leurs réflexes dans le complexe, et donc savaient que leurs essais avaient été au moins aussi bien chronométrés, voire mieux.
— Si l’on oublie le premier essai et que l’on fait la moyenne des suivants, cela devrait donner une vitesse à peu près aussi rapide que le processus lui-même.
— La lumière doit être instantanée, dit Bahram.
— Mouvement instantané ? Vitesse infinie ? Je ne crois pas qu’Iwang soit jamais d’accord avec cette notion, en tout cas il ne sera certainement pas d’accord pour l’accepter comme conclusion de cette seule expérience.
— Qu’en penses-tu ?
— Moi ? Je crois qu’il faut nous éloigner plus encore. Mais nous venons de démontrer que la lumière est rapide, cela ne fait pas de doute.
Ils traversèrent les ruines vides d’Afrasiab en passant par la route nord-sud de l’ancienne cité, qui menait au pont. Les serviteurs, devant eux, pressèrent le pas, laissant Khalid et Bahram sur place.
Khalid chantonnait des notes sans suite. En l’entendant, et en songeant aux pages couvertes de pattes de mouche des carnets du vieil homme, Bahram demanda :
— Tu sembles bien heureux ces derniers temps, père. Pourquoi ?
Khalid le regarda, l’air surpris.
— Moi ? Je ne suis pas heureux.
— Mais si !
Khalid rit.
— Bahram, tu es tellement naïf.
Soudain, il agita son poignet amputé sous le menton de Bahram.
— Regarde, mon garçon. Regarde bien ! Comment pourrais-je être heureux avec ceci ? C’est impossible, évidemment. Mon déshonneur, ma bêtise et mon ambition sont inscrits là, pour que tout le monde puisse les voir et se les rappeler, chaque jour. Allah est sage, même quand il punit. Je suis à tout jamais déshonoré dans cette vie, et je ne pourrai jamais m’en remettre. Jamais manger proprement, jamais me laver, jamais caresser les cheveux de Fedwa, la nuit. Cette vie est finie. Tout ça à cause de la peur, et de l’orgueil. Bien sûr que j’ai honte, bien sûr que je suis fâché – contre Nadir, le khan, moi-même, et Allah – oui, contre lui aussi ! Contre vous tous ! Je serai toujours en colère, toujours !
— Ah, dit Bahram, consterné.
Ils continuèrent leur route silencieusement, au milieu des ruines illuminées par les étoiles.
Khalid soupira.
— Ah, ne fais pas cette tête-là, mon garçon – malgré tout ça – qu’est-ce que je suis censé faire ? Je n’ai que cinquante ans. Avant qu’Allah ne me prenne, j’ai encore du temps devant moi, et il faut bien que je l’occupe. En plus, comme si cela ne suffisait pas, j’ai mon amour-propre. Les gens m’observent, bien entendu. J’étais un homme important, et les gens ont adoré me voir chuter, c’est évident. Et ils continuent d’adorer ça. Alors, quel genre d’histoire vais-je leur donner la prochaine fois ? Parce que c’est ce que nous sommes pour les autres, mon garçon, un sujet de ragot. C’est ça la civilisation, un moulin géant à moudre les ragots. Ainsi, je suis l’histoire de cet homme qui était monté très haut et qui est tombé très bas ; l’homme qui a été cassé, et qui est allé se cacher, rampant comme un chien, dans un trou, pour y mourir. Ou alors je puis être l’histoire de cet homme qui est monté, puis tombé, et qui s’est relevé, comme pour relever un défi, marchant sur une autre route. Quelqu’un qui ne regarde jamais en arrière, quelqu’un qui ne donne à la foule aucune satisfaction. Ça, c’est l’histoire dont j’entends bien les soûler. Et s’ils veulent entendre une autre histoire à mon sujet, qu’ils aillent se faire foutre ! Je suis un tigre, mon garçon, j’ai été un tigre dans une existence antérieure, j’ai dû l’être en tout cas, parce que j’en rêve tout le temps. Je me glisse entre les arbres, je suis en train de chasser. Maintenant mon tigre est attelé à mon chariot, et en avant !
Il tendit sa main gauche vers la ville devant eux.
— C’est la clé, mon garçon, tu dois apprendre à atteler ton tigre à ton chariot.
Bahram hocha la tête.
— En faisant des expériences.
— Mais oui, mais oui !
Khalid s’arrêta et montra le ciel pailleté d’étoiles.
— Et ça, mon garçon, c’est ce qu’il y a de mieux ! Ce qu’il y a de plus merveilleux, parce que c’est sacrément intéressant ! Ce n’est pas un simple moyen d’occuper le temps ou d’échapper à tout ça, fit-il en balayant à nouveau le décor avec son moignon. C’est la seule chose qui compte. Enfin, je veux dire, pourquoi sommes-nous ici, mon garçon ? Pourquoi sommes-nous ici ?
— Pour répandre plus d’amour.
— D’accord, d’accord… Mais comment faire pour aimer au mieux ce monde qu’Allah nous a donné ? En apprenant comment il marche ! Il est là, d’un bloc, avec ces merveilles renouvelées tous les matins, et nous sommes obligés de marner pour complaire à nos khans, nos califats, et tout le toutim. C’est absurde ! Mais si on essaye de comprendre les choses, si on regarde le monde et si on se demande : pourquoi cela arrive-t-il, pourquoi les corps tombent-ils, pourquoi le soleil se lève-t-il tous les matins pour briller au-dessus de nos têtes, réchauffer l’air et faire verdir l’herbe – comment tout cela arrive-t-il ? Selon quelles lois Allah a-t-il fait ce monde ? Alors, ça change tout. Dieu voit qu’on apprécie le monde. Et même s’il ne le voit pas, même si en fin de compte on ne sait rien, même s’il est impossible de savoir quoi que ce soit, au moins on aura essayé.
— Et beaucoup appris, commenta Bahram.
— Pas vraiment. Pas du tout. Mais avec un mathématicien comme Iwang sous la main, nous pourrons peut-être finir par comprendre quelques petites choses, ou bien faire de petites découvertes que nous pourrons transmettre à d’autres. C’est là la véritable œuvre de Dieu, Bahram. Dieu ne nous a pas donné ce monde pour que nous nous contentions d’y ruminer comme des chameaux. Mahomet lui-même a dit : « Recherche le savoir, même si pour cela il te faut aller en Chine ! » Là, grâce à Iwang, c’est la Chine qui est venue à nous. Cela rend les choses plus intéressantes.
— Alors tu es heureux, tu vois ? C’est bien ce que je disais !
— Heureux et furieux. Furieusement heureux. Tout à la fois. C’est la vie, mon garçon. Tu passes ton temps à t’emplir, et tu finis par éclater. Alors Allah te prend, et jette ton âme dans une autre vie, un peu plus tard. Ainsi, tout continue à se remplir.
Un coq matinal chanta à la périphérie de la ville. Dans le ciel, à l’est, les étoiles s’éteignaient une à une. Les serviteurs parvinrent au complexe de Khalid bien avant eux, et l’ouvrirent, mais Khalid s’arrêta au beau milieu des montagnes de charbon, et regarda autour de lui, avec satisfaction.
— Voilà notre Iwang, dit-il doucement.
Le grand Tibétain entra en traînant les pieds comme un ours, épuisé, et pourtant souriant.
— Alors ? demanda-t-il.
— Trop rapide pour qu’on puisse la mesurer, avoua Khalid.
Iwang grogna.
Khalid lui tendit l’outre de vin, et il en prit une longue rasade.
— La lumière, dit-il. Que dire d’autre ?
Le ciel à l’est s’emplissait de cette substance, de cette qualité mystérieuse. Iwang se balançait d’un pied sur l’autre comme un ours dansant au son de la musique. Il était clair qu’il était heureux, heureux comme Bahram ne l’avait jamais vu. Les deux vieux compères avaient adoré leur nuit de travail. L’équipe d’Iwang avait connu bien des mésaventures. Les hommes avaient bu du vin, ils s’étaient perdus, ils avaient roulé dans des fossés, ils avaient chanté, ils avaient confondu d’autres lumières avec celle de Khalid, et puis, au cours du test, n’ayant aucune idée des durées qu’on inscrivait, là-bas, sur la colline d’Afrasiab, cette ignorance les avait frappés par sa drôlerie. Ils s’étaient mis à rire comme des idiots.
Mais ces péripéties n’expliquaient pas la bonne humeur d’Iwang – en fait, c’était plutôt un enchaînement d’idées, qui l’avait mis en état de réceptivité, comme disent les soufis, murmurant des choses dans sa langue maternelle, qu’il fredonnait d’une voix profonde. Les serviteurs chantaient une chanson pour la venue de l’aube.
Il dit à Khalid et Bahram :
— En descendant la crête, je dormais debout, et j’ai eu une vision. En pensant à cette lumière, clignotant dans l’obscurité de la vallée, je me suis dit : Et si je pouvais voir tous les instants en une seule fois, aussi distincts et indépendants les uns des autres que notre Terre voguant dans l’espace, chacun un tout petit peu différent… Si je me déplaçais entre tous ces moments comme si je passais d’une pièce à l’autre, je pourrais tracer la carte du voyage de la Terre. Chaque pas que je faisais en descendant la crête était comme un monde en soi, une tranche d’infinité faite du monde de ce pas. Alors, je suis descendu, passant de monde en monde, pas à pas, sans jamais voir le sol à cause des ténèbres, et il me sembla que s’il devait exister un nombre permettant de révéler l’exacte localisation de chacun de mes pas, alors la crête entière serait révélée, parce qu’il suffirait de tracer une ligne entre chacun de ces pas. Nos pieds aveugles le font sans réfléchir dans le noir, et nous sommes nous-mêmes aveugles quant à la réalité ultime, mais nous pouvons néanmoins saisir l’ensemble par de petites touches régulières. Alors nous pourrions dire : Voici ce qui est ici, ou là, sachant qu’il n’y a pas d’énormes rochers ou d’ornières entre chaque pas, et ainsi la forme de toute la crête pourrait être connue. À chaque pas, je franchissais des mondes.
Il regarda Khalid.
— Tu vois ce que je veux dire ?
— Peut-être, répondit Khalid. Tu suggères d’évaluer un mouvement à l’aide de nombres.
— Oui, et aussi le mouvement à l’intérieur du mouvement, les changements de vitesse, tu sais, qui doivent bien évidemment se produire dans ce monde, au gré de la résistance ou de l’incitation.
— La résistance de l’air, dit Khalid, ravi. Nous vivons au fond d’un océan d’air. Il a son poids, comme l’a démontré l’échelle de mercure. Il pèse sur nous. Il nous apporte les rayons du soleil.
— Qui nous réchauffent, ajouta Bahram.
Le soleil perça à travers les montagnes distantes, à l’est, et Bahram ajouta :
— Prions et remercions Allah pour le glorieux soleil, témoignage dans ce monde de son amour infini.
— Sur ce, dit Khalid en bâillant bruyamment, au lit !
Une démonstration de vol
Évidemment, leurs diverses activités leur valurent une autre visite de Nadir Divanbegi. Cette fois, Bahram était au bazar, le sac sur l’épaule, en train d’acheter des melons, des oranges, des poulets et de la corde, lorsque Nadir apparut soudain devant lui, flanqué de deux gardes du corps en armure et armés de mousquets à long canon. C’était un événement que Bahram ne pouvait pas considérer comme une coïncidence.
— Bien le bonjour, Bahram. J’ai entendu dire que tu étais très occupé, ces temps-ci.
— Toujours, effendi, fit Bahram en inclinant la tête.
Les deux gardes du corps l’observaient comme des faucons.
— Et toutes ces belles activités sont entreprises, bien entendu, pour l’amour de Sayyed Abdul Aziz Khan, et la plus grande gloire de Samarkand ?
— Bien entendu, effendi.
— Alors, parle-m’en, fit Nadir. Fais-m’en la liste, et dis-moi comment tout cela avance.
Bahram déglutit péniblement. Nadir l’avait alpagué au bazar parce qu’il pensait qu’il en apprendrait plus de Bahram que de Khalid ou d’Iwang, et qu’ici, dans un lieu public, Bahram serait trop embarrassé pour biaiser.
Alors il fronça les sourcils et essaya de prendre un air aussi grave et illuminé que possible, ce qui n’était vraiment pas très difficile en ce moment.
— Ils font beaucoup de choses que je ne comprends pas, effendi. Mais le travail semble plus ou moins tourner autour des armes et des fortifications.
Nadir hocha la tête, et Bahram fit un geste en direction d’un marchand de melons près duquel ils se trouvaient.
— Vous permettez ?
— Je vous en prie, répondit Nadir en le suivant.
Bahram s’approcha donc des plateaux de miel et de melons, et commença à en poser quelques-uns sur la balance. Avec Nadir Divanbegi et ses gardes du corps dans la boutique, il était sûr d’obtenir un bon prix !
— Pour les armes, improvisa Bahram en indiquant les melons rouges à un marchand au visage boudeur, nous travaillons à renforcer le métal du fût des canons, afin de les rendre plus légers et plus résistants. Et puis, encore une fois, nous procédons à des tests de trajectoire des boulets en faisant varier les paramètres, en utilisant des poudres et des canons différents, vous voyez ; puis nous enregistrons les résultats pour mieux les étudier, afin de pouvoir déterminer à quel endroit précis nos tirs parviendront.
— Ça, ça pourrait vraiment servir, en effet, répondit Nadir. Vous faites vraiment tout ça ?
— Nous y travaillons, effendi.
— Et les fortifications ?
— Il s’agit de fortifier les murailles, répondit simplement Bahram.
— Évidemment, fit Nadir. Faites-moi la courtoisie d’organiser une de ces fameuses démonstrations pour l’édification de la cour. (Il regarda Bahram droit dans les yeux pour souligner le fait qu’il ne s’agissait pas d’une invitation de pure forme.) Et vite.
— Bien sûr, effendi.
Il savait que Khalid serait furieux d’entendre toutes ces promesses irréfléchies qu’il était en train de faire, mais Bahram ne voyait pas d’autre moyen de s’en sortir que de répondre aussi vaguement que possible, en espérant que cela passerait.
— Quelque chose qui retiendra aussi l’attention du khan. Quelque chose d’excitant pour lui.
— Naturellement.
Nadir fit, d’un doigt, signe à ses hommes, et ils repartirent vers l’autre bout du bazar, laissant derrière eux un sillon d’effervescence dans la foule empressée.
Bahram poussa un profond soupir et s’essuya le front.
— Hé, toi ! lança-t-il en faisant les gros yeux au vendeur qui enlevait un melon de la balance.
— Ce n’est pas du jeu, dit le marchand.
— Non, convint Bahram. Mais les affaires sont les affaires.
Le marchand ne pouvait dire le contraire. En fait, il souriait sous sa moustache tandis que Bahram se laissait tomber sur une caisse.
Bahram retourna au complexe et rapporta l’échange à Khalid, qui grommela, comme prévu. Khalid finit son dîner en silence, piquant des morceaux de lapin dans un bol avec une petite pique d’argent qu’il tenait de la main gauche. Il reposa la pique, s’épongea le visage avec un chiffon et se leva lourdement.
— Viens dans mon bureau et répète-moi exactement ce que tu lui as dit.
Bahram rapporta la conversation aussi fidèlement que possible, pendant que Khalid faisait tourner un globe de cuir sur lequel il avait essayé de dessiner le monde. Il avait laissé la majeure partie en blanc, éludant les revendications des cartographes chinois qu’il avait étudiées, leurs îles dorées nageant dans l’océan, à l’est de Nippon, localisées à différents endroits selon les cartes. Il poussa un soupir quand Bahram eut fini.
— Tu as bien fait, dit-il. Tes promesses étaient vagues, et elles vont dans le bon sens. Nous pourrons nous y conformer plus ou moins fidèlement, et nous en retirerons peut-être même quelque chose sur tel ou tel sujet que nous aurions approfondi de toute façon.
— De nouvelles expériences en perspective…, dit Bahram.
— Oui, fit Khalid, une lumière dans les yeux.
Pendant les semaines suivantes, l’activité habituellement frénétique du complexe prit un tour nouveau. Khalid fit venir tous les canons qu’il avait obtenus de Nadir, et de sourdes détonations émaillèrent leurs journées. Khalid, Iwang, Bahram et les artisans qui fabriquaient la poudre à canon tiraient à tour de bras dans la plaine, à l’ouest de la cité, où ils pouvaient retrouver les boulets après avoir visé des cibles qu’ils atteignaient rarement.
Khalid grommela, en ramassant l’une des cordes avec lesquelles ils ramenaient le canon sur la marque.
— Et si nous fixions les canons au sol ? proposa-t-il. De grosses cordes, de gros piquets… Ça permettrait peut-être aux boulets d’aller plus loin.
— On peut toujours essayer.
Ils essayèrent différentes méthodes. À la fin de la journée, ils avaient la tête cassée par les coups de canon, et Khalid prit l’habitude de se boucher les oreilles avec du coton pour les protéger un peu.
Iwang était de plus en plus absorbé par la trajectoire des boulets. Khalid et lui parlaient de formules mathématiques et de diagrammes auxquels Bahram ne comprenait rien. Il avait l’impression qu’ils perdaient de vue le but de l’exercice, et qu’ils traitaient le canon simplement comme un mécanisme destiné à faire des démonstrations de mouvement, de vitesse et de changement de vitesse.
Et puis Nadir réapparut, porteur de nouvelles. Le khan et sa suite devaient venir le lendemain pour constater leurs progrès.
Khalid passa une nuit blanche dans son bureau, à faire des listes de démonstrations envisageables. Le lendemain, à midi, tout le monde se réunit sur la plaine ensoleillée à côté du fleuve, le Zeravshan. Un grand pavillon fut dressé pour que le khan puisse se reposer en observant les événements.
Ce qu’il fit, allongé sur un divan couvert de soieries, en dégustant des sharbats et en bavardant avec une jeune courtisane plus qu’en suivant les démonstrations. Mais Nadir était debout à côté des canons, et il observa tout très attentivement, en enlevant le coton de ses oreilles pour poser des questions après chaque tir.
— Quant aux fortifications, répondit Khalid à un moment donné, c’est de l’histoire ancienne. L’affaire avait été résolue par les Franjs avant leur disparition. Un boulet de canon arrivera toujours à détruire quelque chose de solide.
Il dit à ses hommes de tirer au canon sur une muraille de pierres qu’ils avaient cimentées en prévision de l’expérience. Le boulet la pulvérisa magnifiquement, et le khan et sa suite poussèrent des cris et des acclamations – bien qu’en fait Samarkand et Boukhara fussent protégées par des murs de grès qui ressemblaient beaucoup à celui qui venait de tomber.
— Maintenant, dit Khalid, regardez ce qui arrive quand un boulet de la même taille, tiré par le même canon, chargé de la même façon, frappe la cible suivante.
C’était un monticule de terre qui avait été érigé non sans efforts par les ex-souffleurs de verre de Khalid. On tira le canon, la fumée âcre s’éclaircit ; le monticule de terre resta inchangé, en dehors d’une cicatrice à peine visible, au centre.
— Le boulet de canon ne peut rien faire. Il se contente de s’enfouir dans la terre et il est avalé. Cent canons ne feraient aucune différence face à une muraille de ce genre. Les boulets se contenteraient de s’y intégrer.
Le khan entendit cela, et n’en fut pas amusé.
— Vous suggérez que nous entassions de la terre autour de Samarkand ? Impossible ! Ce serait bien trop laid ! Les autres khans et les émirs se moqueraient de nous. Nous ne pouvons pas vivre comme des fourmis dans une fourmilière.
Khalid se tourna vers Nadir, le visage poliment atone.
— Ensuite ? demanda Nadir.
— Oui… Maintenant, comprenez-bien qu’à la distance à laquelle un canon tire un boulet, il ne peut le tirer de façon rectiligne. Le boulet, en traversant l’air, peut décrire une courbe dans n’importe quelle direction – et c’est ce qu’il fait.
— Voyons, l’air ne peut sûrement pas offrir une résistance suffisante au fer, dit Nadir avec un revers de main expressif.
— Juste un peu de résistance, c’est exact, mais comprenez que le boulet passe à travers plus de deux lis d’air. Imaginez l’air comme une sorte d’eau légère. Elle aurait certainement un effet. On le voit mieux avec des balles en bois de la même taille, lancées à la main de telle sorte qu’on puisse voir leur mouvement. Nous allons en lancer dans le vent, et vous allez voir comment elles vont partir dans tous les sens.
Bahram et Paxtakor lancèrent les balles de bois en les tenant dans la paume de la main, et elles se mirent à tournoyer dans le vent comme des chauves-souris.
— Mais c’est absurde ! dit le khan. Les boulets de canon sont beaucoup plus lourds. Ils traverseraient le vent comme un couteau coupant du beurre !
Khalid hocha la tête.
— C’est absolument vrai, grand khan. Nous n’utilisons ces balles de bois que pour souligner un effet qui doit se produire avec n’importe quel objet, même aussi lourd que du plomb.
— Ou de l’or, fit Sayyed Abdul Aziz, pour plaisanter.
— Ou de l’or. Dans ce cas, les boulets de canon ne dévient que très légèrement, mais sur les grandes distances qu’ils franchissent, ça devient significatif. De sorte qu’on ne peut jamais dire exactement où les boulets vont tomber.
— Ça doit être toujours vrai, répondit Nadir.
Khalid agita son moignon, oubliant un instant à quoi il ressemblait.
— Nous pourrions remédier à cet inconvénient. Regardez comment les balles de bois volent si elles sont lancées avec effet.
Bahram et Paxtakor lancèrent les boules de balsa en leur imprimant au dernier moment, du bout des doigts, un mouvement de rotation. Certaines des balles décrivirent une courbe, mais elles allèrent plus vite et plus loin que les balles qui avaient été envoyées avec la paume de la main. Bahram atteignit cinq fois d’affilée une cible de tir à l’arc, ce qui lui fit grand plaisir.
— La rotation stabilise leur trajectoire dans le vent, expliqua Khalid. Elles sont encore poussées par lui, évidemment – c’est inévitable. Mais elles ne dévient plus de façon aléatoire quand elles ont le vent de face. C’est le même effet qu’on obtient en empennant une flèche pour la stabiliser.
— Alors vous proposez d’empenner les boulets de canon ? demanda le khan en pouffant.
— Pas exactement, Votre Seigneurie, mais si, en effet. Pour essayer d’obtenir le même genre de rotation. Nous avons expérimenté deux méthodes différentes pour y parvenir. L’une consiste à creuser des stries dans les boulets. Mais ça veut dire qu’ils vont beaucoup moins loin. L’autre consiste à rainurer l’intérieur du fut du canon, formant une longue spirale dans le tube, un tour complet ou un peu moins, sur toute la longueur. Ainsi, le boulet jaillit du canon avec un effet.
Khalid et ses hommes approchèrent un canon plus petit et tirèrent un boulet. Les aides repérèrent l’endroit où il était tombé et le marquèrent avec un drapeau rouge. Il était allé un peu plus loin que le boulet tiré par le plus gros canon.
— Ce n’est pas tant la distance que la précision qui est améliorée, expliqua Khalid. Les boulets partiront toujours tout droit. Nous sommes en train d’établir des tables qui devraient nous permettre de choisir la poudre à canon par type et par poids, et de peser les boulets, et ainsi, avec les mêmes canons, bien sûr, d’envoyer toujours les boulets précisément à l’endroit voulu.
— C’est intéressant… dit Nadir.
Sayyed Abdul Aziz Khan rappela Nadir.
— Nous allons rentrer au palais, dit-il en conduisant sa suite vers les chevaux.
— … mais pas assez, dit Nadir à Khalid. Essayez encore.
De beaux cadeaux pour le khan
— Et si je faisais pour le khan une nouvelle armure damasquinée ? s’exclama Khalid. Quelque chose de joli.
Iwang eut un grand sourire.
— Tu saurais le faire ?
— Bien sûr. C’est de l’acier trempé. Il n’y a aucun mystère. La charge du creuset est un lingot de fer appelé wootz, qu’on forge pour en faire une plaque de fer mêlée à du bois, qui apporte ses cendres au mélange, auquel on aura ajouté de l’eau. On en place quelques creusets dans le fourneau, et quand tout a fondu, le contenu est versé dans un moule de fer fondu, à une température inférieure à celle de la fusion complète des deux éléments. L’acier obtenu est ensuite gravé avec un sulfate minéral ou un autre. On obtient des couleurs et des motifs différents selon le type de sulfate utilisé, le type de wootz, et la température. Cette lame, là, tu vois… (il se leva et prit une lourde dague incurvée à la poignée d’ivoire, et à la lame ornée sur toute sa surface d’une dense résille de lignes entrecroisées, anthracite et blanc), c’est un bon exemple d’ornement appelé « l’échelle de Mahomet ». C’est un travail persan, censé venir de la forge de l’alchimiste Jundi-Shapur. Ils disent qu’il y a de l’alchimie là-dedans.
Il fit une pause, haussa les épaules.
— Et tu crois que le khan…
— En jouant systématiquement sur la composition du wootz, la structure des lingots, la température, le liquide de gravure, nous obtiendrons certainement d’autres maillages. J’aimerais bien retrouver ces sortes de petits tourbillons que j’avais déjà obtenus avec un acier trempé contenant beaucoup de bois.
Un profond silence s’établit. Khalid n’était pas content, c’était évident.
Bahram dit :
— Tu n’as qu’à faire comme si c’était une série de tests.
— Comme d’habitude, répliqua Khalid, énervé. Mais faire des tests, c’est essayer de faire les choses sans en connaître les causes. Ça exige trop de tout, trop de matériaux, trop de substances et de manipulations. Je pense que tout ça se passe à une échelle trop petite pour qu’on puisse l’observer. Les cassures que l’on constate après le moulage ressemblent à des structures cristallines brisées. C’est intéressant, ce qui se passe, mais il n’y a pas moyen de savoir pourquoi, ni de prédire ce qui va se passer. C’est à ça que servent les démonstrations, tu vois. Ça t’apprend quelque chose de particulier. Ça répond à une question.
— Eh bien, nous n’avons qu’à poser des questions auxquelles la métallurgie répondra, suggéra Bahram.
Khalid hocha la tête à contrecœur. Mais il regarda Iwang, pour voir ce qu’il en pensait.
Iwang pensait que c’était en théorie une bonne idée, mais qu’en pratique lui aussi avait du mal à trouver le genre de questions auxquelles ces essais pourraient répondre. Ils savaient à quelle température porter le fourneau, quels minerais, bois et eau ajouter, en quelles quantités, combien de temps il fallait les mélanger, et quelle serait la dureté de l’alliage résultant. Toutes les questions touchant à la pratique de cet art avaient trouvé leurs réponses depuis longtemps, en fait, depuis que l’on faisait de l’acier damasquiné à Damas. Quant aux questions plus fondamentales portant sur les causes, toujours sans réponse, elles étaient difficiles à formuler. Bahram lui-même essaya, longtemps, sans qu’une seule idée lui vienne. Pourtant les bonnes idées étaient sa force, c’était du moins ce qu’on lui disait.
Pendant que Khalid travaillait la question, Iwang s’absorbait avec une concentration terrifiante dans ses mathématiques, laissant même de côté ses travaux de souffleur de verre et d’orfèvre, qu’il abandonna presque totalement à ses nouveaux apprentis, de jeunes et grands Tibétains émaciés, qui étaient apparus il y avait quelque temps, mystérieusement. Il se plongea dans ses livres hindous et ses vieux parchemins tibétains, couvrant ses tablettes de graffitis avant de les reporter sur l’un de ses nombreux carnets de notes : diagrammes colorés, suites de chiffres hindis, lettres ou symboles tibétains, chinois ou sanskrits ; un alphabet secret pour un langage secret – tel était du moins ce que se disait Bahram. Une entreprise plutôt inutile, dérangeante à regarder, tant les feuilles de papier semblaient riches d’un pouvoir palpable, magique, dément. Toutes ces étranges idées étaient arrangées en schémas hexagonaux de chiffres et d’idéogrammes ; et pour Bahram, la boutique du bazar commença à ressembler à l’antre ténébreux d’un magicien, à l’orée de la réalité…
Iwang chassa toutes ces toiles d’araignée de sa tête, en allant s’asseoir au soleil dans la cour du complexe avec Khalid, Zahhar et Tazi – qui venaient de Sher Dor. Bahram leur faisait de l’ombre en regardant par-dessus leurs épaules. Alors Iwang leur parla d’une notion mathématique, qu’il appelait la vitesse-de-la-vitesse.
— Tout est mouvement, dit-il. C’est le karma. La Terre tourne autour du Soleil, le Soleil voyage à travers les étoiles, les étoiles voyagent… Mais pour les besoins de la démonstration que je vais vous faire, je vous propose de partir d’un royaume du non-mouvement. Il se peut que l’univers soit contenu dans un tel vide immobile, mais peu importe ; pour les besoins de la démonstration, il ne s’agit que de dimensions purement mathématiques, qu’on peut désigner comme verticales et horizontales, ou, si vous voulez, par la longueur, la largeur, la hauteur – les trois dimensions que nous connaissons. Mais commençons avec deux dimensions, ce sera plus simple. Un objet en mouvement, par exemple un boulet de canon, peut être situé à l’aide de ces deux dimensions. À quelle distance il est en haut ou en bas, à gauche ou à droite. On pourrait le représenter comme sur une carte. Donc, encore une fois, la dimension horizontale pourra servir à indiquer le passage du temps, et la dimension verticale la distance parcourue, dans une direction donnée. Ça marcherait très bien pour les lignes courbes, pour représenter le mouvement d’un objet dans l’air. Des lignes tangentes à la courbe indiqueraient la vitesse-de-la-vitesse. Alors, on mesurerait tout ce qu’il est possible de mesurer, on reporterait ces mesures, et ce serait comme si on passait à travers les pièces d’une maison. Chaque pièce ayant un volume différent, comme une bouteille, selon sa largeur et sa hauteur. C’est-à-dire qu’elle exprimerait une distance et le temps mis à la parcourir. Une quantité de mouvement, vous me suivez ? Un boisseau de mouvement, une once.
— Cela permettrait de décrire avec précision la trajectoire des boulets de canon, dit Khalid.
— Oui. Plus facilement que la plupart des choses, parce qu’un boulet de canon suit une même ligne. Une courbe, mais rien à voir avec le vol de l’oiseau, par exemple, ou une personne vacant à ses occupations quotidiennes. Dans ce cas, les lois mathématiques…
Iwang parut se perdre, se secoua, et revint à eux.
— De quoi étais-je en train de parler ?
— Des boulets de canon.
— Ah ! Oui, on peut très bien calculer leur trajectoire, aucun problème.
— À condition de connaître la vitesse de départ et l’angle de tir…
— On pourrait savoir très exactement où le boulet atterrira, oui.
— On devrait en parler à Nadir en privé.
Khalid arrangea plusieurs tables entre elles pour permettre de calculer la trajectoire des tirs de canon, avec de jolis dessins de courbes montrant la trajectoire d’un boulet, et un petit livre tibétain plein des précieux calculs d’Iwang. Ces objets furent placés dans une boîte en bois ouvragé, sertie d’argent, de turquoises et de lapis-lazuli, et apportés au khanaka de Boukhara, en même temps qu’un magnifique pectoral damasquiné pour le khan. Le rectangle d’acier ornant le centre représentait un magnifique tourbillon d’acier blanc et gris, avec des mouchetures de fer très finement ciselées par un traitement au vitriol et autres acides. Ce dessin fut appelé par Khalid « Maelström du Zeravshan », et en effet les arabesques ressemblaient à s’y méprendre à un tourbillon du fleuve, qui se produisait à la base du pont Dagbit quand l’eau était à son plus haut. C’était l’une des plus belles pièces de métal travaillé que Bahram ait jamais vues, et il lui sembla que, avec la boîte décorée contenant les travaux mathématiques d’Iwang, cela faisait vraiment un magnifique cadeau pour Sayyed Abdul Aziz.
Khalid et lui avaient revêtu leurs plus belles parures pour l’audience, et Iwang les rejoignit en manteau rouge sombre et chapeau conique à ailes, comme les moines tibétains – en fait, un lama de la plus haute distinction. Ainsi, les porteurs de cadeaux étaient aussi impressionnants que les cadeaux eux-mêmes, se disait Bahram ; bien que, une fois dans le Registan, sous la grande arche couverte de feuilles d’or de la madrasa Tilla Kari, il se sentit moins important. Et une fois en compagnie de la cour, il se sentit tout simplement normal, même pauvrement vêtu, comme un gamin essayant de se faire passer pour un courtisan. En fait, un péquenaud.
Le khan, en tout cas, fut enchanté par l’armure, et loua grandement l’art de Khalid, posant même le pectoral sur sa poitrine, et l’y laissant. Il admira également la boîte, dont il tendit le contenu à Nadir.
Quelques moments plus tard, on leur donna congé, et Nadir les mena au jardin de Tilla Kari. Les diagrammes étaient fort intéressants, dit-il en les parcourant ; il voulait les observer de plus près. Entre-temps, les armuriers du kahn lui avaient appris que faire une spirale à l’intérieur du fut de leurs canons avait provoqué l’explosion de l’un d’eux, les autres ayant perdu en portée. Nadir voulait que Khalid aille trouver les armuriers pour en parler avec eux.
Khalid accepta sur-le-champ, bien que Bahram pût voir dans ses yeux qu’il n’en pensait pas moins ; une fois encore, il serait pris par autre chose que ce qu’il avait vraiment envie de faire. Ce qui échappa à Nadir, bien qu’il n’eût pas quitté Khalid des yeux. En fait, il lui dit joyeusement à quel point le khan appréciait sa grande sagesse et son talent, et combien le peuple du khanat, et de tout le Dar al-Islam, lui serait redevable, si, comme cela semblait probable, ses efforts permettaient de repousser les différentes incursions des Chinois, dont on disait qu’ils avaient envahi les terres du khanat, à l’ouest de leur empire. Khalid le remercia poliment. Ensuite, ils purent partir.
Sur le chemin du retour, qui longeait le fleuve, Khalid se montra irrité.
— Ce voyage n’a servi à rien.
— Il est trop tôt pour le dire, objecta Iwang.
Bahram était d’accord.
— Si. Le khan est un…, dit Khalid en soupirant. Et Nadir ne voit en nous que des serviteurs, c’est clair.
— Nous sommes tous les serviteurs du khan, lui rappela Iwang.
Cela fit taire Khalid.
Comme ils approchaient de Samarkand, ils passèrent non loin des ruines de l’ancienne Afrasiab.
— Dommage que les rois sogdiens ne soient plus là…, dit Bahram.
Khalid secoua la tête.
— Ce ne sont pas les ruines des rois sogdiens, mais celles de Markanda, qui s’étendait ici avant Afrasiab. Alexandre le Grand disait que c’était la plus belle ville qu’il ait jamais conquise.
— Et regarde-la, maintenant, dit Bahram. Ce ne sont plus que de vieilles ruines poussiéreuses, des murs effondrés…
— Samarkand aussi sera un jour comme ça, dit Iwang.
— Alors, qu’importe que nous soyons à la botte de Nadir, c’est ça ? lâcha Khalid.
— Cela aussi passera, dit Iwang.
Des joyaux dans le ciel
Nadir prenait de plus en plus de temps à Khalid, qui ne tenait plus en place. Un jour, il alla trouver Divanbegi pour lui proposer de construire un système complet de drainage souterrain à Boukhara et à Samarkand, afin d’éliminer les nombreuses mares d’eau stagnante qui polluaient les deux villes, surtout Boukhara. Ça empêcherait l’eau de croupir, diminuerait le nombre de moustiques et la survenue des maladies, et notamment la peste. Les caravanes hindoues rapportaient qu’elle dévastait des parties entières du Sind. Khalid suggéra de mettre en quarantaine tous les voyageurs qui arrivaient en ville quand il y avait des rumeurs de peste, et de faire patienter les caravanes qui venaient des zones infectées, pour s’assurer qu’elles n’étaient pas contaminées. Un délai de purification, analogue aux purifications spirituelles du ramadan.
Mais Nadir ignora toutes ces recommandations. Un système de canalisations souterraines, bien que commun en Perse avant même les invasions mongoles, était trop coûteux pour être envisageable à ce moment-là. C’était une aide militaire qu’on attendait de Khalid ; pas une aide médicale. Nadir ne pensait pas que Khalid pût avoir quelques compétences que ce fût en médecine.
C’est ainsi que Khalid regagna le complexe et mit tout le monde au travail sur l’artillerie du khan, en faisant de chaque aspect des canons un sujet d’expérimentation, mais sans essayer d’apprendre quoi que ce soit des causes premières, comme il disait, sauf, occasionnellement, à propos du mouvement. Il travailla sur la résistance du métal avec Iwang, utilisa les mathématiques d’Iwang pour faire des études sur la trajectoire des boulets, et expérimenta un certain nombre de méthodes pour faire en sorte que les boulets de canon décrivent en volant une spirale régulière.
Tout cela était fait à contrecœur et dans la mauvaise humeur ; et Khalid ne retrouvait sa sérénité que l’après-midi, après avoir fait la sieste et mangé des yoghourts, ou tard le soir, après avoir fumé un de ses narghilés. Il pouvait alors se remettre à ses travaux sur les prismes, les bulles de savon, les pompes à air et les colonnes de mercure.
— Si on pouvait mesurer le poids de l’air, on devrait pouvoir mesurer la chaleur, jusqu’à des températures bien supérieures à ce que nous arrivons à distinguer avec nos ampoules, nos « aïe ! » et nos « ouille ! ».
Tous les mois, Nadir envoyait des hommes aux nouvelles à l’atelier de Khalid, et de temps en temps il passait en personne, sans se faire annoncer, plongeant tout le complexe dans la panique, comme une fourmilière envahie par les eaux. Khalid restait immuablement affable, mais se plaignait amèrement à Bahram d’avoir à fournir tous les mois des nouvelles – surtout qu’ils en avaient très peu à donner.
— Moi qui croyais avoir échappé à la malédiction de la lune depuis la ménopause de Fedwa ! ronchonnait-il.
Ironie du sort, ces visites importunes lui faisaient aussi perdre ses appuis dans les madrasas, parce qu’on le croyait favorisé par le trésorier, et qu’il ne pouvait prendre le risque de leur exposer la situation dans toute sa vérité. Il y avait donc des regards froids, des rebuffades au bazar et à la mosquée ; et puis on se montrait souvent agressivement obséquieux avec lui. Ce qui le rendait irritable. Il lui arrivait même parfois de se mettre carrément en rage.
— Un peu de pouvoir, et on voit à quel point les gens sont horribles.
Pour l’empêcher de replonger dans la plus noire mélancolie, Bahram courait partout dans le caravansérail à la recherche de choses susceptibles de lui plaire. Il allait surtout voir les Hindous et les Arméniens, et même les Chinois, et il revenait avec des livres, des boussoles, des pièces d’horlogerie, et un étrange astrolabe, qui voulait prouver que les six planètes occupaient des orbites inscrites dans des polygones qui comportaient chaque fois un côté de moins que le précédent : Mercure tournait dans un décagone, Vénus dans un ennéagone juste assez grand pour contenir le décagone, la Terre dans un octogone qui contenait l’ennéagone, et ainsi de suite jusqu’à Saturne, dont l’orbite était contenue dans un grand cube. Cet astrolabe étonna Khalid et fit l’objet entre Iwang et Zahhar d’intenses discussions, qui duraient la nuit entière, quant à la disposition des planètes autour du Soleil.
Ce nouvel intérêt pour l’astronomie supplanta bientôt tous les autres pour Khalid. Cela devint une véritable passion lorsque Iwang lui apporta un curieux dispositif qu’il avait fabriqué dans son atelier, un long tube d’argent, creux à l’exception des lentilles de verre placées aux deux extrémités. Quand on regardait dans le tube, les choses paraissaient se rapprocher et leurs détails se préciser.
— Comment ça peut-il bien marcher ? demanda Khalid en se collant le bout du tube sur l’œil.
La surprise qu’on pouvait lire sur son visage le faisait ressembler à ces pantins du bazar : naïfs et drôles. Bahram était ravi de le voir ainsi.
— Comme le prisme, peut-être ? suggéra Iwang, indécis.
Khalid secoua la tête.
— Je ne parle pas du fait qu’on voie les choses plus grosses ou plus près, mais qu’on voie beaucoup plus de détails. Comment cela se peut-il ?
— Il est probable que ces détails sont là tout le temps, attendant qu’on les regarde, avança Iwang. Mais l’œil n’a le pouvoir d’en discerner qu’une partie. Je reconnais que je suis surpris, mais réfléchis : la plupart des gens ont la vue qui baisse avec l’âge, surtout de près. Je sais que je n’ai plus mes yeux de vingt ans. J’ai fait mon premier jeu de lentilles pour les utiliser comme lunettes, tu sais, une pour chaque œil, dans une monture. Et pendant que j’en insérais une, j’ai regardé à travers les deux lentilles, l’une devant l’autre. (Il mima l’action avec un grand sourire.) J’étais vraiment très impatient de m’assurer que vous voyiez tous les deux les mêmes choses que moi, pour vous dire la vérité. Je n’arrivais pas à en croire mes yeux.
Khalid regarda à nouveau dans le tube.
C’est ainsi qu’ils se mirent à observer toutes sortes de choses. Des crêtes lointaines, des oiseaux en vol, des caravanes approchant. Ils montrèrent la lunette à Nadir, qui vit aussitôt quelles applications militaires on pouvait en tirer. Ils en avaient fait une pour lui, incrustée de grenats, qu’il apporta au khan – et ils apprirent que le khan était content. Ce qui n’atténua en rien la pression du khanat sur le complexe de Khalid, évidemment ; bien au contraire. Nadir mentionnait en passant qu’ils attendaient avec impatience la prochaine invention remarquable qui sortirait de l’atelier de Khalid, parce qu’on disait que les Chinois étaient en effervescence. Et qui pouvait prévoir comment ce genre de situation évoluerait ?
— Ça ne finira jamais, dit amèrement Khalid, quand Nadir fut parti. C’est comme un collet qui se resserrerait au moindre de nos mouvements.
— Parle-lui de nos découvertes bribe par bribe…, suggéra Iwang. Il aura l’impression d’en avoir plus.
Khalid suivit son conseil, ce qui lui valut un peu de répit, et ils travaillèrent sur toutes sortes de sujets qui donnaient l’impression de pouvoir aider les troupes du khan au combat. Khalid laissait libre cours, la nuit, à sa passion pour les causes premières, surtout quand ils braquaient leur nouvelle lunette sur les étoiles pour l’essayer, et notamment, plus tard le même mois, sur la Lune – qui se révéla être un monde désolé, montagneux, très caillouteux en vérité, grêlé d’innombrables cratères, comme si un super-empereur avait tiré au canon dessus. Et puis, par une nuit mémorable, ils pointèrent leur lunette sur Jupiter, et Khalid s’exclama :
— Dieu tout-puissant ! C’est un monde, aussi, c’est très net ! Avec des bandes au niveau de l’équateur. Et regarde, ces trois étoiles, à côté, plus brillantes que des étoiles : se pourrait-il que ce soient des lunes de Jupiter ?
C’était possible. Elles tournaient vite autour de Jupiter, et les deux qui en étaient le plus près, plus vite que la troisième – tout comme les planètes autour du Soleil. Bientôt, Khalid et Iwang en virent une quatrième, et ils firent un croquis des quatre orbites, afin de préparer les futurs observateurs à comprendre ce qu’ils voyaient, en regardant d’abord leurs schémas. De tout ça, ils firent un livre, un autre cadeau pour le khan – un cadeau sans application militaire ; mais ils donnèrent aux lunes les noms de ses quatre plus vieilles épouses, et il faut croire que ça lui plut. Il aurait dit :
« Des joyaux dans le ciel ! Pour moi ! »
Qui est l’étranger ?
Il y avait, en ville, des factions qui n’aimaient pas Bahram. Quand il se promenait dans le Registan, en voyant ces centaines d’yeux le regarder, les conversations s’amorcer ou s’interrompre sur son passage, il se rendait compte qu’il faisait, lui aussi, partie d’une coterie, d’une faction ; et peu importait qu’il se soit toujours montré bon et gentil. Il était de la famille de Khalid, qui était l’allié d’Iwang et de Zahhar. Ils faisaient collectivement partie de la puissance de Nadir Divanbegi. Ils étaient donc les alliés de Nadir, bien que ce fut lui qui les avait obligés à l’être, comme de la pulpe de papier placée sous une presse ; et même s’ils le détestaient. Beaucoup d’autres personnes à Samarkand détestaient Nadir, encore plus que Khalid, cela ne faisait aucun doute. Khalid était sous sa protection, alors que ces gens étaient ses ennemis : proches d’un adversaire mort, en prison ou en exil, sans doute. À moins qu’ils n’aient pas réussi à se placer lors d’une précédente bataille de palais. Le khan avait d’autres conseillers – courtisans, généraux, parents qui se trouvaient à la cour –, tous jaloux de la parcelle d’attention qu’il leur portait, et envieux de la grande influence de Nadir. Parfois, Bahram avait vent de rumeurs du palais rapportant des complots contre Nadir, mais il n’en connaissait pas les détails. Le fait que leur association, involontaire, avec Nadir puisse leur causer du tort par ailleurs était pour lui d’une injustice criante ; leurs affaires lui valaient déjà suffisamment de souci.
Un jour, cette impression d’avoir des ennemis cachés se trouva vérifiée : Bahram était en visite chez Iwang, quand deux cadis qu’il n’avait jamais vus apparurent à la porte de la boutique du Tibétain, escortés par deux des soldats du khan et un petit troupeau d’oulémas de la madrasa de Tilla Kari. Ils demandèrent à voir les reçus prouvant qu’Iwang avait bien payé ses taxes.
— Je ne suis pas un dhimmi, dit Iwang avec son calme habituel.
Les dhimmis, ou « gens du livre », étaient ces incroyants qui étaient nés et vivaient au khanat, et devaient s’acquitter d’une taxe particulière. L’islam était la religion de la justice, et tous les musulmans étaient égaux devant Dieu et la loi ; mais de tous les citoyens du bas de l’échelle, les femmes, les esclaves et les dhimmis, ces derniers étaient les seuls à pouvoir changer de statut en décidant de se convertir à la vraie foi. En effet, on se rappelait un temps lointain où régnait la loi du « livre ou de l’épée » pour tous les païens, et où seuls les gens du livre – les juifs, les zoroastriens, les chrétiens et les sabins – pouvaient garder leur foi, s’ils y tenaient vraiment. Aujourd’hui, les païens, quelles que fussent leurs origines, étaient autorisés à garder leurs diverses religions, tant qu’ils s’enregistraient auprès du cadi, et s’acquittaient de la taxe annuelle des dhimmis.
C’était banal et simple. Mais depuis que les Safavides chiites étaient montés sur le trône en Iran, le statut légal des dhimmis s’était affaibli – non seulement en Iran, où les mollahs chiites étaient obsédés de pureté, mais aussi dans les khanats de l’Est. La question était laissée à la discrétion des autorités locales. Ainsi qu’Iwang l’avait déjà fait remarquer, l’incertitude elle-même faisait partie de la taxe à payer.
— Vous n’êtes pas un dhimmi ? releva l’un des cadis, surpris.
— Non, je viens du Tibet. Je suis un mustamin.
Les mustamins étaient les visiteurs étrangers, autorisés à vivre pour un temps donné en terre musulmane.
— Avez-vous un aman ?
— Oui.
C’était le sauf-conduit délivré aux mustamins, renouvelé chaque année par le khanaka. Alors, Iwang alla chercher un parchemin dans son arrière-boutique, et revint le montrer aux cadis. Les cadis examinèrent attentivement les nombreux sceaux de cire apposés au bas du document.
— Il est resté huit ans ! se plaignit l’un d’eux. C’est plus que la loi ne l’autorise !
Iwang haussa les épaules.
— On me l’a renouvelé ce printemps.
Un lourd silence s’abattit alors que les hommes examinaient de nouveau les sceaux.
— Un mustamin ne peut être propriétaire, nota quelqu’un.
— Tu es propriétaire de cette boutique ? demanda le chef des cadis, qui allait de surprise en surprise.
— Non, répondit Iwang. Bien sûr que non. Je me contente de la louer.
— Tous les mois ?
— J’ai un bail renouvelable chaque année. Après le renouvellement de mon aman.
— D’où viens-tu ?
— Du Tibet.
— Tu as une maison, là-bas ?
— Oui. À Iwang.
— De la famille ?
— Des frères et des sœurs. Pas de femme ni d’enfants.
— Alors, qui habite ta maison ?
— Une de mes sœurs.
— Tu rentres bientôt ?
Iwang attendit un instant.
— Je ne sais pas, répondit-il.
— Tu veux dire que tu n’as pas l’intention de repartir chez toi ?
— Non, je pense repartir… Mais, les affaires marchent bien, ici. Ma sœur m’envoie des lingots d’argent, dont je fais des objets. C’est Samarkand.
— Oui, et les affaires y seront toujours bonnes ! D’ailleurs, pourquoi partirais-tu ? Tu devrais être un dhimmi, tu es un résident permanent ici, un sujet païen du khan.
Iwang haussa de nouveau les épaules, montra le document. C’était Nadir qui avait apporté ça au khanat, songea Bahram, quelque chose qui venait du cœur de l’islam : la loi était la loi. Les dhimmis et les mustamins étaient protégés par contrat, chacun à leur façon.
— Il ne fait même pas partie des gens du livre, dit un des cadis avec indignation.
— Nous avons beaucoup de livres au Tibet, signala Iwang, faisant comme s’il n’avait pas compris.
Les cadis se sentirent offensés.
— Quelle est ta religion ?
— Je suis bouddhiste.
— Alors tu ne crois pas à Allah, tu ne pries pas Allah ?
Iwang ne répondit pas.
— Les bouddhistes sont polythéistes, dit l’un des cadis. Comme les païens que Mahomet a convertis en Arabie.
Bahram s’avança devant eux.
— « Il n’y a pas de contrainte en religion », dit-il en citant le Coran. À toi, ta religion, à moi, ma religion. C’est ce que le Coran nous enseigne !
Les visiteurs le dévisagèrent froidement.
— N’es-tu pas musulman ? demanda l’un d’eux.
— Bien sûr que je le suis ! Vous le sauriez si vous connaissiez la mosquée de Sher Dor ! Je ne vous y ai jamais vus – où priez-vous le vendredi ?
— À la mosquée de Tilla Kari, répondit le cadi, maintenant fâché.
Ce qui était des plus intéressants, la madrasa de Tilla Kari étant le lieu de réunion des groupes d’étudiants chiites, opposés à Nadir.
— « Al-kufou millatun wahida », dit l’un d’eux.
C’était une contre-citation, ainsi que l’appelaient les théologiens. « L’incroyance est une religion. »
— Seul le digaraz peut se plaindre de la loi, rétorqua Bahram.
Les digaraz étaient ceux qui parlaient sans rancune ni malice, des musulmans d’une neutralité bienveillante.
— Tu n’en es pas un, reprit Bahram.
— Toi non plus, jeune homme.
— Mais c’est vous qui êtes là ! Qui vous a envoyés ? Vous défiez la loi de l’aman, qui vous y autorise ? Sortez d’ici ! Vous n’avez aucune idée de ce que cet homme fait pour Samarkand ! C’est une insulte à Sayyed Abdul lui-même, c’est l’islam que vous insultez ! Dehors !
Les cadis ne bougèrent pas, mais quelque chose dans leur attitude montrait qu’ils étaient sur leurs gardes. Le chef dit, en regardant l’aman d’Iwang :
— Nous en reparlerons au printemps prochain.
D’un geste de la main qui ressemblait à celui du khan, il conduisit les autres dehors. Bahram les vit s’éloigner le long de l’étroit passage qui sortait du bazar.
Pendant un long moment, les deux amis ne surent quoi se dire, aussi mal à l’aise l’un que l’autre.
Finalement, Iwang lâcha un profond soupir.
— Je croyais que Mahomet avait établi une loi régissant la façon dont les hommes devaient être traités dans le Dar al-Islam ?
— C’est Dieu qui l’a établie. Mahomet n’a fait que la transcrire.
— Tous les hommes libres sont égaux devant la loi. Les femmes, les enfants, les esclaves et les incroyants, un peu moins.
— Tous sont égaux, mais ils ont chacun leurs droits particuliers, protégés par la loi.
— Mais pas autant de droits que les musulmans libres.
— Ils ne sont pas aussi forts, alors leurs droits ne sont pas aussi contraignants. Ce sont des gens qui doivent être placés sous la protection des musulmans libres, dans le respect des lois divines.
Iwang pinça les lèvres.
— Dieu est la force en mouvement dans chaque chose, dit-il. Les formes que prennent les objets en mouvement.
— Dieu est l’amour passant à travers toute chose, acquiesça Bahram. C’est ce que disent les soufis.
Iwang approuva.
— Dieu est un mathématicien. Un très grand et très subtil magicien. Nos corps sont aux fourneaux rudimentaires et aux alambics de ton complexe ce que les mathématiques de Dieu sont aux mathématiques.
— Alors, tu reconnais qu’il y a un Dieu ? Je croyais que Bouddha niait l’existence d’un dieu.
— Je ne sais pas. Je parie que certains bouddhistes diraient le contraire. Le vivant sourd du vide. Je ne sais pas, moi-même. Si tout ce que nous voyons n’est entouré que de vide, d’où viennent les mathématiques ? Il me semble qu’elles sont le résultat d’une chose pensante.
Bahram était surpris d’entendre Iwang proférer de tels propos. Il se demandait jusqu’à quel point il croyait ce qu’il disait, après ce qui venait de se passer avec les cadis de Tilla Kari. Bien que cela fasse sens : il était évidemment impossible qu’une chose aussi complexe et belle que le monde puisse parvenir à l’existence sans qu’un Dieu tout-puissant et aimant en soit à l’origine.
— Tu devrais venir à la confrérie soufie, et écouter ce que dit mon professeur, lâcha finalement Bahram, souriant en imaginant le grand Tibétain parmi eux.
Cela dit, leur professeur apprécierait certainement.
Bahram repartit vers le complexe en passant par le caravansérail ouest, où les marchands hindous avaient établi leur campement. Il y régnait une odeur d’encens et de thé au lait. Bahram y termina les quelques courses qu’il avait à faire, achetant des parfums et des sacs de minerais calcinés pour Khalid. Apercevant Dol, qu’il avait connu à Ladakh, il alla le saluer, et prit d’abord le thé avec lui, puis du rakshi, jetant par moments de petits coups d’œil sur les monticules d’épices et les petites figurines de bronze. Bahram tendit le doigt vers les statuettes finement ciselées, et demanda :
— Ce sont vos dieux ?
Dol le regarda, surpris et amusé.
— Certaines sont des dieux, en effet. Celle-ci est Shiva, celle-ci Kali – la destructrice –, celle-ci est Ganesh.
— Un dieu éléphant ?
— C’est ainsi que nous le représentons. Ils ont d’autres formes.
— Mais… un éléphant ?
— As-tu déjà vu un éléphant ?
— Jamais.
— Ils sont très impressionnants.
— Je sais qu’ils sont énormes.
— C’est plus que ça.
Bahram avala une gorgée de thé.
— Je crois qu’Iwang pourrait se convertir à l’islam.
— Il a des problèmes avec son aman ?
Dol rit en voyant l’expression de Bahram, et l’incita à prendre une gorgée de la cruche de rakshi.
Bahram s’exécuta aussitôt, puis continua :
— Crois-tu qu’il soit possible de changer de religion ?
— Beaucoup de gens l’ont fait.
— Mais tu pourrais faire ça ? Tu pourrais dire : « Il n’y a qu’un seul Dieu » ? fit-il en montrant les nombreuses figurines.
Dol sourit.
— Brahma a de très nombreux aspects, tu sais. Et derrière chacun d’eux, il y a le grand Dieu Brahma, qui les contient tous.
— Alors Iwang pourrait être comme ça, lui aussi. Il pourrait déjà croire au seul et unique dieu, le Dieu des Dieux.
— Il pourrait. Dieu se manifeste par autant de façons qu’il y a de gens.
Bahram soupira.
Mauvais air
Bahram venait d’entrer dans le complexe et s’apprêtait à aller parler à Khalid de l’incident chez Iwang quand la porte de l’atelier de chimie s’ouvrit à la volée et que des hommes en surgirent précipitamment, pourchassés par un Khalid hurlant et une épaisse fumée jaune. Bahram tourna les talons et se hâta vers la maison pour empoigner Esmerine et les enfants, mais ils étaient déjà dehors et couraient à toute vitesse. Il les suivit hors du complexe, tout le monde criant et hurlant, et puis, comme le nuage fondait sur eux, ils se laissèrent tomber à terre et se mirent à ramper comme des rats, toussant, hoquetant, crachant et pleurant. Ils dévalèrent la colline en roulant, la gorge, les yeux et les poumons en feu à cause du nuage jaune, empoisonné. La plupart d’entre eux suivirent l’exemple de Khalid et plongèrent tête la première dans le fleuve, n’émergeant que pour de brèves bouffées, en se gardant bien d’inspirer à fond, avant de remettre la tête sous l’eau. Lorsque le nuage se fut dissipé et que Khalid se fut un peu remis, il commença à jurer.
— Qu’est-ce que c’était ? demanda Bahram, qui toussait encore.
— Un creuset d’acide a explosé. Nous faisions une expérience.
— Quel genre ?
Khalid ne répondit pas. Lentement, l’irritation de leurs fragiles muqueuses s’atténua. Le petit groupe détrempé, malheureux, regagna le domaine clopin-clopant. Khalid demanda à ses hommes de nettoyer le laboratoire, puis, suivi de Bahram, se rendit dans son bureau, où il se changea, se lava et coucha quelques notes dans son grand livre, sans doute au sujet de l’expérience ratée.
Sauf que l’échec n’était pas si complet que ça. Tel était, du moins, ce que Bahram déduisit des grommellements de Khalid.
— Qu’essayais-tu de faire, au juste ?
Khalid ne répondit pas directement.
— Il me paraît certain qu’il y a différentes sortes d’air… Différents composants, peut-être, comme dans les métaux. Sauf qu’ils sont tous invisibles à l’œil nu. Nous sentons les différences, parfois. Et il y en a qui peuvent tuer, comme au fond des puits. Ce n’est pas une absence d’air, dans ce cas-là, mais une mauvaise sorte d’air, ou d’un de ses composants. Manifestement plus lourd. Et des distillations différentes, des combustions différentes… On peut éteindre ou étouffer un feu… Quoi qu’il en soit, je pensais qu’en mélangeant du sal ammoniac, du salpêtre et du soufre, j’obtiendrais un air différent. Et c’est ce qui s’est passé, mais j’en ai trop obtenu, et trop vite. Et tout a pété ! C’était manifestement un poison, dit-il en toussant comme un perdu. Cela ressemble à la recette du wan-jen-ti des alchimistes chinois, le « tueur-de-milliers ». Je suppose que je pourrais montrer cette réaction à Nadir et proposer d’en faire une arme. On pourrait peut-être tuer une armée tout entière, avec ça.
Ils ruminèrent cette pensée en silence.
— Enfin, dit Bahram, ça l’aiderait peut-être à conforter sa position auprès du khan.
Il lui expliqua ce qu’il avait vu chez Iwang.
— Tu crois que Nadir a des ennuis à la cour ?
— Oui.
— Et tu penses qu’Iwang pourrait se convertir à l’islam ?
— Il avait l’air de vouloir se renseigner.
Khalid se mit à rire, et partit d’une nouvelle quinte de toux.
— Ce serait bizarre.
— Les gens n’aiment pas qu’on se moque d’eux.
— D’une façon ou d’une autre, je pense que ça lui serait égal, à Iwang.
— Tu savais que c’était le nom de sa ville, Iwang ?
— Non. C’est vrai ?
— Oui. C’est ce qu’il avait l’air de dire.
Khalid haussa les épaules.
— Ça veut dire que nous ne connaissons pas son vrai nom.
Nouveau haussement d’épaules.
— Personne ne connaît jamais son vrai nom.
Un amour grand comme le monde
Vers la fin des moissons, comme l’hiver approchait et que les passes vers l’est étaient fermées, le caravansérail se vida. Les journées de Bahram étaient enrichies par la présence d’Iwang au ribat soufi : il s’asseyait au fond et écoutait attentivement tout ce que le vieux maître Ali disait, ne parlant que rarement, et seulement pour poser les questions les plus simples, généralement sur le sens de tel ou tel mot. Les soufis utilisaient beaucoup de mots persans ou arabes, et bien que le turco-sogdi d’Iwang fut bon, le langage religieux était encore obscur pour lui. Pour finir, le maître donna à Iwang le lexique de termes techniques soufis, ou « istilahat », d’Ansari, intitulé Cent champs et endroits où se reposer, qui comportait une introduction se terminant ainsi : « La véritable essence des états spirituels des soufis est telle que les mots peinent à la décrire : néanmoins, ceux qui ont connu ces états en comprennent parfaitement tous les termes. »
Ce qui, pensait Bahram, était la source du principal problème d’Iwang : il n’avait connu aucun des états décrits.
— Très probablement pas, disait Iwang à Bahram quand ce dernier lui en faisait la remarque. Mais comment faire pour les atteindre ?
— Par l’amour, répondait invariablement Bahram. Tu dois aimer tout ce qui est, particulièrement les gens. Tu verras, c’est l’amour qui fait se mouvoir toute chose.
Iwang plissait les yeux.
— Avec l’amour vient la haine, disait-il. Ce sont les deux facettes de l’excès de sentiment. La compassion plutôt que l’amour, cela me paraîtrait plus adéquat. Il n’y a pas de contrepartie négative à la compassion.
— L’indifférence, suggérait Bahram.
Iwang hochait la tête, réfléchissant à tout cela. Mais Bahram se demandait s’il arriverait jamais à bien comprendre. La source de l’amour de Bahram jaillissait, comme une puissante fontaine dans les collines, de ses sentiments pour sa femme et ses enfants, puis pour Allah, qui lui avait accordé le privilège de vivre sa vie parmi de si belles âmes – pas seulement sa famille, mais aussi Khalid, Fedwa, et tous leurs proches, et les gens du complexe, de la mosquée, du ribat, de Sher Dor, et bien entendu de tout Samarkand et du vaste monde, quand il se sentait en communion avec ce dernier. Iwang n’avait pas ce genre de point d’ancrage, étant célibataire et sans enfants, pour autant que le savait Bahram – et un infidèle par-dessus le marché. Comment pourrait-il ressentir le moins du monde cet amour d’ordre beaucoup plus général et diffus, s’il ne trouvait pas à s’investir en qui que ce fut ?
— Le cœur qui est plus grand que l’intellect n’est pas celui que nous sentons battre dans notre poitrine.
Ainsi parlait Ali. Il s’agissait d’ouvrir son cœur à Dieu, et de permettre à l’amour d’y occuper la première place. Iwang savait déjà comment faire le calme en lui, comment être à l’écoute du monde dans ses moments de quiétude, s’asseyant certains matins, à l’aube, à l’extérieur du complexe, après une nuit passée sur un matelas dans sa boutique. Bahram l’avait déjà rejoint en une ou deux occasions lors de ces éveils matinaux, et avait été alors inspiré par un ciel couleur d’or, si calme, qu’il avait récité Rumi :
Te voilà bien silencieuse, maison du cœur !
Le cœur, à la fois cœur et foyer,
À compris le monde.
Quand Iwang avait fini par répondre, après que le soleil eut percé au-dessus des crêtes et inondé la vallée d’une lumière crémeuse, il avait dit :
— Je me demande si le monde est aussi grand que Brahmagupta le prétend.
— Il disait que c’était une sphère, n’est-ce pas ?
— Oui, bien sûr. On peut s’en rendre compte dans les steppes, quand une caravane point à l’horizon : on voit d’abord les têtes des chameaux. Nous sommes à la surface d’une grande boule.
— Le cœur de Dieu.
Pas de réponse, que des mouvements de tête. Iwang n’était pas d’accord, mais il ne voulait pas le contredire. Bahram renonça et demanda quelles étaient les estimations hindoues de la taille de la Terre, qui étaient clairement ce qui intéressait Iwang à présent.
— Brahmagupta a remarqué que le soleil brillait très précisément à la verticale d’un puits du Deccan, un certain jour de l’année. L’année suivante, il s’arrangea pour être un millier de yogandas plus au nord. Il mesura l’angle des ombres et, grâce à la géométrie des sphères, calcula quel pourcentage de ce cercle représentait cet arc long d’un millier de yogandas. Très simple, très intéressant.
Bahram hocha la tête ; c’était sûrement vrai ; mais ils ne verraient jamais qu’une fraction de ces yogandas, et ici, et maintenant, Iwang avait besoin d’une illumination spirituelle. Ou bien d’amour. Bahram l’invita à venir manger avec sa famille, afin qu’il regarde Esmerine servir le repas, et élever leurs enfants. Les enfants étaient eux-mêmes un vrai bonheur, avec leurs grands yeux liquides quand ils s’arrêtaient de jouer pour écouter avidement Esmerine leur faire la lecture. Les regarder courir à travers le complexe était également un bonheur. Iwang hocha la tête en voyant tout cela.
— Tu es un homme chanceux, dit-il à Bahram.
— Nous sommes tous des hommes chanceux, répondit Bahram.
Iwang approuva.
La Déesse et la Loi
Parallèlement à ses nouvelles études religieuses, Iwang poursuivait ses recherches et ses expérimentations avec Khalid. Ils consacraient l’essentiel de leurs efforts à travailler pour Nadir et le khan. Ils mirent au point un système de signalisation à longue distance pour l’armée, à l’aide de miroirs et de petits télescopes ; ils fondirent aussi des canons de plus en plus gros, et fabriquèrent les chariots géants permettant de les tracter d’un champ de bataille à un autre, à l’aide de chevaux ou de caravanes de chameaux.
— Il nous faudra des routes pour ces chariots, si nous voulons les déplacer, nota Iwang.
En effet, même la grande route de la Soie n’était qu’une piste pour chameaux sur la majeure partie de sa longueur.
Quant à leurs derniers travaux sur les causes premières, ils portaient sur un petit télescope qui agrandissait les objets trop petits pour être vus à l’œil nu. Les astronomes de la grande madrasa d’Ulug Bek en avaient mis un au point, qui pouvait être braqué sur une toute petite tranche d’air, de sorte que tout objet translucide placé entre deux plaques de verre pouvait être éclairé par la lumière du soleil renvoyée par un miroir situé en dessous. Alors de nouveaux petits mondes apparaissaient, juste sous leurs doigts.
Les trois hommes passèrent des heures à observer à l’aide de ce nouveau télescope l’eau de la mare, qui se révéla pleine de créatures bizarrement articulées, en train de nager. Ils regardèrent des coupes de pierre, de bois et d’os, si minces qu’elles en étaient translucides. Et ils étudièrent leur propre sang, qui grouillait de globes ressemblant de façon terrifiante aux bêtes de la mare.
— Le monde devient de plus en plus petit, s’émerveilla Khalid. Si nous pouvions prendre le sang de ces petites créatures qui s’agitent dans nos veines, et le mettre sous une lentille encore plus puissante que celle-ci, je suis sûr que nous verrions dans leur sang des animalcules pareils à ceux qu’il y a dans le nôtre. Et ainsi de suite pour ces animalcules-là, jusqu’à…
Il ne termina pas sa phrase. Il était si impressionné qu’il paraissait hagard. Bahram ne l’avait jamais vu aussi heureux.
— Il est même probable qu’il existe des choses encore plus petites…, avança Iwang, toujours pragmatique. C’est en tout cas ce que disaient les Grecs de l’antiquité. Les particules élémentaires qui constituent tout ce qui est. Si petites, sans doute, que nous ne les verrons jamais.
Khalid se renfrogna.
— Ce n’est qu’un début. On fera sûrement des lunettes plus puissantes. Et alors, qui sait ce qu’on verra. Peut-être que nous pourrons enfin comprendre la structure des métaux, et les changer en or !
— Peut-être, convint Iwang.
Il regarda dans l’oculaire de la lunette en fredonnant.
— Ce qui est sûr, c’est qu’on voit clairement les petits cristaux du granit.
Khalid hocha la tête, griffonna quelque chose dans un de ses livres. Il regarda à nouveau dans la lunette et dessina les formes qu’il voyait.
— De l’infiniment grand à l’infiniment petit, dit-il.
— Cette lunette est un don de Dieu, ajouta Bahram. Il nous rappelle que tout est un. Une seule substance, dont les structures s’interpénètrent, mais néanmoins unique, du grand vers le petit.
Khalid opina à nouveau du chef.
— Alors il se peut que les étoiles aient une influence sur nous, après tout. Peut-être que les étoiles sont des animaux, aussi, comme ces créatures. Si seulement nous pouvions les voir de plus près…
Iwang secoua la tête.
— Tout est un, oui. Ça paraît de plus en plus évident. Mais tout n’est certainement pas animal. Peut-être que les étoiles sont plus proches des pierres que de ces jolies créatures.
— Les étoiles sont du feu.
— Des roches, du feu – mais pas des animaux.
— Mais tout est un, insista Bahram.
Et les deux hommes hochèrent la tête, Khalid avec emphase, Iwang avec réticence, tout en fredonnant doucement.
Par la suite, Bahram eut l’impression qu’Iwang n’arrêtait pas de chantonner. Il venait au complexe et participait aux démonstrations de Khalid. Il allait avec Bahram au ribat pour y entendre les conférences d’Ali, et quand Bahram venait le voir dans son atelier, il jouait avec les nombres ou faisait cliqueter un boulier chinois dans un sens et dans l’autre, toujours distrait, fredonnant sans arrêt. Le vendredi, il venait à la mosquée et se tenait devant la porte, face à La Mecque, écoutant les prières et les lectures, en clignant des yeux pour se protéger du soleil, mais sans jamais s’agenouiller, se prosterner ou prier ; et sans cesser de fredonner.
Bahram pensait qu’il ne devait pas se convertir. Même si ça l’obligeait à retourner au Tibet pour un moment, il semblait clair à Bahram qu’Iwang n’était pas un musulman. Et que ça ne serait pas bien.
À vrai dire, alors que les semaines passaient, il commença à paraître de plus en plus bizarre, de plus en plus étrange. Plutôt plus incroyant que moins ; faisant ses propres expérimentations, semblables à des sortes de sacrifices à la lumière, au magnétisme, au vide ou à la gravité. Un alchimiste, en fait ; mais de tradition occidentale, plus étrange que celle des soufis, comme si, non content de revenir au bouddhisme, il allait encore au-delà, comme s’il remontait à l’antique religion du Tibet – Bon, comme disait Iwang.
Cet hiver-là, il était assis dans son atelier avec Bahram, devant le feu ouvert de son fourneau, les mains tendues devant lui pour réchauffer ses doigts qui dépassaient de ses gants comme de petits bébés, fumant du haschisch dans une pipe à long tuyau et la passant de temps à autre à Bahram, jusqu’à ce que les deux hommes se retrouvent assis là à regarder danser la mince couche de charbon sur le lit de braises orange. Une nuit, au plus profond d’une tempête de neige, Iwang sortit chercher du bois pour le feu. Un mouvement attira le regard de Bahram et il vit une Chinoise assise auprès du fourneau, vêtue d’une robe rouge, les cheveux remontés en chignon. Bahram sursauta ; la vieille femme tourna la tête dans sa direction et le regarda. Il vit que ses yeux noirs étaient pleins d’étoiles. Il tomba de son tabouret et se releva précipitamment, mais elle n’était plus là. Quand Iwang revint dans la pièce, Bahram la lui décrivit, et Iwang eut un haussement d’épaules.
— Il y a des tas de vieilles femmes dans le quartier, dit-il d’un air entendu. C’est là que vivent les pauvres gens, et notamment les veuves, qui doivent dormir par terre, dans la boutique de leur mari mort, à la discrétion des nouveaux propriétaires, et se débrouiller comme elles peuvent pour ne pas mourir de faim.
— Mais la robe rouge – son visage – ses yeux !
— Tout ça ressemble à la déesse du foyer, en réalité. Elle apparaît au cœur de la maison, quand on a de la chance.
— C’est la dernière fois que je fume de ton haschisch.
— S’il n’y avait que ça ! fit Iwang en riant.
Une autre nuit glaciale, quelques semaines plus tard, Iwang vint frapper à la grille du complexe et entra, tout excité – comme un possédé. Si cela n’avait pas été lui, on aurait dit qu’il était soûl.
— Regarde ! dit-il à Khalid en le prenant par son moignon et en le tirant vers son bureau. Regarde ! J’y suis enfin arrivé !
— La pierre philosophale ?
— Non, non ! Rien d’aussi trivial ! C’est la loi universelle, la loi qui régit toutes les autres. Une équation. Regarde !
Il prit une ardoise et écrivit rapidement quelque chose, à la craie, à l’aide des symboles alchimiques que Khalid et lui avaient décidé d’adopter pour noter les quantités qui variaient selon les situations.
— Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, exactement comme le dit toujours Bahram. Tout est attiré vers autre chose précisément par cette force. Multiplie les deux masses qui s’attirent, divise le résultat par le carré de la distance qui les sépare – multiplie ensuite le produit par leur éventuelle vitesse initiale par rapport au corps de référence s’il y en a un, et tu obtiens la force de l’attraction. Là, essaie avec les orbites des planètes autour du Soleil, ça marche pour toutes ! Et elles décrivent des ellipses autour du soleil, parce qu’elles s’attirent toutes les unes les autres, de même qu’elles sont toutes attirées par le Soleil. Le Soleil se trouve à l’un des points focaux de l’ellipse, et la somme de toutes les autres attractions à l’autre.
Il griffonnait frénétiquement tout en parlant. Bahram ne l’avait jamais vu aussi agité.
— Ça explique les différences dans les observations, à Ulug Bek. Ça marche pour les planètes, les étoiles dans leurs constellations, sans aucun doute, la trajectoire d’un boulet de canon au-dessus de la Terre, et le mouvement de ces petits animalcules dans l’eau de la mare ou dans notre sang !
Khalid hochait la tête.
— C’est la force de la gravité elle-même, décrite mathématiquement.
— Oui.
— L’attraction est inversement proportionnelle au carré de la distance ?
— Oui.
— Et elle agit sur tout ?
— Je pense.
— Et la lumière ?
— Je ne sais pas. La masse de la lumière proprement dite doit être si faible… Si elle en a une. Enfin, si faible qu’elle soit, sa masse est attirée par toutes les autres masses. Les masses s’attirent.
— Mais ça, fit Khalid, c’est encore une action à distance.
— Oui, répondit Iwang avec un grand sourire. Ta force universelle, peut-être. Qui agit par un biais que nous ignorons. D’où la gravité, le magnétisme, la lumière.
— Une sorte de feu invisible.
— Ou peut-être une chose qui serait au feu ce que les plus petits animaux sont pour nous. Une force subtile. À laquelle rien n’échapperait, malgré tout. Il y en aurait dans tout. Nous vivons tous dedans.
— Un esprit actif en toute chose.
— Comme l’amour, intervint Bahram.
— Oui, comme l’amour, acquiesça Iwang, pour une fois. En ce sens que, sans lui, tout sur Terre serait mort. Rien ne s’attirerait ni ne se repousserait, rien ne circulerait, rien ne changerait de forme, ni ne vivrait d’aucune façon. Ça se contenterait d’être là, mort et froid.
Et puis il eut un sourire, un vrai sourire. Ses joues lisses et brillantes de Tibétain se creusèrent de profondes fossettes, dévoilant ses grandes dents de cheval luisantes.
— Et nous sommes là ! Alors ça doit être ça, vous comprenez ? Tout bouge, tout vit. Et la force agit exactement en raison inverse de la distance qui sépare les choses.
— Je me demande si ça pourrait nous aider à réaliser la transmutation…, commença Khalid.
Les deux autres l’interrompirent :
— Changer le plomb en or ! Le plomb en or !
Ils riaient.
— C’est déjà de l’or, répondit Bahram.
Les yeux d’Iwang se mirent soudain à briller comme si la déesse du foyer s’était trouvée en lui. Il attira Bahram contre lui et l’emprisonna dans une grande accolade laineuse et humide, en fredonnant toujours.
— Tu es un brave homme, Bahram. Un homme très bon. Écoute, si je crois en ton amour, est-ce que je peux rester ici ? Est-ce que ce serait un blasphème à tes yeux, si je croyais à la gravité, à l’amour, et à l’unicité de toute chose ?
Les théories sans application posent problème
Bahram fut bientôt plus occupé que jamais, de même que tous les ouvriers du complexe. Khalid et Iwang débattaient toujours des ramifications du grand dessein d’Iwang, et continuaient à faire toutes sortes de démonstrations, soit pour le tester, soit pour étudier des points qui s’y rattachaient. Mais leurs recherches n’aidaient que très peu Bahram dans ses travaux à la forge, les propositions ésotériques et hautement mathématiques des deux aventuriers de la science étant difficiles, voire impossibles, à utiliser dans le cadre des travaux visant à obtenir un meilleur acier ou de plus puissants canons. Pour le khan, plus c’était gros mieux c’était, et il avait entendu parler des nouveaux canons de l’empereur de Chine, à côté desquels même les canons géants abandonnés par les Byzantins au cours des grandes pestes du septième siècle paraissaient minuscules. Bahram essayait de rivaliser avec ces canons de légende, et avait bien du mal à les fondre, bien du mal à les déplacer, bien du mal à tirer avec sans les faire exploser. Khalid et Iwang avaient des suggestions à lui faire, mais elles ne marchaient pas ; ce qui ne laissait plus à Bahram que la bonne vieille méthode des approches successives que les métallurgistes avaient utilisée pendant des années, revenant toujours à l’idée que s’il pouvait porter son métal fondu à une température supérieure, avec le bon mélange de matières premières, il obtiendrait un métal de bien meilleure qualité. Il s’agissait donc d’augmenter la quantité d’énergie que le fleuve apportait aux hauts-fourneaux, pour produire une température telle que les métaux fondus seraient chauffés à blanc – d’un blanc si brillant qu’on ne pourrait le regarder sans avoir mal aux yeux. Khalid et Iwang observaient ce spectacle au crépuscule, et discutaient jusqu’à l’aube des origines de cette lumière, si claire, que le feu arrachait au fer.
Tout cela était très bien, mais ils avaient beau envoyer toujours plus d’air dans les chaudières à charbon, amener le fer à devenir aussi blanc que le soleil et aussi liquide que l’eau, ou même plus, les canons ainsi forgés continuaient à exploser comme les précédents. Et Nadir pointait son nez, sans prévenir, au courant des tout derniers résultats. Il était clair qu’il avait des espions au complexe et se fichait pas mal que Bahram le sache. Ou plutôt, voulait qu’il le sache. C’est ainsi qu’il apparaissait, mécontent. Et son regard seul disait : Plus, et plus vite ! – alors que ses paroles les assuraient qu’il avait confiance en leur capacité à donner le meilleur d’eux-mêmes, et que le khan était enchanté par les tables des trajectoires. Il disait :
— Le khan est impressionné par le pouvoir qu’ont les mathématiques à repousser les envahisseurs chinois.
Bahram hochait gravement la tête, accablé, pour montrer qu’il avait parfaitement compris le message, que Khalid affectait minutieusement de ne pas entendre. Il se gardait bien de demander qu’on lui garantit un aman pour Iwang, au printemps prochain, pensant qu’il valait mieux attendre un meilleur moment pour faire appel au bon vouloir de Nadir, et retournait à l’atelier essayer autre chose.
Nouveau métal, nouvelle dynastie, nouvelle religion
À titre de simple exercice, Bahram s’intéressa donc à un métal gris, terne, qui ressemblait à du plomb au-dehors et à de l’étain au-dedans. Il y avait manifestement beaucoup de soufre dans le mercure – si l’on pouvait se fier à cette description des métaux –, mais il était, de prime abord, si difficile à voir qu’on pouvait ne pas le remarquer. Il se révéla, lors de toutes sortes de petits tests et expériences, moins friable que le fer, plus ductile que l’or et, en bref, différent de tous les autres métaux mentionnés par al-Razi et ibn Sina, si étrange que ça puisse être. Un nouveau métal ! Il se mélangeait au fer pour former une sorte d’acier dont on avait l’impression qu’il ferait de bons futs de canons.
— Comment pourrait-il y avoir un nouveau métal ? demanda Bahram à Khalid et Iwang. Et comment faut-il l’appeler ? On ne peut pas continuer à dire « le truc gris »…
— Il n’est pas nouveau, répondit Iwang. Il a toujours été là, parmi les autres, mais nous obtenons des températures plus élevées que toutes celles qui ont jamais été atteintes, alors il s’exprime.
Khalid l’appela « plombor », par plaisanterie, mais faute d’autre nom, celui-ci resta. Et le métal, qu’ils retrouvaient maintenant chaque fois qu’ils fondaient certains minerais de cuivre bleuté, fit partie de leur arsenal.
Les jours se passaient à travailler fébrilement. Les rumeurs de guerre à l’est allaient en s’amplifiant. On disait qu’en Chine les barbares avaient à nouveau fondu sur la Grande Muraille, déposant la dynastie Ming, déliquescente et corrompue, et plongeant cet immense géant dans un tourbillon de violence qui commençait à gagner l’extérieur. Cette fois, les barbares ne venaient pas de Mongolie mais de Mandchourie, au nord-est de la Chine, et on disait que c’étaient les guerriers les plus accomplis que l’on ait jamais vus dans le monde. Il était probable qu’ils allaient conquérir et détruire tout ce qui se trouverait sur leur chemin, y compris la civilisation islamique, à moins qu’une nouvelle invention ne permette de se défendre contre eux.
C’est ce que les gens du bazar disaient, et même Nadir, à sa façon plus tortueuse, confirmait qu’il se passait quelque chose ; l’impression de danger ne cessa de grandir alors que l’hiver passait et que le temps des campagnes militaires revenait. Le printemps, l’époque de la guerre et de la peste, les deux armes favorites de la mort à six bras, disait Iwang.
Bahram passa ces mois à travailler comme si un immense orage, porteur de désastre potentiel, planait perpétuellement sur l’horizon, qu’il essayait de déborder en s’opposant aux vents dominants. Cela assombrissait le bonheur qu’il connaissait au sein de sa petite famille et de celle, plus large, du complexe : son fils et sa fille courant en tous sens, ou récitant nerveusement leurs prières, impeccablement vêtus par Esmerine, les plus polis des enfants – sauf quand ils piquaient des colères d’une violence telle que leurs parents n’en revenaient pas. C’était l’un de leurs principaux sujets de conversation, dans les profondeurs de la nuit, quand ils n’arrivaient pas à dormir et qu’Esmerine sortait brièvement pour se soulager, puis revenait se coller contre lui. Ses seins étaient alors comme des gouttes de pluie argentée qui brillaient à la lueur de la lune et sous les caresses de Bahram. Il cherchait à les réchauffer, comme pour les endormir dans le monde de l’amour au cœur de la nuit, l’un de ces moments bénis de la vie, un de ces moments de grâce du sommeil, le rêve du corps, tellement plus tendre et chaud que n’importe quelle autre partie du jour qu’il était parfois difficile de croire, le matin, qu’il avait vraiment eu lieu, qu’Esmerine – Esmerine, si austère dans ses manières comme dans sa façon de s’habiller, Esmerine, qui faisait travailler les femmes aussi durement que Khalid dans ses accès de tyrannie, et qui ne parlait jamais à Bahram, ou ne le regardait jamais que de façon parfaitement informelle, comme il se devait – qu’Esmerine et lui avaient vraiment été transportés dans ce tout autre monde de la passion, sous leurs draps, dans les profondeurs de la nuit. Quand il la regardait travailler, l’après-midi, Bahram se disait que l’amour changeait tout. Dans le fond, ils n’étaient que des animaux, des créatures que Dieu avait faites assez semblables aux singes ; et on ne voyait pas pourquoi les seins d’une femme n’auraient pas ressemblé aux pis d’une vache, se balançant inélégamment alors qu’elle se penchait pour effectuer une tâche ou une autre ; mais l’amour en faisait des orbes de la plus grande beauté, et il en allait de même pour le monde entier. L’amour faisait entrer toute chose dans une dimension à part, et il n’y avait que l’amour qui pouvait les sauver.
En cherchant d’où pouvait venir ce « plombor », Khalid se replongea dans ses vieux volumes, et il s’arrêta avec intérêt sur un passage du classique de Jabir ibn Hayyam : Le Livre des propriétés, écrit dans les premières années du jihad. Jabir y faisait la liste de sept métaux : l’or, l’argent, le plomb, l’étain, le cuivre, le fer et le kharsini, ou bronze chinois – d’un gris terne, argent quand il était poli, et que les Chinois appelaient paitung, ou « cuivre blanc ». Jabir écrivait que les Chinois en avaient fait des miroirs capables de guérir les maladies des yeux de ceux qui regardaient dedans. Jabir suggérait en outre que le kharsini faisait aussi des cloches au tintement particulièrement mélodieux. C’est ainsi que Khalid fondit le reste de la quantité qu’ils avaient sous la main pour en faire des cloches et vérifier si leur tintement était bien « particulièrement mélodieux », ce qui aurait permis de confirmer l’identification du métal. Tout le monde s’accorda à dire que les cloches tintaient très joliment en vérité ; mais les yeux de Khalid n’allèrent pas mieux après qu’il eut regardé dans un miroir fait de ce métal.
— On va dire que c’est du kharsini, maugréa Khalid. Qui sait ce que ça peut être, ajouta-t-il avec un soupir. Nous ne savons rien.
Mais il continua à faire différentes expériences, à écrire de volumineux commentaires sur chacun de ses essais, pendant les nuits – et plus d’une aube – sans sommeil. Iwang et lui poursuivaient leurs recherches. Khalid donna l’ordre à Bahram, Paxtakor, Jalil et tous les vieux ouvriers de ses ateliers de construire d’autres télescopes, des microscopes, des jauges à pression et des pompes. Le domaine était devenu un endroit où leurs compétences en métallurgie et en mécanique se combinaient pour leur donner tous les moyens de faire de nouvelles choses ; quand ils avaient l’idée d’un nouvel objet, ils pouvaient toujours en réaliser un premier prototype, primitif et grossier. Ensuite, les vieux ouvriers parvenaient à faire de meilleurs moules, affinaient leurs outils ; Khalid et Iwang procédaient à de nouvelles expériences, affinaient leurs calculs, leurs méthodes, au fur et à mesure qu’ils avançaient. Tout – des subtilités de l’horlogerie à la force massive des roues à eau ou des fûts de canon – pouvait être amélioré. Khalid démonta un métier à tisser les tapis persans pour étudier toutes ses petites pièces de métal, et fit remarquer à Iwang que, combiné avec un engrenage à crémaillère et équipé au lieu de fuseaux de timbres en forme de lettres, disposés de façon à pouvoir être encrés et pressés contre le papier, le système pourrait écrire toute une page d’un seul coup, et répéter l’opération aussi souvent que souhaité. Les livres deviendraient aussi communs que des boulets de canon. Iwang avait ri, et répondu qu’au Tibet les moines avaient sculpté des blocs d’imprimerie similaires, mais que l’idée de Khalid était meilleure.
En attendant, Iwang poursuivait ses travaux mathématiques. Une fois, il dit à Bahram :
— Il fallait être un dieu pour imaginer ces choses, puis s’en servir pour faire un monde ! Si nous en identifions ne serait-ce que la millionième partie, nous en découvrirons peut-être plus qu’aucun être intelligent n’en a jamais su depuis l’aube des temps, et nous verrons clairement l’esprit divin.
Bahram hocha la tête, incertain. Il savait, maintenant, qu’il ne voulait pas qu’Iwang se convertisse à l’islam. Ça ne lui paraissait pas bien, ni pour Dieu ni pour Iwang. Il savait que c’était égoïste de penser ça, que Dieu s’en occuperait. Comme il paraissait qu’il l’avait déjà fait, d’ailleurs, car Iwang ne venait plus à la mosquée le vendredi, ni aux cours d’instruction religieuse du ribat. Dieu, ou Iwang ou les deux, avait compris le point de vue de Bahram. La religion ne pouvait être feinte, ou utilisée à des fins matérielles.
Le dragon mord le monde
Maintenant, quand Bahram se promenait dans le caravansérail, il entendait bien des histoires déplaisantes venues de l’est. Les choses allaient mal, la nouvelle dynastie mandchoue était d’humeur conquérante ; le nouvel empereur mandchou, en bon usurpateur qu’il était, ne se satisfaisait pas du vieil et déclinant empire qu’il avait conquis ; il entendait le revivifier par la guerre, portant ses conquêtes aux rizières des riches royaumes du Sud, Annam, le Siam, la Birmanie, ainsi qu’aux vastes terres vides, arides, au cœur du monde, les déserts et les montagnes séparant la Chine du Dar, sillonnées par les fils de la route de la Soie. Après avoir dévoré cette étendue, ils se jetteraient sur l’Inde, les khanats islamiques, et l’empire savafide. Au caravansérail, on disait que Yarkand et Kachgar étaient déjà prises – ce qui était tout à fait plausible dans la mesure où elles avaient été défendues pendant des décennies par les rares garnisons ming restantes, et par des chefs de guerre. Seuls le bassin de Tarim et les montagnes de Ferghana séparaient le khanat de Boukhara de ces terres désertiques. Or la route de la Soie traversait ces endroits en deux ou trois points. Là où passaient les caravanes pouvaient passer les bannières.
Et peu de temps après, c’est ce qu’elles firent. Ils apprirent que les bannières mandchoues flottaient sur la passe de Torugart, qui était le point névralgique de l’une des routes de la Soie, entre Tashkent et le Takla Makan. Le voyage en caravane depuis l’est serait perturbé pendant un certain temps au moins, ce qui voulait dire que Samarkand et Boukhara, qui étaient les principaux centres d’échange du vaste monde, seraient reléguées au rang de vagues culs-de-sac poussiéreux. C’était une catastrophe pour le commerce.
Ces nouvelles leur avaient été apportées par une dernière caravane, d’Arméniens, de Zott, de juifs et d’hindous. Ils avaient dû s’enfuir pour sauver leur peau, abandonnant tout ce qu’ils possédaient. Apparemment, la porte de Dzoungarie, entre le Xinjiang et la steppe khazak, était sur le point de tomber elle aussi. Comme ces nouvelles circulaient dans les caravansérails autour de Samarkand, la plupart des caravanes qui s’y reposaient changèrent leurs plans. Beaucoup décidèrent de rentrer au Franjistan, qui, bien que grouillant de conflits entre petits taïfas, était encore entièrement musulman, ses petits khanats, émirats et sultanats continuant à commercer vaille que vaille, même quand ils se battaient.
Des décisions comme celles-ci transformeraient bientôt Samarkand en ville fantôme. En tant que simple terminus ce n’était pas grand-chose, la bordure extrême du Dar al-Islam. Nadir était inquiet, et le khan ne décolérait pas. Sayyed Abdul Aziz ordonna qu’on reprenne la porte de Dzoungarie et qu’on envoie une garnison aider à défendre la passe de Khyber, de façon à ce que la route du commerce vers l’Inde, au moins, soit sécurisée.
Nadir, accompagné par une garde importante, rapporta ces instructions à Khalid et Iwang, sur un ton sec, comme si c’était la faute de Khalid. À la fin de sa visite, il les informa qu’il emmenait Bahram, sa femme et ses enfants, au khanaka de Boukhara. Ils ne seraient autorisés à rentrer à Samarkand que lorsque Khalid et Iwang auraient construit une arme capable d’écraser les Chinois.
— Ils pourront recevoir des visites au palais. Vous serez le bienvenu si vous voulez leur rendre visite, ou les y rejoindre. Mais je pense que votre travail avancera mieux ici, avec vos hommes et vos machines. Si je pensais que vous travailleriez mieux au palais, je vous y ferais venir, croyez-moi.
Khalid le dévisagea sans mot dire, trop fâché pour parler sans les mettre en danger.
— Iwang s’installera ici avec toi, parce que je l’estime plus utile ici que chez lui. Il recevra une prolongation de son aman par anticipation, en reconnaissance de l’importance de ses travaux pour ces affaires d’État. D’ailleurs, il n’a pas le droit de partir. Et quand bien même, c’est impossible. Le dragon qui vient de se réveiller à l’est a déjà mangé le Tibet. C’est donc une tâche d’ampleur divine qui vous attend, un joug dont vous pouvez vous enorgueillir.
Il eut encore un regard pour Bahram.
— Nous prendrons bien soin des tiens, de même que tu t’occuperas de la façon dont les choses se déroulent ici. Tu peux vivre au palais avec eux, ou bien travailler ici, à ta guise.
Bahram hocha la tête. Le désarroi et la peur l’avaient rendu muet.
— Je ferai les deux, parvint-il à dire en regardant Esmerine et les enfants.
Rien n’était plus comme avant.
Bien des vies changent ainsi, tout à coup, pour toujours.
Un cadeau d’Allah
Par respect pour les sentiments de Bahram, Khalid et Iwang organisèrent le complexe comme une véritable armurerie, et se consacrèrent exclusivement à tester et concevoir de nouveaux engins capables d’accroître les pouvoirs de l’armée du khan. Un canon plus puissant, de la poudre plus réactive, un tir avec effet, le tueur-de-milliers ; et puis les tables de tir, les protocoles logistiques, les alphabets lumineux pour communiquer sur de grandes distances ; ils firent tout cela, et bien d’autres choses encore, pendant que Bahram vivait à moitié au khanaka avec Esmerine et les enfants, et à moitié au complexe, jusqu’à ce que la route de Boukhara devienne pour lui comme l’allée qui traversait la cour : il l’avait empruntée à toutes les heures du jour ou de la nuit, parfois sommeillant sur son cheval, qui faisait alors la route tout seul.
Les améliorations qu’ils apportèrent aux armées du khan étaient prodigieuses, ou l’auraient été si l’on avait pu convaincre les généraux de Sayyed Abdul de respecter les instructions de Khalid, et si Khalid avait eu la patience de les leur transmettre. Mais les deux camps étaient trop fiers pour s’entendre, et rien ne se faisait, bien que Bahram trouvât que c’était une grave erreur de la part de Nadir. Il aurait dû insister, ordonner aux généraux d’obéir à Khalid, et consacrer une plus grande partie du trésor du khan pour engager des soldats aguerris. Mais le grand Nadir Divanbegi avait un pouvoir limité, qui se bornait en fin de compte à un rôle de conseiller auprès du khan. D’autres conseillers donnaient des conseils différents, et le pouvoir de Nadir était peut-être en train de décliner au moment même où il aurait été le plus utile, et ce malgré les innovations de Khalid et d’Iwang – ou, qui sait ? peut-être à cause d’elles. À vrai dire, le khan ne s’était jamais distingué par la pertinence de son jugement. Et il était possible que sa poche ne soit pas aussi insondable qu’elle en avait l’air à l’époque où les bazars, les caravansérails et les chantiers de construction pullulaient et payaient des impôts.
C’était en tout cas l’avis d’Esmerine, même si Bahram devait essentiellement le déduire de ses regards et de ses silences. Elle paraissait croire qu’ils étaient espionnés en permanence, y compris pendant leurs heures sans sommeil au cœur de la nuit, ce qui était une pensée assez terrible. Les enfants s’étaient faits à la vie au palais, comme s’ils avaient fait irruption dans un conte des Mille et Une Nuits, et Esmerine ne faisait rien pour les détromper. Elle savait pourtant bien qu’ils étaient prisonniers, et qu’ils pouvaient dire adieu à la vie si le khan s’énervait de la façon dont les choses se passaient chez Khalid, ou à l’est, ou n’importe où. Alors, naturellement, elle évitait de dire quoi que ce fut qu’on aurait pu lui reprocher, et elle ne lui parlait jamais que de l’excellence de la nourriture, et, généralement, du traitement qui leur était réservé, soulignant à quel point les enfants et elle s’en sortaient bien. Seule la lueur de son regard disait à Bahram combien elle avait peur, et combien elle l’encourageait à combler tous les désirs du khan.
Khalid, lui, n’avait évidemment pas besoin des regards de sa fille pour savoir tout ça. Bahram voyait bien qu’il multipliait les efforts pour améliorer le potentiel militaire du khan, non seulement en se démenant dans l’armurerie, mais aussi en essayant de se mettre dans les bonnes grâces des plus aimables de ses généraux. Il multipliait les suggestions voilées ou directes sur toutes sortes de sujets, depuis la rénovation des murailles de la cité, conformément à ses démonstrations de l’avantage des remblais de terre, jusqu’aux plans de forage des puits et au drainage des eaux usées à Boukhara et à Samarkand. Toutes ces idées furent présentées au conseil militaire, et il en oublia même de ronchonner. Mais les progrès étaient inégaux.
Des rumeurs commencèrent à parcourir la ville comme des chauves-souris, assombrissant leurs journées. Les barbares mandchous avaient conquis le Yunnan, la Mongolie, le Cham, le Tibet, l’Annam et les marches orientales de l’empire moghol ; chaque jour, c’était un endroit différent, un peu plus proche. Il n’y avait aucun moyen de confirmer ces assertions, qui étaient d’ailleurs souvent démenties, soit par contradiction directe, soit simplement par le fait que les caravanes continuaient à venir de certaines de ces régions, et que les marchands n’avaient rien vu d’inhabituel, bien qu’ils aient, eux aussi, entendu des rumeurs. Il n’y avait rien de certain, mais il y avait des troubles à l’est. Les caravanes venaient assurément moins souvent, et elles n’étaient plus seulement constituées de marchands, mais aussi de familles entières, de musulmans, de juifs ou d’hindous, chassés par la peur de la nouvelle dynastie, qui portait le nom de Qing. Des colonies étrangères, implantées depuis des siècles, se dissipèrent comme neige au soleil, et les exilés s’enfuirent vers l’ouest, espérant que les choses iraient mieux dans le Dar al-Islam, chez les Moghols ou chez les Ottomans, ou dans les sultanats taïfas du Franjistan. Ce qui était sans doute le cas, car en islam régnait la loi ; mais Bahram lisait sur leur visage la misère, le manque de tout, la peur et la nécessité de mendier et de voler pour vivre ; les biens qu’ils comptaient vendre n’étant plus qu’un lointain souvenir, alors qu’il leur restait encore toute la moitié occidentale du vaste monde à traverser.
Au moins, ce serait la moitié musulmane du monde. Mais alors que les visites au caravansérail étaient naguère l’un des moments de la journée que préférait Bahram, il en sortait à présent plein d’angoisse et de crainte, plein d’une appréhension aussi intense que l’avidité de Nadir de voir Khalid et Iwang trouver des moyens de défendre le khanat contre les invasions.
— Ce n’est pas nous qui ralentissons les choses, dit amèrement Khalid, une nuit, dans son bureau. Nadir lui-même n’est pas un grand général, et son influence sur le khan vacille ; et vacille de plus en plus. Quant au khan…
Il fit un bruit de ballon qui se dégonfle.
Bahram poussa un soupir. Personne ne pouvait dire le contraire. Sayyed Abdul Aziz n’était pas un sage.
— Nous avons besoin de quelque chose de mortel et de spectaculaire, dit Khalid. Quelque chose qui servirait à la fois pour le khan et contre les Mandchous.
Bahram le laissa plongé dans différentes recettes d’explosifs, et refit, à cheval, le long trajet de retour jusqu’au palais de Boukhara.
Khalid obtint une entrevue avec Nadir, et en revint en marmonnant que si la démonstration qu’il avait proposée se passait bien, Nadir laisserait Esmerine et les enfants rentrer au complexe. Bahram en fut exalté, mais Khalid le mit en garde.
— Il faudrait que le khan soit content, et qui sait ce qui peut plaire à un homme pareil ?
— Nous devons confectionner des obus contenant les formules du wan-jen-ti des Chinois, des obus qui ne se briseront pas au moment du tir, mais qui exploseront en touchant le sol.
Ils expérimentèrent différentes sortes d’obus, dont les essais eux-mêmes se révélèrent périlleux ; plus d’une fois, les gens durent courir se mettre à l’abri. Ce serait une arme terrible s’ils arrivaient à la mettre au point. Bahram se hâtait du matin au soir, en pensant au retour de sa famille et en imaginant Samarkand sauvée des infidèles. Si Allah voulait que cela soit, alors l’arme était un cadeau envoyé par Lui. Ce serait à n’en point douter une arme absolument terrifiante.
Pour finir, ils fabriquèrent des obus creux à culasse plate, munis de deux chambres séparées par une mince paroi, qu’ils remplirent, à l’aide d’une pompe, des liquides qui constituaient le tueur-de-milliers. Une petite quantité de poudre-éclair dans le nez de l’obus exploserait à l’impact, rompant la cloison intérieure, mélangeant les gaz.
Ça marchait huit fois sur dix. Une autre sorte d’obus, bourré de poudre à canon, avec un dispositif d’allumage, explosait avec un bruit assourdissant, dispersant les éclats d’obus comme des balles à fragmentation.
Ils en fabriquèrent une cinquantaine de chaque et organisèrent une démonstration sur leur terrain d’essai près du fleuve. Khalid acheta un petit troupeau de vieilles carnes au fabricant de colle, avec la promesse de les lui revendre quand elles seraient bonnes à abattre. Les garçons d’écurie attachèrent les pauvres bêtes à la limite extrême de portée du canon qui servait aux essais, et quand le khan et ses courtisans arrivèrent dans leurs beaux habits, l’air un peu ennuyés par toutes ces simagrées, Khalid détourna le visage dans une attitude aussi proche du mépris que la prudence l’autorisait, faisant mine de s’affairer auprès du canon. Craignant pour leur tête, Bahram alla faire acte d’obéissance et assaut de plaisanteries auprès de Nadir et de Sayyed Abdul Aziz, expliquant le mécanisme de l’arme et présentant Khalid avec une petite révérence alors que le vieil homme approchait, haletant et transpirant.
Khalid déclara que la démonstration pouvait commencer. Le khan eut un geste dédaigneux de la main – son geste habituel. Khalid fit un signe aux servants du canon, qui appliquèrent l’allumette. Le canon tonna, cracha un nuage de fumée blanche et recula. Son fut avait été tourné vers le haut, de sorte que l’obus retomba violemment sur le nez. La fumée tourbillonna, tout le monde regarda la plaine et les chevaux attachés au piquet ; il ne se passa rien. Bahram retint son souffle…
Et puis un nuage de fumée jaune explosa au milieu des chevaux. Ils bondirent, tentèrent de s’échapper. Deux d’entre eux arrachèrent leur piquet et partirent au galop. Quelques-uns tombèrent lorsque leur corde les ramena en arrière. Pendant ce temps, la fumée s’étendait comme soufflée à partir d’un feu de broussailles invisible, une fumée épaisse, jaune moutarde, dans laquelle les chevaux disparurent. Elle en recouvrit un qui avait rompu son attache, mais qui fonça par hasard dans une volute du nuage. Ils le virent se cabrer, tomber et se débattre sauvagement pour se relever, puis s’effondrer, agité de convulsions.
Le nuage jaune s’éclaircit peu à peu et descendit lentement dans la vallée, porté par le vent. On voyait que c’était une fumée lourde, qui s’accrochait longtemps dans les creux du sol. Et là gisaient deux douzaines de chevaux crevés, étalés en un cercle de deux cents pas au moins.
— S’il y avait eu une armée dans ce cercle, dit Khalid, alors, très excellent serviteur du Seul Vrai Dieu, Khan Suprême, elle serait aussi morte que ces chevaux. Et vous pourriez avoir une batterie de plusieurs dizaines de canons chargés d’obus de ce genre. Une centaine, même. L’armée qui vaincra Samarkand n’est pas encore née.
Nadir, l’air légèrement choqué, dit :
— Et si le vent tournait et soufflait vers nous ?
Khalid haussa les épaules.
— Alors nous serions morts, nous aussi. Il est important de faire de petits obus, qui peuvent être tirés à une grande distance, et toujours sous le vent, si possible. De sorte que si le vent revenait légèrement vers vous, le gaz se dissipant, ça n’aurait pas beaucoup d’importance.
Le khan lui-même avait l’air impressionné par la démonstration, et souriait comme si on lui avait présenté un nouveau genre de feu d’artifice. C’était difficile à dire, avec lui. Bahram soupçonnait qu’il faisait parfois semblant d’être indifférent aux choses afin d’établir une distance entre ses conseillers et lui-même.
Puis il eut un hochement de tête en direction de Nadir et conduisit sa cour sur la route de Boukhara.
— Il faut comprendre, rappela Khalid à Bahram lorsqu’ils regagnèrent le complexe. Il y a dans l’entourage du khan des hommes qui veulent abattre Nadir. Pour eux, peu importe que notre arme soit bonne. En réalité, le mieux est le pire. Le problème n’est pas seulement que ce sont de sombres crétins.
Ces choses arrivèrent
Le jour suivant, Nadir revint avec sa garde au grand complet. Il ramenait Esmerine et les enfants. Nadir hocha sèchement la tête quand Bahram le remercia avec effusion, et dit à Khalid :
— Les obus d’air empoisonné pourraient s’avérer nécessaires, et je veux que vous en produisiez autant que possible, au moins cinq cents, pour lesquels le khan vous remerciera comme il se doit à son retour. En attendant, il vous prouve sa reconnaissance en autorisant votre famille à rentrer.
— Il s’en va donc ?
— La peste sévit à Boukhara. Le caravansérail, les bazars, les mosquées, les madrasas et le khanaka lui-même, tout est fermé. Les membres les plus importants de la cour accompagneront le khan à sa résidence d’été. Je continuerai à traiter ses affaires à partir de là-bas. Prenez soin de vous. Si vous pouvez quitter la ville et continuer votre travail, le khan ne l’interdit pas. Mais il préférerait que vous vous enfermiez ici, dans votre complexe, pour travailler. Quand la peste sera passée, nous pourrons nous retrouver.
— Et les Mandchous ? demanda Khalid.
— Nous avons entendu dire qu’ils avaient été également frappés. Il fallait s’y attendre. Il se pourrait qu’ils l’aient apportée avec eux. Peut-être même nous ont-ils envoyé leurs malades, pour nous contaminer. Cela ressemble assez à l’envoi d’air empoisonné chez l’ennemi.
Le visage de Khalid s’empourpra, mais il ne fit aucun commentaire. Nadir s’en alla. Il était clair qu’il avait d’autres tâches importantes à accomplir avant de quitter Samarkand. Khalid referma le portail derrière lui, le maudissant dans sa barbe. Bahram, ravi du retour inattendu de sa femme et de ses enfants, les serrait contre lui. Ils pleurèrent de joie, et ce n’est que plus tard, quand ils eurent fini d’isoler le complexe – chose qu’ils avaient faite avec succès dix ans auparavant, quand la typhoïde avait ravagé la contrée (ils n’avaient perdu qu’un seul serviteur, qui s’était faufilé dehors pour voir sa petite amie et n’était jamais rentré) –, ce n’est que plus tard, donc, quand la confusion fut passée, que Bahram vit que Laïla, sa fille, avait les joues très rouges, des poussées de fièvre, et restait étendue sans bouger sur un coffre.
Ils la mirent au lit dans une pièce à l’écart. Esmerine avait les traits tirés par la peur. Khalid décréta que Laïla devrait rester enfermée ici, qu’on lui donnerait à boire et à manger de l’autre côté de la porte, avec des bâtons, des filets, des assiettes et des gourdes qui ne devraient pas revenir parmi eux. Mais avant de la laisser partir, naturellement, Esmerine serra sa petite fille sur son cœur ; et le jour d’après, dans leur chambre, Bahram vit qu’elle avait, elle aussi, les joues bien rouges. Il remarqua, alors qu’elle se réveillait en gémissant, qu’elle avait du mal à lever les bras. Il y avait, sous ses aisselles, les marques de la peste, ces protubérances dures et jaunes à la surface de la peau ; on aurait dit (tel est du moins ce qu’il pensa quand elle laissa retomber ses bras) des escarboucles, comme si elle se transformait en bijou à l’intérieur d’elle-même.
Le complexe se changea rapidement en maristan, et Bahram passa ses journées à soigner les autres, courant de-ci de-là à toute heure du jour et de la nuit, frappé d’une fièvre d’un genre différent de celle des malades, exhorté par Khalid de ne jamais toucher sa pauvre famille, ni de s’en approcher. Bahram ne l’écoutait pas toujours. Il ne pouvait s’empêcher de les étreindre, tant qu’ils étaient de ce monde, comme pour les obliger à y rester. Voire les y ramener – quand ses enfants moururent.
Puis les adultes commencèrent à mourir eux aussi. Ils étaient maintenant un maristan en quarantaine, à l’écart de la ville, plutôt qu’une maison saine et sauve. Fedwa mourut mais Esmerine se cramponnait ; Khalid et Bahram se relayaient à son chevet, et Iwang leur donnait un coup de main au complexe.
Un soir, Iwang et Khalid recueillirent l’haleine d’Esmerine sur un morceau de verre et regardèrent la buée à travers leurs petites lentilles, parlant peu. Bahram n’y jeta qu’un coup d’œil et aperçut la horde de petits dragons, de gargouilles, de chauves-souris et autres créatures. Il ne put regarder à nouveau ; il savait qu’ils étaient perdus.
Esmerine mourut et Khalid eut les marques dans l’heure qui suivit. Iwang ne pouvait quitter sa couche dans l’atelier de Khalid, mais il étudiait son propre souffle, son sang et sa bile avec un microscope de son invention, tâchant de dresser un tableau clair de la façon dont la maladie progressait en lui. Une nuit, entre deux halètements, il dit d’une voix sourde :
— Je suis content de ne pas m’être converti. Je sais que tu n’y tenais pas. Maintenant je serais un blasphémateur, parce que s’il y a un Dieu, j’aimerais lui rendre la monnaie de tout ceci.
Bahram ne répondit rien. C’était un jugement, mais de quoi ? Qu’avaient-ils fait ? Les obus empoisonnés étaient-ils un affront à Dieu ?
— Les vieillards vivent jusqu’à soixante-dix ans, dit Iwang. J’en ai à peine plus de trente. J’avais des projets pour toutes ces années.
Bahram n’arrivait plus à réfléchir.
— Tu disais que nous reviendrions, dit-il doucement.
— Oui. Mais j’aimais cette vie. J’avais des rêves pour elle.
Il reposait là, sur sa couche, incapable de prendre la moindre nourriture. Sa peau était très chaude. Bahram ne lui dit pas que Khalid était déjà mort, très vite, abattu par le remords ou la colère en apprenant la mort de Fedwa, d’Esmerine et des enfants – comme d’une attaque plutôt que de la peste. Dans le complexe silencieux, Bahram s’assit sur la couche du Tibétain.
À un moment, Iwang grogna :
— Je me demande si Nadir ne savait pas qu’ils étaient infectés et ne les a pas laissés rentrer pour nous tuer…
— Mais pourquoi ?
— Peut-être craignait-il le tueur-de-milliers. Ou quelque faction de la cour. Il avait d’autres problèmes que nous. Ou bien c’était peut-être quelqu’un d’autre. Ou personne.
— Nous ne le saurons jamais.
— Non. La cour tout entière est peut-être morte à l’heure qu’il est. Nadir, le khan, tout le monde.
— J’espère bien, dit Bahram, songeur.
Iwang approuva. Il mourut à l’aube, sans un mot, en luttant.
Bahram ordonna à tous les survivants du complexe de mettre un linge devant leur bouche, et leur fit déplacer les cadavres dans un atelier fermé derrière les cuves à produits chimiques. Il se sentait tellement étranger à lui-même que les mouvements gourds de son corps lui semblaient les mouvements d’un autre, et qu’il parlait comme s’il était un autre. Fais ceci, fais cela. Mange. Puis, alors qu’il apportait un grand pot à la cuisine, il sentit quelque chose sous son bras et s’assit comme si les nerfs de ses jambes avaient été coupés, pensant : Je crois que c’est mon tour.
Retour dans le bardo
Eh bien, c’était, comme on peut l’imaginer après une fin pareille, une petite jati très découragée et très démoralisée qui se blottissait, cette fois encore, sur le sol noir du bardo. Et qui aurait pu lui en vouloir ? Pourquoi aurait-elle eu la volonté de continuer ? Il était difficile de discerner une récompense pour la vertu, pour un quelconque progrès – une quelconque justice dharmique. Même Bahram n’arrivait pas à trouver du bien là-dedans, et les autres n’essayaient tout simplement pas. Quand ils considéraient, rétrospectivement, dans la vallée des temps, les interminables récurrences de leurs réincarnations, avant qu’ils soient obligés de boire leur fiole d’oubli et que tout redevienne obscur, ils n’arrivaient pas à entrevoir le moindre schéma directeur. Les dieux avaient-ils un plan, ou même un ensemble de procédures ? La longue chaîne de transmigrations était-elle censée rimer à quelque chose ? N’était-ce pas plutôt une simple répétition vide de sens ? Le temps lui-même n’était-il qu’une suite de chaos ? Qui pouvait le dire ? L’histoire de leurs transmigrations, au lieu de n’être qu’une longue narration où l’on ne mourait jamais vraiment – ainsi que les premières expériences de réincarnation semblaient le suggérer –, était devenue un véritable charnier. Pourquoi en continuer la lecture ? Pourquoi aller rechercher leur livre au pied du mur contre lequel ils l’avaient jeté, dégoûtés, souffrants, et poursuivre leur lecture ? Pourquoi se soumettre à une telle cruauté, à un aussi mauvais karma, à un aussi mauvais scénario ?
La raison était simple : ces choses arrivaient. Elles arrivaient un nombre incalculable de fois, juste comme ça. Les océans étaient salés par nos larmes. Personne ne pouvait nier que ces choses arrivaient.
Il n’y avait donc pas le choix. Ils ne pouvaient échapper à la roue de la naissance et de la mort, ils ne pouvaient faire autrement que de s’y soumettre, ou de la contempler, après coup. Et leur anthologiste, Vieille Encre Rouge en personne, devait raconter honnêtement leur histoire ; il devait rendre compte de la réalité, sinon leurs histoires n’auraient eu aucun sens. Or il était crucial qu’elles aient un sens.
Voilà. Il n’y avait pas moyen de fuir la réalité : ils étaient assis là, une douzaine d’âmes tristes, blotties les unes contre les autres tout au bout de la grande estrade de la salle du jugement. Il faisait noir et froid. La lumière blanche, parfaite, n’avait duré cette fois qu’un infime moment, un flash comme l’explosion du globe oculaire ; ensuite, ils s’étaient retrouvés là. Sur l’estrade où gambadaient les chiens, les démons et les dieux noirs, dans un brouillard vague qui enveloppait tout, étouffait tous les sons.
Bahram essaya, mais il ne trouva rien à dire. Il était encore assommé par les événements des derniers jours dans le monde ; il était encore prêt à se lever et à commencer une nouvelle journée, un autre matin comme tous les autres. À affronter la crise de l’invasion de l’Est, le départ de sa famille, si c’était ce que vivre voulait dire – quels que soient les problèmes que la journée apporterait, les ennuis, les soucis, pour sûr, c’était la vie. Mais pas ça. Pas ça encore. Larmes salées d’une mort certaine, larmes amères d’une mort par surprise : l’amertume emplissait l’air comme de la fumée. J’aimais cette vie ! J’avais des projets pour elle !
Khalid était assis là comme toujours, comme quand il s’enfermait dans son bureau, pour réfléchir à un problème. Cette vision donna à Bahram un violent pincement de regret et de chagrin. Toute cette vie, partie. Partie, partie, partie au-delà, complètement partie au-delà… le passé était parti. Même si tu peux t’en souvenir, c’est le passé. Il en avait aimé chaque instant au moment même où il l’avait vécu, vivant chaque instant de sa vie dans un état de nostalgie-du-présent.
Parti, maintenant.
Le reste de la jati était assis ou étalé sur le méchant plancher, autour de Khalid. Même Sayyed Abdul avait l’air perdu, pas seulement désolé pour lui, mais désolé pour eux tous, triste d’avoir quitté ce monde turbulent, mais, oh, tellement intéressant !
Un intervalle s’écoula. Un moment, une année, une ère, le kalpa lui-même, qui pouvait le dire dans un aussi terrible endroit ?
Bahram prit une profonde inspiration, s’ébroua et se redressa.
— Nous avançons, dit-il fermement.
Khalid se racla la gorge.
— Nous sommes des souris pour le chat, dit-il en indiquant la scène où les bouffonneries se poursuivaient. Ce sont de minables trous du cul, je vous le dis. Ils nous tuent pour s’amuser. Ils ne meurent pas, alors ils ne peuvent pas comprendre.
— Oublie-les, conseilla Iwang. Il va falloir que nous fassions ça tout seuls.
— Dieu juge et nous renvoie, dit Bahram. L’homme propose, Dieu dispose.
Khalid secoua la tête.
— Regardez-les. C’est un gros tas de sales gosses qui s’amusent. Personne ne leur dit rien, il n’y a pas de dieu des dieux.
Bahram le regarda, surpris.
— Tu ne vois pas celui qui comprend tout le reste, celui à l’intérieur duquel nous sommes ? Allah ou Brahma, ou ce que tu veux, le seul véritable Dieu des Dieux ?
— Non. Je n’en vois pas trace.
— Tu ne regardes pas ! Tu n’as jamais regardé ! Quand tu regarderas, tu le verras. Quand tu le verras, tout changera pour toi. Alors, tout ira bien.
Khalid se renfrogna.
— Ne nous accable pas avec ces stupidités prétentieuses. Dieu du ciel, Allah, si Tu es là, pourquoi m’as-Tu affligé de ce garçon idiot ! (Il flanqua un coup de pied à Bahram.) Ce serait plus facile sans toi ! Toi et tes maudits « ça va aller » ! Ça ne va pas ! C’est un putain de merdier ! Tu ne fais qu’aggraver les choses avec tes bêtises ! Tu n’as pas vu ce qui nous est arrivé, à nous, à ta femme, ma fille, et à tes enfants, mes petits-enfants ? Ça ne va pas du tout ! Repars de là, tu veux bien ? Nous avons peut-être une hallucination, ici, mais ce n’est pas une excuse pour nous induire en erreur !
Bahram fut blessé par ses paroles.
— C’est toi qui renonces aux choses ! protesta-t-il. Chaque fois. C’est ça, ton cynisme : tu n’essaies même pas. Tu n’as pas le courage de continuer.
— Tu parles que je n’ai pas le courage ! Je n’ai jamais renoncé. C’est juste que je ne suis pas disposé à gober ces mensonges balbutiants. Non, c’est toi qui n’essaies jamais. Qui attends toujours que nous fassions le plus dur, Iwang et moi. Fais-le, pour une fois ! Arrête de bavasser sur l’amour et essaie une fois, bordel ! Essaie toi-même, et tu verras si c’est facile de continuer à sourire quand on cherche à voir la vérité, les yeux dans les yeux.
— Ho ! fit Bahram, piqué au vif. Je fais ma part. J’ai toujours fait ma part. Sans moi, aucun d’entre vous n’aurait pu continuer. Il faut du courage pour faire en sorte que l’amour reste au centre, quand on connaît comme tout le monde le véritable état des choses ! C’est facile de se mettre en colère, tout le monde peut y arriver. C’est de faire en sorte que ça se passe bien qui est difficile, c’est de garder espoir qui est difficile ! C’est de continuer à aimer qui est difficile !
Khalid agita sa main gauche.
— C’est bien joli, tout ça, mais ça ne compte qu’à condition d’affronter la vérité et de se battre. J’en ai marre de l’amour et du bonheur – c’est de la justice que je veux.
— Moi aussi !
— Alors – très bien, montre-la-moi. Montre-moi ce que tu peux faire la prochaine fois, dans ce monde misérable, quelque chose d’un peu mieux que le bonheur béat.
— Très bien, je vais le faire !
— Parfait.
Khalid se releva lourdement, s’approcha d’un pas lent de Sayyed Abdul Aziz et, sans prévenir, lui flanqua un coup qui l’envoya les quatre fers en l’air sur l’estrade.
— Et toi ! rugit-il. Quelle est ton EXCUSE ? Pourquoi es-tu toujours si mauvais ? La constance n’est pas une excuse ! Ton CARACTÈRE N’EST PAS une EXCUSE !
Sayyed le foudroya du regard, étalé par terre, suçant son doigt tordu. Des épées dans le regard.
— Foutez-moi la paix !
Khalid fit mine de lui flanquer un nouveau coup de pied.
— Je te revaudrai ça, promit-il. Un jour ou l’autre, tu me le paieras.
— Oublie-le, lui conseilla Iwang. Ce n’est pas le vrai problème, et il fera toujours partie de nous. Oublie-le, oublie les dieux. Concentrons-nous sur ce que nous faisons. Nous pouvons faire notre propre monde.
LIVRE 5
CHAÎNE ET TRAME
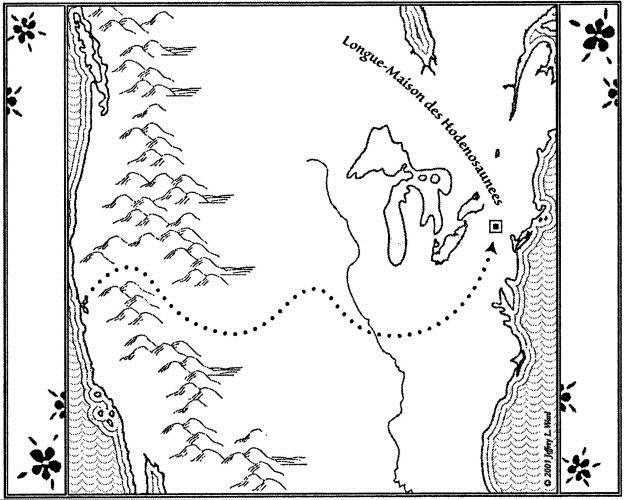
Une nuit peut changer le monde
Les Portiers envoyèrent des messagers, avec des ceintures de wampum, annoncer une réunion du conseil au Pont Flottant. Ils voulaient élever au rang de chef l’étranger qu’ils appelaient Delouest. Il n’y avait rien d’extraordinaire à cela, et les cinquante sachems avaient accepté de se réunir. Il y avait beaucoup plus de chefs que de sachems, dont le titre mourait avec l’homme. Chaque nation était libre de choisir le sien, en fonction de ce qui se passait sur le sentier de la guerre et dans les villages. La seule chose inhabituelle dans cette nomination était l’origine étrangère du candidat, mais cela faisait déjà quelque temps qu’il vivait avec les Portiers, et le bruit courait parmi les neuf nations et les huit tribus que c’était quelqu’un d’intéressant.
Il avait été sauvé par une escouade de guerriers Portiers qui s’étaient avancés loin vers l’ouest pour infliger encore une leçon aux Sioux, voisins des Hodenosaunees. Les guerriers étaient arrivés alors que les Sioux étaient en train de torturer un homme, suspendu au-dessus d’un feu par des crochets enfoncés dans sa poitrine. Tout en préparant leur embuscade, les guerriers avaient été impressionnés par le discours de la victime, qui parlait dans un dialecte compréhensible par les Portiers, comme s’il avait vu qu’ils étaient là.
D’ordinaire, l’attitude à adopter quand on était torturé consistait à rire frénétiquement au nez de ses ennemis, afin de leur montrer qu’une douleur infligée par l’homme ne pouvait triompher de l’esprit. Mais l’étranger n’agissait pas ainsi. Calmement, il faisait remarquer à ses tortionnaires, dans la langue des Portiers et non en sioux :
— Vous êtes vraiment minables comme tortionnaires ! Ce qui blesse l’esprit ce n’est pas la passion, puisque toute passion est un encouragement. En me haïssant, vous m’aidez. Ce qui meurtrit vraiment, c’est d’être broyé comme un gland par une meule. Là d’où je viens, il existe un millier d’outils permettant de déchirer les chairs, mais ce qui fait souffrir, c’est l’indifférence. Vous, vous me rappelez que je suis un être humain, doué de passion, une cible de passion. Je suis heureux d’être ici. Et je suis sur le point d’être sauvé par des guerriers bien meilleurs que vous.
Les Seneques tapis dans les fourrés prirent cela comme le signal évident de l’attaque, et ils se ruèrent sur les Sioux en poussant des cris de guerre. Ils scalpèrent tous ceux qu’ils purent attraper, tout en prenant soin de sauver ce captif qui avait si bien parlé, qui plus est dans leur langue.
Comment saviez-vous que nous étions ici ? lui demandèrent-ils.
Suspendu comme je l’étais, leur répondit-il, j’avais vu vos yeux dans les fourrés.
Et comment se fait-il que vous parliez notre langue ?
Il y a, sur la côte ouest de cette île, une tribu parente de la vôtre, qui est venue ici il y a bien longtemps. C’est avec eux que j’ai appris votre dialecte.
Et voilà comment ils le ramenèrent chez eux, près du Niagara, où il vécut avec les Portiers et le Peuple de la Grande Colline, pendant plusieurs mois. Il participa aux chasses et prit part aux combats. On vanta ses exploits dans toutes les neuf nations, et bien des gens le rencontrèrent et furent impressionnés. Personne ne fut surpris qu’on le nommât chef.
Le conseil devait se tenir sur la colline, en amont du lac Canandaigua, où les Haudenosaunees étaient apparus, en sortant de la terre comme des taupes.
Le Peuple de la Colline, le Peuple du Granit, les Maîtres du Silex et les Tisseurs-de-Chemises, qui étaient montés du sud voici deux générations, après avoir connu bien des malheurs avec les gens venus d’au-delà des océans de l’Est, tous partirent vers l’ouest en suivant la Piste de la Longue-Maison, qui traversait la terre du peuple d’est en ouest. Ils campèrent à quelque distance de la maison du conseil des Portiers, envoyant des messagers pour dire qu’ils arrivaient, comme on le faisait autrefois. Les sachems seneques confirmèrent le jour de la réunion, et renouvelèrent leur invitation.
Au matin convenu, avant l’aube, les gens se levèrent, roulèrent leur couverture et se pressèrent autour des feux pour un rapide repas de gâteaux de maïs et de sirop d’érable. Le ciel était clair, avec seulement une mince ligne de nuages gris à l’est, pareille à l’ourlet finement brodé du manteau que portaient les femmes. La brume du lac se mit à danser. On aurait dit que des farfadets patinaient à la surface, y formant des tourbillons, des farfadets qui se rendaient à un conseil des farfadets, comme il y en avait un à chaque fois que les hommes se réunissaient. L’air était humide et froid, sans un brin de cette chaleur qui les accablerait probablement dans l’après-midi.
Les nations invitées se réunirent dans la prairie, au bord du lac, et s’installèrent là où elles en avaient l’habitude. Le temps que le ciel passe du gris au bleu, il y avait déjà quelques centaines de gens venus assister au Salut au Soleil, chanté par l’un des sachems seneques.
Les nations Onandagas gardaient le bâton de parole, ainsi que le wampum auquel on avait murmuré les lois de la Ligue. Leur puissant et vénérable sachem, Keeper, le Gardien du Wampum, se leva et brandit dans ses mains tendues les ceintures de wampum, lourdes et blanches. Les Onandagas étaient la nation du centre, le feu de leur conseil était le siège des conseils du peuple. Le Gardien du Wampum se lança dans une danse endiablée autour de la prairie, chantant quelque chose que la plupart d’entre eux ne perçurent que sous la forme d’une faible plainte.
On alluma un feu, et les pipes se mirent à tourner. Les Mohawks, les Onandagas et les Seneques, frères entre eux et pères de tous les autres, s’installèrent à l’ouest du feu ; les Oneidas, les Cayugas et les Tuscaroras s’assirent à l’est ; les jeunes nations, les Cherokees, les Shawnees et les Choctaws, s’assirent au sud. Le soleil apparut à l’horizon ; sa lumière coula dans la vallée comme du sirop d’érable, teintant chaque chose d’un jaune estival. Un filet de fumée s’éleva, de gris et de brun mêlés. C’était un matin sans vent, et la brume du lac finit par se dissiper. Des oiseaux se mirent à chanter dans le dais de verdure, à l’est de la prairie.
Des flèches d’ombre et de lumière sortit un homme. Il était petit, râblé, marchait pieds nus, et ne portait pour tout vêtement que le pagne du messager. Son visage était un ovale plat. C’était un étranger. Il avançait les mains jointes, le regard humblement baissé, et passa entre les jeunes nations jusqu’au feu central, où il se présenta, les paumes en avant, au Gardien du Wampum.
— Aujourd’hui, lui dit Keeper, tu deviens chef Hodenosaunee. En cette occasion, l’usage veut que je lise l’histoire du peuple, telle que la raconte le wampum que je tiens, et que je vous rappelle les lois de la Ligue, qui nous ont donné la paix pendant tellement de générations, à nous et aux jeunes nations qui nous ont rejoints, de la mer au Mississippi, des Grands Lacs au Tennessee.
Delouest hocha la tête. Sa poitrine portait encore les profondes cicatrices des tortures infligées par les Sioux. Il était aussi solennel qu’un hibou.
— Je suis plus qu’honoré. Vous êtes la plus généreuse des nations.
— Nous sommes la plus grande assemblée de nations sous les deux, répondit le Gardien d’un ton grave et sérieux. Nous vivons ici, sur les hautes terres de la Longue-Maison, d’où de bonnes routes descendent dans toutes les directions. Dans chaque nation vivent huit tribus, réparties en deux groupes. Les Loups, les Ours, les Castors, et les Tortues ; et les Daims, les Bécassines, les Hérons et les Faucons. Chaque membre de la tribu des Loups est le frère ou la sœur de tous les autres Loups, quelle que soit leur nation. La relation des Loups entre eux est presque plus importante que la relation des membres d’une même nation. C’est une relation croisée, comme la chaîne et la trame d’un panier tressé ou d’un vêtement tissé. De la sorte, nous ne sommes qu’un même vêtement. Nous ne pouvons nous disputer entre nations, car cela déchirerait l’étoffe dont sont faites les tribus. Les frères n’attaquent pas les frères, les sœurs n’attaquent pas les sœurs. Maintenant, Loups, Ours, Castors, Tortues, étant frères et sœurs, ne peuvent se marier entre eux. Ils doivent se marier à l’extérieur, avec les Faucons, les Hérons, les Bécassines ou les Daims.
Delouest hochait la tête à chaque parole du Gardien, cet homme qui non seulement avait œuvré toute sa vie pour la survie du système, mais encore avait contribué à le faire s’étendre et évoluer. Delouest avait été fait membre de la tribu des Faucons, et jouerait ce matin-là au jeu de lacrosse dans l’équipe des Faucons. Il regardait le Gardien avec l’intensité d’un faucon, s’imprégnant de chacun des mots de l’irascible vieil homme, indifférent à la foule grandissant au bord du lac.
Quand le Gardien eut enfin fini son discours, Delouest prit la parole à son tour :
— C’est le plus grand honneur de ma vie, dit-il lentement et distinctement, avec son accent étrange mais compréhensible. Être accepté par le meilleur peuple de la Terre, c’en est plus qu’un pauvre vagabond ne pouvait espérer. Même si je l’ai longtemps désiré. En vérité, j’ai passé de très nombreuses années à parcourir cette grande île dans cet espoir.
Il joignit les mains et courba la tête.
— Cet homme est particulièrement modeste, fit remarquer Iagogeh, Celle-Qui-Entend, l’épouse du Gardien du Wampum. Et pas des plus jeunes. Ce sera intéressant d’entendre ce qu’il dira ce soir.
— Et de le voir jouer, ajouta Tecarnos, encore appelée Goutte-d’Huile, l’une des nièces de Iagogeh.
— Sers la soupe, dit Iagogeh.
— Oui, mère.
Puis tous s’en retournèrent à leurs occupations, les femmes autour du feu et aux préparatifs de la fête, tandis que les hommes allaient arranger le terrain de lacrosse, près du lac.
Les arbitres inspectèrent le terrain, à la recherche de pierres ou de terriers de lapins, puis les piquets des buts furent plantés à chaque extrémité du large champ. Comme toujours, le tournoi opposait l’équipe des Loups, Ours, Castors et Tortues à celle des Daims, Bécassines, Hérons et Faucons. Beaucoup de gens pariaient, et les mises s’amoncelaient dans des filets, gardés par les organisateurs du tournoi. Il s’agissait surtout d’objets personnels, décoratifs, mais aussi de silex, de tambours, de blagues à tabac et de pipes, de lances et de flèches, de deux pistolets à silex, et de quatre mousquets.
Les deux équipes et les arbitres se rejoignirent au milieu du champ. Autour d’eux, et au sommet des collines, la foule assemblée les regardait, attendant. Le match du jour se déroulerait en dix manches. Cinq tirs au but réussis permettaient de gagner la partie. L’arbitre en chef rappela, comme il se doit, les règles principales : pas le droit de toucher la balle avec la main, le pied, un membre, le corps ou la tête ; pas le droit de frapper intentionnellement l’adversaire avec sa crosse. Puis il leva la balle, faite de peau de daim emplie de sable, à peu près de la taille de son poing. Les vingt joueurs – dix de chaque côté du terrain – défendaient leurs buts, l’un d’eux étant près de l’arbitre, afin d’attraper la balle en premier, une fois que l’arbitre l’aurait lâchée – ce qui signifiait l’ouverture du match. La foule hurla au moment où l’arbitre lâcha la balle et alla rejoindre les autres arbitres au bord du terrain, d’où ils suivraient le match, guettant la moindre faute.
Les deux capitaines se disputèrent âprement la balle, les filets en cerceau au bout de leur crosse heurtant le sol et s’entrechoquant. Bien que frapper un joueur fut interdit, on avait le droit de repousser sa crosse avec la sienne ; c’était cependant assez risqué, puisqu’un coup mal dirigé pouvait toucher l’adversaire, et donner à son équipe le droit de tenter un tir au but. C’est pourquoi les deux capitaines tapèrent dans tous les sens, jusqu’à ce que celui des Hérons attrape la balle dans son filet et l’envoie en arrière, vers l’un de ses équipiers. La partie pouvait enfin commencer.
Les joueurs se jetèrent sur celui qui avait la balle. Il louvoya entre eux tant qu’il put et finit par envoyer, d’un coup de crosse, la balle dans le filet de l’un de ses coéquipiers. Si la balle était tombée par terre, presque tous les joueurs se seraient jetés dessus, dans de violents claquements de crosses, pour s’en emparer. Deux joueurs de chaque équipe se tenaient en arrière, en défense, au cas où l’un des joueurs adverses tenterait une percée vers leurs buts.
Très vite, il devint évident que Delouest avait déjà pratiqué le lacrosse auparavant, probablement chez les Portiers. Il n’était pas aussi jeune que la plupart des autres joueurs, ni aussi rapide que les meilleurs coureurs de chaque équipe, mais ceux-ci étaient déjà occupés à se garder mutuellement. Les seuls adversaires véritablement dangereux auxquels Delouest avait à faire face étaient les mieux bâtis des joueurs de l’équipe des Ours-Loups-Tortues-Castors, qui pouvaient opposer à sa robustesse de vigoureux coups d’épaules. Mais ils n’étaient pas aussi rapides que lui. L’étranger tenait sa crosse à deux mains, comme une faux, bas sur le côté, ou devant lui, dans l’attente d’un clash libératoire qui projetterait la balle en avant. Sauf que ses adversaires avaient vite compris que s’ils s’y risquaient, après s’être envolée, la balle ne retomberait plus, le petit homme s’en étant saisi, et ayant détalé à une vitesse incroyable pour un corps aussi trapu. Quand d’autres adversaires parvenaient à le bloquer, ses passes à ses coéquipiers partaient comme des flèches tirées d’un arc ; et si on pouvait leur reprocher quelque chose, c’était d’être tellement puissantes que même les joueurs de son équipe avaient du mal à les attraper. Mais quand ils y arrivaient, ils filaient vers les buts, agitant leur crosse afin de troubler le dernier joueur à garder les buts adverses, mêlant leurs cris à ceux, hystériques, de la foule. Delouest ne parlait ni ne criait jamais, mais jouait dans un silence étrange, sans jamais invectiver les joueurs adverses ni croiser leur regard, ne quittant pas la balle des yeux, sauf pour jeter parfois un coup d’œil au ciel. Il jouait comme en transe, comme s’il était perdu. Et pourtant, quand ses coéquipiers étaient talonnés et bloqués, il se trouvait toujours là, quelque part, prêt à recevoir une passe, quels que soient les efforts que faisait son gardien – ou bientôt ses gardiens – pour le contrer. Des équipiers apparemment cernés, cherchant désespérément à conserver leur crosse libre pour une dernière passe, trouvaient toujours Delouest dans la seule direction où ils pouvaient envoyer la balle. Ce n’était pas évident, mais si, par miracle, ils y arrivaient, alors Delouest la prenait avec dextérité et filait en zigzaguant, semant ses adversaires en décrivant des virages à angle droit, virant, tournant, les surprenant sans cesse, jusqu’à ce qu’il soit enfin bloqué, et qu’une opportunité de passe surgisse. Son tir partait en sifflant, et la balle parcourait le terrain de jeu à la vitesse d’une flèche. C’était très agréable à regarder, tellement particulier que c’en était bizarrement comique. La foule hurla alors que l’équipe des Daims-Bécassines-Faucons-Hérons mettait un nouveau tir au but, qui passa en vrombissant au-dessus du plongeon du gardien adverse. Rarement le score avait été ouvert aussi vite.
Ensuite, l’équipe des Ours-Loups-Castors-Tortues fit ce qu’elle put pour arrêter Delouest, mais ils étaient troublés par son étrange façon de jouer, et ne parvenaient pas à le contrer correctement. S’ils lui tombaient dessus à plusieurs, il faisait une passe à l’un de ses rapides jeunes équipiers, qui gagnaient en assurance au fur et à mesure de leurs succès. S’ils le prenaient à un seul, alors il se mettait à s’agiter bizarrement, chancelant, feintant, paraissant hésiter, trébucher, tant et si bien qu’il troublait son adversaire, qui ne pouvait l’empêcher d’arriver à portée de tir des buts, vers lesquels il se ruait alors, soudain ressuscité, sa crosse à la hauteur du genou, pour, d’un tour du poignet, lancer la balle entre les deux poteaux comme une flèche. Personne n’avait jamais vu de tirs aussi puissants.
Après chaque tir au but, on regagnait le bord du terrain pour se désaltérer, d’un bol d’eau ou de sirop d’érable. Les équipiers des Ours-Loups-Castors-Tortues s’entretinrent sombrement, et décidèrent de faire des changements. Ensuite, un coup de crosse « accidentel » atteignit Delouest en pleine tête, lui ouvrant le crâne et le laissant couvert de son propre sang. Mais la foule lui accorda un tir au but, qu’il sut transformer depuis le milieu du terrain, arrachant au public une formidable ovation. En outre, cela n’affecta pas son étrange mais particulièrement efficace façon de jouer, ni ne le fit regarder une seule fois ses adversaires ; ce qui tira ce commentaire à Iagogeh :
— Il joue comme si les joueurs adverses étaient des fantômes. Il joue comme s’il était tout seul sur le terrain, et qu’il apprenait à courir de façon élégante.
Excellente connaisseuse du jeu de lacrosse, elle appréciait particulièrement cette partie.
Beaucoup plus vite que d’habitude, le score fut de quatre à un pour l’équipe des jeunes tribus. Les vieilles tribus se réunirent pour revoir leur stratégie. Les femmes distribuèrent des gourdes d’eau et de sirop d’érable, et Iagogeh, qui était elle aussi de la tribu des Faucons, s’approcha de Delouest pour lui tendre un peu d’eau – puisque c’était, avait-elle remarqué, la seule chose qu’il buvait.
— Il te faut quelqu’un maintenant, murmura-t-elle en s’accroupissant à côté de lui. Personne ne peut finir seul.
Il la regarda, surpris. D’un geste de la tête, elle lui désigna son neveu, Doshoweh, Fend-la-Fourche.
— C’est ton homme, dit-elle avant de s’éclipser.
Les joueurs se regroupèrent au milieu du terrain pour le lancer, l’équipe des Ours-Loups-Castors-Tortues ne laissant derrière elle qu’un seul joueur en défense. Ils se saisirent de la balle et coururent furieusement, désespérément, vers l’ouest. Le jeu dura quelque temps, aucune équipe ne parvenant à prendre l’avantage, chacune montant et descendant follement le terrain sans réussir à marquer. Puis l’un des joueurs des Daims-Bécassines-Faucons-Hérons se blessa à la cheville, et Delouest demanda à Doshoweh d’entrer pour le remplacer.
L’équipe des Ours-Loups-Castors-Tortues redoubla d’énergie, harcelant ce nouveau joueur. L’une de leurs passes frôla Delouest, qui l’intercepta en bondissant par-dessus un homme à terre. Il la renvoya à Doshoweh, et tous convergèrent en direction du jeune homme, qui paraissait terrorisé et vulnérable ; mais il eut la présence d’esprit de faire une longue passe à Delouest, qui courait déjà à toute allure de l’autre côté du terrain. Delouest attrapa la balle et tous se ruèrent à sa poursuite. Malheureusement, on aurait dit qu’il disposait d’un supplément secret d’énergie, que personne ne lui aurait soupçonné, et dont il se servait à présent pour distancer tous ses poursuivants et atteindre les buts adverses, où, après une feinte du corps et de la crosse, il tira, envoyant la balle se perdre loin derrière les buts, dans les bois. Fin du match.
La foule hurla de bonheur, et une pluie de chapeaux et blagues à tabac s’abattit sur le terrain. Les joueurs, qui s’étaient allongés sur l’herbe, épuisés, se relevèrent et s’embrassèrent en une joyeuse mêlée, sous les regards attendris des arbitres.
Ensuite, Delouest s’assit au bord du lac avec les autres.
— Quel soulagement, dit-il. Je commençais à fatiguer.
Il accepta que des femmes lui mettent une écharpe brodée sur la tête, sur sa blessure, et les remercia, en baissant la tête.
Dans l’après-midi, les plus jeunes s’amusèrent à envoyer un javelot à travers un cerceau que l’on faisait rouler. On proposa à Delouest d’essayer, et il accepta.
— Rien qu’une fois, dit-il.
Il se tint parfaitement droit, et envoya son javelot d’un tir habile et souple à travers le cerceau, qui continua sa course comme si de rien n’était. Delouest s’inclina et céda sa place à qui la voulait.
— Je jouais à ça quand j’étais petit, expliqua-t-il. Cela faisait partie de l’entraînement pour devenir un de ces guerriers que nous appelons samouraïs. Ce que le corps apprend, il ne l’oublie jamais.
Iagogeh, qui avait assisté à tout, alla trouver son mari, le Gardien du Wampum.
— Nous devrions demander à Delouest de nous parler de son pays, lui dit-elle.
Il hocha la tête, se renfrognant comme à chaque fois qu’elle lui prodiguait un conseil, bien qu’il eût l’habitude, chaque jour, depuis plus de quarante ans, de discuter avec elle des affaires de la Ligue. Le Gardien était ainsi, irritable et mauvais. Mais c’était parce que la Ligue était très importante pour lui. Alors Iagogeh ne disait rien. La plupart du temps.
Les préparatifs étant terminés, chacun se dirigea vers la fête. Comme le soleil disparaissait entre les branches des arbres, des feux se mirent à rugir dans les ombres, les peuplant de lumière. Le terrain cérémoniel, au centre des quatre feux dressés aux quatre points cardinaux, s’emplit d’une foule de plusieurs centaines de personnes faisant la queue pour recevoir des bols emplis d’une bouillie de maïs épicée et de gâteaux de maïs, de soupe de pois, de courge chaude et de tranches de viande de daim, d’élan, de canard et de caille. La foule se mettant à manger, le vacarme diminua. Puis on prit le dessert, du pop-corn et de la gelée de fraise des bois nappée de sirop d’érable, que l’on savourait lentement, et qui faisait le délice des enfants.
Pendant que l’on se délectait de ce festin crépusculaire, Delouest se promena dans les champs, une plume d’oie sauvage à la main. Il se présentait aux gens qu’il ne connaissait pas, écoutant leurs histoires ou répondant à leurs questions. Il s’assit avec les proches des joueurs de son équipe, et se remémora leur triomphe de la journée à la partie de lacrosse.
— Ce jeu ressemble à mon ancien travail, dit-il. Dans mon pays, les guerriers se battent avec des armes qui ressemblent à de grandes lances. J’ai vu que vous en aviez quelques-unes, ainsi que des fusils. Ils ont dû être apportés par l’un de mes frères aînés, ou bien par ceux qui sont venus ici jadis, par la mer, de l’est.
Ils hochèrent la tête, songeurs. En effet, des étrangers venus de l’autre côté de la mer avaient établi un village fortifié non loin de la côte, près de la grande baie où se jetait le fleuve de l’Est. Leurs lances, les fers de certains tomahawks et leurs fusils venaient de chez eux.
— Les lances sont très utiles, dit Iagogeh. Et ce n’est pas Brise-Lance qui me contredira !
Les gens s’esclaffèrent en regardant Brise-Lance, qui grimaça, embarrassé.
— Mais ce métal vient de certaines roches, très particulières, dit Delouest. Des roches rouges. À l’aide d’un feu suffisamment chaud, dans un grand four en glaise, vous pourriez vous aussi forger ce même métal. Les pierres qu’il vous faut sont juste au sud de vos terres, en bas de la vallée étroite et mamelonnée.
Prenant un bout de bois, il traça une sorte de carte sur le sol.
Deux ou trois sachems écoutaient ce qu’il disait à Iagogeh. Delouest les salua, en s’inclinant.
— Il faut que je parle au conseil des sachems. C’est très important.
— Mais est-ce qu’un four en glaise supportera une chaleur aussi importante ? l’interrogea Iagogeh, en regardant les grosses aiguilles à tricoter qu’elle portait au cou, suspendues à l’un de ses colliers.
— Oui. Et la pierre noire, en se consumant, chauffe autant que du charbon. Je m’en servais moi-même pour forger des épées. Elles ressemblaient à des faux, en plus longues. Comme des brins d’herbes, ou des crosses de lacrosse. Aussi longues que les crosses, en fait, mais aussi affûtées qu’un tomahawk ou qu’un brin d’herbe, lourdes, et solides. On apprend à frapper de taille, fit-il en envoyant une main devant lui, paume contre terre, et hop, plus de tête ! Personne ne peut rien contre vous.
Tous l’écoutaient attentivement. Ils le voyaient encore, agitant sa crosse autour de lui, comme une graine d’orme dansant au gré du vent.
— Sauf un homme équipé d’un fusil, fit remarquer le grand sachem mohawk Sadagawadeh, Humeur-Égale.
— C’est vrai. Mais la majeure partie d’un fusil est composée d’un métal de même qualité.
Sadagawadeh en convint, très intéressé maintenant. Delouest s’inclina.
Le Gardien du Wampum envoya une cinquantaine de jeunes Neutres chercher les différents sachems, et ils durent parcourir le terrain pour les trouver. Quand ils revinrent, Delouest se tenait au milieu d’un groupe, une balle de lacrosse entre le pouce et l’index. Il avait de grandes mains carrées, couvertes de cicatrices.
— Là, imaginons que ceci est le monde. Le monde est couvert d’eau, dans sa quasi-totalité. Il y a deux grandes îles au milieu du lac du monde. La plus grande île se trouve de l’autre côté, par rapport à nous. L’île sur laquelle nous sommes est grande, mais pas aussi grande que l’autre. Moitié moins grande, ou même moins. Quant à savoir à quel point le lac est grand, je ne sais pas trop…
Avec un morceau de charbon, il traça deux traits sur la balle pour indiquer les îles. Puis il donna à Keeper la balle de lacrosse.
— C’est une sorte de wampum.
Keeper eut un sourire.
— On dirait une image.
— Oui, une image. Du monde entier, sur une balle, parce que le monde est une grande balle. Et qu’on peut y tracer les noms des îles et des lacs.
Le Gardien n’avait pas l’air convaincu, mais Iagogeh n’arrivait pas à voir pourquoi. Il dit aux sachems de se préparer pour le conseil.
Iagogeh alla aider les autres femmes à tout nettoyer. Delouest prit quelques bols et les apporta au lac, pour les laver.
— Je vous en prie, dit Iagogeh, gênée. Nous nous en occuperons…
— Je ne suis le serviteur de personne, répondit Delouest.
Et il continua pendant un moment d’apporter les bols aux filles, en leur posant des questions sur leurs broderies. Quand il vit que Iagogeh était allée se reposer un peu à l’écart, sur un talus, il alla s’asseoir à côté d’elle.
— Je sais que la sagesse hodenosaunee est telle, dit-il tout en continuant de regarder les filles, que ce sont les femmes qui décident qui doit épouser qui.
Iagogeh réfléchit un instant.
— Je suppose qu’on peut voir les choses comme ça, répondit-elle enfin.
— Je suis un Portier à présent, et un Faucon. Je passerai le restant de ma vie ici, parmi vous. Moi aussi, j’espère me marier un jour.
— Je vois.
Elle le regarda, puis regarda les filles.
— Pensez-vous à quelqu’un en particulier ?
— Oh non ! s’exclama-t-il. Je n’aurai pas cette hardiesse. C’est à vous de décider. Après le conseil que vous m’avez donné pour le joueur de lacrosse, je suis sûr que vous ferez un très bon choix.
Elle sourit. Elle regarda les robes de fête des filles, dont certaines savaient que leur aînée les regardait, et d’autres pas.
— Combien d’étés avez-vous connus ? demanda-t-elle.
— Trente-cinq, à peu près. Dans cette vie.
— Vous avez eu d’autres vies ?
— Nous en avons tous eu. Vous ne vous souvenez pas ?
Elle le considéra, ne sachant s’il était sérieux.
— Non.
— Je m’en souviens en rêve, le plus souvent. Et parfois un événement se produit, que l’on a déjà vu.
— J’ai déjà eu cette sensation.
— Eh bien, c’est ça.
Elle frémit. Il commençait à fraîchir. Il était temps d’allumer de nouveaux feux. Entre les branches chargées de feuilles, au-dessus d’eux, une étoile, puis une autre scintillèrent.
— Êtes-vous sûr de ne pas avoir de préférence ?
— Aucune. Les femmes hodenosaunees sont les femmes les plus puissantes de ce monde. Non seulement à cause de l’héritage et de la lignée familiale, mais aussi parce qu’elles choisissent leur partenaire. En fait, cela veut dire que c’est vous qui décidez qui reviendra au monde.
Elle gloussa.
— Si les enfants étaient comme leurs parents !
En effet, les enfants qu’elle avait eus avec le Gardien étaient des plus étranges, et dangereux.
— Celui qui vient au monde attendait d’y venir. Mais beaucoup attendent. Ce sont les parents qui décident qui doit revenir.
— Vous croyez ? Parfois, quand je regarde les miens, j’ai l’impression de voir des étrangers – invités à venir passer quelque temps dans la Longue-Maison.
— Comme moi.
— Oui, comme vous.
C’est alors que les sachems les trouvèrent, et emmenèrent Delouest pour le conduire à la cérémonie d’élévation.
Iagogeh s’assura que le rangement était à peu près fini, puis s’en alla rejoindre les sachems, pour les aider à préparer l’accueil du nouveau chef. Elle brossa ses longs cheveux noirs, qui ressemblaient tellement aux siens, et lui fit un chignon au-dessus de la tête, comme il le voulait. Elle considéra son visage souriant. C’était un homme très particulier.
On lui donna les ceintures et les bandeaux adéquats, qui avaient demandé un hiver entier de travail à une brodeuse de talent, et avec lesquels il parut tout à coup des plus élégants. Un guerrier, un chef, malgré son visage lunaire et ses yeux bridés. Il ne ressemblait à personne, et certainement pas aux étrangers venus de l’autre côté de la mer, à l’est, qu’elle avait parfois entr’aperçus. Pourtant, elle commençait à éprouver un sentiment de familiarité. Ce sentiment la troublait.
Il leva les yeux vers elle pour la remercier de l’avoir aidé. Quand elle croisa son regard, elle eut l’impression bizarre de le reconnaître.
Quelques branches et plusieurs grosses bûches vinrent alimenter le feu central, et le son des tambours et des hochets en carapace de tortue monta dans le ciel, alors que les cinquante sachems des Hodenosaunees formaient un large cercle pour la cérémonie. La foule se massa derrière eux, d’abord mouvante, puis s’asseyant pour que tout le monde puisse voir – vallée immense de visages attentifs.
La cérémonie d’élévation au rang de chef n’était pas longue, par rapport à celle de l’élévation au rang de sachem. Le sachem-parrain, en l’occurrence Grand-Front, de la tribu des Faucons, s’avança et annonça à tous la promotion de Delouest au rang de chef. Grand-Front leur raconta, une nouvelle fois, l’histoire de Delouest, comment ils l’avaient rencontré alors qu’il était torturé par les Sioux, et qu’il leur expliquait les tortures raffinées en pratique dans son pays ; comment il se faisait qu’il parlait déjà un dialecte, certes d’un genre un peu particulier, du langage portier, et combien il désirait, avant même d’être capturé par les Sioux, rencontrer la Ligue de la Longue-Maison. Comment il avait vécu parmi les Portiers, s’était familiarisé avec leurs coutumes et avait mené une petite troupe de guerriers en aval du fleuve Ohio, secourir les Seneques, esclaves des Lakotas, faisant de cette opération de sauvetage un succès, et les ramenant ensuite à la maison. Comment cela, et bien d’autres prouesses, avait fait de lui un candidat apte à être élevé au rang de chef, fort du soutien de tous ceux qui le connaissaient.
Grand-Front continua son discours, leur annonçant que les sachems s’étaient concertés le matin même, et avaient approuvé le choix des Portiers, bien avant que Delouest ne fasse la démonstration de son savoir-faire à la partie de lacrosse. Alors, dans une tempête d’acclamations, on conduisit Delouest dans le cercle des sachems. Son visage plat brillait à la lumière du feu, son sourire était si grand que ses yeux paraissaient s’effacer derrière ses pommettes.
Il leva la main, indiquant qu’il s’apprêtait à leur faire un discours. Les sachems s’assirent sur le sol de terre battue, pour que tout le monde puisse le voir.
— C’est le plus beau jour de ma vie, commença-t-il. Jamais je n’oublierai cette magnifique journée, dussé-je vivre cent ans. Laissez-moi maintenant vous raconter comment cela est arrivé. Vous n’avez entendu qu’une partie de mon histoire. Je suis né sur l’île d’Hokkaido, qui fait partie de Nippon. J’y ai grandi, d’abord en tant que moine, puis en tant que samouraï. C’est-à-dire en guerrier. Je m’appelais Busho.
» À Nippon, les choses ne se passent pas comme chez vous. Nous avions un groupe de sachems, mais un seul chef, appelé empereur, et un clan de guerriers entraînés à se battre pour leur maître, veillant à ce que les paysans lui versent bien une part de leurs récoltes. J’ai quitté le service de mon premier maître parce qu’il était trop cruel envers les paysans. Je suis alors devenu un ronin, un guerrier sans clan.
» J’ai vécu ainsi pendant des années, passant des montagnes d’Hokkaido à celles de Honshu, en mendiant, me faisant à l’occasion moine, chanteur ou soldat. Et puis Nippon tout entier fut envahi par des gens venus de l’Ouest, et qui vivaient sur la grande île du monde. Ces gens, les Chinois, dirigent la moitié de l’autre monde, peut-être plus. Quand ils envahirent Nippon, il n’y eut pas cette fois-ci de grand vent kamikaze pour couler leurs flottes, comme cela arrivait autrefois. Les anciens dieux avaient abandonné Nippon, peut-être à cause de ceux qui vénéraient Allah, dans les îles plus au sud. En tout cas, puisqu’ils pouvaient franchir les mers, plus rien ne pouvait les arrêter. Nous utilisâmes alors nos batteries côtières, plaçâmes des chaînes dans l’eau, lançâmes des feux, leur tombâmes dessus par surprise à la nuit tombée, nageâmes jusqu’à leurs vaisseaux en haute mer pour les y massacrer. Nous en tuâmes beaucoup, flotte après flotte, mais il en venait toujours. Ils établirent sur la côte un fort, dont nous ne parvînmes pas à les chasser. C’était un fort qui protégeait une longue péninsule. Un mois leur suffit pour s’en emparer. Ensuite ils s’attaquèrent à l’île, débarquant sur chacune des plages à l’ouest avec des milliers d’hommes. Tous les hommes et les femmes de la Ligue haudenosaunee n’auraient été qu’une poignée dans cette multitude. Nous avions beau nous battre, encore et encore, nous regrouper dans les collines et les montagnes – dont nous connaissions chaque ravine, chaque grotte –, ils finirent par conquérir les plaines, puis Nippon tout entier. Mon pays, mon peuple n’existaient plus.
» J’aurais dû mourir plus d’une centaine de fois, mais, lors de chaque bataille, une chance extraordinaire, ou autre chose, me sauvait la vie. Je me sortais des luttes au corps à corps, ou bien je parvenais à m’enfuir, afin de remettre le combat à une prochaine fois. Finalement, quand nous ne fûmes plus assez nombreux pour nous battre à Honshu, nous élaborâmes un plan. Il s’agissait d’aller tous ensemble, une nuit, voler trois longs canoës chinois, de ces bateaux dont ils se servaient pour débarquer leurs troupes, et qui sont longs comme plusieurs maisons flottantes mises bout à bout. Nous mîmes alors le cap à l’est, sous le commandement de ceux d’entre nous qui étaient déjà allés à la Montagne d’Or.
» Ces navires avaient des sortes de vêtements cousus ensemble, accrochés à de hauts mâts, qui servaient à attraper le vent. Peut-être en avez-vous déjà vu aux mâts des navires des envahisseurs venus de l’est, car, là-bas comme ici, le vent souffle le plus souvent de l’ouest. C’est ainsi que nous voguâmes vers l’est pendant plusieurs lunes, puis quand les vents devinrent moins favorables, nous nous laissâmes dériver sur le grand courant de la mer.
» En arrivant à la Montagne d’Or, nous trouvâmes d’autres Nippons, qui s’y étaient établis avant nous ; certains des mois auparavant, d’autres des années, voire des dizaines d’années. Quelques-uns étaient les petits-enfants d’anciens colons, parlant une ancienne forme de nippon. Ils se réjouirent de voir débarquer toute une troupe de samouraïs ; ils dirent que nous étions comme les légendaires cinquante-trois ronins, parce que les navires chinois étaient déjà arrivés, s’approchant des rivages pour les bombarder avec leurs puissants canons, avant de rentrer en Chine pour dire à leur empereur qu’un coup de lance suffirait à soumettre le pays.
À ce stade de son histoire, il poussa un long hurlement pour leur montrer ce que voulait dire le fait de mourir transpercé par une de ces énormes lances. C’était horrible à entendre, et, à cause de ses grimaces, horrible à regarder.
— Nous décidâmes de tout entreprendre pour aider notre peuple à défendre cet endroit, afin d’en faire un nouveau Nippon. Évidemment, nous ne perdions pas l’espoir de retourner un jour chez nous, notre vrai chez-nous. Et puis, quelques années plus tard, les Chinois revinrent. Non à bord de navires venus de la Porte d’Or, comme nous nous y attendions, mais par voie de terre, du nord, avec une immense armée. En avançant, ils construisaient des routes et des ponts, et ne parlaient que d’or, de l’or de nos collines. Une fois encore, les Nippons furent exterminés, comme des rats dans un grenier, chassés vers l’est ou le sud, où ils allaient, en titubant, se perdre dans de terribles montagnes, où seul un sur dix survécut.
» Une fois les rares survivants à l’abri dans les grottes et les ravines, je me promis que, si je pouvais les en empêcher, je ne verrais pas les Chinois s’emparer de l’île de la Tortue comme ils s’étaient emparés de la grande île du monde, à l’ouest. Je vécus donc parmi diverses tribus, apprenant leur langage, et, au fils des ans, je parvins à l’est, après avoir franchi de nombreux déserts et plusieurs montagnes immenses. Ces terres arides, de sable et de poussière, où pas un brin d’herbe ne pousse, sont si proches du soleil que tout y paraît brûlé, comme du maïs grillé, et crisse sous les pas. Quant aux montagnes, imaginez de gigantesques pics rocheux, où serpentent quelques canyons étroits. De l’autre côté de ces montagnes, au pied de leur versant est, s’étendent de vastes prairies herbeuses, comme celles que l’on trouve de l’autre côté de vos fleuves. De grands troupeaux de bisons y paissent en paix, fournissant aux tribus vivant là de quoi subsister. Elles migrent au nord, au sud, suivant les bisons dans leurs déplacements. Ces tribus ont beau ne manquer de rien, elles sont pourtant dangereuses, en lutte constante les unes avec les autres ; aussi fis-je très attention en traversant leurs terres. Je continuai vers l’est, jusqu’à ce que je tombe sur une bande de paysans, d’origine hodenosaunee, réduits à l’esclavage. Ils me parlèrent, dans un langage qui, à ma grande surprise, me parut tout de suite familier, et je compris alors, en les écoutant, que les Hodenosaunees étaient enfin les gens que je cherchais. La seule tribu capable de résister aux Chinois.
» C’est pourquoi je vous ai cherchés, et suis venu ici, dormant dans des troncs creux, me faufilant de-ci de-là comme un serpent afin de mieux vous étudier. J’ai remonté l’Ohio et exploré le territoire alentour. J’ai sauvé une jeune esclave seneque, qui compléta mon vocabulaire, jusqu’au jour où nous fumes capturés par une bande de guerriers sioux. C’était à cause de la fille. Elle se battit si furieusement qu’ils furent obligés de la tuer. De même qu’ils étaient en train de me tuer, lorsque vous êtes arrivés, pour me sauver. Pendant qu’ils me torturaient, j’ai senti que des guerriers seneques allaient venir me secourir – d’ailleurs, ils étaient déjà là. Leurs yeux reflétaient la lumière du feu. Et pour finir, je suis ici, avec vous !
Il leva les bras et cria :
— Merci à vous, peuple de la Longue-Maison !
Il prit quelques feuilles de tabac dans sa blague, et les déposa délicatement dans le feu.
— Merci, Grand Esprit, Conscience Unique qui nous contient tous.
— Grand Esprit, répéta la foule en murmurant.
Delouest prit la longue pipe de cérémonie que lui tendait Grand-Front, et la bourra de tabac, en faisant très attention. Tout en tassant les brins avec son pouce, il continua son discours :
— Ce que j’ai vu de votre peuple m’a ravi. Partout ailleurs dans le monde, les canons font la loi. Les empereurs les pointent sur la tête des sachems, qui les pointent sur celle des guerriers, qui les pointent sur celle des paysans, et tous ensemble ils les pointent sur celle des femmes. Et seul l’empereur et quelques sachems ont leur mot à dire. La terre leur appartient, comme vos vêtements vous appartiennent. Quant aux gens, beaucoup sont des esclaves, d’une sorte ou d’une autre. Le monde entier contient peut-être cinq ou dix de ces empires, mais ce nombre diminue sans arrêt, puisqu’ils n’arrêtent pas de se battre entre eux. Et cela continuera, jusqu’à ce qu’un seul survive. Ils dominent le monde, mais personne ne les aime. S’il n’y avait pas ces canons, pointés sur la tête des gens, tous s’en iraient ou se soulèveraient. Ce n’est que violence des uns contre les autres, homme contre homme, et tous contre les femmes. Et malgré ça, leur population ne cesse de s’accroître, parce qu’ils ont des troupeaux, d’élans par exemple, dont ils tirent viande, lait, cuir. Ils élèvent des cochons, des sortes de sangliers, des moutons, des chèvres, des chevaux – pour les monter. Ils sont de plus en plus nombreux, plus nombreux que les étoiles, grâce à ces animaux et grâce à leurs légumes, comme vos trois sœurs, la courge, les haricots et le maïs, et une autre sorte de maïs qu’ils appellent riz, et qui pousse dans l’eau… Ils font pousser tellement de choses que dans chacune de vos vallées ils pourraient nourrir autant de personnes que tous les Hodenosaunees réunis. C’est la vérité, je l’ai vu de mes propres yeux. Sur votre île, déjà, cela a commencé. Sur la côte ouest, et peut-être même sur la côte est.
Il hocha gravement la tête en les dévisageant, fit une pause pour prendre un bout de bois enflammé dans le feu et allumer sa pipe. Puis il tendit la pipe au Gardien du Wampum, et continua, pendant que chaque sachem tirait une grande bouffée.
— Sachez que j’ai étudié les Hodenosaunees aussi attentivement que l’enfant regarde sa mère. J’ai vu comment les enfants sont élevés dans le respect du matriarcat et ne peuvent rien hériter de leur père, ce qui fait qu’aucun homme ne peut à lui seul accumuler trop de biens. Il n’y a pas, chez vous, de place pour les empereurs. J’ai vu comment les femmes arrangent les mariages et donnent leur avis sur chaque question, comment vos vieillards et vos orphelins sont pris en charge. Comment les nations sont divisées en tribus, liées les unes aux autres de telle sorte que tous sont frères et sœurs d’une même ligue, la trame et la chaîne. Comment les sachems sont choisis par tous, même par les femmes. Comment, si par malheur un sachem venait à commettre une mauvaise action, il était renvoyé. Comment leurs fils ne sont en rien des personnes spéciales, mais des hommes comme les autres, qui attendent de se marier, et d’avoir eux-mêmes des garçons, qui s’en iront, et des filles, qui resteront, jusqu’à ce que chacun ait trouvé sa voie. J’ai vu comment cette façon de mener ses affaires apportait la paix à la Ligue. C’est le meilleur système que l’homme ait jamais inventé.
Il leva les mains, comme pour faire une offrande. Il bourra de nouveau la pipe, la ralluma et souffla un filet bleuté dans la colonne de fumée qui montait du brasier. Il nourrit le feu en y mettant d’autres branches, et donna la pipe au sachem à côté de lui, Peur-au-Ventre – qui effectivement, en cet instant, semblait bien mériter son nom. Comme les Hodenosaunees appréciaient autant un bon orateur qu’un bon guerrier, ils l’écoutaient tous, très attentivement.
— Oui, le meilleur des gouvernements, continua Delouest. Mais regardez-vous : votre île regorge de tant de nourriture que vous n’avez pas besoin de fabriquer d’instruments pour exploiter la terre. Vous n’avez pas non plus de métal, ni d’armes de métal. D’ordinaire, voici comment cela arrive : il faut creuser profondément la terre, pour trouver de l’eau. Mais vous, pourquoi creuseriez-vous ? Vous n’en avez pas besoin : il y a des lacs et des rivières partout. Et c’est ainsi que vous vivez.
» Malheureusement, les habitants de la grande île se sont battus pendant bien trop de générations, ils ont fabriqué tellement d’armes et d’outils, et ils sont prêts à traverser les océans, des deux côtés de votre île, pour vous envahir. D’ailleurs, ils sont là. Ils viennent comme des biches chassées par les loups. Ils sont à l’est, derrière Par-delà-l’Ouverture. Ce sont les habitants de l’île située à l’opposé de celle d’où je viens. Ils arrivent, se déployant de par le vaste monde !
» Et il en arrivera toujours ! Laissez-moi vous dire ce qui va se passer, si vous ne faites rien pour défendre cette île, votre île. Ils viendront, et ils bâtiront d’autres forts, sur la côte. Ils ont déjà commencé. Ils commerceront avec vous, échangeront des vêtements contre des fourrures. Des vêtements ! Des vêtements contre cette terre, comme si c’était un vêtement ! Quand vos guerriers se rebelleront, ils vous tueront avec leurs fusils, et vous ne pourrez leur résister longtemps, quel que soit le nombre que vous parviendrez à en tuer, parce qu’ils sont aussi nombreux que les grains de sable de la plus longue de vos plages. Ils vous submergeront, comme les eaux du Niagara.
Il s’arrêta un bref instant, de façon à laisser cette image faire son effet.
— Mais il peut en être autrement, fit-il en levant les mains. Un peuple aussi grand que les Hodenosaunees, avec ses femmes sagaces et ses guerriers avisés, une nation pour laquelle chacun serait heureux de se sacrifier s’il le fallait, comme on se sacrifie pour sa famille – ce peuple peut apprendre à résister aux empires, puisque seuls les empereurs croient aux empires.
» Comment faire ? demandez-vous. Comment empêcher les chutes du Niagara de nous tomber dessus ?
Il fit encore une pause, bourrant une nouvelle fois sa pipe, rajoutant des feuilles de tabac dans le brasier. Il fit passer la pipe de l’autre côté du cercle des sachems.
— Voici comment. Votre Ligue peut accueillir de nouveaux membres, ce que vous avez déjà prouvé en accueillant les Tisseurs-de-Chemises, les Shawnees, les Choctaws et les Chickasaws. Vous devriez inviter toutes les nations voisines de la vôtre à vous rejoindre, puis leur inculquer votre façon de vivre, et leur apprendre le danger que représente la grande île. Chaque nation apportera son savoir-faire et son dévouement à la cause de cette île. Si vous vous unissez, les envahisseurs ne pourront jamais pénétrer plus avant, dans les profondeurs de la grande forêt – qui, même sans opposition, est déjà difficile à pénétrer.
» Enfin, et surtout, il faut que vous appreniez vous aussi à fabriquer des fusils.
La foule l’écoutait à présent avec une attention toute particulière. L’un des sachems se leva, afin que tous puissent voir le mousquet qu’il tenait à la main, et qu’il avait trouvé sur le rivage. Ossature de bois, long canon de métal, détente de métal, et chien muni d’un silex. Il brillait d’une lueur orangée, presque surnaturelle, dans la lumière du feu. Le canon du fusil jetait de tremblants reflets sur leurs visages, comme pour leur dire : « Je suis né, personne ne m’a fabriqué. »
Mais Delouest le montra du doigt.
— Oui. Comme ça. Cela demande moins de travail que n’importe lequel de vos paniers. Le métal vient de pierres broyées que l’on fait chauffer. Les pots et les moules qui servent à contenir le métal fondu sont eux aussi en métal ; mais en un métal plus dur, et qui ne fondra plus. Ou en terre. Même chose pour le canon : il suffit, pour l’obtenir, de faire couler du métal autour d’un bâton de métal solide. On fait chauffer le feu à l’aide de charbon et de houille ; la flamme est attisée par des soufflets. On peut aussi construire un moulin, dont la roue, grâce au courant d’un fleuve, fera se lever et s’abaisser un soufflet si puissant qu’une centaine d’hommes devraient travailler ensemble pour l’actionner.
Il commença alors à décrire un processus, dans sa langue natale. Un quelque chose faisait quelque chose qui actionnait un autre quelque chose. Il illustrait son propos en soufflant sur la braise d’une branche qu’il tenait devant sa bouche, jusqu’à ce qu’elle s’enflamme.
— Les soufflets sont comme des sacs en peau de daim, que l’on comprime de façon répétée à l’aide de mains de bois : des plaques en bois articulées à l’aide de charnières, dit-il en battant vigoureusement des mains. Ce mécanisme peut être actionné grâce au fleuve. D’ailleurs tout pourrait être fait très facilement en exploitant la force des eaux qui nous environnent. Le pouvoir du fleuve sera enfin vôtre. C’est vous qui commanderez à la puissance du Niagara. Vous pourrez faire des disques métalliques, à bords dentelés, et utiliser l’énergie du fleuve pour découper n’importe quel arbre comme si c’était une branche, en faire des planches, vous bâtir des bateaux, des maisons. La forêt couvre toute la moitié est de l’île de la Tortue, fit-il avec un large geste du bras. Des arbres en quantité infinie. Vous pourriez tout faire. De grands navires pour franchir les océans, afin d’apporter la guerre sur leurs propres terres. Tout. Vous pourriez voguer jusque chez eux, et demander aux habitants ce qu’ils préfèrent : être les esclaves d’un empereur, ou bien faire partie d’une grande congrégation de tribus ? Tout, je vous dis !
Delouest s’arrêta, le temps d’une autre bouffée. Le Gardien du Wampum profita de cette occasion pour dire :
— Tu ne parles que de guerres et de batailles. Mais les étrangers établis sur nos côtes se sont montrés amicaux, avides de nous connaître. Ils font du commerce, nous donnent des fusils contre des fourrures. Ils ne nous tirent pas dessus, ils n’ont pas peur de nous. Ils parlent de leur Dieu comme s’il ne nous concernait pas.
Delouest se frotta le menton.
— Et cela continuera, jusqu’au jour où vous vous réveillerez, et vous apercevrez qu’il n’y a autour de vous que des étrangers, dans vos vallées, avec des forts sur vos collines. Ils insisteront pour posséder la terre qu’ils cultivent et la revendiqueront comme si c’était leur propre pot à tabac, prêts à tirer sur tous ceux qui viendront y chasser, ou y couper un arbre. À ce moment-là, ils diront que leurs lois l’emportent sur les vôtres, parce qu’ils sont plus nombreux, et qu’ils ont plus de fusils. Alors ils auront des gardes armés en permanence, prêts à combattre pour eux, partout dans le monde. Vous serez contraints d’abandonner cette terre, et de partir vers le nord, laissant à jamais derrière vous ce pays, le plus haut qui soit en ce monde.
Il se redressa de toute sa taille et leva la main, afin que tous voient à quel point cette terre était haute. Beaucoup rirent en dépit de leur consternation. Ils l’avaient vu aspirer trois ou quatre profondes bouffées de la pipe, et ils avaient maintenant eux aussi fumé, au moins une fois. Alors ils savaient bien à quelle hauteur il planait. Il était parti et bien parti. C’était clair. Il se mit à parler comme s’il était très loin, perdu en lui-même, ou carrément dans les étoiles.
— Ils apporteront des maladies. Beaucoup d’entre vous mourront, terrassés par la fièvre, ou des affections surgies de nulle part, qui se répandront d’une personne à l’autre. La maladie vous détruira de l’intérieur, elle vous rongera de partout, comme le gui. De petits parasites, dans vos corps, de grands parasites, à l’extérieur, des gens qui vivent de votre travail alors même qu’ils sont de l’autre côté du monde, vous obligeant à travailler pour eux sous la menace de leurs fusils, et de leurs lois. Des lois pareilles au gui ! Tout ça pour garantir une vie de luxe à des empereurs, partout dans le monde. Et il y en aura tant qu’elles finiront par détruire tous les arbres de la forêt.
Il prit une profonde inspiration et remua la tête comme un jeune chiot pour chasser ce cauchemar.
— Parfait ! cria-t-il. Ainsi soit-il ! Vivez comme si vous étiez déjà morts ! Vivez comme si vous étiez des guerriers déjà faits prisonniers ! Vous ne comprenez pas ? Les étrangers sur vos côtes doivent être combattus, et refoulés dans un port, si vous pouvez. De toute façon la guerre viendra, quoi que vous fassiez. Mais plus tard elle viendra, mieux vous pourrez vous y préparer, et plus vous aurez de chances de la gagner. Défendre sa maison est plus facile que conquérir l’autre bout de la Terre, après tout. Donc nous pouvons réussir ! En tout cas, nous devons essayer, pour toutes les générations qui nous succéderont !
Encore une longue bouffée, suivie d’un nuage de fumée.
— D’où les fusils ! Des gros, des petits ! Et de la poudre. Des scieries. Des chevaux. Rien qu’avec ça, nous pouvons nous en sortir. Nous échangerons nos informations en tapant sur des troncs creux. Chaque sonorité de notre langue aura son équivalent sur le bois. Taper sur un tronc, c’est communiquer. C’est facile. On peut parler ainsi sans jamais s’arrêter, et sur de grandes distances, pendant de longs moments, quel que soit le lieu où se trouvent celui qui parle et celui qui écoute. Partout dans le monde des gens communiquent ainsi. Écoutez, votre île est isolée des autres par des mers si grandes que vous vivez dans un autre monde depuis l’aube des temps, depuis que le Grand Esprit a créé les gens. Mais à présent les autres arrivent ! Pour leur résister, vous n’avez que votre intelligence, votre imagination, votre courage, et les lois qui régissent vos nations, comme la trame et la chaîne de vos paniers. Grâce à elles, vous êtes beaucoup plus forts que n’importe quel boisseau de roseaux. Plus forts que des fusils !
Tout à coup, il leva les yeux, et cria en direction des étoiles de l’est :
— Plus forts que des fusils !
Vers l’ouest :
— Plus forts que des fusils !
Vers le nord :
— Plus forts que des fusils !
Et vers le sud :
— Plus forts que des fusils !
Beaucoup crièrent avec lui.
Il attendit que le silence revienne.
— Chaque nouveau chef a le droit de demander au conseil des sachems, réuni pour honorer son élévation, qu’on revoie certain point de politique. Je demande à présent aux sachems de bien vouloir considérer le problème des étrangers établis sur la côte est, et de les affronter, en exploitant la force des fleuves, en fabriquant des fusils, et en menant une campagne d’opposition totale à leur présence. Je demande aux sachems de privilégier notre puissance plutôt que nos affaires.
Il joignit les mains et se courba.
Les sachems se levèrent.
Le Gardien dit :
— Cela fait plusieurs requêtes. Mais nous prendrons la première en considération, sachant qu’elle inclut les suivantes.
Les sachems se réunirent par petits groupes et commencèrent à discuter, Broie-la-Roche parlant vivement, plaidant la cause de Delouest ; Iagogeh le voyait bien.
Pour une décision de cette importance, il fallait être des plus attentifs. Les sachems de chaque nation étaient divisés en sous-groupes de deux ou trois membres chacun, et ces sous-groupes s’entretenaient à voix basse, concentrés sur leurs propres paroles comme sur celles de leurs interlocuteurs. Une fois qu’ils avaient décidé quel était l’avis de leur sous-groupe, l’un d’eux allait retrouver les représentants des autres sous-groupes de sa nation – quatre pour les Portiers et les Marécageux. Ces derniers parlaient alors un moment entre eux, pendant que les sachems se consultaient en fumant la pipe. Enfin, un sachem par nation exprimait l’avis des siens aux sept autres, et ils confrontaient leurs points de vue.
Cette nuit-là, la conférence des huit représentants dura un long moment, si long que les gens finirent par se regarder les uns les autres, ne sachant que penser. Quelques années auparavant, au cours d’une conférence où avait été débattu le problème des étrangers établis sur la côte est, ils n’avaient pas réussi à se mettre d’accord, et aucune décision n’avait été prise. Volontairement ou non, Delouest avait évoqué le plus important des problèmes non résolus de ces derniers temps.
D’ailleurs, les événements semblaient se répéter. Keeper, le Gardien, demanda à faire une pause, et annonça au peuple :
— Les sachems se réuniront à nouveau demain matin. Le problème évoqué ce soir est trop important pour qu’on puisse prendre une décision cette nuit, et nous ne voulons pas surseoir plus longtemps aux festivités.
Une rumeur d’approbation parcourut la foule. Delouest s’inclina profondément face aux sachems et se joignit au premier groupe de danseurs, qui ouvrirent le bal en jouant avec des hochets en carapace de tortue. Il prit lui-même un de ces hochets et l’agita bizarrement autour de lui comme s’il s’agissait d’une crosse. Pourtant, ses mouvements étaient extraordinairement fluides et n’avaient rien à voir avec ceux des guerriers hodenosaunees en train de danser. Ces derniers semblaient donner des coups de tomahawk, extrêmement rapides et agiles, tout en sautant en l’air, le plus haut possible, sans cesser de chanter. Bientôt, des perles de sueur brillèrent sur leur peau, tandis que leur chant était ponctué des efforts qu’ils faisaient pour reprendre leur souffle. Delouest regardait, béat d’admiration, un large sourire sur le visage, ces gesticulations, tout en secouant la tête, l’air de dire que tout cela dépassait, et de loin, ses capacités. Alors, la foule, heureuse de voir enfin qu’il y avait quelque chose qu’il ne savait pas faire, se mit à rire et se joignit à la danse. Delouest se retira, dansant avec les femmes, à la façon des femmes, et la longue file des danseurs fit le tour du feu, puis du terrain de lacrosse, avant de revenir au feu. Delouest quitta la file et prit un peu de tabac dans sa blague. Il en plaça dans la bouche de chacune des personnes qui passaient devant lui, y compris Iagogeh et les autres danseuses, dont la grâce entraînante durerait plus longtemps que les sauts endiablés des guerriers.
— Le tabac des shamans, expliqua-t-il à chacun d’eux. Le don des shamans, pour danser.
Cela avait un goût amer, et beaucoup durent boire du sirop d’érable pour le faire passer. Les hommes et les femmes les plus jeunes continuèrent à danser, leurs membres se troublant à la lumière du brasier, plus lumineux et imposant qu’auparavant. Quant au reste de la foule, qu’ils fussent jeunes ou vieux, ils dansaient doucement çà et là, tout en se promenant, en commentant les événements de la journée. Beaucoup se regroupèrent autour de ceux qui regardaient la balle de lacrosse où Delouest avait dessiné le monde. Elle paraissait luire à la lumière du feu, d’un feu étrange et comme venu de l’intérieur.
— Delouest, demanda Iagogeh après un moment, qu’y avait-il dans ce tabac des shamans ?
— C’est une nation plus à l’ouest, où j’ai vécu, qui me l’a donné, répondit Delouest. Cette nuit, plus que les autres nuits, les Haudenosaunees ont besoin de partir en quête d’une vision, tous ensemble. Cela fait voyager l’esprit, comme tous les voyages. Cette nuit, tous partiront loin de la Longue-Maison, tous ensemble.
Il prit une flûte qu’on lui avait donnée, plaça ses doigts délicatement sur les trous, et joua une première séquence de notes, puis une gamme.
— Ha ! s’exclama-t-il, en la regardant de plus près. C’est parce que nos trous ne sont pas placés de la même façon. Qu’importe, je vais réessayer.
Il joua une musique si aiguë que tous se mirent à danser à son rythme, comme des oiseaux. Delouest grimaçait en jouant, puis son visage parut s’apaiser, et il joua, ayant enfin apprivoisé l’instrument.
Quand il eut terminé, il regarda de nouveau la flûte, et déclara :
— C’était « Sakura ». Ou en tout cas, la partition de « Sakura », mais ce n’était pas tout à fait le même morceau. Il ne fait aucun doute que tout ce que je peux vous dire sort de ma bouche également déformé, de même que vos enfants entendent vos paroles à leur façon, et les changent à leur tour. Ainsi, peu importe ce que j’aurai dit ce soir, ou ce que vous ferez demain.
Une des filles dansait en tenant un œuf peint en rouge, l’un de ses jouets, et Delouest se mit à la regarder, attiré par il ne savait quoi. Il regarda autour de lui, et ils virent que sa blessure à la tête avait recommencé à saigner. Ses yeux se révulsèrent et il s’effondra, comme frappé par la foudre, lâchant sa flûte. Il cria quelque chose dans une autre langue. La foule se calma, et ceux qui étaient le plus près de lui s’assirent à ses côtés.
— Cela s’est déjà produit, déclara-t-il d’une voix étrange, lente, grinçante. Ça y est ! Tout me revient !
Il poussa un léger cri, ou plutôt une plainte.
— Pas cette nuit, exactement recommencée, mais son reflet d’autrefois. Écoutez bien : nous vivons plusieurs vies. Nous mourons, puis nous revenons pour une autre vie, jusqu’à ce que nous ayons enfin bien vécu, et que tout se termine. Autrefois j’ai été un guerrier de Nippon – non, de Chine !
Il s’arrêta, se massant le front.
— Oui, de Chine. Et c’était mon frère, Peng. Il a traversé l’île de la Tortue, rocher par rocher, dormant dans les troncs, luttant même contre un ours dans sa tanière, faisant tout ce chemin jusqu’ici, là-haut. Il a atteint cet endroit précis, ce campement, cette maison du conseil. Il me l’a dit après notre mort.
Il poussa un glapissement, parut chercher du regard quelque chose à côté de lui, puis partit en courant vers la maison des ossements.
C’est là qu’étaient disposés les os des ancêtres, une fois blanchis par les oiseaux et les dieux, au cours d’une longue exposition du corps au soleil, sur un hamac de branchages. Ils étaient soigneusement rangés dans la maison des ossements, sous la colline, et ce n’était pas un endroit que les gens allaient voir pendant les fêtes. En vérité, ils n’y allaient presque jamais.
Mais les shamans étaient connus pour le courage avec lequel ils relevaient de tels défis, et la foule regarda les javelots de lumière qui saillaient par les fentes des murs d’écorce de la maison des ossements. La lumière bougeait au gré des mouvements de Delouest, qui promenait sa torche çà et là. C’est alors qu’un long cri sortit de sa bouche, cri qui devint hurlement, « Aaaaaaah ! », alors qu’il émergeait de la maison, éclairant de sa torche un crâne auquel il s’adressait dans son idiome natal.
Il s’approcha du feu et leur présenta le crâne.
— Regardez, c’est mon frère ! C’est moi !
Il plaça le crâne brisé à côté de sa tête, puis le plaça devant ses yeux, et se mit à regarder les orbites vides. Effectivement, la taille correspondait. Alors, la foule s’immobilisa, prête à l’écouter.
— J’ai quitté notre bateau sur la côte ouest, et j’ai pénétré vos terres, avec une fille. Droit vers l’est, vers le soleil levant. Je suis arrivé là juste au moment où vous étiez réunis pour un conseil, similaire à celui-ci, où vous discutiez les lois qui sont les vôtres aujourd’hui. Les cinq nations s’étaient disputées, et avaient été appelées par Daganoweda à tenir un conseil, afin de trouver comment mettre un terme aux combats qui troublaient ces paisibles vallées.
C’était vrai. C’était l’histoire de la façon dont les Haudenosaunees étaient nés.
— Daganoweda, je l’ai vu faire ! Il les rassembla, et leur proposa une ligue de nations, menée par des sachems, par ce système qui relie les tribus entre elles, et par les vieilles femmes. Et toutes les nations ont accepté. C’est ainsi que votre Ligue de paix est née, au cours de ce conseil de la première année, que l’on désigne encore comme celle du premier conseil. Il ne fait aucun doute que beaucoup d’entre vous y ont également assisté, dans l’une de leurs vies antérieures, ou peut-être vous trouviez-vous de l’autre côté du monde, en train d’assister à la construction de ce monastère où je devais grandir. Les voies de la renaissance sont étranges. Les voies sont étranges. J’étais là pour protéger vos nations des maladies que nous ne manquerions pas d’apporter. Je ne vous ai pas donné cette si magnifique façon de gouverner : c’est Daganoweda qui l’a fait, avec ceux d’entre vous qui étaient là, mais je n’en savais rien. Mais je vous ai tout appris de la gale. Il vous a apporté la gale, et vous a appris comment faire une entaille, y placer un peu de croûte, prendre un résidu de la gale qui s’y forme, et lui faire subir le même rituel que lors de la variole, le régime et les prières au dieu de la variole. Pour que nous puissions nous guérir nous-mêmes, sur cette Terre ! Et donc dans les cieux !
Il fit pivoter le crâne et plongea son regard dans ses orbites vides.
— Pauvre, pauvre Peng ! C’est toi qui as fait ça ! Et personne ne le savait ! Personne ne savait qui tu étais ! Personne ne se souvient de ce que j’ai fait, aucune trace n’en subsiste, sauf dans mon esprit, par intermittences, et dans la vie de tous ceux ici qui seraient morts si je n’avais rien fait. C’est cela, l’histoire des hommes, pas celle des empereurs, des généraux et de leurs guerres, mais les actes oubliés de personnes sans nom, et dont on ne parle jamais. Le bien que ces personnes font est comme une bénédiction, elles font à des étrangers ce que vos mères vous ont fait, et elles ne font jamais ce à quoi vos mères sont opposées. Et tout cela nous permet d’avancer, et d’être ce que nous sommes.
La suite de son discours se fit dans sa propre langue, et dura quelque temps. Mais tous le regardaient parler au crâne, qu’il caressait d’une main. Cette vision les tenait tous sous son charme, et quand il s’arrêtait pour écouter, émerveillé, le crâne lui répondre, il leur semblait également entendre le crâne parler, dans une langue faite de pépiements. Ils eurent ainsi plusieurs échanges, et tout à coup, Delouest pleura. Ce fut un choc de le voir se tourner de nouveau vers eux, pour leur parler, dans son curieux seneque :
— Le passé nous envoie ses reproches. Il y a tant de vivants ! Et nous changeons si lentement, oh, si lentement. Vous croyez que cela n’arrive pas, mais ces choses arrivent. Toi, Keeper…
Il se servit du crâne pour désigner le Gardien du Wampum.
— Tu n’aurais jamais pu devenir sachem, autrefois, quand je t’ai connu, ô mon frère. Tu étais trop en colère, mais maintenant tu ne l’es plus. Et toi…
Cette fois-ci, il montra Iagogeh, dont le cœur se mit à battre à toute allure.
— Tu n’aurais jamais su quoi faire de tes grands pouvoirs, ô ma sœur. Tu n’aurais jamais pu apprendre tant de choses au Gardien.
» Nous grandissons ensemble, ainsi que le Bouddha nous l’avait dit. Mais c’est seulement maintenant que nous le comprenons, et que nous sommes capables d’assumer ce fardeau. Vous avez le meilleur gouvernement qui soit sur Terre, jamais personne n’avait à ce point compris combien tous sont nobles, et font partie de la même Conscience Unique. Mais c’est également un fardeau, voyez-vous ? Il vous faut le porter – tous les non-nés appelés à renaître dépendent de vous ! Sans vous, le monde deviendrait un cauchemar. Le jugement des ancêtres…
Il promena alors le crâne autour de lui comme s’il s’agissait d’une pipe à faire tourner, en faisant des gestes furieux en direction de la maison des ossements. Sa blessure saignait abondamment maintenant, et il pleurait, pleurait à chaudes larmes, et la foule le regardait bouche bée, voyageant avec lui dans l’espace sacré des shamans.
— Toutes les nations de cette île sont composées de vos futurs frères, de vos futures sœurs. Voici comment vous devriez les accueillir. Bonjour, futur frère ! Comment vas-tu ? Ils sauraient que votre âme est la leur. Ils s’uniraient à vous si vous vous comportiez comme leurs frères aînés, qui les guideraient sur le chemin. Les luttes entre frères et sœurs cesseraient. Nation après nation, tribu après tribu, la Ligue des Hodenosaunees grandirait. Quand les étrangers arriveront dans leurs canoës pour vous prendre vos terres, vous les affronterez unis, vous leur résisterez, et saurez prendre d’eux ce qui peut servir et rejeter ce qui est néfaste. Vous leur montrerez que sur cette Terre nous sommes tous égaux. Je vois maintenant ce qui va se passer dans un futur proche, je le vois ! Je le vois ! Je le vois ! Je le vois ! Les personnes que je vais être sont en train de rêver et me parlent par l’au-delà des temps, elles s’expriment à travers moi, pour me dire que tous dans le monde regarderont les Hodenosaunees, émerveillés par la justice de leur gouvernement. L’histoire passera de Longue-Maison en Longue-Maison. Partout où des gens souffrent sous le joug d’un chef, on parlera des Hodenosaunees, et on se racontera comment les choses pourraient être, si l’on partageait tout, si chaque homme avait l’occasion, et le droit, de participer à la vie des choses, s’il n’y avait pas d’esclaves, ni d’empereurs, pas de conquêtes ni de soumissions, si les gens étaient comme des oiseaux dans le ciel. Comme des aigles dans le ciel ! Oh, faites que cela vienne, oh, faites que ce jour arrive, oh, ooooohhhhhhhh…
Delouest s’arrêta soudain, pour reprendre son souffle. Iagogeh s’approcha de lui et lui mit un vêtement autour de la tête, afin d’épancher le sang qui suintait de sa blessure. Il était trempé de sueur et de sang. Il la regarda sans la voir, puis leva les yeux vers le ciel étoilé, et dit « Ah ! », comme si les étoiles étaient des oiseaux, ou bien le clignotement d’âmes attendant de naître. Il regarda le crâne comme s’il se demandait comment il était arrivé là, dans sa main. Il le tendit à Iagogeh, qui le prit. Il s’avança vers les plus jeunes guerriers, et chanta, faiblement, les premières paroles d’un de leurs chants. Cela libéra les hommes du sort qui les tenait sous son charme, et ils bondirent sur leurs pieds, au son des tambours et des hochets dont on se remettait à jouer. Bientôt, on dansa autour du feu.
Delouest récupéra le crâne des mains de Iagogeh. Elle eut l’impression de lui donner sa tête. Il repartit, lentement, vers la maison des ossements, titubant comme un ivrogne, se perdant dans la nuit à chacun de ses pas hésitants. Il entra dans la pièce sans prendre de torche. Quand il en ressortit, il ne tenait plus rien, mais s’empara d’une flûte, et s’en alla jouer avec les autres musiciens, improvisant joyeusement, sans mélodie précise. Iagogeh s’insinua dans la danse, et quand elle passa près de lui, l’attira dans la file des danseurs, où il la suivit.
— C’était bien, dit-elle. C’était une très belle histoire que tu nous as racontée.
— Vraiment ? demanda-t-il. Je ne m’en souviens pas.
Elle n’était guère surprise.
— Tu étais parti. Un autre Delouest parlait à travers toi. C’était une bonne histoire.
— Est-ce l’avis des sachems ?
— Nous leur dirons de le penser.
Elle le mena à travers la foule, le plaçant à côté de telle ou telle fille, afin de voir s’ils allaient bien ensemble. Delouest ne réagit à aucune de ses tentatives, continuant à danser et à souffler dans sa flûte, regardant vers le sol ou vers le feu. Il paraissait vidé, diminué, et après quelques danses supplémentaires, Iagogeh l’emmena loin du feu. Il s’assit, jambes croisées, jouant de la flûte les yeux fermés, ajoutant des notes enthousiastes à la musique.
Peu avant l’aube, le feu mourut, se transformant en un amas de cendres grises, où quelques braises rougeoyaient encore. La plupart des gens étaient allés dormir dans la Longue-Maison des Onondagas, tandis que d’autres s’étaient endormis dehors, sur une couverture étendue à même l’herbe, sous les arbres. Ceux qui ne dormaient pas s’étaient rassemblés autour du feu, chantonnant ou se racontant des histoires, attendant l’aube, tout en jetant de temps à autre une branche dans le brasier, pour la voir s’enflammer puis se consumer.
Iagogeh se promenait sur le terrain de lacrosse, épuisée, mais sentant encore dans ses membres vibrer le plaisir de la danse et du tabac. Elle chercha Delouest, ne le trouva pas, ni dans la Longue-Maison, ni dans la prairie, ni dans la forêt, ni dans la maison des ossements. Elle commença à se demander si cette merveilleuse visite n’avait pas été un rêve qu’ils auraient fait ensemble.
À l’est, le ciel se teintait de gris. Iagogeh se dirigea alors vers le lac, à l’endroit des femmes, derrière une avancée de terre couverte d’arbres. Elle voulait profiter du fait qu’il n’y avait encore personne pour faire sa toilette. Elle retira tous ses vêtements, à l’exception de son linge de corps, puis s’avança dans le lac jusqu’à avoir de l’eau en haut des cuisses, et commença à se laver.
C’est alors qu’elle vit quelque chose bouger, de l’autre côté du lac. Une tête noire glissait à la surface de l’eau, comme celle d’un castor. Delouest, se dit-elle. Il nageait, comme un castor, ou comme une otarie. Peut-être était-il redevenu animal ? L’eau se plissait devant lui au fur et à mesure de sa progression, venant mourir en vaguelettes sur le ventre de Iagogeh. Delouest respirait comme un ours.
Elle resta un moment sans bouger, puis quand il eut de nouveau pied, non loin de l’avancée de terre, elle se tourna vers lui et le regarda. Il la vit, et s’immobilisa. Il ne portait que sa ceinture, comme pendant la partie. Joignant les mains, il la salua profondément. Alors elle sortit de l’eau, marcha vers lui, d’abord sur un fond de sable, puis dans la boue.
— Viens, lui dit-elle doucement. J’ai choisi pour toi.
Il la regarda calmement. Il paraissait beaucoup plus âgé que la veille.
— Merci, répondit-il.
Il dit encore autre chose, mais dans sa langue à lui. Un nom, se dit-elle. Son nom à elle.
Ils regagnèrent le rivage. Iagogeh heurta une racine, et s’appuya avec le plus de dignité possible sur l’avant bras de Delouest pour s’aider à marcher. Sur la rive, elle se sécha avec les doigts puis se rhabilla, tandis que Delouest, parti chercher ses propres vêtements, faisait de même. Côte à côte, ils marchèrent jusqu’au feu, passèrent à côté de ceux qui avaient guetté l’aube, et maintenant ronflaient, lovés les uns contre les autres. Iagogeh s’arrêta devant l’un de ces corps. Il s’agissait de Tecarnos. Ce n’était plus une jeune fille, mais une jeune femme, qui n’était toujours pas mariée. Pleine d’esprit, la langue bien pendue, drôle, intelligente. Comme elle dormait, on ne pouvait pas s’en rendre compte, mais l’une de ses jambes sortait avec grâce de sous sa couverture, sous laquelle se devinaient ses formes robustes.
— Tecarnos, dit Iagogeh, doucement. Ma fille. La fille de ma sœur aînée. De la tribu du Loup. C’est une femme bonne. On peut compter sur elle.
Delouest hocha la tête en la regardant, les mains toujours jointes devant lui.
— Je te remercie.
— J’en parlerai aux autres femmes. Nous le dirons à Tecarnos, et aux hommes.
Il sourit, regarda autour de lui, paraissant voir à travers chaque chose. Sa blessure à la tête était à vif, et saignait abondamment, d’un sang mêlé d’eau. Le soleil perça à travers les arbres, et des chants s’élevèrent non loin des feux, de plus en plus fort.
— Ensemble, vous donnerez naissance à de nombreuses bonnes âmes, dit-elle.
— Espérons-le.
Elle posa la main sur son bras, comme elle l’avait fait en sortant de l’eau.
— Tout peut arriver, mais nous (que voulait dire ce nous ? voulait-elle parler d’eux, des femmes, ou des Hodenosaunees ?), nous ferons de notre mieux. C’est tout ce qu’on peut faire.
— Je sais.
Il regarda la main posée sur son bras, et le soleil dans les arbres.
— Peut-être que tout ira bien.
Iagogeh, qui nous a raconté cette histoire, a vu ces choses par elle-même.
C’est ainsi que, bien des années plus tard, les membres de la jati furent de nouveau réunis dans le bardo. Ils avaient réussi à repousser les étrangers établis à l’embouchure du fleuve de l’Est, survécu à toutes les nouvelles maladies qui les avaient frappés, s’étaient alliés avec le peuple de Delouest, ils avaient rassemblé toutes les nations et vécu heureux dans la forêt. Après toutes ces années, donc, Delouest s’approcha de Keeper et lui dit fièrement :
— Tu dois bien l’admettre, j’ai fait ce que tu m’avais demandé. Je suis allé dans le monde et je me suis battu pour le bien ! Nous avons à nouveau fait le bien !
Keeper mit la main sur l’épaule de son jeune frère alors qu’il approchait de la monumentale estrade du jugement, et répondit :
— Oui, petit gars ! Tu as fait ce qu’il fallait. Nous avons fait ce que nous pouvions.
Mais il regardait déjà vers l’avant, vers les énormes tours et les créneaux du bardo. Il regardait vers l’avant avec méfiance, insatisfait, concentré sur les tâches qui l’attendaient. Tout dans le bardo semblait être devenu encore plus chinois que lors de leur précédent passage, comme tous les autres royaumes, peut-être. Mais peut-être aussi n’était-ce qu’une coïncidence due à la perspective sous laquelle ils s’en approchaient. La grande muraille de l’estrade était divisée en dizaines et en dizaines de niveaux, qui menaient dans des centaines de chambres, de sorte qu’on aurait dit une ruche.
Le dieu fonctionnaire à l’entrée de ce labyrinthe, un certain Biancheng, distribuait le programme des réjouissances qui les attendaient plus haut, de gros volumes de plusieurs centaines de pages, intitulés Le Registre de Jade, pleins d’instructions détaillées, avec des descriptions, abondamment illustrées, des divers châtiments qu’ils pouvaient s’attendre à subir pour les crimes et les affronts commis dans leurs vies les plus récentes.
Keeper prit l’un de ces gros volumes et, sans hésitation, le brandit comme un tomahawk, assommant Biancheng, qui s’écroula sur son bureau couvert de papiers. Puis il regarda autour de lui, les longues files d’âmes qui attendaient d’être jugées, et vit qu’elles le regardaient, stupéfaites. Il leur cria :
— Rébellion ! Révolte ! Révolution !
Et sans attendre de voir ce qu’elles allaient faire, il mena sa petite jati à une salle des miroirs, la première pièce de la longue traversée qui les mènerait au jugement, où les âmes devaient contempler ce qu’elles étaient vraiment.
— Bonne idée, admit Keeper après s’être arrêté au milieu de la salle et s’être regardé dans un miroir pour voir ce que personne d’autre ne pouvait voir. Je suis un monstre, annonça-t-il. Mes excuses à vous tous. Et surtout à toi, Iagogeh, pour avoir dû me supporter la dernière fois, et toutes les autres fois auparavant. Et à toi, petit gars, dit-il avec un signe de tête en direction de Busho, qu’il avait connu sous le nom de Delouest. Enfin, nous avons du pain sur la planche. J’ai l’intention de mettre cet endroit en pièces.
Et il commença à parcourir les lieux du regard, à la recherche de quelque chose à jeter sur les miroirs.
— Attends ! fit Iagogeh en feuilletant rapidement son exemplaire du Registre de Jade. Les attaques directes sont inefficaces, si je me souviens bien. Ça me rappelle quelque chose… Nous devons nous attaquer au système proprement dit. Nous avons besoin de quelque chose de plus subtil… Là. C’est bien ça : juste avant qu’on nous renvoie dans le monde, la déesse Meng nous administre une fiole d’oubli.
— Je ne m’en souviens pas, dit Keeper.
— Exactement. Chaque fois que nous entrons dans une nouvelle vie, nous oublions notre passé, et nous devons chaque fois nous battre sans avoir rien retenu des expériences précédentes. Nous devons éviter cela si possible. Alors, écoutez, et retenez bien ce que je vous dis : quand vous serez dans les cent huit chambres de cette Meng, ne buvez rien ! Si on vous y oblige, alors faites semblant, et recrachez tout quand on vous libérera. (Elle poursuivit sa lecture.) Nous émergerons dans le Fleuve Ultime, un fleuve de sang, entre ce royaume et le monde. Si nous pouvions y arriver la mémoire intacte, alors nous agirions plus efficacement.
— Très bien, répondit Keeper. Mais j’ai l’intention de foutre en l’air cet endroit.
— Rappelle-toi ce qui s’est passé la dernière fois que tu as essayé, l’avertit Busho en se plaçant dans le coin de la pièce, afin d’étudier les jeux de reflets. Quand tu as levé l’épée sur la Déesse de la Mort, et qu’elle t’a fait payer chaque coup.
Certaines choses lui revenaient, comme l’avait dit Iagogeh.
Keeper se renfrogna, essaya de se rappeler. Au-dehors, on entendait des gens crier, pousser des rugissements, tirer des coups de feu, courir avec de lourdes bottes. Irrité, distrait, il lança :
— On ne peut pas faire preuve de prudence en de pareils moments. Il faut combattre le mal chaque fois qu’on en a l’occasion.
— C’est vrai, mais il faut le faire intelligemment. À petits pas.
Keeper le regarda avec scepticisme. Il fit un cercle avec son pouce et son index et le leva en l’air.
— Aussi petits que ça ?
Il prit le livre de Iagogeh et le lança contre l’un des murs de miroirs, qui vola en éclats. Un cri s’éleva, de l’autre côté des miroirs brisés.
— Arrête de discuter, dit Iagogeh. Maintenant, fais attention.
Keeper alla récupérer le livre et ils traversèrent en courant une enfilade de pièces fermées, de plus en plus hautes, ils redescendirent, puis remontèrent. Ils n’arrêtaient pas de monter et de descendre des escaliers, dont les volées de marches étaient des multiples de sept ou de neuf. Keeper tapa sur plusieurs fonctionnaires avec le gros livre. Broie-la-Roche n’arrêtait pas de se faufiler dans des pièces latérales et de se perdre.
Ils finirent par arriver aux cent huit chambres de Meng, la Déesse de l’Oubli. Chacun devait passer par une chambre différente et boire la coupe de vin-qui-n’était-pas-du-vin préparée pour lui. Des gardes dont on avait l’impression qu’un coup de livre, si gros soit-il, les laisserait indifférents se dressaient à chaque sortie pour faire appliquer la consigne ; les âmes n’étaient pas censées regagner la vie trop pénalisées ou avantagées par leur passé.
— Je refuse ! hurla Keeper, qu’ils entendirent tous dans les pièces voisines. Je ne me rappelle pas qu’on ait exigé ça de moi les fois précédentes !
— C’est parce que nous avançons ! lui cria Busho. Rappelle-toi le plan ! Rappelle-toi le plan !
Il prit lui-même sa fiole, qui était assez petite, heureusement, et fit semblant d’en avaler le contenu en déglutissant avec un bruit exagéré, gardant le liquide sucré sous sa langue. C’était si bon qu’il eut de la peine à ne pas l’avaler tout rond, mais il résista et n’en laissa que très peu couler dans son gosier.
C’est ainsi que lorsque le garde le jeta dans le Fleuve Ultime, avec les autres, il recracha ce qu’il put du non-vin, mais fut quand même désorienté. Les autres membres de la jati se débattirent de la même façon dans les hauts-fonds, crachant et hoquetant. Flèche-de-Tout riait comme une femme soûle, ayant tout oublié. Iagogeh les rassembla et Keeper, quoi qu’il ait pu oublier, n’avait pas perdu de vue son but principal, qui était de faire autant de dégâts que possible. Mi-nageant, mi-flottant, ils traversèrent le fleuve rouge et arrivèrent à la rive opposée.
Alors, au pied d’un grand mur rouge, ils furent tirés du fleuve par deux dieux démons du bardo, La-Vie-Est-Courte et Mort-À-Petit-Feu. Une banderole pendait le long du mur au-dessus de leurs têtes. Il y était écrit : « Il est facile d’être un être humain, difficile de vivre une vie humaine ; vouloir être humain est encore plus difficile la deuxième fois. Si vous voulez échapper à la roue, persévérez. »
Keeper lut le message et ronchonna.
— La deuxième fois ! Et la dixième ? Et la cinquantième ?
Il se mit à rugir et poussa Mort-À-Petit-Feu dans les flots de sang. Ils avaient recraché suffisamment du non-vin d’oubli de Meng dans le fleuve pour que le dieu gardien oublie rapidement qui l’y avait jeté, quel était son travail, et comment on nageait.
Mais les autres membres de la jati virent ce que Keeper avait fait, et le plan leur revint encore plus clairement à la conscience. Busho jeta l’autre garde dans le fleuve.
— Justice ! hurla-t-il au nageur qui avait soudain tout oublié. La vie est courte, c’est bien vrai !
D’autres gardes apparurent en amont, sur la rive du Fleuve Ultime, et coururent vers eux. Les membres de la jati réagirent rapidement, et pour une fois tous ensemble. Ils arrachèrent la banderole et la tordirent pour en faire une sorte de corde, avec laquelle ils se hissèrent sur la Muraille Rouge. Busho, Keeper, Iagogeh, Broie-la-Roche, Flèche-de-Tout, Zigzag et tous les autres grimpèrent en haut du mur, qui était assez large pour qu’ils puissent s’y allonger. Là, ils purent reprendre leur souffle et jeter un coup d’œil autour d’eux : en bas, dans le bardo noir et enfumé, un combat encore plus chaotique que d’habitude avait éclaté. On aurait dit qu’ils avaient provoqué une révolte générale. De l’autre côté, tout en bas, de gros nuages flottaient au-dessus du monde.
— Ça me rappelle la fois où ils ont emmené Bouton d’Or en haut de la montagne pour la sacrifier, remarqua Keeper. Je m’en souviens, maintenant.
— Là-bas, nous pourrons faire quelque chose de nouveau, dit Iagogeh. Tout dépend de nous. Rappelez-vous !
Et ils se laissèrent tomber au pied du mur comme des gouttes de pluie.
LIVRE 6
LA VEUVE KANG
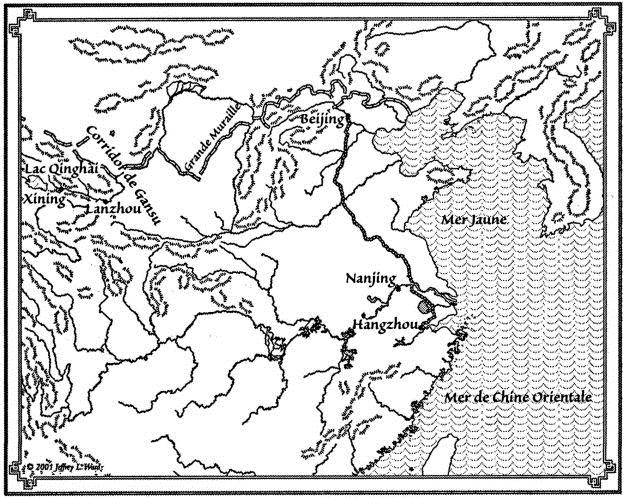
1. L’affaire du voleur d’âmes
La veuve Kang se montrait on ne peut plus sourcilleuse quant aux aspects protocolaires de son veuvage. Elle se présentait comme la wai-wang-ren, « celle qui n’est pas encore morte ». Quand ses fils voulurent fêter son quarantième anniversaire, elle refusa.
— Cela ne siérait pas à celle qui n’est pas encore morte, leur dit-elle.
Veuve à l’âge de trente-cinq ans, juste après la naissance de son troisième fils, elle avait sombré dans un profond désarroi. Elle avait adoré son mari, Kung Xin. Elle avait néanmoins rejeté l’idée du suicide, trop ming à son goût. En ce qui la concernait, le dogme confucéen était parfaitement clair à ce sujet : se suicider, c’était fuir ses responsabilités, et s’en défausser sur ses enfants et ses beaux-parents, ce qui était hors de question. En fait, la veuve Kang Tongbi était déterminée à rester célibataire jusqu’après ses cinquante ans. Elle écrirait de la poésie, lirait les classiques, et s’occuperait du domaine familial. À cinquante ans, elle aurait enfin droit au certificat de chaste veuvage, un diplôme rédigé dans l’élégante calligraphie de l’empereur Qianlong. Elle le ferait encadrer, et le placerait à l’entrée de sa maison. Il se pourrait même que ses trois fils lui fassent alors construire une arche d’honneur en pierre.
Ses deux fils aînés parcouraient le pays, au service de l’administration impériale. Elle élevait le plus jeune tout en s’occupant de leur maison de famille, à Hangzhou, où ne restaient plus que son fils Shih et les serviteurs que ses fils aînés y avaient laissés. Elle surveillait l’élevage de vers à soie qui constituait la principale source de revenus de la famille, ses aînés ne pouvant pas encore se permettre d’envoyer trop d’argent à la maison. L’ensemble du processus de fabrication de la soie, de la filature à la broderie, était sous sa responsabilité. Un magistrat de district n’aurait pas dirigé ses affaires d’une main plus ferme. En cela aussi, elle respectait les préceptes han, selon lesquels le travail des femmes dans les meilleures maisonnées – où l’on tissait généralement le chanvre ou la soie – était déjà considéré comme une vertu, bien avant que la politique des Qing n’en fasse publiquement la promotion.
La veuve Kang vivait dans le quartier des femmes de leur petit domaine, situé au bord du Chu. Les murs extérieurs étaient revêtus de stuc, les murs intérieurs de bardeaux de bois. Le quartier des femmes, qui se trouvait au cœur de la propriété, était un magnifique bâtiment blanc, carré, au toit de tuiles et plein de lumière et de fleurs. Dans ce bâtiment, et dans les ateliers adjacents, la veuve Kang et les filles tissaient et brodaient quelques heures chaque jour, et parfois beaucoup plus – quand la lumière le permettait. Le plus jeune fils de la veuve Kang leur récitait des extraits des classiques qu’il avait appris par cœur, ainsi que sa mère le lui avait ordonné. Elle travaillait au métier à tisser, faisant aller et revenir la navette. Le soir, soit elle filait, soit elle continuait une grande broderie, tout en faisant apprendre à Shih des passages des Analectes, ou de Mencius. Souvent, elle le reprenait sur tel ou tel point, insistant pour qu’il sache parfaitement ses leçons, comme le feraient, en temps voulu, les examinateurs. Le petit Shih n’était pas un élève très doué, même en comparaison de ses aînés – qui avaient été tout juste passables –, et il finissait souvent la soirée en larmes ; mais la veuve Kang Tongbi se montrait impitoyable. Elle attendait qu’il arrête de pleurer, puis lui demandait de reprendre ses leçons. À force, il finit par s’améliorer. Mais c’était un petit garçon nerveux, et malheureux.
Tant et si bien que nul ne se réjouissait plus que lui quand la routine de la maisonnée était rompue par les fêtes. Chacun des trois anniversaires de la Bodhisattva Guanyin était un jour férié très important pour sa mère, spécialement le principal, le dix-neuvième jour du sixième mois. Quand cette fête approchait, la veuve se montrait un peu moins sévère, et vaquait à ses occupations : lectures de circonstance, écriture de poèmes, distribution d’encens et de nourriture pour les femmes pauvres du quartier ; tout cela en plus de ses travaux habituels. À l’approche du grand jour, elle se dépêchait et ne faisait plus rien d’impur, comme se mettre en colère. Les leçons du petit Shih s’arrêtaient alors pendant quelques jours, et elle se rendait à la chapelle du domaine, pour y faire des sacrifices.
Le vieux dans la lune nous attachait des fils rouges
Aux jambes quand nous étions bébés.
Nous nous sommes rencontrés et mariés.
Et te voilà parti.
La vie s’enfuit et coule comme de l’eau ;
La mort nous a brutalement séparés,
Tellement d’années sont passées.
Les yeux brûlants de larmes, je vois un automne précoce approcher.
Celle qui n’est pas encore morte n’est que le rêve,
Le songe, d’un lointain fantôme. Vole une grue, tombe une fleur ;
Seule, si seule, et désespérée.
Je laisse ma broderie,
Vais dans la cour, pour y compter les oies.
Elles ont perdu leurs petits.
Puisse Bodhisattva Guanyin
M’aider à traverser l’hiver de ces dernières années.
Au matin du jour tant attendu, tout le monde jeûna. Et puis, dans la soirée, tout le monde se joignit à l’immense procession, là-haut sur la colline, en emportant un peu de bois de santal dans un sac en tissu, des bannières tournoyantes, des ombrelles, et des lanternes en papier. Chacun suivait le drapeau de sa congrégation et la grande torche de suif qui montrait la voie et chassait les démons. Pour Shih, entre l’excitation de cette procession nocturne et la joie de ne pas avoir de leçons, c’était comme de grandes vacances ! Il marchait derrière sa mère en balançant sa lanterne en papier, en chantant des chansons, enfin heureux.
— Miao Shan était une jeune fille qui refusait de se marier, comme le lui ordonnait son père, disait sa mère aux jeunes filles qui marchaient devant elle.
Elles avaient déjà entendu plusieurs fois cette histoire, mais qu’importe, la veuve Kang continuait :
— Fou de colère, il la fit enfermer dans un monastère, et le brûla. Un bodhisattva, Dizang Wang, emmena son esprit à la Forêt des Corps, afin qu’elle s’occupe des fantômes des morts sans sépulture. Ensuite, elle explora tous les niveaux des enfers, pour y apprendre aux esprits à dépasser leurs souffrances. Elle y arriva si bien que le Seigneur Yama la réincarna en Bodhisattva Guanyin, pour qu’elle enseigne toutes ces bonnes choses aux vivants, avant qu’il ne soit trop tard.
Shih n’écoutait pas cette histoire tellement rabâchée dont il n’arrivait pas à comprendre le sens. Cela n’avait aucun rapport avec la vie de sa mère, et il ne voyait pas pourquoi elle y accordait tant d’importance. Les chants, les feux de joie, la forte odeur des bâtons d’encens, tout cela montait vers la chapelle au sommet de la colline. Là-haut, le prêtre de Bouddha dirigea la prière, puis on chanta, en mangeant des sucreries.
Bien après l’apparition de la lune, ils redescendirent de la colline et suivirent la berge de la rivière, continuant à chanter dans la nuit venteuse. Les employés de la maisonnée marchaient lentement, pas seulement à cause de la fatigue, mais aussi pour ne pas devancer la veuve Kang, qui cheminait à tout petits pas. Elle avait des pieds magnifiques, minuscules, et pourtant elle se déplaçait d’habitude aussi bien que les servantes aux grands pieds plats, d’une démarche claudicante, accompagnée d’un déhanchement caractéristique qui lui donnait une allure que personne ne se serait jamais permis de commenter.
Shih prit de l’avance, protégeant d’une main la flamme vacillante de sa bougie presque éteinte. Soudain, il aperçut dans un tremblement de lumière comme un mouvement devant le mur de leur propriété : une grande ombre noire, avançant de la même démarche chancelante que sa mère, de telle sorte qu’il crut pendant un instant que c’était elle.
Mais l’ombre se mit à gémir à la façon d’un chien, et Shih fit un bond en arrière, criant pour prévenir les autres. Tous se ruèrent vers lui, Kang Tongbi la première, et virent un homme vêtu de haillons, hirsute, recroquevillé, qui les regardait en ouvrant de grands yeux, à la lumière de leurs torches.
— Au voleur ! cria quelqu’un.
— Non ! dit-il d’une voix mal assurée. Je m’appelle Bao Ssu. Je suis un moine bouddhiste de Suzhou. Je voulais juste prendre un peu d’eau à la rivière. Je l’entends…
Il fit un geste et se dirigea vers le fleuve en boitillant.
— Un mendiant ! chevrota quelqu’un d’autre.
Mais comme on avait vu des sorciers à l’ouest de Hangzhou, la veuve Kang approcha sa lanterne pour l’examiner, si près qu’il se mit à loucher.
— Es-tu vraiment un moine, ou l’un de ces êtres chevelus qui se cachent dans leurs temples ?
— Un vrai moine, je le jure. J’avais un certificat, mais il m’a été pris par le magistrat. J’étais l’étudiant de Maître Yu, du Temple du Bosquet de Bambou Pourpre.
Il commença alors à réciter le soutra du Diamant, qui était le préféré des femmes d’un certain âge.
Kang examina attentivement son visage, en promenant sa lanterne autour de sa tête. Puis elle se mit à trembler, et recula d’un pas. Le connaîtrais-je ? se demanda-t-elle.
Elle lui lança :
— Je te connais !
Le moine baissa la tête.
— Je ne vois pas comment, madame. Je viens de Suzhou. Peut-être y êtes-vous déjà venue en voyage ?
Elle secoua la tête, toujours embêtée, le regardant droit dans les yeux.
— Je te connais, murmura-t-elle.
Puis elle se tourna vers les servantes et leur dit :
— Laissez-le dormir à côté du portail de service. Veillez sur lui, on verra le reste demain matin. Il fait de toute façon beaucoup trop sombre maintenant pour que l’on puisse juger de la nature d’un homme.
Au petit matin, l’homme avait été rejoint par un gamin, qui avait quelques années de moins que Shih. Tous deux étaient très sales, et fouillaient dans les ordures, à la recherche de quelques restes pas trop avariés, qu’ils dévoraient voracement. Quand les membres de la maisonnée ouvrirent le portail, ces malheureux les regardèrent, aux aguets, comme des renards. Mais ils ne pouvaient pas s’enfuir : les chevilles de l’adulte étaient anormalement enflées et couvertes d’ecchymoses.
— Pourquoi as-tu été torturé ? cria Kang d’une voix aiguë.
L’homme hésita, regardant le garçon.
— Mon fils et moi voyagions pour rentrer au Bosquet de Bambou Pourpre, quand un jeune garçon s’est fait couper la queue…
Kang laissa échapper un sifflement entre ses dents, mais l’homme la regarda droit dans les yeux, une main levée.
— Nous ne sommes pas des sorciers. C’est pourquoi on nous a laissés passer. Je m’appelle vraiment Bao Ssu, quatrième fils de Bao Ju. Un mendiant qu’ils avaient attrapé car il avait jeté un mauvais sort au chef du village a été soumis à la question, et leur a dit qu’il connaissait un sorcier nommé Bao Ssu-Ju. Ils ont cru que c’était moi. Mais je ne suis pas un voleur d’âmes. Je ne suis qu’un pauvre moine, avec son fils. Pour finir, ils ont réinterrogé le mendiant, et celui-ci a avoué qu’il avait tout inventé, pour qu’on arrête de le torturer. Ils nous ont donc laissés partir.
Kang le regardait, toujours aussi méfiante. Il était bien connu qu’il ne fallait en aucun cas se mêler des affaires des magistrats ; ce qui faisait au moins une chose dont ils s’étaient rendus coupables.
— Est-ce qu’ils t’ont torturé toi aussi ? demanda Shih au garçon.
— Ils allaient le faire, répondit le garçon. Mais à la place, ils m’ont donné une poire, et je leur ai dit que le nom de Père était Bao Ssu-Ju. Je pensais bien faire.
Bao continuait de regarder la veuve.
— Cela vous gênerait-il si nous prenions de l’eau à la rivière ?
— Non. Bien sûr que non. Allez-y.
Elle le regarda, pendant qu’il descendait en boitillant le long du chemin qui menait au fleuve.
— Nous ne pouvons pas les laisser entrer, décida-t-elle. Quant à toi, Shih, reste éloigné d’eux. Mais ils pourront rester dans la petite chapelle du portail. Puisque l’hiver approche, ça sera toujours mieux que la route, enfin, je pense.
Cela ne surprit guère Shih. Sa mère passait son temps à adopter des chats abandonnés ou des concubines répudiées ; elle donnait de l’argent à l’orphelinat de la ville, et rognait encore leur budget en entretenant les nonnes bouddhistes. D’ailleurs, elle envisageait souvent d’en devenir une. Elle écrivait de la poésie : « Ces fleurs, sur lesquelles j’ai marché, blessent mon cœur », récitait-elle parfois. « Quand mes années de riz et de sel seront terminées, disait-elle, je copierai les soutras et prierai toute la journée. En attendant, il n’y pas un instant à perdre : au travail ! »
Ainsi, le moine Bao et son fils étant devenus, en quelque sorte, les gardiens du portail, on les voyait se promener quelquefois, non loin de la rivière, dans les bosquets de bambous, ou bien dans la petite chapelle cachée dans la forêt, toute proche. Bao continua à clopiner, même s’il marchait mieux que la nuit où on l’avait trouvé, lors de la fête de Guanyin. Ce qu’il ne pouvait pas faire, son fils, Xinwu, qui était très fort pour son âge, le faisait pour lui. L’année suivante, quand la fête revint, Bao s’arrangea pour trouver quelques œufs, qu’il peignit en rouge, de façon à en faire cadeau à Kang, à Shih, et aux autres membres de la maisonnée.
(C’était une coutume du sud de la Chine, appelée « beaucoup de bonheur pour la nouvelle année ». Il n’est pas impossible que l’auteur ait cherché à indiquer que le moine Bao avait menti au sujet de l’endroit d’où il venait.)
Bao leur offrit ces œufs avec beaucoup de sérieux :
— Ge Hong raconte que le Bouddha a dit que le cosmos était en forme d’œuf, et que la Terre était comme le jaune à l’intérieur. Tiens, prends-le bien dans ta main, et essaye de l’écraser, dit-il à Shih en lui donnant un œuf. Shih parut surpris, et Kang objecta :
— Pourquoi ? Il est tellement joli.
— Ne vous inquiétez pas, c’est solide. Allez, essaye de l’écraser. Si tu y arrives, je nettoierai.
Shih serra le poing doucement, en détournant le visage, puis serra plus fort. Il serra à en avoir l’avant-bras engourdi. L’œuf résistait. La veuve Kang le lui prit et essaya à son tour. Elle avait beaucoup de force dans les bras, à cause du métier à tisser, mais l’œuf ne se brisa pas.
— Vous voyez, dit Bao. Une coquille d’œuf est très fragile, mais l’œuf lui-même est solide. Les gens sont comme ça, eux aussi. Séparément, ils sont faibles ; mais tous ensemble, ils sont forts.
Par la suite, les jours de fêtes religieuses, Kang allait souvent retrouver Bao à l’extérieur du portail, pour discuter avec lui tel ou tel point des écrits bouddhiques. Le reste du temps, elle faisait comme s’ils n’existaient pas, ne pensant qu’au monde à l’intérieur des murs.
Shih apprenait toujours aussi mal. Apparemment, il n’entendait rien à l’arithmétique en dehors des additions, et se montrait incapable d’apprendre les grands classiques par cœur, à l’exception des premiers mots de chaque passage, et encore. Sa mère retirait une profonde frustration des heures qu’elle passait à le faire travailler.
— Shih, je sais que tu n’es pas idiot. Ton père était un homme brillant, tes frères ont la tête bien faite, et tu es particulièrement futé quand il s’agit de m’expliquer pourquoi rien n’est jamais de ta faute, et pourquoi tout doit toujours aller comme tu veux. Tu n’as qu’à te dire que les équations sont des excuses, et tout ira bien ! Mais tout ce à quoi tu penses, c’est comment faire pour ne penser à rien !
Personne n’aurait résisté à une telle volée de bois vert administrée d’un ton si acerbe. Ce n’était pas seulement à cause de ses paroles, mais aussi à cause de la façon dont Kang les prononçait, d’un ton sans appel et d’une voix de corbeau. Ses lèvres pincées, son regard intense, qui semblait vous foudroyer, cette façon qu’elle avait de vous fixer tout en vous fustigeant en paroles, tout cela était insupportable. Pleurant à chaudes larmes, comme toujours, Shih se recroquevilla sous la virulence de la critique.
Peu après cette sévère réprimande, il revint en courant du marché, chaviré de sanglots. Hurlant, en fait, n’arrivant plus à se contenir.
— Ma queue ! Ma queue ! Ma queue !
On la lui avait coupée. Les serviteurs poussèrent des cris de consternation, et pendant un moment, ce ne fut plus qu’un orage de rugissements. Mais la tempête tourna court, aussi court que le petit moignon de queue dressé sur la nuque de Shih, lorsque la voix glaçante de sa mère s’éleva :
— Ça suffit, vous tous !
Elle attrapa Shih par le bras et l’obligea à s’asseoir sur le fauteuil, près de la fenêtre, où elle l’avait déjà tant de fois examiné. Elle sécha ses larmes d’un geste brusque, puis se mit à le câliner.
— Allons, du calme, du calme. Du calme ! Raconte-moi ce qui s’est passé.
Entre deux sanglots convulsifs et quelques hoquets, il lui raconta toute l’histoire. Il s’était arrêté en revenant du marché pour regarder un jongleur, quand soudain deux mains lui avaient caché les yeux. On lui avait appliqué un chiffon sur le nez et la bouche. Il s’était senti mal et s’était évanoui. Quand il était revenu à lui, il n’y avait plus personne, et sa queue avait disparu.
Kang l’avait écouté en l’observant très attentivement, et quand il eut fini de parler, les yeux rivés au plancher, elle pinça les lèvres et alla regarder par la fenêtre. Elle considéra pendant un long moment les chrysanthèmes plantés sous le vieux genévrier tordu. Finalement, Pao, la chef des servantes, s’approcha d’elle. Shih fut renvoyé, pour qu’on lui nettoie la figure et qu’on lui donne à manger.
(La dynastie des Qing obligeait tous les chinois d’origine han à se raser la tête et à porter une queue, à la mode mandchoue, pour montrer que les Han se soumettaient à l’empereur mandchou. Quelques années avant la Conspiration du Lotus Blanc, des bandits han commencèrent à se couper la queue, en signe de rébellion.)
— Que devons-nous faire ? demanda Pao à voix basse.
Kang laissa échapper un profond soupir.
— Il va falloir qu’on le dise, répondit-elle, de mauvaise humeur. Si nous ne le faisons pas, de toute façon cela finira par se savoir. Des servantes en parleront au marché. On dira alors que nous avons encouragé la rébellion.
— Bien sûr, dit Pao, soulagée. Dois-je aller en informer le magistrat dès à présent ?
Un long moment s’écoula, pendant lequel Kang ne répondit rien. Pao regardait la veuve, de plus en plus effrayée. Elle semblait avoir été ensorcelée. On aurait dit qu’elle était en train de se battre en ce moment même avec des voleurs d’âmes, pour l’âme de son fils.
— Oui. Pars avec Zunli. Nous vous suivrons avec Shih.
Pao se retira. Kang erra dans la maison, regardant chaque objet, comme si elle inspectait les pièces. Finalement, elle sortit du domaine par le portail principal, et descendit doucement vers la rivière.
Elle trouva Bao et son fils Xinwu, au bord du fleuve, sous le grand chêne où ils allaient toujours.
— On a coupé la queue de Shih, leur dit-elle.
Le visage de Bao devint d’un gris de cendre. Des gouttes de sueur perlèrent sur son front.
— Nous l’emmenons immédiatement voir le magistrat, continua-t-elle.
Bao hocha la tête, déglutit. Il jeta un coup d’œil à Xinwu.
— Si vous voulez partir en pèlerinage vers quelque lointain tombeau, dit-elle rapidement, nous prendrons soin de votre fils.
Bao hocha de nouveau la tête, l’air hagard. Kang regarda la rivière s’écouler dans la tiède clarté de l’après-midi. Il y avait de tels reflets à la surface de l’eau qu’elle en avait mal aux yeux.
— Si vous partez, lui dit-elle, alors ils sauront que c’est vous.
Son regard se perdit dans le fil de l’eau. Un peu plus loin, Xinwu s’amusait à lancer des pierres sur la rivière, et s’extasiait à chaque ricochet.
— Pareil si je reste, finit par dire Bao.
Kang ne répondit pas.
Quelques instants plus tard, Bao appela Xinwu, et lui dit qu’il s’en allait faire un pèlerinage, très loin. Il devrait donc rester avec Kang et Shih, chez eux.
— Quand reviendras-tu ? demanda Xinwu.
— Bientôt.
Xinwu parut content ou, en tout cas, ne pas souhaiter en savoir plus.
Bao se leva et toucha la manche de Kang.
— Je vous remercie.
— Partez. Faites attention à ne pas vous faire prendre.
— Ne vous inquiétez pas. Si je le peux, j’enverrai des messages au Temple du Bosquet de Bambou Pourpre.
— Non. Si nous n’avons pas de vos nouvelles, nous saurons que tout va bien.
Il approuva. Comme il s’apprêtait à partir, il eut un moment d’hésitation.
— Vous savez, madame, tout le monde a vécu plusieurs vies. Vous avez dit m’avoir déjà rencontré, mais avant la fête de Guanyin, je n’étais jamais venu par ici.
— Je sais.
— Alors, c’est probablement parce que nous nous sommes rencontrés dans une autre vie.
— Je sais, dit-elle en lui jetant un rapide coup d’œil. Partez.
Il partit en traînant la patte, s’assurant qu’il n’y avait personne pour le voir. Mais des pêcheurs se trouvaient de l’autre côté de la rive. On voyait leurs chapeaux de paille briller au soleil.
Kang emmena Xinwu chez elle, puis s’en alla en chaise à porteurs, avec Shih, vers la ville, et les bureaux du magistrat.
Le magistrat se montra des plus désagréables, reprochant à la veuve Kang de faire peser un tel fardeau sur ses épaules. Mais, pas plus qu’elle, il ne pouvait se permettre de faire comme si de rien n’était. Alors, il interrogea Shih, mécontent, et lui demanda de les conduire sur les lieux de l’incident. Shih leur montra un endroit, non loin d’un taillis de bambous, judicieusement hors de vue des premiers étals d’un marché de quartier. Aucun des habitués présents ce matin-là n’avait jamais vu Shih, ni d’inconnus suspects. C’était une impasse.
Alors Kang et Shih rentrèrent chez eux, et Shih pleura, se plaignant qu’il se sentait malade et qu’il ne pouvait étudier. Kang le considéra gravement, et le laissa tranquille pour le reste de la journée. Mais elle lui administra également une forte dose de poudre de gypse mélangée à des calculs biliaires de vache. Ils n’eurent plus aucune nouvelle, ni de Bao, ni du magistrat, et, au fil des jours, Xinwu se fit à la vie de la maisonnée, passant son temps avec les servantes. Kang se montra moins dure avec Shih, puis un jour se mit violemment en colère. Elle l’attrapa par le trognon de queue qu’il avait encore, et l’obligea à s’asseoir sur son banc de travail, en disant :
— Avec ou sans âme, tu passeras tes examens !
Elle considéra sévèrement sa petite mine de chaton effrayé, en attendant qu’il commence à marmonner la leçon du jour précédent l’incident. Shih semblait vraiment très malheureux, mais essayait de n’en rien montrer à sa mère, si sévère avec lui. Cela ne diminua nullement la dureté de sa mère. S’il voulait dîner, il fallait qu’il fasse ses devoirs.
Puis on apprit que Bao avait été arrêté dans les montagnes, à l’ouest, et ramené pour être interrogé par le magistrat et le préfet du district. Les soldats qui leur avaient annoncé la nouvelle voulaient que Kang et Shih se rendent à la préfecture sur-le-champ ; ils avaient même apporté un palanquin pour les y conduire.
Kang grinça des dents en apprenant ce qui s’était passé, et retourna dans ses appartements afin de s’habiller pour le voyage. Les servantes virent ses mains trembler ; en fait, c’était tout son corps qui tremblait, et ses lèvres étaient si pâles qu’aucun fard ne parvenait à leur rendre leur couleur. Avant de sortir de sa chambre, elle s’assit devant son métier à tisser et pleura amèrement. Puis elle se leva, se remaquilla les yeux et sortit rejoindre les gardes.
À la préfecture, Kang descendit de la chaise à porteurs et conduisit Shih à la chambre où le préfet interrogeait tout le monde. Les gardes voulurent l’empêcher d’entrer, mais le magistrat, qui l’avait vue, l’invita à venir, ajoutant sur un ton qui ne présageait rien de bon :
— C’est la femme qui l’a recueilli.
À ces mots, Shih rentra la tête dans les épaules et, caché derrière la robe de soie brodée de sa mère, regarda les fonctionnaires. À côté du magistrat et du préfet se tenaient de nombreux autres fonctionnaires portant des brassards sur leur robe et arborant les insignes carrés des fonctionnaires de très haut rang : des ours, des daims. Il y avait même un aigle.
Cependant, ils ne dirent pas un mot, se contentant de rester assis dans leur fauteuil, sans quitter du regard le magistrat et le préfet, qui encadraient le malheureux Bao. La tête et les mains de Bao avaient été passées dans des trous pratiqués dans une sorte de planche de bois. Quant à ses jambes, on les avait mises dans une presse à chevilles.
La presse à chevilles était constituée de trois tiges partant d’un socle de bois. Les chevilles de Bao étaient attachées de part et d’autre de la tige centrale ; la partie inférieure des tiges latérales comprimait les chevilles de Bao ; tandis que leur partie supérieure était écartée à l’aide de cales en bois. Le magistrat tenait un énorme maillet. Un seul coup sur les cales de bois suffirait à faire éclater les chevilles de Bao.
— Réponds à la question ! rugit le magistrat penché sous le nez de Bao.
Il se redressa, fit quelques pas en arrière et donna à la cale la plus proche un petit coup de maillet.
Bao hurla.
— Je suis un moine ! glapit-il. Je vivais avec mon fils au bord du fleuve ! Je ne peux plus marcher ! Je n’irai plus nulle part !
— Que font ces ciseaux dans ton sac ? demanda calmement le préfet. Des ciseaux, des poudres, des livres. Et un tronçon de queue.
— Ce ne sont pas des cheveux ! C’est mon talisman ! Je l’avais au temple, regardez comme il est tressé ! Ce sont des écrits sacrés… aaah !
— Ce sont des cheveux, décréta le préfet en les examinant à la lumière.
Le magistrat donna un nouveau coup de maillet.
— Ce ne sont pas les cheveux de mon fils, intervint la veuve Kang, à la surprise de tout le monde. Ce moine vit non loin de chez nous. Il ne va jamais nulle part, sauf à la rivière, pour chercher de l’eau.
— Qu’en savez-vous ? demanda le préfet, plongeant son regard dans celui de Kang. Comment pourriez-vous le savoir ?
— Je l’y voyais à toute heure. Il nous apportait de l’eau, et un peu de bois. Il avait un fils. Il prenait soin de notre chapelle. Ce n’est qu’un pauvre moine, un mendiant. Estropié par votre truc, là…, dit-elle en montrant la presse à chevilles.
— Que fait cette femme ici ? demanda le préfet au magistrat.
Le magistrat frémit, apparemment contrarié.
— Elle est un témoin comme les autres.
— Je n’ai pas besoin de témoins !
— Nous, si, dit l’un des fonctionnaires. Interrogez-la.
Le magistrat se tourna vers elle.
— Pourriez-vous vous porter garante que cet homme était bien chez vous, le dix-neuvième jour du dernier mois ?
— Il était dans ma propriété, ainsi que je l’ai dit.
— Ce jour-là en particulier ? Comment pouvez-vous en être si sûre ?
— La fête de l’annonciation de Guanyin était le lendemain, et Bao Ssu nous a aidés à l’organiser. Nous avons passé toute la journée à préparer les diverses cérémonies.
Le silence se fit dans la pièce. Puis l’un des dignitaires en visite dit sèchement :
— Ainsi, vous êtes bouddhiste ?
La veuve Kang lui rendit calmement son regard.
— Je suis la veuve de Kung Xin, qui était un yamen local de son vivant. Mes fils Kung Yen et Kung Yi ont tous les deux réussi leurs examens, et sont maintenant au service de l’empereur, en outre…
— Oui, oui. Très bien. Mais je vous ai demandé si vous étiez bouddhiste.
— Je suis la voie des Han, répondit froidement Kang.
Le fonctionnaire qui l’interrogeait était un Mandchou, l’un des plus hauts dignitaires de l’empereur Qianlong. Il rougit un peu.
— Quel rapport avec votre religion ?
— Tout. Évidemment. Je suis les coutumes, et j’honore mon mari, ma famille et mes ancêtres. Ce que je peux faire pour occuper mes journées avant d’aller rejoindre mon mari ne regarde personne, bien sûr. Ce ne sont que les occupations spirituelles d’une vieille femme, qui n’est pas encore morte. Mais j’ai vu ce que j’ai vu.
(En Chine, l’âge se calcule en prenant comme base de référence l’année lunaire de sa naissance et en ajoutant une année à chaque Nouvel An lunaire.)
— Quel âge avez-vous ?
— Quarante et un suis.
— Et vous avez passé toute la journée du dix-neuvième jour du neuvième mois avec ce mendiant, ici présent ?
— Suffisamment pour être certaine qu’il n’a pas pu aller en ville et en revenir. Car je me suis bien évidemment mise à tisser dans l’après-midi.
Nouveau silence dans la pièce. Puis le fonctionnaire mandchou fit un geste en direction du magistrat, très énervé.
— Reprenez l’interrogatoire !
Avec un regard vicieux à Kang, le magistrat se pencha pour hurler au visage de Bao :
— Que faisaient ces ciseaux dans ton sac ?
— C’est pour faire des talismans !
Le magistrat donna un nouveau coup, un peu plus fort, sur l’un des coins de bois. Bao glapit de plus belle.
— Dis-moi à quoi ils servent vraiment ! Et pourquoi il y avait une queue dans ton sac ?
À chaque question, il donnait un nouveau coup de maillet.
Puis le préfet reprit l’interrogatoire, en l’accompagnant également de coups de maillet, ponctués des cris de douleur de Bao.
Finalement, écarlate et en sueur, Bao implora :
— Assez ! Par pitié ! Je vais tout vous avouer ! Je vais vous dire ce qui s’est passé.
Le magistrat tint son maillet près d’un des coins de bois.
— Parle !
— Un sorcier m’a piégé, m’obligeant à les aider. Je n’avais pas compris ce qu’ils étaient. Ils m’avaient dit que si je ne les aidais pas, ils voleraient l’âme de mon fils !
— Comment s’appelait ce sorcier ?
— Bao Ssu-nen, presque comme moi. Il venait de Suzhou, et avait de nombreux alliés. Il pouvait traverser la Chine en volant, en une seule nuit ! Il m’a donné un peu de poudre stupéfiante, en me disant quoi faire. S’il vous plaît, je vous en supplie, libérez mes chevilles, par pitié ! Je vais tout vous dire maintenant. Je n’ai pas pu faire autrement. Il fallait que je le fasse, pour sauver l’âme de mon garçon.
— Ainsi, tu as bien coupé des queues le dix-neuvième jour du dernier mois ?
— Seulement une ! Rien qu’une, s’il vous plaît. Ils m’y ont forcé. Libérez-moi, je vous en supplie, libérez-moi !
Le fonctionnaire mandchou haussa les sourcils et se tourna vers la veuve Kang.
— Il semblerait que vous n’ayez pas été aussi longtemps avec lui que vous l’avez prétendu. Et cela vaut peut-être mieux pour vous.
Quelqu’un ricana.
Kang dit alors d’une voix que la colère rendait rauque et tranchante :
— Apparemment, il s’agit encore d’une de ces confessions que permet d’obtenir ce fascinant objet, la presse à chevilles. Toute cette terreur qu’engendre le vol des âmes vient de ces confessions arrachées sous la contrainte, qui ne servent qu’à répandre la panique parmi les servantes et les travailleurs. Rien ne peut être moins utile à l’empereur…
— Silence !
— Vous ne cessez d’envoyer des rapports, forçant l’empereur à s’en inquiéter, mais il suffirait d’une enquête un peu mieux menée pour qu’on y voie clair, et que soit démêlé cet écheveau de mensonges…
— Silence !
— Vous êtes percés à jour, d’où qu’on vous regarde ! L’empereur lui aussi le verra !
Le fonctionnaire mandchou se leva et pointa le doigt sur Kang.
— Peut-être aimerais-tu prendre la place de ce sorcier dans la presse ?
Kang ne répondit rien. Derrière elle, Shih tremblait. Elle se pencha vers lui et tendit le pied, afin qu’il sorte de sous sa robe, montrant à tous une petite pantoufle de soie. Alors elle regarda le Mandchou dans les yeux.
— C’est déjà fait !
(Parler de ses pieds ou les faire voir était indigne d’une femme bien élevée. Fallait-il qu’elle ait du courage !)
— Faites sortir cette folle d’ici ! s’exclama le Mandchou, le visage bouillonnant de colère.
Le pied d’une femme, exposé ainsi à la vue de tous alors qu’on examinait une affaire aussi grave que celle du vol des âmes : cela dépassait l’entendement !
— Je suis témoin ! lança Kang, sans bouger.
— S’il vous plaît, l’implora Bao. Allez-vous-en, madame. Faites ce que le magistrat vous dit.
Il pouvait à peine tourner la tête pour la voir.
— Tout ira bien.
Ils partirent donc. Sur le chemin du retour, dans le palanquin, Kang ne put retenir ses larmes, repoussant les caresses de Shih.
— Que s’est-il passé, mère ? Que s’est-il passé ?
— J’ai souillé le nom de ta famille. J’ai détruit les plus chers espoirs de mon mari.
Shih la regarda, effrayé.
— Mais ce n’est qu’un mendiant !
— Assez ! siffla-t-elle.
Puis elle se mit à jurer comme les servantes.
— Ces Mandchous ! Stupides étrangers ! Ils ne sont même pas chinois. Pas de vrais Chinois. Chaque dynastie commence bien, réparant les méfaits de la précédente. Puis à son tour elle se corrompt. Les Qing en sont là. C’est pourquoi cette histoire de queue coupée leur importe tant. C’est la preuve que nous leur appartenons, la preuve que chaque Chinois leur appartient.
— Mais c’est ainsi, mère. Vous ne changerez pas les dynasties !
— Non. Oh, que j’ai honte ! J’ai perdu mon calme. Je n’aurais jamais dû aller là-bas. Je n’ai fait qu’ajouter de nouveaux coups sur les chevilles du pauvre Bao.
Chez elle, elle se rendit au quartier des femmes. Elle se perdit dans le travail, ne prenant plus de nourriture, tissant tout le jour, jusqu’à tomber de sommeil, sans parler à personne.
Puis on apprit que Bao était mort en prison, d’une fièvre qui n’avait rien à voir avec les interrogatoires – c’est du moins ce que racontèrent ses geôliers. Kang s’enferma pour pleurer dans sa chambre, refusant d’en sortir. Quand elle le fit, quelques jours plus tard, elle passa tout son temps à tisser ou à écrire des poèmes, mangeant devant son métier à tisser ou à son bureau. Elle ne voulait plus rien apprendre à Shih, ni même lui parler, ce qui l’énerva, et l’effraya plus que tout ce qu’elle aurait pu lui dire. Mais il aimait bien aller jouer près du fleuve. Xinwu avait l’ordre de ne pas l’approcher, et les servantes s’occupaient de lui.
Mon pauvre singe, tu as laissé tomber ta pêche,
Et la nouvelle lune a oublié de se lever.
Tu ne grimperas plus dans les pins,
Un petit singe sur le dos.
Reviens, sois un bouton d’or,
Et je serai ton papillon.
Un jour, peu après ces événements, Pao apporta à Kang une petite queue noire. Un serviteur l’avait trouvée en retournant le fumier, enfouie sous le tas de compost de mûriers. Elle était coupée d’une façon qui permettait d’affirmer que c’était bien celle de Shih : les angles correspondaient.
Kang gémit en la voyant, se rendit à la chambre de Shih et le frappa rudement sur l’oreille. Il hurla, pleura.
— Pourquoi ? Pourquoi ?
Sans lui répondre, Kang retourna au quartier des femmes, en marmonnant, s’empara d’une paire de ciseaux et saccagea toutes les tapisseries qu’elles étaient en train de broder. Les servantes crièrent, hurlèrent. Elles n’en croyaient pas leurs yeux. La maîtresse de maison avait fini par devenir folle. Personne ne l’avait vue pleurer autant, même à la mort de son mari.
À partir de cet instant, la veuve Kang n’arriva plus à dormir. Souvent, elle appelait Pao et lui demandait du vin.
— Je l’ai revu, disait-elle. Cette fois c’était un jeune moine, avec une autre tunique. Un hui-hui. J’étais une jeune reine. Cette fois-ci, c’est lui qui me sauvait. Nous nous sauvions ensemble. Et maintenant son fantôme est en colère, il erre entre les mondes.
Ils placèrent des offrandes pour lui près du portail et de la fenêtre. Mais Kang continuait de pousser des cris, qui réveillaient tout le monde. On aurait dit des cris de paon. Parfois, ils la trouvaient, marchant dans son sommeil entre les bâtiments du domaine, parlant dans des langues étrangères, de voix qui n’étaient pas toujours la sienne. Tout le monde savait qu’il ne fallait jamais réveiller quelqu’un qui marchait en dormant, pour ne pas perturber son esprit et lui faire perdre ses repères, l’empêchant de retrouver son corps. Alors, ils la devançaient, bougeant les meubles pour qu’elle ne s’y blesse pas et réveillant le coq pour l’obliger à chanter plus tôt. Pao demanda à Shih d’écrire à ses frères aînés, pour leur raconter ce qui se passait, ou au moins d’écrire ce que sa mère disait en dormant, mais Shih ne voulut pas.
(Remarquez que si cela avait été son père qui avait été malade, ou poursuivi par des fantômes, il aurait certainement eu l’autorisation de rentrer.)
Finalement, Pao parla à la sœur de la première servante du plus âgé des frères de Shih quand elle se rendit au marché de Hangzhou ; de fil en aiguille, le frère aîné, qui vivait à Nanjing, apprit toute l’affaire. Mais il ne put pas venir. Il avait des obligations et ne pouvait pas se libérer.
Il se trouvait, cependant, qu’un lettré musulman était en visite chez lui, un médecin venu des terres frontalières, et comme cet homme était intéressé par toutes les affaires de possession – comme celle de la veuve Kang –, quelques mois plus tard, il vint la voir.
2. Réminiscences
Kang Tongbi reçut le visiteur assise dans l’une des pièces qui donnaient sur la cour du domaine consacrée à l’agrément des invités. Elle le regarda avec attention tandis qu’il se présentait. Il parlait un chinois clair, bien qu’avec un drôle d’accent. Il s’appelait Ibrahim ibn Hasam. C’était un petit homme frêle, à peu près de la taille et de la corpulence de Kang, et il avait les cheveux blancs. Il portait des lunettes qu’il n’enleva pas, et ses yeux nageaient derrière les lentilles comme des poissons dans un aquarium. C’était un vrai hui, originaire d’Iran, mais il avait vécu en Chine pendant presque tout le règne de l’empereur Qianlong, et comme la plupart des étrangers qui avaient longtemps séjourné en Chine, il s’était engagé à y rester toute sa vie.
— La Chine, c’est chez moi, dit-il (ce qui paraissait bizarre, avec son accent, et il hocha la tête comme s’il avait observé son expression). Je ne suis évidemment pas un pur Han, mais j’aime ce pays. En réalité, je vais bientôt rentrer à Lanzhou, vivre parmi les gens de ma confession. Je pense que j’ai assez appris auprès de maître Liu Zhi pour être utile à ceux qui souhaiteraient favoriser le rapprochement des musulmans chinois et des Chinois han. Enfin, c’est ce que j’espère.
Kang hocha poliment la tête à la perspective de cette quête improbable.
— Et vous êtes venu ici pour… ?
Il s’inclina.
— J’assistais le gouverneur de la province dans les cas que l’on a signalés de…
— De vol d’âme ? avança âprement Kang.
— Enfin… Oui. De coupage de queue, en tout cas. Que ce soit une affaire de sorcellerie, ou simplement de rébellion contre la dynastie, ce n’est pas très facile à déterminer. Je suis surtout un érudit, un chercheur en religion, mais j’ai aussi étudié les arts médicaux, et c’est pourquoi on a fait appel à moi, pour voir si je pouvais apporter un éclairage sur l’affaire. J’ai aussi étudié des cas de… de possession de l’âme. Et d’autres choses dans ce genre-là.
Kang le regarda froidement. Il hésita à poursuivre.
— Votre fils aîné m’affirme que vous avez eu à déplorer des incidents de cette espèce.
— Je ne suis pas au courant, répondit-elle sèchement. On a coupé la queue de mon plus jeune fils. Il y a eu une enquête, qui n’a rien donné. Quant au reste, je l’ignore. Je dors, et quand le froid me réveille, je ne suis plus dans mon lit. Mais ailleurs, dans la maison. Mes serviteurs me disent que je marmonne des choses qu’ils ne comprennent pas. Que je parle une langue qui n’est pas le chinois.
Les yeux d’Ibrahim flottèrent derrière ses verres.
— Madame, parlez-vous d’autres langues que le chinois ?
— Bien sûr que non.
— Excusez-moi. Votre fils m’a dit que vous étiez extrêmement cultivée.
— Mon père a tenu à ce que j’apprenne les classiques en même temps que ses fils.
— Vous avez la réputation d’être une habile poétesse…
Kang ne répondit pas mais ses joues prirent une légère teinte rosée.
— J’espère avoir le privilège de lire certains de vos poèmes. Ils pourraient m’aider dans mon travail ici.
— C’est-à-dire ?
— Eh bien, à faire cesser ces déambulations nocturnes, si une telle chose est possible. Et à aider l’empereur dans son enquête sur les coupeurs de queue.
Kang se renfrogna et détourna les yeux.
Ibrahim plongea ses lèvres dans sa tasse de thé et attendit. Il semblait capable d’attendre plus ou moins indéfiniment.
Kang fit signe à Pao de remplir sa tasse.
— Eh bien, allez-y.
Ibrahim s’inclina sur son siège.
— Merci. Nous pourrions peut-être commencer par parler du moine qui est mort, Bao Ssu.
Kang se raidit.
— Je sais que c’est difficile, murmura Ibrahim. Vous vous occupez encore de son fils.
— Oui.
— Et on m’a dit que, lors de son arrivée, vous étiez convaincue de l’avoir déjà rencontré quelque part.
— Oui, c’est vrai. Mais il a dit qu’il venait de Suzhou, et qu’il n’était jamais venu ici. Je ne suis jamais allée à Suzhou. Et pourtant j’avais l’impression de le connaître.
— Et vous avez eu la même impression avec son fils ?
— Non. Mais j’ai la même impression avec vous.
Elle se plaqua les mains sur la bouche.
— Vraiment ? fit Ibrahim en l’observant.
Kang secoua la tête.
— Je ne sais pas pourquoi j’ai dit ça. Ça m’a échappé.
— Ce sont des choses qui arrivent, fit-il avec un geste désinvolte. Mais ce Bao, qui ne vous a pas reconnue… peu après son arrivée, on a signalé des incidents. Des coupages de queues, le nom de gens écrit sur des bouts de papier placés sous les piliers qu’on s’apprêtait à mettre en place – ce genre de choses. Des activités relevant du vol d’âme.
Kang secoua la tête.
— Il n’avait rien à voir là-dedans. Il passait toutes ses journées au bord du fleuve, à pêcher avec son fils. C’était un simple moine, c’est tout. Ils l’ont torturé pour rien.
— Il a avoué avoir coupé bien des queues.
— Après qu’on lui a brisé les chevilles dans un étau ! Il aurait avoué n’importe quoi, comme n’importe qui à sa place ! C’est une façon stupide d’enquêter sur ce genre de crimes. Ça suscite des vocations et on en voit poindre dans les moindres recoins, comme autant de champignons vénéneux.
— C’est vrai, répondit l’homme en aspirant une nouvelle gorgée de thé. Je l’ai souvent dit. Et en réalité, il est de plus en plus clair que c’est ce qui s’est passé ici, ces derniers temps.
Kang braqua sur lui un regard morne.
— À qui le dites-vous !
— Enfin, fit Ibrahim en baissant les yeux. Le moine Bao et son fils ont d’abord été amenés ici pour être interrogés à Anchi comme il vous l’a peut-être dit. Ils mendiaient en chantant devant la maison du chef du village. Celui-ci leur a donné un misérable morceau de brioche à la vapeur, mais Bao et Xinwu avaient tellement faim, apparemment, que Bao a maudit le chef du village, qui a décidé que c’étaient des mauvais sujets, et leur a réitéré l’ordre de déguerpir. Bao l’a maudit à nouveau avant de partir, et le chef du village était furieux, les a fait arrêter et fouiller. C’est là que, dans leurs sacs, on a trouvé des écrits, des remèdes et des ciseaux…
— Autant de choses qu’on trouverait ici.
— Certes, mais le chef du village les a fait attacher à un arbre et frapper avec des chaînes. Cela dit, on n’en a rien tiré de plus. Pourtant, ils étaient salement amochés. Alors le chef du village a pris la fausse queue d’un garde chauve de sa suite, l’a mise dans le sac de Bao et l’a envoyé à la préfecture pour le faire soumettre à la torture.
— Pauvre homme ! s’exclama Kang en se mordant la lèvre. Pauvre créature !
— Oui, fit Ibrahim en sirotant une nouvelle gorgée de thé. Alors, récemment, le gouverneur général a commencé à enquêter sur ces incidents, sur ordre de l’empereur, qui se sent très concerné. J’ai un peu participé à l’enquête – sans procéder aux interrogatoires –, j’ai examiné les preuves matérielles, comme la fausse natte, dont j’ai montré qu’elle était faite de différentes sortes de cheveux. C’est ainsi que le chef du village a été interrogé, et qu’il a raconté toute l’histoire.
— Ce n’était donc qu’un mensonge.
— En effet. Et en réalité, on peut faire remonter tous les incidents à l’origine d’un cas similaire à celui de Bao, à Suzhou…
— C’est monstrueux.
— … sauf pour ce qui concerne votre fils, Shih.
Kang ne répondit pas. Elle fit un signe, et Pao remplit à nouveau les tasses.
Après un très long silence, Ibrahim reprit :
— Il n’y a aucun doute que des voyous, en ville, ont profité de l’atmosphère de terreur pour faire peur à votre fils.
Kang hocha la tête.
— Et puis, poursuivit-il, si vous avez fait des expériences curieuses – la possession par des esprits –, il est également possible qu’il ait…
Elle ne répondit pas.
— Avez-vous connaissance d’autres bizarreries… ?
Pendant un long moment, ils restèrent assis en silence, à boire leur thé. Pour finir, Kang dit :
— La peur elle-même est une sorte de possession.
— Tout à fait !
Nouvelle gorgée de thé.
— Je vais dire au gouverneur général qu’il n’y a pas de quoi s’inquiéter ici.
— Merci.
Nouveau silence.
— Mais je m’intéresse à toutes les manifestations subséquentes, à tout ce qui peut sortir de l’ordinaire.
— Évidemment.
— J’aimerais pouvoir en discuter. Je connais des moyens d’enquêter sur ce genre de chose.
— C’est possible.
Peu après, le docteur hui prit congé.
Une fois qu’il fut parti, Kang fit le tour du domaine, passant de pièce en pièce, une Pao fort inquiète sur les talons. Elle alla voir dans la chambre de Shih, alors vide. Ses livres sur les étagères n’avaient pas été ouverts. Shih devait être au bord du fleuve, sans doute avec Xinwu.
Kang alla voir dans le quartier des femmes, au métier à tisser sur lequel reposait une si grande partie de leur fortune ; et à l’écritoire, avec ses blocs d’encre, ses pinceaux, ses piles de papier.
Les oies filent vers le nord, droit vers la lune.
Les fils grandissent et s’en vont.
Dans le jardin, mon vieux banc.
Certains jours, je préférerais avoir le riz et le sel.
Assise comme une plante, le cou tendu :
Honk ! Honk ! Envole-toi !
Puis dans les cuisines, et dans le jardin, sous le vieux genévrier. Elle finit par se retirer dans sa chambre sans avoir dit un mot.
Mais, cette nuit-là, la maisonnée fut à nouveau réveillée par des cris. Pao se précipita au-dehors, devançant les autres serviteurs et trouva la veuve Kang affalée contre le banc du jardin, sous un arbre. Pao referma la chemise de nuit ouverte sur le sein de sa maîtresse et l’aida à s’asseoir sur le banc en criant « Maîtresse Kang ! » parce qu’elle avait les yeux grands ouverts, alors qu’elle ne voyait rien de ce monde. Elle avait les yeux si blancs qu’ils en étaient luisants, et son regard traversait Pao et les autres sans les voir. Elle s’adressait à des êtres invisibles auxquels elle parlait dans des langues étranges : « In challa, in challa » – un bredouillis de sons, de cris, de couinements –, « Um mana pada hum » ; et tout ça d’une voix – de plusieurs voix qui n’étaient pas les siennes.
— Des fantômes ! glapit Shih qui avait été réveillé par tout ce vacarme. Elle est possédée !
— Silence, s’il vous plaît ! siffla Pao. Nous devons la remettre au lit sans la réveiller.
Zunli et elle la prirent chacun par un bras, la soulevant le plus gentiment possible. Elle était aussi légère qu’un chat, plus légère qu’elle n’aurait dû.
— Doucement, fit Pao alors qu’ils la faisaient basculer par-dessus le rebord de la fenêtre et la reposaient par terre.
Elle gisait là lorsqu’elle se redressa comme une marionnette et dit, d’une voix redevenue la sienne :
— La petite déesse est morte malgré tout.
Pao fit prévenir le docteur hui de ce qui s’était passé, et leur serviteur revint avec un mot, demandant à la revoir. Kang grommela et laissa tomber le mot sur la table sans répondre. Mais, une semaine plus tard, les serviteurs reçurent l’ordre de préparer à manger pour un visiteur, et le docteur Ibrahim ibn Hasam se présenta à la porte, en clignant des yeux comme un hibou derrière ses lunettes.
Kang le salua avec la plus grande solennité et le conduisit au salon, où la table avait été mise avec le plus beau service de porcelaine.
Lorsqu’ils prirent le thé, après déjeuner, Ibrahim hocha la tête et dit :
— On m’a appris que vous aviez eu une nouvelle crise de somnambulisme.
— Mes serviteurs sont indiscrets, répondit Kang en s’empourprant.
— Je regrette. C’est juste que ça pourrait avoir un rapport avec mes investigations.
— Je ne me souviens absolument pas de l’incident, hélas. Je me suis réveillée dans une maison sens dessus dessous.
— Oui. Je pourrais peut-être demander à vos serviteurs ce que vous avez dit quand vous étiez… quand vous étiez sous l’effet du charme ?
— Certainement.
— Merci. (Nouvelle courbette, nouvelle gorgée de thé.) Et puis… Je me demandais si vous accepteriez de m’aider à essayer d’atteindre ce… cette autre voix qui est en vous.
— Comment vous proposez-vous d’y parvenir ?
— C’est une méthode mise au point par les docteurs d’al-Andalus. Elle implique une sorte de méditation sur un objet, comme dans un temple bouddhiste. Un praticien aide le patient à entrer en état de réceptivité, comme ils disent, et il arrive que les voix intérieures se mettent alors à s’exprimer.
— Comme lorsqu’on nous a volé notre âme, c’est ça ?
Il eut un sourire.
— Sauf qu’il n’y a pas vol. C’est plutôt une sorte de conversation, comprenez-vous ? Comme appeler l’esprit de quelqu’un qui serait absent, y compris pour lui-même. Comme ces invocations auxquelles on procède dans vos villes du Sud. Et puis, quand la méditation s’achève, tout redevient normal.
— Vous croyez à l’âme, docteur ?
— Évidemment.
— Et au vol d’âme ?
— Eh bien… (Long silence.) Ce concept fait référence à la notion chinoise de l’âme, je pense. Vous pourriez peut-être me l’expliciter. Faites-vous la distinction entre le hun, l’âme spirituelle, et le po, l’âme corporelle ?
— Oui, bien sûr, répondit Kang. C’est un aspect du yin et du yang. L’âme hun appartient au yang et l’âme po au yin.
Ibrahim hocha la tête.
— Et l’âme hun, étant légère et active, volatile, est celle qui peut se séparer de l’être vivant. En vérité, elle s’en sépare toutes les nuits, pendant le sommeil, et elle revient au réveil. Normalement.
— Oui.
— Et si, par hasard, ou volontairement, elle ne revient pas, c’est une cause de maladie, surtout de maladies infantiles, comme la colique, et de diverses formes d’insomnie, de folie et ainsi de suite.
— Oui.
À présent, la veuve Kang ne le regardait plus.
— Et le hun est l’âme que sont censés rechercher les voleurs d’âmes qui écument le pays. Chiao-hun.
— Oui. Vous n’y croyez manifestement pas.
— Non, pas du tout. Je réserve mon jugement à ce qui se voit. Je vois la distinction, évidemment. Je voyage en rêve, moi-même – croyez-moi, je voyage. Et j’ai traité des patients inconscients, dont le corps continuait à fonctionner parfaitement, éclatant de santé, alors qu’ils étaient allongés là, sur leur lit, et ne faisaient pas un geste, pas un geste depuis des années… Je nettoyais son visage – je nettoyais ses cils quand, tout d’un coup, elle a dit : « Ne fais pas ça. » Au bout de seize ans. Oui, j’ai vu l’âme hun partir et revenir, je crois. C’est comme la plupart des choses, je pense. Les Chinois ont certains mots, certains concepts, certaines catégories, mais inspectés de plus près, ils pourraient être corrélés et on pourrait prouver qu’ils ne font qu’un. Parce que tout est un.
Kang se renfrogna, comme si elle n’était peut-être pas tout à fait d’accord.
— Vous connaissez ce poème de Rumi Balkhi, « Je suis mort comme minéral » ? Non ? C’est un poème du fondateur des derviches, le plus mystique des musulmans.
Il récita :
Je suis mort comme minéral et revenu plante,
Je suis mort comme plante et revenu animal,
Je suis mort comme animal et j’étais Homme.
Pourquoi devrais-je avoir peur ? Quand ai-je été moins proche de la mort ?
Et pourtant, encore une fois, je mourrai comme Homme pour m’élever
Avec les anges bénis ; mais de l’angélisme même
Je dois poursuivre : « Tout, sauf la face de Dieu, doit périr un jour. »
Quand j’aurai sacrifié mon âme angélique,
Je deviendrai ce qu’aucun esprit jamais n’a conçu…
— Je pense que cette dernière mort fait allusion à l’âme-souffle, hun, qui s’éloigne de l’âme corporelle, po, pour se transcender.
Kang y réfléchit.
— Alors, dans l’islam, vous croyez que les âmes reviennent ? Que nous vivons de nombreuses vies et nous réincarnons ?
Ibrahim reposa sa tasse de thé.
— Le Coran dit : « Dieu génère les êtres, et les renvoie encore et encore jusqu’à ce qu’ils reviennent à lui. »
— Vraiment ! fit Kang en le regardant avec un intérêt renouvelé. C’est ce que croient les bouddhistes.
Ibrahim hocha la tête.
— Un maître soufi dont j’ai suivi l’enseignement, Sharif Din Maneri, nous a dit : « Sache avec certitude que cette œuvre a existé avant toi et moi dans les âges passés et que chacun a déjà atteint un certain niveau. Personne n’a commencé cette œuvre pour la première fois. »
Kang regarda Ibrahim en ouvrant de grands yeux, se penchant de son siège à haut dossier vers lui. Elle s’éclaircit délicatement la gorge.
— Je me rappelle des bribes de ces épisodes de somnambulisme, admit-elle. J’ai souvent l’impression d’être quelqu’un d’autre. Généralement une jeune femme, une… une reine d’un pays éloigné, qui a des ennuis. J’ai l’impression que c’était il y a longtemps, mais c’est très vague. Parfois, quand je me réveille, j’ai l’impression qu’une année au moins a passé. Et puis je me réveille pour de bon, et tout se délite, et je ne me rappelle rien, qu’une image ou deux, ou une illustration dans un livre, comme un rêve, mais moins complet, moins… Je regrette. Je n’arrive pas à le dire clairement.
— Mais si, dit Ibrahim. C’est très clair.
— Je pensais vous connaître, murmura-t-elle. Vous, Bao, mon fils Shih, Pao et quelques autres. Je… c’est comme cette sensation qu’on a parfois, cette impression d’avoir déjà vécu ce que l’on est en train de vivre, exactement.
Ibrahim hocha la tête.
— J’ai déjà ressenti ça. Partout, dans le Coran, il est dit : « Je vous le dis en vérité, les esprits qui ont maintenant une affinité seront réunis comme des frères, mais ils se rencontreront tous dans des personnes et des noms différents. »
— Vraiment ? s’exclama Kang.
— Oui. Et ailleurs, il est dit : « Il se dépouille de son corps comme un crabe de sa coquille, et il en forme une nouvelle. La personne n’est qu’un masque que l’âme revêt pour une saison, qu’elle revêt pour un certain temps, et puis elle la rejette et en porte une autre à la place. »
Kang le regardait, bouche bée.
— J’ai du mal à croire ce que j’entends, chuchota-t-elle. Je n’avais personne à qui raconter ces choses. Tous me croient folle. Pour eux, maintenant, je suis une…
Ibrahim hocha la tête et reprit sa tasse.
— Je comprends. Mais je m’intéresse à ces choses. J’ai eu certaines… prémonitions, personnellement. Nous pourrions peut-être essayer de vous mettre en état de réceptivité, et voir ce que ça donne ?
Kang hocha la tête avec emphase.
— Oui.
Comme il avait besoin d’obscurité, ils s’installèrent dans un petit salon, les fenêtres fermées et les portes closes. Une unique chandelle brûlait sur une table basse. Les verres de ses lunettes reflétaient la flamme. On avait ordonné le silence dans la maison, et ils entendaient faiblement des chiens aboyer, des roues de charrette, la rumeur générale de la ville, dans le lointain, tout cela très affaibli.
Ibrahim prit la veuve Kang par le poignet, très doucement. Elle sentit ses doigts frais effleurer son pouls, et son cœur se mit à battre plus vite. Il s’en était certainement aperçu. Mais il lui demanda de regarder la flamme de la bougie, et il lui parla en persan, en arabe, en chinois : une lente mélopée, d’une voix atone, un doux murmure. Elle n’avait jamais entendu de voix pareille.
— Vous marchez dans la fraîche rosée du matin, tout est paisible, tout est bien. Dans le cœur de la flamme, le monde s’épanouit comme une fleur. Vous humez la fleur, lentement, vous inspirez, vous expirez. Tous les soutras vous parlent à travers cette fleur de lumière. Tout s’équilibre, et monte et redescend, coulant le long de votre colonne vertébrale comme la marée. Le soleil, la lune, les étoiles, à leur place, tournent autour de nous, nous enserrant.
Il continua à murmurer ainsi, jusqu’à ce que le pouls de Kang soit stabilisé à chacun de ses trois niveaux, un pouls flottant, vide, sa respiration profonde et détendue. Elle fit vraiment l’impression à Ibrahim d’avoir quitté la pièce, par le portail de la flamme de la bougie. Il n’avait jamais vu personne partir si rapidement.
— Maintenant, suggéra-t-il, vous voyagez dans le monde des esprits, et vous voyez toutes vos vies. Dites-moi ce que vous voyez.
C’est d’une voix haute et douce, qui ne ressemblait pas à sa voix habituelle, qu’elle répondit :
— Je vois un vieux pont, très ancien, qui traverse un cours d’eau à sec. Bao est jeune, et il porte une robe blanche. Des gens me suivent sur le pont vers… un endroit. Vieux et nouveau.
— Que portez-vous ?
— Une longue… chemise. Comme une chemise de nuit. Mais chaude. Des gens nous appellent alors que nous passons.
— Que disent-ils ?
— Je ne comprends pas.
— Répétez ce que vous entendez.
— In sha ar am. In sha ar am. Ce sont des gens sur des chevaux. Oh… vous voilà. Vous aussi, vous êtes jeune. Ils veulent quelque chose. Des gens appellent. Des hommes approchent sur des chevaux. Ils viennent vite. Bao m’avertit…
Elle eut un frisson.
— Ah ! fit-elle de sa voix normale. (Son pouls devint rugueux. Presque un pouls sautillant. Elle secoua sèchement la tête, leva les yeux sur Ibrahim.) Qu’est-ce que c’était que ça ? Que s’est-il passé ?
— Vous étiez partie. Vous voyiez autre chose. Vous vous souvenez ?
Elle fit non de la tête.
— Des chevaux ?
Elle ferma les yeux.
— Des chevaux. Un cavalier. La cavalerie. J’avais des ennuis !
— Hmm, fit-il en lâchant son poignet. C’est bien possible.
— Qu’est-ce que c’était ?
Il haussa les épaules.
— Peut-être un… Parlez-vous une… Non. Vous m’avez déjà dit que non. Mais dans ce voyage du hun, on aurait dit que vous entendiez de l’arabe.
— De l’arabe ?
— Oui. Une prière courante. Beaucoup de musulmans la récitent en arabe, même si ce n’est pas la langue de leur pays. Mais…
Elle frémit.
— Il faut que je me repose.
— Certainement.
Elle le regarda et ses yeux s’emplirent de larmes.
— Je… se pourrait-il que… enfin, pourquoi moi ? fit-elle en secouant la tête, des larmes roulant sur ses joues. Je ne comprends pas pourquoi tout ça arrive !
Il opina du chef.
— Il est si rare que l’on comprenne pourquoi les choses arrivent.
Elle eut un petit rire sec, « Ho ! », et puis elle ajouta :
— Mais j’aime comprendre.
— Moi aussi. Croyez-moi. C’est mon régal favori. Mais c’est si rare, aussi.
Il eut un petit sourire, ou une grimace de chagrin, qu’il lui offrit pour la partager avec elle. Ils communièrent dans la frustration solitaire de comprendre si peu de choses.
Kang inspira profondément et se leva.
— J’apprécie votre aide. Vous reviendrez, j’imagine ?
— Évidemment. (Il se leva à son tour.) Tout ce que madame voudra. J’ai l’impression que nous ne faisons que commencer.
Elle parut soudain surprise, et son regard le traversa.
— Les bannières volent, vous vous souvenez ?
— Pardon ?
— Vous étiez là. (Elle eut un sourire d’excuse, haussa les épaules.) Vous étiez là, vous aussi.
Il fronça les sourcils, essayant de comprendre.
— Des bannières… (Il sembla perdu, à son tour, pendant un moment.) Je… (Il secoua la tête). Peut-être. Je me souviens, quand j’étais enfant, quand je voyais des bannières, quand j’étais enfant, en Iran, ça voulait dire tellement de choses pour moi. Plus que je ne saurais dire. Comme si je volais.
— Revenez, je vous en prie. Peut-être que votre âme hun pourrait aussi revenir.
Il hocha la tête en fronçant les sourcils comme s’il poursuivait encore une pensée qui lui échappait, une bannière dans sa mémoire. Il pensait encore à autre chose lorsqu’il lui dit au revoir et prit congé.
Il revint dans la semaine, et ils eurent une autre séance « dans la chandelle », comme disait Kang. Des profondeurs de sa transe, elle se lança dans un discours qu’aucun d’eux ne comprit – ni Ibrahim, ni Kang quand il lui lut ce qu’il avait noté.
Il haussa les épaules, l’air ébranlé.
— Je vais demander à des collègues. Évidemment, il se peut que ce soit une langue complètement oubliée de nos jours. Nous devons nous concentrer sur ce que vous voyez.
— Mais je ne me rappelle rien ! Ou très peu de choses. Quand on se rappelle ses rêves, ça s’efface au réveil.
— Alors, quand vous êtes dans la chandelle, je dois faire très attention, poser les bonnes questions.
— Et si je ne vous comprends pas ? Ou si je réponds dans une autre langue ?
— Mais vous semblez me comprendre, au moins en partie, répondit-il en hochant la tête. Il doit y avoir des translations d’un royaume à autre. Ou il se peut que Pâme-souffle, hun, soit plus que nous ne le soupçonnions. Ou que le filament qui vous relie à l’âme hun au cours de votre voyage transmette d’autres parties de ce que vous savez. Ou peut-être est-ce l’âme corporelle, po, qui comprend pour vous ? (Il leva les bras au ciel.) Qui pourrait le dire ?
Et puis quelque chose la frappa, et elle posa la main sur son bras.
— Il y avait un glissement de terrain !
Ils se levèrent en silence. Il y eut un vague mouvement d’air.
Il s’éloigna, intrigué, distrait. Chaque fois qu’il s’en allait, il se sentait rêveur, et chaque fois qu’il revenait, il bourdonnait légèrement d’idées, attendant avec impatience leur prochain voyage dans la chandelle.
— Un collègue à Beijing pense qu’il pourrait s’agir d’une forme de berbère. La langue que vous parlez. Et, d’autres fois, de tibétain. Vous connaissez ces endroits ? Le Maroc est à l’autre bout du monde, au nord-ouest de l’Afrique. Ce sont les Marocains qui ont repeuplé al-Andalus à la mort des chrétiens.
— Ah, fit-elle, tout en secouant la tête. J’ai toujours été chinoise, j’en suis sûre. Ça doit être un vieux dialecte chinois.
Il eut un sourire, un sourire rare et agréable.
— Chinoise dans votre cœur, peut-être. Mais je pense que nos âmes errent dans le monde entier, d’une vie à l’autre.
— En groupe ?
— Les destinées des gens s’entrecroisent, comme dit le Coran. Comme les fils de vos broderies. Elles évoluent conjointement, comme les races errantes de la Terre – les juifs, les chrétiens, les Zott. Les survivantes de coutumes anciennes, qui se retrouvent sans foyer.
— Ou les nouvelles îles de l’autre côté de la mer de l’Est, n’est-ce pas ? Alors il se pourrait que nous ayons vécu là aussi, dans les empires de l’or ?
— Ce sont peut-être des Égyptiens du temps jadis, qui auraient fui le déluge de Noé. Les opinions divergent.
— Quels qu’ils puissent être, je suis complètement chinoise, c’est certain. Et je l’ai toujours été.
Il la regarda avec une lueur d’amusement dans les yeux.
— La langue que vous parlez quand vous êtes dans la bougie ne sonne pas très chinois. Et si la vie est inextinguible, comme il le semble, il se pourrait que vous soyez plus vieille que la Chine elle-même.
Elle inspira profondément, poussa un soupir.
— C’est facile à croire.
Faussement sanskrit, originellement écrit en chinois et intitulé « Lengyan jing ». L’éveil à la conscience qu’il décrit, changzi, est parfois appelé « la nature de Bouddha », ou tathagatagarbha, ou « terre de l’esprit ». D’après ce soutra, les adeptes peuvent être « soudain éveillés » à cet état de conscience supérieur.
Lorsqu’il revint, la fois suivante, pour la replonger en état de réceptivité, c’était la nuit, et ils pouvaient travailler dans le silence et l’obscurité ; de sorte qu’il semblait ne plus rien y avoir au monde que la flamme de la bougie, la chambre plongée dans la pénombre et le bruit de sa voix. C’était le cinquième jour du cinquième mois, un jour de malchance, le jour de la fête des fantômes affamés, celui où l’on honore et où l’on donne un peu de paix aux pauvres prêtas qui n’ont pas de descendants vivants. Kang avait récité le soutra Surangama, qui commente le rulai-zang, un état de vide de l’esprit, de tranquillité de l’esprit, de vérité de l’esprit.
Elle effectua les rituels de purification de la maison, jeûna, et demanda à Ibrahim de faire de même. Puis, quand les préparatifs furent achevés, ils s’assirent dans la pièce sombre, étouffante, et regardèrent brûler une bougie. Kang entra dans la flamme presque à l’instant où Ibrahim lui toucha le poignet, son pouls rapide – un pouls yin et yang. Ibrahim la regarda attentivement. Elle marmonna dans l’une ou l’autre de ces langues qu’il ne comprenait pas. Il y avait un miroitement sur son front, et elle semblait égarée.
La flamme de la bougie se réduisit à la taille d’un haricot. Ibrahim déglutit péniblement, tenant la peur à distance, les yeux plissés par l’effort.
Elle s’agita et sa voix se mit à vibrer.
— Dites-le-moi en chinois, demanda-t-il gentiment. Parlez chinois.
Elle gémit, marmonna, et dit, très clairement :
— Mon mari est mort. Ils ne voulaient pas… Ils l’ont empoisonné, et ils ne voulaient pas de reine parmi eux. Ils voulaient ce que nous avions. Ah !
Et elle se remit à parler dans l’autre langue. Ibrahim s’efforça de retenir ses paroles les plus claires, et vit que la flamme de la bougie était remontée, mais anormalement haut, si haut que sa chaleur devint rapidement étouffante et qu’il commença à avoir peur pour le plafond de papier.
— Calme-toi, je t’en prie, ô esprit des morts, dit-il en arabe.
Kang se mit à crier, d’une voix qui n’était pas la sienne :
— Non ! Non ! Nous sommes pris au piège !
Elle éclata en sanglots, pleura toutes les larmes de son corps. Ibrahim la prit par les bras, la serra gentiment et, tout à coup, elle tourna son visage vers lui comme si elle s’était réveillée et ouvrit des yeux ronds.
— Vous étiez là ! Vous étiez là, avec nous, nous étions pris dans une avalanche, nous étions coincés et nous allions mourir !
Il secoua la tête.
— Je ne me souviens pas…
Elle échappa à son étreinte et lui flanqua une bonne gifle. Ses lunettes volèrent à travers la pièce. Elle lui sauta dessus et lui serra la gorge, comme pour l’étrangler, les yeux rivés aux siens. Elle paraissait soudain toute petite.
— Vous étiez là ! s’écria-t-elle. Rappelez-vous, rappelez-vous !
Il eut l’impression de tout revoir dans ses yeux.
— Oh ! fit-il, choqué, voyant à travers elle, tout d’un coup. Oh mon Dieu ! Oh…
Elle le lâcha et il s’écroula. Il tapota le sol comme s’il cherchait ses lunettes.
— Inch Allah, inch Allah… disait-il en tâtonnant dans le noir, avant de lever les yeux vers elle. Vous n’étiez qu’une petite fille…
— Ah ! fit-elle.
Elle se laissa tomber sur le sol, à côté de lui. Elle pleurait à chaudes larmes. Même son nez coulait.
— Ça fait si longtemps. Je me sentais tellement seule. (Elle renifla, s’essuya les yeux.) Ils nous massacraient. Nous massacraient…
— C’est la vie, dit-il en s’essuyant les yeux avec le dos de la main. (Il reprit ses esprits.) Ce sont des choses qui arrivent. Ce sont celles que vous vous rappelez. Vous étiez un jeune garçon noir, autrefois, un beau garçon noir. Je vous vois, à présent. Et vous étiez mon ami, jadis. Nous étions tous les deux des vieillards. Nous étudiions le monde, nous étions amis. Magnifique !
La flamme de la chandelle retrouva lentement sa hauteur normale. Ils restèrent assis par terre, l’un à côté de l’autre, trop épuisés pour bouger.
Pour finir, Pao frappa à la porte quelques coups hésitants, et ils sursautèrent comme s’ils étaient pris en faute, alors qu’ils étaient juste perdus dans leurs pensées. Ils se levèrent, s’assirent sur le banc de fenêtre, et Kang ordonna à Pao de leur apporter du nectar de pêche. Le temps qu’elle revienne, ils avaient repris contenance, Ibrahim avait retrouvé ses lunettes, et Kang avait ouvert les persiennes, laissant entrer l’air de la nuit. Une demi-lune voilée ajoutait sa lumière à celle de la flamme de la bougie.
Les mains encore tremblantes, Kang avala une gorgée de nectar de pêche et grignota une prune. Elle tremblait de tout son corps.
— Je ne sais pas si j’aurai le courage de recommencer, dit-elle en détournant les yeux. C’est trop pénible.
Il hocha la tête. Ils sortirent dans le jardin et s’assirent dans la fraîcheur de la nuit, sous les nuages, en mangeant et en buvant. Ils avaient faim. Une odeur de jasmin emplissait l’obscurité. Ils ne parlaient pas, mais semblaient bien ensemble.
Je suis plus vieille que la Chine elle-même
J’ai parcouru la jungle à la recherche de nourriture,
Vogué sur les sept mers du globe,
Participé à la longue guerre des asuras.
Ils m’ont blessée et j’ai saigné. Bien sûr ; bien sûr.
Pas étonnant que mes rêves soient si agités,
Pas étonnant que je sois si fatiguée.
Pas étonnant que je sois toujours
En colère.
Les nuages s’amoncellent, dissimulant un millier de pics ;
Le vent souffle, éclaircit dix mille arbres.
Viens à moi, mon mari, et vivons
Nos dix prochaines vies tous les deux, ensemble.
Lors de sa visite suivante, Ibrahim avait un air solennel, et on ne l’avait jamais vu aussi bien habillé. Il semblait porter une tenue de religieux musulman.
Après les salutations d’usage, lorsqu’ils furent à nouveau seuls dans le jardin, il se tint debout devant elle et lui dit :
— Je dois retourner au Gansu. J’ai des problèmes de famille à régler. Et mon maître soufi a besoin de moi dans sa madrasa. J’ai retardé mon départ autant que possible, mais il faut vraiment que j’y aille.
Kang détourna le regard.
— J’en serai navrée.
— Oui. Moi aussi. Nous avons encore tant à nous dire.
Silence.
Puis Ibrahim se secoua et reprit la parole :
— J’ai réfléchi à un moyen de résoudre ce problème, cette séparation, si indésirable, et c’est que vous m’épousiez – que vous acceptiez ma demande en mariage et que vous m’épousiez, et que je vous emmène, vos gens et vous, avec moi, au Gansu.
La veuve Kang eut l’air rigoureusement sidérée. Elle le considérait, bouche bée.
— Enfin… Voyons… Je ne peux pas me marier. Je suis veuve.
— Mais les veuves peuvent se remarier. Je sais que les Qing essaient de décourager cette pratique, mais Confucius ne dit rien qui s’y oppose. J’ai cherché, j’ai vérifié auprès des meilleurs experts. Les gens le font.
— Pas les gens respectables !
Il étrécit les yeux, et il eut l’air très chinois, tout à coup.
— Respectables pour qui ?
Elle détourna les yeux.
— Je ne peux pas vous épouser. Vous êtes hui, et je suis celle qui n’est pas encore morte.
— Les empereurs Ming ont ordonné à tous les hui d’épouser de bonnes Chinoises, afin que leurs enfants soient chinois. Ma mère était une Chinoise.
Elle leva les yeux, à nouveau surprise. Elle rougit.
— Je vous en prie, dit-il en tendant la main. Je sais que c’est quelque chose de nouveau. Un choc. Je suis désolé. Réfléchissez-y, s’il vous plaît, avant de me donner votre réponse définitive. Réfléchissez.
Elle se redressa et le regarda avec gravité.
— Je vais y réfléchir.
D’un geste de la main, elle lui signifia son désir de rester seule. Sur une phrase d’adieu, conclue par des mots prononcés intentionnellement dans une autre langue, il se dirigea vers la sortie du domaine.
Ensuite, la veuve Kang arpenta son domaine en long et en large. Pao était dans la cuisine, où elle donnait des ordres aux filles, et Kang lui demanda de venir s’entretenir avec elle au jardin. Pao la suivit, Kang lui dit ce qui était arrivé, et Pao éclata de rire.
Mère de deux fonctionnaires qui connurent une belle réussite, et qu’elle éleva seule, étant veuve.
— Pourquoi ris-tu ? lança Kang. Crois-tu que je me soucie tant du testament d’un empereur Qing ? Que je devrais m’enfermer dans une boîte jusqu’à la fin de mes jours, à cause d’un papier barbouillé d’encre vermillon ?
Pao se figea, d’abord surprise, puis apeurée.
— Mais enfin, maîtresse Kang… Gansu…
— Tu n’y connais rien ! Laisse-moi.
Après cela, personne n’osa plus lui parler. Elle erra dans la maison comme un fantôme affamé, ne reconnaissant personne. C’est à peine si elle parlait. Elle se rendit au Temple du Bosquet de Bambou Pourpre, récita cinq fois le soutra du Diamant, et elle rentra à la maison, les genoux douloureux. Le poème de Li Anzi, « Soudaine Vision des Années », lui revint à l’esprit :
Parfois tous les fils du métier à tisser
Annoncent le tapis à venir.
Nous savons alors que nos futurs enfants
Rêvent de nous dans le bardo.
Nous tissons pour eux de toute la force de nos bras.
Elle ordonna à ses serviteurs de l’emmener en chaise à porteurs chez le magistrat, où elle leur fit poser le palanquin, et ne bougea pas pendant une heure. Les hommes ne voyaient que son visage derrière la gaze qui voilait la fenêtre. Ils la remmenèrent à la maison sans qu’elle soit seulement sortie.
Le lendemain, elle leur demanda de la conduire au cimetière, bien que ce ne soit pas un jour de fête. Sous le ciel vide, elle fit quelques pas, de sa démarche si particulière, balaya les tombes de tous les ancêtres de la famille, et s’assit au pied de la tombe de son mari, la tête dans les mains.
Le jour suivant, elle alla toute seule au bord du fleuve, faisant le chemin à pied, à tout petits pas, en regardant les arbres, les canards, les nuages dans le ciel. Elle s’assit au bord du fleuve, et s’y recueillit comme si elle s’était trouvée dans un temple.
Xinwu était là-bas, comme presque toujours, traînant sa canne à pêche et son panier de bambou. Son visage s’éclaira lorsqu’il la vit, et il lui montra le poisson qu’il avait péché. Il s’assit à côté d’elle, au bord du grand fleuve brun, brillant, compact. Il se remit à pêcher. Elle resta assise là, à l’observer.
— Tu es bon pêcheur, dit-elle en le voyant lancer la ligne dans le courant.
— C’est mon père qui m’a appris, dit-il, avant d’ajouter, au bout d’un moment : Il me manque.
— Moi aussi. Tu crois que… Je me demande ce qu’il en penserait.
Et puis, après une nouvelle pause :
— Si nous partons pour l’ouest, il faudra que tu viennes avec nous.
Elle invita Ibrahim à revenir, et quand il arriva, Pao le conduisit dans le petit salon – que Kang avait fait remplir de fleurs.
Il se tint debout devant elle, tête basse.
— Je suis vieille, lui dit-elle. J’ai traversé tous les âges de la vie. Je suis celle qui n’est pas encore morte. Je ne peux pas revenir en arrière. Je ne vous donnerai pas de fils.
— Je comprends, murmura-t-il. Je suis trop vieux. Et pourtant, je vous demande votre main. Pas pour avoir des enfants. Pour moi.
(« Les âges de la vie » : le lait, les dents, les cheveux relevés, le mariage, les enfants, le riz et le sel, le veuvage.)
Elle le regarda, et se mit à rosir.
— Alors j’accepte votre demande en mariage.
Il sourit.
Après cela, la maisonnée fut comme prise dans un tourbillon. Les serviteurs, même s’ils étaient ouvertement opposés à ce mariage, durent travailler d’arrache-pied tout le jour, tous les jours, pour préparer les lieux à temps pour le quinzième jour du sixième mois, la nuit de la mi-été, traditionnellement propice aux départs en voyage. Les fils aînés de Kang désapprouvaient cette union, bien sûr, mais prirent quand même leurs dispositions pour assister au mariage. Les voisins étaient scandalisés, choqués au-delà de toute expression, mais comme ils n’étaient pas invités, ils n’eurent pas l’occasion d’exprimer leur réprobation aux proches de Kang. Les sœurs de la veuve, au temple, la félicitèrent et lui souhaitèrent bien du bonheur.
— Tu pourras apporter la sagesse de Bouddha à ce hui, lui dirent-elles. Ça pourra servir à tout le monde.
C’est ainsi qu’ils se marièrent lors d’une petite cérémonie à laquelle assistèrent tous les fils de Kang, et seul Shih s’abstint de la féliciter, pour dire le moins. Il passa presque toute la matinée à bouder dans sa chambre, ce que Pao n’osa même pas avouer à Kang. Après la cérémonie, qui eut lieu dans le jardin, le groupe descendit vers le fleuve. Ils avaient beau ne pas être nombreux, ce fut extrêmement chaleureux. Ensuite, tout ce qu’il y avait dans la maison fut mis dans des caisses, les meubles et les objets furent chargés dans des voitures et partirent soit en direction de la nouvelle maison dans l’Ouest, soit vers l’orphelinat que Kang avait contribué à fonder en ville, ou chez ses fils aînés.
Quand tout fut prêt, Kang fit un dernier tour du domaine, s’arrêtant devant chacune des pièces vides pour un dernier coup d’œil. L’endroit paraissait étrangement petit, maintenant.
Ce sacré furlong a contenu ma vie.
Maintenant l’oie s’envole,
Chassée par un phénix venu de l’ouest.
Comment une vie peut-elle changer à ce point ?
Nous vivons vraiment plus d’une vie.
Elle ressortit bientôt et monta dans la chaise à porteurs.
— Tout est parti, complètement parti, dit-elle à Ibrahim.
Il lui tendit un cadeau, un œuf peint en rouge : du bonheur pour la nouvelle année. Elle inclina la tête. Il opina du chef et ordonna à la petite caravane d’entamer le voyage vers l’ouest.
3. Vagues s’entrechoquant
Le voyage dura un peu plus d’un mois. Comme les routes et les chemins étaient secs, ils avancèrent vite. C’était en partie dû au fait que Kang avait demandé à voyager dans une carriole, plutôt que dans un palanquin ou une chaise à porteurs, plus petite. Au début, les serviteurs furent convaincus que ce choix avait été à l’origine d’un différend au sein du nouveau couple, parce que Ibrahim avait tenu à monter avec Kang, dans la voiture couverte, et qu’on les avait entendus se disputer plusieurs jours d’affilée. Mais une après-midi, Pao marcha suffisamment près de la carriole pour comprendre la teneur de leur conversation.
— Ils ne font que parler religion ! dit-elle, soulagée, quand elle revint vers les autres. Belle paire d’intellectuels que ces deux-là !
Les serviteurs rirent, et poursuivirent leur chemin, rassurés. Ils s’arrêtèrent quelque temps à Kaifeng, chez des collègues musulmans d’Ibrahim, repartirent sur les routes qui longeaient la Wei, à l’ouest de Xi’an, dans le Shaanxi, et franchirent quelques cols difficiles, dans d’austères collines, pour arriver enfin à Lanzhou.
Au cours du voyage, Kang alla de surprise en émerveillement.
— Je n’arrive pas à croire que le monde soit tellement vaste, disait-elle à Ibrahim. Que la Chine soit tellement vaste ! Toutes ces rizières, tous ces champs d’orge, et ces montagnes, si vides, si sauvages ! Nous avons bien dû faire le tour du monde, maintenant, non ?
— Nous n’en avons même pas fait le centième, si l’on en croit les marins.
— Ces terres barbares sont si froides, si arides. Tout n’y est que désert et poussière. Comment y garderons-nous une maison propre, ou même chaude ? Autant essayer de vivre en enfer.
— Ce n’est pas aussi terrible, quand même.
— Est-ce que c’est vraiment ça, Lanzhou, la célèbre ville de l’Ouest ? Ce petit village venteux, fait de briques de terre brune ?
— Oui. Mais il se développe rapidement.
— C’est vraiment là que nous allons vivre ?
— Eh bien, j’ai des relations par ici, et à Xining, un peu plus loin vers l’ouest. Nous pourrions aussi nous y installer.
— Allons d’abord voir Xining avant de nous décider. Ça ne peut pas être pire que ça.
Ibrahim ne répondit rien, mais donna l’ordre à leur petite caravane de poursuivre. Quelques jours de route plus tard, alors que le septième mois venait de s’achever, de gros rouleaux de nuages bouillonnants, menaçants, gonflèrent au-dessus d’eux, sans jamais éclater. Sous ce ciel bas, les rudes collines desséchées leur semblèrent plus inhospitalières que jamais, et, à l’exception des terrasses centrales, plates et irriguées, aménagées le long de l’étroite vallée, il n’y avait nulle part trace de travaux agricoles.
— Mais comment font les gens pour vivre ? demanda Kang. De quoi vivent-ils ?
— Ils élèvent des moutons, des chèvres, répondit Ibrahim. Parfois du bétail. C’est comme ça partout, à l’ouest, par-delà le cœur sec du monde.
— Incroyable. On se croirait revenu dans le passé.
Ils atteignirent enfin Xining, encore une petite ville terreuse, brunâtre, blottie sous des montagnes aux versants abrupts, nichée au creux d’une vallée d’altitude. Une garnison de l’armée impériale gardait les portails, et quelques récents baraquements de bois s’élevaient au sein des murs de la ville. Il y avait également un grand caravansérail, mais il était vide. Il était encore trop tôt dans l’année pour commencer à voyager. Derrière, plusieurs ateliers métallurgiques mettaient à profit le faible courant de la rivière pour faire fonctionner leurs forges et leurs presses.
— Argh ! s’écria Kang. Je ne pensais pas qu’il puisse exister un endroit plus poussiéreux que Lanzhou. Apparemment, j’avais tort.
— Attends avant de te décider, suggéra Ibrahim. J’aimerais que tu voies le lac Qinghai. Il n’est plus qu’à une journée de route.
— Nous allons finir par tomber du bord du monde !
— J’aimerais que tu le voies.
Kang accepta sans discuter. En fait, Pao avait l’impression qu’elle appréciait ces régions barbares et terriblement arides, ou qu’en tout cas, elle appréciait le fait de pouvoir s’en plaindre. Plus il y avait de poussière, mieux c’était, semblait dire son expression, quoi qu’elle dise.
Quelques jours plus tard, au bout d’une mauvaise route vers l’ouest, ils sortirent d’un défilé qui donnait sur les rives du Qinghai. Il était si beau qu’ils en restèrent sans voix. Le hasard avait voulu qu’il y ait ce jour-là beaucoup de vent, et de grands et longs nuages blancs couraient sur le ciel bleu-gris, comme des motifs brodés. Le soleil brillait, faisant se refléter les nuages à la surface du lac, les irisant de tons de jade, ainsi que son nom le laissait entendre. À l’ouest, le lac se fondait dans l’horizon ; on ne voyait de ses rives qu’une crête de collines vertes. Qu’un tel endroit existât, au milieu d’une telle désolation de bruns, tenait du miracle.
Kang descendit de la carriole et marcha doucement vers la plage de galets, en récitant le soutra du Lotus, écartant les mains pour sentir le vent sur ses paumes, à la fois fort et doux. Ibrahim la laissa seule quelques instants, puis la rejoignit.
— Pourquoi pleures-tu ? s’inquiéta-t-il.
— « Alors, voici le grand lac », récita-t-elle.
Maintenant enfin je comprends
L’immensité de l’univers ;
Ma vie y gagne un nouveau sens !
Mais pense à toutes ces femmes
Qui ne sortent jamais de chez elles,
Et qui auront vécu leur vie
Sans voir un tel endroit !
Ibrahim s’inclina.
— Tout à fait. De qui est ce poème ?
Elle secoua la tête, pour chasser ses larmes.
— De Yuen, la femme de Shen Fu, quand elle a vu le T’ai Hu. Le Grand Lac ! Je me demande ce qu’elle aurait pensé si elle avait vu celui-ci ! C’est dans les Six récits au fil inconstant des jours. Tu connais ? Non. Bien. Que dire alors ?
— Rien.
— Parfaitement.
Elle se tourna vers lui, les mains jointes.
— Merci, cher mari, de m’avoir montré ce grand lac. Il est vraiment magnifique. Maintenant, je peux m’arrêter. Vivons où tu voudras. Xining, Lanzhou, à l’autre bout du monde, où nous nous sommes déjà rencontrés, dans une autre vie – où tu voudras. Je serai bien partout.
Elle s’appuya sur lui, versant de nouvelles larmes.
Dans un premier temps, Ibrahim décida qu’ils s’installeraient à Lanzhou. L’accès au corridor de Gansu y était plus facile, les routes vers l’ouest et la Chine intérieure plus accessibles. En outre, la madrasa dont il avait été le plus proche dans sa jeunesse venait de s’établir à Lanzhou, car elle avait été obligée de quitter Xining, sous la pression du trop grand nombre d’arrivants musulmans occidentaux.
Ils s’installèrent dans un petit domaine aux murs de terre brune au bord de la rivière Tao, non loin de l’endroit où elle se jetait dans le Fleuve Jaune. Les eaux du Fleuve Jaune étaient effectivement jaunes, d’un jaune opaque, terreux, tourbillonnant, très exactement de la couleur des collines où il avait sa source. La Tao, elle, était brunâtre, mais un peu plus claire.
Ils jouissaient de plus de place que dans l’ancienne demeure de Kang, à Hangzhou. Les premiers jours, la veuve décréta que les femmes seraient installées dans un bâtiment à l’arrière, autour duquel elle posa les marques d’un futur jardin, dont elle commanda aussitôt les premiers arbres. Elle entendait paysager tout le domaine. Elle voulut également installer des métiers à tisser, mais Ibrahim lui fit remarquer qu’ici, faute de bosquets de mûriers ou de filatures, ils auraient le plus grand mal à se procurer du fil de soie. Si elle voulait continuer à tisser, il lui faudrait apprendre à travailler la laine. Ce dont elle convint, dans un soupir. Elles commencèrent rapidement à travailler, sur des métiers manuels, tout en continuant les ouvrages de soie débutés à Hangzhou.
Pendant ce temps, Ibrahim se rendait à des réunions de travail avec ses anciens compagnons des écoles musulmanes. Il rencontra également les nouveaux fonctionnaires Qing de la ville, et les aida à mettre un peu d’ordre dans cette région, qui, il fallait bien le reconnaître, avait beaucoup changé sur les plans politique et religieux depuis son départ. La nuit venue, il s’asseyait avec Kang sur la véranda dominant les flots boueux de la rivière, et répondait à ses incessantes questions :
(Tromper le peuple est un très grave forfait en Chine.)
— Pour simplifier légèrement, depuis que Ma Laichi est revenu du Yémen, avec des textes parlant de renouveau et de changement religieux, il y a eu des conflits avec les musulmans de cette partie du monde. Il faut que tu comprennes que les musulmans vivent ici depuis des siècles, presque depuis les débuts de l’islam, en fait. Mais ils se trouvaient si loin de La Mecque et des autres centres religieux de l’islam que de nombreuses dissidences et hérésies se produisirent. Ma Laichi voulait les réformer, mais l’ancienne oumma établie ici le traîna en justice, devant la cour civile Qing, l’accusant de huozhong.
Le visage de Kang se durcit. Il ne faisait aucun doute qu’elle se rappelait les conséquences de ce type de tromperie, en Chine intérieure.
— Pour finir, le gouverneur général du pays, Paohang Guangsi, refusa de traiter le cas. Mais Ma Laichi n’était pas au bout de ses peines pour autant. Il chercha à convertir les Salars à l’islam – un peuple de nomades, qui parlent un sabir dérivé du turc. Tu en as déjà vu : ce sont ceux qui n’ont pas l’air chinois, et qui portent de petits bonnets blancs.
— Ils te ressemblent.
— Un petit peu, c’est possible, répondit Ibrahim en fronçant les sourcils. Quoi qu’il en soit, les gens commencèrent à s’agiter. On disait que les Salars étaient dangereux.
— Je peux le comprendre, c’est vrai qu’ils en ont l’air.
— Et tu dis qu’ils me ressemblent ! Enfin, peu importe. De toute façon, il y a beaucoup d’autres forces dans l’islam, parfois en lutte les unes contre les autres. Une nouvelle secte, les Naqshabandis, prône un retour à un islam plus pur, plus orthodoxe, comme aux premiers temps. Leur chef, en Chine, s’appelle Aziz Ma Mingxin. Lui aussi, comme Ma Laichi, a passé de nombreuses années au Yémen et à La Mecque, étudiant avec Ibrahim ibn Hasa al-Kurani, un cheikh très important, dont les prêches sont écoutés dans le monde entier.
» Un jour, ces deux grands cheikhs rentrèrent d’Arabie avec des idées de profondes réformes, qu’ils avaient eues en étudiant avec les mêmes gens. Malheureusement, ce n’étaient pas les mêmes réformes. Ma Laichi prônait la récitation silencieuse des prières, la dhikri, alors que Ma Mingxin, plus jeune, avait étudié sous l’égide de professeurs qui disaient que les prières pouvaient être chantées à voix haute.
— Cela me paraît être une différence mineure.
— Tout à fait.
Quand Ibrahim ressemblait à un Chinois, cela voulait dire que sa femme l’amusait.
— Le bouddhisme autorise les deux.
— Effectivement. Mais elles sont le signe de divisions plus profondes, comme toujours. En tout cas, Ma Mingxin pratiquait la prière jahr, ce qui signifie « dite à haute voix ». Cela déplut à Ma Laichi et aux siens, puisque c’était le signe à la fois d’une nouvelle forme de religion et d’une religion plus pure, qui venait dans ce pays. Pourtant, ils ne pouvaient pas l’empêcher de s’étendre. Ma Mingxin était soutenu par les soufis de la Montagne Noire, qui contrôlaient les deux versants du Pamir, attirant un nombre sans cesse croissant de fidèles, chassés par les guerres que se livraient les Iraniens et les Ottomans, les Ottomans et les Fulanis.
— On dirait vraiment que tout le monde se bat chez vous.
— Oui, heu, il faut bien admettre que l’islam n’est pas aussi bien organisé que le bouddhisme, dit-il en plaisantant.
Ce qui fit rire Kang.
— Cela dit, tu as raison, c’est effectivement un problème, poursuivit-il. Tant que Ma Laichi et Ma Mingxin seront en désaccord, l’espoir de nous voir un jour tous unis restera vain. La Khafiyya de Ma Laichi collabore avec les Qing, et ils qualifient la pratique de la Jahriyya de superstitieuse, et même d’immorale.
— Immorale ?
— À cause des danses et du reste. Les mouvements en rythme que l’on fait en priant, et même le fait de prier à haute voix.
— Pourtant, cela me paraît tellement banal. Prier c’est prier, après tout.
— Oui. C’est pourquoi la Jahriyya s’est défendue en accusant la Khafiyya de n’être qu’un culte de la personnalité, voué à Ma Laichi. Et ils l’accusèrent de prévarication, disant que son mouvement avait pour seul but de le conduire au pouvoir et d’amasser des richesses. Tout cela avec la complicité de l’empereur, et contre les autres musulmans.
— Ennuis en perspective…
— Oui. Tu comprends, tout le monde par ici porte une arme. Il s’agit généralement de fusils, comme tu l’as vu au cours du voyage, parce que la chasse est importante, dans cette région, pour se nourrir. Tant et si bien que chaque mosquée a sa milice, prête à donner un coup de main en cas de bagarre, et que les Qing ont renforcé leurs garnisons, pour essayer de calmer tout ça. Jusqu’à présent, les Qing ont soutenu la Khafiyya, qu’ils ont traduite par « Vieil Enseignement », de même qu’ils ont traduit la Jahriyya par « Nouvel Enseignement ». Ce sont dans les deux cas de mauvaises traductions, de toute façon. Mais ce qui est mauvais pour la dynastie des Qing est justement ce qui attire tant de jeunes musulmans. Et beaucoup de choses sont nouvelles par ici. À l’ouest de la Montagne Noire, les choses changent de plus en plus vite.
— Comme toujours.
— Oui, mais plus vite encore.
— La Chine est un pays où les choses changent lentement, dit doucement Kang.
— Ou, en fonction du tempérament de l’empereur, ne changent pas du tout. En tout cas, ni la Khafiyya ni la Jahriyya ne sont plus fortes que l’empereur.
— Tout à fait.
— Le résultat, c’est qu’elles passent leur temps à se battre entre elles. Et comme les armées Qing contrôlent maintenant l’ensemble des territoires jusqu’au Pamir, territoires qui étaient autrefois composés d’émirats musulmans indépendants, la Jahriyya est persuadée que tout doit redevenir comme avant, comme à l’époque du Dar al-Islam.
— Je doute que l’empereur apprécie.
— Moi aussi. Mais la plupart de ceux qui veulent ces choses ne sont jamais allés en Chine intérieure, et y ont encore moins vécu, contrairement à nous. Ils ne connaissent donc pas la puissance de la Chine. Ils ne voient d’elle que de petites garnisons, et quelques soldats, envoyés par dix ou vingt, partout dans cet immense pays.
(Dans ce cas, « mauvaise énergie », mais on peut également traduire par « essence vitale », « médium psychophysique », ou « mauvaises vibrations ».)
— Pourtant, cela pourrait changer les choses. Bien. On dirait que tu m’as emmenée dans une terre gorgée de ki.
— J’espère que cela ne se passera pas trop mal. Ce qu’il faudrait à mon avis, ce serait une sorte d’histoire complète, et analytique, qui ferait apparaître les bases communes des enseignements de l’islam et de Confucius.
Kang haussa les sourcils.
— Ah bon, tu crois ?
— J’en suis sûr. En tout cas, c’est à ça que je travaille depuis une vingtaine d’années.
Kang eut l’air intéressée :
— Il faudra que tu me montres tes travaux.
— Avec grand plaisir. Peut-être pourrais-tu m’aider à les traduire en chinois ? J’ai l’intention d’en publier des versions en chinois, en persan, en turc, en arabe, en hindi, et dans bien d’autres langues. Je vais avoir besoin de traducteurs.
— Je t’aiderai avec plaisir, dit Kang avec un sourire. Si je ne suis pas trop ignorante.
Bientôt, la maisonnée trouva son rythme. Chacun vaquait à ses occupations, selon la même routine qui prévalait avant leur déménagement. Les quelques Chinois han qui vivaient exilés dans cette terre lointaine respectaient les mêmes célébrations, les mêmes fêtes qu’eux. Les jours de fête, ils construisaient des temples en haut des falaises qui dominaient les fleuves. Les jours saints de l’islam, qui étaient des événements importants pour la plupart des habitants de la ville, s’ajoutaient à ces fêtes.
Chaque mois, de nouveaux musulmans arrivaient de l’ouest. Des musulmans ; des confucéens ; quelques bouddhistes, ces derniers généralement mongols ou tibétains ; presque pas de taoïstes. Lanzhou était d’abord une ville musulmane, ou chinoise han, dont les communautés avaient du mal à coexister, malgré plusieurs siècles de voisinage. On ne se retrouvait qu’en de rares occasions, par exemple lors des mariages mixtes, qui étaient peu fréquents.
La nature bipartite de la région causa immédiatement quelques difficultés à Kang, qui avait des dispositions à prendre pour Shih. S’il voulait continuer ses études, en vue de passer les examens du gouvernement, il était temps de lui trouver un tuteur. Mais il n’en voulait pas. L’autre possibilité était de l’envoyer étudier dans l’une des madrasas locales, et donc qu’il se convertisse à l’islam. Ce qui était impensable – en tout cas pour Kang. Shih et Ibrahim considéraient pourtant que ça n’était pas inenvisageable. Shih demanda un délai de réflexion, avant de se décider. Je n’ai que sept ans, disait-il. Est ou ouest, il faut que tu choisisses, répondait Ibrahim. En tout cas, disaient Kang et Ibrahim, il faut que tu choisisses.
Kang insista pour qu’il poursuive ses études afin de passer les examens impériaux.
— C’est ce que ton père aurait voulu.
Ibrahim était d’accord. Un jour ou l’autre, très probablement, il finirait par repartir vers la Chine intérieure, où la réussite de ses examens était l’une des conditions qui permettaient d’avancer dans la vie.
Shih, pourtant, n’avait aucune envie d’étudier. Il affecta de s’intéresser à l’islam, ce qu’Ibrahim ne pouvait évidemment pas désapprouver, même s’il restait discret. Mais l’intérêt enfantin de Shih se portait surtout sur les mosquées de la Jahriyya, pleines de chants, de musique, de danses, et où même, parfois, on buvait du vin, tout en se flagellant. Ces ferventes démonstrations de la foi évitaient de trop avoir à penser, et présentaient l’avantage supplémentaire, aux yeux du gamin, d’offrir quelques bagarres avec les jeunes de la Khafiyya.
— La vérité, dit amèrement Kang, c’est qu’il préfère les cours qui lui demanderont le moins de travail. Mais je veux qu’il passe ses examens, même s’il choisit de devenir musulman.
Ibrahim était d’accord avec elle, et Shih fut obligé par l’un et l’autre de s’atteler à ses études. Il s’intéressa moins à l’islam, puisque devenir musulman impliquait de suivre davantage de cours. Il estimait avoir déjà trop de travail.
Il n’aurait pourtant pas dû lui être si difficile de se consacrer à l’étude et aux livres, qui constituaient l’une des principales activités des gens de la maison. Kang avait profité de leur départ à l’ouest pour réunir tous les poèmes en sa possession dans un coffre. Elle laissait désormais aux filles le gros des travaux de tissage et de broderie, et elle passait la majeure partie de son temps à parcourir ses épaisses liasses de papier, relisant ses volumineux recueils de poèmes, ainsi que ceux de ses amis, de sa famille, ou d’étrangers, qu’elle avait réunis pendant toutes ces années. Les femmes de la haute société de la Chine du Sud avaient écrit des poèmes de façon convulsive pendant la quasi-totalité des dynasties Ming et Qing. Grâce au petit échantillonnage qu’elle avait recueilli – qui se montait tout de même au nombre de vingt-six mille –, elle put faire part à Ibrahim du schéma qu’elle commençait d’entrevoir dans le choix des thèmes récurrents de ces poèmes : la souffrance du concubinage ; l’enfermement et les restrictions physiques (elle était trop pudique pour préciser ce qu’elles étaient vraiment, et Ibrahim évita soigneusement de regarder ses pieds, ne la quittant pas des yeux) ; le travail répétitif et éreintant de ces années de riz et de sel ; la douleur, le danger et la joie d’enfanter ; l’important traumatisme que représentait le fait d’être élevée comme un animal domestique, dévolu à être marié, et à devenir une sorte d’esclave pour la famille de son mari. Kang parlait avec émotion du sentiment permanent de rupture et de dislocation causé par cet événement pourtant si banal de la vie des femmes :
— C’est comme être réincarnée, mais en se souvenant de tout. Une mort et une renaissance dans un monde moins bon, où l’on n’est plus qu’une sorte de fantôme affamé, une bête de somme, ou les deux, et où l’on se souvient parfaitement de cette lointaine époque où l’on se rêvait reine du monde ! Pour les concubines, c’est pire : c’est une descente au royaume des bêtes et des prêtas qui mène en Enfer ! Et dire qu’il y a plus de concubines que de femmes…
Ibrahim l’écoutait en hochant la tête, l’encourageant à composer des poèmes sur ces sujets, et à recueillir les meilleurs poèmes en sa possession, afin d’en faire une anthologie, comme celle de Yun Zhu, « Des débuts corrects », récemment publiée à Nanjing.
— Comme elle le dit elle-même dans son introduction, fit remarquer Ibrahim, « Pour chacun de ceux que j’ai conservé, il doit y en avoir dix mille autres que je n’ai pas gardés ». Et combien parmi ces dix milliers de poèmes sont plus beaux, plus dangereux que les siens ?
— Neuf mille neuf cents, répondit Kang, qui pourtant appréciait beaucoup l’anthologie de Yun Zhu.
Elle commença donc à préparer sa propre anthologie. Ibrahim l’aida, en demandant à ses collègues, de la Chine intérieure, mais aussi de l’Ouest et du Sud, de leur envoyer tous les poèmes écrits par des femmes qu’ils pourraient trouver. Le temps passant, de nombreux poèmes arrivèrent, comme des grains de riz dans un bol, jusqu’à ce que des pièces entières de leur nouveau domaine fussent pleines de papiers, que Kang classait soigneusement par auteur, par province, par dynastie, etc. Elle passait le plus clair de son temps à son travail, qui semblait l’absorber complètement.
Un jour, elle alla trouver Ibrahim, une feuille à la main.
— Écoute, dit-elle d’une voix étranglée. C’est un poème de Kang Lanying intitulé « La nuit où je donnai naissance à mon premier enfant ».
Elle lut :
La nuit où je donnai naissance à mon premier enfant,
Le fantôme du vieux moine Bai
M’est apparu. Il a dit,
S’il vous plaît, madame, permettez que je revienne,
Comme votre enfant. C’est alors que je sus
Que la réincarnation était une réalité. Je répondis,
Qui étiez-vous, quel genre de personne êtes-vous,
Pour remplacer l’âme qui est déjà en moi ?
Il dit, je vous ai déjà vue.
Je vous ai suivie à travers les âges
En essayant de vous rendre heureuse.
Laissez-moi revenir,
Et j’essaierai encore.
Kang regarda Ibrahim, qui se frottait la barbe.
— Cela a dû lui arriver comme cela nous est arrivé, dit-il. Ce sont ces moments-là qui nous font comprendre que quelque chose de plus important est en jeu.
Quand elle ne travaillait pas sur son anthologie, Kang Tongbi aimait à se promener, parfois, l’après-midi, dans les rues de Lanzhou. C’était quelque chose de nouveau. Elle emmenait une servante, et deux de leurs serviteurs les plus costauds, des musulmans, portant une longue barbe, une épée courbe passée à la ceinture. Elle arpentait les rues, les berges de la rivière, la pathétique grand-place de la ville, les marchés poussiéreux qui l’entouraient, et la promenade au-dessus des murailles de la ville, d’où l’on avait une bonne vue sur la rive sud de la rivière. Elle acheta plusieurs paires différentes de « sandales papillons », ainsi qu’on les appelait, qui seyaient à ses petits pieds délicats et, les prolongeant, leur donnaient en même temps l’apparence de pieds normaux, lui permettant parfois – en fonction de la façon et du matériau dont elles avaient été faites – de se sentir plus légère, plus sûre d’elle. En fait, elle achetait toutes les sandales papillons qui ne ressemblaient pas à celles qu’elle avait déjà. Aucune, se disait Pao, ne paraissait l’aider beaucoup à marcher – elle se déplaçait toujours aussi lentement, de cette même démarche, faite de petits pas et de déhanchements. Mais elle préférait marcher plutôt qu’être portée, malgré les rues non pavées et poussiéreuses de la ville, trop chaudes ou trop froides, toujours venteuses. Elle marchait en observant chaque chose très attentivement, profitant du fait qu’elle se déplaçait lentement.
— Pourquoi ne voulez-vous pas vous promener en chaise à porteurs ? l’interrogea Pao, un jour qu’ils rentraient en traînant la patte, épuisés.
Kang répondit simplement :
— Parce que, comme je l’ai lu ce matin : « De grands principes pèsent aussi lourd qu’un millier d’années. Cette vie au fil inconstant des jours est aussi légère qu’un grain de riz. »
— Pas pour moi.
— Parce que toi, au moins, tu as de bons pieds.
— Ce n’est pas vrai. Grands peut-être, mais cela ne les empêche pas de me faire mal. Je n’arrive pas à croire que vous refusiez cette chaise.
— Il faut bien avoir des rêves, Pao.
— Aaah… je ne sais pas. Comme le disait souvent ma mère, une peinture de gâteau de riz n’a jamais rassasié personne.
— Le moine Dogen, entendant cela, avait répondu : « Si la peinture de la faim te reste étrangère, tu ne seras jamais une vraie personne. »
Chaque année, à l’occasion de la fête d’équinoxe du printemps, du bouddhisme et de l’islam, ils allaient au lac Qinghai, et s’asseyaient sur les berges de la grande mer de jade, pour renouveler leur engagement à vivre, brûlant de l’encens et des billets de papier, priant, chacun à sa façon. Revivifiée par la magnificence de ces paysages, Kang, de retour à Lanzhou, se jetait dans divers projets avec une intensité terrifiante. Autrefois, à Hangzhou, ses servantes s’émerveillaient de sa capacité de travail. Maintenant, elle les effrayait. Elle faisait en une journée ce qu’une personne normale faisait en une semaine.
Pendant ce temps, Ibrahim continuait d’œuvrer à la réconciliation des deux religions, qui s’affrontaient dans le Gansu, sous leurs yeux. Le corridor de Gansu était la grande passe reliant les moitiés orientale et occidentale du monde. Et les longues caravanes de chameaux qui allaient depuis des temps immémoriaux vers Shaanxi, à l’est, ou le Pamir, à l’ouest, étaient maintenant rejointes par d’immenses convois de chars à bœufs, venus essentiellement de l’ouest. Des musulmans et des Chinois s’installèrent dans la région, et Ibrahim alla trouver les chefs des différentes factions. Le reste du temps, il réunissait des textes, les lisait, écrivait à des chercheurs partout dans le monde, et passait plusieurs heures par jour à rédiger ses propres ouvrages. Kang l’aidait dans son travail, comme il l’aidait dans le sien, mais, les mois passant, et les conflits dans la région gagnant en virulence, l’aide qu’elle lui apportait tournait de plus en plus à la critique. Elle lui mettait la pression – ainsi qu’il le lui fit quelquefois remarquer, quand il se sentait fatigué, ou sur la défensive.
Kang se montrait impitoyable, comme d’habitude.
— Regarde, disait-elle, tu ne te sortiras pas de ces problèmes avec de beaux discours. Les différences sont les différences ! Regarde, là, ton Wang Daiyu, ce génial penseur, le mal qu’il se donne pour faire correspondre les Cinq Vertus du confucianisme et les Cinq Piliers de l’islam.
— Il a pourtant raison, dit Ibrahim. Ensemble, ils se combinent pour créer les Cinq Constantes, ainsi qu’il les appelle, valables pour tous, partout, et immuablement. Le fondement de l’islam c’est la bienveillance de Confucius, ou ren. La charité c’est le yi, ou droiture. La prière c’est le li, ou propriété, le jeûne c’est le shi, ou savoir. Le pèlerinage c’est le xin, ou foi dans l’humanité.
— Mais écoute un peu ce que tu dis ! s’exclama Kang en levant les mains au ciel. Ces concepts n’ont quasiment rien à voir les uns avec les autres ! La charité ce n’est pas la droiture, pas du tout ! Le jeûne ce n’est pas le savoir ! Il n’y a donc rien d’étonnant à ce que ton professeur de la Chine intérieure, Liu Zhi, identifie les mêmes Cinq Piliers de l’islam, non avec les Cinq Vertus, mais avec les Cinq Relations, le wugang, pas le wuchang ! Et lui aussi a dû infléchir le sens des mots, des concepts, et les transformer totalement afin de permettre les correspondances entre chacun des deux groupes. Dans les deux cas, c’est pitoyable ! Si tu veux faire comme eux, alors tout va avec tout.
Ibrahim se renfrogna. Mais il ne la contredit pas, se contentant de lui signaler :
— Liu Zhi ne cache pas qu’il y a des divergences entre les deux systèmes, mais il a cherché leurs points communs. Pour lui, la Voie du Ciel, ou tiando, est mieux comprise par l’islam ; et la Voie de l’Humanité, rendao, par le confucianisme. C’est pourquoi le Coran reste le « livre sacré », tandis que les Analectes expriment des principes fondamentaux pour tous les êtres humains.
Kang hocha la tête, encore une fois.
— Peut-être, mais les mandarins de l’intérieur ne voudront jamais croire que le Livre sacré du Ciel a été donné par Tiangfang. D’ailleurs, comment le pourraient-ils ? Il n’y a que la Chine qui compte pour eux. Le Royaume du Milieu, à mi-chemin de la terre et du ciel ; le Trône du Dragon, maison de l’Empereur de Jade – le reste du monde n’est peuplé que de barbares, et une chose aussi sacrée que le Livre du Ciel ne peut en venir. De même, pour tes cheikhs et tes califes, à l’ouest, comment pourraient-ils accepter la Chine, qui ne croit pas en leur Dieu unique ? Alors que c’est le point le plus important de leur foi ! Comme s’il pouvait n’y avoir qu’un seul dieu…, murmura-t-elle.
Une fois encore, Ibrahim parut troublé. Mais il insista :
— Dans le fond, c’est pareil. Et l’empire s’étendant vers l’ouest, et de plus en plus de musulmans allant vers l’est, il faudra bien faire la synthèse. Sinon, nous courons à la catastrophe.
— Peut-être, reconnut Kang en frémissant. Mais en même temps, on ne mélange pas l’huile et le vinaigre.
— Les idées ne sont pas des produits chimiques. Ou alors ils sont comme le mercure et le soufre des taoïstes, qui se mêlent pour faire toute chose.
— Par pitié, ne me dis pas que tu as envie de te faire alchimiste !
— Mais non. Seulement dans le royaume des idées, où le grand œuvre reste à accomplir. Après tout, regarde ce que les alchimistes ont réussi à faire dans le monde matériel. Toutes ces nouvelles machines, tous ces nouveaux objets…
— La pierre est plus malléable que les idées.
— J’espère bien que non. Tu dois pourtant reconnaître qu’on a déjà vu dans l’histoire d’autres grandes collisions entre des civilisations différentes former des cultures syncrétiques. En Inde, par exemple, les invasions de l’islam ont conquis une civilisation hindoue très ancienne, et les deux se sont souvent affrontées ; le prophète Nanak a pourtant réussi à fusionner les deux, pour donner les Sikhs, qui croient en Allah et au karma, à la réincarnation et au jugement de Dieu. Il a trouvé l’harmonie derrière la discordance, et maintenant les Sikhs sont l’un des groupes l’un plus puissants d’Inde. C’est en fait le plus grand espoir de l’Inde, entre les guerres et les troubles qui la ravagent. Nous avons besoin de quelque chose comme ça.
Kang hocha la tête.
— Il se peut que nous l’ayons déjà. Depuis longtemps peut-être, bien avant Mahomet, bien avant Confucius.
— Que veux-tu dire ?
— Je parle du bouddhisme.
Ibrahim fit la grimace, ce qui déclencha chez Kang un de ces éclats de rire dont on se demandait s’ils étaient bienveillants. Elle se moquait de lui tout en étant sérieuse, ce qui était assez caractéristique de ses rapports avec son mari.
— Tu dois bien admettre que ce n’est pas le matériel qui manque. Il y a plus de bouddhistes dans ces terres dévastées que partout ailleurs.
Il marmonna quelque chose à propos de Lanka et de la Birmanie.
— Oui, oui, dit-elle. Et aussi le Tibet, la Mongolie, les Annamites, les Thaïs et les Malais. Ils ont toujours été là, tu vois, à la frontière de la Chine et de l’islam. Toujours été là. Et leur enseignement est fondamental. Tout à fait essentiel.
— Il va falloir que tu me l’apprennes, dit Ibrahim dans un soupir.
Elle sourit, ravie.
Cette année-là, dans la quarante-sixième année du règne de l’empereur Qianlong, un afflux de familles musulmanes, avec femmes et enfants, et même des animaux, beaucoup plus important que les années précédentes, arriva de l’ouest, par l’ancienne route de la Soie. Ils parlaient toutes sortes de langues. Des villages entiers, des villes même, s’étaient vidés, et leurs habitants étaient partis vers l’est, apparemment chassés par la guerre toujours plus intense entre les Iraniens, les Afghans et les Kazakhs, et la guerre civile au Fulan. La plupart de ces nouveaux arrivants étaient chiites, dit Ibrahim. Mais il y avait aussi d’autres sortes de musulmans : des Naqshabandis, des wahhabites, et différents types de soufis… Enfin, c’est ce qu’Ibrahim essayait d’expliquer à Kang. Mais elle se contentait de pincer les lèvres, et disait d’un ton réprobateur :
— L’islam est aussi cassé qu’un calice tombé à terre.
Plus tard, quand de violents heurts opposèrent les musulmans déjà établis aux nouveaux arrivants, elle fit ce commentaire :
— On dirait qu’ils font exprès de jeter de l’huile sur le feu. Ils vont finir par s’entretuer.
Elle n’avait pas l’air particulièrement alarmée. Shih avait encore demandé à aller étudier dans une qong de la Jahriyya, prétextant qu’il désirait vraiment se convertir à l’islam. Mais tout ce que sa mère entendit, c’est qu’il en avait de nouveau assez d’étudier, et que ce petit-là avait très envie de se rebeller. Elle avait eu largement le temps, et de multiples occasions, d’observer les femmes musulmanes de Lanzhou, et elle qui trouvait déjà les femmes chinoises opprimées par les hommes déclara que le sort des musulmanes était encore pire, et de loin.
— Regarde ça, dit-elle un jour à Ibrahim, alors qu’ils prenaient l’air sur leur véranda. Elles sont cachées comme des déesses derrière leurs voiles, mais on les traite comme des vaches. Ils ont le droit d’en épouser autant qu’ils veulent, ce qui fait qu’aucune ne bénéficie du soutien de sa famille. Et pas une seule ne sait lire. Quelle honte !
— Les Chinois ont bien des concubines, rétorqua Ibrahim.
— Nulle part il ne fait bon être une femme, répondit Kang, énervée. Les concubines ne sont pas des femmes, elles n’ont pas les mêmes droits que les épouses.
— Alors, les choses ne sont supportables en Chine que pour les femmes mariées ?
— Comme partout ailleurs. Mais ne pas savoir lire, même quand on est la fille d’un homme riche et cultivé… ! Ne pas pouvoir lire, ne pas pouvoir écrire à ses parents, à ses frères, à ses sœurs !
Autant de choses que Kang ne faisait jamais, mais Ibrahim se garda bien de lui en faire la remarque. Il se contenta de hocher la tête, gravement.
— Le sort des femmes était pire, avant que Mahomet n’apporte l’islam au monde.
— En disant cela, tu ne dis pas grand-chose ! Que la vie était dure, alors, il y a plus de mille ans, c’est ça ? Ce devait être de sacrés barbares ! Il y avait déjà plus de deux mille ans que les Chinoises jouissaient de certains privilèges.
Ibrahim fronça les sourcils et baissa la tête. Il ne répondit rien.
Ils virent que les choses changeaient, partout dans Lanzhou. Les mines de fer du Xinjiang alimentaient les fonderies que l’on construisait en amont et en aval de la ville. Le nouvel afflux de population fournit la main-d’œuvre nécessaire à une rapide croissance industrielle, surtout dans la métallurgie et dans le bâtiment. Les forges produisaient principalement des canons, de telle sorte que la garnison de la ville fut encore renforcée ; à la Garde Verte régulière de la Chine s’ajoutèrent les cavaliers mandchous. Les forges avaient l’obligation de vendre leurs canons au Qianlong, et les armes prirent la route de l’est, vers l’intérieur exclusivement. Comme la plupart des travailleurs étaient musulmans – et Dieu sait si ce travail était pénible – quelques fusils prirent cependant le chemin de l’Ouest, en dépit des interdictions chinoises. Résultat : on renforça encore la surveillance militaire, il y eut davantage de soldats chinois, plus de bannières mandchoues – et les heurts entre les militaires et les ouvriers se multiplièrent. Cette situation ne pouvait pas durer.
Les plus anciens habitants regardaient, impuissants, la situation dégénérer. Aucun individu, seul, ne pouvait rien changer. Ibrahim s’évertua à essayer de maintenir de bonnes relations entre les hui et l’empereur, mais cela lui valut quelques ennemis parmi les récents arrivants, qui prônaient le renouveau et le jihad.
Au milieu de toute cette agitation, Kang annonça un jour à Pao qu’elle était enceinte. Pao n’en revenait pas, et Kang elle-même n’avait pas l’air d’y croire.
— On peut toujours s’arranger pour vous faire avorter, murmura Pao, le regard en biais.
Kang refusa poliment.
— Il faut que je me fasse à l’idée d’être mère à mon âge. Vous devez m’aider.
— Nous vous aiderons, ne vous inquiétez pas.
Ibrahim lui aussi fut surpris par la nouvelle, mais il annonça vite :
— C’est une bonne chose qu’un enfant naisse de notre union. Un peu comme nos livres, mais vivant.
— Ce sera peut-être une fille.
— Si telle est la volonté d’Allah, qui suis-je pour m’y opposer ?
Kang le considéra gravement, hocha la tête, puis s’éloigna.
Dorénavant, elle ne sortait plus que rarement dans les rues, et seulement la journée, en chaise à porteurs. La nuit, de toute façon, c’était bien trop dangereux. Les gens respectables ne s’aventuraient plus jamais dehors après le coucher du soleil ; il n’y avait que des bandes de jeunes hommes, souvent soûls, de la Jahriyya ou de la Khafiyya, ou d’aucune des deux, même si d’ordinaire la plupart des bagarres étaient à mettre sur le compte de la Jahriyya. Les bavards contre les sourds-muets, disait Kang avec mépris.
En effet, ce furent des bagarres entre musulmans qui furent à l’origine des premiers troubles très importants. Tel était du moins l’avis d’Ibrahim. Suite aux heurts entre la Jahriyya et la Khafiyya, un détachement arriva, avec un haut fonctionnaire Qing, Xinzhu, qui se rendit chez le préfet de la ville, Yang Shiji. Ibrahim revint d’une réunion avec ces deux personnages, profondément troublé.
(Le changement de dynastie.)
— Ils ne comprennent pas, dit-il. Ils parlent d’insurrection, mais ici personne ne parle de la Grande Entreprise. Et que pourraient-ils dire ? Nous sommes si loin de l’intérieur, ici, que personne ou presque ne sait ce qu’est la Chine. Il ne s’agit que de conflits régionaux, et ils débarquent ici, en pensant qu’il s’agit d’une vraie guerre.
Malgré les mises en garde d’Ibrahim, la nouvelle administration fit arrêter Ma Mingxin. Ibrahim hocha sombrement la tête. Ensuite, les nouveaux détachements se déplacèrent dans la campagne à l’ouest.
Ils rencontrèrent le chef de la Salar Jahriyya, Su Quarante-Trois, à Baizhuangzi. Les Salars avaient caché leurs armes, et prétendirent suivre le Vieil Enseignement. Entendant cela, Xinzhu leur annonça qu’il comptait mettre un terme au Nouvel Enseignement ; les hommes de Su les attaquèrent aussitôt et poignardèrent Xinzhu et Yang Shiji.
Quand on apprit ce qui s’était passé à Lanzhou, grâce à des cavaliers mandchous qui avaient réussi à s’échapper, Ibrahim geignit de colère et de dépit.
— Maintenant, c’est vraiment une insurrection, dit-il. Sous la loi des Qing, tout ira très mal pour tout le monde. Comment ont-ils pu être aussi stupides ?
(Sortes de bouées gonflables, à l’aide desquelles des générations de gens ont pu franchir le Fleuve Jaune, la Wei et la Tao.)
Peu après arrivèrent d’importantes forces, que Su Quarante-Trois et ses hommes attaquèrent. De nouvelles troupes furent alors envoyées. En représailles, Su Quarante-Trois attaqua Hezhou, à la tête d’une armée de deux mille hommes, puis traversa le fleuve sur des pifacis et établit son campement devant les portes de Lanzhou. Tout à coup, la guerre était là.
Les autorités Qing qui avaient survécu à l’embuscade de la Jahriyya exhibèrent Ma Mingxin, chargé de chaînes, sur les murailles de la ville. À sa vue, ses fidèles se prosternèrent, les yeux baignés de larmes, et se mirent à crier : « Cheikh ! Cheikh ! » On entendit leurs cris du haut des falaises environnantes et de l’autre côté du fleuve. Ayant ainsi infailliblement identifié le chef de la rébellion, les autorités le firent descendre des murailles, et le décapitèrent.
Quand la Jahriyya apprit ce qui s’était passé, ses adeptes n’eurent de cesse que de se venger. Ils n’avaient pas de machines permettant de faire un siège en règle de Lanzhou, aussi construisirent-ils, sur une colline proche, un fort à partir duquel ils commencèrent à attaquer sans répit ceux qui entraient ou sortaient de la ville. Les fonctionnaires Qing de Beijing furent informés de ces harcèlements, et répondirent par la manière forte à l’assaut mené contre l’une de leurs capitales de province, en envoyant le commissaire impérial Agui, l’un des plus importants gouverneurs militaires de Qianlong, pour pacifier la région.
Ce à quoi il échoua. La vie à Lanzhou devint triste et pénible. Finalement, Agui envoya Hushen, son principal chef militaire, à Beijing. À son retour, il était porteur de nouveaux ordres, qui autorisaient Agui à lever une importante milice armée, des Tibétains de Gansu, des Mongols d’Alashan, et tous les hommes de la Garde Verte de la région. De farouches géants qui arpentaient d’un pas terrible les rues de la ville, transformée en énorme caserne.
— C’est une vieille technique Han, commenta amèrement Ibrahim. Emmenez tous les non-Han par-delà la frontière et faites-les se battre entre eux, jusqu’à ce qu’ils se soient entretués.
Ainsi renforcé, Agui put couper le ravitaillement en eau du fort de la Jahriyya dressé sur la colline, de l’autre côté du fleuve, et les situations s’inversèrent. Les assiégés devinrent les assiégeants, comme au jeu de go. Au bout de trois mois, le bruit courut en ville que la bataille finale avait été livrée, et que Su Quarante-Trois avait été tué, avec ses milliers d’hommes.
À cette nouvelle, Ibrahim se rembrunit.
— Cela n’en restera pas là. Ils voudront venger Ma Mingxin, Su Quarante-Trois et tous les autres. Plus on massacrera de membres de la Jahriyya, plus on verra de jeunes musulmans s’y enrôler. L’oppression engendre toujours la rébellion !
— Comme dans l’affaire du voleur d’âmes, nota Kang.
Ibrahim hocha la tête, et redoubla d’efforts dans son travail. On aurait dit qu’il pensait que s’il arrivait à réconcilier ces deux civilisations sur le papier, les sanglantes batailles qui faisaient rage partout autour d’eux cesseraient d’elles-mêmes. Aussi passait-il de nombreuses heures chaque jour à écrire, ne touchant pas aux repas que lui apportaient les serviteurs. Ses échanges avec Kang n’étaient que le prolongement de ses travaux d’écriture ; et inversement, ce que sa femme lui répondait au cours de ces conversations se retrouvait rapidement incorporé dans ses livres. L’opinion de personne d’autre n’avait autant d’importance à ses yeux.
(Il doit probablement s’agir de l’œuvre en cinq volumes publiée dans la soixantième année de Qianlong connue sous le nom de Réconciliation des philosophies de Lu Zhi et de Ma Mingxin.)
Kang maudissait les jeunes combattants musulmans :
— Vous autres, musulmans, vous êtes beaucoup trop religieux. Quoi ? Tuer et mourir au nom de ridicules points de détails du dogme ? C’est de la folie !
Et, peu après, Ibrahim couchait dans l’immense étude que Kang avait surnommée Mahomet contre Confucius le passage suivant :
Face à la tendance de l’islam à s’imposer toutes sortes d’épreuves physiquement pénibles – le jeûne, les danses tourbillonnantes, l’autoflagellation, et le jihad lui-même – on ne peut que se demander à quoi cela est dû. Les causes sont multiples : les paroles de Mahomet édictant le jihad, la genèse de l’islam même, les rudes et hostiles paysages désertiques où sont nées tant de sociétés musulmanes, et avant tout, peut-être, le fait que pour les peuples musulmans la langue religieuse est par définition l’arabe, qui est, pour beaucoup, une seconde langue. Cela a des conséquences importantes, dans la mesure où la langue d’un individu est toujours rattachée à une réalité matérielle profonde, par son vocabulaire, sa grammaire, sa logique, et par les métaphores, images et symboles – qui, pour la plupart, s’effacent derrière les noms eux-mêmes. Or, dans le cas de l’islam, pour la plupart des croyants, au lieu de rendre compte d’une réalité matérielle, la langue sacrée est détachée de tout contexte. Elle n’est qu’une seconde langue, mal traduite, mal connue. Elle ne charrie que des concepts abstraits, sans rapport avec la réalité, prônant un dévouement à un monde d’idées qui n’a plus rien à voir avec le monde réel, coupé de la vie des sens et des réalités physiques. Tout cela ouvre la voie à un extrémisme résultant d’un manque de perspective, d’un manque d’assise concrète. Comprenez bien le genre de processus linguistique dont je parle : les musulmans dont l’arabe est la deuxième langue n’ont pas « les pieds sur terre » ; leur comportement est bien trop souvent déterminé par des concepts abstraits, fluctuants, isolés, dans le monde vide du langage. Nous avons besoin du monde. Chaque situation doit être replacée dans son contexte pour pouvoir être comprise. En fait, notre religion gagnerait à être enseignée dans la langue de chacun des pays où elle s’est établie. Le Coran devrait être traduit dans toutes les langues de la Terre ; à moins que l’apprentissage de l’arabe ne s’améliore. Cela dit, suivre cette direction supposerait que l’arabe devienne la langue principale du monde, ce qui n’est pas un projet bien réaliste, et pourrait même être considéré comme une autre façon de mener le jihad.
Une autre fois, alors qu’Ibrahim écrivait quelque chose sur la théorie des cycles dynastiques, commune à la Chine et à l’islam, sa femme avait envoyé promener tout ça, comme elle l’aurait fait d’une broderie ratée :
— On n’étudie pas l’histoire comme on étudie les saisons. C’est une métaphore pour imbéciles. Et si cela n’avait rien à voir ? Et si l’histoire était un fleuve et coulait éternellement ?
Peu après, Ibrahim écrivit dans son Commentaire de la Doctrine du Grand Cycle de l’Histoire :
Ibn Khaldun, le plus illustre historien musulman, parle dans la Muqaddimah des grands cycles de dynasties. Ce modèle cyclique a également été identifié par la plupart des historiens chinois, à commencer par Han Dong Zongshu, dans la Rosée luxuriante des annales du printemps et de l’automne. Il y jette les bases d’un système inspiré de Confucius, que Kang Yuwei complétera par la suite, dans ses Commentaires des Rites de l’Évolution, où il est question des Trois Âges – le Désordre, la Petite Paix, la Grande Paix –, chacun passant par des cycles internes de plus petits désordres, petites paix et grandes paix, de telle sorte que les trois deviennent neuf, les neuf quatre-vingt-un et ainsi de suite. La cosmologie religieuse hindoue, qui était jusqu’à présent le seul système de cette civilisation à aborder l’histoire en tant que telle, parle aussi de grands cycles. Il y a d’abord le Kalpa, qui est une journée dans la vie de Brahma, et qui dure quatre milliards trois cent vingt millions d’années. Il est divisé en quatorze Manvataras, divisés à leur tour en soixante et onze Maha-yugas, de trois millions trois cent vingt mille ans chacun. Chaque Maha-yuga, ou Grand Âge, est divisé en quatre âges, Satya-yuga, l’âge de la paix, Treta-yuga, Dvapara-yuga, et Kali-yuga, qui est l’âge où nous sommes, un âge de déclin et de désespoir, en attente de renouveau. Ces périodes de temps, beaucoup plus longues que celles de la plupart des autres civilisations, semblent excessives à de nombreux commentateurs des origines, mais il faut ajouter que, plus on apprend de choses sur l’antiquité de la Terre, grâce aux coquillages retrouvés au sommet des montagnes, aux strates de dépôts sédimentaires, et ainsi de suite, plus il semble que les introspections hindoues ont parfaitement réussi à lever le voile sur le passé pour accéder à la véritable échelle des choses.
Mais, dans tous les cas, les cycles ne sont observables qu’à condition d’ignorer l’essentiel des retranscriptions de ce qui s’est réellement passé, et ne sont, de toute façon, très probablement, que des théories basées sur la succession des années et le retour des saisons ; les civilisations n’étant vues que comme les feuilles d’un arbre, connaissant un cycle de croissance et de déclin, puis de renaissance. Il se pourrait fort bien que l’histoire proprement dite ne suive pas du tout ce modèle, et que chaque civilisation engendre son destin particulier, qui ne saurait être relié à aucun modèle cyclique sans altérer la réalité des événements.
Ainsi, l’expansion extrêmement rapide de l’islam ne semble correspondre à aucun cycle, et son succès résulte peut-être du fait qu’il ne proposait pas un cycle, mais une marche vers Dieu, un message très simple – en opposition à la fâcheuse tendance de la plupart des philosophies du monde à vouloir tout systématiser. Un message que les masses pouvaient comprendre facilement.
Kang Tongbi elle aussi passait une bonne partie de son temps à écrire, complétant son anthologie de poèmes féminins, les regroupant par thèmes, et écrivant des commentaires explicitant leur apport particulier à l’ensemble. Elle commença aussi, avec l’aide de son mari, un Traité sur l’histoire des femmes du Hunan, dans lequel ses idées, ou du moins ses commentaires, reflétaient le plus souvent la pensée de son mari – comme il le faisait dans ses propres livres. Cela permettrait plus tard aux chercheurs de confronter leurs écrits de ces années à Lanzhou, et d’en faire une sorte de dialogue vivant, ou de chant à deux voix.
Mais les opinions de Kang étaient bien à elle, et Ibrahim les aurait, le plus souvent, réfutées. Plus tard cette année-là, par exemple, agacée par l’inanité du conflit qui déchirait la région, et redoutant qu’un conflit de plus grande ampleur ne surgisse, sentant un orage s’amonceler au-dessus d’eux, prêt à éclater, Kang écrivit dans son Traité :
On peut donc voir émerger des religions et des systèmes de pensée différents selon le type de société où ils ont vu le jour. La façon dont les gens se nourrissent détermine leur façon de penser et leur type de croyance. Les sociétés agricoles croient aux dieux des pluies, aux dieux des semences, et généralement à tous les dieux affectant d’une manière ou d’une autre le travail des récoltes (c’est le cas de la Chine). Les peuples qui élèvent du bétail croient en un dieu berger, unique (c’est le cas de l’islam). Dans chacune de ces deux cultures transparaît la notion primitive de dieux aidants, tels des géants qui observeraient les hommes du haut des nuages, ou des parents qui ne s’en comporteraient pas moins comme de sales gosses, décidant, au gré de leurs caprices, qui récompenser, qui punir, sur la base des lâches sacrifices consentis par les hommes soumis à leurs lubies. Les religions qui prêchent le sacrifice ou la prière à de pareils dieux, dans le but d’en obtenir une rétribution matérielle, sont les religions de peuples désespérés et ignorants. Ce n’est que dans les sociétés les plus sûres et les plus avancées que l’on trouve des religions susceptibles d’affronter la réalité de l’univers, et de reconnaître qu’il n’y a pas de manifestations évidentes d’un quelconque dieu, sinon l’existence du cosmos même, ce qui veut dire que tout est sacré, qu’il y ait un dieu ou non pour nous regarder.
Ibrahim lut son manuscrit, et se prit la tête dans les mains, en soupirant.
— Ma femme est plus sage que moi ! dit-il. Je suis un homme comblé. Il y a tout de même des moments où j’aurais préféré ne pas étudier les idées, mais les choses. J’ai l’impression d’être au-delà de mon domaine de compétences.
Pas un jour ne passait sans qu’on apprenne que les Qing avaient de nouveau tué des musulmans. On était censé défendre le Vieil Enseignement et combattre le Nouvel Enseignement, mais des bureaucrates ignorants et ambitieux étaient arrivés de l’intérieur, accumulant les bavures. Par exemple, Ma Wuyi, le successeur de Ma Laichi, et non de Ma Mingxin, reçut l’ordre de s’exiler au Tibet, avec tous ses adeptes. Vieil Enseignement, nouveau territoire, disaient les gens en pleurant de rage à l’annonce de cette bourde administrative, qui entraînerait sans aucun doute de nombreuses morts. Cela devint la troisième des Cinq Grandes Erreurs de la campagne de suppression. Et le désordre s’accrut.
Un jour, un musulman chinois, nommé Tian Wu, rallia ouvertement les Jahriyyas, pour les aider à se révolter et à secouer le joug de l’oppression de Beijing. Cela se passa juste au nord du Gansu, et tout le monde à Lanzhou se mit à stocker des vivres en prévision de la guerre.
Bientôt, de nouvelles bannières arrivèrent, et comme tout le reste, la guerre devait traverser le corridor de Gansu, pour aller d’est en ouest. Ainsi, alors que la plupart des combats avaient lieu dans le lointain Gansu, à l’est, ils en recevaient constamment des nouvelles à Lanzhou – aussi fréquentes que le passage des troupes fraîches.
Kang Tongbi trouva des plus déconcertantes l’idée que la majorité des combats puissent se dérouler à l’est, entre l’intérieur et leur ville. Il fallut plusieurs semaines à l’armée Qing pour écraser les forces de Tian Wu, bien que ce dernier ait été tué dès les premiers jours de combat. Peu après, on apprit à Gansu que le général Qing Li Shiyao avait donné l’ordre de massacrer plus d’un millier de femmes et d’enfants à l’est de Gansu.
Ibrahim était désespéré.
— Maintenant, tous les musulmans de Chine sont pour la Jahriyya dans leur cœur.
— C’est possible, répondit Kang cyniquement. Mais cela ne les empêche pas d’accepter que les territoires de la Jahriyya soient confisqués par le gouvernement.
Il était également avéré que des congrégations de la Jahriyya se créaient maintenant partout, au Tibet, au Turkestan, en Mongolie, en Mandchourie, et vers le sud, jusqu’au lointain Yunnan. Aucune autre secte musulmane n’avait jamais attiré autant d’adeptes, et nombreux étaient les réfugiés qui, fuyant les guerres à l’ouest, entraient dans la Jahriyya dès leur arrivée, heureux de trouver à s’enrôler, après avoir subi le traumatisme d’une guerre civile musulmane, dans un jihad radical contre des infidèles.
Jamais pendant ces périodes de trouble Ibrahim et Kang – dont la grossesse était bien avancée – n’avaient perdu l’habitude de se retirer, le soir, sur leur véranda, afin d’y regarder la Tao se jeter dans le Fleuve Jaune. Ils commentaient les nouvelles du jour, parlaient de leur travail, comparaient poèmes et textes religieux, comme si c’étaient les seules choses qui comptaient vraiment. Kang essaya d’apprendre l’alphabet arabe, qu’elle trouva difficile, mais instructif.
— Regarde, disait-elle, il n’y a pas moyen de reproduire les tonalités du chinois dans cet alphabet, en tout cas pas vraiment. Et je suppose que l’inverse est également vrai !
Elle fit un geste pour montrer l’endroit où se rejoignaient les fleuves.
— Tu disais que les gens pouvaient se mélanger comme les eaux de ces deux fleuves. C’est possible. Mais regarde la ligne de partage, à l’endroit où ils se rejoignent. Regarde comme on continue de voir ces tourbillons d’eau claire dans tout ce jaune.
— Une centaine de lis plus loin c’est différent, contesta Ibrahim.
— Peut-être. Mais je m’interroge. En fait, tu dois être en train de devenir comme l’un de ces Sikhs dont tu m’as parlé, qui prennent le meilleur des anciennes religions et en font quelque chose de nouveau.
— Et le bouddhisme, alors ? demanda Ibrahim. Tu disais qu’il avait profondément modifié la religion en Chine. Comment faire pour l’appliquer également à l’islam ?
Elle réfléchit un instant.
— Je ne suis pas sûre que ce soit possible. Le Bouddha a dit qu’il n’y avait pas de dieux, mais plutôt des êtres conscients, présents dans chaque chose, même dans les nuages, ou les rochers. Tout est sacré.
— Il faut qu’il y ait un dieu, soupira Ibrahim. L’univers ne peut venir de rien.
— Nous n’en savons rien.
— Je crois que c’est Allah qui l’a créé. Mais maintenant, c’est peut-être à nous de choisir. D’ailleurs, ne nous a-t-il pas dotés de libre arbitre, pour voir ce que nous ferions ? Encore une fois, la Chine et l’islam détiennent peut-être chacun une partie d’une même vérité. Peut-être que le bouddhisme en détient une troisième. Nous devons les réunir. Ou ce sera un désastre.
La nuit tomba sur la rivière.
— Il faut que tu fasses progresser l’islam, dit Kang.
Ibrahim frémit.
— Le soufisme s’y est évertué pendant des siècles. Les soufis essayent de le faire progresser, les wahhabites de le faire régresser, disant qu’il ne peut y avoir ni amélioration, ni progrès. Et ici l’empereur écrase les deux.
— Pas vraiment. Le Vieil Enseignement est reconnu par la loi impériale. Les livres de ton Liu Zhu font partie de la collection impériale de textes sacrés. Ce n’est pas comme avec les taoïstes. Même le bouddhisme ne jouit pas auprès de l’empereur d’autant de considération que l’islam.
— Jusqu’à maintenant, déplora Ibrahim. Tant qu’il se tenait tranquille, loin à l’ouest. Mais à présent ces jeunes têtes brûlées sont en train d’embraser la situation, ruinant toute chance de coexistence.
Kang n’ajouta rien à ses paroles. C’est ce qu’elle disait depuis longtemps déjà.
Maintenant, il faisait parfaitement nuit. Les paisibles habitants de Lanzhou étaient tous rentrés chez eux, aucun n’osant se risquer dehors, malgré les hauts murs de la ville. C’était bien trop dangereux.
D’autres nouvelles arrivèrent, en même temps qu’un nouvel afflux de réfugiés venus de l’ouest. Le sultan ottoman avait apparemment fait alliance avec les émirats des steppes au nord de la mer Noire – ces descendants des États de la Horde d’or, qui n’étaient que très récemment sortis de l’anarchie. Ensemble, ils avaient vaincu les armées de l’empire safavide, écrasant les bastions chiites en Iran et poursuivant vers l’est, en direction des malheureux émirats désorganisés d’Asie centrale et des routes de la Soie. Le chaos régnait partout dans les terres du Milieu, avec son cortège de nouvelles guerres en Irak et en Syrie, de famines et de destructions. Pourtant, on avait dit qu’avec la victoire ottomane la paix s’établirait dans cette partie occidentale du monde. En attendant, des milliers de musulmans chiites se dirigeaient vers le Pamir, où ils pensaient trouver des États réformistes amicaux. On aurait dit qu’ils ignoraient que la Chine s’y trouvait.
— Dis-m’en plus sur l’enseignement du Bouddha, demanda un jour Ibrahim lors d’une de leurs conversations sur la véranda. J’ai l’impression que c’est très primitif et centré sur soi. Tu sais : les choses sont ce qu’elles sont, et chacun s’y adapte, se préoccupant avant tout de lui-même. Tout est bien. Or, apparemment, les choses dans ce monde ne vont pas bien. Qu’en pense le bouddhisme ? N’a-t-il rien de mieux à proposer, ou est-ce qu’il se contente de dire que les choses sont ce qu’elles doivent être ?
— « Si tu veux aider les autres, fais preuve de compassion. Si tu veux t’aider toi-même, fais preuve de compassion. » C’est ce que dit le Dalaï Lama des Tibétains. Et Bouddha lui-même a dit à Sigala, qui vouait un culte aux Six Directions, que la discipline noble interpréterait les Six Directions par parents, professeurs, épouse et enfants, amis, serviteurs et employés, et gens de religion. Ce sont eux qui devraient être adorés, disait-il. Adorés, est-ce que tu comprends ? Comme des choses sacrées. Les gens de ta propre vie ! Ainsi, la vie quotidienne devient elle-même une sorte de culte, tu vois ? Il ne s’agit pas de prier le vendredi et de terroriser le monde entier pendant le reste de la semaine.
— Ce n’est pas ce que prône Allah, je te l’assure.
— Non. Mais il y a bien le jihad, n’est-ce pas ? Maintenant, on dirait que tout le Dar al-Islam est en guerre, contre lui-même ou le reste du monde. Les bouddhistes n’ont jamais conquis quoi que ce soit. La non-violence, la compassion, la gentillesse composent la matière de plus de la moitié des Dix Directives du Bouddha adressées au Bon Roi. Asoka ravagea l’Inde dans sa jeunesse, puis il devint bouddhiste, et n’a plus jamais tué personne. Il était le Bon Roi personnifié.
— Mais si peu imité.
— C’est vrai. Nous vivons des temps barbares. Le bouddhisme se répand grâce à des gens qui veulent se convertir de leur plein gré, dans le but de faire le bien, ce qui leur semble juste. Mais le pouvoir se trouve entre les mains de ceux qui préfèrent utiliser la force. L’islam emploiera la force, l’empereur emploiera la force. Ils régneront sur le monde. Ou se battront pour sa domination, jusqu’à ce qu’il soit détruit.
Une autre fois, elle ajouta :
— Ce que je trouve intéressant, dans toutes ces religions des temps anciens, c’est que seul le Bouddha ne s’est pas proclamé Dieu. Il n’a même pas prétendu parler à Dieu. Les autres ont tous prétendu être Dieu, ou le fils de Dieu, ou parler au nom de Dieu. Alors que le Bouddha s’est contenté de dire : il n’y a pas de Dieu. L’univers lui-même est sacré, les êtres humains sont sacrés, tous les êtres conscients sont sacrés et peuvent tendre vers l’illumination. Tout ce qu’il faut, c’est faire un peu plus attention au quotidien, aux petits riens de la vie, remercier et rendre grâce pour chaque chose qu’on fait dans la journée. C’est la moins contraignante des religions. Ce n’est même pas une religion en fait, plutôt un mode de vie.
— Mais alors, que font toutes ces statues de Bouddha que je vois partout, et ces cultes qu’on lui voue, dans des temples ? Tu passes toi-même beaucoup de temps à prier.
— C’est en partie dû au fait que le Bouddha est révéré comme un homme modèle. Les esprits simples le voient autrement, c’est certain. Mais ce sont surtout des gens qui s’agenouillent devant tout et n’importe quoi, et pour eux, Bouddha n’est qu’un dieu parmi d’autres. Ils n’ont rien compris. En Inde, ils en ont fait un avatar de Vishnou, un avatar qui tente délibérément d’éloigner les gens du culte que l’on doit vouer à Brahma, n’est-ce pas ? Non, pas de doute, beaucoup de gens n’y ont rien compris. Mais il est là, attendant d’être vu, s’ils le veulent.
— Et tes prières ?
— Prier m’aide à y voir plus clair.
Assez rapidement, l’insurrection de la Jahriyya fut matée, et la partie ouest de l’empire parut retrouver un semblant de paix. Mais il y avait à présent des forces plus profondes à l’œuvre, qui préparaient, sans relâche, dans la clandestinité, une nouvelle rébellion musulmane. Ibrahim redoutait que même le problème de la Grande Entreprise ne redevienne d’actualité. Les gens parlaient de troubles à l’intérieur, de sociétés secrètes Han et de confréries cherchant à renverser les empereurs mandchous de leur trône pour y rasseoir les Ming. De telle sorte que le gouvernement commença à se méfier des Han ; après tout, l’empereur était mandchou, c’est-à-dire un étranger. Et même le confucianisme extrêmement pointilleux de l’empereur Qianlong ne pouvait pas passer ce fait sous silence. Si les musulmans à l’ouest de l’empire se révoltaient, alors il y aurait des Chinois, à l’intérieur et sur la côte sud, pour y voir une occasion d’intensifier leur propre rébellion ; et l’empire risquerait d’éclater. À n’en pas douter, il semblait que le sheng shi, l’apogée du cycle de cette dynastie particulière (si un tel apogée existait bien), venait d’être franchi.
Ibrahim écrivit plusieurs fois à l’empereur, afin de l’inciter à reconnaître publiquement le Vieil Enseignement, de façon à le faire bénéficier lui aussi de la faveur impériale. L’islam deviendrait ainsi l’une des religions officielles de l’empire, au même titre que le bouddhisme et le taoïsme.
Mais l’empereur ne répondait jamais à ces lettres – et à en juger par le contenu de la magnifique calligraphie vermillon peinte au bas des autres pétitions renvoyées par l’empereur à Lanzhou, il paraissait assez peu probable qu’Ibrahim reçoive un jour une réponse plus favorable. « Pourquoi ne sommes-nous entouré que de canailles et d’imbéciles ? s’indignait l’un des commentaires impériaux. Les coffres n’ont cessé de s’emplir de l’or et de l’argent du Yingzhou depuis le début de notre règne, et nous n’avons jamais été aussi prospère. »
L’empereur marquait un point, c’était certain. Et il en savait beaucoup plus sur l’empire que n’importe qui. Pourtant, Ibrahim persévéra. Et pendant ce temps, de nouveaux réfugiés continuaient de se déverser vers l’est, au point que le corridor de Gansu, le Shaanxi et Xining furent bientôt envahis par ces nouveaux arrivants – des musulmans, qui ne s’entendaient pas nécessairement entre eux, mais vivaient comme si leur hôte, la Chine, n’existait pas. Lanzhou continua apparemment de prospérer, les marchés grouillaient de gens et de marchandises, les mines, les fonderies, les forges ne cessaient de livrer de nouveaux armements, de nouvelles machines de toutes sortes, engins agricoles, métiers mécaniques, véhicules ; mais la partie délabrée de la ville s’étendait maintenant le long des rives du Fleuve Jaune sur de nombreux lis, et les deux rives de la Tao étaient encombrées de taudis, où les gens vivaient sous des tentes, dans le meilleur des cas. Les anciens habitants de la ville ne la reconnaissaient plus, et tous restaient, s’ils étaient prudents, cloîtrés derrière leur porte à la nuit tombée.
Ô mon enfant, toi qui arrives en ce monde,
Prends garde à bien choisir l’endroit où tu naîtras.
Les choses ont si vite fait d’aller mal
Que parfois je m’en effraie.
Si seulement nous vivions à l’Âge de la Grande Paix,
Que je serais heureuse de voir ton innocent visage
Regarder les oies s’envoler vers le sud, à l’automne.
Un jour, en aidant Ibrahim à remettre de l’ordre dans ses livres et ses parchemins, ses encriers et ses pinceaux, Kang s’arrêta pour lire l’une de ses pages :
« L’histoire peut être vue comme une série de chocs entre civilisations, ces chocs permettant aux choses d’avancer, au progrès de s’accomplir. Cela ne se produit peut-être pas au moment du heurt, ces périodes étant généralement marquées par la destruction et la guerre, mais bien après, au moment où chacune des deux cultures essaie de se redéfinir et de marquer sa suprématie. Alors, de grands progrès peuvent se faire très rapidement, avec des créations remarquables dans les domaines technique et artistique. Les idées fleurissent, les gens tentent de s’entendre, et, au fil du temps, la compétition aidant, naissent les plus fortes, les plus souples, les plus généreuses des idées. C’est ainsi que le Fulan, l’Inde et le Yingzhou progressent malgré les difficultés, alors que la Chine dépérit du fait même de sa structure monolithique, et ce en dépit des énormes quantités d’or qui affluent du Dahai. Une civilisation isolée ne peut progresser. Elle ne peut y arriver qu’en entrant en conflit avec une ou plusieurs autres. À l’image de ces vagues, sur la plage, qui ne sont jamais aussi hautes que lorsque d’autres, devant elles, refluent et les heurtent, dans un bouillonnement d’eau blanche s’élevant dans les airs à des hauteurs impressionnantes. L’histoire ne suit peut-être pas les mouvements des saisons, mais celui des vagues dans la mer, allant de-ci de-là, s’entrechoquant, s’appariant et se séparant, formant parfois de si magnifiques figures qu’on dirait, pour un temps, une véritable Montagne de Diamant d’énergie culturelle. »
Kang reposa la feuille, et regarda tendrement son mari.
— Si seulement c’était vrai, dit-elle doucement.
— Quoi ?
Il avait levé les yeux.
— Tu es quelqu’un de bien, mon mari. Mais je crois que tu t’es lancé, par bonté, dans une aventure impossible.
Et puis, au cours de la quarante-quatrième année du règne de l’empereur Qianlong, alors que la grossesse de Kang Tongbi approchait de son terme, il plut durant tout le troisième mois, et, partout, les terres furent inondées. Était-ce à cause de la misère provoquée par ces inondations, ou parce que ses chefs avaient prévu de mettre à profit la confusion qu’elles avaient causée, personne n’aurait su le dire ; en tout cas, la rébellion reprit de plus belle, dans tout l’Ouest. Cette fois, les insurgés musulmans attaquaient les villes les unes après les autres, et pendant que les factions chiites, wahhabites, de la Jahriyya et de la Khafiyya s’entretuaient dans toutes les mosquées et à tous les coins de rues, les bannières Qing elles-mêmes ployèrent sous les coups redoublés des rebelles. La situation était si grave que le bruit commença à courir que le gros de l’armée impériale arriverait bientôt ; mais entre-temps la dévastation s’était répandue partout, et à Gansu la nourriture commença à manquer.
Lanzhou fut à nouveau assiégée, cette fois par une coalition de diverses sectes de rebelles immigrés musulmans, de toutes les nationalités. Dans la maisonnée d’Ibrahim, chacun fit de son mieux pour protéger les derniers jours de la grossesse de la maîtresse de maison. Malheureusement, il avait tellement plu que les eaux du Fleuve Jaune avaient dangereusement grossi, et menaçaient de déborder. Et comme ils se trouvaient au point de confluence du Fleuve Jaune et de la rivière Tao, leur domaine était le premier concerné. Les hautes falaises de la ville n’étaient pas si hautes que ça, finalement. C’était un spectacle effrayant que celui des eaux brunes, bouillonnantes, montant à tout allure vers la ville. Enfin, le quinzième jour du dixième mois, alors que l’armée impériale n’était plus qu’à un jour de marche en aval, et que la perspective d’être assiégés paraissait s’éloigner, la pluie se mit à tomber plus fort que jamais ; et les flots de la rivière et du fleuve montèrent tant qu’ils inondèrent la ville.
C’est à ce terrible moment qu’une explosion – provoquée par des rebelles, pensèrent-ils tous – détruisit le barrage en amont de la Tao. Une vague immense d’eau boueuse dévala la rivière, sortit de son lit, inonda les réservoirs, déjà pleins, de Lanzhou et se jeta dans le Fleuve Jaune, dont elle grossit encore les flots, de telle sorte que l’eau monta jusqu’au sommet des collines qui bordaient l’étroite vallée de la rivière. Quand l’armée impériale arriva, Lanzhou tout entière était recouverte d’une eau marronnasse. On en avait jusqu’aux genoux, et l’eau continuait à monter.
Ibrahim était parti à la rencontre de l’armée impériale, en compagnie du gouverneur de Lanzhou, afin de s’entretenir avec son nouveau commandement et d’aider les autorités à trouver les chefs rebelles avec lesquels elles pourraient négocier. C’est ainsi qu’au plus fort de l’inondation, tandis que les flots continuaient de monter autour des murs du domaine d’Ibrahim, seules les femmes et quelques serviteurs étaient présents pour faire face au désastre.
Les murs du domaine et les sacs de sable qu’ils avaient placés devant les portails parurent d’abord suffire, puis on apprit, par des gens qui fuyaient la ville et tentaient de gagner d’autres endroits, plus élevés, que le barrage venait d’être détruit et que des trombes d’eau menaçaient d’envahir le domaine.
— Venez vite ! hurla Zunli. Nous devons fuir, gagner les hauteurs ! Il faut partir, maintenant !
Kang Tongbi l’ignora. Elle était occupée à bourrer des coffres avec ses papiers et ceux d’Ibrahim. Mais il y avait des pièces et des pièces entières de livres et de parchemins, ainsi que le lui fit remarquer Zunli. Jamais elle n’aurait le temps de tous les sauver.
— Alors aide-moi ! grinça Kang, s’activant à un rythme de plus en plus effréné.
— Mais comment ferons-nous pour tous les déplacer ?
— Mets les boîtes dans le palanquin, vite !
— Et comment vous enfuirez-vous ?
— Je marcherai ! Dépêche-toi ! Allons, allons !
Ils remplirent les boîtes.
— Mais ce n’est pas bien ! protesta Zunli en regardant le ventre arrondi de Kang. Ibrahim aurait souhaité que vous partiez. Il ne se serait pas soucié de ces livres !
— Bien sûr que si ! hurla Kang. Allez, emballe ! Va chercher les autres, et emballez tout ça !
Zunli fit ce qu’il pouvait. Toute une heure passée à courir, paniqués, les avait épuisés, les autres serviteurs et lui-même, alors que Kang Tongbi commençait seulement à s’essouffler.
Finalement, elle se laissa fléchir. Ils sortirent par le portail principal du domaine et furent immédiatement environnés par une eau brunâtre, qui leur arrivait aux genoux et cherchait à pénétrer dans le domaine, dont ils parvinrent heureusement à refermer le portail. C’était un spectacle très étrange, en vérité, que de voir la ville tout entière transformée en lac mousseux et marron. Le palanquin avait été tellement chargé de livres et de documents que tous les serviteurs durent se réunir sous ses barres pour le soulever et le déplacer. Le lent grondement de l’eau en train d’envahir la ville faisait vibrer l’air, de façon si affreuse qu’ils en avaient des frissons. Le lac brun, écumant, qui avait largement débordé le lit de la rivière et envahi la ville, montait maintenant à l’assaut des collines alentour. Lanzhou était complètement inondée. Les servantes pleuraient, vrillant l’air de leurs longues plaintes, de leurs cris, de leurs hurlements. Pao semblait avoir disparu. C’est alors que Kang entendit ce que seules les oreilles d’une mère pouvaient entendre – un enfant pleurer.
Kang se rendit compte alors qu’elle avait oublié son propre fils. Elle fit demi-tour et retourna dans le domaine, se faufilant par le portail que l’eau avait fini par ouvrir. Les serviteurs, occupés à manœuvrer le lourd palanquin, ne la virent pas partir.
Elle se rua, mi-nageant, mi-courant, dans les flots qui montaient toujours, jusqu’à la chambre de Shih. Le domaine était complètement inondé.
Shih avait apparemment commencé par se cacher sous son lit, mais l’eau avait fini par l’en chasser, l’obligeant à monter dessus. Il s’y tenait, recroquevillé, terrifié.
— Au secours ! Maman, au secours !
— Viens vite, allez !
— Je ne peux pas ! Je ne peux pas !
— Je ne peux pas te porter, Shih. Viens ! Les serviteurs sont tous partis, il n’y a plus que toi et moi !
— Je ne peux pas !
Il éclata en sanglots, se blottissant sur son lit comme un enfant de trois ans.
Kang le regarda. Sa main droite se tendait déjà vers le portail, comme pour abandonner le reste de son corps. Elle se mit à rugir, attrapa le garçon par l’oreille, l’obligeant à se relever.
— Dépêche-toi, sinon je t’arrache l’oreille, espèce de hui ! hurla-t-elle.
— Je ne suis pas le hui ! C’est Ibrahim le hui ! Tout le monde est un hui, mais pas moi ! Aïe ! brailla-t-il, tandis que sa mère lui tordait l’oreille, la décollant quasiment de sa tête.
Elle le traîna ainsi, à travers les eaux montantes, jusqu’au portail du domaine.
Comme ils sortaient, une brusque montée d’eau leur arriva dessus, à hauteur de taille pour elle, de poitrine pour lui. Quand la vague reflua, le niveau de l’eau s’était encore élevé. Ils en avaient jusqu’aux cuisses. Le rugissement était assourdissant. Ils ne pouvaient s’entendre. Aucun serviteur n’était en vue.
Un terrain surélevé se trouvait juste au bout de l’avenue qui menait à la muraille sud de la ville. Kang s’y dirigea, en cherchant ses serviteurs du regard. Elle trébucha et lâcha un juron : l’une de ses sandales papillons venait d’être aspirée par un trou d’eau. Elle retira l’autre, décidant de poursuivre pieds nus. Shih semblait s’être évanoui. Il était plongé dans un état catatonique, et elle avait dû passer un bras sous ses genoux pour le soulever et l’emmener avec elle, le faisant reposer au sommet de son gros ventre rond. Elle appela ses serviteurs d’une voix bouillonnante de colère, mais ne put entendre son propre cri. Elle glissa une nouvelle fois et implora Guanyin, Celle Qui Entend les Pleurs.
C’est alors qu’elle aperçut Xinwu, qui nageait vers elle comme une loutre. Il avait un air sérieux, déterminé. Derrière lui, Pao pataugeait dans sa direction, ainsi que Zunli. Xinwu prit Shih des bras de Kang et lui donna une grande claque sur son oreille déjà rouge.
— Par ici ! hurla-t-il à Shih, en pointant la muraille.
Kang vit avec surprise Shih s’y diriger en courant, bondissant hors de l’eau au fur et à mesure qu’il avançait. Xinwu resta à côté d’elle, pour l’aider à progresser dans l’avenue inondée. Elle était comme l’une de ces barges du canal, ballottée par le courant, les vagues frappant la proue de son ventre distendu. Pao et Zunli les rejoignirent pour l’aider.
— J’étais partie en avant pour m’assurer qu’on avait pied ! hurla-t-elle, les yeux pleins de larmes. Quand je suis revenue, je croyais que vous étiez dans le palanquin !
De son côté, Zunli disait qu’il la croyait partie avec Pao. Enfin, la pagaille habituelle.
Depuis les murailles, les autres serviteurs leur criaient des encouragements, regardant monter le niveau de l’eau. « Dépêchez-vous ! criaient-ils, les yeux écarquillés de terreur. Dépêchez-vous ! »
Au pied de la muraille, le courant était très fort. Kang tenta gauchement de résister aux flots, glissant au moindre petit pas. Des gens firent descendre vers eux une échelle de bois, du haut de la muraille, et Shih y grimpa à toute allure. Kang s’y accrocha tant bien que mal. Elle n’était jamais montée à une échelle auparavant, et les efforts que faisaient Xinwu, Pao et Zunli pour la pousser ne l’aidaient pas vraiment. Elle avait le plus grand mal à garder ses pieds abîmés sur les barreaux ronds de l’échelle ; pour tout dire, ses pieds n’étaient même pas aussi longs que la largeur des barreaux. Elle n’arrivait à rien. De plus, elle vit du coin de l’œil une grande vague marron, charriant des détritus, se jeter sur les murailles, y arrachant chaque échelle et tout ce qu’on y avait posé. Elle se hissa par la force des bras et parvint enfin à poser un pied sur un barreau sec.
Pao et Zunli la soutenaient de leur mieux, lorsque des mains se tendirent depuis la muraille pour l’aider à s’y hisser. Enfin, Pao, Zunli et Xinwu vinrent l’y rejoindre. Au même moment, la grande vague marron emporta l’échelle, qui disparut dans les flots.
Beaucoup de monde s’était réfugié en haut des murailles, qui formaient à présent une sorte d’île, toute en longueur, au milieu des eaux. Des gens, sur le toit d’une pagode, faisaient de grands gestes. Tout le monde sur la muraille regardait Kang, qui arrangeait les plis de sa robe et chassait de la main ses cheveux de sa figure, tout en s’assurant que tous ceux du domaine étaient bien là. Elle eut un rapide sourire. C’était la première fois, d’ailleurs, qu’ils la voyaient sourire.
Quand ils retrouvèrent Ibrahim, tard dans la journée, après avoir été emmenés en barque sur une colline plus au sud, au-dessus de la ville inondée, Kang ne souriait plus. Elle serra Ibrahim contre elle, et ils s’assirent, au milieu d’un chaos de gens.
— Écoute-moi bien, lui dit-elle, une main sur le ventre, si jamais c’est une fille…
— Je sais, dit Ibrahim.
— Si jamais c’est une fille, je ne veux pas entendre parler de lui bander les pieds.
4. La vie après la vie
Bien des années plus tard, une ère plus tard, deux vieillards étaient assis sur leur véranda et regardaient couler le fleuve. Depuis qu’ils se connaissaient, ils avaient discuté de toutes sortes de choses. Ils avaient même écrit ensemble une histoire du monde, mais ils ne parlaient plus beaucoup, maintenant, si ce n’est pour se montrer un détail du jour finissant. Ils ne parlaient que très rarement du passé, et jamais du temps où ils étaient restés assis tous les deux dans une pièce obscure, à plonger dans la lumière de la bougie, qui leur avait permis d’entrevoir ces étranges vies antérieures. Il était trop perturbant de se rappeler à quel point ces heures avaient été terrifiantes et impressionnantes. De plus, le message était passé, la connaissance acquise. Il y avait dix mille ans qu’ils étaient ensemble : bien sûr. Ils étaient un vieux couple marié. Ils le savaient, et ça suffisait. Ils n’avaient pas besoin d’approfondir le sujet.
Ça aussi, c’est le bardo ; le nirvana. Quand l’éternel vous touche.
(C’est ce que sa femme lui avait appris à voir.)
Un jour, donc, avant de sortir sur la véranda admirer le coucher du soleil avec sa compagne, le vieil homme resta assis devant sa page blanche tout le long de l’après-midi, à réfléchir, en regardant les piles de livres et de manuscrits derrière lesquelles disparaissaient les murs de son bureau. Finalement, il prit son pinceau et il écrivit, à lents, très lents coups de pinceau :
La Fortune et les Quatre Grandes Inégalités
Les archives éparses et les ruines dévastées du Vieux Monde nous disent que les civilisations primitives virent le jour en Chine, en Inde, en Perse, en Égypte, au Moyen-Orient et en Anatolie. Les premiers fermiers de ces régions fertiles acquirent des méthodes de culture et d’entreposage qui produisirent des moissons en quantité bien plus importante que les besoins du moment. Très vite, des soldats, soutenus par des prêtres, prirent le pouvoir dans toutes les régions, et leur nombre augmenta. Ils accaparèrent ces nouvelles récoltes, surabondantes, par le biais d’impôts et de saisies directes. Le travail était réparti entre les groupes décrits par Confucius et le système des castes hindou : les guerriers, les prêtres, les artisans et les fermiers. Avec cette division du travail, la domination des fermiers par les guerriers et les prêtres fut institutionnalisée. Et cet assujettissement n’a jamais pris fin. C’était la première inégalité.
En même temps qu’ils divisaient le travail entre les civils, les hommes qui ne l’avaient pas déjà fait établirent une domination générale sur les femmes. Il se peut que cela se soit produit plus tôt, au cours des premiers âges de la pure et simple subsistance, mais il n’y a aucun moyen d’en être sûr ; ce que nous pouvons voir de nos propres yeux, c’est que dans les cultures pastorales les femmes travaillent à la fois chez elles et dans les champs. En réalité, pour vivre de la terre, il faut que tout le monde travaille. Mais, dès le début, les femmes firent ce dont les hommes avaient besoin. Et dans chaque famille, l’exercice du pouvoir de chaque individu reflétait la situation générale : le roi et son héritier dominaient les autres. C’était la deuxième inégalité, la troisième étant la domination des femmes et des enfants par les hommes.
La brève ère qui suivit fut marquée par le début des échanges entre les premières civilisations, l’ouverture des routes de la Soie qui reliaient la Chine, la Bactriane, l’Inde, la Perse, le Moyen-Occident, Rome et l’Afrique, et le déplacement des moissons en surplus dans tout l’Ancien Monde. L’agriculture s’adapta à ces nouveaux marchés, et la production de viande, de céréales en vrac et de cultures spécialisées – comme les olives, le vin et les mûriers – augmenta considérablement. Par ailleurs, les artisans fabriquèrent de nouveaux outils et, grâce à eux, des matériels agricoles et des vaisseaux plus performants. Certains groupes de négociants et certaines personnes commencèrent à saper le monopole du pouvoir qui appartenait aux premiers empires de prêtres militaires, et l’argent commença à remplacer la terre comme source ultime du pouvoir. Tout ceci se produisit bien avant que ne l’avancent ibn Khaldun et les historiens du Maghreb. Au cours de la période classique – vers 1200 avant l’Hégire –, en dehors du fait qu’ils avaient ébranlé les vieilles coutumes, les changements provoqués par le commerce avaient répandu et aggravé les trois premières inégalités, soulevant de nombreuses interrogations sur la nature humaine. Les grandes religions classiques furent fondées précisément pour tenter de répondre à ces questions – le zoroastrisme en Perse, le bouddhisme en Inde et les philosophies rationalistes en Grèce. Mais, quelles que soient ses particularités métaphysiques, chaque civilisation appartenait à un monde qui faisait circuler les richesses en tous sens et, pour finir, jusqu’aux élites ; ces mouvements de fortune devenaient la force motrice du changement dans les affaires humaines – en d’autres mots, de l’histoire. La richesse allait à la richesse. De la période classique à la découverte du Nouveau Monde (de 1200 avant l’Hégire à l’an 1000 de l’Hégire, à peu près), le commerce fit du Moyen-Occident l’épicentre du Vieux Monde, et une partie importante des richesses s’y concentra. C’est vers le milieu de cette période que l’islam apparut. Il en arriva très vite à dominer le monde. Il est vraisemblable que ce phénomène eut des motifs économiques sous-jacents. L’islam, et ce n’est peut-être pas un hasard, apparaissait au « centre du monde », la zone que l’on appelait parfois la Zone de l’Isthme, entourée par le golfe Persique, la mer Rouge, la Méditerranée, la mer Noire et la mer Caspienne. Toutes les routes commerciales nécessaires se croisaient à cet endroit, comme les artères du dragon dans une perspective feng shui. Il n’y a donc rien de particulièrement surprenant à ce que, pendant un moment, l’islam ait apporté au monde une monnaie universelle – le dinar – et une langue véhiculaire – l’arabe. Mais c’était aussi une religion. À vrai dire, ça devint même la religion universelle, et il faut bien comprendre que son succès en tant que religion venait en partie du fait que, dans un monde en proie à des inégalités croissantes, l’islam parlait d’un royaume où tous seraient égaux – égaux devant Dieu, sans considération d’âge, de sexe, de métier, de race ou de nationalité. C’était là que résidait le principal attrait de l’islam : l’inégalité pouvait être abolie ; on pouvait s’en affranchir dans le plus important des royaumes, le royaume éternel de l’esprit.
En attendant, pourtant, le commerce des denrées alimentaires et des produits de luxe se poursuivait dans tout le Vieux Monde, d’al-Andalus à la Chine. Ces échanges portaient essentiellement sur les animaux, le bois, le métal, le tissu, le verre, l’encre et les calames, l’opium, les pharmacopées et, de plus en plus au fur et à mesure que les siècles passaient, les esclaves. Ceux-ci venaient essentiellement d’Afrique, et ils prirent de l’importance, parce qu’il y avait de plus en plus de travail à faire, alors qu’en même temps les progrès du machinisme qui auraient permis d’obtenir des outils plus performants n’avaient pas encore été effectués, de sorte que ce surcroît de travail ne pouvait être assuré que par des hommes et des animaux. C’est pourquoi, en plus de l’assujettissement des fermiers, des femmes et de la famille, émergea une quatrième inégalité, celle de la race ou du groupe, conduisant à l’asservissement des peuples les plus faibles, aussitôt réduits en esclavage. Et l’accaparement des richesses par les élites se poursuivit.
La découverte du Nouveau Monde n’avait fait qu’accélérer le processus, générant à la fois plus de profits et plus d’esclaves. Les routes commerciales elles-mêmes s’étaient substantiellement déplacées de la terre à la mer, et l’islam ne contrôlait plus les carrefours comme il l’avait fait pendant un millier d’années. Le principal centre d’accumulation de profits s’était déplacé vers la Chine ; en vérité, la Chine aurait pu être le centre depuis le début. C’était elle qui avait toujours été la plus peuplée ; et dès l’antiquité, les gens du monde entier avaient fait le commerce des produits chinois. La balance commerciale de Rome avec la Chine était tellement déficitaire qu’elle perdait un million d’onces d’argent par an. La soie, la porcelaine, le bois de santal, le poivre – Rome, comme le monde entier, envoyait son or en Chine en échange de ces produits, et la Chine s’enrichissait. Et maintenant que la Chine avait pris le contrôle des côtes occidentales du Nouveau Monde, elle avait aussi commencé à profiter d’un afflux direct d’énormes quantités d’or, d’argent et d’esclaves. Cette double accumulation de richesses, à la fois par le commerce de marchandises manufacturées et par extraction directe, était quelque chose de nouveau, une sorte d’accumulation d’accumulations.
Il apparaît donc que la Chine est clairement la puissance montante du monde, en compétition avec la précédente puissance dominante, le Dar al-Islam, qui continue d’exercer une forte attraction sur les gens qui espèrent une justice au paradis, après y avoir renoncé sur Terre. L’Inde existe donc en tant que troisième culture géographiquement située entre les deux précédentes, faisant le lien entre elles, tout en étant bien évidemment influencée par elles. En attendant, les cultures primitives du Nouveau Monde, récemment reliées à la masse de l’humanité et aussitôt dominées par elle, luttaient pour leur survie.
D’une manière générale, l’histoire de l’humanité pourrait se résumer au vol des richesses, dont la destination se déplaçait au gré des puissances du moment, tout en répandant, toujours et partout, les quatre grandes inégalités. C’est l’histoire. Pour autant que je le sache, nulle part, dans aucune civilisation, à aucun moment les richesses créées par tous n’ont été équitablement distribuées. Le pouvoir s’est exercé partout où il pouvait, et chaque nouveau pouvoir s’est aussitôt empressé d’ajouter à l’inégalité générale. Laquelle a crû en proportion directe des richesses détournées ; parce que richesse et pouvoir sont presque la même chose. Les riches, en effet, achètent le pouvoir des armes dont ils ont besoin pour imposer plus d’inégalité. Et c’est ainsi que le cycle perdure. Résultat : pendant qu’un petit pourcentage d’êtres humains vit dans la profusion alimentaire, dans le confort matériel et l’accès au savoir, ceux qui n’ont pas cette chance sont devenus l’équivalent de facto d’animaux domestiques, attelés aux riches et aux puissants, produisant les richesses dont ils ne bénéficieront jamais. Quand vous êtes une jeune fille de ferme noire, que pouvez-vous dire au monde ? Et d’ailleurs, que pourrait vous dire le monde ? Vous subissez les quatre grandes inégalités et vous vivez une demi-vie à moitié vécue dans l’ignorance, la faim et la peur. En réalité, une seule de ces quatre grandes inégalités suffit à créer de telles conditions. Force est donc de reconnaître que la très grande majorité des êtres humains ayant jamais vécu a connu une vie de misère et de servitude, imposée par une petite minorité de riches et de puissants. Pour chaque empereur, chaque bureaucrate, chaque calife, chaque cadi, pour chacune de ces vies riches et comblées, il y a eu dix mille vies étriquées, gâchées, perdues. Même si on s’accorde a minima sur ce qu’est une vie bien remplie, et même si on admet que la vie spirituelle et la solidarité ont permis à beaucoup de pauvres et de malheureux de connaître un tant soit peu de bonheur et de réussite, on ne voit pas comment on pourrait conclure autrement qu’en disant qu’il y a eu plus de misère que de vies pleinement vécues. Toutes les religions du monde ont tenté d’expliquer ou d’atténuer ces inégalités, y compris l’islam, qui s’est montré original en imaginant un royaume dans lequel tous seraient égaux. Toutes ont essayé de justifier les inégalités de ce monde. Toutes ont échoué. Même l’islam a échoué. Le Dar al-Islam est aussi entaché par l’inégalité que le reste du monde. En réalité, je pense même maintenant que la description indienne et chinoise de la vie après la mort, le système de six lokas ou royaumes de réalité – les devas, les asuras, les hommes, les bêtes, les prêtas et les habitants de l’enfer –, n’est qu’une description métaphorique mais exacte de ce monde et des inégalités qui existent en lui : les devas vivant dans le luxe, jugeant les autres, les asuras se battant pour maintenir les devas dans leur position privilégiée, les hommes s’en sortant comme ils peuvent, les bêtes travaillant comme des bêtes, les prêtas, des sans-abri vivant dans la crainte de l’enfer, et les habitants de l’enfer, de pauvres hères réduits à l’esclavage par la misère.
Tant que le nombre des vies pleinement vécues ne sera pas supérieur au nombre des vies gâchées, nous resterons coincés dans une sorte de préhistoire, indigne du grand esprit de l’humanité. L’histoire en tant qu’histoire digne d’être racontée ne commencera que quand le nombre des vies pleinement vécues surpassera celui des vies gâchées. Il est à craindre que bien des générations ne passent avant que l’histoire ne commence. Toutes les inégalités devront prendre fin ; toutes les richesses excédentaires devront être distribuées équitablement. En attendant, nous ne sommes que des espèces de singes balbutiants, et l’humanité telle que nous aimons généralement l’envisager n’existe pas encore. Pour dire les choses en termes religieux, nous sommes encore dans le bardo, attendant de naître.
La vieille femme lut les pages écrites par son mari en faisant les cent pas sur leur longue véranda. Elle était très agitée. Lorsqu’elle eut fini sa lecture, elle caressa l’épaule de son mari. Le jour tirait à sa fin ; une nouvelle lune brillait comme une faucille dans le ciel indigo. Le fleuve noir coulait au loin. Elle s’approcha de son propre écritoire, à l’autre bout de la véranda, prit son pinceau et de quelques virgules rapides, spontanées, remplit une page.
Deux oies sauvages volent vers le nord dans le crépuscule.
Un lotus incline sa tête lourde dans la lagune.
Près de la fin de cette existence
Une sorte de colère gonfle mon sein ;
Une tigresse : la prochaine fois je l’attellerai
À mon chariot. Et regardez comme je vole !
Fini de clopiner sur ces mauvais pieds.
Maintenant, il n’y a plus rien à faire
Qu’écrire dans la pénombre et regarder avec mon bien-aimé
Les fleurs de pêcher flotter au fil de l’eau.
En voyant derrière moi toutes ces longues années,
Tout ce qui s’est passé de-ci de-là,
Je pense que ce que j’ai préféré, c’était le riz et le sel.
LIVRE 7
L’ÂGE DES GRANDS PROGRÈS
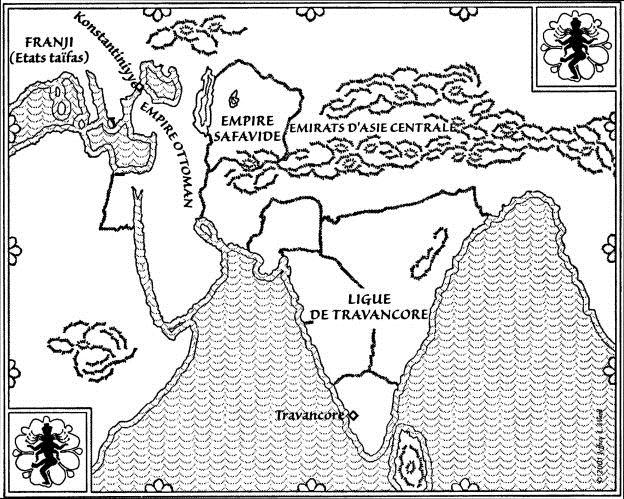
1. La chute de Konstantiniyye
Le troisième docteur du sultan et calife ottoman Selim, Ismail ibn Mani al-Dir, un Arménien, avait commencé sa carrière comme cadi, en étudiant le droit et la médecine à Konstantiniyye. Comme c’était un excellent médecin, il gravit rapidement les échelons de la bureaucratie ottomane, jusqu’au jour où le sultan Selim lui demanda de venir soigner l’une des femmes de son sérail. La fille du harem se rétablit grâce aux soins d’Ismail, qui guérit peu après le sultan Selim lui-même d’une maladie de peau. Après quoi, le sultan éleva Ismail au rang de médecin chef de la Sublime Porte et de son sérail.
Ismail passa alors son temps entre les nombreuses et discrètes visites à ses patients et la poursuite de ses études telle que l’effectue tout médecin, c’est-à-dire en pratiquant. Il ne se préoccupait guère de ses fonctions à la cour. Il noircissait d’épais recueils d’études de cas, notant tous les symptômes, médicaments, soins et résultats. Il assistait aux interrogatoires des janissaires, ainsi que l’y obligeait son titre, et prenait, là aussi, des notes.
Le sultan, impressionné par le dévouement et le talent de son médecin, s’intéressa aux cas qu’il étudiait. Les corps de tous les janissaires qu’il avait fait exécuter après l’échec de leur coup d’État de 1202 furent mis à la disposition d’Ismail, et l’interdiction religieuse d’autopsier les cadavres et de les disséquer fut levée, au motif qu’elle ne concernait pas les criminels. Il y avait beaucoup de travail, et il fallait le faire très vite, bien que les corps aient été plongés dans la glace. Le sultan participa lui-même à de nombreuses dissections, posant des questions à chaque incision. Il ne mit d’ailleurs pas longtemps à voir les avantages que l’on pouvait retirer de la vivisection, et s’empressa de l’encourager.
Une nuit de 1207, le sultan appela son médecin, lui demandant de venir dans son palais de la Sublime Porte. Un de ses vieux garçons d’écurie était en train de mourir, et Selim l’avait fait confortablement installer au milieu d’une chambre, dans un lit placé sur l’un des immenses plateaux d’une gigantesque balance extrêmement précise, tandis que sur l’autre plateau se trouvait un amoncellement d’or, équilibrant le tout.
Le vieil homme se mourait en respirant à grand bruit, sous le regard du sultan, qui se régalait d’un dîner de minuit. Il expliqua au docteur qu’il était sûr que cette méthode permettrait de déterminer la présence de l’âme, si une telle chose existait, et d’en calculer le poids.
Ismail alla voir le vieil homme sur son lit surélevé, et lui prit doucement le poignet. Le souffle du vieillard faiblissait, se faisait haletant. Le sultan se leva et tira Ismail en arrière, tout en lui indiquant l’aiguille de la balance. Il ne fallait toucher à rien.
Le vieil homme arrêta de respirer.
— Bientôt, murmura le sultan. Regarde…
Ils regardèrent. Il y avait peut-être dix personnes dans la pièce. Tout était parfaitement silencieux et immobile, comme si le monde entier s’était tenu là, pour témoigner de cette expérience.
Lentement, très lentement, le plateau de la balance où se trouvaient le vieil homme et son lit commença à monter. Quelqu’un eut un hoquet. Le lit s’éleva, puis resta suspendu en l’air, au-dessus d’eux. Le vieil homme s’était allégé.
— Enlevez la plus petite quantité d’or possible, murmura le sultan. Commencez par la monnaie.
Un de ses gardes du corps s’attela à la tâche, retirant, piécette par piécette, une petite quantité d’or. Puis une plus grande. Finalement, le plateau du vieillard commença à redescendre, jusqu’à se trouver en dessous du niveau du plateau chargé d’or. Le garde du corps remit une piécette, puis une autre, jusqu’à ce que la balance fût de nouveau à l’équilibre. Le poids du mourant avait diminué d’un peu plus d’une piécette.
— Intéressant, commenta le sultan d’une voix redevenue normale.
Puis il partit prendre son dessert, et invita Ismail à s’approcher.
— Viens, mangeons. Et dis-moi ce que tu penses de ces troubles à l’est, de ces gens dont on dit qu’ils voudraient nous attaquer.
Le docteur haussa les épaules. Il n’avait pas d’avis sur la question.
— Allons, tu dois sûrement penser quelque chose, l’encouragea le sultan. Dis-moi ce que tu sais.
— Comme tout le monde, j’ai entendu dire qu’ils venaient du sud de l’Inde, répondit docilement Ismail. Ils ont vaincu les Moghols. Ils ont une excellente armée, des navires pour la transporter de conquête en conquête, et des villes côtières fortifiées. Leur chef aime qu’on l’appelle le Kerala de Travancore. Ils ont battu les Safavides, et attaqué la Syrie et le Yémen…
— Allons, je sais tout cela, coupa le sultan. Ce que je te demande, Ismail, c’est une explication. Comment ont-ils fait pour accomplir toutes ces choses ?
— Je l’ignore, Excellence, répondit Ismail. Les quelques lettres que j’ai reçues de mes collègues orientaux ne parlent pas de ces affaires militaires. J’ai cru comprendre que leur armée se déplaçait très rapidement, à une vitesse d’environ cent lieues par jour si je ne me trompe.
— Cent lieues par jour ! Mais comment est-ce possible ?
— Je ne sais pas. L’un de mes collègues m’a écrit qu’il soignait des blessures par le feu. J’ai entendu dire que leur armée épargnait ceux qu’elle faisait prisonniers, et les envoyait à l’arrière, dans des zones agricoles qu’elle avait conquises.
— Bizarre. Sont-ils hindous ?
— Hindous, bouddhistes, sikhs. J’ai l’impression qu’ils pratiquent une sorte de mélange entre ces trois religions, une nouvelle espèce de religion pourrait-on dire, inventée par ce sultan de Travancore. Les gourous hindous font souvent cela, et ce serait un personnage de ce genre.
Le sultan Selim hocha la tête.
— Mange, ordonna-t-il.
Ismail attaqua une coupe de sorbet.
— Est-ce qu’ils se servent de feu grégeois, ou de l’alchimie noire de Samarkand ?
— Je ne sais pas. Samarkand elle-même a été abandonnée, si j’ai bien compris, après une épidémie de peste, puis une série de tremblements de terre. Mais ses travaux alchimiques ont pu être poursuivis en Inde.
— Alors nos agresseurs se serviraient de magie noire, conclut le sultan, en haussant le sourcil.
— Je ne puis l’affirmer.
— Et au sujet de leurs navires ?
— Vous en savez plus que moi, Excellence. On raconte qu’ils font voile contre le vent.
— Encore de la magie noire !
— Plutôt le pouvoir de machines, Excellence. Un de mes correspondants sikhs m’a dit qu’on pouvait faire bouillir de l’eau dans des pots hermétiquement clos, obligeant la vapeur à sortir par de petits tuyaux, comme des canons de fusil. La vapeur jaillit en poussant un système de roues à aubes, un peu comme le fleuve fait tourner la roue d’un moulin, et le navire avance.
— Mais alors, ils ne peuvent se déplacer que vers l’arrière ?
— Il suffit d’inverser le système, Excellence.
Le sultan jeta un regard suspicieux à Ismail.
— N’arrive-t-il jamais que l’un de ces navires explose ?
— Cela doit arriver, si quelque chose ne marche pas.
Selim parut satisfait.
— Fort bien, c’est très intéressant ! Alors il suffirait qu’un boulet de canon atteigne leur chaudière pour faire exploser tout le navire !
— C’est plus que probable.
Le sultan était ravi.
— Ce sera parfait pour s’exercer au tir. Viens, suis moi.
Il quitta la pièce suivi de son cortège habituel : gardes du corps, au nombre de six, cuisinier et serviteurs, astronome, valet, et le Chef des Eunuques Noirs, tous lui emboîtèrent le pas, plus le médecin, que le sultan tenait par l’épaule. Il conduisit Ismail par le Portail du Plaisir, dans son harem, sans un mot à ses gardes, laissant derrière lui sa suite se demander qui devait le suivre ou non dans le sérail. Pour finir, seuls un serviteur et le Chef des Eunuques Noirs entrèrent.
Dans le sérail, tout était d’or et de marbre, de soie et de velours. Les murs des antichambres étaient couverts de peintures religieuses et d’icônes datant du temps de Byzance. Le sultan fit un geste, et l’Eunuque Noir hocha la tête en direction de l’un des gardes, en faction devant une porte au loin.
L’une des concubines du harem sortit, escortée par quatre servantes : c’était une jeune femme à la peau laiteuse et aux cheveux roux, et dont le corps luisait à la lumière des lampes à gaz. Ce n’était pas une albinos, mais plutôt une personne au teint naturellement pâle, l’une des célèbres esclaves blanches du sérail, l’une des rares descendantes connues des anciens Franjs. Des générations entières de sultans ottomans avaient continué de les apparier entre eux, s’efforçant d’en garder la lignée pure. Nul en dehors du sérail ne voyait jamais les femmes, et nul, hors du palais du sultan, ne voyait jamais les mâles auxquels on les faisait s’accoupler.
Les cheveux de cette jeune femme étaient d’un roux teinté de reflets d’or, le bout de ses seins était rose, et sa peau d’un blanc si translucide que l’on pouvait voir le réseau de ses veines bleutées, notamment sous ses seins, qui étaient très légèrement gonflés. Le docteur se dit qu’elle devait être enceinte d’environ trois mois. Le sultan n’avait pas l’air de l’avoir remarqué ; c’était sa favorite, et il allait encore avec elle chaque jour.
La si familière routine commença. L’odalisque se dirigea vers la partie d’un lit que l’on pouvait cacher par des rideaux, mais le sultan ne prit pas la peine de les tirer. Les servantes aidèrent la femme à s’installer confortablement, les bras écartés, les cuisses ouvertes et les genoux levés. Selim dit « Très bien » et la rejoignit. Il sortit son membre roide de sa culotte bouffante et s’allongea sur elle. Ils gigotèrent comme il est d’usage, jusqu’à ce que le sultan, dans un frisson et un grognement, fasse sa petite affaire. Il s’assit alors à côté d’elle, et lui caressa le ventre et les jambes.
Puis, comme une pensée lui traversait l’esprit, il se tourna vers Ismail.
— Comment c’est, maintenant, là d’où elle vient ? demanda-t-il.
Le docteur s’éclaircit la gorge.
— Je ne sais pas, Excellence.
— Dis-moi ce que tu as entendu.
— J’ai entendu dire que la Franji, à l’ouest de Vienne, était principalement divisée entre l’Andalousie et la Horde d’Or. Les Andalous occupent les vieilles terres franques ainsi que les îles au nord. Ce sont des sunnites, avec l’habituelle cohorte de soufis et de wahhabites rivalisant pour les faveurs des émirs. L’est est un salmigondis de principautés vassales de la Horde d’Or et des Safavides, la plupart chiites. Les soufis y sont très importants. Ils ont également occupé les îles proches de leurs côtes, ainsi que la péninsule romaine, même si une bonne partie de cette dernière reste entre les mains des Berbères et des Maltais.
— Alors, ils sont prospères, dit le sultan en hochant la tête.
— Je ne sais pas. Il y pleut plus que dans les steppes, mais il y a des montagnes partout, ou des collines. Il y a une plaine sur la côte nord où ils ont des vignobles et des cultures de ce genre. D’après mes informations, l’Andalousie et la péninsule romaine s’en sortent bien. Mais au nord de leurs montagnes, la situation est plus difficile. On dit que la peste sévit encore dans les basses terres.
— Et pourquoi ça ? Que s’est-il donc passé là-bas ?
— Eh bien, il y fait toujours froid et humide. Du moins, c’est ce qu’on dit, ajouta le docteur avec un frisson. En fait, personne n’en sait rien. Il se pourrait que la peau blanche des habitants les rende plus sensibles à la peste. C’est du moins ce que soutient al-Ferghana.
— Mais aujourd’hui de très bons musulmans vivent dans ces régions, et tout va très bien.
— C’est vrai. Les Ottomans des Balkans, les Andalous, les Safavides, la Horde d’Or. Ils sont tous musulmans, à l’exception de très rares juifs, et de Zott.
— Mais l’islam est divisé.
Le sultan réfléchit un instant, tout en caressant machinalement la toison pubienne, rousse, de l’odalisque.
— Dis-moi encore, d’où venaient les ancêtres de cette fille ?
— Des îles qui se trouvent au nord de la côte de Franquie, risqua le docteur. D’Angleterre. Ils étaient tous très pâles là-bas, et quelques-uns des habitants des îles les plus lointaines ont survécu à la peste. Leur peuple a été découvert et réduit en esclavage un siècle ou deux plus tard. On raconte qu’ils ignoraient complètement ce qui s’était passé.
— Ce sont de bonnes terres ?
— Absolument pas. Forêts, rochers… Ils vivaient de l’élevage des moutons, et de la pêche. C’était un peuple de primitifs, un peu comme celui du Nouveau Monde.
— Où ils ont trouvé beaucoup d’or.
— L’Angleterre était plus réputée pour ses mines d’étain que pour ses mines d’or, si je me souviens bien.
— Combien de ces survivants ont été capturés ?
— D’après ce que j’ai lu, seulement quelques milliers. La plupart sont morts, ou se mélangèrent au gros de la population. Il se peut que vous ayez les derniers spécimens de race pure.
— Oui. Et celle-ci est grosse de l’un de ces hommes. C’est ce que je voulais te dire. Nous prenons autant soin des hommes que des femmes, afin que leur lignée ne s’éteigne pas.
— Très astucieux.
Le sultan se tourna vers son Eunuque Noir.
— Je suis prêt pour Yasmina, maintenant.
Entra alors une autre fille, très noire, au corps quasiment identique à celui de la jeune fille blanche, à l’exception du fait qu’elle n’était pas enceinte. Côte à côte, on aurait dit les pièces d’un jeu d’échecs. La fille noire prit la place de la fille blanche sur le lit. Le sultan se prépara à la monter.
— Eh bien, les Balkans sont un endroit fort triste, lâcha-t-il. Mais plus à l’ouest c’est peut-être mieux. Nous pourrions déplacer la capitale de notre empire à Rome, tout comme ils l’avaient eux-mêmes, jadis, déplacée ici.
— Oui. Mais la péninsule romaine est parfaitement repeuplée.
— Venise aussi ?
— Non. Toujours déserte, Excellence. Elle est souvent inondée, et puis elle a été particulièrement ravagée par la peste.
Le sultan se mordit les lèvres.
— Je ne – oh, ah ! – je n’aime pas les marécages !
— Non, Excellence.
— Bon, eh bien, nous les affronterons ici même. Je dirai aux troupes que leur âme, la plus précieuse piécette de leur corps, montera au Paradis des Dix Mille Années s’ils meurent en défendant la Sublime Porte. Ils mèneront la même vie que moi ici. Nous rencontrerons ces envahisseurs quand ils seront au détroit.
— Fort bien, Excellence.
— Laisse-moi, maintenant.
Mais quand la marine indienne apparut, ce ne fut pas dans la mer Égée, mais dans la mer Noire, la mer Ottomane. De petits bateaux noirs couvraient la mer Noire, des bateaux avec des roues à aubes sur le côté, sans voiles, juste de longs plumets de fumée blanche qui sortaient des cheminées au-dessus des roufs noirs. Ils ressemblaient aux fours des forges, et auraient dû couler comme des pierres. Mais ils ne coulaient pas. Ils passèrent dans une traînée de vapeurs blanches le détroit du Bosphore relativement mal gardé, détruisant les batteries côtières au passage, et jetèrent l’ancre non loin de la Sublime Porte. De là, ils tirèrent une grande quantité d’obus explosifs sur le palais de Topkapi, la plupart dirigés vers la série de batteries censées défendre ce côté-ci de la ville, mais qui ne servaient quasiment plus que pour les cérémonies et qu’on avait trop longtemps négligées, personne n’ayant osé attaquer Konstantiniyye depuis des siècles. Comment ces bâtiments étaient arrivés jusqu’à la mer Noire, c’était un mystère.
En tout cas, ils étaient là, criblant d’obus les défenses, les faisant taire ; tirant alors obus sur obus en direction des murailles du palais, et des batteries qui restaient à Péra, de l’autre côté de la Corne d’Or. La population de la ville se précipita chez elle, alla chercher refuge dans les mosquées, ou s’enfuit dans la campagne, de l’autre côté du mur de Théodose. Très vite, la ville parut déserte, à l’exception de quelques jeunes hommes qui montaient aux créneaux pour observer l’assaut ; puis, quand on se rendit compte que les navires de fer ne bombardaient pas la ville mais seulement Topkapi, d’autres jeunes hommes sortirent dans les rues. Quant au palais, malgré ses énormes murailles, réputées imprenables, il était bombardé sans relâche.
Ismail fut invité par le sultan à venir le retrouver dans ce qui était dorénavant une gigantesque cible. Il rassembla dans des caisses tous les papiers qu’il avait accumulés au cours des dernières années, ses notes, ses réflexions, ses schémas, ses échantillons et ses spécimens. Il espérait trouver un moyen d’envoyer tout ça à la madrasa de Nsara, où bon nombre de ses plus fidèles correspondants vivaient et travaillaient ; ou même à l’hôpital de Travancore, patrie de leurs assaillants, et d’un autre groupe de fidèles amis médecins.
Mais il n’y avait pas moyen d’organiser un tel transfert, de sorte qu’il les laissa chez lui, avec une note sur le couvercle de chaque caisse détaillant son contenu, et sortit dans les rues désertes qui menaient à la Sublime Porte. C’était une journée ensoleillée, mais en dehors des voix qui montaient de la grande mosquée bleue, le seul signe de vie était les chiens errants, comme si le Jour du Jugement était enfin arrivé, et qu’Ismail avait été oublié.
En tout cas, c’était assurément le Jour du Jugement pour le palais, que des obus frappaient continuellement. Ismail réussit à passer les portails extérieurs, et fut conduit auprès du sultan. Ce dernier était particulièrement excité par les événements. Selim le Troisième se tenait au sommet de la plus haute des échauguettes de Topkapi, dominant le spectacle de la flotte qui les bombardait, et admirait, comme s’il s’agissait d’une fête, chacune de leurs actions à l’aide d’un long télescope d’argent.
— Pourquoi ces navires ne coulent-ils pas alors qu’ils sont en fer ? demanda-t-il à Ismail. Ils doivent pourtant être bien lourds…
— Il doit y avoir suffisamment d’air dans leurs cales pour qu’ils flottent, répondit Ismail, bien conscient de ce que sa réponse avait de théorique et, peut-être, d’erroné. Si nous parvenions à percer leur coque, alors sans doute couleraient-ils plus vite que des navires de bois.
L’un des navires tira. Il y eut une gigantesque explosion, un nuage de fumée et, apparemment, un léger mouvement du navire vers l’arrière. Leurs canons tirèrent, un par navire. Curieuses petites choses, si semblables à de grands cygnes noirs ou à des scarabées d’eau géants.
Le tir pulvérisa le mur du palais sur leur gauche. Ismail sentit trembler le sol. Il poussa un soupir.
Le sultan le regarda.
— On a peur ?
— Un peu, Excellence.
— Viens, dit le sultan avec une grimace, je veux que tu m’aides à choisir quoi emporter. Il me faut les plus précieux de mes bijoux.
C’est alors qu’il vit quelque chose voler au-dessus d’eux.
— Mais qu’est-ce que c’est ?
Il se tourna vers le télescope, et Ismail leva les yeux. Il y avait comme une sorte de point rouge dans le ciel. Il dérivait au fil du vent, au-dessus de la ville, semblable à un gros œuf rouge.
— Il y a un panier en dessous ! s’exclama le sultan. Et des gens dans le panier ! Ils savent faire voler des choses !
Ismail cligna des yeux.
— Puis-je me permettre d’utiliser le télescope, Excellence ?
Sous de gros nuages blancs, le point rouge s’approchait d’eux en planant dans les airs. Tout devenait clair pour Ismail.
— L’air chaud monte, dit-il, comme en proie à une sorte de vertige. Ils doivent avoir un réchaud dans le panier. La chaleur de sa flamme réchauffe l’air contenu dans le ballon, faisant s’élever l’ensemble !
— Magnifique ! s’esclaffa le sultan en tapant dans ses mains.
Puis il recolla son œil au télescope, et déclara :
— Cependant, je ne vois pas de flammes.
— Ce doit être un petit feu, sinon le ballon brûlerait. Si c’est une sorte de poêle à charbon, vous ne le verrez même pas. Et pour descendre, il leur suffit de diminuer l’intensité du brasier.
— J’en veux un pareil, déclara le sultan. Pourquoi ne m’en as-tu pas fait un ?
— Parce que je n’y ai pas pensé. Enfin, avec un peu de chance, le vent le chassera peut-être dans une autre direction, ajouta Ismail alors que le ballon venait vers eux.
— Surtout pas ! glapit le sultan avec exaltation. Je veux voir ce dont il est capable.
Il fut satisfait. Le ballon décrivit une courbe juste au-dessus des murailles effondrées du palais, sous les nuages ou entre eux, disparaissant même à l’intérieur de l’un d’eux, ce qui donna à Ismail la puissante sensation qu’il volait dans l’air comme un oiseau. Des gens dans l’air, comme des oiseaux !
— Abattez-le ! s’écria, plein d’enthousiasme, le sultan. Tirez sur le ballon !
Les gardes du palais essayèrent, mais les rares canons qui restaient ne pouvaient être haussés suffisamment pour le viser. Les artilleurs tirèrent dessus, le sultan saluant par un cri de joie chacune des sèches détonations. La fumée âcre de la poudre à canon monta dans l’air, masquant les senteurs de citron, de jasmin et de poussière. Mais, pour autant qu’ils pouvaient en juger, pas un tir n’atteignit ni le ballon ni le panier. En regardant les minuscule visages qui les contemplaient d’en haut, depuis le bord du panier, apparemment enroulés dans d’épaisses écharpes de laine, Ismail se dit que le ballon était peut-être hors de portée, trop haut pour pouvoir être atteint.
— Les balles ne doivent pas pouvoir monter à cette altitude, commenta-t-il.
Cela dit, ils n’étaient pas trop haut pour lancer des choses en dessous d’eux. Les gens dans le panier semblèrent les saluer d’un geste de la main, puis un point noir tomba vers eux, comme un faucon en piqué, un faucon extrêmement compact et rapide. Il s’écrasa au beau milieu du toit de l’un des bâtiments intérieurs du palais, et explosa dans un énorme nuage de tuiles fracassées, dont les débris voltigèrent un peu partout dans la cour et le jardin.
Le sultan exultait de bonheur. Trois nouvelles bombes s’abattirent sur le palais, dont l’une sur un énorme canon entouré de gardes. Elle les tua en faisant d’énormes dégâts.
Les cris du sultan couvraient le vacarme des explosions, assourdissant Ismail.
— Ils arrivent, dit-il en tendant le doigt vers les navires de fer.
Les navires étaient tout près des côtes. Des chaloupes s’approchaient des plages, et lorsque les hommes furent prêts à débarquer, les navires se mirent à tirer de plus belle, à une cadence redoublée. Leurs hommes accosteraient sur une plage où il n’y avait personne pour contre-attaquer, juste au bas d’une ancienne muraille, à présent réduite en poussière.
— Ils seront bientôt là, lança Ismail.
Pendant ce temps, le ballon avait été poussé par les vents plus à l’ouest, derrière le palais, au-dessus des champs, par-delà les murailles de la ville.
— Suis-moi, dit soudain Selim en attrapant Ismail par le bras. Il faut faire vite.
Ils dévalèrent plusieurs volées de marches d’un escalier de marbre détruit, suivis par l’entourage immédiat du sultan. Celui-ci les mena dans le labyrinthe de chambres et de couloirs qui occupait le sous-sol du palais.
Dans ces profondeurs, quelques lampes à huile éclairaient faiblement des salles entières emplies du butin amassé par les Ottomans depuis quatre siècles, et peut-être même par les Byzantins, sinon les Romains, les Grecs, les Hittites ou les Sumériens. Tous les trésors du monde étaient entassés là, dans une enfilade de pièces. L’une n’était emplie que de pièces d’or, avec tout de même quelques lingots ; une autre était bourrée d’objets d’art religieux byzantins ; une autre d’armes anciennes ; une autre encore de bois rares et de fourrures. Il y en avait même une qui regorgeait de monceaux de roches colorées, d’aucune valeur pour autant qu’Ismail put en juger.
— Nous n’aurons pas le temps de tout regarder, signala-t-il en courant derrière le sultan.
Mais Selim se contenta de rire. Laissant derrière lui une longue galerie où était entreposée toute une série de tableaux et de statues, il entra dans une petite pièce adjacente, vide à l’exception de quelques sacs posés sur un banc.
— Prenez-les, ordonna-t-il à ses serviteurs hors d’haleine.
Puis il se remit à courir, d’un pas vif et sûr.
Ils arrivèrent à un escalier qui descendait sous terre, loin au-dessous du palais. C’était une vision étrange que celle de ces marches en marbre lisse, filant dans les entrailles du monde, au sein d’une galerie naturelle, taillée dans la roche. La grande caverne-citerne de la ville se trouvait un peu plus au sud-est, si les renseignements d’Ismail étaient bons. Ils finirent par se retrouver dans une grotte au plafond bas, dont le sol était inondé, et qui donnait sur une jetée de pierre, où était amarrée une longue barge étroite manœuvrée par des gardes impériaux. Des torches, sur le quai, et des lanternes, sur la barge, donnaient à la scène un aspect surnaturel. Ils se trouvaient apparemment dans une galerie parallèle à la caverne-citerne, et pourraient y aller à la rame.
Selim montra à Ismail le plafond de la cage d’escalier, et Ismail vit alors que des explosifs avaient été placés dans des fissures et des trous percés à cet office. Quand ils seraient partis, et suffisamment loin, cette issue serait probablement détruite, entraînant avec elle la destruction d’une bonne partie du palais. En tout cas, le chemin par lequel ils allaient s’enfuir serait obstrué, et on ne pourrait pas les suivre.
Des hommes s’activèrent à charger la barge, pendant que le sultan inspectait les bâtons de dynamite. Quand ils furent prêts à partir, il alluma lui-même leurs mèches, avec un sourire émerveillé. Ismail parcourut l’endroit du regard, en se disant que la lumière ressemblait à celle des icônes byzantines qu’ils avaient vues en courant à travers les salles du trésor.
— Nous allons rejoindre l’armée des Balkans, puis nous traverserons l’Adriatique, vers Rome ! annonça le sultan. Nous allons conquérir l’Ouest, après quoi nous reviendrons chasser ces infidèles, et nous les punirons pour leur impudence !
Les marins reprirent en chœur les cris de joie des gardes impériaux, donnant l’impression de milliers d’hommes, à cause des murs proches et de la voûte basse du lac intérieur. Le sultan accueillit ces acclamations en levant les bras, puis monta à bord de la barge, aidé par trois ou quatre de ses hommes. Personne ne vit qu’Ismail avait tourné les talons et remontait l’escalier maudit, en route vers un autre destin.
2. Travancore
Les gardes du corps du sultan avaient placé d’autres bombes réglées pour faire sauter les cages du zoo. Aussi, quand Ismail remonta l’escalier et ressortit à l’air libre, il trouva le palais plongé dans le chaos. Les envahisseurs et les défenseurs couraient en tous sens, pourchassant les éléphants, les lions et les caméléopards, ou fuyant devant eux. Un couple de rhinocéros noirs, couverts de sang, pareils à des sangliers de cauchemar, fonçaient aveuglément entre les hommes qui hurlaient ou tiraient des coups de fusil. Ismail leva les mains, s’attendant à être pris pour cible, et se disant qu’il aurait peut-être mieux fait de fuir avec Selim, tout compte fait.
Mais ils ne tirèrent sur personne, que sur les animaux. Quelques gardes gisaient à terre, morts ou blessés. D’autres s’étaient rendus et étaient étroitement surveillés, posant beaucoup moins de problèmes que les animaux. Pour le moment, il semblait que, contrairement à la rumeur, les envahisseurs n’avaient pas pour coutume de massacrer les vaincus. En réalité, ils se hâtaient d’évacuer leurs captifs, alors que des détonations ébranlaient le palais. Les murs et les toits s’effondraient, des panaches de fumée jaillissaient par les fenêtres et les cages d’escalier : avec toutes ces explosions et ces bêtes affolées, il paraissait prudent de quitter Topkapi au plus vite.
Ils furent regroupés à l’ouest de la Sublime Porte, dans l’enceinte du mur de Théodose, sur un terrain de parade où le sultan avait l’habitude de passer ses troupes en revue et de faire un peu de cheval. Les femmes du sérail, en hidjab, étaient entourées par leurs eunuques et une cohorte de gardes. Ismail s’assit avec ce qui restait de la maisonnée : l’astronome, divers ministres, les cuisiniers, les serviteurs, etc.
Les heures passant, ils commencèrent à avoir faim. Plus tard, dans l’après-midi, un détachement de l’armée indienne, de petits hommes à la peau sombre, leur apporta des sacs de pain plat.
— Votre nom, s’il vous plaît ? demanda l’un des hommes à Ismail.
— Ismail ibn Mani al-Dir.
L’homme fit courir son doigt sur une liste, s’arrêta et prit un autre à témoin.
Celui-ci, qui semblait être un officier, inspecta Ismail.
— Êtes-vous le docteur Ismail de Konstantiniyye, qui a écrit des lettres à Bhakta, l’abbesse de l’hôpital de Travancore ?
— C’est moi, répondit Ismail.
— Alors suivez-moi, s’il vous plaît.
Ismail se leva et le suivit en dévorant le pain qu’on lui avait donné. Condamné ou non, il mourait de faim ; et rien n’indiquait qu’on l’emmenait pour le fusiller. En vérité, la mention du nom de Bhakta semblait indiquer le contraire.
Dans une tente toute simple, mais très vaste, un homme assis derrière un bureau interrogeait des prisonniers. Ismail n’en reconnut aucun. On le conduisit devant l’officier qui menait les interrogatoires, et celui-ci le regarda avec curiosité.
— Vous figurez en haut de la liste de gens qui doivent se présenter au Kerala de Travancore, dit-il en persan.
— Je suis très étonné.
— C’est pour être félicité. À la demande de Bhakta, abbesse de l’hôpital de Travancore, apparemment.
— Une correspondante de longue date, en effet.
— Tout s’explique. Veuillez suivre le capitaine, que voici. Il va vous conduire au bateau pour Travancore. Mais d’abord, une question : on dit que vous êtes un intime du sultan. Est-ce vrai ?
— C’était vrai.
— Pouvez-vous nous dire où le sultan est allé ?
— Il a pris la fuite avec ses gardes du corps, répondit Ismail. Je crois qu’ils sont partis pour les Balkans, avec l’intention de refonder le sultanat plus à l’ouest.
— Vous savez comment ils ont fui le palais ?
— Non. Ils ne m’ont pas emmené, comme vous pouvez le voir.
Ismail avait entendu dire que leurs vaisseaux à moteur marchaient grâce à la chaleur des feux. Des feux qui brûlaient dans des chaudières où bouillait de l’eau, dont la vapeur était chassée dans des tuyaux qui actionnaient des roues à aubes, enchâssées dans de grands capots de bois, de part et d’autre de la coque. Des valves contrôlaient la quantité de vapeur arrivant dans chaque roue, et le vaisseau pouvait tourner sur place. Il avançait à grand bruit dans le vent, rebondissant maladroitement sur les vagues, qu’il fendait par l’avant, de sorte que le pont était noyé sous les embruns. Lorsque le vent soufflait par l’arrière, l’équipage hissait de petites voiles, et le bâtiment avançait normalement, mais avec une impulsion supplémentaire, fournie par les deux roues. Ils brûlaient du charbon dans les chaudières, et prétendaient que les dépôts de charbon des montagnes d’Iran alimenteraient leurs bâtiments jusqu’à la fin des temps.
— Qui a construit ces vaisseaux ? demanda Ismail.
— Le Kerala de Travancore en a ordonné la construction. Des forgerons d’Anatolie ont appris à faire les chaudières, les brûleurs et les roues à aubes. Le reste vient des chantiers navals de l’extrémité orientale de la mer Noire.
Ils arrivèrent dans un petit port près de la vieille ville de Trébizonde, et Ismail fut incorporé à un groupe qui continuait à cheval vers le sud-est à travers l’Iran, franchissant des collines desséchées et des montagnes enneigées, jusqu’en Inde. Partout, il y avait des troupes de cavaliers à peau sombre, de petits hommes habillés de blanc. Des canons montés sur des affûts à roues étaient placés en évidence dans toutes les villes et à tous les carrefours. Les villes ne semblaient pas avoir souffert de la guerre. Elles avaient l’air prospères, grouillantes d’activité. Ils changeaient de chevaux à de grands relais fortifiés tenus par l’armée, où ils s’arrêtaient également pour dormir. Beaucoup de ces relais étaient placés au pied des collines où des feux de joie brûlaient toute la nuit. En cachant ou en dévoilant ces feux, on pouvait communiquer rapidement d’un bout à l’autre du nouvel empire. Le Kerala était à Delhi et serait de retour à Travancore d’ici quelques semaines ; l’abbesse Bhakta était à Bénarès, mais elle aussi regagnerait bientôt Travancore. On informa Ismail qu’elle avait hâte de le rencontrer.
En attendant, Ismail découvrait à quel point le monde était grand. Et pourtant, il n’était pas infini. Dix jours de cheval, sans s’arrêter, les amenèrent de l’autre côté de l’Indus. Sur la côte occidentale, verdoyante, de l’Inde, une surprise l’attendait : ils montèrent dans des voitures de fer qui rappelaient un peu les vaisseaux noirs, sauf que leurs roues de fer suivaient des chaussées faites de deux rails de fer parallèles. Il avait l’impression de voler à travers les vieilles cités que les Moghols avaient si longtemps dirigées. La chaussée de fer longeait le bord disloqué du Deccan, au sud d’une région couverte d’interminables plantations de cocotiers, et, grâce à la puissance de la vapeur, ils avançaient aussi vite que le vent. Ils parvinrent ainsi à Travancore, sur la côte la plus au sud de l’Inde.
Beaucoup de gens s’étaient installés dans la ville depuis les récentes victoires impériales. Après avoir traversé une région de vergers et de cultures – sauf qu’Ismail aurait été incapable de dire ce qu’on y cultivait –, ils arrivèrent dans les faubourgs de la ville. Les environs étaient pleins de nouveaux bâtiments, de campements, de chantiers de construction, d’entrepôts : en fait, sur des centaines de lieues à la ronde, on aurait dit que la ville n’était qu’un immense chantier.
Du reste, le cœur de la ville était lui aussi en chantier. Leur caravane de voitures de fer s’arrêta dans un vaste hangar, où s’engouffrait un écheveau de rails appariés, et ils franchirent une porte qui donnait sur la ville. Un palais de marbre blanc, petit selon les critères de la Sublime Porte, se dressait au milieu d’un parc qui occupait une bonne partie du cœur de la vieille ville. De là, on voyait le port, où grouillaient toutes sortes de navires. Plus au sud s’étendait un chantier naval où l’on construisait des vaisseaux d’un genre nouveau ; un môle s’avançait dans la mer verte, peu profonde ; et l’eau qu’il encerclait, à l’abri d’une longue île basse, était aussi pleine de bateaux que le port intérieur, avec beaucoup de petites embarcations à voile ou à rames. Par rapport à la torpeur poussiéreuse des ports de Konstantiniyye, c’était une scène tumultueuse.
Ismail fut emmené à cheval dans la cité bouillonnante et plus loin le long de la côte, jusqu’à une plantation de palmiers, derrière une large plage de sable jaune. Là, des murailles entouraient un vaste monastère bouddhique, et on pouvait voir de nouveaux bâtiments au loin, à travers la plantation. Une jetée s’étendait à partir des bâtiments, et plusieurs vaisseaux qui marchaient à la vapeur étaient amarrés là. C’était apparemment l’endroit où se trouvait le fameux hôpital de Travancore.
L’intérieur du monastère était calme. Il n’y avait même pas un souffle de vent. Ismail fut conduit à une salle à manger où il put se restaurer, puis on l’invita à se laver de la fatigue du voyage. Les bains étaient carrelés, avec des piscines d’eau chaude et froide, dont certaines à ciel ouvert.
De l’autre côté, un petit pavillon ornait une pelouse verte, entourée d’un parterre de fleurs. On donna à Ismail une robe marron, propre, qu’il enfila, et il alla, pieds nus, vers un pavillon où une vieille femme était en grande conversation avec un petit groupe de personnes.
Elle s’arrêta en le voyant, et le guide d’Ismail les présenta.
— Ah ! C’est un grand plaisir, dit la femme, en persan. Je suis Bhakta, l’abbesse de cet endroit, et votre humble correspondante. (Elle se leva et s’inclina devant Ismail, les mains jointes. Elle avait les doigts tordus et marchait avec raideur. Ismail eut l’impression qu’elle avait de l’arthrite.) Soyez le bienvenu. Laissez-moi vous servir du thé, ou du café, si vous préférez.
— Du thé, ce sera parfait, dit Ismail.
— Bodhisattva, dit un messager à l’abbesse, le Kerala va nous rendre visite, à la prochaine lune.
— C’est un grand honneur, répondit l’abbesse. La lune sera en étroite conjonction avec l’étoile du matin. Aurons-nous le temps d’achever les mandalas ?
— Ils pensent que oui.
— Très bien.
L’abbesse continua à siroter son thé.
— Il vous a appelée bodhisattva ? releva Ismail.
L’abbesse sourit comme une petite fille.
— Un terme d’affection, sans autre signification. Je ne suis qu’une pauvre nonne, à qui notre Kerala a fait l’honneur de confier cet hôpital pendant un certain temps.
— Vous ne m’en aviez rien dit dans vos lettres, dit Ismail. Je pensais que vous n’étiez qu’une nonne, dans une sorte de madrasa et d’hôpital.
— Ça a longtemps été le cas.
— Quand êtes-vous devenue l’abbesse ?
— En l’an 1194 de votre calendrier. L’abbé précédent était un lama japonais. Il pratiquait une forme japonaise de bouddhisme, qui a été introduite ici par son prédécesseur. Il était venu ici avec beaucoup d’autres moines et nonnes japonais, qui avaient fui leur pays, conquis par les Chinois. Les Chinois persécutent même les bouddhistes de leur propre pays, et au Japon, ce fut pire. Alors ils sont venus ici, directement, ou en passant par le Sri Lanka.
— Et ils ont étudié la médecine, j’imagine.
— Oui. Mon prédécesseur, en particulier, avait une vision très claire, et c’était un homme très curieux. Nous y voyons généralement comme en pleine nuit, mais il était debout dans la lumière du matin, parce qu’il procédait à des expériences pour vérifier chacune de nos assertions. Il sentait la force des choses, la force du mouvement, et il imaginait des moyens de les tester, de toutes les façons possibles et imaginables. Si nous en sommes arrivés là, c’est grâce aux portes qu’il a ouvertes.
— Je pense pourtant que vous avez poursuivi des voies nouvelles.
— Oui. Nous avons sans cesse la révélation de nouvelles choses, et nous travaillons dur depuis qu’il a quitté ce corps. L’accroissement des échanges nous a permis de mettre la main sur de nombreux documents utiles et remarquables, dont certains de Franji. Il m’apparaît clairement, à présent, que l’île d’Angleterre était une sorte de Japon en devenir, de l’autre côté du monde. Maintenant, des forêts ont repoussé sur leurs ruines, et ils font le commerce du bois et construisent leurs propres vaisseaux. Ils nous apportent des livres et des manuscrits retrouvés dans les ruines. Des chercheurs un peu partout dans Travancore ont appris leur langue, les ont traduits, et ces livres ont l’air très intéressants. Des gens comme le Maître d’Henly étaient plus avancés que vous ne pourriez le croire. Ils prônaient une organisation efficace ; insistaient sur la bonne qualité des comptes rendus, leur exactitude, le recours aux approches successives pour déterminer les rendements… D’une façon générale, ils pratiquaient une gestion rationnelle de leurs fermes, comme ici. Ils avaient des soufflets actionnés par des roues à eau, et ils pouvaient chauffer leurs chaudières à blanc ou au rouge. Ils s’inquiétaient déjà de la déforestation, à leur époque, vous vous rendez compte ? Henly avait calculé qu’une chaudière pouvait brûler tous les arbres dans un rayon d’un yoganda en quarante jours.
— Et c’est probablement ce qui arrivera, dit Ismail.
— Et même plus vite encore, sans aucun doute. En attendant, ils s’enrichissent.
— Et ici ?
— Ici, nous sommes riches d’une autre façon. Nous aidons le Kerala, il étend la portée du royaume tous les mois, et à l’intérieur de ses frontières, tout va plutôt en s’améliorant. Nous produisons plus de nourriture, nous tissons plus de vêtements. Il y a moins de guerres, moins de vols.
Après le thé, Bhakta lui fit faire le tour du domaine. Une rivière coulait gaiement à travers le monastère. Elle actionnait quatre grands moulins de bois et leurs roues, et s’échappait par une grande écluse, tout au bout d’un bassin de retenue. Ses flots étaient bordés de pelouses vertes et de palmiers. Des bourdonnements, des bruits de métal et des rugissements montaient de grands entrepôts construits à côté des moulins, sur les deux rives, et des panaches de fumée s’élevaient de leurs grandes cheminées de briques.
— La fonderie, la forge, la scierie et la manufacture.
— Vous m’avez parlé, dans vos lettres, d’une armurerie, dit Ismail. Et d’une poudrière.
— Oui, mais le Kerala ne veut pas nous imposer ce fardeau, parce que le bouddhisme est par principe non violent. Nous avons appris à son armée certaines choses sur les armes, parce qu’elle protège Travancore. Nous avons exposé ce problème au Kerala – nous lui avons dit qu’il était important pour des bouddhistes d’œuvrer pour le bien, et il nous a promis que dans tous les territoires qui tomberaient sous son contrôle nous imposerions un ensemble de lois qui préserverait le peuple de la violence ou des mauvaises actions. En effet, nous l’aidons à protéger les gens. Évidemment, on peut avoir des soupçons, quand on voit ce que font les dirigeants, mais celui-ci s’intéresse beaucoup à la loi. En fin de compte, il fait ce qu’il veut, évidemment. Mais il aime les lois.
Ismail réfléchit à la façon dont Konstantiniyye avait été conquise, presque sans effusion de sang.
— Il doit y avoir une certaine vérité là-dedans, ou je ne serais pas vivant.
— Oui, racontez-moi ça. J’ai cru comprendre que la capitale ottomane ne s’était pas très vigoureusement défendue.
— Non. Mais c’est en partie à cause de la vigueur de l’attaque. Les gens ont été démoralisés par les vaisseaux de fer, et les sacs volants au-dessus de leurs têtes.
Bhakta eut l’air intéressée.
— Ça, c’est nous qui les avons fabriqués, je dois l’admettre. Et pourtant, les vaisseaux n’avaient pas l’air vraiment formidables.
— Considérez chaque vaisseau comme une batterie d’artillerie mobile.
L’abbesse hocha la tête.
— La mobilité est l’un des mots d’ordre du Kerala.
— À juste raison. En fin de compte, c’est la mobilité qui l’emporte, et tout ce qui est à portée de tir de la mer peut être détruit. Or Konstantiniyye est tout entière à portée de tir de la mer.
— Je vois ce que vous voulez dire.
Après le thé, l’abbesse emmena Ismail aux docks et aux chantiers navals. Le vacarme y était assourdissant. À la fin de la journée, ils retournèrent à pied à l’hôpital et Bhakta conduisit Ismail à la faculté de médecine, où ils apprenaient aux moines à devenir médecins. Les professeurs les saluèrent et montrèrent à Ismail, sur l’un des murs, l’étagère qu’ils avaient consacrée aux lettres et aux dessins qu’il avait envoyés à Bhakta au fil des ans, tous catalogués selon un système auquel il ne comprit rien.
— Chaque page a été recopiée plusieurs fois, dit l’un des hommes.
— Votre travail semble très éloigné de la médecine traditionnelle, remarqua un autre. Nous espérions que vous pourriez nous parler des différences entre la théorie chinoise et la vôtre.
Ismail secoua la tête et feuilleta ces vestiges de son ancienne vie. Il n’aurait jamais cru avoir autant écrit. Peut-être y avait-il plusieurs exemplaires de la même chose sur cette étagère.
— Je n’ai pas de théorie. Je me suis contenté de noter ce que j’avais sous les yeux. Mais évidemment, dit-il avec gravité, je serai ravi de parler avec vous de tout ce que vous voudrez.
— Nous apprécierions vraiment si vous pouviez le faire devant une assemblée, dit l’abbesse. Beaucoup de gens voudraient vous entendre et vous poser des questions.
— Certainement. Tout le plaisir serait pour moi.
— Merci. Alors nous nous réunirons demain.
Un mécanisme, quelque part, actionna les cloches qui sonnaient les heures et les tours de garde.
— Quel genre d’horloge utilisez-vous ?
— Une version de la roue à mercure de Bhaskara, vous allez voir, répondit Bhakta en menant Ismail vers un grand bâtiment. Elle est idéale pour les calculs astronomiques. Le Kerala en a même tiré un nouveau calendrier, beaucoup plus précis que l’ancien. Mais pour dire la vérité, nous sommes actuellement en train de tester des horloges munies d’échappements mécaniques à poids. Nous essayons aussi des horloges à ressort, qui seraient utiles en mer, où il est essentiel de mesurer le temps avec précision pour déterminer la longitude.
— J’ignorais tout ça.
— Bien sûr. Vous vous occupiez de médecine.
— Oui.
Le lendemain, ils retournèrent à l’hôpital et, dans une vaste salle où l’on procédait aux opérations, un grand nombre de moines et de nonnes vêtus de robes brunes, marron et jaunes s’assirent à même le sol pour l’écouter. Bhakta fit déposer par des assistants plusieurs gros et grands livres pleins de dessins anatomiques, principalement chinois, sur la table derrière laquelle Ismail fut invité à s’asseoir.
L’assistance paraissait attendre qu’il prenne la parole, alors il dit :
— Je suis heureux de vous faire part de mes observations. Ça vous aidera peut-être, je n’en sais rien. Je ne sais pas grand-chose du système médical officiel. J’ai étudié certains des ouvrages grecs traduits par ibn Sina et d’autres, mais je n’en ai pas tiré grand-chose. Je n’ai pas retiré grand-chose non plus d’Aristote. Un peu plus de Galien. La médecine ottomane proprement dite n’était pas très évoluée. En vérité, je n’ai jamais trouvé nulle part une explication générale qui colle avec ce que j’avais vu de mes propres yeux, et c’est pour ça que j’ai renoncé à toutes les hypothèses il y a longtemps, et entrepris de dessiner et d’écrire ce que je voyais, et cela seulement. Alors il va falloir que vous me parliez de ces idées chinoises si vous pouvez les exprimer en persan, et je vous dirai si mes observations concordent ou non. C’est tout ce que je puis faire, conclut-il avec un haussement d’épaules.
Ils le regardèrent en ouvrant de grands yeux, et il continua nerveusement :
— C’est tellement utile, le persan. La langue qui relie l’islam et l’Inde. (Il agita la main.) Des questions ?
C’est Bhakta qui rompit le silence :
— Et les méridiens dont parlent les Chinois, qui parcourent le corps en partant de la peau et y reviennent ?
Ismail regarda les dessins anatomiques qu’elle lui montra dans un des livres.
— Se pourrait-il que ce soient les nerfs ? demanda-t-il. Certaines de ces lignes suivent le trajet des nerfs principaux. Et puis elles divergent. Je n’ai jamais vu de nerfs décrire des parcours pareils, de la joue au cou, le long de la colonne vertébrale vers la cuisse, et remontant dans le dos. Généralement, les nerfs se ramifient comme les branches d’un amandier, contrairement aux vaisseaux sanguins qui se ramifient comme les branches d’un bouleau. Ils ne forment pas non plus de nœuds comme ceux qu’on voit là.
— Nous ne pensons pas que les méridiens soient les nerfs.
— Alors, quoi ? Vous voyez quelque chose quand vous procédez aux autopsies ?
— Nous ne pratiquons pas d’autopsies. Quand l’occasion se présentait pour nous d’examiner des corps déchiquetés, leurs parties ressemblaient à ce que vous nous avez décrit dans vos lettres. Mais les observations que les Chinois ont faites de ces choses, leurs réflexions, remontent à l’antiquité, et ils ont obtenu de bons résultats en enfonçant des épingles dans les points méridiens, entre autres méthodes. Ils obtiennent très souvent d’excellents résultats.
— Comment le savez-vous ?
— Eh bien, certains d’entre nous l’ont constaté. Ce que nous en savons se résume pour l’essentiel à ce qu’ils en ont dit. En fait, nous nous demandons s’ils n’ont pas trouvé de systèmes trop petits pour être vus. Pouvons-nous être sûrs que les nerfs sont les seuls messagers du mouvement vers le muscle ?
— Je pense, répondit Ismail. Coupez le bon nerf, et les muscles qui se trouvent au-delà ne bougeront plus. Pincez un nerf et le muscle concerné se contractera.
Son public le regardait, les yeux ronds. L’un des hommes les plus âgés dit :
— Peut-être les signaux se transmettent-ils autrement que par les nerfs ? Et pourquoi pas par les méridiens ? Après tout, ils sont aussi indispensables que les nerfs.
— Peut-être. Mais regardez ça, fit-il en indiquant un diagramme. Ils ne montrent pas les glandes surrénales. Ni le pancréas. Or ils jouent un rôle indispensable.
— Pour les Chinois, les organes vitaux sont au nombre de onze, reprit Bhakta. Cinq yin et six yang. Le cœur, les poumons, la rate, le foie et les reins sont yin.
— La rate n’est pas essentielle.
— Et puis il y a les six organes yang, la vésicule biliaire, l’estomac, l’intestin grêle, le gros intestin, la vessie, et le triple réchauffeur.
— Le triple réchauffeur ? Qu’est-ce que c’est que ça ?
Elle lui traduisit les notes en chinois au-dessous du dessin.
— Ils disent qu’il a bien un nom, mais pas de forme propre. Il combine les effets des organes qui régulent l’eau, un peu comme un réchaud. Le réchauffeur supérieur est un brouillard, le réchauffeur du milieu une mousse, le réchauffeur du bas un marais. Celui du haut correspond à la tête et à la partie supérieure du corps, celui du milieu aux tétons et au nombril, et celui du bas à l’abdomen en dessous du nombril.
Ismail secoua la tête.
— Ils le trouvent lors de la dissection ?
— Comme nous, ils pratiquent peu la dissection. Il y a des interdits religieux similaires. Une fois, dans leur dynastie Sung, vers l’an 390 du calendrier islamique, ils ont disséqué quarante-six rebelles.
— Je doute que ça ait servi à grand-chose. Il faut voir beaucoup de dissections, et de vivisections, sans idées préconçues, pour commencer à y voir clair.
Les moines et les nonnes le regardaient à présent avec un drôle d’air, mais il continua en examinant les dessins.
— Ce flux qui traverse le corps et toutes ses parties, ne serait-ce pas le sang ?
— Un équilibre harmonieux de fluides, matériel, comme le sang, et spirituel, comme le jing, le shen et le ki, ce qu’on appelle les Trois Trésors…
— Et qu’est-ce que c’est, je vous prie ?
— Le jing est la source du changement, répondit une nonne d’une voix hésitante. Il entretient et nourrit, comme un fluide. On pourrait utiliser un autre mot persan pour le définir : l’essence. En sanskrit, on dit semen, ou la possibilité générative.
— Et le shen ?
— Le shen, c’est la conscience. Un peu comme l’esprit, mais une partie du corps, aussi.
Ismail fut intéressé.
— Ils l’ont pesée ?
Bhakta fut la première à rire.
— Leurs médecins ne pèsent pas les choses. Avec eux, il n’y a pas de choses, il y a des forces et des relations.
— Eh bien, je ne suis qu’un anatomiste. Ce qui anime les parties me dépasse. Trois trésors, un seul, une myriade – je ne saurais dire. Il semble qu’il y ait une vitalité qui l’anime, qui va et vient, qui flue et reflue. La dissection ne peut la trouver. Notre âme, peut-être. Vous croyez que l’âme revient, non ?
— En effet.
— Les Chinois aussi ?
— Oui, dans leur immense majorité. Pour leurs taoïstes, il n’y a pas de pur esprit, il est toujours mêlé à des choses matérielles. Alors leur immortalité requiert le mouvement d’un corps à un autre. Et toute la médecine chinoise est fortement influencée par le taoïsme. Leur bouddhisme est le même que le nôtre, pour l’essentiel, bien que plus matérialiste, là encore. Il est principalement incarné dans tout ce que font les femmes d’un certain âge, pour aider la communauté et préparer leur prochaine vie. La culture confucéenne officielle ne parle pas beaucoup de l’âme, tout en reconnaissant son existence. Dans la plupart des écrits chinois, la frontière entre l’esprit et la matière est vague, parfois inexistante.
— C’est évident, répondit Ismail en regardant à nouveau le diagramme des méridiens. Enfin, reprit-il avec un soupir. Ils ont fait de longues études, et ils ont aidé des gens à vivre pendant que je me contentais de faire des croquis de dissections.
Ils poursuivirent ainsi. Ils étaient toujours plus nombreux à poser des questions, à faire des commentaires et des observations. Ismail répondait à toutes les questions de son mieux. Le mouvement du sang dans les chambres du cœur ; les fonctions de la rate, si tant est qu’elle en ait ; la localisation des ovaires ; les états de choc consécutifs à l’amputation des jambes ; l’eau dans les poumons perforés ; les mouvements des membres quand différentes parties du cerveau mis à nu étaient excitées au moyen d’aiguilles : il décrivit ce qu’il avait vu dans chacun de ces cas, et alors que la journée passait, la foule assise sur le sol le regardait d’un air de plus en plus réservé, voire méfiant. Deux nonnes quittèrent silencieusement la salle. Alors qu’Ismail décrivait la coagulation du sang consécutive à l’arrachage d’une dent, le silence se fit. Rares étaient ceux qui osaient le regarder dans les yeux et, remarquant cela, il se troubla.
— Je vous l’ai dit, je ne suis qu’un anatomiste… Il faudrait voir si nous pouvons réconcilier mes observations et vos textes théoriques.
Il avait le visage très rouge et l’air d’avoir chaud, comme s’il avait de la fièvre.
Pour finir, l’abbesse Bhakta se leva, s’approcha de lui avec raideur et prit ses mains tremblantes entre les siennes.
— Ça suffit, dit-elle gentiment.
Tous les moines et les nonnes se levèrent, joignirent leurs mains comme pour prier et s’inclinèrent devant lui.
— Vous avez fait du bien avec du mauvais, dit Bhakta. Maintenant, reposez-vous, et nous allons nous occuper de vous.
C’est ainsi qu’Ismail s’installa dans une petite chambre, au monastère. Il étudia des textes chinois récemment traduits en persan par les moines et les nonnes, et enseigna l’anatomie.
Un après-midi, ils se rendirent à pied, Bhakta et lui, de l’hôpital à la salle à manger, dans la chaleur lourde des jours précédant la mousson. L’air était aussi chaud et humide qu’une couverture mouillée. L’abbesse lui indiqua une petite fille qui courait entre les rangées de melons du grand jardin.
— C’est la nouvelle incarnation du lama précédent. Elle est arrivée parmi nous l’an dernier. Elle est née à l’heure de la mort du vieux lama, ce qui est très inhabituel. Mais nous ne l’avons pas trouvée alors parce que nous n’avons commencé les recherches que l’an dernier. Et elle nous est aussitôt apparue.
— Son âme serait passée d’un homme à une femme ?
— Apparemment. Nous avons bien sûr aussi cherché parmi les petits garçons, comme le veut la tradition. C’est l’une des choses qui nous ont permis de l’identifier si facilement. Elle a insisté pour qu’on lui fasse passer les tests, en dépit de son sexe. À quatre ans. Et elle a identifié tous les objets de Peng Roshi. Elle en a reconnu beaucoup plus que la plupart des nouvelles incarnations, et elle m’a répété la teneur de ma dernière conversation avec Peng, presque mot pour mot.
— Vraiment ! fit Ismail en regardant Bhakta.
Bhakta riva son regard au sien.
— J’ai eu l’impression de le regarder à nouveau dans les yeux. Alors nous avons déclaré que Peng était revenu parmi nous sous la forme de la bodhisattva Tara, et nous avons commencé à faire plus attention aux filles et aux nonnes, chose que j’avais toujours encouragée, évidemment. Nous avons imité l’habitude chinoise d’inviter les vieilles femmes de Travancore à venir au monastère, consacrer leur vie à l’étude des soutras et de la médecine, puis à retourner s’occuper des habitants de leurs villages et à enseigner tout cela à leurs petits-enfants et arrière-petits-enfants.
La petite fille disparut entre les palmiers, au bout du jardin. La nouvelle lune fauchait le ciel, comme suspendue à une étoile du soir, plus brillante que les autres. La brise leur apporta un battement de tambour.
Bhakta tendit l’oreille.
— Le Kerala a été retardé, dit-elle. Il ne sera là que demain.
Les tambours se firent à nouveau entendre à l’aube, juste après que l’horloge eut sonné la naissance du jour. Des roulements de tambours lointains, comme le grondement du tonnerre ou des canons, mais plus rythmés, annoncèrent l’arrivée du Kerala. Quand le soleil se leva, on aurait dit qu’il y avait un tremblement de terre. Les moines, les nonnes et leurs familles qui vivaient au monastère se déversèrent hors des dortoirs pour le voir, et la grande cour qui se trouvait derrière la porte fut précipitamment dégagée.
Les premiers soldats avançaient d’une démarche dansante, faisant un pas glissé en avant tous les cinq pas, en poussant des cris chaque fois qu’ils faisaient passer leur fusil d’une épaule à l’autre. Les musiciens suivaient, marquant la cadence, leurs mains frappant sur les tablas. Quelques-uns jouaient des cymbales. Ils portaient des chemises d’uniforme avec des pièces rouges cousues aux épaules, et ils se positionnèrent autour de la grande cour jusqu’à former une courbe, de presque cinq cents hommes, face à la porte. Quand le Kerala et ses officiers arrivèrent à cheval, les soldats présentèrent les armes et crièrent trois fois. Le Kerala leva la main et le commandant du détachement hurla des ordres : les joueurs de tablas arrachèrent un roulement crescendo à leurs instruments et les soldats entrèrent en dansant dans la salle à manger.
— C’est bien ce qu’on disait : ils sont rapides, dit Ismail à Bhakta. Et ils marchent avec un tel ensemble.
— Oui. Ils vivent à l’unisson. Au combat, c’est pareil. Le rechargement des armes a été décomposé en dix mouvements, réglés sur dix battements de tambour différents. Les soldats sont répartis en dix groupes, et tirent chacun à tour de rôle, au rythme des tambours. Leurs salves sont des plus dévastatrices, si j’ai bien compris. Aucune armée ne leur résiste. Ou du moins, ça a été vrai pendant de nombreuses années ; il semblerait maintenant que la Horde d’Or commence à entraîner ses armées d’une façon similaire. Mais même comme ça, et malgré la modernisation des armes, personne n’est de taille à résister au Kerala.
C’est alors que ce dernier mit pied à terre, et que Bhakta s’approcha de lui, Ismail sur ses talons. Le Kerala mit fin, d’un geste, à leurs courbettes, et Bhakta dit, sans préambule :
— Je vous présente Ismail de Konstantiniyye, le fameux médecin ottoman.
Le Kerala le regarda avec intensité, et Ismail déglutit péniblement, sentant la chaleur de son regard impérieux. Le Kerala était un petit homme râblé, nerveux, aux cheveux noirs encadrant un visage en lame de couteau. Son torse paraissait un poil trop long pour ses jambes. Son visage, très séduisant, était ciselé comme celui d’une statue grecque.
— J’espère que vous êtes impressionné par notre hôpital, dit-il dans un persan clair et distinct.
— Je n’en ai jamais vu d’aussi beau.
— À quelle stade d’avancement était la médecine ottomane quand vous êtes parti ?
— Nous commencions à peine à comprendre comment fonctionnent certaines parties du corps, répondit Ismail. Mais il restait encore bien des mystères.
— Ismail a étudié les théories des anciens Égyptiens et des Grecs, ajouta Bhakta. Il nous a apporté ce qu’elles avaient d’utile, ainsi que l’ensemble de ses propres découvertes, qui corrigeaient les erreurs des anciens, ou prolongeaient leurs recherches. Ses lettres forment l’une des bases à partir desquelles nous travaillons.
— Vraiment.
Le regard du Kerala se fit encore plus pénétrant. Il avait des yeux saillants, et ses iris étaient un kaléidoscope de couleurs, comme des cercles de jaspe.
— Intéressant ! Il faudra que nous reparlions de tout cela. Mais d’abord, je voudrais m’entretenir des récents développements avec vous, en privé, Mère Bodhisattva.
L’abbesse hocha la tête et marcha, main dans la main, avec le Kerala, jusqu’à un pavillon qui surplombait un verger nain. Ils n’étaient accompagnés d’aucun garde du corps, mais ils étaient surveillés de loin par des gardes postés, l’arme au pied, sur les murs du monastère.
Ismail alla au bord du fleuve, où quelques moines préparaient la future cérémonie des mandalas de sable. Des moines et des nonnes en robes de bure ou couleur safran se dispersèrent tout le long du rivage, disposèrent des carpettes et des paniers de fleurs en bavardant gaiement, sans grande hâte. Leur Kerala parlait souvent avec leur abbesse pendant la demi-journée, voire plus longtemps. On savait qu’ils étaient très amis.
Mais, ce jour-là, ils finirent plus tôt, et le rythme s’accéléra considérablement lorsqu’on apprit qu’ils quittaient le pavillon. Les paniers de fleurs furent lancés au fil de l’eau, les soldats réapparurent au son des tablas qui faisaient battre le cœur plus vite. Ils se glissèrent au bord du fleuve, sans leurs armes, et s’assirent, formant une allée pour permettre à leur chef d’approcher. Il s’avança parmi eux, s’arrêtant pour poser la main sur l’épaule de tel ou tel, saluant chacun de ses hommes par son nom, s’inquiétant de leurs blessures et ainsi de suite. Les moines qui s’étaient occupés des mandalas sortirent de leur atelier, en chantant au son des trompettes tonitruantes, entourant deux mandalas – des disques de bois aussi grands que des roues de moulin, chacun porté par deux hommes –, sur lesquels se trouvaient des dessins de sable aux couleurs éclatantes. L’un représentait un motif géométrique exécuté dans des tons vifs : vert, rouge, jaune, bleu, blanc et noir. L’autre était une carte du monde sur laquelle Travancore était un point rouge, comme un bindi, l’Inde occupant le centre du disque. Le mandala représentait presque tout le reste du monde, de la Franji à la Corée et au Japon, l’Afrique et l’Inde étant incurvées autour du bas. Les couleurs étaient naturelles : l’océan était bleu foncé, les mers intérieures d’un bleu plus clair, les terres émergées vert ou marron, selon les cas, les chaînes de montagnes vert foncé, et leurs sommets d’un blanc neigeux. Les fleuves étaient des lignes bleues, et une ligne rouge vif ceignait ce qu’Ismail interpréta comme étant la limite des conquêtes du Kerala, qui comprenaient maintenant l’empire ottoman jusqu’à l’Anatolie et Konstantiniyye, à l’exception des Balkans et de la Crimée. C’était magnifique. On avait l’impression de voir le monde depuis le soleil.
Le Kerala de Travancore se promenait avec l’abbesse, l’aidait à marcher sur le chemin. Ils s’arrêtèrent au bord du fleuve, et le Kerala examina attentivement, minutieusement, les mandalas, indiquant telle ou telle partie de la représentation du doigt et interrogeant l’abbesse et ses moines. D’autres moines se mirent à chanter à voix basse, bientôt imités par les soldats. Bhakta se tourna vers eux et ajouta sa voix flûtée, haut perchée, aux leurs. Le Kerala prit le mandala géométrique entre ses mains et le souleva délicatement. La roue de bois était presque trop grande pour qu’il la tienne à lui seul. Il descendit avec dans le fleuve, où des bouquets d’hortensias et d’azalées flottèrent autour de ses jambes. Il éleva le mandala au-dessus de sa tête, l’offrant au ciel, puis, à une inflexion du chant, alors que les trompettes joignaient leur cuivre à la musique, il abaissa le disque devant lui et le fit basculer sur le côté, très lentement. Le sable glissa comme une nappe, les couleurs se déversant dans l’eau et s’y fondant, tachant les jambières de soie du Kerala. Il plongea le disque dans l’eau et lava le reste du sable dans un nuage multicolore que le courant dissipa. Il passa sa main sur le disque de bois, puis sortit de l’eau. Il avait les chaussures boueuses, ses jambières trempées étaient barbouillées de vert, de rouge, de bleu et de jaune. Il prit l’autre mandala des mains de ceux qui l’avaient fait, s’inclina devant eux, au-dessus du disque, se retourna et le livra aux eaux du fleuve. Cette fois, les soldats se déplacèrent et se prosternèrent, front contre terre, en chantant une prière à l’unisson. Le Kerala abaissa lentement le disque, et tel un dieu offrant un monde à un dieu supérieur, le posa sur l’eau et le laissa flotter, tournant lentement encore et encore sous ses doigts, monde fluctuant qu’il plongea dans le fleuve, aussi profondément que possible, alors que le chant s’amplifiait. Tout le sable se répandit dans l’eau et macula ses bras et ses jambes. Alors qu’il remontait sur la rive, éclaboussé de couleurs, ses soldats se relevèrent et poussèrent trois cris, puis encore trois.
Plus tard, le Kerala prit un thé aux senteurs délicates, et s’assit auprès d’Ismail pour discuter avec lui. Il écouta tout ce qu’Ismail avait à lui dire sur le sultan Selim le Troisième, puis raconta à Ismail l’histoire de Travancore, ses yeux ne quittant jamais le visage de son interlocuteur.
— Notre combat pour repousser le joug des Moghols a commencé il y a longtemps, avec Shivaji, le Seigneur de l’Univers, qui a inventé la guerre moderne. Shivaji a utilisé tous les moyens possibles pour libérer l’Inde. Une fois, il fit appel à un lézard géant du Deccan pour l’aider à escalader les falaises sur lesquelles était juchée la Forteresse du Lion. Une autre fois, alors qu’il était encerclé et assiégé par l’armée du Bijapuri, sous le commandement du grand général moghol Afzal Khan, Shivaji proposa de se rendre à lui en personne, et se présenta devant lui vêtu uniquement d’une chemise de tissu qui dissimulait une dague à queue de scorpion. Les doigts de sa main gauche, cachés, étaient glissés dans des griffes de tigre tranchantes comme des rasoirs. Lorsqu’il embrassa Afzul Khan, il le déchiqueta à mort sous les yeux de tous, et par ce signal ses armées donnèrent l’assaut aux Moghols et les défirent.
» Après cela, Alamgir attaqua pour de bon, et passa le dernier quart de siècle de sa vie à reconquérir le Deccan, ce qui coûta cent mille vies humaines par an. Lorsqu’il eut fini de soumettre le Deccan, son empire était exsangue. Entre-temps, il y avait eu d’autres révoltes contres les Moghols, au nord-ouest, parmi les Sikhs, les Afghans et les sujets de l’est de l’empire safavide, ainsi que chez les Rajputs, les Bengalis, les Tamils, etc., dans toutes les régions de l’Inde. Elles connurent parfois un certain succès, et les Moghols – qui avaient écrasé leurs sujets sous les impôts pendant des années – subirent une révolte de leurs propres zamindars, et ce fut la ruine. Une fois que les Marathas, les Rajputs et les Sikhs furent solidement établis, ils instituèrent un système fiscal propre, et, même s’ils prêtaient toujours serment d’allégeance à Delhi, les Moghols n’en reçurent plus aucun argent.
» C’est ainsi que la situation alla en se dégradant pour les Moghols, surtout ici, dans le Sud. Mais les Marathas et les Rajputs avaient beau être hindous, ils parlaient des langues différentes, et c’est à peine s’ils se connaissaient. Tant et si bien qu’une rivalité naquit entre eux, et que l’emprise des Moghols sur l’État-mère indien s’accrut. En cette fin de règne, le nazim devint Premier ministre d’un khan complètement absorbé par son harem et sa hookah, et ce nazim alla vers le sud fonder la principauté qui inspira le développement de notre Travancore.
» Ensuite, Nadir Shah traversa l’Indus au même gué qu’Alexandre le Grand, mit Delhi à sac, massacrant trente mille personnes, et rapporta chez lui un milliard de roupies en or et en pierres précieuses, ainsi que le trône du Paon. Cela marqua la fin des Moghols.
» Après cela, les Marathas n’ont cessé d’étendre leur territoire jusqu’au Bengale. Mais les Afghans ont secoué le joug des Safavides, et ont envahi l’est jusqu’à Delhi, qu’ils ont mise à sac à leur tour. Quand ils se retirèrent, ils laissèrent le contrôle du Panjab aux Sikhs pour une taxe équivalente au cinquième des récoltes. Puis les Pathans mirent Delhi à sac une fois de plus, semant la ruine et la désolation pendant un mois entier dans une ville qui était devenue un vivant cauchemar. Le dernier empereur qui portât un titre moghol eut les yeux crevés par un petit chef afghan.
» Alors une cavalerie marathane de trente mille chevaux marcha sur Delhi, recrutant deux cent mille volontaires rajputs en montant vers le nord. Sur le champ de bataille fatal de Panipat, où le destin de l’Inde s’était si souvent joué, ils rencontrèrent une armée composée de troupes afghanes et ex-mogholes en plein jihad contre les Hindous. Les musulmans étaient soutenus par les populations locales, et ils avaient le grand général Shah Abdali à leur tête. Cent mille Marathas trouvèrent la mort au combat, et trente mille autres furent capturés, puis échangés contre rançon. Finalement, les soldats afghans se lassèrent de Delhi et obligèrent leur khan à retourner à Kaboul.
» Mais les Marathas avaient été écrasés. Les successeurs du nazim sécurisèrent le Sud, les Sikhs prirent le Panjab et les Bengalis prirent le Bengale et l’Assam. Là-bas, nous nous rendîmes compte que les Sikhs étaient nos meilleurs alliés. Leur dernier gourou déclara que, désormais, leurs écrits sacrés étaient l’incarnation du gourou lui-même. Ils connurent une grande prospérité, érigeant, de fait, une puissante muraille entre l’islam et nous. Et nous apprîmes également beaucoup des Sikhs. Ils incarnent une sorte de mélange d’Hindous et de musulmans, inhabituel dans l’histoire indienne, et très instructif. Ils prospérèrent, donc, et en retenant leur leçon et en coordonnant nos efforts aux leurs, nous prospérâmes nous aussi.
» Et puis, à l’époque de mon grand-père, un certain nombre de réfugiés des conquêtes chinoises du Japon arrivèrent dans cette région, des bouddhistes attirés par le Lanka, le cœur du bouddhisme. Des samouraïs, des moines et des marins, de très bons marins – ils avaient couru les mers du grand océan de l’Est, qu’ils appellent le Dahai… En fait, ils arrivèrent aussi bien de l’est que de l’ouest.
— Ils avaient fait le tour du monde ?
— En effet. Et ils ont beaucoup appris à nos constructeurs de navires. Les monastères bouddhiques de la région étaient déjà des centres de ferronnerie, de mécanique et de céramique. Les mathématiciens locaux contribuèrent à l’épanouissement de leur art et à l’application de leurs calculs dans la navigation, la balistique et la mécanique. Tout cela connut une forme d’aboutissement, ici, dans les grands chantiers navals, et nos flottes marchande et militaire furent bientôt plus importantes que celles de la Chine même. Ce qui est une bonne chose, parce que l’empire chinois soumet une part sans cesse croissante du monde – la Corée, le Japon, la Mongolie, le Turkestan, Annam et le Siam, les îles de Malaisie –, la région que nous appelions la Grande Inde, en fait. Nous avons donc besoin de nos vaisseaux pour nous protéger de ce pouvoir. Du côté de la mer, nous sommes tranquilles, et par ici, à l’abri des terres arides du Deccan, nous sommes difficiles à conquérir par le continent. L’islam semble vivre ses derniers jours en Inde, sinon dans la totalité de l’Occident.
— Vous avez vaincu sa plus puissante cité, observa Ismail.
— Oui. Je frapperai encore et toujours les musulmans, de sorte qu’ils ne puissent plus jamais attaquer l’Inde. Il y a eu suffisamment de viols à Delhi. Alors j’ai fait construire une petite flotte sur la mer Noire, pour attaquer Konstantiniyye, écraser les Ottomans comme le nazim a écrasé les Moghols. Nous établirons de petits États dans toute l’Anatolie, prenant leur terre sous notre influence comme nous l’avons fait en Iran et en Afghanistan. En attendant, nous continuons à travailler avec les Sikhs, à les traiter comme nos principaux alliés et partenaires dans ce qui devient une confédération indienne élargie de principautés et d’États. Rares sont les opposants à l’unification de l’Inde sur ces bases, parce que, si elle réussit, alors ce sera la paix. La paix pour la première fois depuis l’invasion moghole, il y a plus de quatre siècles. L’Inde est donc en train d’émerger de sa longue nuit. Et maintenant, nous allons répandre le jour partout.
Le lendemain, Bhakta emmena Ismail à une fête dans les jardins du palais du Kerala, à Travancore. Le grand parc qui entourait le pavillon de marbre donnait sur la partie nord du port, loin du vacarme et de la fumée des chantiers navals, visibles du côté sud de la baie. En dehors du parc, des palais blancs, plus sophistiqués, appartenaient non au Kerala mais aux grands négociants locaux, qui s’étaient enrichis dans la construction navale, le commerce et surtout le financement de ce genre d’entreprises. Parmi les hôtes du Kerala se trouvaient beaucoup d’hommes de ce type, tous richement vêtus de soie et de bijoux. Ismail eut l’impression que cette société raffolait tout particulièrement des pierres semi-précieuses – la turquoise, le jade, le lapis-lazuli, la malachite, l’onyx, le jaspe et ainsi de suite –, polies en gros cabochons ronds et en perles dont on faisait des colliers. Leurs femmes et leurs filles portaient des saris aux couleurs éclatantes, et certaines promenaient en laisse des guenons apprivoisées.
Les gens circulaient à l’ombre des palmiers et des arbres, mangeaient à de longues tables couvertes de mets délicieux, ou buvaient dans des gobelets en verre. Bhakta fut approchée par quelques moines bouddhistes vêtus de marron ou de safran. Ils échangèrent quelques mots. Puis elle présenta à Ismail les Sikhs qui organisaient les festivités – des hommes barbus, coiffés d’un turban –, et des Marathas, des Bengalis, des Africains, des Malais, des Birmans, des Sumatranais, des Japonais et des Haudenosaunees du Nouveau Monde.
— Il y a tant de peuples différents, ici, observa Ismail.
— C’est grâce au développement des échanges maritimes.
Beaucoup d’entre eux semblaient désireux de parler à Bhakta, et elle emmena Ismail vers l’un des « plus proches assistants » du Kerala, un certain Pyidaungsu, un petit homme à la peau noire qui, dit-il, avait grandi en Birmanie, et à l’est de la pointe de l’Inde. Il parlait un excellent persan, ce qui était sans nul doute la raison pour laquelle l’abbesse lui avait confié Ismail, tandis qu’elle s’entretenait avec sa propre meute d’interlocuteurs.
— Le Kerala a été extrêmement content de vous rencontrer, dit tout de suite Pyidaungsu en emmenant Ismail à l’écart. Il est très désireux de faire des progrès dans certains domaines médicaux, surtout celui des maladies infectieuses. Nous avons perdu plus de soldats à cause des maladies ou des infections que du fait de nos ennemis, au combat. Cela l’affecte beaucoup.
— Ce n’est pas ma spécialité, dit Ismail. Je ne suis qu’un anatomiste, qui s’efforce de comprendre comment le corps est fait.
— Mais toutes les avancées dans la compréhension du corps nous aident à approfondir les sujets qui intéressent le Kerala.
— En théorie, du moins. Et ça prendra du temps.
— Mais ne pourriez-vous examiner les procédures de l’armée, et voir s’il n’y a pas là quelques points propices à la propagation des maladies ?
— Peut-être, dit Ismail. Bien que certains aspects soient assez inévitables, comme la promiscuité, le fait de voyager ou de dormir ensemble.
— Oui, mais peut-être pouvons-nous changer la façon dont ces choses se font…
— C’est possible. Il paraît vraisemblable que certaines maladies soient transmises par des créatures si petites que l’œil ne peut les voir…
— Les créatures dans le microscope ?
— Oui, ou encore plus petites. L’exposition à une minuscule quantité de ces créatures, ou à des créatures préalablement tuées, semble donner aux gens une résistance aux expositions ultérieures. C’est ce qui arrive à ceux qui ont survécu à la variole.
— Oui, la variolisation. Les troupes sont déjà scarifiées contre la variole.
Ismail marqua sa surprise à cette nouvelle, et l’aide de camp s’en aperçut.
— Nous essayons tout, dit-il en riant. Le Kerala croit que les habitudes doivent être réexaminées d’un œil neuf afin d’être changées, et améliorées autant que possible. Les habitudes alimentaires, d’hygiène, d’évacuation des eaux usées… Il avait débuté très jeune, comme officier d’artillerie, et il a appris la valeur des procédures. C’est lui qui a suggéré que le fut des canons soit foré plutôt que coulé, le moulage ne pouvant donner une surface suffisamment lisse. Les canons dont la surface était plus uniforme étaient à la fois plus puissants, plus légers et plus précis. Il a testé toutes ces choses, et réduit l’arsenal à un ensemble de mouvements réglés d’avance, comme une danse, à peu près semblables pour toutes les tailles de canons, ce qui leur permet de se déployer aussi vite que l’infanterie, presque aussi vite que la cavalerie. Et facilite leur transport à bord des vaisseaux. Les résultats ont été prodigieux, comme vous le voyez, fit-il en balayant l’assemblée d’un geste satisfait.
— Vous avez été officier d’artillerie, j’imagine.
— En effet, répondit-il en riant.
— Et maintenant vous profitez des réjouissances données ici.
— Oui, mais il y a d’autres raisons à cette réunion. Les banquiers, les armateurs. Si vous voulez que je vous dise, tous doivent leur situation aux futs des canons.
— Mais pas les docteurs.
— Non. Et je le regrette ! Encore une fois, si vous voyez ce qu’on pourrait assainir dans les procédures de la vie militaire, dites-le-moi.
— Pas de contacts avec les prostituées ?
— Eh bien, c’est un devoir religieux pour beaucoup d’entre eux, fit-il en riant à nouveau. Il faut les comprendre. Les danseuses des temples sont importantes pour bien des cérémonies.
— Ah. Alors, dans ce cas aussi il faut respecter des règles d’hygiène. Les animalcules se déplacent d’un corps à l’autre par la saleté, par le contact, par l’eau et la nourriture, et par la respiration. En faisant bouillir les instruments chirurgicaux, on réduit les infections. Il faut faire porter des masques aux docteurs, aux infirmières et aux patients, pour réduire les risques de contamination.
L’officier eut l’air content.
— Le respect de l’hygiène est l’un des avantages du système des castes. Le Kerala n’approuve pas les castes, mais il serait possible de faire en sorte que l’hygiène devienne une de nos priorités.
— Il semblerait que l’ébullition tue les animalcules. Le matériel de cuisine, les casseroles, les chaudrons, l’eau potable – tout cela devrait être bouilli. Mais je crains que ce ne soit pas très pratique.
— Certes, mais c’est possible. Quelles autres méthodes pourrait-on utiliser ?
— Certaines herbes, peut-être, et des substances, toxiques pour les animalcules mais pas pour les gens. Mais ces substances, personne ne sait si elles existent.
— On pourrait faire des essais.
— Effectivement.
— Sur des empoisonneurs, par exemple.
— On l’a déjà fait.
— Oh, le Kerala sera content. Il adore les expériences, les notes, les nombres comme ceux dont ses mathématiciens ont noirci des pages pour montrer si les impressions d’un médecin étaient justes lorsqu’on les appliquait à l’armée dans son ensemble. Il aimerait vous revoir à ce sujet.
— Je lui dirai tout ce que je sais, promit Ismail.
L’officier lui serra la main et la garda entre les siennes.
— Je vais tout de suite vous remmener au Kerala. Pour le moment, les musiciens sont là, à ce que je vois. J’aime les écouter du haut des terrasses.
Ismail le suivit un moment, comme dans un tourbillon, puis l’un des assistants de l’abbesse le happa et le ramena au groupe constitué par le Kerala pour assister au concert.
Les chanteuses portaient des saris magnifiques, les musiciens des vestes de soie multicolores, tissées de toutes sortes de façons, surtout d’un bleu ciel éclatant et d’un rouge d’orange sanguine. Les musiciens commencèrent à jouer ; les percussionnistes établirent le rythme sur leurs tablas et les autres se mirent à pincer les cordes de grands instruments pareils à des ouds, ou à des luths à long manche. Ils rappelaient à Ismail Konstantiniyye, où l’on entendait, dans toute la ville, ces sortes d’instruments nasillards.
Une chanteuse s’avança et chanta dans une langue étrangère, les notes dévalant la gamme sans s’arrêter nulle part, s’incurvant continuellement en des tonalités nouvelles pour Ismail, sans ces tons et ces quarts de ton qui infléchissaient rapidement la mélodie vers le haut et vers le bas, comme dans d’autres musiques. Les compagnes de la chanteuse dansaient lentement derrière elle, se rapprochant autant que possible de l’immobilité quand elle tenait la note, et cependant bougeant toujours, les mains tendues, les paumes levées vers le ciel, parlant la langue de la danse.
Puis les deux joueurs de tablas se mirent à jouer plus vite, selon un rythme complexe mais régulier, entremêlé comme les brins d’une tresse avec le chant. Ismail ferma les yeux ; il n’avait jamais entendu une musique pareille. Les mélodies se superposaient et se poursuivaient sans jamais s’interrompre. Le public tanguait et roulait en rythme avec elles, les soldats dansant sur place, se déplaçant autour du centre immobile que constituait le Kerala, qui lui aussi, se trémoussait, incapable de résister à la magie de la musique. Lorsque les percussionnistes accélérèrent furieusement le rythme pour marquer la fin du morceau, les soldats se mirent à pousser des cris, des hurlements, et à faire de grands bonds. Les chanteuses et les musiciens s’inclinèrent profondément en souriant, et s’approchèrent pour recevoir les compliments du Kerala. Il s’entretint un moment avec la chanteuse principale, lui parlant comme à une vieille amie. Ismail se retrouva dans une sorte de file qui s’était formée de part et d’autre de l’abbesse, et devant laquelle défilaient les musiciens en sueur. Il salua chacun d’eux d’un hochement de tête, comme ils passaient devant lui. Ils étaient jeunes. Des parfums de toutes sortes caressaient les narines d’Ismail, du jasmin, de l’orange, des odeurs d’iode et d’écume, et il prit une profonde inspiration. L’odeur du large portée par la brise se fit plus forte. Cette fois, elle venait vraiment de la mer. Juste au-dehors, l’océan s’étendait, gris et bleu, comme une route menant au monde entier.
La fête se dispersa à nouveau dans les jardins, selon des schémas déterminés par les lents déplacements du Kerala. Ismail fut présenté à un quartet de banquiers, deux Sikhs et deux Travancoriens, et il les écouta discuter – en persan, par courtoisie envers lui – de la situation compliquée qui régnait en Inde, dans tout l’océan Indien et dans le monde en général. Les villes et les ports rivalisaient entre eux, on construisait de nouvelles villes sur des embouchures de fleuves où il n’y avait rien jusque-là, la loyauté des populations locales fluctuait, les esclavagistes musulmans d’Afrique de l’Ouest, l’or d’Afrique du Sud et d’Inka, l’île à l’ouest de l’Afrique – tout cela existait depuis des années, mais tout avait changé, d’une certaine façon. L’effondrement des vieux empires musulmans, la multiplication des nouvelles machines, des nouveaux États, des nouvelles religions, des nouveaux continents, tout cela partait d’ici, comme si les vibrations des violents combats avec l’Inde provoquaient des ondes de changement, des vagues dans le monde entier, qui fusionnaient en refluant.
Bhakta présenta quelqu’un d’autre à Ismail et les deux hommes se saluèrent d’un hochement de tête en s’inclinant légèrement. L’homme s’appelait Wasco, et il venait du Nouveau Monde, la grande île à l’ouest de la Franji, que les Chinois appelaient Yingzhou. Wasco l’appelait Hodenosauneega, ce qui voulait dire « le territoire des peuples de la Longue-Maison », dit-il dans un persan passable. Il représentait la Ligue hodenosaunee, lui expliqua Bhakta. On aurait dit un Sibérien ou un Mongol, ou un Mandchou qui ne se serait pas rasé le front. Il était grand, il avait le nez fort, busqué, et même le soleil écrasant du Kerala ne lui faisait pas d’ombre. C’était comme si ces îles isolées, de l’autre côté du monde, avaient produit une race plus saine et plus vigoureuse. Sans doute avait-il été envoyé par son peuple pour cette raison même.
Bhakta les quitta et Ismail dit poliment :
— Je viens de Konstantiniyye. Vos gens ont-ils de la musique comme celle que nous venons d’entendre ?
Wasco réfléchit un instant.
— Nous chantons et nous dansons, mais tous ensemble, de façon informelle, et au petit bonheur, si vous voyez ce que je veux dire. Les tambours, ici, sont beaucoup plus fluides et compliqués. Le son est épais. Je trouve ça fascinant. J’aimerais vraiment avoir l’occasion de réentendre ça, pour vérifier que j’ai bien entendu ce que je crois avoir entendu.
Il agita la main d’une façon qu’Ismail ne comprit pas. En signe d’étonnement, peut-être, devant la virtuosité des percussionnistes.
— Ils jouent magnifiquement, répondit Ismail. Nous avons aussi des percussionnistes, mais ceux-ci ont élevé les tablas à un niveau supérieur.
— Je vous l’accorde.
— Et les villes, les vaisseaux, tout ça ? Y a-t-il dans votre pays un port comme celui-ci ? demanda Ismail.
L’expression de surprise de Wasco ressembla à celle de tout le monde, ce qui, se dit Ismail, était normal ; c’était la tête que faisaient tous les nouveau-nés. En réalité, avec son persan approximatif, Ismail s’émerveillait qu’il soit aussi compréhensible malgré son origine exotique.
— Non. Là d’où je viens, nous ne formons pas de regroupements aussi importants ; je pense qu’il y a plus de gens qui vivent autour de cette baie que dans tout mon pays.
Ce fut au tour d’Ismail d’être surpris.
— Si peu que ça ?
— Oui. Je trouve qu’il y a beaucoup de gens, ici. Cela dit, nous vivons dans une grande forêt, extrêmement épaisse et dense. Les fleuves font d’excellentes voies de communication. Jusqu’à ce que vous arriviez, nous chassions et nous avions quelques cultures, mais nous ne fabriquions que ce dont nous avions besoin, sans métaux, sans bateaux. Ce sont les musulmans qui les ont apportés sur notre côte ouest, et qui ont érigé des forts dans quelques-uns de nos ports, en particulier à l’embouchure de la rivière de l’Est, et dans l’Ile-Longue. Ils étaient peu nombreux, au départ, et nous avons appris, grâce à eux, bien des choses que nous avons mises en application. Mais nous avons été frappés par des maladies inconnues, et beaucoup sont morts, pendant qu’un grand nombre de musulmans débarquaient, amenant des esclaves d’Afrique pour les aider. Cela dit, notre terre est très vaste, et la côte elle-même, où les musulmans sont installés, n’est pas une très bonne terre. Alors nous commerçons avec eux, et mieux encore, avec les vaisseaux de Travancore. Nous étions très heureux de voir ces vaisseaux, vraiment, parce que nous étions inquiets à cause des musulmans franjs. Nous le sommes encore. Ils ont beaucoup de canons, ils vont où ils veulent, ils nous disent que nous ne connaissons pas Allah, et que nous devons le prier et ainsi de suite. Alors nous avons été contents de voir arriver d’autres peuples, dans de bons vaisseaux. Des gens qui n’étaient pas musulmans.
— Les Travancoriens ont-ils déjà attaqué les musulmans, chez vous ?
— Pas encore. Ils sont arrivés à l’embouchure du Mississippi, un grand fleuve. Mais ils finiront bien par en découdre. Ils sont très bien armés, les uns comme les autres, contrairement à nous. Bref, ça ne saurait tarder. (Il riva son regard à celui d’Ismail et eut un sourire chaleureux.) Je dois me souvenir que vous êtes sûrement musulman, vous aussi.
— Mais je ne l’impose pas aux autres, répondit Ismail. L’islam vous permet de choisir.
— Oui, c’est ce qu’on disait. Mais ici, à Travancore, cela se vérifie effectivement. Les Sikhs, les Hindous, les Africains, les Japonais, on voit de tout par ici. Le Kerala ne semble pas s’en soucier. Et peut-être même que cela lui plaît.
— Les Hindous absorbent tout ce qui les touche, à ce qu’on dit.
— Ça me paraît bien, répondit Wasco. Ou du moins préférable à Allah à la pointe du fusil. Nous faisons nos propres vaisseaux, maintenant, dans nos grands lacs, et nous serons bientôt en mesure d’arriver jusqu’à vous en passant par l’Afrique. À moins que le Kerala ne creuse ce canal à travers le désert du Sinaï, pour relier la Méditerranée à la mer Rouge, ce qui nous permettrait de venir beaucoup plus facilement chez vous. Il est prêt à conquérir toute l’Égypte pour que ce soit possible. Mais il y a encore beaucoup de choses à dire, de décisions à prendre. Ma Ligue aime beaucoup les ligues.
Puis Bhakta s’approcha d’eux et emmena à nouveau Ismail.
— Vous avez l’honneur d’être invité à rejoindre le Kerala dans l’un des chariots du ciel.
— Les sacs flottants ?
— Oui, répondit Bhakta avec un sourire.
— Oh, quelle joie !
Suivant l’abbesse clopinante, Ismail traversa des terrasses, chacune embaumant un parfum distinct, de citron, de muscade, de cannelle, de menthe et de rose, montant, niveau après niveau, par de petits escaliers de pierre. Il avait à chaque pas l’impression de gravir des étapes vers un royaume supérieur, où les sens et les émotions étaient plus affûtés : une vague terreur du corps, alors que les odeurs le projetaient de plus en plus loin, dans un état plus élevé. Il avait la tête qui tournait. Il n’avait pas peur de la mort, mais son corps n’était pas chaud à l’idée de ce qui pourrait la provoquer. Il rattrapa l’abbesse et marcha à côté d’elle. Son calme l’apaisait. À la façon dont elle montait les marches, il comprit qu’elle souffrait en permanence. Et pourtant elle n’en parlait jamais. À cet instant, comme elle s’arrêtait pour reprendre son souffle, elle se retourna et regarda l’océan. Elle mit une main déformée sur le bras d’Ismail, et lui dit combien elle était heureuse qu’il soit là, parmi eux, tout ce qu’ils pourraient accomplir ensemble, en travaillant sous les directives du Kerala, qui créait une terre où de grandes choses seraient possibles. Ils allaient changer le monde. Pendant qu’elle parlait, Ismail se sentit enivré par les parfums qui flottaient dans l’air, enivré par la vision des choses à venir… Le Kerala, multipliant les conquêtes, envoyant ici, au monastère, des choses et des gens du monde entier, des livres, des cartes, des instruments, des remèdes, des outils, des gens affligés de maladies inhabituelles ou qui avaient des dons nouveaux, tout cela venant de l’ouest de l’Oural et de l’est du Pamir, de Birmanie et du Siam, de la péninsule malaise, de Sumatra, de Java et de la côte est de l’Afrique, et même un médecin-sorcier de Madagascar en train de déployer les ailes presque transparentes d’une sorte de chauve-souris, permettant à Ismail d’examiner des veines et des artères vivantes, et de fournir une description complète de la circulation du sang qui plairait beaucoup au Kerala. Ismail vit aussi un médecin chinois de Sumatra lui montrer ce que les Chinois entendaient par le ki et le shen, qui se révélaient être ce qu’il avait toujours appelé la lymphe, une chose produite par de petites glandes sous les bras, et que l’on pouvait soigner avec des emplâtres d’herbes et d’autres substances, comme l’avaient toujours dit les Chinois ; il vit encore un groupe de moines bouddhistes qui avaient classé les différents éléments en familles, selon leurs propriétés chimiques et physiques, formant un mandala magnifique qui fournissait matière à des discussions interminables dans les salles de cours, les ateliers, les fonderies et les hôpitaux ; et tous procédaient à des explorations, sans avoir besoin de faire le tour du monde en bateau, sans jamais quitter Travancore, avides de trouver quelque chose d’intéressant à raconter au Kerala, la prochaine fois qu’il passerait – pas pour qu’il les récompense, même si c’était probable, mais parce qu’il serait tellement heureux d’avoir cette nouvelle information, et qu’il aurait ce sourire que tout le monde mourait d’envie de voir, et qui résumait toute l’histoire de Travancore, ici et maintenant.
Ils arrivèrent à une large terrasse où le ballon attendait. Son immense enveloppe de soie était déjà pleine d’air chaud, et tirait par saccades sur ses amarres. Le panier de bambou tressé était plus gros qu’une voiture et presque autant qu’un petit pavillon ; les cordes qui le reliaient à l’enveloppe de soie formaient un réseau de lignes très fines, si nombreuses que l’ensemble donnait une impression de résistance. La soie de l’enveloppe était diaphane. Un réchaud à charbon – auquel était fixé un soufflet à main – était boulonné à un cadre de bambou fixé sous l’enveloppe, juste au-dessus de leurs têtes, lorsqu’ils étaient dans le panier, où ils entrèrent par une petite porte.
Le Kerala, la chanteuse, Bhakta et Ismail montèrent donc dans le panier et se mirent aux quatre coins. Pyidaungsu jeta un coup d’œil et dit :
— Hélas, j’ai l’impression qu’il n’y a pas de place pour moi. Nous serions trop tassés. J’irai la prochaine fois, bien que je regrette de devoir laisser passer cette occasion !
Le pilote et ses passagers larguèrent les amarres, n’en conservant qu’une seule. Il n’y avait presque pas de vent ce jour-là, et ce serait, dit-on à Ismail, un vol contrôlé. Ils devaient monter comme un cerf-volant, lui expliqua le pilote, et quand la ligne serait presque complètement tendue, ils éteindraient le réchaud et se stabiliseraient comme n’importe quel cerf-volant, suspendus à quelques milliers de mains au-dessus du paysage. La brise légère qui soufflait habituellement du large dans l’après-midi les ferait flotter dans l’intérieur des terres si jamais la corde venait à casser.
Et ils montèrent.
— C’est comme le chariot d’Arjuna, leur dit le Kerala tandis qu’ils hochaient la tête, les yeux brillants d’excitation.
La chanteuse était belle, les échos de son chant peuplaient toujours l’air autour d’eux ; le Kerala était encore plus beau ; et Bhakta, la plus belle d’entre tous. Le pilote actionna une ou deux fois le soufflet. Le vent jouait dans les cordages.
Vu d’en haut, le monde était plat. Il s’étendait à une distance terrifiante, jusqu’à l’horizon – des collines vertes au nord, à l’est et au sud ; et à l’ouest, l’étendue bleue, plate, de la mer, sur laquelle le soleil brillait comme de l’or sur un plat de céramique bleue. Les choses, en bas, étaient petites, mais bien distinctes. Les arbres faisaient comme de minuscules touffes de laine verte. On se serait cru dans une miniature persane, magnifiquement détaillée, avec ces champs de riz entourés de rangées de palmiers plantés sur des buttes, et au-delà ces vergers de petits arbres méticuleusement alignés. On aurait dit une tapisserie d’une finesse exquise.
— Quel genre d’arbres est-ce là ? s’étonna Ismail en indiquant les collines vert foncé, à l’est.
C’est le Kerala qui répondit. Il était évident que c’était lui qui était à l’origine de la plupart des vergers visibles en dessous d’eux.
— Ces terres font partie du domaine de la ville et ce sont des plantations d’arbres à partir desquels nous produisons les huiles essentielles qui constituent notre principal produit d’exportation. Nous les échangeons contre toutes sortes de marchandises. Vous en avez senti quelques-unes en arrivant jusqu’au panier : le vétiver, le costus, la valériane et l’angélique. Des buissons comme le lentisque, le néroli, le kaatoanbangkal, le parijat et la reine de la nuit. Des herbes comme la citronnelle, les cymbopogons et la palmarosa. Des fleurs, comme vous pouvez le voir, dont la tubéreuse, la rose, le jasmin, et les fleurs de champac et de frangipanier. Des herbes, aussi : la menthe poivrée, la menthe médicinale, le patchouli, l’artémise. Et là, dans les bois, il y a les plantations de santal et d’agar. Tous ces arbres et ces plantes sont cultivés, plantés, soignés, récoltés, traités et transformés, et le produit est mis en bouteilles ou en sachets, puis envoyé en Afrique, en Franji, en Chine ou dans le Nouveau Monde, où ils n’avaient pas, jusque-là, de substances aromatiques et médicinales aussi puissantes, et de loin. Ils ont été très impressionnés, et tous nos produits sont extrêmement recherchés. À présent, j’ai des gens qui explorent le monde à la recherche d’autres espèces, pour voir ce qui poussera ici. Celles qui prospèrent sont cultivées, et leurs huiles vendues dans le monde entier. La demande est tellement forte que nous avons du mal à la satisfaire, et l’or afflue à Travancore alors que ses merveilleux parfums embaument la terre entière.
En arrivant au bout de la corde d’amarrage, le panier tourna, et en dessous d’eux le cœur du royaume leur fut révélé, la cité de Travancore telle que la voyaient les oiseaux, ou Dieu. La campagne, tout autour de la baie, était couverte de toits, d’arbres, de routes, de quais, aussi petits que les jouets d’une princesse. Ils ne s’étendaient pas tout à fait aussi loin qu’à Konstantiniyye, mais la cité était néanmoins assez vaste, et constituait un véritable arboretum verdoyant, où les bâtiments et les routes étaient à peine visibles. Il n’y avait que dans la région du port que les toits étaient plus nombreux que les arbres.
Juste au-dessus d’eux flottait une tapisserie de nuages moirés que le vent poussait vers l’intérieur des terres. Au large, une grande rangée de gros nuages blancs, marbrés, venait vers eux.
— Il va bientôt falloir que nous redescendions, annonça le Kerala au pilote, qui hocha la tête et vérifia son réchaud.
Une nuée de vautours voleta autour d’eux avec curiosité. Le pilote poussa un grand cri pour les effrayer et sortit un pistolet d’un sac accroché à la paroi intérieure du panier. Ça ne s’était jamais produit sous ses yeux, disait-il, mais il avait entendu parler d’un vol d’oiseaux s’abattant du ciel, qui avaient crevé l’enveloppe avec leur bec. Des faucons, jaloux de leur territoire, apparemment ; sans doute les vautours seraient-ils moins téméraires, mais il ne serait pas bon de se laisser surprendre.
Le Kerala se mit à rire, regarda Ismail et embrassa d’un geste les champs colorés, parfumés.
— C’est le monde que nous voulons, et que vous allez nous aider à faire, dit-il. Nous irons de par le monde planter des jardins et des vergers jusqu’à l’horizon, nous construirons des routes dans les montagnes et dans les plaines, nous ferons des terrasses dans les collines, nous irriguerons les déserts jusqu’à ce qu’il y ait des jardins partout, et que l’abondance règne, et ce sera la fin des empires et des royaumes, des califes, des sultans, des émirs, des khans et des zamindars, des rois, des reines et des princes, des cadis, des mollahs et des oulémas, de l’esclavage, de l’usure, de la propriété et des impôts, des riches et des pauvres, des meurtres et de la torture. Il n’y aura plus d’exécutions, de prisons et de prisonniers, plus de généraux, de soldats, d’armées et de marines, de patriarches, de clans, de castes, de faim et de souffrance – pas plus de souffrance, du moins, que la vie ne nous en apporte du fait que nous naissons et qu’il faut bien mourir, et nous verrons alors, pour la première fois, quel genre de créature est l’homme en réalité.
3. La Montagne d’Or
Dans la douzième année du règne de l’empereur Xianfeng, la pluie noya la Montagne d’Or. Il commença à pleuvoir le troisième mois d’automne, début habituel de la saison humide sur cette partie de la côte du Yingzhou, et il ne cessa plus de pleuvoir jusqu’au deuxième mois du printemps suivant. Il plut tous les jours pendant la moitié d’une année, et souvent à verse, à torrents, comme sous les tropiques. Très vite, alors qu’on n’était pas encore à la moitié de l’hiver, la grande vallée centrale de la Montagne d’Or fut inondée dans toute sa longueur, formant un gigantesque lac long de cent cinquante lis et large de trois cents. Une eau brunâtre dévalait les pentes des collines vertes bordant le delta, jusque dans la grande baie et par-delà la Porte d’Or, donnant à l’océan une teinte boueuse, sur toute sa largeur et jusqu’aux îles Peng-lai. Puis l’eau partit aussi vite qu’elle était arrivée, mais il en resta une grande quantité, qui formait une véritable mer intérieure. Sur toute la longueur de la vallée, les villes chinoises, les villages, les fermes avaient été noyés jusqu’au toit, et la population avait été chassée vers les sommets, le long de la ligne de côte, au pied de la Montagne d’Or, et surtout vers la ville, la légendaire Fangzhang. Ceux qui vivaient du côté est de la vallée partirent généralement vers les contreforts, progressant le long des voies ferrées ou des routes carrossables. Ils traversèrent des vergers de pommiers et des vignobles dominant les profonds canyons qui coupaient en deux les hauts plateaux. Où ils tombèrent sur une importante population de Japonais.
Beaucoup de ces Japonais étaient arrivés là pendant la diaspora, quand les armées chinoises avaient conquis le Japon, au cours du règne de Yung Cheng, cent vingt années plus tôt. C’étaient eux qui les premiers avaient cultivé le riz dans la vallée centrale ; mais une génération plus tard, deux peut-être, l’immigration chinoise s’était répandue dans la vallée comme les pluies qui la submergeaient actuellement, et la plupart des Japonais nisei et sansei étaient partis pour les contreforts, se faisant chercheurs d’or, vignerons ou cultivateurs de pommes. Ils y rencontrèrent un certain nombre d’anciens, venus se réfugier dans les contreforts pour fuir l’épidémie de malaria qui les avait récemment presque tous fauchés. Les Japonais fraternisèrent avec les survivants, et les autres anciens, qui se trouvaient plus à l’est. Ensemble, ils résistèrent aux incursions chinoises, luttant par tous les moyens, sauf l’insurrection ; car par-delà la Montagne d’Or s’étendaient les hauts et terribles déserts alcalins, où rien ne pouvait vivre. Ils étaient dos au mur.
C’est pourquoi l’arrivée de ces nombreuses familles de réfugiés chinois n’était pas vraiment perçue par ceux qui se trouvaient déjà là comme un événement des plus enthousiasmants. Les contreforts étaient composés de plateaux inclinés, montant vers les hautes montagnes, entrecoupés de profonds canyons aux flancs abrupts, boisés, où coulait une rivière. Ces canyons envahis d’arbousiers n’avaient pu être investis par les autorités chinoises, et beaucoup de familles japonaises s’y étaient réfugiées, vivant des paillettes d’or trouvées dans les cours d’eaux ou de l’exploitation de petites mines. Les campagnes chinoises de construction de routes avaient souvent privilégié les plateaux, et les canyons étaient restés aux mains des Japonais, en dépit de la présence de quelques prospecteurs chinois. Une sorte d’Hokkaido exilée, coincée entre la vallée chinoise et le grand désert des autochtones. Et voilà que ce monde s’emplissait de cultivateurs de riz chinois trempés comme des soupes.
Aucun de ces deux groupes ne se réjouissait. L’estime en laquelle les Chinois tenaient les Japonais rappelait la proverbiale aversion des chats pour les chiens, et réciproquement. Les Japonais des contreforts essayèrent bien, au début, d’ignorer les Chinois qui installaient des camps de réfugiés un peu partout, dans les plus grandes gares de chemin de fer comme dans les plus petits relais de poste ; et les Chinois, de leur côté, feignirent d’ignorer les habitants japonais dont ils étaient en train d’envahir le territoire. Puis le riz vint à manquer, les gens commencèrent à s’énerver, et les autorités chinoises envoyèrent des troupes pour pacifier la région. Et il pleuvait toujours.
Un groupe de Chinois échappa à l’inondation en suivant la piste qui longeait la rivière de la Truite Arc-en-Ciel. Dominant la rive nord de la rivière se trouvaient de nombreux pâturages et pommeraies appartenant pour la plupart à des Chinois de Fangzhang, mais où travaillaient des Japonais. Ce groupe de Chinois établit son campement dans l’une de ces pommeraies, et fit de son mieux pour s’abriter de la pluie, qui tombait toujours, inlassablement. Ils construisirent une sorte de grange, au toit de bardeaux soutenu par des poteaux, avec des bâches en guise de murs, et un feu de camp à l’une des extrémités ; ce n’était pas grand-chose, mais c’était mieux que rien. Le jour, des hommes descendaient tant bien que mal au fond du canyon pour aller pêcher dans la rivière. D’autres allaient dans la forêt chasser le chevreuil, en tuant des dizaines dont ils faisaient sécher la viande.
Yao Je, la matriarche d’une de ces familles, se désespérait d’avoir dû abandonner sa ferme, et surtout ses vers à soie, qui étaient restés dans des boîtes accrochées aux chevrons de l’atelier de filature. Son mari pensait qu’on ne pouvait pas y faire grand-chose, mais la famille employait un serviteur japonais, un garçon du nom de Kiyoaki, qui se porta volontaire pour redescendre dans la vallée, dès que le temps le permettrait, et aller, en barque, chercher les vers à soie. Son maître n’appréciait pas sa proposition, mais sa maîtresse l’approuva. Elle voulait absolument récupérer ses vers à soie. Ainsi, par un matin pluvieux, Kiyoaki partit pour la ferme inondée, espérant qu’elle serait encore accessible.
Il trouva la barque de la famille Yao toujours attachée au chêne où ils l’avaient laissée, et commença à ramer au-dessus de ce qui avait été autrefois les rizières, à l’est de leur ferme, en direction du domaine. Un fort vent d’ouest souleva des vagues à la surface de l’eau, et il fut repoussé vers son point de départ. Mais il recommença. Quand il atteignit enfin le domaine inondé des Yao, il avait les mains couvertes d’ampoules. Il accosta au sommet de l’une des murailles du domaine, qui racla le fond de sa barque. Il l’attacha à l’une des cheminées de l’atelier de filature, qui était le plus haut bâtiment de la ferme. Il se faufila à l’intérieur en se glissant par une fenêtre, et marcha sur les chevrons, jusqu’aux feuilles de papier humides couvertes des petites boîtes, pleines de cailloux, et d’un paillis de mûriers, qui contenaient les si précieux cocons des vers à soie. Il rassembla toutes les feuilles dans un sac de toile huilée, qu’il déposa délicatement par la fenêtre dans la barque, ravi.
Cependant, il s’était mis à pleuvoir plus fort, et la pluie fouettait violemment la surface de l’eau. Aussi Kiyoaki trouva-t-il plus sage de passer la nuit dans le grenier de la maison des Yao. Mais il était si vide qu’il en était effrayant, et, pour la seule raison qu’il avait peur, Kiyoaki décida de rentrer. La toile huilée protégerait les cocons, et il était trempé depuis si longtemps que l’être un peu plus ne le dérangeait pas. Il était comme une grenouille sautant hors de sa mare, et retombant dedans ; cela lui était égal. Il remonta donc dans la barque et commença à ramer.
Mais, à présent, un vent vicieux soufflait de l’est, arrachant à l’eau des vagues d’une taille et d’une force étonnantes. Kiyoaki avait mal aux mains, et par moments la coque de sa barque heurtait quelque chose : le faîte d’un arbre, des poteaux télégraphiques, parfois d’autres choses, qu’il n’identifiait pas, trop effrayé pour regarder. Des doigts d’hommes morts ! Il n’y voyait guère dans ces ténèbres liquides et, comme la nuit se faisait de plus en plus noire, il ne sut bientôt plus dans quelle direction ramer. Une toile frottée d’huile était rangée sous la proue de la barque. Il la tira sur les plats-bords, l’attacha fermement, se glissa dessous, et se laissa dériver, allongé dans le fond du bateau, écopant de temps à autre à l’aide d’une boîte de conserve. C’était humide, mais au moins il ne chavirerait pas. Il se laissa aller au gré du courant, puis finit par s’endormir, bercé par les vagues.
Il se réveilla plusieurs fois dans la nuit, et chaque fois, après avoir écopé, il s’efforçait de se rendormir. La barque roulait et tanguait, mais les vagues ne passèrent jamais par-dessus bord. Si elles le faisaient, la barque se renverserait, et il se noierait ; alors il évitait de trop y penser.
À l’aube, il fut évident qu’il avait dérivé plutôt vers l’ouest que vers l’est. Il s’était perdu quelque part dans la vaste mer intérieure qui occupait la vallée centrale. Un bouquet de chênes indiquait la présence d’un îlot, ou en tout cas d’une hauteur, vers laquelle il rama.
Comme il ramait en tournant le dos à cette nouvelle petite île, il ne la vit pas arriver ; il ne s’en rendit compte que lorsque la proue de sa barque la heurta. Immédiatement, il s’aperçut qu’elle grouillait de bestioles : araignées, insectes, serpents, écureuils, taupes, rats, souris, renards, et un raton-laveur. Tous se jetèrent brusquement sur l’embarcation, qui était devenue le nouveau point le plus élevé de la plage. Et de là, sur lui, puisqu’il était encore ce qu’il y avait de plus haut à bord du bateau. Il poussait des hurlements de détresse, et chassait, en tapant dessus, les serpents, araignées et écureuils, désespérés, qui grimpaient sur lui, lorsqu’une jeune femme tenant un bébé bondit sur le bateau, comme les autres créatures, sauf qu’elle était descendue de l’arbre en direction duquel Kiyoaki avait ramé. La fille pleurait et sanglotait :
— Ils essaient de le manger ! Ils essaient de manger mon bébé !
Mais ce qui préoccupait avant tout Kiyoaki, c’était la multitude de bestioles qui grouillaient sur lui, au point de manquer lui faire perdre une rame. Quand il eut fini d’écraser, balayer ou chasser par-dessus bord tous ces petits intrus, il replaça les rames dans les dames de nage et s’éloigna rapidement. La jeune fille et son bébé s’assirent sur le banc de la chaloupe ; la jeune fille continuait à chasser les insectes et les araignées, en poussant des « Ouh ! Ouh ! Ouh ! ». Elle était chinoise.
Du plafond de nuages gris et bas, la pluie recommença à tomber. Il n’y avait que de l’eau, à perte de vue, à l’exception des arbres de la petite île dont ils étaient partis si rapidement.
Kiyoaki ramait vers l’est.
— Tu vas dans la mauvaise direction, pleurnicha la jeune fille.
— C’est de là que je viens, expliqua Kiyoaki. La famille qui m’emploie est là-bas.
La fille ne répondit rien.
— Comment t’es-tu retrouvée sur cette île ?
Elle resta coite.
Alourdie par ses passagers, la barque était plus difficile à manœuvrer, et les vagues menaçaient de la faire chavirer. Des criquets et des araignées grouillaient et rampaient sous leurs pieds, et le raton-laveur avait réussi à se faufiler dans l’espace ménagé sous la proue de l’embarcation. Kiyoaki rama à en avoir les mains en sang, mais ils ne virent pas le moindre petit bout de terre ; la pluie tombait si fort qu’ils avaient l’impression d’avancer dans une sorte d’épais brouillard.
La fille geignait, donnait la tétée à son bébé, écrasait des insectes sous ses talons.
— Rame vers l’ouest, ne cessait-elle de lui dire. Le courant t’aidera.
Kiyoaki rama vers l’est. La barque rebondissait tant bien que mal sur les vagues et, de temps à autre, ils devaient écoper. Le monde entier paraissait n’être plus qu’un océan. Une fois, Kiyoaki aperçut une bande de côte entre deux nuages bas sur l’horizon, à l’ouest, beaucoup plus près qu’il ne s’y attendait ou qu’il n’aurait osé l’espérer. Le courant avait dû les déporter vers l’ouest.
À la nuit tombée, ils approchèrent d’une nouvelle petite île, dont ils voyaient les arbres.
— Mais c’est la même ! dit la jeune femme.
— C’est juste qu’elle lui ressemble.
Le vent recommença à souffler, rappelant ces brises nocturnes venues du delta, qu’ils appréciaient tant durant les chaleurs de l’été. Les vagues grossirent, et grossirent, se fracassant à la proue du navire, s’écrasant sur la toile au-dessus d’eux et retombant à leurs pieds. Il fallait absolument débarquer, au plus vite. Sinon ils couleraient et se noieraient.
Alors Kiyoaki redoubla d’efforts et ils parvinrent à toucher terre. Une fois encore, ils furent assaillis par une marée d’insectes et d’animaux. À la grande surprise de Kiyoaki, la jeune Chinoise jura comme un charretier, s’attaquant à toutes les créatures qui s’approchaient de son bébé, surtout aux plus grosses. Quant aux plus petites, ils durent s’en accommoder. Les chênes hébergeaient une petite troupe de singes des neiges, qui les dévisageaient de leurs gros yeux globuleux. Kiyoaki attacha la barque à une branche, s’éloigna, étendit une couverture mouillée sur un coin de boue humide, entre deux racines, retira la lourde toile huilée du navire et s’arrangea pour en faire, à l’aide de branches, une tente aussi solide que possible. Il invita la jeune Chinoise à s’y abriter, avec son bébé, et se faufila sous la tente avec eux. Ensuite, en même temps que toute une ménagerie d’insectes, de serpents et de rongeurs, ils se préparèrent pour la nuit. Mais ils eurent du mal à dormir.
Le lendemain matin, il pleuvait toujours autant. La jeune femme avait placé son bébé entre elle et Kiyoaki, pour le protéger des rats. À présent, elle lui donnait le sein. Il faisait plus chaud sous la tente que dehors. Kiyoaki se demandait s’il ne pourrait pas faire un feu. Après tout, il y avait suffisamment à manger : serpents, écureuils… Mais ils ne trouveraient pas de bois sec.
— Nous ferions mieux de repartir, dit-il.
Alors, ils sortirent dans le crachin froid et regagnèrent la chaloupe. Au moment même où Kiyoaki l’éloignait du rivage, une dizaine de singes des neiges se laissèrent tomber du haut des branches et grimpèrent avec eux. La fille hurla et mit son bébé sous sa chemise, le protégeant de tout son corps, défiant du regard les singes d’approcher. Mais ils se contentèrent de rester là, sagement assis comme n’importe quels passagers. Parfois, ils regardaient leurs pieds, sinon, la pluie. Ils se grattaient le menton, se demandant peut-être s’il cesserait jamais de pleuvoir. L’un d’eux regarda la jeune Chinoise. Alors elle lui cria quelque chose, et le singe recula, intimidé.
— Laisse-les tranquilles, dit Kiyoaki.
Les singes étaient japonais ; les Chinois ne les aimaient pas, et passaient leur temps à se plaindre de leur présence au Yingzhou.
Ils dérivèrent sur la vaste mer intérieure. La jeune femme et son bébé étaient couverts d’araignées et de puces, comme s’ils étaient déjà morts. Les singes commencèrent à les épouiller, mangeant quelques insectes, en jetant d’autres par-dessus bord.
— Je m’appelle Kiyoaki.
— Moi, c’est Peng-ti, dit la jeune Chinoise, en chassant quelques insectes des cheveux de son bébé et en tâchant d’ignorer les singes.
Kiyoaki avait les mains en sang à force de ramer, mais au bout d’un certain temps il réussit à oublier la douleur. Ils mirent le cap à l’ouest, s’abandonnant au courant qui les avait déjà menés si loin.
Un petit bateau apparut dans la bruine. Kiyoaki hurla, réveillant la jeune fille et son bébé ; mais l’embarcation faisait déjà voile vers eux.
Il y avait deux marins à bord. Deux Japonais. Peng-ti les regarda, d’un air suspicieux.
L’un d’eux dit aux naufragés de monter à leur bord.
— Mais dites aux singes de rester où ils sont ! lança-t-il en riant.
Peng-ti leur tendit son bébé, puis se hissa elle-même par-dessus le plat-bord.
— Vous avez de la chance de n’avoir eu que des singes, dit le second marin. Plus au nord, dans la vallée, le Fort Noir est suffisamment en hauteur pour servir de refuge à tous ceux qui n’ont pu fuir ailleurs, et les animaux qui y sont allés, à la nage, sont encore plus nombreux que ceux qu’il y avait autrefois dans vos rizières. Ils ont eu beau fermer les portes, les murs ne sont rien pour les ours, les ours bruns, les ours dorés… Ils commençaient à leur tirer dessus quand le magistrat leur a dit d’arrêter. Ils allaient épuiser tout leur stock de munitions, et cela n’aurait pas empêché la ville de se remplir d’ours. Pour finir, les grands ours dorés ont brisé les portes, laissant passer des loups, des élans… Tous ces hardis explorateurs ont investi les rues du Fort Noir, obligeant les gens à se cacher dans leurs greniers en attendant que ça passe !
Les deux hommes s’esclaffèrent à cette évocation.
— On a faim, dit Peng-ti.
— Oui, ça se voit, répondirent-ils.
— Nous allons vers l’est, mentionna Kiyoaki.
— Et nous vers l’ouest.
— Parfait, dit Peng-ti.
Et il pleuvait toujours. Ils abordèrent un nouveau bosquet, dont les frondaisons dépassaient d’un quai inondé. Entre les branches des arbres, une douzaine de malheureux Chinois trempés attendaient, tremblant comme des singes, trop heureux de les voir arriver. Ils sautèrent à bord du bateau. Cela faisait six jours, dirent-ils. Six jours dans les arbres ! Le fait d’avoir été sauvés par des Japonais ne semblait pas du tout les incommoder.
Maintenant, le bateau et la barque étaient portés par un courant d’eau marron, entre de vertes collines embrumées.
— Nous continuons vers la ville, dit l’homme qui tenait le gouvernail. C’est le seul endroit dont les quais sont encore accessibles. De toute façon, j’aimerais me sécher, et puis m’offrir un bon gueuleton à Japantown.
Ils repartirent donc sur l’eau, grêlée par la pluie. Le delta et ses digues, tout était sous l’eau. Ce n’était qu’un immense lac d’eau marron. Quelques arbres pointant leurs branches çà et là permettaient apparemment aux marins de s’orienter. Ils montraient du doigt certains de ces arbres, et parlaient avec animation dans un japonais qui offrait un saisissant contraste avec leur chinois, plus qu’approximatif.
Pour finir, ils arrivèrent à un détroit bordé de hautes collines et, comme le vent les poussait dans ce détroit – qui devait être la Porte Intérieure, se dit Kiyoaki –, ils amenèrent la voile et se laissèrent porter par le courant, manœuvrant leur gouvernail pour rester dans la partie la plus rapide, qui les emmena derrière la courbe des hautes collines du Sud. Plus loin, ils passèrent par des goulets, pour déboucher finalement dans l’immense étendue d’eau de la Baie d’Or, aux flots maintenant agités et fangeux. Le sommet des vertes collines environnantes disparaissait dans un plafond de nuages gris, écrasant. Comme ils louvoyaient vers la ville, certains nuages s’effilochèrent, formant de longues bandes de coton gris au-dessus des collines du nord de la péninsule. Une colonne de lumière tomba sur le rucher de maisons et de rues qui recouvrait le moindre espace de terre jusqu’au sommet du mont Tamalpi, et une coulée pareille à de l’argent ou de l’étain liquide envahit de blancheur certains des quartiers de la ville, généralement grise. C’était un spectacle impressionnant.
La partie occidentale de la baie, juste au nord de la Porte d’Or, était hérissée de nombreuses péninsules qui s’avançaient dans l’eau. Ces péninsules étaient également couvertes de bâtiments, et se trouvaient être, de fait, les quartiers les plus animés de la ville. Elles délimitaient trois petites anses. Celle du milieu, la plus grande, était le port de commerce. La péninsule au sud faisait partie de Japantown, qui s’étendait derrière eux, au sein d’un amoncellement d’entrepôts et de quartiers ouvriers. Là, comme l’avaient dit les marins, les jetées et les quais flottants étaient intacts et fonctionnaient normalement, comme si la vallée centrale n’avait connu aucune inondation. Seule la couleur marronnasse de l’eau de la baie indiquait qu’il s’était passé quelque chose.
Alors qu’ils approchaient des docks, les singes de la chaloupe commencèrent à s’agiter. En fait, le choix se résumait pour eux entre la noyade et la poêle à frire, et pour finir l’un des singes se jeta par-dessus bord et se mit à nager en direction d’une île, plus au sud. Immédiatement, tous les autres singes l’imitèrent avec un grand « splash », reprenant leurs conversations comme si de rien n’était, une fois un peu plus loin.
— C’est pour ça qu’on l’appelle l’île aux Singes, dit le pilote.
Il les conduisit au port du milieu. Sur les quais, parmi les hommes, se trouvait un magistrat chinois, qui les regarda approcher, et leur dit :
— Toujours aussi inondé, là-bas, à ce que je vois…
— Toujours inondé. Et il pleut toujours.
— Les gens doivent avoir faim.
— Oui.
Les Chinois montèrent sur les quais et remercièrent les marins, qui s’en allèrent avec Kiyoaki, Peng-ti et le bébé. L’homme de barre les rejoignit alors qu’ils suivaient le magistrat vers le « Bureau des Réfugiés de la Grande Vallée », qui avait été installé dans les bureaux des douanes à l’arrière du port. On y procéda à l’enregistrement de leurs nom, lieu de résidence avant l’inondation, endroit où se trouvaient leurs proches – quand on le savait. Les employés leur donnèrent un jeton, qui permettait d’avoir un lit dans l’un des bâtiments du contrôle de l’immigration, situé sur une île aux flancs escarpés, un peu plus loin dans la baie.
L’homme de barre eut l’air inquiet. Ces grands bâtiments avaient été construits quelque cinquante années plus tôt, afin de mettre en quarantaine les candidats à l’immigration vers la Montagne d’Or qui n’avaient pas la chance d’être chinois. Ils étaient entourés par des palissades surmontées de fils de fer barbelé et possédaient d’immenses dortoirs, pour les hommes d’un côté, pour les femmes de l’autre. Aujourd’hui, ils servaient de centre d’accueil au flot de réfugiés fuyant l’inondation qui s’écoulait dans la baie, pour la plupart des Chinois originaires de la vallée ; mais les gardiens de l’île n’avaient en rien changé le comportement qu’ils avaient autrefois avec les immigrants, et les réfugiés de la vallée s’en plaignaient amèrement. Ils avaient le plus grand mal à obtenir l’autorisation d’aller rejoindre les membres de leurs familles habitant la région, ou de s’installer plus au nord, ou plus au sud de la vallée. Certains préféraient même repartir vers la vallée inondée pour attendre, sur une crête, que l’eau descende. Par ailleurs, on avait rapporté plusieurs cas de choléra, et le gouverneur de la province avait déclaré l’état d’urgence, ce qui lui donnait les pleins pouvoirs pour agir au mieux des intérêts de l’empereur : une sorte de loi martiale, appuyée par l’armée de terre et la marine.
L’homme de barre, après leur avoir expliqué tout cela, dit à Kiyoaki et à Peng-ti :
— Vous pouvez rester si vous voulez. Nous, nous irons dans une maison d’hôtes, à Japantown. C’est propre et ce n’est pas cher. Ils voudront bien vous faire crédit si nous leur disons de vous faire confiance.
Kiyoaki regarda Peng-ti, qui regardait à terre. Serpents ou araignées ? Camp de réfugiés ou Japantown ?
— Nous viendrons avec vous, finit-elle par répondre. Merci beaucoup.
L’avenue qui partait des quais vers le centre de la ville, situé sur une hauteur, était bordée des deux côtés par des restaurants, des hôtels et des boutiques, où s’affichaient aussi bien la fluide calligraphie des Japonais que les massifs idéogrammes chinois. Les rues perpendiculaires à l’avenue étaient étroites, avec des maisons surmontées de toitures arrondies aux coins tournés vers le ciel, touchant presque les tuiles de la maison d’en face. Les gens portaient des vestes ou des ponchos huilés, et se promenaient avec des ombrelles noires ou bigarrées, dont beaucoup étaient en lambeaux. Tout le monde était trempé et marchait le dos rond, la tête rentrée dans les épaules. Le milieu des rues n’était qu’un immense torrent d’eau boueuse, qui dévalait la pente jusque dans la baie. Le vert des collines, à l’ouest, était ponctué de toits de tuiles, rouge, vert ou bleu vif : c’était un quartier chic, malgré la présence de Japantown, à ses pieds. Ou peut-être à cause d’elle. Quelqu’un avait dit à Kiyoaki que le bleu de ces tuiles, là-haut, s’appelait bleu de Kyoto.
Ils cheminèrent le long de plusieurs ruelles, jusqu’à la grande maison d’un marchand de fournitures pour bateaux, dont l’atelier et la boutique se trouvaient perdus dans le labyrinthe des rues de Japantown. Les deux Japonais, dont le plus âgé s’appelait Gen, présentèrent les jeunes naufragés à la propriétaire de la maison d’hôtes qui se trouvait juste à côté. C’était une vieille Japonaise édentée, vêtue d’un modeste kimono marron. Il y avait un autel dans le salon et dans l’entrée de la maison. Sitôt franchi le seuil de sa porte, elle les débarrassa de leurs vêtements trempés. Elle les considéra, d’un œil critique, et se lamenta :
— Tout le monde est si trempé de nos jours… On dirait qu’on vous a sortis du fond de la baie, et que vous avez été grignotés par les crabes…
Elle leur donna des vêtements secs et fit envoyer les leurs à nettoyer. Son établissement comportait une aile pour les hommes et une autre pour les femmes. Kiyoaki et Peng-ti reçurent chacun une natte, puis on leur servit un repas chaud, de riz et de soupe, arrosé de quelques coupes de saké chaud. Gen paya pour eux, et refusa leurs remerciements avec la brusquerie des Japonais.
— Vous me paierez une fois rentrés chez vous, dit-il. Vos familles seront tellement contentes de me rembourser…
Ni l’un ni l’autre ne trouva rien à redire à cela. Nourris, au sec ; plus rien ne leur manquait, si ce n’est monter dans leur chambre, et dormir d’un sommeil de plomb.
Le lendemain matin, Kiyoaki fut réveillé par des cris. Le marchand d’à côté engueulait un de ses employés. Kiyoaki jeta un coup d’œil par la fenêtre de sa chambre qui donnait sur la boutique de quincaillerie marine, et vit le marchand frapper rageusement un pauvre gamin sur la tête avec un boulier, dont les billes tressautaient à chaque coup.
Gen, qui était entré dans la pièce, assista à la scène sans broncher.
— Allez, viens, dit-il à Kiyoaki. J’ai des courses à faire, j’en profiterai pour te montrer un peu la ville.
Ils prirent donc vers le sud la grande avenue côtière qui longeait la baie et ses plus petits ports. Le port au sud était encore plus bondé que celui de Japantown. Ses quais n’étaient qu’une forêt de mâts et de cheminées. Dans la ville derrière et au-dessus s’amoncelaient des maisons à deux ou trois étages, toutes en bois, au toit de tuiles, imbriquées les unes dans les autres. Gen lui dit que c’était le style chinois traditionnel. Elles descendaient si près du rivage que certaines avaient les pieds dans l’eau. Toute l’extrémité de la péninsule était couverte d’une masse compacte de bâtiments, quadrillée par des rues menant d’est en ouest, de la baie vers l’océan, et du nord au sud, donnant sur des parcs et des jardins qui surplombaient la Porte d’Or. Un épais brouillard avait envahi le détroit, masquant les eaux limoneuses. Elles se déversaient si loin dans la baie qu’on ne voyait nulle part le bleu de la mer. Sur la péninsule, de longues batteries côtières tournées vers l’océan assuraient la défense de la ville. Ces forteresses de béton, disait Gen, permettaient de contrôler le détroit, à l’intérieur comme à l’extérieur, sur plus d’une cinquantaine de lis.
Gen s’assit sur l’un des murets du front de mer donnant sur le détroit. Il fit un geste de la main vers le nord, où les rues et les toits s’étendaient à perte de vue.
— Le plus grand port de la Terre. La plus grande ville du monde, disent certains.
— Elle est grande, c’est sûr. Je ne savais pas qu’elle serait si…
— Un million de gens vivent ici, paraît-il. Et il en arrive tous les jours. Ils n’arrêtent pas de construire, au nord de la péninsule.
De l’autre côté du détroit, en revanche, le sud de la péninsule n’était que fange, marécages et collines abruptes et pelées.
— Par rapport à l’agitation de la ville, on se croirait dans le désert, ne put s’empêcher de remarquer Kiyoaki.
— Oui, reconnut Gen avec un frisson. Je suppose que c’est parce qu’il y a trop de marécages, et que le terrain est trop escarpé pour qu’on puisse y faire des rues. Probablement qu’ils s’y mettront un jour. Mais pour le moment, c’est mieux ici.
Les îles ponctuant la baie étaient réservées aux domaines des fonctionnaires impériaux. Le toit couvert d’or de la demeure du gouverneur se dressait au sommet de la plus grande de ces îles. À la surface de l’eau marron, teintée d’écume, flottaient de nombreux petits bateaux. À voile, pour la plupart, mais quelques-uns arboraient fièrement leurs deux cheminées, crachant un long panache de fumée. Des petites marinas, avec des hangars à bateaux carrés, se voyaient çà et là dans les îles. Kiyoaki regardait ce beau paysage, émerveillé.
— Peut-être qu’un jour j’irai m’installer là-bas. On doit pouvoir y trouver du travail.
— Et comment ! Plus bas, au port, il y a beaucoup de travail. On manque de bras pour décharger les bateaux. Tu n’auras qu’à prendre une chambre à la maison d’hôtes. Tu pourrais même travailler à la boutique de fournitures pour bateaux.
Kiyoaki se remémora la scène qui l’avait réveillé.
— Pourquoi cet homme était-il si en colère ?
— Ce n’était vraiment pas de chance, dit Gen en fronçant les sourcils. Tagomi-san est quelqu’un de bien. D’habitude, il ne frappe jamais ses aides, je t’assure. Mais il était énervé. Il n’y a pas moyen de décider les autorités à piocher dans les réserves de riz pour nourrir les gens coincés dans la vallée. Le marchand a beaucoup d’influence dans la communauté japonaise, ici, et cela fait des mois qu’il essaie. Il pense que les bureaucrates, là-bas, dans ces îles (il fit un geste), espèrent que les gens vont crever de faim.
— Mais c’est de la folie ! La plupart sont des Chinois !
— Oui, c’est sûr, il y a beaucoup de Chinois, mais il y a sûrement encore plus de Japonais.
— Comment ça ?
— Tu sais, nous sommes beaucoup plus nombreux dans la vallée centrale que les Chinois, dit Gen en le regardant. Réfléchis. Ce n’est peut-être pas évident, parce que seuls les Chinois ont le droit de posséder la terre, et donc de diriger les rizières, notamment celles d’où tu viens, plus à l’est. Mais en haut de la vallée, et en bas, bref aux extrémités, ce sont surtout des Japonais, et sur les contreforts, le long de la ligne de côte, il y en a encore plus. Nous sommes arrivés ici les premiers, tu comprends ? Maintenant, avec cette gigantesque inondation, les gens sont chassés par la faim, et par les eaux. Les bureaucrates se disent que quand tout sera fini, et que l’eau se retirera – si cela arrive un jour –, si la plupart des autochtones, et des Japonais, sont morts de faim, rien n’empêchera de les remplacer par de nouveaux immigrants. Et ce seront tous des Chinois.
Kiyoaki restait bouche bée, interdit.
Gen le dévisagea curieusement. Il semblait apprécier ce qu’il voyait.
— Alors, voilà : Tagomi a essayé d’organiser un système d’aide privé, chargé d’apporter de la nourriture aux gens de l’intérieur des terres. C’est ce que nous faisions quand nous vous avons trouvés. Mais ce n’est pas facile, et cela coûte très cher. Cela met le vieux en rogne. Et ses malheureux ouvriers en font les frais !
Gen se mit à rire.
— Pourtant, vous avez sauvé ces Chinois, réfugiés dans les arbres…
— Oui, oui. Notre boulot. Notre devoir. Faire le bien ne peut pas faire de mal, hein ? C’est ce que dit toujours la vieille femme de la maison d’hôtes. Et bien sûr, elle passe son temps à se faire avoir.
Ils regardèrent une langue de brouillard s’allonger dans le détroit. Les nuages de pluie, à l’horizon, ressemblaient à une gigantesque Flotte des trésors. Un immense pinceau de pluie avait déjà commencé à noircir les parties désertes de la péninsule sud.
Gen lui donna une tape amicale sur l’épaule.
— Allons, viens, j’ai encore quelques courses à faire pour elle…
Il conduisit Kiyoaki à une station de tramways, où ils prirent le premier en partance pour la partie ouest de la ville. Ils montèrent des rues, en descendirent d’autres, traversèrent quelques quartiers d’habitations sordides, puis un quartier de bâtiments du gouvernement, situé en haut des pentes d’où l’on voyait l’océan mousser sous la pluie, passèrent le long de vastes esplanades bordées de cerisiers, puis devant une autre forteresse.
— Ses canons protègent les collines au nord, dont les quartiers abritent certaines des plus belles propriétés de la ville, dit Gen.
Ils purent en admirer quelques-unes, que le tramway salua d’un coup de sifflet. Arrivés en haut des rues vertigineuses, ils purent voir les temples au sommet du mont Tamalpi. Puis ils redescendirent dans la vallée, où ils changèrent de tramway, pour franchir la péninsule et repartir vers Japantown, les bras chargés de provisions pour la propriétaire de la maison d’hôtes.
Kiyoaki alla voir dans l’aile des femmes si Peng-ti et son bébé allaient bien. Il la trouva assise dans l’embrasure d’une fenêtre, le bébé dans les bras, l’air morne et désolée. Elle n’était pas allée voir auprès des autorités chinoises si par hasard des parents à elle se trouvaient ici, ne leur avait pas demandé d’aide non plus – de toute façon, il semblait ne pas falloir en attendre grand-chose. En fait, tout paraissait lui être égal. Elle restait avec les Japonais, comme si elle se cachait. Mais elle ne parlait pas un mot de japonais, alors qu’ici ils ne parlaient que ça ; et elle ne comprenait rien de ce qu’ils disaient, sauf quand l’un d’eux avait l’idée de s’adresser à elle directement en chinois.
— Viens avec moi, lui dit-il en chinois. Gen m’a donné un peu d’argent pour le tramway. On pourrait aller voir la Porte d’Or.
Elle commença par hésiter, puis accepta. Kiyoaki lui expliqua comment prendre le tramway, ce qu’il venait de découvrir, et ils descendirent se promener dans le parc d’où l’on avait une vue plongeante sur le détroit. Le brouillard s’était presque entièrement dissipé, et le prochain front de nuages orageux n’était pas encore arrivé. La ville et la baie formaient un spectacle extraordinaire, éblouissant, au sens propre du terme. Le flot d’eau marron, charriant des débris et des barbes d’écume, continuait à se déverser dans la mer à une vitesse impressionnante.
— S’il y a tellement de courant, commenta Kiyoaki, c’est peut-être à cause du reflux.
Peng-ti hocha gravement la tête, l’écoutant. Toutes les rizières de la vallée centrale semblaient avoir été broyées et transportées, morceau par morceau, jusque dans l’océan. À l’intérieur des terres, tout serait à reconstruire. Kiyoaki dit quelque chose à ce sujet, et une lueur de colère s’alluma dans les yeux de Peng-ti et s’éteignit rapidement.
— Tant mieux, dit-elle. Je ne veux plus jamais y retourner.
Kiyoaki la regarda, surpris. Elle ne devait pas avoir plus de seize ans. Où étaient ses parents, sa famille ? Elle n’en parlait pas, et il était trop bien élevé pour oser l’interroger.
Alors ils regardèrent en silence le spectacle de la baie, brillant dans la pâle lueur du soleil. Le bébé se mit à geindre, et Peng-ti lui donna discrètement le sein. Kiyoaki regarda son visage, puis les eaux se ruer dans l’océan. Il pensait aux Chinois, à leur impitoyable bureaucratie, à leurs immenses villes, à leur mainmise sur le Japon, la Corée, Mindanao, l’Aozhou, le Yingzhou, l’Inka…
— Comment s’appelle ton bébé ? demanda-t-il.
— Hu Die, répondit la jeune fille. Cela veut dire…
— Papillon, dit Kiyoaki en japonais. Je sais.
Il imita avec les mains le vol d’un papillon, et la jeune fille sourit, et approuva.
Puis des nuages passèrent devant le soleil et, une légère brise s’étant mise à souffler, il commença à faire frais. Ils reprirent le tramway et rentrèrent à Japantown.
À la maison d’hôtes, Peng-ti se rendit dans l’aile des femmes. Comme il n’y avait encore personne dans celle des hommes, Kiyoaki se rendit au magasin de fournitures pour bateaux, pensant y demander du travail. Au rez-de-chaussée, la boutique était déserte, mais peut-être y avait-il quelqu’un à l’étage, où se trouvaient les bureaux des comptables et des employés. Il monta l’escalier.
La lourde porte du maître des lieux était close, mais des voix résonnaient de l’autre côté. Kiyoaki s’approcha, entendant des hommes parler japonais :
— … ne vois pas comment nous pourrions coordonner nos efforts et nous assurer que tout partira bien en une seule fois…
La porte s’ouvrit brutalement. Kiyoaki fut attrapé par la peau du cou et happé à l’intérieur du bureau. Huit ou neuf Japonais le considéraient gravement, entourant un vieil étranger au crâne chauve, assis sur la chaise réservée aux hôtes de marque. Le propriétaire du magasin rugit :
— Qui l’a laissé entrer ?
— Il n’y avait personne en bas, dit Kiyoaki. Je cherchais seulement quelqu’un pour demander du…
— Depuis combien de temps nous écoutais-tu ?
Le vieil homme était tellement furieux que Kiyoaki se demanda s’il n’allait pas lui taper sur la tête avec son boulier, ou pire.
— Comment oses-tu nous espionner ! Nous pourrions te jeter dans la baie, avec des pierres attachées aux pieds !
— Ce n’est que l’un de ceux que nous avons récupérés dans la vallée, dit Gen depuis un coin de la pièce. Il se trouve que je le connais un peu. Puisqu’il est là, autant l’enrôler. J’ai déjà procédé à son évaluation. En fait, il n’a pas mieux à faire. Je dirais même qu’il sera bon.
Alors que le vieil homme crachotait une objection, Gen se leva et empoigna Kiyoaki par la chemise.
— Que quelqu’un aille fermer la porte du magasin, dit-il à l’un des jeunes hommes, qui partit en courant.
Puis il se tourna vers Kiyoaki.
— Écoute-moi bien, mon garçon. Comme je te l’ai dit hier, nous essayons d’aider les Japonais.
— Bravo.
— En fait, nous travaillons à la libération du peuple japonais. Pas seulement ici, mais également au Japon.
Kiyoaki déglutit, et Gen le secoua.
— Eh oui ! Le Japon proprement dit ! Une guerre d’indépendance pour notre vieux pays, et pour ici. Tu peux travailler avec nous, et t’associer à l’une des plus belles choses que puisse faire un Japonais. Alors, c’est oui ou c’est non ?
— C’est oui ! lâcha Kiyoaki. C’est oui, bien sûr ! Dites simplement ce que je dois faire !
— Commence par t’asseoir et te taire, lança Gen. Ensuite, écoute, on t’en dira plus.
Le vieil étranger posa une question dans sa propre langue.
Un autre fit un geste en direction de Kiyoaki, et répondit dans la même langue. Puis il dit à Kiyoaki, en japonais :
— Je te présente le docteur Ismail, de Travancore, la capitale de la Ligue indienne. Il est venu nous aider à organiser la résistance contre les Chinois. Si tu veux assister à cette réunion, tu dois jurer que tu ne répéteras à personne ce que tu entendras ou verras. Cela veut dire que tu t’engages à servir la cause, et qu’il n’y a pas de retour en arrière. Si jamais nous apprenons que tu as parlé à quelqu’un, nous te tuerons. Tu as bien compris ?
— J’ai compris, répondit Kiyoaki. Je suis avec vous, je vous l’ai dit. Vous pouvez continuer sans crainte, je ne dirai rien. J’ai travaillé pour les Chinois dans la vallée, j’ai été leur esclave, toute ma vie.
Tous, dans la pièce, le regardèrent. Seul Gen eut une grimace en entendant ce si jeune homme dire « toute ma vie ». Kiyoaki s’en aperçut, et rougit vivement. Mais, quel que fût son âge, c’était pourtant la vérité. Il ferma la bouche et s’assit par terre, dans un coin de la pièce, près de la porte.
Les hommes recommencèrent à discuter. Ils posaient des questions à l’étranger, qui les regardait en tortillant sa fine moustache blanche. Il avait le regard à la fois intense et inexpressif d’un oiseau. Enfin, l’homme chargé de traduire leurs paroles se tourna vers lui et se mit à parler dans un langage fluide, qui semblait ne pas comporter assez de sons pour rendre tous les mots ; mais le vieil étranger le comprit fort bien, et répondit à chaque question, de façon complète et précise, s’interrompant à la fin de chaque phrase pour laisser à l’interprète japonais le temps de traduire sa réponse. Apparemment, il avait l’habitude de travailler avec un traducteur.
— Il dit que son pays a connu le joug des Moghols pendant plusieurs siècles, avant de se libérer, grâce à une campagne militaire menée par leur Kerala. Leurs méthodes ont été systématisées, et peuvent être enseignées. Le Kerala lui-même a été assassiné, il y a une vingtaine d’années. Le docteur Ismail dit que ce fut un désastre indescriptible. D’ailleurs, comme vous pouvez le constater, cette évocation le bouleverse encore. Mais le seul remède est de continuer, et d’accomplir la volonté du Kerala. Et il voulait que, partout dans le monde, les hommes brisent les chaînes de l’impérialisme. Ainsi, même Travancore fait maintenant partie d’une Ligue indienne, qui n’est pas sans connaître des problèmes, parfois violents, mais globalement, malgré leurs différends, tous ses membres s’y considèrent comme égaux. Il dit que ce genre de ligue a d’abord vu le jour ici, au Yingzhou, plus à l’est, chez les Hodenosaunees. Les Franjs se sont installés sur la plupart des côtes est du Yingzhou, comme nous l’avons fait à l’ouest, et beaucoup des grands anciens qui y vivaient autrefois sont morts de maladies, comme ceux d’ici, mais les Hodenosaunees occupent toujours la majeure partie des terres autour des grands lacs, et les Travancoriens les ont aidés dans leur combat contre les musulmans. Il dit que c’est la clé du succès. Ceux qui luttent contre l’impérialisme doivent s’entraider. Il dit qu’ils ont aussi aidé quelques pays d’Afrique, plus au sud, et notamment un certain roi Moshesh, de la tribu des Basuthos. Le docteur est allé là-bas, et, grâce à lui, les Basuthos ont pu vaincre les esclavagistes musulmans, ainsi que les Zoulous. Sans son aide, les Basuthos n’auraient probablement pas survécu.
— Demande-lui ce qu’il entend par « aide ».
Le docteur étranger accueillit la question avec un hochement de tête, et commença à le lui expliquer, en énumérant chaque élément de sa réponse sur ses doigts.
— Il dit qu’ils commencent par enseigner ce que leur Kerala a élaboré, et qui permet d’organiser un réseau de résistants armés, capables d’affronter des armées plus importantes. Ensuite, ils peuvent, dans certaines occasions, fournir des armes. Ils pourraient nous en faire passer en contrebande, s’ils pensent que nous en valons la peine. Enfin, troisième point, rare mais possible, ils peuvent prendre une part active au combat, s’ils pensent que l’issue de la bataille en sera changée.
— Ils se battent déjà contre les musulmans, tout comme les Chinois. Pourquoi nous aideraient-ils ?
— Il dit que c’est une excellente question. C’est pour garder un certain équilibre, et pour que les deux grands empires continuent de s’affronter. Les Chinois et les musulmans se combattent partout, même en Chine, où se trouvent quelques rebelles musulmans. Mais pour le moment, les musulmans de Franji et d’Asie sont faibles, et divisés, en lutte les uns contre les autres, comme ici, au Yingzhou. Pendant ce temps, les Chinois continuent de s’engraisser sur le dos de leurs colonies, ici comme tout autour du Dahai. La bureaucratie Qing a beau être corrompue et inefficace, leurs usines tournent toujours à plein régime, et l’or continue d’affluer, d’ici, ou d’Inka. Alors, quel que soit leur degré d’inefficacité, ils continueront de s’enrichir. C’est pour cette raison, dit-il, que les Travancoriens cherchent à empêcher la Chine de devenir tellement puissante qu’elle finirait par dominer le monde entier.
— Personne n’est assez puissant pour s’emparer tout seul du monde, gronda l’un des Japonais. Il est bien trop grand.
L’étranger demanda ce qui venait d’être dit, ce dont l’informa l’interprète. Le docteur Ismail leva alors un doigt, et répondit.
— Il dit, reprit l’interprète, que c’était peut-être vrai autrefois, mais que maintenant, grâce aux bateaux à vapeur, aux communications par ki, aux échanges, notamment commerciaux, transocéaniques, et aux machines capables de fournir plusieurs milliers de chameaux-vapeur de puissance, il n’est pas impossible qu’un pays dominant puisse prendre l’avantage, et continuer à grandir. C’est une question de… enfin, comment dire ? De puissance démultipliant la puissance. De telle sorte qu’il est dans l’intérêt de tous d’empêcher un pays, quel qu’il soit, de devenir assez puissant pour initier ce genre de processus. Il dit que, pendant un certain temps, on a d’abord cru que c’était l’islam qui allait finir par dominer le monde, avant que leur Kerala ne frappe au cœur les vieux empires musulmans, et ne les brise. Apparemment, la Chine aurait besoin d’un traitement similaire, et alors, il n’y aurait plus d’empires, les gens seraient libres et formeraient des ligues avec quiconque les aiderait.
— Mais comment ferons-nous pour rester en contact avec eux, de l’autre côté du monde ?
— Il reconnaît que ce n’est pas facile. Mais les navires à vapeur sont rapides. Cela peut se faire. Ils l’ont fait en Afrique, et en Inka. Des liaisons ki peuvent être établies rapidement entre les groupes.
Ils continuèrent, les questions devenant de plus en plus pratiques et détaillées. Kiyoaki n’y comprenait pas grand-chose. Les villes dont ils parlaient ne lui disaient rien : Basutho, Nsara, Séminole, etc. Finalement, le docteur Ismail sembla fatigué, et ils terminèrent la réunion en prenant le thé. Kiyoaki aida Gen à remplir les tasses et à les faire passer, puis Gen ramena Kiyoaki au rez-de-chaussée, et rouvrit la porte du magasin.
— Tu as failli nous attirer des ennuis, lui dit-il. Il va falloir que tu travailles dur, pour te faire pardonner de m’avoir causé une telle frayeur !
— Pardon. Vous pouvez compter sur moi. Merci pour votre aide.
— Oh là, ça devient dangereux ! Surtout pas de merci. Fais ton travail, et je ferai le mien.
— Très bien.
— Maintenant, le vieux voudra certainement que tu l’aides au magasin. Tu pourras vivre à côté. Il te tapera dessus avec son boulier, comme tu l’as vu faire. Mais ton principal travail consistera à nous servir de messager. Si jamais les Chinois apprennent ce que nous faisons, cela ira très mal, je te préviens. C’est la guerre, tu comprends ? C’est peut-être une guerre secrète, qui se fait la nuit, dans les rues, dans les ports, mais ce n’en est pas moins une guerre. Tu comprends ?
— Je comprends.
Gen riva son regard au sien.
— Enfin, on verra. D’abord, on va retourner dans la vallée. J’ai des amis là-bas, je veux qu’ils sachent ce qui est en train de se passer. Puis on reviendra ici, pour travailler.
— Tout ce que vous voudrez.
Un aide fit faire le tour du magasin à Kiyoaki, qui devait bientôt le connaître dans les moindres recoins. Ensuite, il put retourner à la maison d’hôtes. Peng-ti était en train d’aider la vieille dame à couper des légumes ; Hu Die reposait au soleil, dans une corbeille à linge. Kiyoaki s’assit à côté du bébé, jouant d’un doigt avec lui, tout en repensant à sa journée. Il regarda Peng-ti apprendre les noms japonais des légumes. Elle non plus n’avait pas envie de repartir vers la vallée. La vieille femme parlait assez bien le chinois, et les deux femmes discutaient. Mais, même à elle, Peng-ti ne disait pas plus de choses sur son passé qu’elle n’en avait révélé à Kiyoaki. Il faisait si chaud dans la cuisine que l’air en était presque irrespirable. Il se remit à pleuvoir. Le bébé lui fit un sourire, comme pour le rassurer. Comme pour lui dire que tout irait bien.
Puis ils retournèrent se promener dans le parc de la Porte d’Or, et ils s’assirent sur un banc pour regarder les eaux marron se perdre dans la mer. Kiyoaki prit la main de Peng-ti et lui dit :
— Écoute, je vais m’installer ici. Je repartirai juste une fois dans la vallée, pour rapporter à madame Yao ses vers à soie. Mais je reviendrai vivre ici.
Elle l’écoutait attentivement.
— Moi aussi, lui dit-elle. D’ailleurs, comment quitter un tel endroit ? ajouta-t-elle en lui montrant la baie.
Elle prit Hu Die, sa petite fille, et la leva à bout de bras, de façon à lui faire admirer le panorama, puis la présenta à chacun des quatre vents.
— C’est ton nouveau chez-toi, Hu Die ! C’est là que tu vas grandir !
Hu Die roula de gros yeux ronds en admirant la vue.
Kiyoaki éclata de rire.
— Oui. Elle va se plaire ici. Mais écoute, Peng-ti, je vais entrer dans la…
Il cherchait une façon de le lui dire.
— Je vais faire quelque chose pour le Japon. Tu comprends ?
— Non.
— Je vais entrer dans la résistance. Lutter contre la Chine.
— Je vois.
— Je vais me battre contre la Chine.
Elle serra les dents. Puis elle lâcha, brusquement :
— Qu’est-ce que ça peut me faire ?
Son regard se perdit par-delà la baie, vers la Porte Intérieure, où des vagues brunes frappaient les collines vertes.
— Je suis si heureuse d’être ici.
Elle le regarda dans les yeux, et il sentit son cœur bondir.
— Je suis avec toi, lui dit-elle.
4. L’orage approche
Le nouvel empire chinois était principalement maritime, sa flotte étant redevenue la première du monde. L’accent avait été mis sur les capacités de transport ; ce qui expliquait pourquoi les bâtiments chinois caractéristiques des débuts de la période moderne étaient très gros, et très lents. La vitesse n’était pas la priorité. Ce qui devait leur poser des problèmes par la suite, lors des combats navals avec les Indiens et les musulmans d’Afrique, de la Méditerranée et de Franji. Dans la Méditerranée, la mer d’Islam, les musulmans construisirent des bateaux plus petits mais beaucoup plus rapides et plus maniables que leurs contemporains chinois. Si bien que, lors de plusieurs combats navals décisifs des dixième et onzième siècles, les flottes musulmanes défirent des flottes chinoises beaucoup plus importantes, préservant l’équilibre du pouvoir et empêchant la Chine des Qing de parvenir à l’hégémonie mondiale. De fait, la guerre de course musulmane dans le Dahai constitua l’une des principales sources de revenus des gouvernements islamiques, ce qui fut à l’origine de nombreuses frictions entre l’islam et la Chine, et finalement l’un des nombreux facteurs qui menèrent à la guerre. La mer surpassant, et de loin, la terre en tant que zone d’échanges commerciaux et militaires, la vitesse et la maniabilité supérieures des bâtiments musulmans devinrent l’un des atouts qui leur permirent de disputer la suprématie maritime aux Chinois.
La vapeur et les coques d’acier qui avaient été mises au point à Travancore furent vite reprises par les deux autres principales puissances du Vieux Monde, mais la suprématie de la Ligue indienne dans ce domaine lui permit de tenir tête à ses principaux rivaux des deux côtés de l’océan.
C’est ainsi qu’aux douzième et treizième siècles, selon le calendrier islamique, c’est-à-dire durant la dynastie Qing en Chine, les trois principales cultures du Vieux Monde se livrèrent une compétition croissante pour s’accaparer les richesses du Nouveau Monde, d’Aozhou et du Vieux Monde, maintenant pleinement occupés et exploités.
Le problème était que l’enjeu était devenu trop important. Les deux plus grands empires étaient à la fois les plus forts et les plus faibles. La dynastie Qing continuait d’étendre sa domination, au sud, au nord, dans le Nouveau Monde et en Chine même. Pendant ce temps, l’islam contrôlait une très importante partie du Vieux Monde, et les côtes est du Nouveau Monde. La côte orientale du Yingzhou était occupée par les musulmans, le centre par la Ligue des Tribus, et l’ouest par des colonies chinoises et de nouveaux ports de commerce travancoriens. L’Inka était un champ de bataille entre les Chinois, les Travancoriens et les musulmans d’Afrique de l’Ouest.
C’est ainsi que le monde était divisé entre les deux grandes puissances vieillissantes, la Chine et l’islam, et les deux nouvelles, plus petites, la Ligue de l’Inde et celle du Yingzhou. Par leur politique commerciale et de conquête maritime, les Chinois étendirent lentement leur hégémonie sur le Dahai, colonisant l’Aozhou, les côtes ouest du Yingzhou et d’Inka, et faisant des incursions par voie maritime dans de nombreux autres endroits. L’Empire du Milieu, puisque tel était son nom, devint, de fait, le centre du monde par le nombre aussi bien que par sa puissance maritime. Il représentait à vrai dire un danger pour tous les autres peuples de la Terre, malgré les différents problèmes que connaissait l’administration Qing.
Au même moment, le Dar al-Islam poursuivait son expansion dans toute l’Afrique, sur les côtes orientales du Nouveau Monde, en Asie centrale, aux frontières de l’Inde, qu’il n’avait jamais vraiment quittées, en Asie du Sud-Est, et même jusqu’aux côtes occidentales, isolées, d’Aozhou.
Au milieu de tout ça, prise en tenaille, si l’on peut dire, se trouvait l’Inde. Travancore en était la principale force politique, mais le Panjab, le Bengale, le Rajahstan et tous les autres États du sous-continent étaient prospères et grouillaient d’activités, hors de leurs frontières comme chez eux, pris dans la tourmente et les conflits, toujours en bisbille avec leurs voisins et malgré tout à l’abri des empereurs et des califes. Dans ce bouillonnement, ils étaient à la pointe de la recherche scientifique mondiale, avec des comptoirs commerciaux sur tous les continents, en lutte perpétuelle contre toutes les hégémonies, les alliés de tous contre l’islam, et souvent contre les Chinois, avec qui ils entretenaient des relations difficiles, faites de crainte mêlée de nécessité. Mais alors que les décennies passaient et que les vieux empires musulmans se montraient de plus en plus agressifs dans l’Est, d’un bout à l’autre de la Transoxianie et dans tout le nord de l’Asie, un nombre sans cesse croissant de pays étaient disposés à pactiser avec la Chine, pour faire contrepoids, comptant sur l’Himalaya et les jungles impénétrables de Birmanie pour ne pas se retrouver à la merci du grand parapluie chinois.
C’est pour cette raison que, bon gré mal gré, les États indiens s’alliaient souvent avec la Chine dans l’espoir de trouver de l’aide auprès d’elle contre leur vieil ennemi, l’islam. Et pour cela également que, la guerre entre l’islam et la Chine étant finalement entrée dans une phase active, d’abord en Asie centrale, puis dans le monde entier, Travancore et la Ligue indienne furent attirées dans la tourmente, et que l’affrontement entre musulmans et Hindous prit un nouveau tournant, mortel.
Pendant la vingt et unième année du règne de l’empereur Kuang Hsu, le dernier de la dynastie Qing, les enclaves musulmanes de Chine du Sud se révoltèrent toutes en même temps. Les bannières mandchoues furent envoyées vers le sud, et la rébellion plus ou moins écrasée, au cours des nombreuses années qui suivirent. Mais la répression avait peut-être été trop efficace : les musulmans de l’ouest de la Chine ayant tellement souffert de la longue dictature militaire des Qing, et leurs frères croyants de l’est ayant été exterminés, c’était maintenant le jihad ou la mort. Ils se révoltèrent, dans les vastes déserts vides et les montagnes d’Asie centrale, et, de brunes, les villes de leurs vertes vallées devinrent rapidement rouges.
Le gouvernement Qing, corrompu mais inamovible, et à l’abri de ses richesses, fit mouvement contre les rébellions musulmanes en initiant une autre campagne de conquête, vers l’ouest, à travers l’Asie. Cela marcha un moment, faute d’État suffisamment puissant dans le centre désolé du monde pour s’opposer à lui. Mais un jihad défensif des musulmans d’Asie de l’Ouest, que rien alors n’aurait pu unir, sauf cette menace d’invasion chinoise, finit par éclater.
Cette alliance imprévue de l’islam fut une sacrée réussite. Les guerres entre les vestiges des empires safavides et ottomans, entre les chiites et les sunnites, les soufis et les wahhabites, les états franjs et le Maghreb, n’avaient pas cessé pendant la période de consolidation des États et des frontières. Et bien que les frontières soient souveraines et plus ou moins fixées, en dehors des combats permanents çà et là, l’islam n’était pas en position, au départ, de répondre d’une seule voix à la menace de la Chine.
Mais, se sentant menacés par l’expansion chinoise à travers toute l’Asie, les États islamiques divisés unirent leurs forces et commencèrent à riposter à l’unisson. Une collision qui se préparait depuis des siècles se produisit : pour chacune des deux grandes civilisations anciennes, l’hégémonie globale ou l’annihilation complète étaient encore des possibilités envisageables. Les enjeux ne pouvaient être plus importants.
La Ligue indienne essaya d’abord de rester neutre, de même que les Hodenosaunees. Mais la guerre les entraîna aussi dans son tourbillon quand les envahisseurs islamiques franchirent la frontière du nord de l’Inde, comme ils l’avaient fait si souvent auparavant, et descendirent vers le sud du Deccan, à travers le Bengale, et jusqu’en Birmanie. De la même façon, les armées musulmanes entreprirent la conquête du Yingzhou, d’est en ouest, attaquant la Ligue hodenosaunee et les Chinois à l’ouest. Le monde entier sombrait dans ce royaume de conflit total.
Et c’est ainsi que commença la Longue Guerre.
LIVRE 8
LA GUERRE DES ASURAS
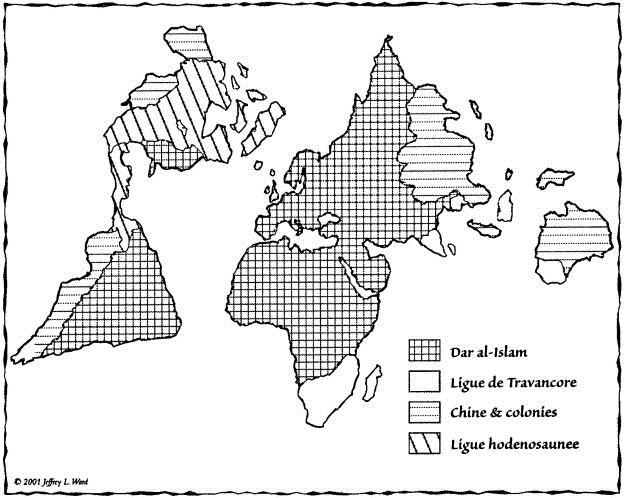
— La Chine est indestructible, nous sommes bien trop nombreux. Le feu, les inondations, la famine, la guerre ne font qu’élaguer l’arbre. Les branches tombées stimulent la vie. L’arbre continue de croître.
Le commandant Kuo se sentait en verve. C’était l’aube, l’heure de la Chine. La lumière matinale illuminait les avant-postes musulmans, qui avaient le soleil dans les yeux, ce qui leur faisait craindre les tireurs embusqués, et les empêchait de viser eux-mêmes. Le crépuscule était l’heure de l’islam. L’appel à la prière, les coups de fusil, parfois une pluie d’obus. Mieux valait rester dans les tranchées quand le soleil se couchait, ou dans les abris souterrains.
Mais là, le soleil était de leur côté. Ciel d’un bleu glacial, mains gantées frottées l’une contre l’autre pour se réchauffer, thé, cigarettes, le grondement d’un canon dans le lointain, plus au nord. Cela faisait deux semaines qu’ils les canardaient. Probablement un tir d’artillerie en vue d’un nouvel assaut ; peut-être l’attaque dont on parlait depuis des années – tellement d’années en fait que c’était devenu le terme signifiant que cela n’arriverait jamais. « Quand nous donnerons l’assaut », ou « quand les poules auront des dents », c’était la même chose. À moins que.
Rien de ce qu’ils voyaient ne leur permettait de se prononcer à ce sujet. Dehors, au beau milieu du corridor de Gansu, les vastes montagnes au sud et les immenses déserts au nord restaient invisibles. On se serait cru dans les steppes, en tout cas autrefois, avant la guerre. À présent, sur toute sa largeur, des montagnes jusqu’au désert, et sur toute sa longueur, de Ningxia jusqu’à Jiayuguan, le corridor était transformé en boue. Les tranchées avaient avancé, reculé, li après li, pendant à peu près soixante ans. Et tout ce temps, il n’était pas un brin d’herbe, pas un grain de poussière qui n’ait été bombardé, plus d’une fois. Ne restait plus qu’une sorte de mer immonde et noire, parsemée de crêtes, de failles et de cratères. Comme si l’on avait essayé de reproduire sur Terre la surface de la Lune. Chaque printemps, l’herbe s’escrimait à pousser, en vain. La ville de Ganzhou s’était jadis élevée en cet endroit précis, le long du fleuve Jo ; maintenant, il n’y avait plus signe ni de l’un ni de l’autre. La terre avait été pulvérisée jusqu’à la pierre. Ganzhou avait été autrefois le berceau d’une florissante culture sino-musulmane, de telle sorte qu’en observant ce morceau de terre dévastée, si morne dans la lumière de l’aube, c’était un peu de la géologie de cette guerre qu’on voyait.
Les énormes canons grondèrent derrière eux. Les obus des canons les plus récents partaient jusque dans l’espace, et atterrissaient deux cents lis plus loin. Le soleil montait toujours dans le ciel. Ils se retirèrent alors dans ce royaume souterrain, fait de boue noire et de planches humides, qui était leur maison. Tranchées, galeries, grottes. Dans de nombreuses grottes il y avait des niches, avec des bouddhas à l’allure inflexible, main tendue vers l’avant comme un policier réglant la circulation. Le sol des tranchées inférieures était inondé, à cause des pluies torrentielles de la nuit.
Plus bas, dans la grotte des transmissions, l’opérateur du télégraphe avait reçu des ordres. L’attaque générale commencerait dans deux jours. On monterait à l’assaut sur tout le long du corridor. Il fallait tenter de se sortir de cette impasse, se dit Iwa. Faire sauter le bouchon ! Par-delà les steppes et droit vers l’ouest, à l’assaut ! Bien sûr, être à la tête de cet assaut était le pire endroit où se trouver, pensa-t-il. Mais c’était une remarque purement académique. De toute façon, une fois au front, il ne voyait pas comment les choses auraient pu empirer. C’était vraiment une question de pure forme, puisqu’en Enfer ils y étaient déjà, et que morts, ils l’étaient aussi. Alors ! D’ailleurs, à chaque fois qu’ils portaient un toast, entrechoquant leurs verres de rakshi, le commandant Kuo le leur rappelait :
— Nous sommes tous des cadavres ! Levons nos verres en l’honneur du Seigneur Mourir-à-Petit-Feu !
Aussi Baï et Kuo se contentèrent-ils de hocher la tête : au pire endroit, c’était toujours là qu’on les envoyait. Ils y avaient déjà passé cinq ans, ou, d’une façon plus générale, leur vie tout entière. Prenant une dernière gorgée de thé, Iwa dit :
— Cela ne peut être qu’intéressant, c’est forcé.
Il aimait lire les télégrammes et les journaux, pour essayer d’imaginer ce qui allait se passer.
— Regardez ça, disait-il en brandissant un journal, alors que tous essayaient de dormir. Les musulmans ont été chassés du Yingzhou. Au terme d’une campagne de vingt ans !
Ou bien :
— Bataille navale géante ! Deux cents navires coulés ! Dont seulement vingt des nôtres, même si les nôtres sont plus gros, il faut le reconnaître. Dans le Dahai Nord, l’eau est à zéro degré ! Brrrr ! Je suis bien content de ne pas être un marin !
Il prenait des notes et traçait des cartes. Il étudiait la guerre. Quand les communications sans fil apparurent, il fut enchanté. Il passait des heures dans la salle des transmissions, à dialoguer avec d’autres enthousiastes aux quatre coins du monde.
— Perturbations importantes dans la kisphère ce soir, m’a dit un type d’Afrique du Sud. Ouaip, mauvaise nouvelle.
Il retoucha l’une de ses cartes.
— Il dit que les musulmans ont repris le Sahel et ont enrôlé de force tous les habitants d’Afrique de l’Ouest, pour en faire des soldats esclaves.
Pour lui, les voix qui sortaient du récepteur n’étaient pas toujours fiables, bien sûr, mais ne l’étaient ni plus ni moins que les communiqués officiels des quartiers généraux, qui tenaient plus de la propagande, ou du mensonge – pour tromper les espions adverses.
— Écoutez-moi ça, s’égosillait-il tout en lisant allongé sur sa couchette. Il paraît qu’ils sont en train de réunir tous les juifs, les Zott, les chrétiens et les Arméniens pour les tuer. Qu’ils font des expériences médicales sur eux… qu’ils remplacent leur sang par du sang de mule pour voir combien de temps ils survivent… Mais qui peut croire une chose pareille ?
— C’est peut-être vrai, suggéra Kuo. Tuons les indésirables, ceux qui pourraient nous trahir quand nous sommes au front…
— Pour moi, c’est peu probable. Pourquoi se donneraient-ils tant de mal… dit-il en chiffonnant le journal.
Mais, à présent, il se tenait face au sans-fil, tournant les boutons pour essayer d’en apprendre un peu plus sur le prochain assaut. Cela dit, nul n’avait besoin d’avoir étudié les guerres pour savoir ce qu’un assaut signifiait. Ils avaient déjà participé à tous les précédents, et la perspective d’en mener un autre leur sapa le moral pour la journée. En trois ans, le front n’avait bougé que de trois lis, et encore, vers l’est ! Les musulmans avaient dû se battre trois ramadans de suite. Chaque année de campagne leur avait coûté excessivement cher, plusieurs millions de soldats, avait calculé Iwa. C’est pourquoi le gros de leurs troupes était à présent essentiellement composé d’enfants et de femmes, comme chez les Chinois. Il y avait eu tellement de morts que ceux qui avaient survécu aux trois dernières années étaient un peu comme les Huit Immortels, ils vivaient au jour le jour, dans une sorte de transe, coupés d’un monde dont ils n’avaient que des échos, ou qu’ils auraient regardé par le mauvais bout de la lorgnette. Boire leur thé dans une tasse était à présent leur seul luxe. Nouvel assaut général, hordes humaines progressant vers l’ouest, dans la boue, barbelés, mitrailleuses, obus tombant du ciel : ainsi soit-il. Ils buvaient leur thé. Mais il avait un goût amer.
Baï était prêt à en finir. Il n’aimait plus cette vie. Kuo reprochait à la Quatrième Assemblée des Talents Militaires d’avoir ordonné l’assaut juste au moment de la courte saison des pluies.
— Ben voyons, que pouvait-on attendre d’autre d’un organisme appelé Quatrième Assemblée des Talents Militaires !
C’était un peu injuste, ainsi que Kuo se plut à le leur expliquer par une rapide analyse : la Première Assemblée était composée de vieilles badernes qui se battaient comme lors des précédentes guerres ; la Seconde Assemblée n’était qu’un ramassis d’arrivistes ambitieux, pour qui les hommes n’étaient que de la chair à canons ; la Troisième Assemblée, un mélange improbable de sous-officiers tatillons et de crétins irrécupérables ; la Quatrième Assemblée, quant à elle, était arrivée après le coup d’État qui avait renversé la dynastie des Qing pour la remplacer par un gouvernement militaire, de telle sorte qu’il n’était pas complètement idiot de penser que la Quatrième Assemblée pourrait peut-être obtenir de meilleurs résultats que les trois précédentes, et qu’elle pourrait enfin arranger les choses. Malheureusement, jusqu’à présent, les résultats n’avaient pas été à la hauteur des espérances.
Iwa, qui trouvait que l’on avait déjà abordé ces questions trop souvent, se contenta de faire quelques commentaires au sujet de la qualité du riz qu’on leur avait servi aujourd’hui. Puis, quand ils eurent mangé, ils sortirent dire à leurs hommes de se tenir prêts. Les escouades de Baï étaient essentiellement composées de conscrits venus du Sichuan. Elles comprenaient également trois pelotons de femmes qui occupaient les tranchées de quatre heures à six heures – on considérait qu’elles avaient de la chance. Quand Baï était plus jeune et que les seules femmes qu’il connaissait étaient celles des bordels de Lanzhou, il ne se sentait pas à l’aise avec elles, comme s’il avait affaire à des membres d’une autre espèce, des créatures épuisées qui le considéraient gravement, depuis l’autre côté d’un gigantesque abysse, et semblaient – c’est du moins l’impression qu’il avait – affreusement consternées, comme si elles leur reprochaient, quand elles pensaient aux hommes : « Bandes de sombres idiots, vous avez détruit le monde entier. » Mais à présent qu’elles étaient dans les tranchées, elles n’étaient plus que des soldats comme les autres, avec cette seule différence qu’en les regardant Baï comprenait à quel point les choses avaient changé : il n’y avait plus personne pour leur faire des reproches.
Dans la soirée, les trois officiers se réunirent à nouveau, en prévision de la prochaine visite d’un général qui commandait leur ligne, une nouvelle lumière de cette Quatrième Assemblée, quelqu’un qu’ils n’avaient encore jamais vu. Ils l’écoutèrent distraitement prononcer quelques mots, pour faire valoir l’importance de leur attaque du lendemain.
— C’est une diversion, déclara Kuo quand le général Shen fut remonté à bord de son train privé et reparti pour l’intérieur. Et si je vous disais qu’il y a des espions parmi nous et qu’il veut les tromper ? Si vraiment c’était d’ici que devait partir l’offensive, alors il y aurait des millions de soldats en renfort derrière nous. Mais vous entendez les trains : rien n’a changé dans leurs rotations.
En fait, il y avait eu de nouveaux trains, répondit Iwa. Des milliers de conscrits avaient été déplacés ici, et il n’y avait nulle part où les accueillir. Ils ne pourraient pas rester très longtemps.
Cette nuit-là, il plut. Des flottilles de bombardiers musulmans passèrent en bourdonnant au-dessus d’eux, et larguèrent leurs bombes, endommageant les rails. Les réparations commencèrent dès la fin du raid. Des lampes à arc trouèrent la nuit de grandes phosphorescences argentées, striées de blanc. On aurait dit le négatif abîmé d’une photo. Dans cette clarté artificielle, les hommes s’agitaient, maniant pelles, pioches et masses, poussant des brouettes, comme après n’importe quelle catastrophe, mais ils avaient ces mouvements accélérés qu’on voyait parfois sur les films. De toute façon, il n’y avait plus d’autres trains, et quand l’aube arriva, on s’aperçut que les renforts n’étaient pas si nombreux que ça. De même, on n’avait pas distribué de munitions supplémentaires.
— Ils s’en foutent, conclut Kuo.
Le plan prévoyait qu’on lançât d’abord une première attaque aux gaz, qui descendraient la colline devant eux, poussés par les vents d’est du matin. Au premier tour de garde, un câble arriva, signé du général : Attaquez !
Mais, ce matin-là, il n’y avait pas un souffle de vent. Kuo télégraphia la nouvelle au poste de commandement de la Quatrième Assemblée, trente lis vers l’arrière, et réclama de nouveaux ordres. La réponse arriva rapidement : Ne changez rien, attaquez ! Aux gaz, comme prévu.
— Nous allons tous y rester, soupira Kuo.
Ils mirent leur masque et ouvrirent les vannes qui commandaient l’ouverture des lourds réservoirs métalliques. Le gaz jaillit avec force, formant un nuage épais, nauséabond, de couleur jaunâtre. Il descendit la colline, noyant chaque aspérité de la pente, puis stagna en bas, inerte, menaçant. Leur cachant complètement cette zone neutre, qu’ils surnommaient « la zone de mort ». D’une certaine façon, c’était parfait, même si ceux dont les masques étaient défectueux risquaient d’avoir quelques soucis. Mais l’effet sur les musulmans serait indéniable : quelle horreur, que ce brouillard jaune qui s’approchait d’eux en flottant doucement, et d’où sortiraient, vague après vague, des monstres à visage d’insecte, tirant au fusil et lançant des grenades ! Enfin, ils s’approchèrent de leurs mitrailleuses et les dessertirent de leur pied.
Bien vite, Baï ne pensa à rien d’autre qu’à progresser, de cratère en cratère, se servant comme d’un bouclier de tel monticule de boue, ou de tel cadavre, encourageant les soldats terrés dans leurs trous à en sortir et à avancer.
— Il vaut mieux y aller maintenant, avant que le gaz ne s’installe ! Il faut qu’on déborde leurs lignes, et qu’on foute en l’air leurs mitrailleuses !
Et ainsi de suite, dans un tonnerre si assourdissant que de toute façon personne ne l’entendait. Un souffle de l’habituel vigoureux petit vent du matin déplaça la poche de gaz de la zone neutre vers les lignes musulmanes, et les tirs de mitrailleuses se firent moins nombreux. Leur attaque gagna en vigueur, des hommes avec des cisailles s’activèrent à couper les barbelés, que franchissaient des hommes en armes. Ils se trouvèrent alors dans les tranchées musulmanes, et ils retournèrent les énormes canons iraniens sur les ennemis, qui fuyaient, et tirèrent jusqu’à ne plus avoir de munitions.
Ensuite, s’ils avaient eu quelques renforts, les choses auraient pu devenir intéressantes. Mais les trains étant bloqués cinquante lis en arrière de leurs lignes, le vent ramenant la poche de gaz vers l’est et les puissants canons musulmans les canardant, commençant à détruire ce qui avait été leurs propres lignes, la position obtenue au cours de cet assaut devint rapidement intenable. Baï donna l’ordre à ses troupes de descendre se cacher dans les galeries des musulmans. Le jour passa, empli de cris confus, d’échanges de télégrammes et d’incommunications sans fil. Pour finir, Kuo cria à Baï que l’ordre de faire retraite avait été donné. Ils rassemblèrent les rescapés et repartirent, à travers cette mer de boue empoisonnée, retournée, mêlée de restes de corps éparpillés, qui était tout ce qu’ils avaient gagné ce jour-là. Une heure après la tombée de la nuit, ils avaient retrouvé leurs propres tranchées, deux fois moins nombreux qu’ils ne l’étaient au matin.
Bien après minuit, les officiers se réunirent dans leur petit abri, allumèrent leur réchaud et mirent du riz à cuire. Chacun avait encore dans les oreilles les cris de ses hommes. D’ailleurs, ils ne s’entendaient pas parler. Cela continuerait un jour ou deux. Kuo était encore bouillonnant de colère, et l’on n’avait pas besoin d’entendre ce qu’il disait pour le comprendre. Il était en train de se demander comment revoir les Cinq Plus Graves Erreurs de la campagne de Gansu : fallait-il déclasser l’une des précédentes Cinq Plus Graves Erreurs, ou les rebaptiser « Six Plus Graves Erreurs » ?
— Une Assemblée de génies, en effet ! hurla-t-il en plaçant la casserole de riz sur leur feu de charbon, les mains tremblantes, noires de boue. Quelle bande de putains d’imbéciles !
À la surface, les trains-hôpitaux poussaient de longs cris métalliques, laissant parfois s’échapper une plainte vaporeuse. Ils avaient les oreilles qui sifflaient. De toute façon, trop de choses s’étaient passées pour qu’ils puissent en parler. Ils mangèrent dans le silence d’un énorme rugissement. Malheureusement, Baï se mit à vomir, puis eut du mal à respirer. Il dut accepter d’être transporté à la surface, et vers l’arrière, jusqu’à l’un des trains-hôpitaux. Jeté au milieu des gazés, des blessés, des mourants. Il leur fallut un jour entier pour se déplacer de seulement vingt lis vers l’est, puis encore un jour, avant qu’une équipe de médecins débordée s’occupe enfin d’eux. Baï faillit mourir de soif, mais fut sauvé par une fille qui portait un masque. Elle lui fit boire quelques gorgées d’eau, pendant qu’un médecin diagnostiquait une brûlure des poumons, consécutive aux gaz. On lui introduisit des aiguilles d’acupuncture dans le cou et sur la figure, grâce auxquelles sa respiration s’améliora. Il eut alors la force de boire plus, mangea un peu de riz, puis commença à parler de sa sortie de l’hôpital. Il n’avait pas l’intention de rester là, risquant de mourir de faim ou de la maladie d’un autre. Il retourna à pied vers le front, faisant une partie du voyage à l’arrière d’une carriole tirée par un âne. Il faisait nuit quand il atteignit enfin une première batterie de canons. Il voyait luire de façon éclatante les tubes noirs des mortiers et des canons, pointés vers les étoiles, et les petites silhouettes de leurs servants, courant au-dessous d’eux à la lumière des lampes à arc, se bouchant les oreilles avec les mains (ce que fit aussi Baï), avant de s’éloigner. Tout cela lui fit penser de façon claire, une fois encore, qu’ils avaient tous été déplacés dans le royaume supérieur, empêtrés dans la guerre des asuras, un conflit titanesque où les humains n’étaient que des fourmis, broyées sous les roues géantes des machines de guerre asuras.
Quand il fut de retour sous terre, Kuo se moqua de lui pour être revenu si vite – « Tu es comme un singe apprivoisé, on ne peut pas se débarrasser de toi ! » – mais Baï, à présent soulagé, répondit simplement :
— On est plus en sécurité ici qu’à l’hôpital.
Ce qui déclencha chez Kuo une nouvelle crise de rires. Iwa revint de la grotte des transmissions, avec plein de nouvelles : apparemment, leur assaut se révélait n’avoir été qu’une simple diversion, ainsi que Kuo l’avait dit depuis le début. Il fallait faire pression sur le bouchon de Gansu afin d’y fixer les armées musulmanes, pendant que le Japon acceptait enfin d’honorer ses engagements à aider la cause. En échange, la Chine acceptait de reconnaître son indépendance ; indépendance que les Japonais avaient de toute façon fini par conquérir, mais qui aurait pu se voir compromise. Des troupes fraîches de Japonais avaient fait une profonde percée sur le front nord. Ils avaient enfoncé les lignes musulmanes sur plusieurs lis, causant une profonde déroute chez les musulmans, et se ruaient vers l’ouest et le sud comme une horde de ronins enragés lancés dans une équipée sauvage. Avec un peu de chance, les Japonais prendraient à revers les troupes musulmanes du corridor de Gansu, les obligeant à se retirer, y laissant seules les troupes chinoises, épuisées, sur une bande de terrain enfin redevenue paisible.
— Je suppose, commença Iwa, que la haine que nous vouent les Japonais a été moins forte que la peur qu’ils avaient de voir l’islam conquérir le monde.
— Ils vont s’emparer de la Corée et de la Mandchourie, prédit Kuo. Ils ne voudront jamais les rendre. Ils prendront quelques villes côtières aussi. Maintenant que nous sommes saignés à blanc, ils n’ont plus qu’à se servir.
— Parfait, lança Baï. Qu’ils prennent Beijing, si c’est ce qu’ils veulent, et si cela signifie la fin de la guerre.
Kuo le regarda, ne sachant quoi penser.
— Je ne sais pas, des musulmans ou des Japonais, lesquels feraient les pires maîtres. Ces Japonais, ce sont des coriaces. Et ils ne nous portent pas dans leur cœur. Depuis qu’Edo a été détruite par un tremblement de terre, ils s’imaginent que les dieux sont avec eux. Ils ont déjà tué tous les Chinois qu’il y avait au Japon.
— Quoi qu’il arrive, nous ne serons les esclaves ni des uns, ni des autres, dit Baï. Les Chinois ne peuvent être vaincus, ça vous dit quelque chose ?
Les deux jours précédents n’avaient pas abondé dans le sens de ce proverbe.
— Sauf par des Chinois, ironisa Kuo. Ils ont tellement de talents !
— Les Japonais ont peut-être déjà débordé leur flanc nord, nota Iwa. Cela changerait bien des choses.
— Cela mettrait un terme à la guerre, dit Baï.
Il toussa, et Kuo se moqua de lui :
— Pris entre le pilon et le mortier ! s’exclama-t-il.
Il marcha vers leur coffre-fort, inséré dans l’un des murs en boue de leur antre, l’ouvrit et en sortit une bouteille de rakshi, dont il but une goulée. Il buvait une bouteille de gnôle par jour, quand il parvenait à s’en procurer, commençant à boire dès son réveil, et finissant alors qu’il avait déjà les yeux fermés, le soir avant de s’endormir.
— À la santé du Dixième Grand Succès ! Ou bien est-ce le Onzième ? Et dire que nous avons réchappé à chacun d’entre eux !
En cet instant, il franchissait la limite de la plus élémentaire prudence, qui voulait que l’on évitât ces sujets.
— Nous nous en sommes sortis, ainsi que des Six Bourdes Majeures, des Trois Incroyables Foirages, et des Neuf Plus Grands Manques de Bol. Un miracle ! Je parie qu’une bande de fantômes affamés tient de sacrées ombrelles au-dessus de nos têtes, mes frères !
Baï hocha la tête, mal à l’aise. Il n’aimait pas qu’on parle de ces choses-là. Il se concentra sur le vacarme des bombardements. Il essaya d’oublier ce qu’il avait vu au cours des trois derniers jours.
— Comment est-il possible de survivre à tout ça ? demanda Kuo imprudemment. Tous ceux avec qui nous étions au début sont morts. En fait, chacun d’entre nous a dû connaître cinq ou six promotions de nouveaux officiers. Depuis combien de temps cela dure-t-il ? Cinq ans ? Comment est-ce possible ?
— Je suis Peng-zu, dit Iwa. Je suis l’Immortel Malchanceux, je ne peux être tué. Je pourrais même plonger dans un nuage de gaz, et m’en sortir vivant.
Il leva la tête de son bol de riz, la mine lugubre.
Même Kuo était effrayé par ses propos.
— Bon, eh bien, tu n’as pas eu de chance jusqu’à présent, mais il y aura d’autres occasions, ne t’inquiète pas. Ne crois pas que dès demain tout sera terminé. Les Japonais peuvent toujours prendre le Nord, de toute façon personne n’en veut. Mais quand ils voudront sortir de la taïga pour descendre dans les steppes, alors là, les choses sérieuses commenceront. Je ne crois pas qu’ils aillent très loin. Si la percée s’était faite au sud, ce serait différent. On aurait alors un accès direct à l’Inde.
— Cela ne se fera jamais, déplora Iwa en secouant la tête.
Ce genre d’analyse, c’était tout lui. Les deux autres durent lui demander de s’expliquer. Pour les Chinois, le front sud était essentiellement constitué de la grande muraille de l’Himalaya, du Pamir et des jungles d’Annam, de Birmanie, du Bengale et d’Assam. Il n’y avait que très peu de passages envisageables dans les montagnes, et ils étaient inexpugnables. Comme les jungles, le seul moyen de les traverser était les fleuves, et c’était trop dangereux. Les fortifications le long de leur front sud étaient donc géographiques et immuables. Mais il en allait de même pour les musulmans de l’autre côté. Les Indiens se retrouvaient donc bloqués dans le Deccan. En fait, les steppes étaient le seul passage possible, mais comme les armées des deux camps s’y étaient regroupées, on arrivait à une impasse.
— Il faudra bien que cela finisse un jour, fit remarquer Baï. Sinon, cela ne finira jamais.
Kuo explosa de rire, aspergeant tout le monde de rakshi.
— J’admire ton sens de la logique, mon ami Baï ! Mais cette guerre n’est pas logique. Elle est la fin de tout, et elle ne finira jamais. Nous passerons notre vie à nous battre, puis nos enfants après nous, puis leurs enfants… jusqu’à ce que tout le monde soit mort. Et alors le monde recommencera, ou non, selon le cas.
— Je ne suis pas d’accord, renâcla doucement Iwa. Cela ne peut pas durer éternellement. Elle finira juste d’une autre façon, c’est tout. Il y a la guerre en mer, en Afrique, au Yingzhou. Il faudra bien que, quelque part, quelqu’un l’emporte. Alors cette région ne sera plus que… comment dire ? Un épiphénomène de cette longue guerre, une anomalie, ou je ne sais quoi. Le front qui ne bougeait pas. Ce que cette guerre avait d’immobile là où elle était la plus immobile. Notre histoire passera de génération en génération, parce qu’il ne se produira plus jamais rien de pareil.
— C’est vraiment réconfortant, dit Kuo. Nous sommes donc dans la plus immobile des situations jamais connue de mémoire de soldat !
— Au moins, nous sommes dans quelque chose, rétorqua Iwa.
— Mais oui ! C’est un hommage ! Un honneur même, si c’est ce à quoi tu penses !
Baï préférait ne pas y penser. Une explosion, à la surface, délogea un peu de terre du plafond. Ils se ruèrent sur leurs assiettes, leurs tasses, afin de les couvrir.
Quelques jours plus tard, la routine habituelle avait repris son cours. Les Japonais avaient-ils réussi leur percée, là-bas, plus au nord ? En tout cas, ici, il n’y avait rien de nouveau. Les bombardements et les tirs embusqués des musulmans n’avaient pas diminué, comme si la Sixième Bourde Majeure, avec ses cinquante mille morts (et mortes), ne s’était jamais produite.
Peu après, les musulmans imitèrent les Chinois et commencèrent eux aussi à utiliser des gaz empoisonnés, qui se répandaient sur la zone neutre au moindre souffle de vent. La seule nouveauté, c’est qu’ils les envoyaient parfois dans des obus, qui tombaient avec un sifflement infernal, et explosaient en répandant leur habituel quota d’éclats (sans compter toutes sortes de choses coupantes, car les musulmans commençaient, eux aussi, à être à cours de métal, et c’est ainsi que les Chinois trouvèrent des baguettes, des os de chat, des sabots, et même un jour tout un dentier). S’ajoutant aux éclats, donc, un épais nuage de fumée jaunâtre sortait en sifflant des obus. Ce n’était apparemment pas que du gaz moutarde, mais toutes sortes de poisons et de substances, qui obligeaient les Chinois à porter en permanence leur masque à gaz, ainsi que des gants, et une espèce de capuche. De toute façon, harnaché ou non, quand un de ces obus tombait, il était difficile de ne pas se retrouver immédiatement brûlé, au niveau des poignets, des chevilles et du cou.
Parmi tout cet éventail d’inconvénients, il y avait ces nouveaux obus, si énormes, lancés si haut par de si gros canons qu’ils redescendaient des nuages à une allure supérieure à la vitesse du son, si bien qu’on ne les entendait pas arriver. Ces obus étaient plus gros qu’un homme, et avaient été spécialement étudiés pour ne pas exploser à l’impact, mais s’enfoncer loin sous terre avant d’éclater. Leur souffle était si terrible que beaucoup plus d’hommes mouraient enterrés dans leurs tranchées, leurs galeries ou leurs grottes, qu’il n’y en avait de tués par l’impact proprement dit. Quand un de ces obus tombait sans éclater, on s’affairait précautionneusement à le déterrer, pour le charger soigneusement à bord d’un train, dont il occupait tout un wagon. L’explosif utilisé était d’un genre nouveau. On aurait dit une sorte de colle de poisson, avec une odeur de jasmin.
Un soir, au crépuscule, ils commentaient autour d’un verre de rakshi les nouvelles qu’Iwa avait entendues dans la grotte des transmissions. L’armée du Sud était sévèrement châtiée pour une faute qu’elle aurait commise sur le front : chaque chef d’escadron devait envoyer un certain pourcentage de ses hommes devant le peloton d’exécution, afin d’encourager les autres.
— Quelle bonne idée ! dit Kuo. Justement, je sais qui envoyer !
Iwa secoua la tête.
— Une loterie aurait créé plus de solidarité.
— Solidarité ! ironisa Kuo. Autant se débarrasser de tous les tire-au-flanc pendant qu’il en est temps, avant qu’ils ne vous tirent dans le dos, une nuit.
— Je trouve que c’est une idée horrible, dit Baï. Ce sont des Chinois. Comment peut-on tuer des Chinois qui n’ont rien fait de mal ? C’est de la folie. La Quatrième Assemblée des Talents Militaires est devenue complètement folle.
— Comme s’ils avaient jamais été sains d’esprit, rétorqua Kuo. Il y a plus de quarante ans que tout le monde est fou sur cette Terre !
Soudain, un violent souffle d’air les plaqua au sol. Baï et Iwa se rentrèrent dedans en se relevant. Iwa n’entendait plus rien. Kuo n’était nulle part, il avait disparu. À l’endroit où il se tenait, il n’y avait plus qu’un énorme trou dans le sol. Un trou parfaitement rond, d’à peu près douze pieds de diamètre, profond d’une trentaine de pieds, et au fond duquel brillait de sinistre façon le culot d’un énorme super obus musulman. Encore un obus qui n’avait pas explosé.
Une main droite gisait sur le sol à côté du trou, pareille à une énorme araignée blanche.
— Merde alors, dit Iwa entre deux détonations. Ils ont tué Kuo !
L’obus musulman lui était tombé pile dessus. D’ailleurs, fit remarquer plus tard Iwa, il n’était pas impossible que ce fut parce qu’il lui était tombé dessus que l’obus n’avait pas explosé. L’obus l’avait écrasé comme un vulgaire ver de terre. Il ne restait plus que sa pauvre main.
Baï considéra la main, trop sonné pour bouger. Il entendait encore le rire de Kuo retentir à ses oreilles. Kuo lui-même aurait certainement bien ri, s’il avait pu voir la tournure prise par les événements. Il n’y avait aucun doute, c’était bien sa main ; et Baï se rendit compte alors qu’il le connaissait beaucoup plus intimement qu’il n’en avait jamais eu conscience ; ils avaient passé tellement d’heures ici, assis dans leur terrier, où Kuo tenait son bol de riz, posait la bouilloire sur le réchaud, leur apportait une tasse de thé ou un verre de rakshi. Sa main, comme le reste de sa personne, faisait partie de la vie de Baï. Calleuse, couverte de cicatrices, la paume propre et le dos crasseux, telle qu’elle avait toujours été, alors qu’il n’était plus au bout. Baï se laissa tomber sur le sol boueux.
Iwa ramassa doucement la main tranchée, à laquelle ils offrirent la même cérémonie funèbre qu’aux corps complets, avant de la mettre à bord du train de la mort, qui l’emmènerait vers les crématoriums. Ensuite, ils burent ce qui restait du rakshi de Kuo. Baï n’arrivait pas à parler, et Iwa le laissa tranquille. La propre main de Baï s’était mise à trembler, sous l’effet de la fatigue qu’on ressentait toujours quand on était dans les tranchées. Qu’était devenue leur ombrelle magique ? Que ferait-il à présent, sans les rires acides de Kuo pour dissiper ces miasmes de mort ?
Puis les musulmans attaquèrent à leur tour, et les Chinois durent défendre leurs tranchées pendant à peu près une semaine. Ils ne quittèrent pas leur masque à gaz et tirèrent munition sur munition sur les fedayins et les assassins qui sortaient, pareils à des fantômes, des plis du brouillard jaune. Baï, qui n’arrivait plus à respirer, dut être évacué vers l’arrière ; mais, à la fin de la semaine, il retrouva Iwa dans la même tranchée que celle où ils avaient commencé le combat, sauf qu’il y avait un nouvel escadron, composé quasi exclusivement de conscrits venus d’Aozhou, le pays de la tortue qui soutenait le monde : de la bleusaille du Sud jetée dans la bataille comme autant de balles tirées par une mitrailleuse. Ils eurent si peu de répit que l’épisode de l’obus qui avait raté paraissait s’être passé il y avait bien des années.
— Autrefois, j’avais un frère nommé Kuo, expliqua Baï à Iwa.
Iwa hocha la tête, et lui tapota l’épaule.
— Va voir si nous n’avons pas reçu de nouveaux ordres.
Son visage était noir de cordite, sauf autour de la bouche et du nez, protégés par son masque à gaz, et sous les yeux, où ses larmes avaient tracé de petits deltas blancs. Il ressemblait à une marionnette, son visage figurant le masque d’un asura en peine. Il avait passé un peu plus d’une quarantaine d’heures d’affilée à tirer à la mitrailleuse, et avait dû tuer un peu plus de trois mille hommes. Il avait le regard vide, et ne semblait voir ni Baï, ni le monde.
Baï se détourna et descendit d’un pas mal assuré dans les galeries, vers la grotte des transmissions. Là, il s’affala sur une chaise et essaya de reprendre son souffle. Il avait perpétuellement l’impression de tomber, de traverser le sol, la terre, pour se perdre quelque part au fond de l’oubli. Mais un craquement le fit sursauter ; et il leva les yeux pour regarder qui était assis là, à la table du télégraphe.
C’était Kuo, qui le regardait avec un sourire grimaçant.
Baï se raidit.
— Kuo ! s’exclama-t-il. Nous te croyions mort !
Kuo hocha la tête, lourdement.
— Je suis mort, lui dit-il. Et toi aussi.
Baï le regarda. Sa main droite était bien là, au bout de son bras.
— L’obus a explosé, dit-il. Il nous a tous tués. Et depuis, tu erres dans le bardo. Comme nous tous. Mais toi, tu fais comme si tu n’y étais pas. Pourtant, je me demande bien ce que tu peux trouver de si intéressant à cet enfer pour vouloir y rester. Vraiment, je n’arrive pas à comprendre. Tu es tellement, tellement obstiné, Baï. Il faut que tu admettes que tu es dans le bardo si tu veux arriver à comprendre ce qui t’arrive. C’est la guerre du bardo qui compte le plus. La guerre des âmes.
Baï essaya de dire oui ; puis non ; puis se retrouva sur le sol de la cave. Apparemment, il avait dû tomber de sa chaise, et ça l’avait réveillé. Kuo était parti, sa chaise était vide.
— Kuo ! Reviens ! gémit Baï.
Mais la pièce resta vide.
Plus tard, Baï raconta à Iwa, d’une voix tremblante, ce qui s’était passé. Le Tibétain lui jeta un regard acéré, et haussa les épaules.
— Peut-être qu’il disait vrai, dit-il, ajoutant, avec un ample geste du bras : D’ailleurs, rien ne prouve le contraire.
Un nouvel assaut fut lancé sur leurs lignes, et ils reçurent l’ordre de faire retraite vers l’arrière, où des trains les prendraient en charge. Évidemment, au dépôt régnait la plus extrême confusion. Des hommes les poussèrent du bout de leur fusil à bord de wagons, comme du bétail, et les trains partirent, dans un chaos de sifflets et de bruits de ferraille.
Iwa et Baï s’étaient assis au fond de l’un des wagons qui les emmenaient vers le sud. De temps en temps, ils profitaient de leurs privilèges d’officiers pour sortir sur l’étroite plate-forme à l’extrémité du wagon, et fumer une cigarette, les yeux perdus dans le vague, sous le ciel bas couleur d’acier. Leur convoi gravissait une pente, et plus ils montaient, plus il faisait froid. La raréfaction de l’air réveilla des douleurs dans les poumons de Baï, qui fit un geste en direction des monceaux de roches et de glace entre lesquels ils roulaient.
— Voilà, c’est peut-être à ça que ressemble le bardo.
— Mais non, c’est le Tibet, dit Iwa.
Mais Baï voyait bien que c’était pire que ça. Des cirrus s’étendaient comme des faux, au-dessus de leurs têtes. Ils se seraient crus sur une scène de théâtre, tant tout paraissait irréel. Même le ciel était noir, d’un noir uniforme, infini.
En tout cas, quel que fut ce royaume, Tibet ou bardo, dans la vie ou hors d’elle, la guerre continuait. La nuit, des avions, précédés par de petits dirigeables de reconnaissance, passaient en grondant au-dessus d’eux, et larguaient leurs bombes. De puissants projecteurs à arc trouaient la nuit, clouant les avions aux étoiles, et parfois les faisant exploser, dans un déluge de flammes. Le paysage paraissait hanté par les images que voyait Baï dans ses rêves. Une neige d’un noir de jais brillait à la pâle lumière du soleil rivé à l’horizon.
Le convoi s’arrêta au pied d’une gigantesque chaîne de montagnes apparemment infranchissable. Le deuxième acte de cette pièce de cauchemar pouvait enfin commencer. La scène où il allait se dérouler était si profonde qu’ils la voyaient se perdre sous le niveau du plateau aride de la steppe. Cette passe était leur but. Leur objectif était d’annihiler les défenses qui la protégeaient, et de poursuivre vers le sud, vers un quelconque niveau situé en dessous de ce plancher de l’univers. C’était probablement la passe vers l’Inde. La porte menant à un royaume inférieur. Très bien défendue, évidemment.
Les « musulmans » qui la défendaient demeuraient invisibles, toujours au-dessus de l’énorme masse neigeuse de ces pics de granit, qui s’élevaient bien plus haut que toutes les montagnes de la Terre ; des montagnes asuras, tout comme les canons qu’ils avaient apportés pour les écraser étaient des canons asuras. Jamais il n’avait été aussi clair pour Baï qu’ils se trouvaient pris dans une guerre qui les dépassait, et qui faisait des millions de morts pour une cause qui n’était pas la leur. Des crocs de glace et de roche noire mordaient le plafond des étoiles. Le vent arrachait aux cimes de longues bannières de neige, qui se perdaient dans la voie lactée. À la fin du jour, ces mêmes bannières, crevées par le soleil couchant, se transformaient en grandes flammes asuras, pareilles aux langues d’un gigantesque brasier brûlant parallèlement au ciel ; comme si le royaume des asuras était perpendiculaire au leur. Baï se disait que c’était d’ailleurs peut-être pour ça que leur pauvre petite parodie de guerre allait si désespérément de travers.
Les énormes canons des musulmans se trouvaient de l’autre côté des montagnes, sur leur versant sud. Ils ne les entendaient jamais. Leurs obus passaient en sifflant au-dessus des étoiles, traçant dans le ciel noir de longues traînées blanches, cristallines. La plupart de ces obus tombaient sur l’énorme montagne blanche qui se trouvait à l’est de l’immense passe, la détruisant petit à petit, explosion après explosion ; comme si les musulmans étaient devenus fous et avaient déclaré la guerre à la Terre elle-même.
— Pourquoi détestent-ils tant cette montagne ? demanda Baï.
— C’est le Chomolungma, répondit Iwa. C’était la plus haute montagne du monde. Alors les musulmans ont bombardé son sommet pyramidal, jusqu’à ce qu’il soit plus petit que le sommet de la deuxième plus haute montagne du monde, qui se trouve en Afghanistan. Comme ça, maintenant, la plus haute montagne du monde est musulmane.
Son visage était aussi pâle que d’habitude, mais il avait l’air triste, comme si le sort de la montagne comptait vraiment pour lui. Cela inquiéta Baï : si Iwa était fou, alors tout le monde sur Terre l’était aussi. Iwa aurait dû être la dernière personne au monde à perdre la raison. Mais il était peut-être déjà trop tard. Un soldat de leur escouade avait fondu en larmes à la vue de cadavres de mules et de chevaux ; la vue de corps humains déchiquetés ne le dérangeait pas, mais les carcasses sanguinolentes de ces pauvres bêtes lui fendaient le cœur. D’une manière étrange, cela pouvait se comprendre. Sauf que Baï n’éprouvait aucune sorte de compassion pour les montagnes. Au pire, c’était un dieu en moins. Cela faisait partie de la guerre du bardo.
La nuit, le froid était si intense qu’il induisait comme une sorte de stase. À la lumière étincelante des étoiles, tout en fumant une cigarette près des latrines, Baï réfléchissait à ce que cela pouvait bien vouloir dire : une guerre dans le bardo. Ce plateau était l’endroit où l’on triait les âmes, où elles étaient réconciliées avec la vraie nature des choses, avant d’être renvoyées dans le monde. On rendait le jugement, on évaluait le karma ; les âmes repartaient sur Terre pour essayer encore, ou étaient envoyées au nirvana. Baï avait lu l’exemplaire du Livre des morts d’Iwa. Ici, chaque phrase faisait sens et donnait forme au plateau. Morts ou vivants, ils marchaient dans une pièce du bardo, écrivant leur destin. C’était toujours pareil ! Cette pièce était aussi froide qu’une scène de théâtre vide. Ils avaient établi un camp, sur du gravier et du sable, au pied d’un glacier gris. Leurs gros canons semblaient tapis, leurs futs pointés vers le ciel. De plus petits canons, sur les contreforts de la vallée, les protégeaient des attaques aériennes. Leurs emplacements ressemblaient à ces anciens monastères de style dzong, que l’on voyait toujours çà et là, perchés au sommet des éperons montagneux.
Le bruit courut qu’ils allaient essayer de franchir Nangpa La, la profonde passe qui trouait la chaîne de montagnes. L’une de ces anciennes routes du sel, le meilleur endroit où traverser, sur plusieurs lis de distance. Des sherpas tibétains, qui s’étaient établis au sud de la passe, les guideraient. De l’autre côté de la passe, un canyon menait à leur capitale, le village de Namche Bazaar, maintenant en ruines, comme le reste. De Namche, des pistes partaient directement vers le sud, vers les plaines du Bengale. C’était un excellent endroit où traverser l’Himalaya, en fait. Le chemin de fer pourrait remplacer le chemin de pierre en quelques jours seulement, et ils pourraient alors faire venir par bateau les nombreuses armées de Chine, ou du moins ce qu’il en restait, et les débarquer sur la plaine du Gange. Les rumeurs fusaient, remplacées chaque jour par de nouvelles. Iwa passa la nuit entière au télégraphe.
Il semblait à Baï que quelque chose avait changé dans le bardo lui-même. Comme s’ils étaient passés dans la pièce suivante, un enfer tropical cramponné à l’histoire ancienne. La bataille pour la passe s’annonçait particulièrement violente, comme l’étaient toutes les batailles pour n’importe quelle passe au monde. Les artilleries de deux civilisations se faisaient face de part et d’autre, déclenchant de fréquentes avalanches sur les flancs de granit. Pendant ce temps, des tirs continuaient de faire descendre le sommet du Chomolungma. Les Tibétains se battirent comme des prêtas quand ils virent cela. Iwa semblait s’être réconcilié avec cette idée :
— Ils ont un proverbe parlant des montagnes allant à Mahomet. Mais je crois que la déesse mère s’en fout.
En attendant, cela leur fit, encore une fois, mesurer le degré de folie auquel étaient parvenus leurs assaillants. Disciples fanatiques et ignorants d’un cruel culte du désert, auxquels on avait promis l’éternité dans un paradis où les orgasmes sexuels avec de magnifiques houris dureraient dix mille années, il n’était pas surprenant qu’ils cherchassent à ce point à se suicider, heureux de mourir, luttant avec l’insouciance des fumeurs d’opium, qu’il était difficile de contrer. D’ailleurs, il était bien connu qu’ils étaient de grands amateurs de benzédrine et de haschich, menant la guerre dans un état second, proche du rêve, guerroyant de façon saccadée, parfois comme des bêtes enragées. Beaucoup de Chinois auraient été heureux de les y rejoindre. L’opium avait évidemment droit de cité dans l’armée chinoise, mais il y avait pénurie. Cela dit, Iwa avait des contacts dans la région, et alors qu’ils se préparaient à monter à l’assaut du Nangpa La, il en extorqua un peu à des membres de la police militaire. Baï et lui le fumèrent sous forme de cigarettes, et le burent dans un mélange d’alcool, de clous de girofle et de médicaments de Travancore – réputés améliorer la vue et endormir les émotions. Cela marchait assez bien.
Finalement, il y eut tellement de bannières, de divisions, de gros canons réunis sur cette haute plaine du bardo, que Baï fut convaincu que les rumeurs étaient fondées, et qu’un assaut général mené contre Kali, Shiva ou Brahma était sur le point de commencer. La preuve supplémentaire en était que beaucoup de divisions étaient composées de soldats expérimentés, plutôt que de jeunes garçons, de paysans ou de femmes – des divisions qui avaient une grande expérience de la guerre, acquise dans les îles ou dans le Nouveau Monde, où les combats avaient été particulièrement intenses, et où ils prétendaient l’avoir emporté. En d’autres termes, c’étaient précisément le genre de soldats qui auraient déjà dû mourir. D’ailleurs, ils semblaient morts. Ils fumaient cigarette sur cigarette, comme des morts. Toute une armée de morts, réunis là pour envahir le riche Sud des vivants.
La lune crût et décrût, et le bombardement de l’ennemi invisible continua. Des flottilles d’avions ressemblant à des serpes partaient vers la passe et n’en revenaient jamais. Le huitième jour du quatrième mois, jour de la conception du Bouddha, l’assaut commença.
La passe elle-même avait été piégée, et quand ses premiers défenseurs furent tous tués, ou se furent repliés vers le sud, les falaises bordant la passe explosèrent dans de terribles déflagrations, obstruant le large col. Le Cho Oyu lui-même maigrit un peu dans la terrible explosion. Ce fut la fin pour de nombreuses bannières chargées de le sécuriser. Baï les regarda d’en bas, et se demanda : Quand on meurt dans le bardo, où va-t-on ? Seul le hasard lui avait évité de faire partie des premiers escadrons envoyés dans la passe.
En attendant, les défenses ennemies avaient été neutralisées, en même temps que les premières vagues d’assaut chinoises. Maintenant, la passe était à eux, et ils pouvaient commencer à descendre le canyon formé par le glacier qui menait à la plaine du Gange. Ils durent lutter pour chaque pouce de terrain, principalement sous le feu de bombardements à distance, et tombant dans des pièges ou sur des champs de mines placés à des endroits cruciaux. Ils déminaient, ou faisaient exploser les charges à chaque fois qu’ils le pouvaient, ou sautaient sur celles qu’ils avaient laissées passer. Mais, globalement, ils avançaient assez vite, construisant même une route et une voie ferrée au fur et à mesure que les musulmans abandonnaient le terrain, se retirant dans la plaine. Bientôt, ils n’eurent plus qu’à subir leurs bombardements aériens, et quelques coups tirés depuis et autour de Delhi, erratiques et désopilants, sauf quand par hasard ils arrivaient à faire mouche.
Dans le profond canyon sud, ils eurent l’impression de changer à nouveau de monde. Et d’ailleurs, Baï revint complètement sur l’idée qu’ils étaient dans le bardo. De toute façon, si c’était le cas, c’était à un tout autre niveau : chaud, humide, luxuriant, avec des arbres foisonnants, des buissons et des touffes d’herbe qui explosaient au-dessus d’une terre noire et recouvraient tout. Ici, même le granit paraissait vivant. Peut-être que Kuo lui avait menti, et que lui, Iwa, et tous les autres étaient encore en vie, dans un vrai monde où il était mortel de mourir. Quelle horrible idée ! Le vrai monde devenant le bardo, les deux étant la même chose… Baï fut ballotté à travers ces jours frénétiques sans réussir à se sentir concerné. Après toute cette souffrance, il n’avait fait que renaître dans sa propre vie, qui continuait toujours. Il avait récupéré comme s’il ne devait jamais la quitter, en dehors d’un moment d’une cruelle ironie, quelques jours de folie, et il s’était déplacé dans une nouvelle existence karmique tout en restant coincé dans le même minable cycle biologique qui, pour une raison inconnue, était devenu une parfaite imitation de l’enfer. Tout se passait comme si la roue du karma s’était cassée et que les rouages de la vie karmique et de la vie biologique s’étaient détachés, dispersés de telle sorte que tout s’était mis à fluctuer sans avertissement. On vivait sans le savoir, parfois dans le monde physique, d’autres fois dans le bardo, tantôt dans ses rêves, et tantôt éveillé, le plus souvent tout cela en même temps, sans qu’il y ait de cause ou d’explication. Déjà, les années qu’il avait passées dans le corridor de Gansu, c’est-à-dire toute sa vie, aurait-il dit autrefois, se perdaient dans les brumes du rêve, et même le très étrange aspect mystique de la plaine du Tibet devenait rapidement une sorte de fausse mémoire, dont il avait le plus grand mal à se souvenir, bien qu’elle fut gravée sur ses yeux et qu’il passât son temps à la voir, superposée à tout ce qu’il regardait.
Un soir, l’officier du télégraphe vint les trouver en courant et leur ordonna de se dépêcher de monter au sommet de la colline. En amont, le barrage de glace qui retenait un lac de montagne avait été bombardé par les musulmans. Ses eaux se déversaient à présent dans le canyon, l’emplissant sur une profondeur de cinq cents pieds, parfois plus, en fonction de l’étroitesse de la gorge.
L’escalade commença. Et quelle escalade ! Ils étaient là, hommes déjà morts, morts depuis des années, et pourtant ils grimpaient comme des singes, pris d’une frénésie qui les poussait de corniche en corniche, jusqu’en haut du canyon. Ils avaient établi leur campement au fond d’un défilé étroit, ce qui était parfait pour éviter les bombardements aériens, et lorsqu’ils émergèrent au-dessus des broussailles ils entendirent de plus en plus distinctement un grondement lointain, un roulement de tonnerre – peut-être un éboulement comme il s’en produisait dans le si bruyant Dudh Kosi, mais peut-être pas, c’étaient peut-être les flots approchants de la rivière en crue –, quand la pente s’adoucit enfin. Ils se retrouvèrent après une bonne heure de marche à près de mille pieds au dessus du Dudh Kosi, regardant loin en bas la ligne blanche qui leur semblait si inoffensive vue du large promontoire où les officiers les avaient réunis, regardant loin en bas dans la gorge, mais aussi, autour d’eux, les extraordinaires murailles de glace et les sommets des montagnes, entendant un sourd rugissement montant de la plus haute, au nord, un rugissement terrible et victorieux, comme le feulement d’un dieu tigre. De leur position privilégiée ils observèrent l’inondation, qui arriva alors que la nuit tombait : le rugissement enfla, devint aussi assourdissant qu’un bombardement sur le front, mais beaucoup plus grave et bas, presque tectonique, passant du sol à leurs pieds avant de parvenir à leurs oreilles, et puis un mur d’eau sale apparut, charriant des arbres et des rochers sur son front chaotique et bouillonnant, déchirant les parois du canyon jusqu’à son lit de pierre et provoquant des éboulements parfois si importants qu’ils retenaient les eaux pendant quelques minutes, jusqu’à ce que le flot passe par-dessus, l’aplanissant, provoquant un nouveau surgissement dans l’inondation générale. Une fois la première vague passée, partie plus loin dans le canyon, il ne resta plus à leurs pieds que des parois déchirées, blanches dans le crépuscule, et une rivière terreuse, écumante, qui grondait et ronflait juste un peu au-dessus de son niveau habituel.
— Nous devrions construire les routes plus haut, nota Iwa.
Baï ne put s’empêcher de rire tant Iwa semblait calme. L’opium rendait tout vibrant. Il se rendit compte soudain :
— Oh là ! Cela vient de me revenir – je suis déjà mort noyé ! J’ai senti l’eau me submerger. L’eau, la neige et la glace. Toi aussi tu étais là ! Je me demande si cette inondation ne nous était pas destinée, et si ce n’est pas par hasard que nous en avons réchappé. Je ne pense pas vraiment que nous devrions être là.
Iwa le regarda.
— Que veux-tu dire ?
— Que cette inondation, là, en dessous, était censée nous tuer !
— Eh bien, répondit Iwa lentement, apparemment concerné, on dirait qu’on ne l’a pas attendue…
Baï ne peut s’empêcher de rire. Sacré Iwa, va !
— Oui. Au diable l’inondation ! C’était une autre vie.
Les constructeurs de routes avaient cependant appris une bonne leçon qui ne leur avait pas causé trop de pertes (en vies humaines, en tout cas, car les pertes matérielles furent importantes). À présent, ils construisaient les routes en haut des canyons, là où leur pente était plus douce, y créant des corniches et des traversées, remontant très haut le long des gorges tributaires, construisant des ponts au-dessus de l’eau, prévoyant l’emplacement de batteries anti-aériennes, et même une petite piste d’atterrissage sur un épaulement presque plan près de Lukla. Jouer le rôle d’un bataillon du génie était beaucoup plus intéressant que se battre, ce que faisaient la plupart des troupes qui étaient restées dans les profondeurs du canyon, afin de le garder assez longtemps ouvert pour laisser aux trains le temps de le traverser. Ils n’arrivaient pas à croire à leur chance, ni à la chaleur des jours, ou à la réalité de cette vie loin du front, si luxueuse, à ce silence, à la douceur des muscles qui se détendent, à tout ce riz, et à ces légumes, curieux mais frais…
Puis ces jours heureux parurent se brouiller lorsque arriva le moment où toutes les routes, où toutes les voies furent enfin achevées. Ils prirent les premiers trains qui redescendaient, et campèrent dans une grande plaine verte, poussiéreuse, car ce n’était pas encore la mousson. Division après division, on les dirigea vers le front, qui se trouvait à une distance variant tous les jours, quelque part à l’ouest. C’était là que ça se passait, maintenant.
Un matin, ils durent y aller, eux aussi. Ils voyagèrent toute une journée par le train, puis on les fit descendre et ils continuèrent à pied. Ils traversèrent une succession de ponts flottants, jusqu’à ce qu’ils se retrouvent quelque part près de Bihar. Une autre armée y avait déjà établi son campement. Des alliés. Alliés, quel concept ! Des Indiens qui étaient ici chez eux, et faisaient mouvement vers le nord après avoir contenu l’avancée des hordes musulmanes qui descendaient vers le sud du continent, depuis près de quarante ans. Maintenant c’était à leur tour d’avancer et de traverser l’Indus. Maintenant, c’était au tour des musulmans de risquer d’être coupés en deux par un mouvement en tenaille qui enserrait toute l’Asie Quelques-uns étaient déjà piégés en Birmanie, le gros de la troupe étant toujours dans l’Ouest et commençant obstinément une lente retraite.
Iwa bavarda alors pendant plus d’une heure avec quelques officiers travancoriens, parlant en népalais, qu’il avait lui-même pratiqué quand il était enfant. Les officiers et les soldats indiens étaient petits et noirs de peau. Les hommes comme les femmes étaient rapides et agiles, propres, bien habillés, bien armés – fiers, voire arrogants, dans la mesure où ils assumaient le plus gros de l’attaque musulmane, et qu’ils avaient évité à la Chine d’être conquise en ouvrant un second front. Iwa les approcha, sans trop savoir si discuter de la guerre avec eux était une si bonne idée que ça.
Mais Baï était impressionné. Le monde ne serait peut-être pas réduit en esclavage, après tout. La percée en Asie du Nord semblait au point mort, les montagnes de l’Oural étant en quelque sorte l’équivalent de la Grande Muraille de Chine pour la Horde d’Or et les Franjs, même si d’après les cartes les choses se passaient agréablement loin, à l’ouest. Par ailleurs, avoir franchi l’Himalaya en force face à une telle résistance, avoir rallié les armées indiennes et coupé le monde de l’islam en deux…
— La guerre maritime pourrait bien faire passer au second plan le conflit en Asie…, dit Iwa, un soir, alors qu’ils s’étaient assis par terre pour manger un peu de riz dont la teneur en épices paraissait vouloir venger les défunts sommets du Chomolungma.
Entre deux bouchées incendiaires, transpirant abondamment, il ajouta :
— Pendant cette guerre, nous avons connu deux ou trois nouvelles générations d’armes, révolutionnant généralement à chaque fois la technologie. De nouveaux canons, tous plus énormes les uns que les autres, de nouveaux navires, et maintenant de nouveaux avions. Il arrivera, assurément, un jour où la seule chose qui comptera vraiment pour un pays sera le nombre de ses avions et de ses bombardiers. Le gros de la bataille se livrera dans les cieux, et ceux qui en auront le contrôle pourront larguer des bombes plus grosses que celles que pourrait envoyer n’importe quel canon, pile sur la capitale de l’ennemi. Sur ses usines, sur ses palais, sur ses bâtiments gouvernementaux.
— Bien, dit Baï, au moins ce sera plus propre. Viser la tête et frapper fort. C’est ce que Kuo dirait.
Iwa approuva avec un énorme sourire, en pensant à la façon dont Kuo l’aurait dit. Sans compter que le riz d’ici n’avait rien à voir avec celui que leur faisait Kuo.
Les généraux de la Quatrième Assemblée des Talents Militaires rencontrèrent les généraux indiens, et ils s’accordèrent à dire qu’il fallait construire plus de voies ferrées en direction du front ouest. Il se préparait une offensive combinée, c’était clair, et chacun y allait de ses supputations. Ils resteraient en réserve pour protéger leurs lignes arrière des forces musulmanes toujours stationnées dans la péninsule malaise ; ou bien ils seraient embarqués dans des bateaux à l’embouchure du Gange sacré, et emmenés sur la côte arabe afin d’attaquer La Mecque même ; ou alors, on les ferait débarquer sur les plages des péninsules au nord de la Franji ; et ainsi de suite. Mais jamais aucune de ces histoires ne disait comment ils rentreraient chez eux.
Finalement, ils marchèrent vers l’avant, comme d’habitude, vers l’ouest, tenant le flanc droit qui longeait les contreforts du Népal, des collines qui surgissaient, abruptes et vertes, de la plaine du Gange – comme si, remarqua Iwa un jour en passant, l’Inde était une sorte de bateau bélier qui était rentré dans l’Asie, s’était glissé par en dessous, poussant jusqu’au Tibet, et doublant la hauteur de la terre là-bas, tout en s’enfonçant pratiquement sous le niveau de la mer ici.
Baï secoua la tête devant ce fantasme géomorphologique. Il ne voulait pas voir les continents comme de grands navires en mouvement ; pour lui la Terre était solide. Il essayait de se convaincre que Kuo et lui s’étaient trompés, qu’il était toujours en vie, et pas dans le bardo – où, bien sûr, les continents pouvaient se déplacer comme les scènes de théâtre qu’ils étaient. Kuo avait probablement été désorienté par sa propre mort brutale, et ne savait plus du tout où il était. Ce n’était pas très bon signe pour sa prochaine incarnation. Ou bien il avait juste voulu faire une blague à Baï – Kuo pouvait se montrer cruellement moqueur, même s’il le faisait assez rarement. Dans le fond, peut-être qu’il avait rendu service à Baï en le convainquant qu’il n’avait rien à redouter du reste de la guerre puisque de toute façon il était déjà mort ; et qu’effectivement il livrait combat à un niveau où cela avait un sens, où cela pouvait servir à quelque chose, où cela pouvait peut-être changer l’âme des gens dans cet endroit, hors du monde, où elle avait une chance de changer, d’apprendre ce qui comptait vraiment, afin qu’ils aient, dans leur prochaine vie, un cœur plus grand, un esprit plus entreprenant.
Qu’en feraient-ils alors ? Et pour quoi se battaient-ils ? Il n’était pas difficile de savoir contre quoi ils se battaient : contre des hordes de fanatiques esclavagistes et réactionnaires, qui voulaient que le monde ne change jamais, un peu comme autrefois les dynasties Tang ou Sung –, d’absurdes zélotes, des religieux passéistes et sanguinaires –, des assassins sans scrupules, qui se battaient l’esprit embrumé par l’opium, aveuglés par d’anciennes croyances. Contre tout ça, bien sûr, mais pour quoi ? Ce pour quoi les Chinois combattaient, décida Baï, c’était… la clarté, ou pour l’inverse de la religion, quoi que ça puisse être. Pour l’humanité. Pour la compassion. Pour le bouddhisme, le taoïsme, le confucianisme, ce trépied qui convenait si bien à une description du monde : une religion sans dieu, rien qu’avec le monde, et aussi d’autres royaumes potentiels de réalité, des royaumes de l’esprit, et le vide lui-même – une religion sans dieu, sans berger pour les guider en ressassant toutes sortes d’interdits dignes d’un vieux patriarche dément, une religion plutôt peuplée d’innombrables esprits immortels dans une vaste panoplie de royaumes et d’êtres, dont les humains, et bien d’autres choses conscientes, tout ce qui vit, tout ce qui est sacré, tout ce qui était dans la tête de Dieu – parce que oui, il y avait bien un DIEU, au sens d’une entité transcendantale universelle consciente d’elle-même et qui était la réalité proprement dite, le cosmos, avec tout ce qu’il comporte, y compris les idées humaines, les formes et les relations mathématiques. Cette idée elle-même était Dieu, et évoquait une sorte de culte qui était l’attention que l’on devait au vrai monde, une sorte d’étude naturelle. Le bouddhisme chinois était l’étude naturelle de la réalité, et pouvait susciter des sentiments de dévotion juste parce qu’on avait remarqué le vert d’un arbre, les couleurs du ciel, des animaux passant au loin, le mouvement d’un bûcheron ou d’une porteuse d’eau. Cette étude initiale de la dévotion menait à une compréhension plus profonde des mathématiques sous-jacentes à la nature des choses, par pure curiosité, et parce que ça semblait les aider à y voir plus clair. C’est pourquoi ils fabriquaient des instruments permettant de voir les choses plus en détail, ou plus loin, un yang plus haut, un yin plus profond.
Il s’ensuivait une sorte de compréhension de la réalité humaine qui plaçait la compassion au-dessus de toutes les valeurs, une compassion issue d’une compréhension éclairée, elle-même issue de l’étude de ce qui se trouvait là, dans le monde. C’est ce qu’Iwa passait son temps à dire, pendant que Baï préférait penser aux émotions suscitées par ces mêmes efforts d’attention et de compréhension : la paix, une curiosité aiguisée, un intérêt débridé – la compassion.
Mais en attendant : quel cauchemar ! Un cauchemar où tout s’accélérait, quoi qu’on fasse, partant dans toutes les directions et plein d’incohérences, comme un rêveur sentant les rapides mouvements de l’œil qui précèdent le réveil, et l’ouverture à un nouveau jour. Chaque jour nous nous réveillons dans un nouveau monde, chaque sommeil engendre une nouvelle réincarnation. Certains gourous locaux disent que cela se produit à chaque nouveau souffle.
Ils quittèrent donc le bardo pour partir dans le monde réel, faire la guerre, avec leur aile gauche composée de ces régiments de vétérans indiens, de petits hommes noirs et barbus, de plus grands, blancs et au nez crochu, de Sikhs, barbus et enturbannés, de femmes au buste généreux, de Gurkhas descendus de leurs montagnes, et même une escouade de Népalaises, si belles qu’on aurait dit que chacune était la reine de beauté de son quartier. À les voir tous ensemble, on avait l’impression d’un cirque, mais ils étaient très rapides, très bien armés, et se déplaçaient en train ou dans de longues files de camions. Les Chinois n’arrivaient pas à les suivre. Alors, on bâtit plus de voies ferrées, et les Chinois essayèrent de les rattraper, en envoyant vers l’ouest des milliers d’hommes avec tout leur matériel. Mais quand les voies ferrées s’arrêtaient, les Indiens continuaient d’avancer rapidement, à pied, ou dans des voitures à roues de caoutchouc qui, par centaines, traversaient sans encombre les routes des villages, sèches en cette saison, soulevant des nuages de poussière, ou sur les rares réseaux de routes goudronnées qu’on rencontrait parfois, les seules où l’on pourrait encore rouler quand arriverait la mousson.
Ils avancèrent à peu près tous ensemble vers Delhi, et tombèrent sur une armée musulmane qui fuyait sur les deux rives du Gange, parce que les Chinois avaient pris position au pied des collines népalaises.
Bien sûr, le flanc droit s’étendait jusqu’aux collines, chaque armée essayant de dépasser l’autre. Les escadrons de Baï et d’Iwa furent considérés comme des troupes de montagne à cause de leur expérience dans le Dudh Kosi, et bientôt vinrent les ordres de prendre et de tenir les collines, au moins la première crête, ce qui voulait dire s’emparer de quelques points plus hauts, sur les chaînes de montagnes beaucoup plus au nord. Ils se déplaçaient la nuit, apprenant à gravir des pistes trouvées et balisées par leurs éclaireurs gurkhas. Baï lui-même prit l’habitude de partir en reconnaissance toute la journée, et alors qu’il crapahutait dans des ravines encombrées de broussailles, il s’inquiétait, non pas d’être découvert par les musulmans – parce qu’ils paraissaient ne pas vouloir bouger de chez eux, de leurs routes, de leurs camps – mais plutôt de savoir si des centaines d’hommes pourraient suivre les sentiers tortueux qu’il était obligé d’emprunter pour franchir certains cols.
— C’est pour ça qu’ils t’ont envoyé, expliqua Iwa. Si tu peux le faire, alors n’importe qui peut y arriver.
Il sourit et ajouta :
— C’est ce que Kuo aurait dit.
Chaque nuit, Baï allait inspecter de haut en bas la piste qu’ils suivraient, s’assurant que toutes les routes étaient aussi bonnes que prévu, apprenant, étudiant, et n’allant se coucher qu’après avoir regardé le soleil se lever depuis sa nouvelle cachette.
C’est ce qu’ils faisaient lorsque les Indiens se présentèrent sur leur flanc sud. Ils entendirent au loin des tirs d’artillerie, puis virent des plumets de fumée dans le ciel blanc d’un matin brumeux, la brume étant le signe que la mousson approchait. Lancer un gigantesque assaut alors que la pluie menaçait dépassait l’entendement ; il était fort probable que cette idée figurerait bientôt en tête de la liste récemment augmentée des Sept Bourdes Majeures, et alors que les nuages de l’après-midi apparaissaient, grossissaient et noircissaient au-dessus d’eux, lardant les contreforts des collines et les vallées de terribles éclairs qui frappaient les parties métalliques des nombreuses pièces d’artillerie éparpillées sur les crêtes, il était impressionnant de voir que les Indiens continuaient d’avancer à toute allure, comme si de rien n’était. Parmi toutes les choses qu’ils avaient accomplies, ils avaient notamment mené à la perfection l’art de faire la guerre sous la pluie. Ce n’étaient ni des rationalistes tao-bouddho-chinois, convinrent Baï et Iwa, ni la Quatrième Assemblée des Talents Militaires, mais des hommes libres, ayant toutes sortes de religions, et même plus religieux que les musulmans, puisqu’il semblait que l’islam n’était que rage et vœux pieux, et ne souhaitait que l’établissement du gouvernement tyrannique de Dieu le Père – enfin, le leur. Les Indiens avaient une myriade de dieux, certains à tête d’éléphant, d’autres avec six bras. Même la mort était un dieu, à la fois mâle et femelle – la vie, la noblesse, il y avait des dieux pour tout. Chacune des qualités de l’homme était déifiée. Ce qui donnait un peuple bigarré de croyants, de farouches guerriers, entre autres – de grands cuisiniers, un peuple très sensuel. Parfums, saveurs, musique, uniformes chamarrés, art du détail, tout cela se retrouvait dans leurs camps, ostensiblement, les hommes et les femmes se tenant debout à côté d’un joueur de tambour et chantant, les femmes, grandes, à forte poitrine, avec de grands yeux et d’épais sourcils, des femmes terribles en fait, avec des bras de bûcherons, et présentes dans tous les régiments de tireurs d’élite indiens.
— Oui, reconnut en tibétain un adjudant indien, les femmes tirent mieux que les hommes, et notamment les femmes de Travancore. C’est probablement dû au fait qu’elles commencent à tirer dès l’âge de cinq ans. Apprenez à tirer aux garçons dès l’âge de cinq ans, et ils tireront aussi bien.
Maintenant les pluies étaient pleines de cendres noires, qui transformaient l’eau en boue sombre. Une pluie noire. On appela Baï et Iwa : leurs escadrons devaient se rendre dans la plaine aussi vite que possible. L’assaut général approchait. Ils descendirent les pistes en courant, se regroupèrent à une vingtaine de lis en arrière de la ligne de front et se mirent en marche. Ils devaient rejoindre ce qui tenait lieu d’arrière-garde aux assaillants, et stationner dans la plaine elle-même, mais juste dans le piémont des collines, de façon à pouvoir s’y réfugier en cas de résistance.
Enfin, c’était le plan prévu. Mais alors qu’ils approchaient du front, ils apprirent que les musulmans avaient cédé et que c’était la débandade. Ils devaient participer à leur poursuite.
Les musulmans fuyaient vraiment très vite, les Indiens les talonnaient, et les Chinois ne pouvaient rien faire d’autre que suivre les deux armées si rapides, dans les champs, les forêts, par-dessus les canaux ou à travers des ouvertures dans les barrières de bambous ou les murs, des hameaux trop petits pour être appelés villages, tous vides et silencieux, généralement brûlés, et qui pourtant les ralentissaient sans qu’on pût dire pourquoi. Des tas de cadavres, déjà en train d’enfler. Tout le sens de l’incarnation était ici rendu manifeste par son opposé, la désincarnation, la mort – le départ de l’âme, laissant si peu de choses derrière elle : une masse putréfiée, un hachis du genre de celui qu’on trouvait dans les saucisses. Cela n’avait rien d’humain. À part, çà et là, un visage épargné, parfois même paisible ; cet Indien par exemple, allongé sur le sol et regardant de côté, parfaitement immobile, figé, ne respirant pas ; la statue de ce qui avait dû être jadis un homme très impressionnant, costaud, large d’épaules, capable – un visage autoritaire, avec des moustaches, un front immense, des yeux comme ceux des poissons sur les étals des marchés, ronds, étonnés, et pourtant impressionnants. Baï dut réciter un charme pour réussir à passer à côté de lui, puis ils parvinrent à une zone où la terre elle-même fumait, comme la zone neutre de Gansu, des mares d’eau empoisonnée, puantes, leur surface argentée luisant au ciel plein de fumée et de poussière, sentant la cordite et le sang. Le bardo lui-même devait ressembler à peu près à cela, encombré par de si nombreux arrivants, fâchés, confus, souffrants, la pire façon d’entrer au bardo. Ici se trouvait son reflet vide, déchiqueté et immobile. L’armée chinoise passait au travers en silence.
Baï trouva Iwa, et ils traversèrent ensemble les ruines calcinées de Bodh-Gaya, en direction d’un parc sur la rive ouest du Phalgu. C’était là que l’arbre du Bouddha poussait autrefois, leur dit-on, le vieil arbre assattha, l’arbre pipai, sous lequel le Bouddha avait reçu l’illumination tant de siècles auparavant. Cet endroit avait été aussi bombardé que le sommet du Chomolungma, et il n’y avait plus trace d’arbre, de parc, de village ni de rivière, rien qu’une terre boueuse, noire, retournée, à perte de vue.
Puis Kuo se planta devant Baï.
— La branche est coupée, lui dit-il, en lui offrant de la main gauche une brindille de l’arbre du Bouddha.
Sa main droite manquait toujours. Baï prit la branche, et le remercia :
— Kuo, dit-il en déglutissant, je suis surpris de te revoir.
Kuo le dévisagea.
— Alors c’était vrai, nous sommes vraiment dans le bardo ? demanda Baï.
Kuo hocha la tête.
— Tu ne me crois toujours pas, hein ? Et pourtant, c’est la vérité. Regarde !
Il fit un geste en direction de la plaine noire, fumante.
— Le plancher de l’univers. Encore.
— Mais pourquoi ? demanda Baï. Je ne comprends pas.
— Comprends pas quoi ?
— Je ne comprends pas ce que je suis supposé faire. Vie après vie… je me les rappelle, maintenant !
Il y réfléchit un instant, les revoyant à travers les années.
— Oui, je me les rappelle, et j’ai essayé, à chaque fois. J’essaye encore !
Derrière le rideau de fumée noire de la plaine, il leur semblait voir les pâles échos des images de leurs vies passées, dansant dans la lumière soyeuse d’une légère bruine.
— On dirait que ça ne fait jamais aucune différence. Ce que je fais n’a aucune importance.
— Mais si, Baï. Mais en fait, tu es idiot. Un putain d’idiot très naïf.
— Arrête, Kuo. Je ne suis pas d’humeur.
Pourtant, sur son visage, se lisait une pénible ébauche de sourire. Après tout, il n’était pas si mécontent que ça d’être un peu taquiné. Iwa et lui avaient bien essayé de temps à autre de se taquiner un peu, mais nul n’y arrivait comme Kuo.
— Je ne suis peut-être pas un aussi bon chef que toi, mais j’ai pourtant fait quelques bonnes choses, et ça n’a jamais rien changé. Aucune des règles du dharma ne semble s’y rattacher.
Kuo s’assit à côté de lui, croisa les jambes, s’installant confortablement.
— Bon, qui sait. J’ai déjà réfléchi plusieurs fois à tout ça, moi aussi, pendant que j’étais dans le bardo. Et cela a duré longtemps, crois-moi – tellement de monde a été balancé ici, en une seule fois, qu’il y a maintenant une sacrée file d’attente. C’est exactement comme le reste de cette guerre, un cauchemar logistique, et je n’ai pas cessé de vous regarder lutter, vous jetant les uns sur les autres comme des mouches contre une vitre, ainsi que je l’avais fait moi aussi, et j’ai réfléchi. Je me suis dit alors que quelque chose avait peut-être mal tourné, autrefois, quand j’étais Kheim et toi Bouton d’Or, cette petite fille que nous aimions tous. Tu te souviens ?
Baï secoua la tête en signe de dénégation.
— Dis-moi.
— Étant Kheim, j’étais annamite. J’étais l’un des éléments de cette fière lignée d’amiraux chinois peu recommandables, venus de l’étranger. J’avais été un roi pirate pendant des années, sévissant le long des côtes d’Annam, et les Chinois avaient signé un traité avec moi comme ils l’auraient fait avec n’importe quel potentat. Au terme de ce traité j’acceptai de prendre la tête de leur armée d’invasion de Nippon, en tout cas la tête de la partie maritime, et peut-être plus.
» Quoi qu’il en soit, nos projets échouèrent à cause du manque de vent, mais nous avons poursuivi notre route et découvert les continents océaniques. Puis nous t’avons trouvée, prise avec nous, perdue, et sauvée du dieu exécuteur du peuple du Sud. C’est là que j’ai senti que quelque chose clochait, alors que nous redescendions de la montagne après t’avoir récupérée. J’ai tourné mon arme vers des gens, j’ai appuyé sur la gâchette, senti le pouvoir de vie ou de mort entre mes mains. Je pouvais les tuer, et ils ne l’auraient pas volé. C’étaient des sauvages, des cannibales sanguinaires, des tueurs d’enfants. Je pouvais le faire, rien qu’en pointant mon arme vers eux. Et j’ai alors pensé qu’une telle puissance devait forcément avoir un sens. Que notre supériorité militaire devait provenir d’une supériorité plus large, que notre morale elle-même était supérieure. Que nous valions mieux qu’eux. Je suis parti vers le bateau et j’ai mis le cap à l’ouest en ressentant toujours ce même sentiment de supériorité, comme si nous étions des dieux face à ces horribles sauvages. Et c’est pour ça que Bouton d’Or est morte. Tu es mort pour m’apprendre que j’avais tort – et que, bien que l’ayant sauvée, nous l’avions tuée aussi. Que ce sentiment que nous avions alors éprouvé, celui de marcher parmi eux comme s’ils n’étaient que des chiens, était un poison qui ne cesserait jamais de courir dans les veines de tous ceux qui tiennent un fusil. Jusqu’à ce que tous ceux qui comme Bouton d’Or vivent en paix sans jamais tenir d’arme soient morts, tués par nous. De telle sorte qu’il n’y aura plus que des hommes avec des fusils, qui se tireront dessus les uns les autres, le plus vite possible dans l’espoir que cela ne leur arrivera pas, à eux, jusqu’à ce que tous les hommes soient morts, et que nous tombions tous dans ce royaume des prêtas, et de là, en Enfer.
» Ainsi, notre jati est liée à celle de tous ceux avec qui nous vivons, quoi qu’on fasse, et ce n’est pas grâce à toi, je te le dis encore, Baï, quand on considère ta tendance à te montrer d’une naïveté confondante, à te sentir coupable, et ta radicale inefficacité parce que tu es trop gnan-gnan et le cœur sur la main…
— Hé, dit Baï. Ce n’est pas juste. Je t’ai aidé. J’ai fait tout ce chemin avec toi.
— Eh bien oui, c’est exact. Je te l’accorde. En tout cas, maintenant nous sommes tous dans le bardo, en route pour un royaume inférieur, au mieux le royaume des humains, mais peut-être même un peu plus bas, en route dans une de ces affreuses spirales qui mènent vers l’enfer, et qui nous guettent toujours, là en dessous… De toute façon c’est en cours, et on n’y peut rien changer, quoi qu’on fasse, l’humanité ne sera même pas un rêve pour nous, pendant encore quelque temps, nous avons fait tant de mal ! Putains d’enculés ! Bordel, parce que tu crois que je n’ai pas essayé ?
Kuo se releva d’un bond, très énervé.
— Est-ce que tu crois que tu es le seul au monde à avoir essayé de faire le bien ?
Il agita son moignon devant Baï, puis le tendit vers les cieux, bas et gris.
— Mais nous avons échoué ! Nous avons détruit la réalité elle-même, est-ce que tu comprends ? Est-ce que tu comprends ?
— Oui, répondit Baï.
Il se tenait à présent les genoux dans les mains, et tremblait.
— Je comprends.
— Très bien. Maintenant, nous sommes dans un de ces royaumes inférieurs. Il faut faire avec. Notre dharma nous commande de faire le bien, même ici. Dans l’espoir d’avancer vers le haut, même un peu. Jusqu’à ce que la réalité revienne, grâce aux efforts conjugués de millions de personnes. Le monde entier devra être reconstruit. C’est là que nous en sommes.
Il tapota doucement l’épaule de Baï en signe d’adieu. Puis il s’en alla, s’enfonçant un peu plus dans la boue à chaque pas, jusqu’à disparaître entièrement.
— Hé ! l’appela Baï. Kuo ! Ne pars pas !
Peu après, Iwa vint le voir et se tint debout devant lui, le regardant sans comprendre.
— Alors ? demanda Baï en levant la tête de ses genoux et en se redressant. Qu’est-ce qu’il y a ? Ils vont sauver l’arbre du Bouddha ?
— Ne t’inquiète pas pour l’arbre, dit Iwa. Ils prendront une pousse d’un arbre-fille à Lanka. Ils l’ont déjà fait. Mieux vaut s’occuper des gens.
— Pour eux aussi il va falloir prendre d’autres pousses. Et faire pousser de nouvelles vies. Quand les choses iront mieux ! cria-t-il à l’adresse de Kuo. Quand les choses iront mieux !
Iwa lâcha un profond soupir. Il s’assit juste là où Kuo s’était assis. La pluie se mit à tomber sur eux. Un long moment se passa, dans un profond silence.
— Le problème, dit Iwa, c’est qu’il n’y aura peut-être pas de prochaine vie. C’est ce que je crois. C’est comme ça. Fan Chen disait que l’âme et le corps étaient juste deux aspects d’une même chose. Il parle du tranchant et du couteau, comme images de l’âme et du corps. Sans couteau, pas de tranchant.
— Sans tranchant, pas de couteau.
— Non…
— Mais le tranchant dure, le tranchant ne meurt jamais…
— Regarde donc tous ces cadavres autour de nous. Ce qu’ils étaient ne sera jamais plus. Quand vient la mort, tout est fini.
Baï pensa à cet Indien, allongé, si immobile sur le sol.
— Tu es seulement égaré, dit-il. Bien sûr que tout n’est pas fini. J’en parlais avec Kuo, il n’y a pas une minute.
— Arrête de t’accrocher, Baï, dit Iwa en le regardant. C’est ce que le Bouddha a appris, ici même. N’essaye pas d’arrêter le temps. Personne ne peut le faire.
— Le tranchant dure. Je t’assure qu’il coupait aussi bien qu’autrefois !
— Il faut essayer d’accepter le changement. Et le changement mène à la mort.
— Puis au-delà de la mort.
Baï dit cela aussi joyeusement que possible, mais sa voix sonnait creux. Kuo lui manquait.
Iwa pensa à ce que Baï avait dit, le regardant de cet air qui semblait dire : Je me serais attendu à quelque chose d’un peu plus utile, de la part d’un bouddhiste assis sous l’arbre du Bouddha. Mais quoi ? Le Bouddha lui-même avait dit : La souffrance est réelle. Il faut lui faire face, vivre avec. On n’a pas le choix.
Après un certain temps, Baï se leva et retourna auprès des autres officiers, pour voir ce qu’ils faisaient. Ils étaient en train de chanter un soutra, probablement en sanskrit, se dit Baï. Et il se joignit à eux, en chantant doucement Lenyan jing en chinois. Au fil de la journée, des bouddhistes des deux armées vinrent se joindre à eux, par centaines. La boue était couverte de monde, priant dans toutes les langues du bouddhisme, debout sur cette terre brûlée qui fumait sous la pluie, d’une fumée qui s’étendait jusqu’à l’horizon, gris foncé et argent. Puis ils firent silence. Le cœur en paix, plein de compassion, de paix. Le tranchant restait en eux.
LIVRE 9
NSARA

1
Quand il y avait du soleil, le matin, les parcs au bord du lac s’emplissaient de promeneurs. Aux premiers jours du printemps, alors que la végétation n’arborait encore que de petits bourgeons verts porteurs des promesses d’une profusion de couleurs, les cygnes affamés se regroupaient à la surface luisante de l’eau noire bordant la promenade et se disputaient les bouts de pain sec que leur lançaient les enfants. C’était d’ailleurs l’une des activités favorites de Budur quand elle était plus petite. La vue de ces cygnes se chamaillant pour quelques quignons de pain la faisait toujours rire ; maintenant, elle regardait la nouvelle génération d’enfants s’amuser de la même façon, avec un pincement au cœur à l’idée de son enfance perdue, et parce qu’elle savait que si les cygnes étaient beaux et comiques, ils n’en étaient pas moins affamés et désespérés. Elle aurait aimé avoir le courage d’aller se joindre aux gamins pour jeter encore un peu de pain à ces pauvres bêtes. Mais le faire, à son âge, aurait paru bizarre. On l’aurait prise pour une de ces demeurées que l’on emmenait parfois faire un tour en dehors de l’école. Et puis, de toute façon, il n’y avait pas beaucoup de restes de pain à la maison.
La lumière jouant sur l’eau baignait les façades des maisons de l’autre côté de la promenade de tons chauds, citron, pêche, abricot, comme si elles brillaient d’une lumière intérieure, prisonnière de leurs pierres. Budur rentra chez elle à travers la vieille ville, longeant de vieux bâtiments aux murs de granit gris ou de bois noirci. Turi était une ancienne ville romaine. Elle avait d’abord été une halte sur la route traversant les Alpes. Père les avait une fois amenés dans un obscur col au milieu des montagnes appelé le Trou de Serrure, où l’on pouvait encore voir un tronçon d’ancienne voie romaine, zigzaguant à travers l’herbe comme le dos pétrifié d’un dragon, chasseur solitaire traquant les pieds des soldats ou des commerçants. Maintenant, après des siècles d’une vie obscure, Turi était enfin redevenue une ville d’étape – mais pour les trains –, et la plus grande ville de la Franji centrale, la capitale des Émirats Alpins Unis.
Le centre-ville était sillonné de trams grinçants et brinquebalants, mais Budur préférait marcher. Elle ne s’occupait pas d’Ahab, son chaperon ; elle l’aimait bien, lui, en tant que personne, elle appréciait cet homme sans prétentions, mais elle n’aimait pas son travail, qui consistait entre autres à l’accompagner dans chacune de ses sorties. Elle l’ignorait, par principe, parce que sa présence était une offense à sa dignité. Elle savait aussi qu’il rapporterait à Père ses moindres faits et gestes, et quand il lui dirait qu’elle l’avait superbement ignoré, le harem ferait une nouvelle fois part à Père de son mécontentement, quitte à le faire de façon indirecte.
Elle mena Ahab entre les maisons incrustées comme des joyaux dans la colline dominant la ville, jusqu’à la Grande Rue. Le mur entourant leur maison était magnifique. On aurait dit une sorte d’immense tapisserie ornée de lierre vert et de pierres dressées. Le portail en bois était surmonté d’une arche de pierre qui semblait sourdre d’un treillis de glycine. On avait l’impression qu’on aurait pu en retirer la clé de voûte sans le faire tomber. Ahmet, leur gardien, était confortablement installé dans la petite cahute en bois à l’entrée du portail, où il bavardait à n’en plus finir avec les visiteurs, allant jusqu’à offrir le thé à tous ceux qui osaient s’attarder.
Dans la maison, tante Idelba parlait au téléphone, qui était posé sur une table de la cour intérieure, sous un auvent, de telle sorte que tout le monde l’entendait. C’était une façon pour Père d’empêcher que l’on dise quoi que ce soit de fâcheux ; mais en vérité, tante Idelba parlait généralement de choses microscopiques, des lois mathématiques régissant les noyaux des atomes, et personne ne comprenait rien à ce qu’elle disait. Budur aimait l’écouter quand même, parce que cela lui rappelait un peu ces contes de fées que tante Idelba lui racontait le soir, au lit, quand elle était petite, ou bien les conversations qu’elle avait avec sa mère à la cuisine – la cuisine était l’une de ses passions, et elle pouvait vous débiter toute une série de recettes, d’ingrédients et d’ustensiles, qui ressemblait assez, par ce qu’elle avait de mystérieux et d’évocateur, aux longues péroraisons de tante Idelba au téléphone, comme si cette dernière concoctait en fait un nouveau monde. Parfois, d’ailleurs, quand elle raccrochait, l’air préoccupée et absente, et que Budur venait la serrer dans ses bras, elle finissait par admettre que oui, c’était tout à fait ça : les ilmi, les scientifiques, étaient en train de concocter un nouveau monde. Ou en tout cas, ils pourraient le faire. Un jour, elle raccrocha, les joues rouges, et esquissa quelques petits pas de danse dans la cour, chantant des syllabes sans suite ou la chansonnette qu’elle poussait en étendant le linge : « Dieu est grand, grand est Dieu, lave notre linge, lave nos âmes ! »
Cette fois-ci, elle raccrocha sans paraître apercevoir Budur et leva les yeux vers le petit bout de ciel bleu qu’on voyait depuis la cour.
— Qu’est-ce qu’il y a, Idelba ? Tu te sens hem ?
Hem était le terme qu’employaient les femmes pour définir ces petits vagues à l’âme sans cause apparente.
— Non, répondit Idelba en secouant la tête, ce n’est qu’un mushkil.
Un mushkil était un problème bien précis.
— Ah bon ? Quoi donc ?
— Eh bien… Pour dire les choses simplement : les chercheurs du laboratoire ont obtenu des résultats très étranges. En gros, c’est ça. Personne n’arrive à comprendre ce qu’ils signifient.
Le laboratoire, avec lequel Idelba venait de parler au téléphone, était désormais son principal contact avec le monde extérieur. Elle avait enseigné les mathématiques et fait de la recherche, à Nsara. Elle travaillait avec son mari sur l’infiniment petit. Mais sa mort prématurée avait mis au jour certaines irrégularités dans ses travaux, et Idelba avait perdu son unique source de revenus. Le poste qu’ils partageaient s’était révélé n’être en fin de compte que celui de son mari ; elle s’était donc retrouvée sans travail et à la rue. C’est du moins ce que Yasmina disait ; Idelba elle-même n’en avait jamais parlé. Elle était arrivée, un beau jour, avec une simple valise, en larmes. Elle voulait voir le père de Budur, son demi-frère. Il avait accepté de l’accueillir, un certain temps. C’est à cela, expliqua Père plus tard, que servent entre autres choses les harems ; ils permettaient d’accueillir les femmes qui n’avaient nulle part où aller.
— Votre mère et vous, les filles, vous passez votre temps à vous plaindre de ce système, mais, tout bien considéré, quel autre choix avez-vous ? Sinon la souffrance des femmes abandonnées serait insupportable.
En entendant cela, Mère et la cousine la plus âgée de Budur, Yasmina, râlaient et grondaient, le visage empourpré. Rema, Aïsha et Fatima les regardaient alors bizarrement, essayant de comprendre ce qu’elles auraient dû ressentir face à cet état des choses qui leur semblait après tout si naturel. Tante Idelba, quant à elle, ne se permettait jamais le moindre commentaire. Ni pour approuver ni pour désapprouver ce système. Parfois, une ancienne connaissance l’appelait au téléphone, notamment l’un de ses neveux, qui avait apparemment un problème et semblait penser que tante Idelba pourrait l’aider à le résoudre ; il appelait assez régulièrement. Un jour, Idelba essaya d’expliquer à Budur et à ses sœurs de quel genre de problème il s’agissait, à l’aide d’un tableau noir et d’une craie.
— Les atomes ont des coquilles, comme les sphères que l’on voit dans les cieux des vieux dessins. Ces coquilles entourent le centre de chaque atome, qui est petit mais lourd. Trois genres de particules s’agglutinent dans le cœur de l’atome ; certaines sont chargées de yang, d’autres de yin, et les dernières sont neutres, chacune à des degrés divers. Elles sont reliées entre elles par une très grande force, extrêmement puissante, mais également très localisée, et qui diminue très vite quand on s’éloigne du cœur de l’atome.
— Comme dans un harem, commenta Yasmina.
— Oui, si tu veux. En fait, c’est plutôt comme la gravité. Mais, de toute façon, il y a une sorte de répulsion ki entre chacune des particules, que cette force contrebalance, créant une sorte de compétition entre elles deux et – grossièrement – les autres forces existantes. Maintenant, certains métaux très lourds sont composés de tellement de particules qu’un certain nombre parviennent à s’échapper, une par une. Ces particules en fuite laissent une trace caractéristique derrière elles, à des vitesses distinctes. Là-bas, à Nsara, ils ont obtenu des résultats étranges à partir d’un métal particulièrement lourd, un élément plus lourd encore que l’or, en fait, le plus lourd des éléments connus à ce jour, appelé l’alactin. Ils le bombardent de particules neutres, et obtiennent des résultats vraiment étranges, sur tous les plans, et très difficiles à expliquer. Le cœur lourd de cet élément semble instable.
— Comme Yasmina !
— Oui, bravo, c’est très intéressant que tu dises ça, parce que même si ce n’est pas vrai, cela illustre parfaitement cette manie que l’on a de toujours chercher un moyen de se représenter ces choses qui sont si petites qu’on ne peut pas les voir.
Elle se tourna vers le tableau noir, puis revint à ses étudiantes – qui n’avaient rien compris. Une émotion indéchiffrable passa sur son visage, et s’estompa.
— Enfin, c’est encore un de ces phénomènes inexplicables. Restons-en là pour l’instant. Il faudra procéder à d’autres expériences au laboratoire.
Ensuite, elle se mit à gribouiller en silence pendant plusieurs heures. Des nombres, des lettres, des idéogrammes chinois, des équations, des points, des traits, des schémas – qui ressemblaient un peu aux illustrations de ces épais traités où il était question de l’Alchimiste de Samarkand.
Après un temps, elle ralentit le rythme et s’étira.
— Il faudra que j’en parle à Piali, dit-elle.
— Il n’est pas à Nsara ? lança Budur.
— Si, si.
Budur comprit que c’était d’ailleurs visiblement l’un des éléments de son mushkil.
— Nous en parlerons par téléphone, c’est ce que je voulais dire.
— Parle-nous un peu de Nsara, lui demanda Budur pour la millième fois peut-être.
Idelba haussa les épaules. Elle n’était pas d’humeur. D’ailleurs, elle ne l’était jamais. Elle mettait toujours un moment à franchir les barrières du regret qui la séparaient de cette époque. Son premier mari l’avait répudiée vers la fin de sa période de fertilité, alors qu’elle n’avait pas eu d’enfants ; son second mari était mort jeune. Ça faisait beaucoup à surmonter. Mais quand Budur avait la patience de la suivre sur la terrasse et dans le dédale des chambres, elle finissait souvent par y arriver. Peut-être le fait de passer de chambre en chambre l’y aidait-il, peut-être que chaque chambre correspondait à l’un des endroits où elle avait vécu, comme s’il y avait également des chambres dans nos têtes, avec le ciel pour plafond, les collines pour murs, et les immeubles pour mobilier. On vivait peut-être ainsi, passant d’une chambre à une autre, dans une structure plus grande. Les chambres les plus vieilles continuaient d’exister tout en ayant disparu, ou bien avaient été vidées, comme si dans la réalité on ne pouvait traverser qu’une seule chambre à la fois. Parfois, on restait coincé, comme en prison ; et pourtant, par la pensée…
D’abord, Idelba commençait par parler du temps qu’il faisait à Nsara, de l’Atlantique, agité par les orages, où l’eau, le vent, les nuages, la pluie, la brume, le brouillard, la grêle, et parfois même la neige, s’éclipsaient, chassés par le soleil, bas sur l’horizon. Une lumière dorée illuminait alors le rivage, l’embouchure du fleuve et les quais de cette gigantesque ville qui emplissait la vallée jusqu’en Anjou. En fait, tous les États d’Asie et de Franji étaient venus là, dans l’Ouest, dans cette ville la plus à l’ouest, à la rencontre de cet autre grand flux venu de l’autre côté de la mer, de ces gens du monde entier, comme ces Hodenosaunees si beaux, et ces réfugiés d’Inka, grelottant sous leur poncho, dont les bijoux en or éclaboussaient de petits reflets métalliques la grisaille des après-midi d’hiver. Tous ces étrangers faisaient de Nsara un endroit fascinant, disait Idelba, comme le faisaient également les ambassades importunes, chinoises et travancoriennes, venues faire appliquer les accords d’après-guerre, installées là tels les monuments de la défaite des musulmans, dans leurs blocs d’immeubles sans fenêtres à l’arrière du quartier du port. Idelba décrivait cela les yeux brillants, d’une voix vibrante, et quand elle ne se retenait pas, elle finissait par s’exclamer :
« Nsara ! Nsara ! Ohhh, Nssssssssssarrrrra ! »
Alors, parfois, elle s’asseyait, par terre au besoin, et se prenait la tête dans les mains, dépassée par tout ça. Budur était sûre que c’était la plus excitante et la plus extraordinaire ville au monde.
Les Travancoriens y avaient bien évidemment établi une de leurs écoles monastiques bouddhiques, ainsi qu’ils l’avaient fait dans chaque ville et cité du monde, apparemment, une école dotée des facultés et laboratoires les plus modernes, jouxtant les vieilles madrasas et mosquées qui continuaient de fonctionner globalement comme depuis l’an 900. À côté des moines et des professeurs bouddhistes, les clercs des madrasas paraissaient bien ignorants et bien provinciaux, disait Idelba. Mais les nouveaux venus se montraient toujours très respectueux des pratiques musulmanes, n’intervenant jamais, toujours courtois, et, le temps passant, un certain nombre de professeurs soufis et de religieux réformateurs avaient fini par construire leurs propres laboratoires. Ils avaient même suivi l’enseignement des monastères pour préparer les cours sur les lois naturelles qu’ils donneraient dans leurs madrasas.
— Ils nous ont donné le temps d’avaler et de digérer la pilule arrière de notre défaite, disait Idelba à propos des bouddhistes. Ce fut très malin de la part des Chinois, cette façon de rester en arrière et de laisser ces gens leur servir d’émissaires. Ainsi, nous ne voyons jamais vraiment à quel point les Chinois peuvent être brutaux. Nous pensons que ce sont les Travancoriens qui ont tout fait.
Budur avait pourtant l’impression que les Chinois n’avaient pas été aussi durs qu’ils auraient pu l’être. Les sommes exigées en réparation étaient raisonnables, même Père le reconnaissait, et si elles ne l’étaient pas, les dettes finissaient toujours par être oubliées, voire abandonnées. D’ailleurs en Franji, au moins, les hôpitaux et les écoles monastiques bouddhiques étaient les seuls signes apparents que les vainqueurs imposaient leur volonté – ou à peu près ; ce côté obscur, l’ombre de leurs conquérants, l’opium, devenait de plus en plus courant dans les cités franjs, et Père déclara, furieux, après avoir lu les journaux, que puisque tout venait d’Afghanistan ou de Birmanie, alors leur transport par bateau jusqu’en Franji devait certainement être autorisé par les Chinois. Même à Turi on voyait dans les cafés des quartiers ouvriers, près de l’embouchure du fleuve, ces pauvres âmes abruties par la fumée à l’odeur étrange. Idelba disait qu’à Nsara la drogue était très répandue, comme dans toutes les grandes villes du monde, bien que ce fut une ville islamique ; en fait, la seule capitale islamique à n’avoir pas été détruite par la guerre : Konstantiniyye, Le Caire, Moscou, Téhéran, Zanzibar, Damas et Bagdad avait été bombardés et n’étaient pas encore complètement reconstruits.
Nsara avait traversé la guerre sans encombre, et était devenue la ville des soufis, des scientifiques – la ville d’Idelba ; elle y était allée après avoir passé son enfance à Turi et dans la ferme familiale des Alpes ; elle y était même allée à l’école, et les formules mathématiques lui avaient parlé, comme à haute voix, depuis les pages des manuels ; elle les comprenait, elle connaissait cet étrange langage alchimique. De vieux messieurs lui en expliquèrent la syntaxe, qu’elle s’appliqua à suivre, et à force de travail elle développa ses connaissances, et commença à se faire connaître du petit monde des études de la matière microscopique en publiant ses premières spéculations théoriques alors qu’elle n’avait pas vingt ans.
— Les esprits jeunes sont souvent les plus forts en mathématiques, expliqua-t-elle plus tard, alors qu’elle n’était plus impliquée dans ces travaux.
Elle avait intégré les laboratoires de Nsara, où elle avait aidé le célèbre Lisbi et son équipe à assembler un accélérateur de particules, elle s’était mariée, avait divorcé, puis, apparemment très vite, et plutôt mystérieusement, (mais ça c’était ce que pensait Budur), elle s’était remariée, sans qu’on en entendît vraiment parler à Turi. Elle avait encore travaillé, avec beaucoup de plaisir, en compagnie de son second mari, qui était mort très brutalement. Son retour à Turi, sa retraite étaient tout aussi mystérieux pour Budur, qui lui demanda un jour :
— Est-ce que tu portais le voile, là-bas ?
— Quelquefois, répondit Idelba, ça dépendait. Le voile a une sorte de pouvoir, dans certaines situations. Tous ces signes renvoient en fait à autre chose ; ce sont des phrases exprimées à l’aide de matière. Le hijab peut dire aux étrangers : « Je suis islamiste, et solidaire avec les hommes de mon pays, contre vous, contre le monde entier. » Aux hommes de l’islam, il dira : « J’accepte de jouer à ce jeu idiot, cette espèce de lubie que vous avez, mais seulement si en échange vous faites ce que je vous demande. » Pour certains hommes, cet échange, cette forme de capitulation devant l’amour, est une sorte de soulagement de cette folie que suppose le fait d’être un homme. Ainsi, porter le voile c’est un peu comme mettre un manteau d’une reine magicienne.
Puis, face à l’expression émerveillée de Budur, elle crut bon d’ajouter :
— Mais cela peut être aussi comme un collier d’esclave, c’est certain.
— Alors, tu ne le portais pas toujours ?
— D’habitude, je ne le portais pas. Au laboratoire, cela aurait été franchement idiot. Je portais une djellaba de laboratoire, comme les hommes. Nous étions là pour étudier les atomes, pour étudier la nature. Quoi de plus proche de Dieu ! Et de plus asexué ? Il n’est tout simplement pas question de sexe. Alors, tu peux voir les gens avec qui tu travailles face à face, âme à âme.
Les yeux brillants, elle cita une phrase d’un vieux poème :
— « À chaque instant vient une épiphanie qui fend les montagnes en deux. »
C’était ainsi que les choses s’étaient passées pendant la jeunesse d’Idelba ; et maintenant elle était là, dans le petit harem de classe moyenne de son frère, « protégée » par lui d’une façon qui lui valait de fréquentes crises de hem, ce qui en vérité faisait d’elle une personne d’humeur changeante, comme une Yasmina qui aurait été plus encline au secret qu’au bavardage. Seule avec Budur, alors qu’elles étendaient le linge sur la terrasse, elle regardait le sommet des arbres dépassant les murs et soupirait :
— Si seulement je pouvais encore me promener au petit matin parmi les rues vides de la ville ! Ce bleu, puis ce rose – refuser ça à quelqu’un est absurde. Refuser le monde à quelqu’un, et prétendre que c’est pour son bien, c’est de l’obscurantisme ! C’est inacceptable !
Mais elle ne s’enfuyait pas. Budur ne comprenait pas bien pourquoi. Assurément, Idelba aurait pu descendre la colline en tramway et aller à la gare, prendre le train pour Nsara, trouver un logement quelque part, et un travail quelconque. Si elle ne le faisait pas, qui le ferait ? Quelle femme en serait capable ? Sûrement pas une femme de bonne réputation. Si Idelba n’y arrivait pas, personne ne le ferait. La seule fois où Budur osa lui poser cette question, elle se contenta de hocher la tête gravement, et répondit :
— Il y a aussi d’autres raisons. Mais je ne peux pas t’en parler.
La présence d’Idelba dans la maison avait donc pour Budur quelque chose d’un peu effrayant, qui lui rappelait chaque jour que la vie d’une femme pouvait s’écraser comme un avion tombant du ciel. Et plus ça durait, moins Budur s’y faisait, et elle remarqua qu’Idelba elle-même commençait à s’agiter, passant de pièce en pièce, un livre à la main, marmonnant, ou bien plongée dans ses papiers, à côté d’une énorme machine à calculer, qui était une sorte de réseau de fils avec des voyants lumineux de toutes les couleurs. Elle pouvait rester des heures à écrire sur son tableau noir, et la craie crissait, cliquetait, voire sautait de ses doigts. Elle parlait au téléphone, en bas, dans la cour, l’air tantôt agacée, tantôt contente ; dubitative ou excitée – et tout ça à propos de chiffres, de lettres, de valeur de ceci ou de cela, de forces et de faiblesses, d’attractions entre des choses microscopiques que personne ne verrait jamais. Un jour, alors que Budur regardait ses équations, elle dit :
— Tu sais, Budur, il y a vraiment beaucoup, beaucoup d’énergie contenue à l’intérieur des choses. Chandalaa, de Travancore, est vraiment le plus grand penseur que l’on ait jamais eu sur Terre ; on pourrait même dire que la Longue Guerre a été une catastrophe rien que parce qu’il y est mort. Mais il nous a laissé beaucoup de choses, et notamment la formule de l’équivalence masse-énergie. Regarde, la masse est une mesure de poids, disons – tu la multiplies par le carré de la vitesse de la lumière – tu la multiplies par un demi-million de lis à la seconde, tu vois un peu ! Tu te rends compte combien ça fait ? Le résultat est absolument énorme, rien que pour une toute petite quantité de matière. C’est l’énergie ki contenue à l’intérieur. Une mèche de tes cheveux est bourrée d’encore plus d’énergie que n’en déploie une locomotive.
— Pas étonnant que j’aie tant de mal à y passer la brosse, dit timidement Budur.
Idelba éclata de rire.
— J’ai dit une bêtise ? demanda Budur.
Idelba ne répondit pas tout de suite. Elle était perdue dans ses pensées, absente. Puis elle regarda Budur.
— Quand les choses vont mal, c’est parce que nous les faisons aller mal. C’est ainsi. Rien dans la nature n’est faux en soi.
Budur n’était pas tout à fait d’accord avec elle. La nature faisait les hommes et les femmes, la nature faisait la chair, le sang, les cœurs, les règles, les sentiments amers… parfois tout cela paraissait faux à Budur, comme si le bonheur était un morceau de pain rassis, pour lequel les cygnes affamés de son cœur se battaient.
Les femmes n’avaient pas le droit d’aller sur le toit de la maison ; on aurait pu les y voir depuis les terrasses des maisons situées sur la colline, à l’est de Turi. Les hommes non plus n’y allaient jamais, alors que c’était un si bel endroit, d’où l’on pouvait contempler, par-dessus les arbres de la rue, les Alpes jusqu’au lac de Turi. Alors, quand tous les hommes étaient partis et qu’Ahmet dormait dans son fauteuil à côté du portail, tante Idelba et la cousine Yasmina prenaient les poteaux où l’on mettait le linge à sécher et les utilisaient comme les montants d’une échelle. Elles les plaçaient dans deux jarres à olives et les attachaient ensemble avec des cordes, sur lesquelles elles grimpaient en faisant bien attention, tandis que les filles en dessous tenaient les poteaux. Elles montaient ainsi sur le toit, la nuit, sous les étoiles, dans le vent, chuchotant pour qu’Ahmet ne les entende pas, chuchotant, parce que sinon elles se seraient mises à crier, de toute la force de leurs poumons. Au clair de lune, les Alpes se détachaient nettement sous le ciel, à la façon de ces décors de carton qui servent de fond aux théâtres de marionnettes, parfaitement verticales, l’image même de ce que les montagnes devaient être. Yasmina avait apporté ses chandelles et ses poudres afin de réciter les formules qui rendraient fous ses admirateurs – comme s’ils ne l’étaient pas déjà. Mais Yasmina avait un insatiable désir du regard des hommes, sans doute encore aiguisé par le fait qu’il n’y en avait aucun dans le harem. Son encens de Travancore s’élevait en volutes dans la nuit, bois de santal, musc, safran, nag champa… Toutes ces odeurs exotiques montaient à la tête de Budur, lui faisant voir le monde d’une façon complètement différente. Le lui faisant voir plus vaste, plus mystérieusement significatif – les choses étaient pleines de sens, comme des vases emplis d’eau, à ras bord. Chaque chose devenait son propre symbole, la lune le symbole de la lune, le ciel le symbole du ciel, les montagnes le symbole des montagnes, tout cela baigné dans la mer bleu sombre du désir. Le désir, l’essence même du désir, douloureux et beau, plus grand que le monde.
Mais une nuit, alors que c’était pourtant la pleine lune, Idelba n’organisa aucune expédition sur le toit. Elle avait passé de nombreuses heures au téléphone, ce mois-là, et après chaque conversation s’était montrée particulièrement éteinte. Elle n’avait pas dit aux filles de quoi elle avait parlé, ni avec qui, bien qu’à son attitude Budur pensât qu’il devait s’agir de son neveu, comme d’habitude. Mais elle ne leur en avait pas pipé mot.
C’est peut-être ce qui fit que Budur se montra attentive et sensible à certains changements. Une nuit de pleine lune, elle dormit à peine, se réveillant toutes les heures pour voir les ombres se déplacer sur le sol, se réveillant de rêves où elle fuyait, apeurée, à travers les rues d’une vieille ville, pour échapper à quelque chose qu’elle ne parvenait jamais à bien voir. Un peu avant l’aube, elle fut réveillée par un bruit provenant de la terrasse, et regarda par sa petite fenêtre. Dehors, Idelba était en train de transporter les poteaux qui servaient à étendre le linge, de la terrasse à la cage d’escalier. Puis les jarres d’olives.
Budur sortit dans le couloir et alla voir par la fenêtre qui donnait sur la cour de devant. Idelba appuyait leur échelle contre le mur de la propriété, juste au coin de la maison d’Ahmet, à côté du portail. Elle passerait le mur non loin d’un grand orme qui poussait dans la ruelle entre leur maison et celle des voisins.
Sans un instant d’hésitation, sans même prendre le temps de réfléchir, Budur retourna en courant dans sa chambre, s’habilla, puis dévala les escaliers et sortit dans la cour, derrière la maison, regardant un peu partout pour s’assurer qu’Idelba était bien partie.
Ce qui était le cas. La voie était libre, Budur pouvait la suivre sans problème.
Cette fois, elle hésita ; et il aurait été difficile de décrire ses pensées à ce moment crucial de son existence. Aucun enchaînement d’idées n’occupait particulièrement son esprit, mais plutôt une sorte d’oscillation de sa vie entière : le harem, les humeurs de sa mère, l’indifférence que son père avait pour elle, le visage simplet d’Ahab, toujours sur ses talons comme un idiot, les larmes de Yasmina ; tout Turi en équilibre sur les deux collines bordant les deux rives du Limât et dans sa tête ; et par-dessus tout ça, il y avait de grosses masses nuageuses de sentiments, comme les nuages que l’on voyait parfois bouillonner au-dessus des Alpes. À la fois dans sa poitrine, et en dehors d’elle, elle avait l’impression que des milliers d’yeux la regardaient ; ceux des fantômes qui l’avaient, probablement, étudiée toute sa vie, qu’elle soit consciente ou non de leur présence, un peu comme des étoiles. Ou quelque chose d’approchant. C’est toujours comme ça, quand on décide de changer, quand on décide de se sortir de la routine du quotidien, de se débarrasser des œillères de l’habitude et de se tenir nu face à la vie. Et même si le monde est vaste, même s’il est sombre et qu’il y a du vent, c’est le moment de choisir. Oui, le monde paraît immense dans ces moments-là. Trop immense pour qu’on y vive. À la vue de tous les fantômes de la Terre. Au centre de l’univers.
Elle se jeta en avant. Courut vers l’échelle, grimpa rapidement ; comme quand elle montait sur le toit. L’orme était gros et solide, et elle n’eut aucune difficulté à descendre dans les branches basses pour sauter jusqu’au sol, ce qui la réveilla complètement. Ensuite, elle se releva en douceur, comme si tout cela était prévu depuis le début.
Elle sortit de la ruelle en tapinois, et, une fois dans la rue, elle regarda vers l’arrêt du tramway. Son cœur battait à tout rompre, et elle était en sueur malgré la fraîcheur de l’air. Elle pourrait prendre le tram ou bien descendre directement les rues étroites, si pentues qu’en bien des endroits elles étaient remplacées par des escaliers. Elle était sûre qu’Idelba était partie vers la gare, et si elle se trompait, elle renoncerait à la suivre.
Même avec un voile, il était encore trop tôt pour qu’une jeune fille de bonne famille prenne le tram toute seule ; en fait, il était toujours trop tôt pour qu’une jeune femme respectable sorte toute seule. Alors elle courut en direction de la première volée de marches d’une ruelle et commença à dévaler aussi vite que possible un parcours sinueux, à travers des parcs, des cours, des avenues, l’escalier dit « des roses », un tunnel fait d’érables japonais, rouges. Elle descendit plus bas encore, suivant la route familière qui menait à la vieille ville et au pont qui franchissait le fleuve, derrière lequel se trouvait la gare. Arrivée au pont, elle jeta un coup d’œil en amont, vers ce petit coin de ciel qui se dessinait entre les vieux bâtiments de pierre. De bleu, l’arche du pont virait au rose, encadrant le sommet du petit morceau de montagne visible au loin, pareil à une broderie lâchée à l’autre bout du lac.
Sa résolution commençait à flancher quand elle vit Idelba dans la gare. Elle regardait les horaires des trains. Budur se cacha derrière un lampadaire et courut par une porte de côté dans la gare, où elle trouva un autre horaire de chemin de fer. Le premier train pour Nsara partait de la voie 16, qui était à l’autre bout de la gare. Départ à cinq heures pile. Probablement dans pas longtemps. Elle regarda la pendule suspendue au-dessus des voies, sous l’énorme toit de fer et de verre ; il lui restait cinq minutes. Elle se glissa dans le dernier wagon.
Le train s’ébranla doucement et partit. Budur se déplaça vers l’avant, passant de wagon en wagon, se retenant au dossier des sièges, le cœur battant de plus en plus vite. Que dirait-elle à Idelba ? Et si Idelba n’avait pas pris le train ? Et si elle s’y trouvait seule, en route pour Nsara, sans un sou en poche ?
Mais Idelba était là. Assise sur un siège, elle se penchait pour regarder par la vitre. Budur prit son courage à deux mains, s’élança à travers le compartiment, courut vers elle en pleurant, se jeta dans ses bras et dit :
— Pardon, tante Idelba, je ne savais pas que tu irais aussi loin, je ne t’ai suivie que pour te tenir compagnie, j’espère que tu as un peu d’argent pour m’offrir mon billet…
— Par Allah tout-puissant ! s’écria Idelba.
Son visage exprima d’abord la surprise puis la colère ; mais surtout contre elle-même, se dit Budur en la voyant à travers ses larmes, même si elle passa un moment ses nerfs sur Budur, en disant :
— Je m’occupe de choses sérieuses moi, ce n’est pas un caprice de gamine ! Oh, mais qu’est-ce qui va se passer ? Qu’est-ce qui va se passer ? Je devrais te renvoyer immédiatement par le prochain train !
Budur se contenta de secouer la tête en pleurant de plus belle.
Le train roulait à toute allure en cliquetant, traversant un paysage qui semblait des plus fades, collines et fermes, fermes et collines, bosquets, pâturages, qui défilaient à une allure incroyable – si vite que regarder par la fenêtre lui donnait le vertige.
À la fin d’une longue journée, le train entra dans les faubourgs lugubres d’une ville comme Basruisseau mais en plus grand. Sur des lis et des lis, ce n’était que des blocs d’appartements et des maisons particulières derrière leurs murs, des bazars grouillants de monde, des mosquées de quartier et de grands immeubles de toutes sortes ; puis des paquets entiers d’immenses bâtiments, regroupés autour des nombreux ponts franchissant le fleuve, juste avant qu’il ne se jette dans l’estuaire ; et maintenant un port géant, protégé par une jetée qui était suffisamment large pour qu’on puisse y faire passer une rue, avec des magasins de chaque côté.
Le train les emmena directement au cœur de ce quartier de grands immeubles, où une gare, au toit de verre sale, donnait sur une large rue bordée d’arbres, une avenue séparée en deux par de grands chênes plantés sur un terre-plein central. Le port et la jetée n’étaient qu’à quelques pâtés de maisons. L’air sentait le poisson.
Une longue esplanade longeait la rive du fleuve, bordée d’une rangée d’arbres à feuilles rouges. Idelba descendit rapidement la corniche, qui ressemblait un peu à celle de Turi, mais en plus grande. Puis elle prit une petite rue bordée de maisons à deux étages, dont le rez-de-chaussée était occupé par des magasins et des restaurants. Elles entrèrent dans l’une de ces maisons et montèrent l’escalier. Elles se retrouvèrent sur le palier du premier étage, face à trois portes. Idelba sonna à celle du milieu, et la porte s’ouvrit. Elle donnait sur un appartement qui avait des allures de vieux palais en ruines.
2
Il s’avéra que ce n’était pas un vieux palais, mais plutôt un vieux musée. Aucune des salles n’était très grande ou très impressionnante, mais il y en avait beaucoup. Les faux plafonds, les couloirs sans plafond, les tapisseries et les revêtements muraux coupés au milieu indiquaient que des pièces naguère plus grandes avaient été divisées et redivisées en de plus petites. La plupart n’étaient meublées que d’un lit ou d’un divan, et l’immense cuisine était pleine de femmes, généralement maigres, qui préparaient à manger ou attendaient de manger. La pièce bruissait de leurs conversations et du ronflement des fours.
— C’est quoi cet endroit ? demanda Budur par-dessus le vacarme.
— Une zawiyya, répondit Idelba. Une sorte de pension de famille pour femmes. Un anti-harem, lâcha-t-elle avec un sourire amer.
Elle expliqua qu’il y en avait beaucoup au Maghreb, et que la mode s’était répandue en Franji. La guerre avait tué trop d’hommes, laissant de nombreuses femmes seules – même si la désolation avait durement frappé hommes et femmes. Ces vingt dernières années, pendant lesquelles plus de civils que de soldats avaient trouvé la mort, les brigades de femmes avaient été aussi nombreuses chez les Chinois que chez les musulmans. Mais Turi, comme tous les autres émirats des Alpes, avait envoyé moins d’hommes au front que les autres pays, préférant les garder dans les usines d’armement. C’est pourquoi Budur avait plus entendu parler du problème des classes creuses qu’elle ne l’avait réellement constaté. Quant aux zawiyyas, Idelba disait qu’elles étaient théoriquement illégales, les lois régissant l’accès des femmes à la propriété n’ayant pas encore été modifiées. Mais le recours à des prête-noms masculins, et d’autres astuces légales, avait permis d’en régulariser plusieurs dizaines, voire centaines.
— Pourquoi ne t’es-tu pas installée dans une de ces maisons, après la mort de ton mari ? demanda Budur.
— J’avais besoin de prendre un peu de recul, répondit Idelba en se rembrunissant.
On leur donna une chambre à trois lits, pour elles deux. Le troisième lit servirait de table et de bureau. La pièce était poussiéreuse, et leur petite fenêtre donnait sur d’autres fenêtres, aux carreaux sales, par-delà une cheminée d’aération. Les bâtiments de cet endroit étaient tellement tassés les uns sur les autres qu’il avait fallu ménager des puits d’air au milieu.
Mais personne ne s’en plaignait. Un lit, une cuisine, des femmes autour de soi : Budur était contente. Pourtant, Idelba était encore préoccupée par quelque chose, qui avait un rapport avec son neveu Piali et son travail. Assise sur son lit, elle considérait Budur avec une détresse qu’elle ne pouvait dissimuler.
— Tu sais, je devrais te renvoyer chez ton père. J’ai déjà assez d’ennuis comme ça.
— Pas question.
Idelba la regarda.
— Quel âge as-tu, déjà ?
— Vingt-trois ans.
Enfin, elle les aurait dans deux mois.
Idelba fut surprise.
— Je te croyais plus jeune.
Budur baissa les yeux, écarlate.
— Désolée, fit Idelba avec une grimace. C’est à cause du harem. Et parce qu’il n’y a plus d’hommes à épouser… Mais écoute, il faut bien que tu fasses quelque chose.
— Je veux rester ici !
— Quand même, il faut que tu dises à ton père où tu es, et que ce n’est pas moi qui t’ai enlevée.
— Il va venir me chercher !
— Non. Je ne crois pas. De toute façon, il faut que tu lui dises quelque chose. Appelle-le, ou écris-lui.
Mais Budur avait peur de parler à son père, même au téléphone. L’idée d’une lettre était intéressante. Elle pourrait s’expliquer sans révéler précisément où elle était.
Elle écrivit donc :
Cher Père, chère Mère,
Quand Tante Idelba est partie, je l’ai suivie sans qu’elle le sache. Je suis venue habiter à Nsara, pour y faire des études. Le Coran dit que toutes les créatures d’Allah sont égales sous Son regard. Je vous écrirai toutes les semaines, à vous ainsi qu’au reste de la famille pour vous tenir au courant. Je vous promets d’être bien sage, et de ne pas faire honte à la famille. Je suis dans une bonne zawiyya, avec Tante Idelba, qui veillera sur moi. Il y a ici beaucoup d’autres jeunes femmes qui font cela, et elles m’aideront. J’étudierai à la madrasa. Transmettez toute mon affection à Yasmina, Rema, Aïsha, Nawah et Fatima.
Votre fille qui vous aime,
Elle posta sa lettre, et ne pensa plus à Turi. Après leur avoir écrit, elle se sentit moins coupable. Elle régla les formalités pour étudier à l’Institut dépendant de la madrasa, puis, alors que les semaines passaient entre ses études, le ménage, la cuisine et toutes les autres tâches auxquelles elle participait dans la zawiyya, elle comprit que son père ne lui répondrait jamais. Sa mère était une illettrée. Ses cousines avaient probablement reçu l’interdiction de lui écrire ; et peut-être lui en voulaient-elles de les avoir quittées. On n’enverrait pas son frère la chercher, ce dont il n’avait d’ailleurs probablement pas envie. De même que la police ne viendrait pas l’arrêter, pour la renvoyer, sous bonne garde, à Turi. Ce genre de chose ne se faisait plus. Il y avait littéralement des milliers de femmes qui fuyaient de chez elles, et bon débarras ! Ce qui avait passé pendant des années, à Turi, pour un système de lois et de coutumes immémoriales, universelles, n’était rien de plus en fait que les vestiges d’habitudes imposées par un fragment moribond d’une société conservatrice, perdue dans ses montagnes, s’ingéniant à inventer toutes sortes de « traditions » panislamistes au moment même où celles-ci disparaissaient partout dans le monde – comme une brume au petit matin, ou (plus approprié) la fumée d’un champ de bataille. Elle ne reviendrait pas, c’était aussi simple que ça ! Personne ne l’y obligerait. De toute façon, personne n’en avait envie ; ça aussi c’était un peu choquant. Il y avait des moments où elle avait moins l’impression d’être partie que d’avoir été abandonnée.
Mais il y avait cette vérité qui la frappait chaque jour, quand elle sortait de la zawiyya : elle ne vivait plus dans un harem. Elle pouvait aller où bon lui semblait, quand elle voulait. Et cela suffisait à lui faire éprouver un sentiment bizarre, une sorte d’ivresse. Elle était ivre, de liberté, de solitude, et presque trop heureuse, au point d’en être un peu désorientée et même légèrement paniquée. Un jour, alors qu’elle était envahie de cette euphorie, elle vit un homme, de dos, sortir de la gare, et pensa pendant un instant que c’était son père. Elle en fut heureuse, soulagée. Mais ce n’était pas lui. Ses mains tremblèrent pendant toute la journée. Elle était à la fois en colère, honteuse, effrayée, et mélancolique.
Cela se reproduisit. Plusieurs fois même, et elle en vint à considérer cette expérience comme une sorte de fantôme entrevu dans un miroir ; sa vie passée revenue la hanter : son père, ses oncles, son frère, ses cousins… En fait, il s’agissait à chaque fois d’étrangers, mais qui leur ressemblaient juste assez pour la faire sursauter, lui faire battre le cœur, apeurée. Elle les aimait, pourtant. Elle aurait été si heureuse de les savoir fiers d’elle, de savoir qu’ils tenaient assez à elle pour venir la chercher. Mais si cela impliquait de retourner au harem, alors elle ne voulait plus jamais les revoir. Jamais plus elle ne se soumettrait à un quelconque règlement. Même les règles normales, ordinaires, provoquaient chez elle un sursaut de colère, un NON radical et immédiat, qui l’emplissait comme un cri viscéral. L’islam, littéralement, voulait dire soumission. Mais NON ! Elle avait perdu cette faculté. Qu’une policière lui fasse signe de ne pas traverser la route du port, particulièrement encombrée, en dehors du passage protégé, et Budur la maudissait. Même les règles de la zawiyya la faisaient grincer des dents. Et n’oublie pas de laver ton assiette ! Et n’oublie pas d’aider à la lessive du jeudi ! NON !
Mais toute cette colère n’était rien en comparaison du fait qu’elle était libre. Elle se réveillait le matin, se rappelait où elle était et bondissait de son lit pleine d’une énergie stupéfiante. Une heure de travail acharné à la zawiyya, et elle avait fait sa toilette, s’était habillée, avait pris son petit déjeuner, avait fait sa part des travaux collectifs, la vaisselle, nettoyé les salles de bains, effectué toutes ces corvées répétitives, toutes ces corvées qui, à la maison, étaient faites par des domestiques – mais il valait tellement mieux consacrer une heure à ce travail que d’obliger d’autres personnes à y sacrifier leur vie entière ! Il était évident que c’était un modèle de relations et de travail humain !
Cela fait, elle sortait respirer l’air humide et salé de la mer, pareil à une drogue fraîche. Elle avait parfois une liste de courses à faire, parfois seulement sa sacoche d’étudiante, pleine de livres, de cahiers et de stylos. Où qu’elle aille, elle passait d’abord au port, regarder l’océan au bout de la jetée et les drapeaux claquer au vent. Par une belle matinée, elle alla au bout de la jetée, sans but précis. Personne au monde ne savait où elle était. Elle seule le savait. Mon dieu, que c’était bon ! Le port grouillait de bateaux, l’eau brune s’écoulait vers le large emportée par la marée, le ciel était un lavis de bleu pâle, et tout d’un coup elle se sentit éclore. Un océan de nuages battait dans sa poitrine. Elle pleurait de bonheur. Ah, Nsara ! Nssssssarrrrrra !
Mais la première tâche qui figurait sur sa liste, souvent, le matin, consistait à se rendre au Foyer des invalides de guerre du Croissant Blanc, de grands baraquements militaires reconvertis, assez loin dans le parc au bord du fleuve. C’était l’une des occupations qu’Idelba lui avait suggérées, et Budur trouvait cela à la fois contraignant et stimulant – c’était ce qu’aurait dû être, mais n’avait jamais été, la mosquée du vendredi. La majeure partie de ces baraquements et de l’hôpital était occupée par quelques milliers de soldats aveuglés par les gaz de combat, sur le front de l’Est. Ils passaient la matinée assis sans dire un mot, dans leur lit, dans un fauteuil ou une chaise roulante, selon le cas, et quelqu’un leur faisait la lecture, généralement une femme : le journal du jour, aux minces pages qui noircissaient les doigts, parfois le Coran ou les hadiths, même si ceux-ci étaient moins populaires. Beaucoup de ces hommes avaient été à la fois blessés et aveuglés, et ne pouvaient ni marcher ni se bouger. Ils restaient assis là, la moitié du visage ou les jambes arrachées, conscients, apparemment, de l’aspect qu’ils devaient offrir, tournés vers la personne qui leur faisait la lecture, l’air à la fois honteux et avides, comme s’ils l’auraient volontiers tuée et mangée, s’ils l’avaient pu, sous le coup d’un amour impossible, d’un amer ressentiment, ou les deux à la fois. Budur n’avait jamais vu d’expressions aussi crues de sa vie, et elle s’efforçait souvent de garder les yeux baissés sur le texte qu’elle lisait, craignant peut-être que, si elle les regardait, ils ne s’en rendent compte et n’aient un mouvement de recul ou un sifflement réprobateur. Du coin de l’œil, elle voyait un public de cauchemar, à croire que l’un des niveaux de l’enfer avait surgi des profondeurs, levant le rideau sur ses habitants, qui attendaient de savoir à quelle sauce on allait les manger, comme ils avaient attendu et été dévorés dans la vie. Mais elle avait beau faire, chaque fois qu’elle leur faisait la lecture, Budur en voyait plus d’un pleurer, quoi qu’elle lise, même si ce n’était que la météo de Franji, d’Afrique ou du Nouveau Monde. À vrai dire, le temps était l’un de leurs sujets préférés.
Parmi les autres lectrices, il y avait des femmes très ordinaires qui avaient néanmoins de belles voix, graves et claires, musicales, des femmes qui chantaient toute leur vie sans le savoir (d’ailleurs, si elles l’avaient su, l’effet aurait été gâché). Quand elles lisaient, bien des auditeurs se redressaient sur leur lit, dans leur fauteuil roulant, captivés, amoureux d’une femme à qui ils n’auraient pas accordé un regard s’ils avaient pu la voir. Et Budur vit que certains des hommes se penchaient en avant de la même façon pour elle, bien qu’à ses propres oreilles sa voix ait des accents désagréablement haut perchés et rocailleux. Mais il y en avait à qui cela plaisait. Elle leur lisait parfois des histoires de Schéhérazade, s’adressant à eux comme s’ils étaient le colérique roi Shahryar, et elle la rusée narratrice, restant en vie une nuit de plus. Par un midi brumeux, émergeant de cette antichambre de l’enfer dans la lumière irisée du soleil, elle fut saisie, jusqu’au vertige, par une évidence : cette vieille histoire s’était inversée ; Schéhérazade était libre de s’en aller, alors que les Shahryar étaient à jamais prisonniers de leurs corps démantibulés.
3
Ce devoir accompli, elle traversait le bazar pour se rendre à ses cours, où elle étudiait des matières conseillées par tante Idelba. L’Institut de la madrasa était une dépendance du monastère et de l’hôpital bouddhiques. Budur y suivait trois cours, qu’Idelba payait pour elle : statistiques élémentaires (en fait, au départ, des mathématiques de base), comptabilité et histoire de l’islam.
Cette dernière matière était enseignée par une femme appelée Kirana Fawwaz, une Algérienne courtaude, à la peau mate et à la voix rauque de fumeuse impénitente. On lui donnait quarante ou quarante-cinq ans. La première fois qu’elle rencontra ses élèves, elle leur dit qu’elle avait servi dans les hôpitaux militaires, pendant la guerre, puis, vers la fin de la Nakba (ou Catastrophe, ainsi qu’on appelait souvent la guerre), dans les brigades de femmes du Maghreb. Cependant, elle n’avait rien à voir avec les soldats du Foyer du Croissant Blanc ; elle était sortie victorieuse de la Nakba, et déclara lors de ce premier cours qu’ils auraient dû gagner, s’ils n’avaient pas été trahis à la fois à l’intérieur et hors de leurs frontières.
— Trahis par quoi ? demanda-t-elle de sa voix rauque de corbeau, voyant leurs visages étonnés. Je vais vous le dire : par les religieux. Par nos hommes, d’une façon plus générale. Et par l’islam lui-même.
Sa classe ne la quittait pas des yeux. Quelques élèves baissèrent la tête, mal à l’aise, comme s’ils s’attendaient à ce que Kirana se fasse arrêter sur-le-champ, à moins qu’un éclair ne la foudroie. En tout cas, au moins, elle se ferait écraser avant la fin de la journée par un tram surgi d’on ne sait où. Il y avait plusieurs hommes dans la salle, dont l’un était assis juste à côté de Budur. Il portait un bandeau sur un œil. Pourtant, aucun d’eux ne broncha, et le cours se poursuivit comme si tout le monde pouvait dire des choses pareilles et s’en sortir sans histoires.
— L’islam est la dernière des vieilles religions monothéistes du désert, disait Kirana. C’est donc un phénomène tardif, une anomalie. Il a succédé aux premiers monothéismes des campagnes du Moyen-Occident, qui existaient déjà, plusieurs siècles avant Mahomet, et s’est greffé sur eux : le christianisme, les Esséniens, les Juifs, les Zoroastriens, les adorateurs de Mithra, etc. C’étaient dans tous les cas des patriarcats rigoureux, qui avaient remplacé de plus anciens polythéismes matriarcaux, créés par les premières civilisations agricoles, où les dieux habitaient chaque plante domestique, et où les femmes étaient tenues pour essentielles pour tout ce qui touchait à l’alimentation et à la vie.
» L’islam était donc un arrivant tardif, une version révisée des premiers monothéismes. Et en tant que tel, il aurait pu être le meilleur des monothéismes, ce qu’il était par bien des côtés. Mais parce qu’il avait vu le jour dans une Arabie déchirée par les guerres de l’empire romain et celle des États chrétiens, il avait dû faire face dans un premier temps à une situation d’anarchie quasi totale, de guerre tribale opposant les uns aux autres, et où les femmes étaient à la merci de n’importe quel petit groupe d’hommes en armes. De ces abîmes-là, aucune religion n’aurait pu s’élever bien haut.
» C’est dans ce contexte que Mahomet arriva, prophète s’efforçant de faire le bien, de ne pas succomber à la guerre, et à travers qui Dieu était réputé parler – dans bien des cas, il s’agissait de babillages, ainsi que le Coran l’atteste.
Cette remarque souleva quelques cris étouffés, et plusieurs femmes se levèrent et sortirent. Les hommes, en revanche, restèrent tous, médusés.
— En tout cas, que ce fût la parole de Dieu ou de simples babillages, peu importe : dans un premier temps, il en sortit plutôt du bien. De formidables progrès eurent lieu dans le domaine des lois, de la justice, des droits de la femme et, d’une manière générale, de la place et du rôle réservés à l’homme dans l’histoire. D’ailleurs, ce fut très exactement ce sens de la justice et du divin qui donna à l’islam un pouvoir unique au cours des premiers siècles de son existence, alors qu’il se répandait dans le monde en dépit du fait qu’il n’apportait aucune nouveauté matérielle – encore une des preuves radicales que ce qui fait vraiment avancer l’histoire, ce sont les idées, et rien qu’elles.
» Puis vint le temps des califes, des sultans, des divisions, des guerres, des religieux et de leurs hadiths. Les hadiths prirent le pas sur le Coran proprement dit. Ils s’emparèrent de toutes les bribes un tant soit peu misogynes de la pensée globalement féministe de Mahomet, et les cousirent au linceul dans lequel ils venaient d’enfermer le Coran, dont le propos était bien trop radical pour pouvoir être promulgué, en tant que tel. Des générations de religieux misogynes rédigèrent des monceaux de hadiths qui n’étaient en rien justifiés par le Coran. Ils réinstaurèrent donc une tyrannie injuste, se réclamant fréquemment, et faussement, de la parole d’un étudiant qui la tenait d’un maître – toujours des hommes évidemment ; comme si un mensonge passant à travers trois, dix générations d’hommes pouvait se métamorphoser en vérité. Ce qui n’est pas le cas.
» C’est ainsi que l’islam, comme le christianisme et le judaïsme avant lui, se mit à stagner, et dégénéra. Mais il était si répandu que cet échec et cet effondrement furent difficiles à voir ; et en effet, il aura fallu la Nakba pour que les choses se voient enfin. Cette perversion de l’islam nous a valu de perdre la guerre. Ce sont les droits de la femme, et rien d’autre, qui ont donné la victoire à la Chine, à Travancore et au Yingzhou. C’est l’absence de droits de la femme en islam qui a transformé la moitié de sa population en une sorte de cheptel improductif et illettré, et nous a fait perdre la guerre. Les fabuleux progrès intellectuels et techniques qui avaient vu le jour au temps des premiers scientifiques de l’islam ont été récupérés et poursuivis par les moines bouddhistes de Travancore et de la diaspora japonaise ; et cette révolution des capacités mécaniques fut rapidement développée par la Chine et les États libres du Nouveau Monde ; par tout le monde en fait, sauf par le Dar al-Islam. Au beau milieu de la guerre nous voyagions encore à dos de chameau. Nos routes n’ont jamais eu que la largeur nécessaire pour permettre à deux dromadaires de se croiser. Pas une de nos villes qui ne ressemblât à une casbah ou à une médina, avec des maisons serrées les unes contre les autres comme des étals de bazar. Quoi d’étonnant à ce que rien n’ait pu être fait pour moderniser les choses. Seule la destruction des centres-villes au cours de la guerre nous a permis de les reconstruire de manière plus moderne, et seules nos tentatives désespérées pour essayer de nous défendre nous ont fait nous tourner, enfin, vers un semblant de progrès. Mais c’était insuffisant, et beaucoup trop tard.
À ce stade du cours de Kirana Fawwaz, la salle était nettement moins pleine qu’au début. Deux demoiselles s’étaient même exclamées, en sortant, outrées, qu’elles allaient rapporter ces propos blasphématoires aux religieux et à la police. Mais Kirana Fawwaz se contenta de prendre le temps d’allumer une cigarette, leur fit un petit signe de la main leur enjoignant de déguerpir au plus vite, et poursuivit, calmement, inexorablement, comme si de rien n’était :
— Aujourd’hui, après le désastre de la Nakba, tout doit être reconsidéré. Tout. Il faut regarder chaque racine, chaque branche, chaque feuille de l’islam, si nous voulons l’améliorer – si c’est possible. C’est une question de vie ou de mort pour notre civilisation. Mais en dépit de cette nécessité pourtant tellement évidente, les fondamentalistes ne cessent de radoter leurs vieux hadiths comme des sortilèges capables d’invoquer les djinns, et dans des États comme l’Afghanistan, le Soudan, ou même dans certains coins de Franji – dans les Émirats alpins ou au Skandistan par exemple –, le Hezbollah règne, les femmes doivent porter le tchador ou le hijab, sont cloîtrées dans des harems, et les hommes au pouvoir dans ces États se croient encore en l’an 300, à Bagdad ou à Damas, et s’imaginent que Haroun al-Rachid va sortir d’une lampe à huile pour arranger les choses. Ils feraient aussi bien de devenir chrétiens et de croire que les cathédrales vont recommencer à jaillir et que Jésus va descendre des cieux sur les ailes des anges.
4
En écoutant parler Kirana, Budur revoyait les aveugles de l’hôpital ; les résidences, cachées derrière leur mur, le long des rues de Turi ; le visage de son père tandis qu’il faisait la lecture à sa mère ; l’océan ; une tombe blanche dans la jungle ; toute sa vie en fait, et bien des choses auxquelles elle n’avait jamais pensé auparavant. Elle en était bouche bée, abasourdie, effrayée – mais aussi exaltée, par chacune de ses paroles, si choquantes : cela confirmait tout ce qu’avait toujours suspecté la petite fille révoltée, bridée, qu’elle avait été, prisonnière de la maison de son propre père. Elle avait passé sa vie à se dire que quelque chose en elle n’allait pas – en elle, dans le monde, ou dans les deux. Et voilà que la réalité s’ouvrait sous ses pieds comme une trappe. Tous ses pressentiments venaient de trouver une éclatante confirmation. Elle se cramponnait à son siège, pétrifiée, regardant leur professeur, comme hypnotisée par un grand faucon tournoyant dans le ciel au-dessus de sa proie, hypnotisée non seulement par ce qui ressortait de colère de son analyse des causes de l’échec, mais aussi par l’image qu’elle suscitait de l’histoire elle-même, cet immense chapelet d’événements qui les avait menés à ce moment, ici et maintenant, dans cette ville portuaire occidentale battue par la pluie ; hypnotisée comme si Kirana avait été l’oracle du temps personnifié, s’adressant à eux de sa voix de corbeau, intense et rocailleuse. Il s’était déjà passé tellement de choses, Nahdas après Nakbas, pas à pas ; que dire après tout ça ? Il fallait avoir du courage ne serait-ce que pour oser en parler.
Et du courage, il était clair que cette Kirana Fawwaz n’en manquait pas. C’est alors qu’elle s’interrompit et parcourut du regard la classe à moitié vide.
— Bien…, dit-elle chaleureusement.
Elle adressa un sourire à Budur, dont les yeux écarquillés devaient la faire ressembler à l’un de ces poissons stupéfaits, étalés sur la glace des poissonniers.
— Maintenant que tous ceux qui devaient partir sont partis, il ne reste plus que ceux qui ont assez de cœur au ventre pour oser s’aventurer dans ce sombre territoire : le passé !
Ceux qui avaient du cœur au ventre ou n’avaient pas les couilles de partir, se dit Budur, en jetant un coup d’œil autour d’elle. Un vieux soldat manchot regardait imperturbablement devant lui. Le borgne était toujours assis à côté d’elle. Plusieurs femmes d’âges divers et variés regardaient autour d’elles, mal à l’aise, en se tortillant sur leur banc. Quelques-unes parurent à Budur n’être que des femmes ordinaires. L’une d’elles souriait béatement. Cela ne ressemblait en rien à ce qu’Idelba lui avait dit de la madrasa de Nsara, et de l’Institut des Hautes Études ; c’étaient plutôt les épaves du Dar al-Islam, les pauvres survivants de la Nakba, des cygnes dans leur hiver ; des femmes qui avaient perdu leur mari, leur fiancé, leur père, leurs frères, des femmes restées seules et qui n’avaient plus eu depuis l’occasion de rencontrer un homme ; des blessés de guerre, dont un vétéran aveugle comme ceux à qui Budur faisait la lecture, et que sa sœur emmenait en classe, ou ce manchot, ou cet autre, avec un bandeau sur l’œil, assis à côté d’elle ; il y avait aussi deux Hodenosaunees, une mère et sa fille, dignes et sûres d’elles, à l’aise, intéressées, même si rien de tout cela ne les impliquait vraiment. Un docker au dos cassé paraissait ne venir ici que pour s’abriter de la pluie six heures par semaine. Tels étaient ceux qui étaient restés, les âmes perdues de la ville, à la recherche d’une activité d’intérieur sans trop savoir laquelle. Peut-être, pour le moment du moins, leur suffisait-il de rester ici à écouter les dures paroles de Kirana Fawwaz.
— Ce que je veux faire, dit-elle, c’est déchirer le voile de toutes ces histoires, ces millions d’histoires que nous nous sommes racontées pour nous protéger de la réalité, de la Nakba, et trouver une explication. Comprendre le sens de ce qui s’est passé, vous me suivez ? Il s’agit d’une introduction à l’histoire, comme celle de Khaldun, mais sous la forme d’une conversation. Je vous suggérerai différents projets de recherche au fur et à mesure que nous progresserons. Maintenant, allons boire quelque chose.
Elle les conduisit dans la pénombre de ces longues soirées du nord, vers un de ces cafés derrière les quais, où elle retrouva des relations issues d’autres pans de sa vie qui étaient déjà là, en train de prendre un dîner tardif, de fumer des cigarettes, de tirer sur un narguilé collectif ou de boire de petites tasses d’un café épais. Ils passèrent toute la soirée à discuter, jusque tard dans la nuit. Dehors, les quais étaient vides et calmes, les lumières de l’autre côté du port couraient sur les eaux noires. Il s’avéra que l’homme au bandeau sur l’œil était un ami de Kirana ; il s’appelait Hasan. Il se présenta à Budur et l’invita à s’asseoir à côté de lui et de ses amis – dont certains étaient des chanteurs et des comédiens de l’institut et des théâtres de la ville.
— Ma camarade étudiante, dit-il à ses amis, a été, je crois, assez saisie par le discours d’ouverture de notre professeur.
Budur hocha timidement la tête, et tous s’adressèrent à elle en jacassant. Elle commanda un café.
Les conversations autour des marbres salis couvraient tous les sujets, comme toujours dans ces endroits – et Turi ne faisait pas exception à la règle. Les nouvelles des journaux. Des considérations sur la guerre. Des ragots sur les notables de la ville. Ce qu’on disait des pièces et des films du moment. Kirana écoutait tout cela, parfois se taisant, parfois participant à la conversation comme si elle faisait encore cours.
— L’Iran est le vin de l’histoire, ils se font toujours pressurer…
— Il y a des années meilleures que d’autres…
— … pour eux, toutes les grandes civilisations finissent toujours par se faire écraser…
— C’est al-Katalan qui recommence, voilà tout. C’est trop facile.
— Une histoire du monde se doit d’être simple, dit le vieux soldat manchot.
Il s’appelait Naser Shah, ainsi que l’apprit Budur. Il parlait franjic avec un accent iranien.
— Le truc c’est d’aller droit aux causes des choses, de donner un sens à l’ensemble.
— Et s’il n’y en a pas ? demanda Kirana.
— Mais si, il y en a un, répondit Naser calmement. Tous les peuples de la Terre ont toujours interagi pour donner un sens global à l’histoire. L’histoire n’est qu’une. Certains de ses aspects sont facilement repérables. La théorie du choc des civilisations d’Ibrahim al-Lanzhou par exemple… Il ne fait aucun doute qu’il s’agit encore de yin et de yang, mais elle fait apparaître assez clairement que ce nous appelons le progrès est pour l’essentiel provoqué par le choc de deux cultures.
— Progresser en s’entrechoquant ! Tu parles d’un progrès ! Tu as vu ces deux trams, l’autre jour, quand l’un d’eux a déraillé ?
— Pour al-Lanzhou, les trois civilisations pivots correspondent aux trois religions logiquement possibles : l’islam, qui croit en un dieu unique, l’Inde en plusieurs dieux, et la Chine en aucun dieu.
— C’est pour ça que la Chine a gagné ! s’exclama Hasan, son œil unique brillant de malice. Les événements leur ont donné raison. La Terre a émergé de la poussière cosmique, la vie est apparue et a évolué jusqu’à ce qu’un certain singe se mette à articuler de plus en plus de sons, et nous voilà ! Dieu n’a jamais rien eu à voir là-dedans, il n’y a rien de surnaturel dans cette histoire, pas d’âmes éternelles se réincarnant jusqu’à la fin des temps. Il n’y a que les Chinois qui ont osé affronter ça, montrant la voie avec leur science, n’honorant que leurs ancêtres, ne travaillant que pour leurs descendants. Voilà pourquoi ils nous dominent !
— Mais non, c’est juste parce qu’ils sont plus nombreux ! dit l’une des femmes à l’allure équivoque.
— En attendant, ils nourrissent plus de gens avec moins de terres. Cela prouve bien qu’ils ont raison !
— Mais ce qui fait la force d’une culture peut être également son point faible, dit Naser. On l’a vu à la guerre. Le fait que les Chinois n’aient pas de religion les a rendus particulièrement cruels.
Les élèves hodenosaunees arrivèrent et se joignirent à leur conversation. Elles aussi connaissaient Kirana. Kirana les salua :
— Voici nos conquérantes ! dit-elle. Une culture où les femmes ont le pouvoir ! Je me demande si l’on ne pourrait pas juger les civilisations à l’aune de la réussite de leurs femmes ?
— C’est elles qui les ont toutes bâties ! proclama l’une des plus vieilles femmes, qui jusqu’à présent s’était contentée d’écouter en tricotant.
Elle avait au moins quatre-vingts ans. Elle n’avait donc pratiquement connu que la guerre, du début à la fin, de l’enfance à la vieillesse.
— Aucune civilisation ne peut durer sans les maisons que les femmes bâtissent en elle.
— Ah oui ? Et quel pouvoir politique ont-elles pris, hein ? Regardez comme leurs hommes apprécient l’idée que les femmes aient ce genre de pouvoir…
— Elles l’ont en Chine.
— Non, chez les Hodenosaunees.
— Pas à Travancore ?
Personne ne se risqua à dire quoi que ce soit.
— C’est un sujet qui mérite d’être creusé ! dit Kirana. Ce sera l’un de nos sujets d’étude. Une histoire des femmes des autres pays du monde – leurs actions en tant qu’actrices de la vie politique, leur destin. Le fait que notre histoire ne mentionne aucune de ces choses-là est le signe que le naufrage du patriarcat n’est toujours pas terminé. Et nulle part ce n’est plus vrai que dans l’islam.
5
Budur raconta bien évidemment à Idelba la leçon de Kirana et la réunion qui l’avait suivie. Elle en parla avec beaucoup d’excitation, pendant qu’elles faisaient la vaisselle, puis la lessive. Idelba l’écoutait attentivement, hochant la tête et posant des questions, se montrant très intéressée. Mais pour finir elle dit :
— J’espère que tu trouveras le temps de travailler sérieusement tes cours de statistiques. On peut parler de tout ça jusqu’à la fin des temps, mais les mathématiques sont la seule chose qui te permettra de faire des progrès.
— Que veux-tu dire ?
— Tout simplement que le monde est régi par des nombres et par des lois physiques, traduites en termes mathématiques. Les connaître te permettra de mieux appréhender les choses. Et ça te servira pour ton travail, plus tard. À propos…, je pense pouvoir t’obtenir une place au laboratoire. Tu nettoieras les éprouvettes. Ce sera bien, comme ça tu auras un peu d’argent, et puis tu comprendras qu’il faut que tu apprennes un vrai métier. Ne tombe pas dans le piège des conversations de café.
— Mais parler peut servir ! Ça permet d’apprendre des tas de choses, pas seulement sur l’histoire, mais sur sa signification aussi. Cela me permet d’y voir plus clair, comme lors de nos conversations au harem.
— Certes ! Au harem, on pouvait parler tant qu’on voulait ! Mais il n’y a que dans un institut que tu pourras te pencher vraiment sur la science. Tu t’es donné le mal de venir ici, alors autant en profiter au maximum.
Budur réfléchit un moment. Idelba, la voyant songeuse, poursuivit :
— Et même si tu veux étudier l’histoire, ce qui n’est pas bête, il y a un autre moyen de le faire que de bavasser dans les cafés. C’est d’aller voir les antiquités, de visiter des sites archéologiques. Tu y trouverais des éléments pour étayer les théories – comme on le fait dans les autres sciences. La Franji regorge de vieux endroits de ce genre que l’on étudie actuellement pour la première fois avec cette rigueur scientifique dont je te parle, et c’est très intéressant. D’ailleurs, il faudra des dizaines, voire des centaines d’années, pour inspecter tous ces sites.
Elle se redressa et se massa les reins, en regardant Budur.
— Viens avec moi pique-niquer vendredi. Je t’emmènerai sur la côte, au nord, voir les menhirs.
— Les menhirs ? Qu’est-ce que c’est ?
— Tu verras vendredi.
Le vendredi, elles prirent donc le tram jusqu’au bout de la ligne, où elles changèrent pour un bus qui traversait des rangées de pommiers entre lesquelles elles voyaient parfois des petites parcelles bleu sombre d’océan. Elles descendirent après une demi-heure de route, et se rendirent à l’ouest d’un petit village, dans une forêt où de gigantesques pierres levées étaient disposées en longs alignements sur une plaine herbeuse, légèrement mamelonnée. Çà et là, un vieux chêne interrompait le défilé de pierres. C’était vraiment très étrange.
— Qui les a mises là ? Les Francs ?
— Ça date d’avant les Francs. Peut-être même avant les Celtes. Personne ne sait vraiment. On n’a pas encore trouvé avec certitude l’endroit où ils vivaient, et il est très difficile de dire à quelle époque ces pierres ont été dressées.
— Il a dû falloir, je ne sais pas…, des siècles pour lever toutes ces pierres !
— Cela dépend combien ils étaient pour le faire. Peut-être étaient-ils aussi nombreux autrefois qu’aujourd’hui, qui sait ? Mais je pense que non, parce qu’on n’a pas trouvé de villes en ruines, comme en Égypte ou au Moyen-Occident. Non, il devait s’agir d’une plus petite population, à qui cela a demandé beaucoup de temps et d’efforts.
— Mais que peut faire un historien de trucs pareils ? demanda Budur, alors qu’elles suivaient l’une des longues avenues créées par les alignements de pierres, examinant les motifs de lichen noir et jaune qui noircissaient leur surface érodée.
Elles étaient pour la plupart au moins deux fois plus grandes que Budur. C’étaient vraiment de très grosses choses.
— On peut étudier les objets à la place des histoires. Cela s’écarte parfois de l’histoire, pour se rapprocher de l’enquête scientifique. Savoir dans quelles conditions matérielles vivaient ces gens, quels objets ils fabriquaient. Tu sais, c’est une science qu’on a commencé à pratiquer à l’époque des premiers âges de l’islam, en Syrie et en Irak, puis qu’on a laissée de côté. Jusqu’à la Nahda.
La Nahda était la renaissance de la culture islamique la plus raffinée dans certaines villes, comme Téhéran ou Le Caire, durant le premier demi-siècle précédant la Longue Guerre, qui avait tout détruit.
— Maintenant, nos connaissances en physique et en géologie sont telles que de nouvelles façons d’enquêter apparaissent tout le temps. Les reconstructions et les constructions nouvelles permettent de mettre au jour toutes sortes de trouvailles, et tout cela arrive en même temps. C’est très excitant. La Franji s’avère être l’un des endroits les plus intéressants à étudier. C’est un très vieil endroit, tu sais ?
Elle se tourna vers les longues rangées de pierre, pareilles à des semailles faites par des dieux de pierre qui ne seraient jamais revenus pour les moissons. Les nuages filaient à toute allure dans le ciel, qui paraissait anormalement bas et plat.
— Il n’y a pas que ces alignements d’ailleurs, ni les cercles de pierres en Britannia. Il y a aussi des tombeaux de pierre, des monuments, parfois des villages entiers. Il faudra que je t’emmène un de ces jours visiter les Orcades. De toute façon, il n’est pas impossible que je m’y rende prochainement. Tu viendras avec moi. J’aimerais que tu penses à étudier toutes ces choses. Cela te donnera des bases solides pendant que tu écouteras ta madame Fawwaz débiter ses contes des mille et une nuits.
Budur passa la main sur le fin manteau de lichen recouvrant l’une des pierres levées, et promit :
— Je le ferai.
6
Ses cours, son nouveau boulot consistant à laver la vaisselle de labo à l’institut d’Idelba, ses promenades le long du port et de la jetée, son rêve d’un nouveau syncrétisme, d’un islam incorporant le meilleur du bouddhisme qui prévalait au labo : les journées de Budur passaient dans un brouillard de pensée qui se nourrissait de tout ce qu’elle faisait et voyait. La plupart de ceux qui travaillaient au laboratoire d’Idelba étaient des moines et des nonnes bouddhistes. Compassion, rectitude, une sorte d’agape, comme disaient les anciens Grecs – les Grecs, les fantômes de ces lieux, des gens qui avaient eu toutes les idées, dans un paradis perdu dont il était déjà question dans les histoires de Platon sur l’Atlantide ; qui se révélaient exactes, à en croire les derniers travaux des archéologues fouillant les ruines de la Crète.
Budur s’intéressa aux cours de cette nouvelle matière, l’archéologie. De l’histoire qui n’était pas que palabres, qui pouvait être une science… Les gens qui la pratiquaient étaient un curieux mélange de géologues, d’architectes, de physiciens, d’étudiants du Coran, d’historiens, qui ne se contentaient pas d’étudier les histoires, mais aussi les objets que les gens avaient laissés derrière eux.
Pendant ce temps, on continuait à parler, dans la classe de Kirana, et ensuite dans les cafés. Un soir, dans un café, Budur demanda à Kirana ce qu’elle pensait de l’archéologie :
— Oui, bien sûr, l’archéologie est très importante, répondit-elle. Cela dit, les pierres levées ne sont pas très bavardes. Enfin, on vient de découvrir des grottes, dans le Sud, pleines de peintures murales apparemment très anciennes, beaucoup plus anciennes que les Grecs même. Je peux te donner les noms des gens qui s’en occupent, à Avignon.
— Merci.
Kirana but son café à petites gorgées et écouta les autres un certain temps. Puis elle dit à Budur, murmurant au milieu du vacarme :
— Ce qui est intéressant, je crois, derrière toutes ces théories dont nous parlons, c’est ce qui n’est jamais écrit. C’est particulièrement important pour les femmes, parce que la plupart des choses que nous avons faites n’ont jamais été consignées par écrit. Ce ne sont que des choses très ordinaires, tu comprends, la vie quotidienne : élever les enfants, nourrir la famille, tenir la maison. Il s’agit plus d’une culture orale, transmise de génération en génération. Une culture utérine, comme disait Kang Tongbi. Tu devrais lire ses travaux. Enfin, la culture utérine n’a pas de dynasties à revendiquer, pas de guerres, pas de nouveaux continents inexplorés, c’est pourquoi les historiens ne se sont jamais souciés de la rapporter – ce qu’elle est, comment elle se transmet, comment elle évolue au fil du temps, en fonction des conditions matérielles et sociales. Évoluant avec elles, enfin, je veux dire : s’entremêlant avec elles.
— Dans les harems, cela paraît assez évident, dit Budur, nerveuse de se retrouver collée, genou contre genou, avec cette femme.
Sa cousine Yasmina avait dirigé en cachette suffisamment de « travaux pratiques » entre filles, où l’on s’embrassait et tout ça, pour que Budur sache très exactement ce que signifiait le genre de pression qu’exerçait sur elle la jambe de Kirana. Elle décida de l’ignorer et poursuivit :
— C’est comme Schéhérazade, vraiment. Raconter des histoires pour continuer à vivre. L’histoire des femmes est un peu comme ça, des histoires racontées les unes après les autres. Et chaque jour tout est à recommencer.
— Oui, l’histoire de Schéhérazade est un bon exemple de nos rapports avec les hommes. Mais on doit pouvoir trouver mieux. Les femmes devraient trouver mieux, pour transmettre l’histoire aux plus jeunes femmes, par exemple. Les Grecs avaient une mythologie passionnante, pleine de déesses qui servaient de modèle au comportement des femmes. Déméter, Perséphone… Ils avaient aussi une fabuleuse poétesse qui parle de tout cela, Sapho. Tu n’as jamais lu ses poèmes ? Je t’en donnerai les références.
7
Ce fut le début de bien des conversations plus personnelles autour d’un verre, tard dans la nuit dans des cafés battus par la pluie. Kirana prêta à Budur plusieurs livres sur toutes sortes de sujets, mais principalement sur l’histoire des Franjs : comment la Horde d’Or avait réchappé à la peste qui avait anéanti les chrétiens ; l’influence permanente des structures nomadiques de la Horde sur les nouvelles civilisations issues des États du Skandistan ; le repeuplement, par les Maghrébins, d’al-Andalus, de Nsara et des îles celtes ; la zone de conflit entre les deux cultures repeuplant la vallée du Rhin. Ainsi que d’autres livres décrivant les mouvements des Turcs et des Arabes à travers les Balkans, venant s’ajouter à la mésentente des émirats de Franji, et des petits États taïfas qui s’entredéchiraient depuis des siècles, en fonction de leur allégeance aux sunnites ou aux chiites, aux soufis ou aux wahhabites, aux Turcs, aux Maghrébins ou aux Tartares ; guerres pour la suprématie ou la survie, souvent désespérées, créant des situations toujours oppressives pour les femmes. À vrai dire, il n’y avait qu’en Extrême-Occident que le sort des femmes s’était un tant soit peu amélioré avant la Longue Guerre, progrès que Kirana associait à la présence de l’océan, aux contacts avec d’autres civilisations maritimes, et au fait que Nsara était depuis ses origines un refuge pour les orthodoxes et les marginaux. La ville avait d’ailleurs été fondée par une femme, la légendaire sultane Katima.
Budur prit ses livres et entreprit d’en faire la lecture à haute voix aux soldats aveugles de l’hôpital. Elle leur lut l’histoire de la Glorieuse Révolution du Ramadan, quand les femmes turques et kirghizes avaient mené des mouvements qui s’étaient emparés des centrales des grands barrages au-dessus de Samarkand et étaient venues s’installer dans les ruines de la ville légendaire, qui avait été abandonnée depuis près d’un siècle à cause d’une série de violents tremblements de terre ; comment elles y avaient formé une nouvelle république où les lois saintes du ramadan s’appliquaient toute l’année, et où la vie des gens se fondait dans une communauté dévouée à Dieu, où tous les êtres étaient égaux, qu’ils fussent mâles ou femelles, adultes ou enfants, de telle sorte que la ville avait retrouvé sa gloire d’antan ; et comment elles avaient réussi à y faire de nombreux progrès, aussi bien en matière culturelle que juridique. Tous y vivaient heureux. Jusqu’au jour où le shah avait envoyé ses armées à l’est de l’Iran, et les avait massacrés comme hérétiques.
Ses soldats l’écoutaient en hochant la tête. Ainsi vont les choses, disaient leurs visages silencieux. Le bien finit toujours par être écrasé. On finit toujours par arracher les yeux de ceux qui voient le mieux. Ils avaient une telle façon d’écouter chacun de ses mots, comme des chiens affamés regardant les gens manger à la terrasse des cafés, qu’en les voyant Budur emprunta des livres pour les leur lire. Elle fit un tabac avec le Livre des rois, de Firdoussi, ce grand poème épique décrivant l’Iran d’avant l’islam. De même qu’avec le poète lyrique soufi Hafiz, et bien sûr Rumi, et Khayyam. Budur elle-même adorait leur lire des extraits de sa version très annotée de la Muqaddimah, d’ibn Khaldun.
— Il y a tellement de choses chez Khaldun, disait-elle à ses auditeurs. Tout ce que j’ai appris à l’Institut, je le retrouve chez lui. L’une de mes profs est très fière de sa théorie selon laquelle l’univers est un agrégat de trois ou quatre civilisations majeures, chacune d’elles étant l’État pivot, entouré de plus petits États périphériques. Écoutez ce que dit Khaldun, dans le chapitre intitulé « Chaque dynastie ne peut avoir plus d’une certaine quantité de provinces, de terres »…
Elle lut :
— « Quand les groupes dynastiques débordent de leurs frontières pour envahir celles de leurs voisins, leur nombre ne peut que diminuer. C’est le moment où la dynastie atteint son expansion maximale, et où les régions frontalières forment une sorte de ceinture protectrice autour du cœur du royaume. Si la dynastie entreprend alors de s’étendre au-delà de ses possessions, l’accroissement de son territoire fait qu’elle ne peut maintenir partout la même présence militaire, et elle court le risque de se faire envahir par n’importe quel ennemi ou voisin. Ce qui se fait au détriment de la dynastie. »
Budur leva les yeux de son texte et expliqua :
— C’était une description très succincte de la théorie cœur-périphérie. Khaldun dit aussi que l’islam n’a pas d’État-cœur auquel les autres États peuvent se rallier.
Ses auditeurs hochèrent la tête. Ils savaient tout ça. L’absence d’alliance coordonnée sur les différents fronts pendant la guerre avait été un sérieux problème, aux conséquences parfois terribles.
— Khaldun parle aussi du problème économique récurrent de l’islam, qui trouve sa source dans les pratiques bédouines. Il dit de ces dernières : « Les endroits qui tombent entre les mains des bédouins sont aussitôt dévastés. La raison en est que les bédouins sont un peuple de sauvages, parfaitement habitués à la sauvagerie et à ses causes. La sauvagerie est devenue pour eux une sorte de seconde nature. Ils l’apprécient, parce qu’elle leur rappelle qu’ils sont libres de toute autorité, et qu’ils ne se soumettent à aucun chef. Une telle disposition naturelle est l’opposé et la négation même de toute forme de civilisation. » Puis il poursuit en disant : « Il est dans leur nature de piller tout ce que les autres peuples possèdent. Leur nourriture, ils la trouvent partout où s’étend l’ombre de leurs lances. » Ensuite, il nous expose sa théorie de la valeur du travail : « Le travail est désormais la seule vraie base du profit. Quand le travail n’est pas apprécié à sa juste valeur et récompensé, l’espoir de profit diminue, et aucun travail productif ne peut être effectué. Les populations sédentaires se dispersent, et la civilisation décline. » C’est vraiment extraordinaire, tout ce qu’a vu Khaldun, et cela à une époque où les gens à Nsara mouraient de la peste, et où dans le reste du monde les gens ne pensaient même pas à l’histoire.
Sa lecture touchait à sa fin. Ses auditeurs s’engoncèrent dans leurs fauteuils et dans leurs lits, se recroquevillant dans l’attente des longues heures vides de l’après-midi.
Budur s’en alla, en proie à ce mélange désormais habituel de culpabilité, de soulagement et de plaisir, et se rendit cette fois directement au cours de Kirana.
— Comment pouvons-nous transcender nos origines ? lui demanda-t-elle d’une voix plaintive. Quand notre foi nous commande de ne pas y renoncer ?
— Notre foi ne dit rien de tel, répondit Kirana. C’est juste quelque chose que les fondamentalistes disent pour conserver leur emprise sur nous.
Budur se sentit troublée.
— Mais que faut-il penser de ces passages du Coran dans lesquels il est dit que Mahomet est le dernier prophète et que la loi coranique doit s’appliquer jusqu’à la fin des jours ?
Kirana secoua la tête, l’air agacée.
— Encore une fois, c’est faire d’un cas particulier une loi générait, ce qui est vraiment la tactique favorite des fondamentalistes. En fait, il y a, dans le Coran, certaines vérités dont Mahomet a dit qu’elles étaient éternelles – et notamment cette réalité existentielle selon laquelle tous les individus sont fondamentalement égaux entre eux. D’ailleurs, comment cela pourrait-il jamais changer ? Mais les problèmes dont le Coran parle le plus, et qui se posèrent surtout à l’époque de la construction de l’État arabe, changèrent au gré des circonstances, et même dans le Coran proprement dit. Au sujet de l’alcool, par exemple, ses recommandations ne sont pas toujours les mêmes. D’où le naskh, qui stipule que les recommandations les plus récentes du Coran l’emportent sur les plus anciennes. Les dernières paroles du prophète étaient très claires : nous devions nous ouvrir au changement, afin d’améliorer l’islam, d’apporter des solutions morales correspondant à l’esprit du Coran, mais qui permettraient de répondre à des problèmes nouveaux.
— Je me suis toujours demandé si l’un des sept scribes de Mahomet n’avait pas pu ajouter dans le Coran quelques-unes de ses propres idées, dit Budur.
Encore une fois, Kirana fit un signe de dénégation.
— Rappelle-toi la façon dont le Coran a été écrit. Le mushaf, c’est-à-dire le document matériel final, a été rédigé par Osman, qui avait réuni tous les témoins encore en vie après la mort de Mahomet – ses scribes, ses femmes, ses compagnons –, et, tous ensemble, ils se mirent d’accord pour reconnaître une seule et unique version du livre saint. Aucun ajout personnel n’aurait pu passer entre les mailles d’un tel filet. Non, le Coran parle d’une seule voix, celle de Mahomet, celle d’Allah. Et c’est un important message de justice et de paix pour la Terre ! Ce sont les hadiths qui contiennent des faux messages, réimposant hiérarchie et patriarcat, où les cas particuliers sont transformés en lois générales. C’est dans les hadiths qu’est abandonné le grand jihad, le combat que chacun doit mener contre ses propres tentations, au profit du petit jihad, la défense de l’islam contre toute attaque. Non. Dans bien des cas, les dirigeants et les religieux ont déformé le Coran pour défendre leurs intérêts particuliers. C’est ce qui s’est passé dans toutes les religions, bien sûr. C’est inévitable. Tout ce qui est divin doit se présenter à nous vêtu d’habits humains, et donc nous parvient changé. Le divin est pareil à la pluie tombant sur Terre, réduisant en boue tous nos efforts pour parvenir à la divinité – sauf dans ces rares moments de totale inondation décrits par les mystiques, où nous ne sommes plus que pluie. Mais ces moments sont toujours extrêmement brefs, comme les soufis eux-mêmes s’accordent à le reconnaître. Nous ne devrions pas hésiter à briser le calice des circonstances, quand il le faut, pour arriver à la vérité de l’eau qu’il contient.
Encouragée, Budur demanda :
— Alors, comment faire pour devenir des musulmans modernes ?
— C’est impossible, rétorqua la vieille femme au tricot, sans que s’interrompe le cliquetis de ses aiguilles. Il s’agit d’un ancien culte du désert qui n’a apporté que ruine et désolation à d’innombrables générations, dont la tienne et la mienne, hélas. Il est temps de le reconnaître et d’aller de l’avant.
— Mais vers quoi ?
— Vers tout ce qui voudra bien se présenter ! s’écria la vieille dame. Vers les sciences, vers la réalité elle-même ! Pourquoi se cramponner à ces anciennes croyances du désert ? Il ne s’agit jamais que de la domination des faibles par les forts, des femmes par les hommes. Mais ce sont les femmes qui portent les enfants et qui les élèvent, plantent les semailles et font les récoltes, font à manger, s’occupent de la maison et des personnes âgées ! Ce sont les femmes qui font le monde ! Les hommes font la guerre, et en font ce qu’il y a de plus important, avec leurs lois, leurs religions et leurs armes. Des bandits, des gangsters, c’est ça l’histoire ! Je ne vois pas pourquoi nous devrions nous plier à ça !
Le silence se fit dans la classe, et la vielle dame se remit à manier ses aiguilles comme si elle était en train d’assassiner tous les rois et tous les religieux de la Terre. Soudain, ils entendirent tomber la pluie, les cris des enfants qui jouaient dans la cour, et le bruit des aiguilles de la vieille dame, qui cliquetaient comme un appel au meurtre.
— Mais alors, si nous nous engageons sur cette route, dit Naser, les Chinois auront gagné pour de bon.
Le silence se fit encore plus assourdissant.
La vieille dame finit par répondre :
— S’ils ont gagné, ce n’est pas par hasard. Ils n’ont pas de dieu, et ils adorent leurs ancêtres et leurs descendants. Leur humanisme leur a permis d’accomplir d’immenses progrès, d’étudier les sciences – tout ce dont nous avons été privés !
Le silence s’accrut encore, tellement qu’ils purent entendre la corne de brume, là-bas dans le port, meuglant sous la pluie.
— Mais tu ne parles que de leurs élites, remarqua Naser. Leurs femmes avaient les pieds bandés si serré que cela les estropiait, comme ces oiseaux auxquels on coupe les ailes. Ça aussi c’est la Chine. Ce sont de sacrés enculés, je te le dis tel quel. Je l’ai vu à la guerre. (Il se tourna vers les autres.) Je ne vous dirai pas ce que j’ai vu, mais je le sais, croyez-moi. Ils n’ont aucun sens de la divinité, et donc aucune règle de conduite ; rien qui les empêche de faire preuve de cruauté. Et pour être cruels, ils sont cruels. Ils ne considèrent pas les gens qui vivent hors de Chine comme de vrais êtres humains. Seuls les Han sont humains. Les autres sont des hui hui, comme les chiens. Arrogants, cruels au-delà de toute expression – il ne me semble pas bon du tout de chercher à les imiter, de faire en sorte qu’ils aient gagné à ce point-là.
— Mais nous n’étions pas meilleurs qu’eux, répondit Kirana.
— Sauf quand nous nous comportions en vrais musulmans. Ce qui serait un excellent sujet pour un cours d’histoire, je trouve, serait de se concentrer sur ce qu’il y avait de meilleur dans l’islam, qui a traversé le temps, et de voir si cela peut nous aider aujourd’hui. Chaque sourate du Coran nous y incite par ses premiers termes : Au nom de Dieu, le miséricordieux, le très miséricordieux, plein de miséricorde. La compassion, le pardon – comment exprimer tout ça ? Ce sont des concepts que les Chinois n’ont même pas. Les bouddhistes ont essayé de les leur apporter, mais on les a traités comme des mendiants et des voleurs. Pourtant ce sont des concepts fondamentaux, au cœur de l’islam. Notre vision est celle d’un peuple uni comme une seule famille, ayant pour seule règle la compassion et le pardon. C’est ce qui a motivé Mahomet, conduit par Allah ou par son seul sens de la justice, par l’Allah qui est en chacun de nous. C’est ça, l’islam, pour moi ! Voilà ce pour quoi je me suis battu pendant la guerre. Voilà les qualités que nous pouvons apporter au monde et que les Chinois n’ont pas. L’amour, pour dire les choses simplement. L’amour.
— Mais si ces choses ne nous permettent pas de vivre…
— Assez ! s’écria Naser. Pas de ce bâton-là, s’il vous plaît. Je ne vois aucun peuple sur Terre qui vive de bons sentiments. C’est d’ailleurs ce que devait voir Mahomet quand il regardait autour de lui : de la sauvagerie, partout, des hommes comme des bêtes. C’est pourquoi chaque sourate commence par un appel à la compassion.
— Tu parles comme un bouddhiste, dit-elle.
Le vieux soldat était d’ailleurs prêt à le reconnaître.
— La compassion, n’est-ce pas le principe directeur de leurs actions ? J’apprécie ce que les bouddhistes font dans ce monde. Ils nous font beaucoup de bien. Ils ont fait beaucoup de bien aux Japonais, et aux Hodenosaunees. J’ai lu des livres expliquant que nous devons tous nos progrès scientifiques à la diaspora japonaise, qui est la dernière et la plus puissante des diasporas bouddhiques. Ils ont repris les idées des anciens Grecs et de Samarkand.
— Nous devrions peut-être chercher ce qu’il y a de plus bouddhique dans l’islam, dit Kirana. Et le cultiver.
— Je vous le dis, faisons fi du passé !
Clic, clic, clic !
Naser n’eut pas l’air d’approuver.
— Et c’est comme ça qu’on verra arriver une nouvelle sauvagerie, scientifique. Comme pendant la guerre. Nous devons garder les valeurs qui nous paraissent bonnes, qui suscitent la compassion. Nous devons garder ce qu’il y a de mieux dans nos traditions, et créer quelque chose de nouveau, quelque chose de mieux qu’avant.
— Cela me paraît être de bonne politique, dit Kirana. Mais n’est-ce pas, après tout, ce que Mahomet nous a enjoint de faire ?
8
Tels étaient l’amer scepticisme de la vieille femme, l’espoir obstiné du vieux soldat, la quête insatiable de Kirana, une quête dont les réponses ne la satisfaisaient jamais, mais qu’elle poursuivait, idée après idée – les confrontant à la façon dont elle ressentait les choses, à trente années de boulimie de lecture, à la piètre vie menée derrière les quais de Nsara. Budur, encapuchonnée dans son ciré, courait en courbant le dos sous la pluie, vers la zawiyya. Elle sentait tout un monde invisible se presser autour d’elle – la rapide et vigoureuse désapprobation de jeunes passants estropiés, les nuages en effervescence, les mondes secrets qui gravitaient dans toutes ces choses qu’Idelba étudiait au laboratoire. Son travail qui consistait, la nuit, à balayer et à reconstituer les stocks était… intéressant. De plus grandes choses attendaient, tapies dans la distillation finale de toutes ces recherches, dans les formules griffonnées sur les tableaux noirs. Il y avait des années de travaux mathématiques derrière les expériences des physiciens, des siècles de travaux qui aboutissaient enfin à des explorations concrètes d’où pourraient émerger de nouveaux mondes. Budur eut le sentiment qu’elle n’arriverait jamais à comprendre les mathématiques utilisées dans ces recherches, mais les laboratoires devaient tourner rond si l’on voulait que les travaux progressent, de sorte qu’elle s’occupa bientôt des commandes de fournitures, du bon fonctionnement des cuisines et des salles à manger, et du règlement des factures (la facture de ki était particulièrement salée).
Et pendant que les scientifiques continuaient à discuter, dans les cafés les conversations se poursuivaient. Idelba et son neveu Piali passaient des heures au tableau noir, développant telle ou telle de leurs idées, et proposant telle ou telle solution à l’un ou l’autre de leurs mystérieux problèmes, concentrés, ravis, mais parfois inquiets – à en juger par certains accents de la voix d’Idelba –, comme si les équations révélaient en quelque sorte des nouvelles auxquelles elle ne pouvait pas, ou ne voulait pas croire. Elle passait à nouveau beaucoup de temps au téléphone, cette fois-ci dans le petit bureau de la zawiyya, et bien souvent elle s’absentait sans prévenir. Budur était incapable de dire si tous ces phénomènes étaient liés entre eux. Il y avait encore bien des aspects de la vie d’Idelba qui lui étaient totalement étrangers.
Des hommes auxquels elle parlait en dehors de la zawiyya, des paquets, des appels… Mais il semblait, à voir les sillons verticaux entre ses sourcils, qu’elle était fort préoccupée, et que son existence n’était pas des plus simples.
— Mais sur quoi porte cette étude qui vous pose tant de problèmes, à Piali, les autres et toi ? demanda une nuit Budur à Idelba, qui rangeait consciencieusement son bureau.
Elles étaient les dernières au laboratoire, et Budur en tirait un certain orgueil : on leur faisait vraiment confiance. Ce qui lui avait donné suffisamment d’assurance pour interroger sa tante.
Idelba cessa de s’activer pour la regarder.
— Il semblerait que nous ayons des soucis. Tu ne dois parler à personne de tout ça. Enfin… Je t’ai déjà dit que le monde était fait d’atomes, de petites choses avec un noyau, autour duquel tournent, en cercles concentriques, des particules de foudre. Tout cela se passe à une échelle si petite qu’il est difficile de l’imaginer. Chaque grain de poussière que tu balayes en comporte plusieurs millions. Et tu en as des milliards au bout des doigts.
Elle agita ses mains sales dans l’air.
— Et chacun de ces atomes recèle une importante quantité d’énergie. Il s’agit de l’énergie ki, qui est vraiment semblable à de la foudre en cage. Rends-toi compte de la puissance que cela représente, des billions de ki contenus dans chacune de ces petites choses.
Elle fit un geste en direction du mandala ovale peint sur l’un des murs : la table d’éléments périodiques, représentés par des chiffres et des lettres arabes, accompagnés d’une profusion de commentaires en caractères minuscules.
— Le cœur recèle une force qui confine toute cette énergie, comme je te l’ai déjà dit, une force incroyable à brève distance, qui concentre si fortement l’énergie électrique dans les limites du cœur qu’elle ne peut s’en échapper. Ce qui tombe bien, parce que la quantité d’énergie contenue là est proprement phénoménale. Nous vivons à son rythme.
— C’est aussi l’impression que ça me fait, dit Budur.
— Oui. Mais regarde, elle est mille fois plus puissante que nous ne le ressentons. La formule proposée, comme je te l’ai déjà dit, c’est l’énergie est égale à la masse multipliée par le carré de la vitesse de la lumière, et la lumière va vraiment très vite. Ainsi, il suffirait que l’énergie d’un tout petit peu de matière vienne à être libérée, pour que le monde…
Elle hocha la tête.
— Bien sûr, la force qui la contient est si grande que ce genre de chose n’arrivera jamais. Mais nous continuons à étudier cet élément, l’alactin, que les physiciens de Travancore appellent Main de Tara. Je suspecte son noyau d’être instable, et Piali commence à être d’accord avec moi. Il est évident que cela grouille de djinns, à la fois yin et yang, organisés de telle sorte que, pour moi, l’ensemble se comporte un peu comme une goutte d’eau dont la cohésion est assurée par la tension de surface, mais si grosse que la tension aurait le plus grand mal à la contenir, tant et si bien que la goutte s’étirerait comme si elle était en train de tomber, se déformant à ses extrémités, mais restant entière. Sauf que, à un moment donné, elle s’étirerait tellement que la tension de surface ne parviendrait plus à la contenir, malgré l’énorme force exercée, si bien que le djinn finirait par sortir de sa prison, la cassant en deux, et que le noyau se transformerait alors en atomes de plomb, tout en émettant une partie de sa force intrinsèque, sous forme de rayons d’énergie invisible. C’est eux que nous voyons sur ces plaques photographiques que tu nous aides à réaliser. Ça fait une sacrée quantité d’énergie pour un seul noyau brisé. Ce que nous nous sommes demandé – ce que nous avons été obligés de prendre en compte, étant donné la nature du phénomène – c’est, si nous réunissons suffisamment d’atomes ensemble, et si nous brisons ne serait-ce qu’un seul de leurs noyaux, est-ce que l’énergie ki ainsi libérée pourrait briser d’autres noyaux au même moment, et ainsi de suite – tout cela à la vitesse de la lumière, dans un espace à peu près grand comme ça (elle écarta les mains). En fait, est-ce que cela ne déclencherait pas une sorte de réaction en chaîne ? dit-elle.
— C’est-à-dire…
— C’est-à-dire une énorme explosion !
Pendant un long moment, ce fut comme si le regard d’Idelba s’était perdu dans un univers de pures mathématiques.
— Ne parle jamais à personne de tout ça, répéta-t-elle enfin.
— Je te le promets.
— À personne.
— Promis.
Des mondes invisibles, gorgés d’énergie et de puissance : des harems subatomiques, chacun vibrant au bord d’une immense explosion. Budur soupira en imaginant tout cela. Il n’y avait pas d’échappatoire à la violence contenue au cœur des choses. Même les pierres étaient mortelles.
9
Budur se réveillait le matin à la zawiyya, puis aidait à la cuisine et au bureau. En fait, il y avait beaucoup de points communs entre son travail à la zawiyya et son travail au laboratoire, et bien que l’ambiance fut radicalement différente dans les deux cas, les tâches avaient toujours quelque chose d’un peu fastidieux. Ses cours et ses longues promenades dans la ville devinrent des moments privilégiés de rêverie et de réflexion.
Elle se promenait donc le long des quais ou du fleuve, sans plus craindre de voir soudain surgir quelqu’un de Turi pour la remmener chez son père. Il y avait encore beaucoup d’endroits de la ville qu’elle ne connaissait pas, mais elle avait ses itinéraires favoris et, de temps en temps, elle montait dans un tram et allait jusqu’au terminus, juste pour voir quel genre de quartiers il traversait. Elle aimait surtout les quartiers du port et ceux qui bordaient le fleuve, où elle pouvait se promener pendant des heures. Une lumière blafarde perçait à travers les nuages chassés par le vent marin ; elle s’asseyait à la terrasse des cafés le long du port ou de la promenade qui donnait sur la mer. Elle lisait, écrivait, levant quelquefois les yeux pour voir les moutons d’écume se perdre au pied du grand phare, au bout de la jetée ou sur la côte rocheuse plus au nord. Elle se promenait sur la plage. Bleus pâles du ciel, derrière le désordre des nuages ; bleus vifs de l’océan ; blancs des nuages et des vagues mourantes ; elle adorait ces choses-là, les aimait de tout son cœur. Ici, elle était libre d’être elle-même. Un air de cette pureté cristalline valait bien un peu de pluie.
Dans un quartier plutôt miteux, battu par les vents du bord de mer, au terme de la ligne de tram numéro six, s’élevait un petit temple bouddhiste, près duquel Budur aperçut un jour la mère et la fille hodenosaunees qui étaient dans sa classe. Elles la virent et s’approchèrent d’elle.
— Bonjour, dit la mère. Tu es venue nous rendre visite !
— En fait, je me promenais dans la ville, répondit Budur, surprise. J’aime bien ce quartier.
— Je vois, dit la mère poliment, l’air dubitative. Pardon, mais comme nous connaissons ta tante Idelba, je croyais que c’était elle qui t’avait envoyée. Bon, tu ne veux pas entrer quand même ?
— Oui, merci.
Quelque peu décontenancée, Budur les suivit dans l’enceinte du temple, où s’étendait un jardin. Des arbrisseaux bordant des allées de gravillons entouraient une cloche jouxtant un bassin. Des nonnes vêtues de longues robes rouge foncé arpentaient les galeries et les promenoirs. L’une des nonnes s’assit à côté des Hodenosaunees, qui s’appelaient Hanea – la mère – et Ganagweh – la fille. Elles parlaient le franjic, avec un fort accent nsarais teinté d’un autre, que Budur ne parvenait pas à identifier. Elle les écouta parler des travaux de réparation du toit. Ensuite, elles l’invitèrent à les suivre dans une pièce où se trouvait une grosse radio ; Hanea s’assit devant un microphone et tint une conversation dans sa propre langue avec quelqu’un de l’autre côté de l’océan.
Après quoi, elles rejoignirent quelques nonnes dans la salle de méditation, et restèrent un moment assises là à chanter.
— Alors, vous êtes bouddhistes ? demanda Budur aux Hodenosaunees à la fin de la séance, comme elles regagnaient le jardin.
— Oui, répondit Hanea. C’est très fréquent dans notre peuple. Nous trouvons que le bouddhisme ressemble beaucoup à notre ancienne religion. Et je crois vraiment que cela nous a rapprochés des Japonais qui vivent à l’ouest de notre pays, et qui nous ressemblent par bien d’autres côtés. Nous avions besoin qu’ils nous aident à nous défendre contre des gens qui venaient de chez vous.
— Je vois.
Elles s’arrêtèrent devant un groupe de personnes assises en cercle autour de blocs de grès dont elles faisaient des sortes de grosses briques plates, apparemment, parfaitement régulières et à la surface lisse. Hanea les montra du doigt et expliqua :
— Ce sont des pierres sacrées, pour le sommet du Chomolungma. As-tu entendu parler de ce projet ?
— Non.
— Voilà : le Chomolungma était la plus haute montagne du monde, avant la destruction de son sommet par l’artillerie musulmane durant la Longue Guerre. Il y a actuellement un projet en cours, un projet à long terme, qui consiste à reconstituer le sommet de la montagne. On y envoie des briques comme celles-ci. Des alpinistes faisant l’ascension du Chomolungma en emportent chacun une, pour la laisser là-haut, où des maçons l’utiliseront pour reconstruire un nouveau sommet en forme de pyramide.
Budur considéra les blocs de pierre dressée, plus petits que la plupart des rochers qui décoraient le jardin. On l’invita à ramasser l’une des briques ; elle pesait presque aussi lourd que trois ou quatre de ses livres.
— Il en faudra beaucoup ?
— Plusieurs milliers. C’est un projet de très longue haleine, répondit Hanea en souriant. Une centaine d’années, peut-être mille. Cela dépendra du nombre d’alpinistes qui voudront bien faire l’ascension en emportant une pierre avec eux. Une masse considérable de roche a été pulvérisée. C’est une bonne idée, non ? Le symbole de la restauration d’un ordre beaucoup plus général dans le monde.
Elles étaient en train de préparer à manger dans la cuisine, et elles invitèrent Budur à partager leur repas, mais elle déclina leur invitation, expliquant qu’elle devait prendre le prochain tram pour rentrer.
— Bien sûr, acquiesça Hanea. Salue ta tante pour nous. Nous avons hâte de la voir.
Elle n’expliqua pas ce qu’elle entendait par là, et Budur y réfléchit en retournant à l’arrêt près de la plage. Elle se blottit derrière la vitre, à l’abri des fortes rafales de vent, en attendant le tram qui la ramènerait en ville. À moitié endormie, elle eut une vision : une longue ligne de gens montant au sommet du monde, des livres de pierre dans leurs bras.
10
— Viens avec moi aux Orcades, lui dit Idelba. Tu pourrais m’aider, et puis il y a des ruines que j’aimerais te montrer.
— Les Orcades ? Où c’est, déjà ?
C’était un archipel situé à l’extrême nord des îles celtes, au nord de l’Écosse. La majeure partie de la Britannia était peuplée par des gens venus d’al-Andalus, du Maghreb et d’Afrique de l’Ouest ; puis, au cours de la Longue Guerre, les Hodenosaunees avaient construit une importante base navale dans une baie au creux de la plus grande île des Orcades, où ils se trouvaient toujours, dominant de fait la Franji, mais protégeant également par leur présence les rares descendants des premiers habitants de ces îles : des Celtes qui avaient survécu à la fois à l’arrivée des Francs, des Franjs, et aussi à la peste, bien sûr. Budur avait lu des histoires au sujet de ces survivants de la grande peste. C’étaient des hommes de haute taille, à la peau claire, aux cheveux roux et aux yeux bleus. Assise dans la nacelle du dirigeable où elle avait pris place avec Idelba, Budur regardait le paysage au-dessous d’elle. Elle voyait les vertes collines anglaises, tavelées par l’ombre des nuages et quadrillées par les cultures, les haies et des murets de pierres grises, et elle se demanda quel effet cela pourrait faire de se trouver devant de véritables Celtes. Arriverait-elle à soutenir leur regard muettement accusateur sans flancher à la vue de leurs yeux et de leur peau d’albinos ?
Mais, bien sûr, les choses ne se passèrent pas ainsi. Elles s’aperçurent en se posant que les Orcades étaient des collines herbeuses, avec à peine un arbre ici ou là, à l’exception de quelques bosquets poussant contre les murs chaulés de fermes typiques. Elles avaient toutes deux cheminées, une à chaque extrémité – architecture réplique d’elle-même, apparemment ancienne, puisqu’on la retrouvait à l’identique dans les ruines grises situées non loin des versions modernes des mêmes maisons. En outre, les Orcadiens n’étaient pas ces demeurés dégénérés par la consanguinité et criblés de taches de rousseur que Budur s’attendait à trouver après avoir entendu parler des esclaves blancs des sultans ottomans. C’étaient des pêcheurs en cirés, forts en gueule, solidement charpentés, à la face rubiconde, et qui se criaient après comme tous les marins de tous les villages de pêcheurs sur la côte de Nsara. Ils faisaient comme si de rien n’était quand ils traitaient avec les Franjs, à croire que c’étaient eux qui étaient normaux et les Franjs qui étaient exotiques ; ce qui bien sûr était exact, ici. Apparemment, pour eux, les Orcades étaient le monde entier.
Budur et Idelba commencèrent à comprendre pourquoi en allant visiter les ruines de l’île en véhicule à moteur. Il y avait trois mille ans sinon plus que le monde venait aux Orcades. Ils avaient donc des raisons de se sentir au cœur des événements, à un carrefour. Toutes les civilisations qui s’étaient succédé ici, et il avait dû y en avoir des dizaines au fil des siècles, avaient érigé leurs constructions en se servant du grès stratifié de l’île, que les vagues avaient fort commodément séparé en plaques, en solives et en grandes briques plates, parfaites pour construire des murs de pierres sèches, qui étaient encore plus solides si on les scellait avec du ciment. Les plus vieux habitants s’étaient également servis des pierres pour construire leurs châlits, des étagères dans leur cuisine, de telle sorte qu’ici, dans cette petite étendue d’herbes dominant la mer occidentale, il était possible de se pencher sur d’antiques maisons de pierre, maintenant dégagées du sable qui les avait envahies. On pouvait alors voir comment s’étaient organisés les gens qui avaient vécu là cinq mille ans auparavant, à ce qu’on disait, leurs outils, leur mobilier, dans l’état exact où ils les avaient laissés. Les pièces enfoncées dans le sol rappelaient à Budur sa propre chambre à la zawiyya. Le temps n’y avait rien changé d’essentiel.
Idelba hocha la tête quand on lui dit à quelle époque remontait la colonisation et quelles méthodes de datation avaient été utilisées. Elle réfléchit à haute voix à certaines géochronologies qu’elle avait en tête, et qui pourraient être approfondies. Mais, au bout d’un moment, elle fit silence, comme les autres, et resta là à contempler les magnifiques intérieurs vides des maisons des anciens. Ces choses, que nous laissons et qui durent.
De retour dans la seule ville de l’île, Kirkwall, elles marchèrent dans des rues pavées jusqu’à un petit complexe de temples bouddhiques, situé derrière la vieille cathédrale des anciens, un modeste ensemble par rapport aux immenses squelettes qu’on trouvait sur le continent, mais avec un toit, et achevé. Il s’agissait de quatre bâtiments étroits entourant un jardin de pierre, d’un style que Budur trouva chinois.
C’est là qu’Hanea et Ganawegh accueillirent Idelba. Budur eut un choc en les voyant, et elles rirent devant la tête qu’elle faisait.
— Nous t’avions bien dit que nous ne tarderions pas à nous revoir, tu te rappelles ?
— Oui, dit Budur. Mais pourquoi ici ?
— C’est ici que se trouve la plus grande communauté hodenosaunee de Franji, répondit Hanea. C’est de là que nous sommes descendues à Nsara, en fait. Et nous y revenons très souvent.
Ensuite, on leur fit visiter le complexe, et elles s’assirent dans une pièce donnant sur la cour, où elles prirent le thé. Idelba et Hanea s’étaient éclipsées, laissant une Budur fort déconcertée en compagnie de Ganagweh.
— Mère a dit qu’elles en avaient pour une heure ou deux, dit Ganagweh. Sais-tu de quoi elles vont parler ?
— Non, répondit Budur. Et toi ?
— Non. Je veux dire, je suppose que cela a un rapport avec les efforts que fait ta tante pour essayer d’améliorer les relations diplomatiques entre nos deux pays. Mais je ne fais que rappeler une évidence.
— Oui, fit Budur, improvisant. Je savais qu’elle s’y intéressait. Mais comme je vous ai rencontrées dans la classe de Kirana Fawwaz…
— Oui. Sans parler de la fois où tu es venue nous voir au monastère, là-bas. On dirait que nos vies sont destinées à se croiser.
Elle avait un sourire que Budur ne parvenait pas à comprendre.
— Allons nous promener. Elles en ont pour un moment. Il est vrai qu’elles ont beaucoup de choses à se dire, après tout.
Budur ignorait tout cela, mais ne fit aucun commentaire. Elle passa le reste de la journée à se promener dans Kirkwall avec Ganagweh, qui se révéla être une fille vive, sûre d’elle, pleine d’esprit ; les rues étroites et les solides gaillards des Orcades ne l’impressionnaient pas le moins du monde. Et en effet, arrivées au bout de la ligne de tram, elles poursuivirent à pied jusqu’à un rivage désert dominant la grande baie, qui avait été jadis une base navale grouillante d’animation. Ganagweh s’arrêta non loin d’un rocher, se déshabilla et courut dans l’eau en criant. Elle en ressortit en hurlant, dans un geyser d’eau blanche, sa peau noire brillant au soleil alors qu’elle se séchait avec les doigts, éclaboussant Budur et la défiant d’aller piquer une tête.
— Ça te fera du bien ! Elle n’est pas si froide, et ça te réveillera !
C’était exactement le genre de choses que Yasmina voulait tout le temps qu’elles fassent, mais Budur refusa, par timidité, gênée de regarder le gros et bel animal ruisselant debout à côté d’elle, au soleil ; et quand elle s’avança vers la mer pour prendre la température de l’eau, elle fut contente d’avoir refusé : elle était glacée ! Ce fut alors comme si elle se réveillait. Elle prit conscience de l’odeur de sel du vent, et des cheveux noirs et trempés de Ganagweh, qui volaient autour de sa tête, alors qu’elle s’ébrouait comme un chien, l’aspergeant. Ganagweh se moqua d’elle et se rhabilla encore toute mouillée. En repartant, elles croisèrent un groupe d’enfants à la peau pâle, qui les regardèrent bizarrement.
— Rentrons voir comment les vieilles se débrouillent, dit Ganagweh. C’est drôle de voir ces grand-mères prendre le sort du monde entre leurs mains, non ?
— Oui, dit Budur en se demandant ce qui pouvait bien se passer dans le monde.
11
Au cours du vol de retour vers Nsara, Budur interrogea Idelba à ce sujet, mais Idelba secoua la tête. Elle ne voulait pas en parler, et était trop occupée à écrire dans son carnet de notes.
— Plus tard, répondit-elle.
À Nsara, Budur se remit sérieusement au travail. Sur les conseils de Kirana, elle lut des livres sur l’Asie du Sud-Est, et apprit comment les civilisations hindoue, bouddhique et islamique s’étaient mélangées pour donner naissance à quelque chose de tout nouveau, de vivant, qui avait survécu à la guerre et exploitait maintenant les grandes richesses minérales et botaniques de Birmanie, de Malaisie, de Sumatra, de Java, de Bornéo et de Mindanao pour former un groupe d’opposants au pouvoir centralisateur de la Chine, afin de se libérer de son influence. Ils s’étaient répandus en Aozhou, l’énorme île-continent de terre brûlée qui se trouvait au sud, et avaient même franchi les océans pour atteindre l’Inka et, de l’autre côté, Madagascar et l’Afrique du Sud. Cela marquait en quelque sorte l’émergence d’une culture du Sud, où les immenses villes de Pyinkayaing, Djakarta et Kwinana, sur la côte ouest de l’Aozhou, ouvraient la voie, commerçaient avec Travancore et construisaient à tour de bras, élevant des villes où se dressaient de nombreux gratte-ciel d’acier, de plus d’une centaine d’étages. La guerre avait endommagé ces villes, mais ne les avait pas détruites, et à présent les différents gouvernements mondiaux se réunissaient à Pyinkayaing pour tenter de se mettre d’accord et faire du monde d’après guerre un endroit plus juste, plus paisible.
Le temps passant, et les choses s’aggravant, il y eut de plus en plus de réunions. Il fallait tout essayer pour empêcher la guerre de recommencer ; elle avait réglé si peu de choses. C’était du moins ce que pensaient les membres de l’alliance des vaincus.
Il n’était pas bien clair alors qu’il fut dans l’intérêt des Chinois et de leurs alliés, ainsi que des pays du Yingzhou qui étaient entrés en guerre bien après les autres, de satisfaire aux exigences de l’islam. Kirana fit remarquer en passant, lors d’un de ses cours, que l’islam était peut-être bien en ce moment dans la poubelle de l’histoire et ne le savait même pas. Et plus Budur lisait de livres à ce sujet, plus elle se disait que, si c’était le cas, le monde n’aurait pas à en souffrir. Les vieilles religions mouraient ; et quand un empire échouait à conquérir le monde, il finissait généralement par disparaître.
C’est ce que Kirana disait de façon très claire dans ses propres écrits. Budur avait emprunté ses livres à la bibliothèque du monastère. Certains avaient été publiés plus de vingt ans auparavant, pendant la guerre elle-même. Kirana devait alors être bien jeune. Budur les lut avec la plus grande attention, entendant la voix de Kirana dans sa tête à chaque phrase ; c’était un peu comme une transcription de ses cours, mais son propos allait beaucoup plus loin. Elle avait écrit sur toutes sortes de sujets, théoriques et pratiques. Des recueils entiers de ses textes sur l’Afrique traitaient des nombreux problèmes des femmes, et de santé publique. Budur ouvrit un livre au hasard, et tomba sur un discours qu’elle avait fait à des sages-femmes au Soudan :
Si les parents de la fille insistent, et si l’on ne peut les en dissuader, il est très important de ne couper qu’un tiers du clitoris et de laisser les deux autres tiers intacts. Mutiler une jeune fille avec un couteau, en lui coupant tout, va à l’encontre des paroles du Prophète. Les hommes et les femmes sont faits pour être égaux devant Dieu. Mais si on retire à une femme tout son clitoris, alors elle devient une sorte d’eunuque, elle devient frigide, paresseuse, sans aucun désir, sans humour, elle ne s’intéresse plus à rien, comme un mur de boue, un morceau de carton, sans étincelle, sans buts, sans plus d’aspirations qu’une mare d’eau croupie, sans vie. Ses enfants sont malheureux, son mari est malheureux, elle ne fait rien de sa vie. Au moment de pratiquer l’excision, rappelez-vous : coupez un tiers, laissez deux tiers ! Coupez un tiers, laissez deux tiers !
Budur tourna les pages du livre, troublée. Il lui fallut quelque temps pour se remettre, puis elle lut la nouvelle page qui lui tombait sous les yeux :
J’ai eu le privilège de voir Raiza Tarami à son retour du Nouveau Monde, où elle a assisté au colloque de l’Ile-Longue, au Yingzhou, sur les problèmes des femmes, juste à la fin de la guerre. Les participants au colloque, qui venaient du monde entier, furent très impressionnés par la maîtrise avec laquelle cette femme de Nsara abordait tous les problèmes. Ils s’attendaient à voir une femme arriérée, ignorante et voilée, vivant recluse dans un harem. Mais Raiza n’était pas ce genre de femme, et elle pouvait en remontrer à ses sœurs de Chine, de Birmanie, du Yingzhou et de Travancore. En fait, ses conditions de vie l’avaient menée à pousser ses travaux théoriques bien plus loin que la plupart de ses consœurs.
Elle nous représenta donc dignement, et quand elle rentra en Franji, elle était arrivée à la conclusion que le voile était le principal obstacle au progrès que rencontraient les femmes musulmanes, et qu’en fait il symbolisait la complicité du système tout entier. Le voile devait tomber si l’on voulait que tombe le système réactionnaire. Et c’est ainsi qu’à son arrivée au port de Nsara, elle se présenta à visage découvert devant l’Institut des femmes. Ses condisciples les plus proches avaient également retiré leur voile. Autour de nous, la foule commençait à faire entendre son mécontentement, dont les premiers signes, des cris, des bousculades, se manifestaient déjà. C’est alors que les femmes de la foule apportèrent leur soutien à celles qui s’étaient dévoilées, retirèrent leur propre voile, et le jetèrent à terre. Ce fut un très beau moment. Après cela, les voiles commencèrent à disparaître rapidement de Nsara. Il suffit ensuite de quelques années pour que les femmes enlèvent leur voile dans tout le pays. C’était une première brique ôtée dans le mur des réactionnaires. Grâce à ce geste, Nsara prit la tête de notre mouvement en Franji. Et j’ai eu la chance de voir tout cela de mes propres yeux.
Budur prit une profonde inspiration et corna cette page. Elle la lirait plus tard à ses soldats aveugles. Les semaines passèrent, et elle continua de lire les œuvres de Kirana, dévorant ses nombreux recueils d’essais et de conférences. Ce fut une expérience éprouvante, Kirana n’hésitant pas à s’attaquer de front, et avec virulence, à tout ce qui lui déplaisait. Quelle vie, décidément ! Budur eut soudain honte de son enfance et de sa jeunesse cloîtrée, et du fait qu’elle avait vingt-trois ans, bientôt vingt-quatre, et qu’elle n’avait toujours rien fait. Au même âge, Kirana Fawwaz était déjà allée en Afrique, avait fait la guerre et travaillé dans les hôpitaux. Elle avait tellement de choses à rattraper !
Budur lut également de nombreux livres dont Kirana n’avait pas parlé. Elle étudia pendant quelque temps les civilisations sino-musulmanes d’Asie centrale, et comment elles avaient essayé, plusieurs siècles durant, de réconcilier leurs deux cultures. Il y avait dans ces livres quelques vieilles et mauvaises photographies de ces gens, chinois en apparence, musulmans de religion, chinois de langue, musulmans de loi. On avait du mal à croire que des gens aussi bigarrés aient pu exister. Les Chinois les avaient presque tous éliminés pendant la guerre et avaient exilé les survivants de l’autre côté du Dahai, par-delà les déserts et les jungles du Yingzhou et d’Inka, où ils travaillaient dans les mines et les plantations. En fait, c’étaient des esclaves, même si la Chine prétendait ne plus pratiquer l’esclavage, dont elle disait que c’était un atavisme musulman. En attendant, quel que fut leur nom, il n’y avait plus aucun musulman dans leurs provinces du Nord. Cela pouvait se reproduire n’importe où.
Budur eut alors l’impression, quoi qu’elle lût, quelque partie de l’histoire qu’elle étudiât, que tout était déprimant, dégoûtant, effrayant, horrible ; sauf quand il s’agissait du Nouveau Monde, où les Hodenosaunees et les Dineis avaient réussi à créer une civilisation, capable tout juste, mais quand même, de résister aux Chinois à l’ouest, et aux Franjs à l’est. Sauf que, même là, les maladies et les pestes avaient fait tellement de ravages, au cours des douzième et treizième siècles, que leur population avait failli disparaître, et que les survivants avaient été contraints de se cacher au centre de leur île. Néanmoins, si peu nombreux qu’ils fussent, ils survécurent et s’adaptèrent. Ils avaient réussi à rester ouverts aux influences étrangères, incorporant à leur Ligue tous ceux qu’ils rencontraient, devenant bouddhistes, s’alliant à la Ligue de Travancore à l’autre bout du monde, qu’ils avaient en fait aidée à se créer en lui montrant l’exemple ; se renforçant de tout, en gros, même quand ils étaient terrés dans leur sauvage forteresse, loin de tout rivage et du Vieux Monde en général. Peut-être en réalité cela les avait-il aidés. Prendre ce qui pouvait servir, combattre le reste. Un endroit où les femmes avaient toujours eu un certain pouvoir. Et maintenant que la Longue Guerre avait dévasté le Vieux Monde, ils étaient soudain devenus un nouveau géant, de l’autre côté des mers, dont les représentants en cet endroit étaient des gens comme les grandes Hanea et Ganagweh, qui arpentaient les rues de Nsara dans leurs longs manteaux de fourrure ou de peau huilée, écorchant le franjic avec dignité et sans penser à mal. Kirana n’avait pas beaucoup écrit sur les Hodenosaunees, pour autant que Budur puisse en juger. Cependant, Idelba travaillait avec eux, d’une façon mystérieuse, mais qui impliquait, maintenant, de convoyer des colis. Budur donnait un coup de main en les apportant en tram au temple d’Hanea et Ganagweh, sur la côte nord. Elle le fit à quatre reprises pour Idelba sans jamais poser de questions, et sans jamais qu’Idelba lui fournisse d’explication. Encore une fois, comme à Turi, on aurait dit qu’Idelba savait des choses que les autres ignoraient. Idelba vivait une vie terriblement compliquée. Des hommes l’attendaient à l’entrée de leur immeuble. Certains lui jetaient des regards énamourés, et il y en avait même un qui frappait à la porte en bêlant :
— Idelbaaa, je t’aime, s’il te plaaaît !
Il se mettait alors à chanter d’une voix d’ivrogne dans une langue que Budur ne reconnaissait pas, tout en martyrisant une guitare. Idelba en profitait pour s’éclipser dans sa chambre, et réapparaissait une heure plus tard, comme si de rien n’était. D’autres fois, elle disparaissait pendant plusieurs jours, revenait, les sourcils en bataille, quelquefois heureuse, d’autres fois agitée… Une vie vraiment très compliquée. Et dont plus de la moitié se passait en secret.
12
— Oui, dit un jour Kirana en réponse à une question de Budur sur les Hodenosaunees, alors qu’il en passait quelques-uns devant le café où elles étaient assises. Il n’est pas impossible qu’ils soient l’espoir de l’humanité. Mais je ne crois pas que nous les comprenions encore suffisamment pour en être sûrs. Quand ils auront achevé la domination du monde, alors nous en saurons davantage.
— Étudier l’histoire te rend cynique, remarqua Budur.
Le genou de Kirana était encore fortement appuyé sur le sien. Budur la laissa faire, sans réagir d’aucune façon.
— Ou disons plutôt que tes voyages et l’enseignement t’ont rendue pessimiste.
Pour dire les choses avec délicatesse.
— Absolument pas, répliqua Kirana en allumant une cigarette. Elle fit un geste en direction de son paquet et dit, en changeant de sujet :
— Tu vois déjà comme ils nous ont rendus accros à leur tabac ! Enfin, je ne suis pas pessimiste. Juste réaliste. Pleine d’espoir, ah, ah ! Les faits sont là, il suffit de les regarder.
Elle aspira une longue bouffée de sa cigarette et fit la grimace.
— Aïe, mal au ventre ! Ha ! L’histoire, jusqu’à présent, c’est un peu comme les règles des femmes, un ovule de possibilités, caché dans ce que la vie a de plus ordinaire, où des hordes de petits barbares lui donnent l’assaut, s’efforcent de le trouver, échouent, se bagarrent les uns contre les autres – jusqu’à ce qu’un putain de flot de sang foute en l’air tout espoir d’y arriver. Après quoi, il n’y a plus qu’à recommencer.
Budur gloussa, choquée et amusée. Jamais cette pensée ne lui avait traversé l’esprit.
Kirana partit d’un rire espiègle en la voyant réagir.
— L’œuf rouge, dit-elle. Le sang et la vie.
Son genou appuya plus fort sur celui de Budur.
— Le problème c’est : les hordes de spermatozoïdes parviendront-elles à l’œuf ? L’un d’eux parviendra-t-il à prendre la tête et à féconder la graine, pour que la Terre tombe enceinte ? Ne naîtra-t-il donc jamais de civilisation digne de ce nom ? Ou l’histoire est-elle condamnée à mourir vieille fille ?
Elles rirent ensemble, Budur avec gêne, pour bien des raisons.
— Il lui faudra choisir le bon partenaire, se risqua-t-elle à dire.
— Oui, dit Kirana avec cet air finaud qu’elle avait toujours, les coins de ses lèvres imperceptiblement relevés. Les Martiens, peut-être ?
Budur se rappela sa cousine Yasmina « s’entraînant à embrasser ». Des femmes aimant des femmes ; faire l’amour à des femmes ; cela était courant, dans la zawiyya, et probablement ailleurs aussi. Il y avait, après tout, beaucoup plus de femmes que d’hommes à Nsara, comme dans le reste du monde. On voyait très peu d’hommes d’une trentaine ou d’une quarantaine d’années dans les rues ou dans les cafés de Nsara, et ces rares hommes paraissaient souvent hantés, ou fuyants, perdus dans les brumes de l’opium, bien conscients de s’être, en quelque sorte, tirés des griffes du destin. Oui – toute cette génération avait été sacrifiée. C’est pourquoi l’on voyait si souvent des femmes en couple, se tenant par la main, vivant ensemble dans des vieux immeubles sans ascenseurs ou dans des zawiyyas. Plus d’une fois, Budur les avait entendues dans sa propre zawiyya, dans la salle de bains ou dans les chambres, ou marchant dans le couloir, tard dans la nuit. Cela faisait simplement partie de la vie, quoi qu’en disent les gens. Elle avait elle-même participé une ou deux fois aux jeux de Yasmina, au harem. Yasmina lisait à haute voix l’un de ses romans roses, écoutait l’un de ses feuilletons radiophoniques, ou l’une de ces plaintives mélodies qui leur arrivaient de Venise ; après quoi elle sortait se promener dans la cour, en chantant sous la lune, espérant qu’un homme serait en train de l’espionner en cet instant précis, ou qu’il sauterait par-dessus le mur pour la prendre dans ses bras. Mais il n’y avait pas d’hommes dans les parages pour faire ça. Essayons juste de voir ce que cela ferait, murmurait-elle d’une voix rauque à l’oreille de Budur, comme ça on saura quoi faire, et une fois la surprise passée, Budur la sentait l’embrasser passionnément sur la bouche en se collant contre elle, et quand Budur avait surmonté sa surprise, elle sentait la passion l’envahir, comme si un transfert de ki venait de s’opérer. Alors, elle lui rendait son baiser en pensant : Est-ce que quand ce sera pour de vrai ça me fera battre le cœur aussi fort que ça ? Est-ce possible ?
La cousine Rema était encore plus experte, bien que moins passionnée, que Yasmina. Comme Idelba, elle avait déjà été mariée, et avait vécu dans une zawiyya à Rome. Elle les regardait faire et disait calmement : Non, pas comme ça, passez votre jambe derrière celle de l’homme que vous embrassez, pressez votre pubis contre sa hanche, ça les rend complètement fous, cela ferme le circuit, vous comprenez, le ki passe de vous à lui comme dans une dynamo. Quand elles essayaient de le faire, elles constataient que c’était vrai. Après quelque temps de cet exercice, Yasmina avait le rouge aux joues, et se mettait à pleurer de manière peu convaincante, Oh, que nous sommes mauvaises, que nous sommes mauvaises, alors Rema se gaussait et disait : Ces choses arrivent dans tous les harems de la Terre. Cela montre à quel point les hommes sont idiots. Cela montre à quel point le monde est devenu fou.
Maintenant, au beau milieu de la nuit, dans ce café de Nsara, Budur pressa doucement son genou contre celui de Kirana, d’une manière éloquente, amicale mais neutre. Les fois précédentes, elle s’était toujours arrangée pour partir en même temps que d’autres étudiants. Elle évitait de croiser le regard de Kirana quand cela aurait pu prêter à conséquence, passer pour une invitation à la suivre. Elle n’était pas sûre, si elle répondait de manière plus directe à ses avances, ou s’engageait dans quoi que ce fût, dans l’au-delà des baisers et des caresses, des répercussions que cela pourrait avoir sur ses études, ou sur sa vie en général. Le sexe, elle savait ce que c’était, ce serait la partie la plus évidente ; mais elle ne savait rien du reste. Elle n’était pas sûre de vouloir une aventure avec cette femme plus vieille qu’elle, si forte, sa prof, et pourtant, encore, d’une certaine façon, une étrangère. Mais si on ne se jette pas à l’eau, est-ce que les gens ne restent pas, pour toujours, des étrangers ?
13
Budur et Kirana étaient à une soirée mondaine, se sentant un peu perdues au milieu de la foule des invités qui se pressaient en grand nombre sur l’immense patio dominant la Lawiyya et son estuaire. Elles se tenaient si près l’une de l’autre que leurs bras se touchaient un peu, comme sans le faire exprès, comme si la cohue autour du riche mécène, le philosophe Tahar Labid, les obligeait à le faire si elles voulaient jouir des magnifiques perles qui sortaient de sa bouche ; même si en fait il était évident qu’il n’était qu’un affreux vantard, un homme qui ne cessait de répéter votre nom tout en vous parlant, à peu près à chaque phrase qu’il daignait vous adresser, ce qui à la longue était des plus troublants. On aurait dit qu’il essayait de vous dominer, ou bien, plus simplement, de se rappeler quel était le nom de la personne à laquelle il débitait l’un de ses interminables monologues. Se rendrait-il compte un jour que cela poussait les gens à le fuir à tout prix ?
Après un certain temps de ce régime, Kirana ne put s’empêcher de frissonner. Elle avait l’impression qu’il était en train de boire ses propres paroles, et cela ressemblait un peu trop à cette façon qu’elle avait elle aussi, parfois, de se perdre. Il était temps de s’éloigner. Elle prit Budur par la main et l’emmena un peu plus loin. À force de nettoyer la vaisselle du laboratoire, Budur avait les mains toutes blanches et gercées.
— Tu devrais mettre des gants en caoutchouc, lui dit Kirana. Je pensais qu’ils feraient attention à ça, au laboratoire.
— C’est le cas, et j’en mets. Mais parfois, avec, on a du mal à tenir les choses…
— Qu’importe.
Budur sourit intérieurement que Kirana, cette grande intellectuelle, s’intéresse aux craquelures de ses mains. Puis on vint lui demander ce qu’elle pensait de certaines féministes chinoises, et un auditoire se forma autour d’elle, avide d’entendre sa réponse. Budur la regarda expliciter les liens qui les rattachaient aux musulmans chinois, et notamment à Kang Tongbi. Grâce aux encouragements de son mari, l’intellectuel sino-musulman Ibrahim al-Lanzhou, elle avait jeté les bases d’un féminisme théorisé plus tard dans la Chine intérieure par plusieurs générations de femmes de la défunte période Qing. Leurs revendications avaient été farouchement combattues par la bureaucratie impériale, puis la Longue Guerre avait fait passer tout cela au second plan, et les brigades de femmes et les équipes d’ouvrières s’étaient trouvées plongées dans une misère sociale telle que rien, même pas les efforts des fonctionnaires chinois, n’avaient pu leur faire faire marche arrière. Kirana pouvait réciter de mémoire la liste des demandes faites au cours de la guerre par le Conseil Chinois des Femmes Travaillant dans l’Industrie, et ne se priva pas de le prouver sur-le-champ :
— Égalité des droits pour les hommes et pour les femmes, accès plus large et facilité des femmes à l’éducation, amélioration du statut de la femme au foyer, monogamie, droit des femmes au choix du conjoint, aides aux carrières, interdiction de vendre ou d’acheter une femme, interdiction d’avoir une concubine, interdiction de mutiler physiquement une femme, amélioration du statut politique de la femme, réforme de la prostitution…
On aurait dit une sorte de chanson étrange, comme un chant ou une prière.
— Seulement, vous comprenez, les féministes chinoises disaient que les femmes avaient la partie plus belle au Yingzhou ou à Travancore, et à Travancore les femmes disaient avoir tout appris des Sikhs, qui avaient tout appris dans le Coran. Et nous nous sommes focalisées sur les Chinoises. En fait, vous comprenez, c’est un peu comme si les femmes du monde entier s’étaient donné le mot pour dire qu’ailleurs les femmes sont mieux traitées, et avaient ainsi entrepris le long processus d’amélioration de leurs conditions de vie ! Sur des bases fausses : cela n’allait bien nulle part, sauf chez les Hodenosaunees, mais cela nous ne le savions pas encore.
Et elle continua de parler, brossant brillamment un tableau des trois cents dernières années du féminisme dans le monde, et pendant tout ce temps Budur crispait ses mains aux jointures blanchies, pensant : Elle a envie de toi, elle veut que tu aies les mains douces, parce que si elle arrive à ses fins, tu la caresseras…
Budur s’éloigna de quelques pas, pensive, solitaire. Elle aperçut Hasan sur une terrasse, un peu plus loin, et alla rejoindre le groupe qui l’entourait, où se trouvait Naser Shah, ainsi que la vieille grand-mère du cours de Kirana, qui paraissait désœuvrée, sans son tricot. Il s’avéra qu’en fait ils étaient frère et sœur, et qu’elle était même l’hôtesse de cette soirée : Zainab Shah, qui répondit un peu sèchement quand on lui présenta enfin Budur. Hasan était un vieil ami de la famille. Budur comprit en écoutant Naser discuter avec eux que cela faisait des années qu’ils connaissaient Kirana et qu’ils avaient même suivi ses cours, autrefois.
— Ce qui me gêne le plus, c’est de voir à quel point il peut se montrer répétitif et étroit d’esprit, comme un homme de loi…
— C’est pour ça que ça marche si bien quand il s’agit de le mettre en pratique…
— Ça marche pour qui ? C’était l’homme de loi des religieux.
— Pas un écrivain, en tout cas.
— Le Coran est fait pour être récité et entendu, en arabe, c’est comme de la musique. C’est un grand poète. Tu devrais l’entendre à la mosquée.
— Je n’y mettrai pas les pieds. C’est bon pour les gens qui veulent pouvoir dire : « Je suis meilleur que vous, regardez, tout le monde peut voir que je crois en Allah. » Je déteste ça. Le monde est ma mosquée.
— La religion est comme un château de cartes. Il suffit de la toucher du bout du doigt pour la faire s’écrouler.
— C’est brillant, mais c’est faux. Comme la plupart de tes aphorismes.
Budur laissa Naser et Hasan, et se dirigea vers une longue table où se trouvaient des petits-fours et des verres de vin rouge ou blanc, écoutant au passage ce qui se disait, tout en se régalant de quelques canapés au hareng mariné.
— J’ai entendu dire que le conseil des ministres devait se prosterner devant l’armée pour l’empêcher de puiser dans le trésor. En fait, rien n’a changé…
— … les six lokas sont les noms des parties du cerveau qui permettent d’accomplir les différents types de mentation. Le niveau animal est le cervelet, le niveau des fantômes affamés est l’archipel limbique, le royaume des humains est le lobe pariétal, le royaume des asuras est le cortex frontal, et le royaume des dieux est le thalamus qui joint les deux hémisphères du cerveau, lequel, lorsqu’il est excité, nous permet d’avoir des aperçus d’une réalité supérieure. C’est très impressionnant, vraiment, de rendre les choses aussi claires que ça par la pure introspection.
— Mais ça ne fait que cinq ! Et l’enfer ?
— L’enfer, c’est les autres.
— … je t’assure qu’il n’y en a pas autant que ça.
— Ils contrôlent les océans, alors ils peuvent venir chez nous quand ils veulent. Et nous, ne nous pouvons pas aller chez eux sans leur permission. Donc…
— Donc, nous devrions remercier notre bonne étoile. Il faut que les généraux se sentent aussi faibles que possible…
— C’est vrai, mais il ne faut pas exagérer non plus. Il ne faudrait pas jeter le bébé avec l’eau du bain.
— … est bien connu que la croyance en la réincarnation est répandue un peu partout dans le monde, et qu’elle passe d’une culture à l’autre, allant généralement vers celles qui sont soumises aux plus grandes tensions.
— Peut-être que le passage d’une culture à une autre se fait parce que les gens qui y croient y sont réincarnés. Tu n’y avais jamais pensé ?
— … une étudiante après l’autre, on a l’impression que c’est compulsif. Comme s’il cherchait à remplacer des amis, ou quelque chose comme ça. C’est vraiment triste, d’un autre côté, ce sont les étudiantes qui en souffrent le plus, alors c’est difficile d’avoir trop de peine…
— … l’histoire aurait été complètement différente si seulement…
— Oui ? Si seulement quoi ?
— Si seulement nous avions conquis le Yingzhou quand nous le pouvions encore.
— … c’est un véritable artiste, ce n’est pas si facile de travailler avec les parfums, tout le monde a son propre système d’association, et pourtant il arrive à nous toucher au plus profond de nous-même, oui, il nous touche vraiment. Cette fragrance, d’abord de vanille, puis de cordite et enfin de jasmin, c’est… Et je ne parle que des odeurs de tête, bien sûr, chaque effluve en comprend un bouquet d’une intense richesse, je crois, mais quelle progression, c’est… bouleversant, non, vraiment…
Non loin de la table des cocktails un ami d’Hasan, appelé Tristan, tirait d’un oud aux accents bizarres des sons encore plus étranges, sur des accords répétitifs, en chantant dans une ancienne langue franque. Budur sirota un verre de vin blanc et le regarda jouer, en évacuant le brouhaha des conversations. Sa musique était intéressante, chacun de ses sons semblant flotter dans l’air comme pour s’y attarder. Il avait une moustache noire incurvée au-dessus de ses lèvres. Son regard croisa celui de Budur, et il lui sourit, brièvement. La ballade se termina enfin et il y eut quelques applaudissements. Des gens entourèrent le musicien et l’assaillirent de questions. Budur s’approcha pour écouter ses réponses. Hasan était là, et Budur se retrouva juste à côté de lui. Tristan répondait laconiquement, par timidité sans doute. Il ne voulait pas parler de sa musique. Budur aimait bien son allure, son visage. Les chansons venaient de France et de Navarre, disait-il. Et de Provence. Troisième et quatrième siècles. Les gens voulaient en savoir plus, mais il eut un mouvement dédaigneux et rangea son oud dans son étui. Il n’expliqua pas son comportement, mais Budur se dit qu’il devait trouver que la foule faisait trop de bruit. Tahar se replia vers la table des cocktails, suivi par tout un aréopage.
— Mais enfin, Vika, puisque je te dis que c’est seulement une amie…
— … tout ça remonte à l’époque de Samarkand, quand il y avait encore…
— … il faudra que ce soit beau, dur. Je veux faire honte à tout le monde.
— … c’est à ce moment précis, ce jour-là, à cette heure-là, que tout a commencé…
— … décidément, Vika, je ne sais pas ce que tu as, tu dois être sourde…
— … non, ce que je veux dire, en fait, c’est que…
Budur s’éloigna doucement du groupe, puis, fatiguée de la soirée et de ses invités, quitta la fête. À la gare, l’horaire indiquait que le tram suivant ne passerait pas avant une demi-heure. Alors elle partit à pied, marchant le long du fleuve. Quand elle arriva enfin au centre-ville, elle appréciait tant le simple fait de marcher qu’elle poursuivit sa promenade. Elle alla sur la jetée, dépassa les échoppes des poissonniers et s’offrit au vent, à l’endroit où la jetée se transformait en une allée de réglisse noir versé sur les épais et ronds rochers verts posés sur la mer huileuse qui venait les lécher. Elle regarda les nuages, le ciel, et se sentit soudain heureuse – une émotion naquit en elle, tel un enfant, un bonheur où l’inquiétude n’était qu’une chose distante et vague, l’ombre d’un nuage à la surface bleu sombre de la nuit. Et dire qu’elle aurait pu mourir sans avoir vu l’océan !
14
Idelba vint trouver Budur un soir à la zawiyya et la mit à nouveau en garde :
— Budur, ce que je t’ai dit à propos de l’alactin. Ce que sa fission impliquerait… N’en parle à personne, hein…
— Bien sûr que non. Mais dans ce cas, pourquoi m’en as-tu parlé ?
— Eh bien… nous nous demandons si nous ne sommes pas surveillés… Apparemment, par quelques-uns des membres du gouvernement, par un service de sécurité quelconque. C’est un peu flou. En tout cas, on n’est jamais trop prudent.
— Pourquoi ne préviens-tu pas la police ?
— Bah…
Budur vit qu’elle se retenait de lever les yeux au ciel.
— Depuis la guerre, la police fait partie de l’armée, dit Idelba en baissant la voix. Alors nous préférons absolument éviter d’attirer l’attention sur ce genre de sujets.
— Enfin, ça ne devrait pas être un problème ici, répondit Budur avec un ample geste du bras. Les femmes de la zawiyya ne trahiraient jamais l’une de leurs compagnes, et sûrement pas à la police.
Idelba la regarda en se demandant si elle était sérieuse.
— Ne sois pas si naïve, dit-elle enfin, sèchement.
Puis elle lui tapota le genou et se leva pour aller aux toilettes.
D’autres nuages devaient bientôt assombrir le bonheur de Budur. Dans tout le Dar al-Islam, les journaux ne parlaient que de troubles et d’inflation. Les coups d’État militaires au Skandistan, en Moldavie, en al-Germanie et au Tyrol, tout près de Turi, avaient inspiré au reste du monde une terreur sans commune mesure avec leur portée ; ils avaient été perçus comme le signe d’un regain d’agressivité de la part des musulmans. L’islam tout entier était accusé de ne pas respecter les résolutions imposées après la guerre par la Conférence de Shangaï, comme si l’islam était un bloc monolithique – ce qui était déjà un concept lisible au plus fort de la guerre. La Chine, l’Inde et le Yingzhou demandèrent la remise en vigueur des sanctions et des embargos. L’effet de cette seule menace se fit immédiatement sentir en Franji. Les cours du riz, des pommes de terre, du sirop d’érable et du café montèrent vertigineusement. Les habitants se remirent à stocker, les vieilles habitudes de la guerre reprenant rapidement le dessus, et alors que les prix grimpaient en flèche, les produits de première nécessité disparurent des épiceries au moment où ils apparaissaient sur les étagères. Et cela valait pour tout, pour les denrées alimentaires comme pour le reste. Le stockage était un phénomène extrêmement contagieux, une sale mentalité, un manque de confiance dans la faculté du système à faire face aux problèmes ; et comme le système s’était en effet désastreusement effondré à la fin de la guerre, beaucoup de gens étaient prompts à stocker à la première alerte. Faire à manger à la zawiyya était devenu un exercice d’ingéniosité. Elles n’avaient souvent pour dîner qu’une soupe de pommes de terre, aromatisée ou agrémentée de tout ce qui permettait de lui donner un semblant de goût ; mais elles étaient souvent obligées de l’allonger de beaucoup d’eau pour que toutes, autour de la table, en aient un bol.
La vie dans les cafés se poursuivait dans sa gaieté coutumière, en apparence du moins. Les voix trahissaient peut-être une certaine nervosité ; les rires semblaient parfois forcés, les yeux étaient plus brillants, les piliers de bar encore plus soûls que d’habitude. On commença même à stocker l’opium. Des gens se déplaçaient avec des brouettes de papier-monnaie. Certains sortaient de leurs poches des billets romains de cinq quintillions de drachmes pour payer les cafés, et s’esclaffaient quand on les leur refusait. En fait, ce n’était pas très drôle. Toutes les semaines le prix des choses augmentait, et on avait l’impression qu’il n’y avait rien à faire. Les gens riaient de leur propre désarroi. Budur allait moins souvent au café, ce qui lui faisait faire des économies, et lui évitait l’un de ces moments bizarres avec Kirana. Elle allait parfois avec Piali, le neveu d’Idelba, dans d’autres genres de cafés, plus populaires. Piali et ses copains, dont parfois Hasan et son ami Tristan, semblaient préférer les gargotes fréquentées par les marins et les dockers. Et c’est ainsi que, cet hiver-là, alors qu’un épais brouillard stagnait dans les rues de la ville, Budur passa de longs moments à écouter des histoires du Yingzhou et du tempétueux Atlantique, le plus redoutable de tous les océans.
— Nous vivons de souffrances, dit amèrement Zainab Shah, tout en tricotant dans leur café habituel. Nous sommes comme les Japonais une fois conquis par les Chinois.
— Que se brise le calice des circonstances, murmura Kirana.
Elle avait une expression sereine et indomptable dans la pénombre.
— Ils se sont déjà tous brisés, ajouta Naser.
Il était assis dans un coin, et regardait la pluie courir sur les vitres. Il fit tomber la cendre de sa cigarette dans un cendrier.
— Et je ne dirai pas que je le regrette.
— En Iran non plus ils n’ont pas l’air de le regretter, dit Kirana comme pour le réconforter. Ils font de sacrés progrès là-bas, ils sont très en avance dans des tas de domaines. La linguistique, l’archéologie, les sciences physiques… Les plus grands savants sont chez eux.
Naser approuva, perdu dans ses pensées. Budur avait compris qu’il avait consacré sa fortune à financer bon nombre de recherches, depuis son exil à la cause indéterminée. Encore une vie bien compliquée.
La pluie redoubla. Le temps semblait communier avec eux. Le vent et la pluie giflaient la devanture du café La Sultane, et de grands filets d’eau serpentaient sur les carreaux, chassés par de brusques rafales. Le vieux soldat regardait la fumée de sa cigarette monter, plumets jumeaux de gris et de brun, puis se détacher en volutes solitaires. Piali lui avait naguère expliqué la dynamique de cette paresseuse ascension, reflet inversé des deltas de pluie qui ruisselaient sur les vitres. Une lumière d’orage parait d’argent la rue détrempée. Budur se sentait heureuse. Le monde était beau. Elle avait tellement faim que le lait de son café lui faisait comme un repas. La lumière de l’orage était un repas. Elle pensait : Cet instant est beau. Ces vieux Perses sont beaux ; leur accent persan est beau. La rare sérénité de Kirana est belle. Adieu, passé ! Adieu, futur ! Ce bon vieux Khayyam l’avait bien compris, et c’était l’une des raisons pour lesquelles les mollahs ne l’aimaient pas.
Emplis la coupe et dans l’embrasement du printemps
Quitte les habits hivernaux de la repentance,
Bref est le vol de l’oiseau du temps.
Voler – partir ! L’oiseau s’en est allé !
Les autres rentrèrent chez eux, et Budur resta avec Kirana, qui écrivait dans son carnet à couverture marron. Kirana leva les yeux, contente que Budur la regarde. Elle prit une cigarette, et elles parlèrent un moment, du Yingzhou et des Hodenosaunees. Comme toujours, les idées de Kirana débouchaient sur quelque chose d’intéressant. Elle pensait que, aussi paradoxal que cela puisse paraître, si les Hodenosaunees avaient réussi à survivre lorsque le Vieux Monde les avait découverts, c’était parce qu’ils étaient au tout premier stade de la civilisation. C’étaient des chasseurs et des cueilleurs astucieux, plus intelligents que les individus des cultures plus développées, et beaucoup plus ouverts que les Inkas, engoncés dans un système théocratique rigide. S’ils n’avaient pas été aussi vulnérables aux maladies du Vieux Monde, les Hodenosaunees auraient très certainement déjà conquis la planète. Maintenant, ils rattrapaient le temps perdu.
Elles parlèrent de Nsara, de l’armée, des religieux, de la madrasa et du monastère. De l’enfance de Budur. Du séjour en Afrique de Kirana.
Quand le café ferma, Budur suivit Kirana jusqu’à sa zawiyya, où il y avait un petit bureau mansardé dont la porte était souvent fermée. Là, sur un canapé, elles roulèrent l’une sur l’autre, en s’embrassant à pleine bouche, glissant d’une étreinte à la suivante. Kirana serrait Budur à lui broyer les côtes. Elle l’étreignait encore de toutes ses forces quand son ventre se crispa sous l’effet d’un violent orgasme.
Ensuite, Kirana la tint contre elle, plus calme que jamais, avec son habituel sourire en coin.
— À ton tour, dit Budur.
— J’ai déjà joui, je me frottais sur ton tibia.
— Tu sais, il y a plus doux que ça.
— Non, vraiment, ça va. Je suis contente.
Et Budur comprit, avec un choc qu’elle ne put s’empêcher de trahir par son regard, que Kirana ne la laisserait pas la toucher.
15
Par la suite, Budur éprouva un curieux sentiment pendant les cours, puis au café. Kirana se comportait avec elle comme elle l’avait toujours fait, sans doute par souci des convenances. Budur trouva cela déroutant, et presque triste. Au café, elle s’asseyait de l’autre côté de la table, en face de Kirana, dont elle croisait rarement le regard. Mais Kirana paraissait fort bien s’en accommoder, continuant à discourir comme d’habitude. Maintenant, Budur trouvait à sa façon de parler quelque chose d’un peu forcé, voire d’exaspérant. Pourtant celle-ci n’avait en rien changé. Ce n’était ni plus ni moins verbeux qu’avant.
Budur se tourna vers Hasan, qui racontait son futur voyage vers les îles du Sucre, où il comptait bien passer ses journées à fumer de l’opium, vautré sur les vastes plages de sable blanc, ou à nager dans l’eau turquoise, aussi chaude qu’un bain.
— Ce serait génial, non ? demanda-t-il.
— Je garde ça pour ma prochaine vie, répondit Budur.
— Ta prochaine vie ! fit Hasan en haussant les épaules, tout en la regardant les yeux brillants, avec un sourire sardonique. C’est si mignon d’y croire…
— On ne sait jamais, dit Budur.
— C’est vrai. Tu devrais aller voir madame Sururi, elle te dirait qui tu étais dans tes vies passées. Tu pourrais même parler à tes anciens amoureux, dans le bardo. La moitié des veuves de Nsara le font. Il paraît que ça les aide à se sentir mieux. Tant qu’on y croit… (Il fit un geste en direction de la vitre, derrière laquelle on voyait passer des gens, la tête rentrée dans les épaules, sous leur parapluie.) Quoi qu’il en soit, c’est stupide. La plupart des gens ne vivent même pas la seule vie qu’ils ont…
Une seule vie… Budur avait du mal à accepter cette idée, bien que la science, et tout le reste, l’ait clairement établi : on n’avait qu’une seule vie. Quand Budur était petite, sa mère lui avait dit un jour : Sois gentille ou tu reviendras plus tard sous la forme d’un escargot. Aux enterrements, on disait une prière pour la prochaine vie des morts ; on demandait à Allah de leur donner une chance de s’améliorer. Il n’était plus question de ça maintenant, pas plus que de l’idée de vie future, de paradis, d’enfer, de Dieu lui-même – toutes ces sornettes, toutes ces croyances superstitieuses des anciennes générations qui, dans leur immense ignorance, concoctaient des mythes pour donner un sens aux choses. Ils vivaient à présent dans un monde matériel, devenu ce qu’il était grâce à la chance et à la physique ; ils se démenaient pendant une seule et unique vie, et mouraient ; c’était la conclusion que les physiciens avaient tirée de leurs travaux. Et rien de ce que Budur avait pu voir ou vivre ne lui permettait de démentir cette affirmation. Pas de doute, c’était vrai. C’était la réalité ; ils devaient s’y faire, ou vivre dans le mensonge. Tout le monde devait accommoder cet état de fait à sa propre solitude cosmique, à la Nakba, à la faim, aux soucis, aux cafés, à l’opium, et à la conscience de sa finitude.
— J’ai bien entendu ? Tu as dit que nous devrions aller voir madame Sururi ? lança Kirana depuis l’autre côté de la table. C’est une très bonne idée ! Ce serait une sorte de classe de nature ! Ce serait très profitable pour tout le monde – un peu comme de visiter un endroit où les gens n’auraient pas changé de mode de vie depuis des siècles.
— D’après ce qu’on m’a dit, ce serait une vieille drôlesse, mais tout ça c’est du charlatanisme.
— Une de mes amies est allée la voir. Elle m’a dit qu’elle s’était beaucoup amusée.
Ils avaient passé bien trop d’heures assis là, à regarder les mêmes cendriers, les mêmes ronds de café sur les tables, les mêmes deltas de pluie sur les vitres. Alors, ils allèrent tous chercher leur manteau, leur parapluie, et prirent le tram numéro quatre vers un quartier déshérité, près du vieux port. Il y avait de petites épiceries arabes à chaque coin de rue. Entre un petit magasin de couture et une laverie, une étroite volée de marches montait vers des appartements au-dessus d’une boutique. Ils frappèrent à une porte, et on les fit entrer dans une sorte de grande pièce noire, pleine de canapés et de tables basses. Apparemment, il s’agissait de l’ancien salon d’un grand appartement défraîchi.
Une dizaine de femmes âgées et trois vieux messieurs regardaient, assis sur des chaises, une femme aux cheveux noirs. Elle était plus jeune que Budur ne s’y attendait, mais pas si jeune que ça. Elle était habillée comme les Zott, elle avait les yeux passés au khôl, les lèvres et les joues maquillées, et ses bras et son cou disparaissaient sous une profusion de bijoux fantaisie. Quand ils entrèrent, elle parlait à ses adeptes d’une voix basse et gutturale. Elle invita, d’un geste, les nouveaux arrivants à prendre place sur des chaises vides à l’arrière de la pièce.
— Chaque fois que l’âme descend dans un corps, poursuivit-elle, c’est comme si un soldat de Dieu montait au front de la vie pour combattre l’ignorance et les méchants. Il essaye alors dans la mesure de ses moyens de révéler son propre statut divin et d’établir la vérité de Dieu sur Terre. Puis, à la fin de son voyage dans cette incarnation, il retourne à sa propre région du bardo. Quand les conditions le permettent, je peux parler à cette région du bardo.
— Combien de temps y reste l’âme avant de revenir ? demanda l’une des vieilles dames.
— Cela dépend des circonstances, répondit madame Sururi. Chaque âme a sa propre façon d’évoluer. Certaines ont commencé dans le monde minéral, d’autres dans le monde animal. Quelquefois cela commence par l’opposé ; les dieux cosmiques assument directement forme humaine. (Elle hocha la tête comme si elle était coutumière de ce dernier fait.) Il y a tellement de façons différentes…
— Alors, ce serait vrai ? Nous aurions été des animaux lors d’une précédente incarnation ?
— Oui, c’est tout à fait possible. Au cours du long voyage de notre âme, nous avons été toutes sortes de choses. Y compris des plantes et des animaux. On ne peut évidemment pas évoluer beaucoup entre deux incarnations. Mais en l’espace de plusieurs incarnations, de grands changements peuvent être accomplis. Par exemple, le seigneur Bouddha a lui-même révélé avoir été une chèvre dans une précédente existence. Mais comme il était devenu dieu, cela n’avait plus d’importance.
Kirana étouffa un sifflement entre ses dents et bougea sur sa chaise pour masquer le bruit.
Madame Sururi fit comme si de rien n’était et continua :
— Il n’était pas difficile pour lui de voir ce qu’il avait été dans le passé. Certains d’entre nous ont cette faculté. Mais il savait que le passé ne comptait pas. Notre but n’est pas derrière nous, il est devant nous. À toute personne un tant soit peu dotée de conscience, je le dis toujours, le passé n’est que poussière. Je dis cela parce que le passé ne nous a pas donné ce que nous cherchions. Ce que nous voulons, c’est « réaliser Dieu » et être auprès de ceux que nous aimons. Cela ne dépend que de notre cri intérieur. Nous devons dire : « Je n’ai pas de passé. Je commence ici et maintenant, avec la grâce de Dieu et mes propres aspirations. »
Il n’y avait pas grand-chose à objecter, pensa Budur. Cela lui allait droit au cœur ; étrange, étant donné de qui cela venait ; mais elle sentait le scepticisme qui émanait de Kirana, pareil à la chaleur d’un brasier. D’ailleurs, il lui sembla qu’il commençait à réchauffer la pièce elle-même, comme un radiateur poussé au maximum. Mais peut-être tout cela n’était-il que l’effet de la propre gêne de Budur. Elle se pencha vers Kirana et lui serra la main dans l’espoir d’apaiser son agitation. Budur trouvait les propos de la voyante finalement très intéressants.
Une vieille veuve, qui portait toujours cette sorte de badge qu’on leur avait distribué pendant la guerre, dit :
— Quand une âme choisit d’investir un nouveau corps, est-ce qu’elle sait déjà le genre de vie qu’elle va avoir ?
— Elle ne verra que les possibles. Dieu est omniscient, mais Il cache le futur. Même Dieu ne se sert pas tout le temps de son omniscience. Sinon, ce serait trop facile.
La bouche de Kirana s’ouvrit, toute ronde, comme pour dire quelque chose, et Budur lui flanqua un coup de coude.
— L’âme se souvient-elle de ce qu’elle a connu précédemment, ou bien oublie-t-elle tout à chaque fois ?
— L’âme n’a pas besoin de se rappeler ce genre de choses. Ce serait comme se souvenir de ce qu’on a mangé la veille, ou de ce qu’une disciple a fait à manger. Il me suffit de me rappeler que la disciple a été gentille avec moi, et qu’elle m’a donné à manger. Je n’ai pas besoin de me rappeler le menu de chaque repas. Juste qu’on me l’a offert. Seul cela marque l’âme.
— Parfois, mon… mon amie et moi, nous méditons en nous regardant dans les yeux… Il nous semble parfois que nos visages se transforment… Que nos cheveux n’ont plus la même couleur. Je me demande ce que cela veut dire…
— Cela veut dire que vous voyez vos précédentes incarnations. Mais je ne vous le recommande pas. Supposez, que trois ou quatre incarnations plus tôt, vous ayez été une féroce tigresse ? À quoi bon le savoir ? En vérité je vous le dis, le passé n’est que poussière…
— Est-ce que, par hasard, certains de vos disciples… heu… est-ce que certains d’entre nous se seraient connus dans leurs précédentes incarnations ?
— Oui. Nous voyageons en groupe. Nous passons notre temps à nous croiser. Il y a deux disciples, ici, par exemple, qui sont des amies dans cette vie présente. En méditant sur elles, j’ai appris que dans une vie passée elles avaient été sœurs, très proches l’une de l’autre. Et dans une incarnation antérieure, elles étaient mère et fils. Les choses sont ainsi. Rien n’échappe à mon troisième œil. Quand vous avez établi un profond lien spirituel, rien ne peut vraiment le faire disparaître.
— Pouvez-vous nous dire… pouvez-vous nous dire qui nous étions autrefois ? Ou qui parmi nous a ce lien ?
— En fait, je n’ai rien dit personnellement à ces deux personnes, mais mes vrais disciples m’ont entendu le leur dire en leur for intérieur. Et donc ils le savent déjà, au plus profond d’eux. Mes vrais disciples – ceux que j’ai choisis comme miens, et qui m’ont choisie moi – seront comblés et se réaliseront dans cette incarnation, ou dans la prochaine, ou dans très peu d’incarnations. Certains disciples auront besoin d’une vingtaine d’incarnations, parce qu’ils ont mal commencé. D’autres, qui sont venus à moi dans leur première ou deuxième incarnation humaine, auront peut-être besoin de centaines d’incarnations pour atteindre leur but. La première ou la deuxième incarnation ne sont, la plupart du temps, que des incarnations à moitié animales. L’animal est toujours en eux, comme un facteur dominant. En ce cas, comment pourraient-ils réaliser Dieu ? Même ici, parmi nous, au Centre de développement spirituel de Nsara, il y a de nombreux disciples qui n’ont eu que six ou sept incarnations… Et quand je me promène dans les rues de la ville, je vois certains Africains, ou des gens de l’autre côté des mers, qui sont encore à l’évidence plus proches de l’animal que de l’humain. Que peut faire un gourou de telles âmes ? Eh bien, il ne peut pas faire grand-chose.
— Pouvez-vous… pouvez-vous nous mettre en relation avec les âmes qui sont parties ? Maintenant ? N’est-il pas temps, enfin ?
Madame Sururi rendit à celle qui l’interrogeait son regard, calme, posé.
— Elles vous parlent en ce moment même, n’est-ce pas ? Nous ne pouvons les faire venir ici ce soir, à la vue de tout le monde. Les esprits n’aiment pas être ainsi exposés. Nous avons des invités qui n’y sont pas encore habitués. Et je suis fatiguée. Vous savez comme il est exténuant de dire à haute voix, dans ce monde-ci, les choses qui nous sont murmurées à l’esprit. Passons plutôt dans la salle à manger, et allons nous régaler des mets que vous avez eu la bonté d’apporter. Nous mangerons en sachant que ceux que nous aimons nous parlent en silence.
Ceux du café décidèrent, du regard, de partir pendant que les autres passaient dans la pièce voisine, ne voulant pas commettre l’indélicatesse de prendre la nourriture d’autrui sans croire à sa religion. Ils firent don de quelques piécettes à la voyante, qui les accepta dignement, ignorant les regards appuyés de Kirana, se contentant de la regarder sans honte ni complicité.
Le tram n’arriverait pas avant au moins une demi-heure, aussi le petit groupe préféra-t-il rentrer à pied, en traversant le quartier ouvrier, longeant le fleuve, s’amusant à rejouer certaines des scènes auxquelles ils venaient d’assister, rigolant, se moquant. Kirana riait plus fort que tous les autres, et dit, prenant le fleuve à témoin :
— Rien n’échappe à mon troisième œil ! Mais je ne peux rien vous dire pour le moment ! Quel tas de conneries !
— Je vous ai déjà dit ce que j’avais à vous dire à l’intérieur de vous-mêmes, maintenant, à table !
— Certains de mes disciples étaient des sœurs dans leurs vies antérieures, en fait des sœurs chèvres, mais de toute façon le passé, on s’en fout, ah, ah, ah, ah, ah, ah !
— Oh, ça va ! coupa sèchement Budur. Il faut bien qu’elle vive. (Puis elle se tourna vers Kirana :) Elle dit des choses aux gens, et ils lui donnent de l’argent. En quoi est-ce si différent de ce que tu fais, toi ? Et si, grâce à elle, ils se sentaient mieux ?
— Tu crois ça ?
— Elle leur donne quelque chose, et ils lui donnent à manger. Elle leur dit ce qu’ils souhaitent entendre. Toi, tu dis aux gens des choses qu’ils ne veulent pas entendre en échange de quoi manger, est-ce que c’est mieux ?
— Et comment ! répondit Kirana en gloussant de nouveau. C’est un sacré bon truc, vu comme ça. Voici ce que je te propose, hurla-t-elle au monde par-delà le fleuve. Je te dis ce que tu ne veux pas entendre, et toi tu me nourris !
Même Budur se mit à rire.
Ils franchirent le dernier pont bras dessus, bras dessous, en bavardant et en riant. Ils arrivèrent ainsi au centre-ville, dans le vacarme des trams et le brouhaha de la foule. Budur regardait les gens avec intérêt, se remémorant le visage aux traits fatigués de la fausse gourou, qui avait l’air si froidement professionnel, et si dur. Elle comprenait l’hilarité de Kirana. Les vieux mythes n’étaient que des histoires. La seule réincarnation à laquelle on avait droit était celle du lendemain matin, au réveil. Personne d’autre n’était vous, même pas celui qu’on était un an auparavant, ni celui qu’on serait dans dix ans. Tout était affaire de moment, d’une quantité infinitésimale de temps, si petite qu’elle était toujours derrière nous. La mémoire était sélective, une pièce sombre au chic désuet dans un quartier miteux animé par les flashs de lointaines lumières. Elle avait jadis été une jeune fille, dans le harem d’un brave marchand. Et maintenant ? Maintenant, elle était une femme libre, libre d’arpenter les rues de Nsara, de jour comme de nuit, en compagnie d’un groupe d’intellectuels railleurs – et voilà tout. Cela la fit rire elle aussi, d’un rire tellement éclatant qu’il en était douloureux, empli d’une joie qui touchait à la férocité. En fait, c’était là ce que Kirana donnait en échange d’un peu de nourriture.
16
La zawiyya de Budur accueillit trois nouvelles locataires. C’étaient des femmes tranquilles, qui avaient été poussées à venir là par des histoires pareilles à celles des autres, et qu’elles gardaient pour elles. Comme toujours, on commença par les faire travailler à la cuisine. La façon dont elles la regardaient et évitaient de se regarder entre elles mettait Budur mal à l’aise. Elle avait vraiment du mal à croire que de telles jeunes femmes puissent trahir une autre jeune femme si semblable à elles, et trouvait d’ailleurs deux des nouvelles arrivantes charmantes. Budur était plus dure avec elles qu’elle n’aurait voulu l’être, en évitant cependant de se montrer ouvertement hostile : Idelba l’avait prévenue qu’une telle attitude aurait pu éveiller leurs soupçons. C’était un jeu subtil auquel Budur n’avait pas l’habitude de jouer – en tout cas pas vraiment – et qui lui rappelait les divers rôles qu’il lui était déjà arrivé de jouer face à Père ou Mère, ce qui n’était pas un souvenir agréable. Elle voulait que tout soit complètement nouveau, elle voulait se tenir droite face au monde, poitrine contre poitrine, comme disaient les Iraniens. Mais, apparemment, vivre supposait de porter un masque la plupart du temps. Elle devait faire comme si de rien n’était pendant les cours de Kirana, jouer l’indifférence quand elles se retrouvaient dans les cafés, même quand elles étaient jambe contre jambe, et elle devait être aimable avec ces espionnes.
Pendant ce temps, de l’autre côté de la place, au laboratoire, Idelba et Piali travaillaient plus dur que jamais, continuant leurs recherches jusque tard dans la nuit, tous les soirs. Budur avait l’impression que les choses devenaient de plus en plus sérieuses bien qu’elle s’efforçât de minimiser ses problèmes. « Ce n’est que de la physique, répondait Idelba quand on l’interrogeait sur ses travaux. J’essaie d’y voir plus clair. Vous savez à quel point les théories peuvent être intéressantes, mais cela reste des théories. Il ne s’agit pas de vrais problèmes. »
On aurait dit que tout le monde portait un masque, même Idelba. Mais elle s’y prenait mal, alors qu’elle avait si souvent besoin d’en porter un. Budur voyait parfaitement que pour elle l’enjeu était manifestement très important.
— S’agit-il d’une bombe ? lui demanda-t-elle un soir, à voix basse, tandis qu’elles fermaient le labo désert.
Idelba eut une brève hésitation.
— Peut-être, murmura-t-elle, en regardant autour d’elle. En tout cas, c’est faisable. Alors, je t’en prie, n’en parle plus jamais.
Pendant les mois qui suivirent, Idelba travailla tant et, comme tout le monde à la zawiyya, mangea si peu qu’elle tomba malade et dut s’aliter. Pour elle, c’était extrêmement frustrant, et alors qu’elle était encore gravement malade, elle essaya de se lever. Mais elle dut se contenter de travailler dans son lit, noircissant des feuilles de papier et faisant cliqueter sa règle à calculs dès son réveil.
Puis, un jour, elle reçut un coup de téléphone alors que Budur était là. Elle enfila sa robe de chambre et se traîna dans le couloir pour prendre l’appel. À son retour, elle se précipita à la cuisine et demanda à Budur de la rejoindre dans sa chambre.
Budur la suivit, surprise de la voir se déplacer si vite. Idelba ferma la porte de sa chambre et commença à fourrer ses livres, ses papiers et ses cahiers dans un sac de marin.
— Cache ça pour moi, lui dit-elle sur le ton de l’urgence. Malheureusement, je ne crois pas que tu puisses partir. Ils t’arrêteraient et te fouilleraient. Il faut que cela reste quelque part dans la zawiyya, mais pas dans ta chambre, ni dans la mienne. Ils les passeront toutes les deux au peigne fin. Ils pourraient chercher partout, je ne sais trop quoi te conseiller.
Elle parlait à voix basse, sur un ton désespéré. Budur ne l’avait jamais vue ainsi.
— Qui ça, « ils » ?
— Peu importe, dépêche-toi ! C’est la police ! Ils sont en route, dépêche-toi !
On sonna à la porte une première fois, puis une seconde.
— Ne t’inquiète pas, dit Budur.
Puis elle se précipita vers sa chambre. Elle regarda autour d’elle : on fouillerait sa chambre, peut-être toute la maison. Et le sac était particulièrement rebondi. Elle parcourut encore une fois la chambre du regard, passant mentalement tous les endroits en revue, se demandant si cela dérangerait Idelba qu’elle se débarrasse du sac de toile… Elle n’avait rien de particulier en tête, et elle ignorait l’importance exacte de ces papiers, mais elle pourrait peut-être les déchirer, puis les jeter dans les toilettes et tirer la chasse.
Il y avait des gens dans le couloir. Elle entendait des voix de femmes. Apparemment, les officiers de police qui étaient entrés étaient des femmes. Les lois de la zawiyya, qui en interdisaient l’accès aux hommes, étaient donc respectées. C’était peut-être un signe. Et puis des voix d’hommes montèrent de la rue, se disputant avec les anciennes de la zawiyya. Il y avait des femmes dans le couloir. On frappa brutalement à sa porte. Elles commenceraient par sa chambre et par celle d’Idelba, c’était sûr. Elle passa son sac en sautoir, grimpa sur son lit puis sur le dosseret métallique, se dressa sur la pointe des pieds, fit coulisser un panneau du faux plafond et d’une détente qui rappelait les bonds des danseurs, suivie d’un rétablissement, se faufila dans l’espace situé entre les deux parois, passa dans le caisson du plafond et grimpa sur le sommet poussiéreux du mur, large d’environ deux pieds. Elle s’y installa et remit le panneau en place, tout cela sans bruit.
Le vieux musée avait eu jadis de très hauts plafonds, percés de lucarnes vitrées, à présent complètement opacifiées par la crasse. Dans la pénombre, elle distinguait, entre le plafond et le faux plafond, des enfilades de chambres, le haut ouvert des couloirs, ainsi que les véritables murs, qui limitaient la perspective, au loin. Ce n’était vraiment pas l’endroit idéal pour se cacher, puisqu’il suffisait de lever les yeux, n’importe où dans le couloir, pour la voir.
Le haut des murs était constitué de poutres de bois gauchies appuyées sur les murs porteurs, comme autant de chapiteaux. Chaque mur était doublé de part et d’autre par des cloisons de plâtre, particulièrement sonores. Elle pourrait donc passer d’un mur à l’autre, si elle trouvait une poutre, quelque part.
Elle mit son sac sur son dos et avança à quatre pattes sur les poutres poussiéreuses, à la recherche d’une issue, tout en faisant bien attention à rester hors de vue du couloir. Dans le faux plafond, tout paraissait délabré, assemblé à la va-vite, et elle trouva rapidement un endroit où trois murs se rencontraient, et où la poutre n’allait pas jusqu’au mur porteur. L’espace ménagé au bout n’était pas suffisant pour contenir le sac plein, mais elle put y mettre pas mal de papiers ; ce qu’elle fit rapidement, jusqu’à ce que le sac soit vide, après quoi, elle l’y fourra à son tour. La cachette n’était pas parfaite, elle ne résisterait pas à une fouille minutieuse, mais c’était ce qu’elle avait encore trouvé de mieux dans l’urgence, et elle n’en était, au fond, pas mécontente. Cela dit, si jamais on la voyait là-haut sur les poutres, tout était perdu. Elle repartit en rampant le plus discrètement possible, entendant des voix venir de sa chambre. Il leur suffirait de monter sur le dosseret de son lit et de soulever un des panneaux du faux plafond pour la voir. La salle de bains, un peu plus loin, n’avait pas l’air occupée, aussi se dirigea-t-elle dans cette direction, s’écorchant le genou sur un clou. Enfin, elle souleva délicatement le coin d’un des panneaux du faux plafond, s’assura qu’il n’y avait personne, le retira, se coula par le trou, resta un moment suspendue par les mains au faux plafond, lâcha tout, et tomba lourdement sur le sol carrelé de la salle de bains. Elle avait maculé le mur de sang et de poussière ; ses genoux et ses pieds étaient noirs de crasse. Quant à ses mains, elles laissaient un peu partout des traces aussi sombres que l’âme de Caïn. Elle se lava à un lavabo, ôta précipitamment sa djellaba, la mit dans le panier à linge sale, prit quelques serviettes propres dans l’armoire et en mouilla une pour nettoyer le mur. Le panneau du plafond était resté de guingois, et il n’y avait pas de chaise dans la salle de bains ; il n’y avait donc pas moyen de le remettre en place. Elle jeta un bref coup d’œil dans le couloir. Elle entendait de fortes voix en train de se disputer, parmi lesquelles elle reconnut celle d’Idelba, indignée. Mais il n’y avait personne en vue. Elle se précipita dans la première chambre ouverte, prit une chaise et revint en courant dans la salle de bains. Elle plaça la chaise contre le mur, grimpa dessus, monta très précautionneusement sur le dossier et remit le panneau en place, en se coinçant les doigts au passage. Elle prit une fraction de seconde pour s’assurer que les panneaux étaient bien jointifs, et redescendit, faisant déraper la chaise, qui bascula sur le carrelage, et – bang ! Elle se releva en vitesse, jeta un nouveau coup d’œil dans le couloir : la dispute continuait, mais le bruit se rapprochait. Elle courut remettre la chaise en place, retourna dans la salle de bains, se précipita sous la douche, se savonna les genoux, sentit son écorchure la brûler. Elle se lava et se relava, entendit des voix devant la salle de bains. Elle se rinça le plus rapidement possible, et elle était déjà séchée et enveloppée dans une grande serviette quand des femmes firent irruption dans la pièce. Deux d’entre elles portaient des uniformes de l’armée, ressemblant à ces soldats que Budur avait vus, jadis, à la gare de Turi. Elle prit un air étonné, resserrant la serviette autour d’elle.
— Êtes-vous Budur Radwan ? demanda l’une des policières.
— Oui ! Que se passe-t-il ?
— Nous voulons-vous parler. Où étiez-vous ?
— Comment ça, où j’étais ? Vous le voyez bien, où j’étais ! De quoi s’agit-il, enfin ? Que me voulez-vous ? Que faites-vous ici ?
— Nous voulons vous parler.
— Bon, eh bien, laissez-moi m’habiller, et je vous parlerai. Je suppose que je n’ai rien fait de mal ? Je peux quand même m’habiller avant d’aller parler à mes compatriotes, non ?
— Ici, on est à Nsara, dit l’une d’elles. Vous venez de Turi, n’est-ce pas ?
— Certes, mais nous sommes toutes franjs, toutes de bonnes musulmanes dans une zawiyya, à moins que je ne me trompe ?
— Allez vous habiller, dit une autre. Nous avons quelques questions à vous poser concernant certaines affaires, des problèmes de sécurité liés peut-être à des personnes habitant ici. Alors, venez. Où sont vos vêtements ?
— Dans ma chambre, bien sûr !
Et Budur passa devant elles pour aller dans sa chambre, à la recherche de la djellaba qui cacherait ses genoux, et le sang qui pourrait couler le long de sa jambe. Son sang était chaud, mais sa respiration tranquille. Elle se sentait forte, et elle sentait grandir en elle une colère pareille à ces rochers de la jetée, ancrant sa résolution.
17
Ils eurent beau fouiller, ils ne trouvèrent pas les papiers d’Idelba. De même qu’ils sortirent de leurs interrogatoires quelque peu déconcertés et assez écœurés. La zawiyya poursuivit la police en justice, l’accusant de violation de propriété ; et seule l’invocation du secret militaire empêcha que l’affaire soit jetée en pâture aux journaux, ce qui aurait à coup sûr donné lieu à un nouveau scandale. La cour légitima l’enquête, mais aussi le droit de la zawiyya au respect de sa vie privée. Ainsi, tout redevint normal, ou presque. Idelba ne parla plus jamais de son travail à personne, ne travailla plus dans certains laboratoires et ne passa plus une seconde en compagnie de Piali.
Budur, elle, continuait comme d’habitude à aller de la maison au travail, ou au café La Sultane. Elle s’asseyait près de la vitre et regardait le port, les forêts de mâts et de superstructures métalliques, le haut du phare au bout de la jetée, tandis que les conversations faisaient autour d’elle. À leur table venaient aussi très souvent s’asseoir Hasan et Tristan. On aurait dit des coquillages exposés par la marée basse, qui brillaient d’un éclat mouillé au clair de lune. Les talents oratoires, le sens de la poésie d’Hasan lui conféraient une force avec laquelle il fallait compter, vérité que toute l’avant-garde de la ville avait fini par accepter, parfois à contrecœur. Hasan lui-même commentait sa notoriété avec un air narquois censé traduire son humilité, et souriait de façon sardonique quand il parlait de son entregent. Budur savait combien il pouvait être désagréable, mais elle l’aimait bien. Elle s’intéressait plus à Tristan et à sa musique, qui ne se limitait pas aux chansons qu’il leur avait interprétées au cours de la réception. Il composait des pièces bien plus ambitieuses, pour des orchestres allant parfois jusqu’à deux cents musiciens, à l’interprétation desquelles il n’hésitait pas à participer en jouant du kundun – un instrument à cordes venu d’Anatolie, diaboliquement difficile à jouer, muni de touches métalliques qui servaient à changer de tonalité. Il écrivait la partition de chaque instrument de ces vastes compositions, le moindre accord ou changement de ton, la plus petite note en vérité. Comme dans ses chansons, ces compositions plus longues témoignaient de son intérêt pour les anciennes harmoniques des chrétiens disparus. Dans la plupart des cas, il ne s’agissait que de simples accords, offrant chacun des possibilités de modulations sophistiquées, qui pouvaient, à des moments charnières, retrouver les accords pythagoriciens qui servaient de bases aux chorales et aux chants des anciens. Écrire chaque note et exiger des musiciens de l’orchestre qu’ils ne jouent que, et très exactement, les notes portées sur leur partition, était un exercice que beaucoup considéraient, au mieux, comme pratiquement impossible, au pire, comme mégalomaniaque. La musique orchestrale, bien que rappelant dans sa structure les classiques ragas hindous, n’interdisait pourtant pas aux musiciens d’improviser dans les détails. Ce qui donnait lieu à certaines créations spontanées, qui faisaient tout le charme et l’intérêt de la musique, chaque musicien jouant à la fois en accord et en opposition avec les ragas. Personne n’aurait jamais accepté de se laisser torturer par Tristan si le résultat n’avait été de toute beauté, ainsi que tout le monde pouvait en juger. De son côté, Tristan insistait pour dire que cette façon de jouer n’était pas de son invention, mais s’inscrivait dans le prolongement des anciennes civilisations. En fait, il s’inspirait de leur façon de jouer, faisant même de son mieux pour invoquer les fantômes affamés des anciens dans ses rêves et rêveries musicales. Les vieilles pièces franques qu’il espérait ressusciter étaient toutes d’inspiration religieuse, dévote, et devaient être comprises et jouées comme telles : de la musique sacrée. Même si dans le petit cercle hyper branché de cette élite avant-gardiste tous considéraient que c’était la musique proprement dite qui était sacrée, de telle sorte que cette définition était un peu redondante.
De même, le fait de considérer l’art comme sacré impliquait le plus souvent que l’on fume de l’opium ou que l’on boive du laudanum afin de se préparer à cette expérience ; certains se servaient également des formes plus concentrées d’opium développées pendant la guerre, la fumant ou se l’injectant. Les états, proches du rêve, qu’elles induisaient rendaient la musique de Tristan inoubliable, quasi hypnotique – comme disaient ceux qui la jouaient, même ceux qui n’étaient pas vraiment fanas des petits airs simplets des anciennes civilisations. L’opium faisait plonger ceux qui les écoutaient dans un au-delà de sons et de musique, de notes et d’harmonies, les faisant vibrer à l’unisson de leurs interprètes. Si au cours du concert un artiste parfumeur diffusait ses arômes, alors c’était carrément mystique. Certains jugeaient cela avec scepticisme. Kirana avait un jour déclaré :
— Quand ils planent dans leur stratosphère, ils pourraient se contenter de chanter la même note pendant des heures en se respirant les dessous de bras, et ils seraient aussi heureux que des oiseaux !
Souvent, c’était Tristan lui-même qui donnait le départ de la célébration de l’opium, avant de commencer à diriger. Ainsi, ces soirées avaient une allure quasi religieuse, dont Tristan était une sorte de maître soufi mystique, ou l’une de ces incarnations d’Hussein des pièces mettant en scène son martyre, auxquelles la foule opiacée assistait une fois partie pour le pays des rêves. On y voyait Hussein revêtir son propre linceul avant d’être assassiné par Shemr, sous les gémissements de la foule, non parce qu’il s’était fait tuer, mais parce qu’il avait choisi cette forme de martyre. Dans certains pays chiites, l’acteur qui jouait Shemr devait parfois s’enfuir en courant après la représentation, et plus d’un acteur malchanceux, ou trop épuisé par l’excellence de sa prestation pour pouvoir courir, avait été sacrifié par la foule en colère. Tristan approuvait parfaitement tout cela ; c’était le genre d’immersion artistique dans laquelle il voulait plonger son auditoire.
Mais seulement dans le monde laïc ; pour la musique, pas pour Dieu. Tristan était plus persan qu’iranien, comme il le faisait parfois remarquer, plus proche d’Omar que n’importe quel mollah, ou d’un mystique d’obédience zoroastrienne, préparant quelque rituel en l’honneur d’Ahura-Mazda, une sorte de culte au soleil qui, dans les brumes de Nsara, venait parfois du fond du cœur. Frayer avec les chrétiens, fumer de l’opium, adorer le soleil ; il faisait toutes sortes de folies pour sa musique, et notamment travailler plusieurs heures par jour pour coucher chaque note à sa juste place. Rien de tout cela n’eût compté si la musique avait été mauvaise, or il se trouvait qu’elle était bonne, et même plus que ça. En fait, c’était la musique de leur vie, c’était la musique de la Nsara de ce temps-là.
Il exposait toutes les théories sous-jacentes à l’aide d’aphorismes, ou de petites phrases courtes, énigmatiques, que l’on se répétait en disant « Vous connaissez la dernière de Tristan ? » ; mais bien souvent il se contentait de hausser les épaules, de sourire et de tendre sa pipe à opium, et surtout, de commencer à jouer. Il composait ce qu’il composait. Les intellectuels pouvaient toujours s’amuser à discourir sur le sens de sa musique. C’est ce qu’ils faisaient, d’ailleurs, parfois jusque tard dans la nuit. Tahar Labid était intarissable sur ce sujet, et ensuite il disait à Tristan, avec une pointe d’agressivité : C’est exact, n’est-ce pas, Tristan Ahura ? Puis il continuait sans même attendre de réponse, comme si Tristan était un savant idiot, risible, incapable d’expliquer pourquoi il avait choisi telle note plutôt que telle autre ; comme si vraiment il ne savait pas ce que sa musique voulait dire. Mais Tristan se contentait de sourire à Tahar, aussi énigmatique qu’un sphinx sous sa moustache, aussi détendu que s’il avait été allongé sur son divan à contempler de l’autre côté de la vitre les pavés humides et noirs. Parfois, il jetait à Tahar un regard amusé.
— Pourquoi ne me réponds-tu jamais ? s’exclama un jour Tahar.
Tristan pinça les lèvres et lui siffla une réponse.
— Oh, allez ! fit Tahar, rouge de colère. Parle, qu’enfin on voie que tu as quelque chose dans la tête !
Tristan se leva.
— Pas d’injure, je te prie ! Bien sûr que je n’ai aucune idée en tête, pour qui me prends-tu !
Alors Budur alla s’asseoir à côté de lui. Quand il l’invita, d’un geste du menton et en pinçant les lèvres, à le rejoindre dans l’une des arrière-salles du café où se réunissaient les fumeurs d’opium, elle accepta. Elle avait déjà pris la décision, bien avant cela, d’accepter si jamais l’opportunité lui en était offerte, afin de voir ce que cela faisait d’entendre la musique de Tristan sous influence ; afin de voir ce que cela faisait de se droguer, de se servir de la musique comme d’un rituel lui permettant de dépasser sa peur de la fumée, peur sans nul doute importée de Turi.
La pièce était petite et sombre. Un houka plus gros qu’un narguilé était posé sur une table basse, au milieu des coussins. Tristan coupa un morceau d’un pain d’opium, le mit dans le bol et l’alluma avec un petit briquet en argent, tandis que l’un des occupants de la salle se mettait à inhaler. On fit alors circuler l’unique tuyau de pipe entre les fumeurs, qui aspirèrent la fumée à tour de rôle, et se mirent aussitôt à tousser. Le morceau noir dans le bol bouillonnait comme du goudron en se consumant, dégageant une épaisse fumée blanche, dont l’odeur rappelait celle du sucre. De peur de tousser, Budur décida de n’en prendre qu’un tout petit peu, mais quand on lui passa la pipe, elle eut beau inhaler le plus doucement possible, la première bouffée la fit tousser comme une perdue. Comment cette chose qui était si peu entrée en elle pouvait-elle à ce point l’affecter ? Cela semblait impossible.
L’effet gagna bientôt en intensité. Elle sentit ses veines gonfler sous sa peau. Le sang la remplissait comme un ballon. Il aurait jailli hors d’elle si sa peau, maintenant brûlante, palpitant au rythme de son pouls et du monde, ne l’en avait empêché. Tout semblait bondir et danser en écho aux battements de son cœur. Les murs devinrent flous, se mirent à puiser. De nouvelles couleurs apparaissaient à chaque battement de cœur. La surface des choses fluctuait, ondulant au gré de tensions diverses. En fait, tout semblait être, comme le disait tante Idelba, un agrégat d’énergies. Budur se leva avec les autres, et alla, en faisant bien attention à ne pas se casser la gueule, jusqu’à la salle de concert sise dans l’ancien palais.
C’était une salle immense, toute en longueur, assez semblable à un paquet de cartes placé sur la tranche. Les musiciens entrèrent et s’assirent. Leurs instruments ressemblaient à des armes extraterrestres. Sous la conduite de Tristan, qui dirigeait de la main et du regard, ils commencèrent à jouer. Les chœurs adoptaient le style des anciens pythagoriciens, pur, presque suave, une voix solitaire continuant à chanter au moment du déchant. Tristan avec son oud, et les autres joueurs d’instruments à cordes, des plus graves aux plus aigus, firent entendre leurs accents, doucement d’abord, puis de plus en plus fort, brisant les harmonies les plus simples, créant un monde nouveau, une Asie de sons, faisant éclore une « réalité » tellement plus complexe et sombre qu’après une longue et rude bataille l’ancien plain-chant de l’Ouest rendait grâce. Budur comprit alors que Tristan chantait l’histoire de la Franji. C’était la narration, en musique, du passé de l’endroit où ils vivaient, eux, les occupants tardifs de ces lieux. Franjs, Francs, Celtes, et ainsi de suite, en remontant jusqu’aux ténèbres éternelles… Chaque peuple faisait son temps. Ce n’était pas un concert olfactif, et pourtant des bâtons d’encens brûlaient devant les musiciens, dont la musique, en s’épanouissant, semblait tisser ensemble les épaisses fumées aux odeurs de santal et de jasmin, qui se répandaient dans la salle de concert. Lorsqu’elles parvinrent à Budur, elles se mirent à chanter en elle, jouant un rondeau complexe calqué sur son pouls et sur la musique elle-même. D’ailleurs, la mélodie tout entière était clairement un autre langage du corps, et Budur se rendit compte qu’elle en saisissait chacune des subtilités au moment où elle était énoncée, alors qu’elle ne pourrait jamais le parler, ni s’en souvenir.
C’était un langage assez proche de celui du sexe – comme elle le découvrit plus tard cette même nuit, quand elle alla chez Tristan et, de là, dans son lit. Il habitait un appartement miteux de l’autre côté du fleuve, dans les quartiers sud du port. C’était une sorte de mansarde froide et humide, un vrai cliché d’artiste. Apparemment, le ménage n’avait pas été fait depuis que sa femme était morte, peu après la fin de la guerre – dans un accident d’usine, avait cru comprendre Budur d’après ce que disaient les autres, une conjonction de malchance et de machine défectueuse. Mais il y avait un lit et des draps propres, ce qui mit la puce à l’oreille de Budur. Enfin, il y avait si longtemps qu’elle montrait à Tristan qu’il l’intéressait… Il ne s’agissait peut-être, après tout, que d’une marque de courtoisie, ou d’amour-propre, d’un genre assez touchant. C’était un amant de rêve, et il joua de son corps comme d’un oud, la caressant doucement, langoureusement, attisant sa passion, y ajoutant une dimension de lutte et de résistance qui décuplait son excitation. L’expérience la hanta par la suite, comme si l’amour avait enfoncé ses crocs en elle. Cela n’avait rien à voir avec la rude animalité de Kirana, et Budur se demanda ce que Tristan attendait d’elle, de leur relation. Elle comprit également, dès leur première nuit, qu’elle ne l’apprendrait pas de lui ; il était aussi peu loquace avec elle qu’avec Tahar. Elle devrait se contenter, pour apprendre à le connaître, de ce quelle arriverait à déduire de sa musique, de son visage, de ses expressions. Qui se trouvaient d’ailleurs parfaitement révélatrices, annonciatrices de ses changements d’humeur, ainsi que (peut-être) de son caractère ; qu’elle appréciait. C’est ainsi que pendant un certain temps elle rentra souvent avec lui, s’arrangeant pour les préservatifs avec la clinique de la zawiyya, passant ses soirées dans les cafés et saisissant au vol les opportunités qui se présentaient.
Au bout d’un certain temps, elle commença à trouver lassant de tenter de parler avec un homme qui ne savait que chanter – autant essayer de vivre avec un oiseau. Cela lui rappelait douloureusement cette distance qu’il y avait entre son père et elle, et le mutisme qui accompagnait ses tentatives d’exploration de son passé, tout aussi peu bavard. Et alors que la situation en ville allait en s’aggravant, et que chaque semaine qui passait voyait un nouveau zéro s’ajouter à la valeur faciale des billets de banque, il devint presque impossible de réunir les grands ensembles requis par les compositions de Tristan. Quand le panchayat qui s’occupait du vieux palais refusait de leur prêter une salle, ou quand les musiciens étaient retenus par leur vrai travail, à l’école, au port, ou dans les boutiques – où ils vendaient des chapeaux et des imperméables –, Tristan se contentait de jouer de son oud, ou de jouer avec ses stylos, couchant des mélodies sur le papier. Il utilisait pour cela la notation indienne, qu’on disait plus vieille encore que le sanskrit, même si Tristan avoua un jour à Budur l’avoir oubliée pendant la guerre, et avoir été obligé d’inventer un nouveau système, dont il se servait à présent et qu’il avait appris à ses musiciens. Elle trouva que ses mélodies étaient plus tristes, telles les plaintes d’un cœur lourd, pleurant ce qui avait disparu pendant la guerre, ce qu’on avait perdu ensuite, ce qu’on perdait encore, au moment même où Tristan jouait. Budur, qui comprenait tout cela, continua de venir voir Tristan de temps à autre, ne quittant pas des yeux les mouvements de ses lèvres sous sa moustache, pour savoir ce qui l’amusait quand elle ou les autres parlaient, observant le bout jaune de ses doigts pendant qu’ils faisaient fleurir sur les cordes de son oud de nouvelles mélodies, ou semaient sur le papier une longue plainte d’encre dont les notes étaient autant de larmes. Un jour, elle entendit une chanteuse dont elle se dit qu’elle devrait lui plaire, et l’emmena l’écouter. Il s’avéra qu’elle lui plut. Sur le chemin du retour, il ne cessa de chantonner, jetant à travers les vitres du tram des regards qui se perdaient dans les rues noires, où les gens se hâtaient de lampadaire en lampadaire, courant sur le vif-argent des pavés luisants de pluie, courbés sous leur parapluie ou leur poncho.
— C’est comme dans la forêt, dit Tristan (et les pointes de sa moustache se relevèrent). Là-haut, dans tes montagnes, tu sais ? On voit des endroits où les avalanches ont couché tous les arbres sur leur passage, et puis, à la fonte des neiges, les arbres ne peuvent plus se redresser. Ils restent couchés, comme s’ils craignaient encore la furie des éléments.
Il fit un geste en direction de la foule qui attendait à l’arrêt du tram, et ajouta :
— Maintenant, nous sommes comme ces arbres…
18
Les jours et les semaines suivants, Budur continua de lire avec avidité, à la zawiyya, à l’Institut, dans les parcs, au bout de la jetée et à l’hôpital des soldats aveugles. Entre-temps, ils avaient vu arriver, avec les immigrés du Moyen-Occident, de nouveaux billets de dix quintillions de piastres, alors qu’ils utilisaient déjà des billets de dix milliards de drachmes. Récemment, un homme avait bourré sa maison de billets du sol au plafond, et avait échangé le tout contre un cochon. À la zawiyya, il devenait de plus en plus difficile de préparer des repas suffisamment conséquents pour les nourrir toutes. Elles faisaient pousser des légumes sur le toit, maudissant les nuages, et vivaient du lait de leurs chèvres, des œufs de leurs poules, de pots de concombres au vinaigre, de potirons accommodés à toutes les sauces, de soupes de pommes de terre, si allongées d’eau qu’elles étaient encore plus liquides que du lait.
Un jour, Idelba surprit les trois espionnes en train de fouiller la petite étagère au-dessus de son lit, et les fit expulser de la maison comme de vulgaires voleuses. Elle avait appelé la police, sans mentionner qu’il s’agissait d’espionnes, ce qui lui aurait valu d’être confrontée à la difficulté d’expliquer ce qui aurait bien pu mériter d’être volé chez elle, en dehors de ses idées.
— Elles vont avoir des problèmes, fit remarquer Budur quand les trois filles furent parties. Même si leurs employeurs les font sortir de prison.
— Oui, convint Idelba. J’ai failli les laisser là, comme tu as pu le constater. Mais à partir du moment où elles se sont fait pincer, nous devions faire comme si nous ne savions pas qui elles étaient. La vérité, c’est que nous ne pouvions plus nous permettre de les nourrir. Autant les laisser retourner auprès de ceux qui les ont envoyées. Enfin, si elles ont de la chance…
Une ombre passa sur son visage. Elle n’avait pas envie d’y penser – de penser à ce à quoi elle les avait peut-être condamnées. C’était leur problème. Elle s’était endurcie durant les deux années qui avaient suivi son arrivée à Nsara avec Budur. En tout cas, c’était l’avis de Budur.
— Il ne s’agit pas que de mon travail, lui expliqua Idelba en voyant la tête qu’elle faisait. Le problème est toujours d’actualité. Non, il s’agit plutôt des problèmes que nous avons maintenant. Les choses en resteront peut-être là si nous mourons toutes de faim avant. La guerre s’est mal terminée, voilà tout. Je veux dire, pas seulement pour nous, les vaincus, mais pour tout le monde. L’équilibre est tellement précaire que tout pourrait s’effondrer. C’est pourquoi nous devrions nous serrer les coudes. Et si certains ne jouent pas le jeu, alors je ne sais pas ce qui…
Un soir, au café, Budur demanda à Tristan :
— Après tout le temps que tu as passé à étudier la musique des Francs, t’est-il déjà arrivé de te demander comment ils pouvaient bien être ?
— Oui, bien sûr, répondit-il, ravi qu’on lui pose la question. Tout le temps. Je pense qu’ils étaient exactement comme nous. Ils passaient leur temps à se battre. Ils avaient des monastères, des madrasas, et des machines actionnées par l’eau. Ils avaient de petits navires, mais qui pouvaient faire voile contre le vent. Ils auraient pu être les premiers à dominer les mers.
— Alors ça, ça m’étonnerait ! dit Tahar. Comparés aux navires chinois, leurs bateaux n’étaient pas plus gros que des boutres. Allons, Tristan, tu le sais bien.
Tristan haussa les épaules.
— Ils avaient dix ou quinze langues différentes, et trente ou quarante principautés, n’est-ce pas ? demanda Naser. Ils étaient trop divisés pour conquérir qui que ce soit.
— Ils se sont battus tous ensemble pour prendre Jérusalem, remarqua Tristan. Leurs guerres entre eux avaient fait d’eux de redoutables guerriers. Ils croyaient qu’ils étaient le peuple élu de Dieu.
— Les primitifs le croient souvent.
— En effet, répondit Tristan avec un sourire.
Il se pencha de côté pour regarder, par la vitre, la mosquée, non loin de leur café.
— Comme je vous le disais, reprit-il, ils étaient exactement comme nous. S’ils n’avaient pas disparu, il y aurait plus de gens comme nous.
— Personne n’est comme nous, dit Naser tristement. Je pense que les Francs étaient un peuple très différent.
Tristan haussa de nouveau les épaules.
— Tu aurais beau dire, ça ne changerait rien. Tu pourrais dire qu’ils auraient fini en esclavage, comme les Africains, ou qu’ils nous auraient réduits en esclavage, ou apporté un âge d’or, ou que leurs guerres auraient été pires que la Longue Guerre…
Les autres hochaient la tête en l’entendant énumérer toutes ces possibilités.
— Cela ne changera absolument rien. Nous ne le saurons jamais, alors, tu peux raconter ce que tu veux… Ce sont nos djinns.
— Je trouve étrange cette façon que l’on a de les regarder de haut, dit Kirana. Tout ça parce qu’ils sont morts. À un niveau inconscient, on a l’impression que c’est de leur faute. À cause d’une faiblesse physique, d’un travers moral, ou d’une mauvaise habitude…
— Leur orgueil était un affront pour Dieu.
— Ils étaient pâles parce qu’ils étaient faibles, ou inversement. Muzaffar l’a expliqué : plus noire la peau, plus forts les gens. Les plus noirs des Africains sont les plus forts de tous, les plus pâles des habitants de la Horde d’Or sont les plus faibles. Il a fait des tests. Sa conclusion était que les Francs étaient génétiquement inaptes à la survie. Les perdants du jeu de l’évolution, de la sélection du plus fort.
Kirana secoua la tête.
— C’est probablement dû à une mutation de la peste, tellement puissante qu’elle a tué tous ceux qui l’ont contractée avant de s’éteindre d’elle-même. Cela aurait pu arriver à n’importe qui. Aux Chinois, ou à nous.
— Il y a autour de la Méditerranée une sorte d’anémie générale qui aurait pu les rendre plus sensibles à ce genre de…
— Non. Cela aurait pu nous arriver.
— Cela n’aurait pas été forcément plus mal, dit Tristan. Ils croyaient en un Dieu de pardon, leur Christ n’était qu’amour et pardon.
— C’est difficile à croire, à en juger par ce qu’ils ont fait en Syrie.
— Ou en al-Andalus…
— Mais c’était là, en eux, prêt à éclore. Alors que pour nous, ce qui est latent, c’est le jihad.
— Tu disais qu’ils étaient comme nous…
Tristan sourit sous sa moustache.
— Peut-être. La carte a bien des blancs, il y a des ruines sous nos pieds, et le miroir est vide. Et les nuages du ciel ressemblent à des tigres.
— Tout cela est tellement vain, lança Kirana. Et si cela s’était passé autrement, ou si ce n’était pas arrivé, et si la Horde d’Or avait enfoncé le corridor de Gansu dès le début de la Longue Guerre, et si les Japonais avaient attaqué la Chine juste après avoir repris le Japon, et si les Ming avaient gardé la Flotte des trésors, et si nous avions découvert et conquis le Yingzhou, et si Alexandre le Grand n’était pas mort si jeune, et si, et si… Les choses auraient été tellement différentes, et pourtant, tout cela reste vain. Et ces historiens, qui parlent de se servir de l’histoire parallèle pour étayer leurs théories, sont tellement ridicules. Parce que personne ne sait pourquoi les choses arrivent, vous comprenez ? Tout peut découler de tout. Même l’histoire, la vraie, ne nous apprend rien. Parce que nous ne savons pas si l’histoire est sensible au point que, faute d’un clou, une civilisation se serait effondrée, ou si, au contraire, nos actes les plus lourds de signification ne sont pas que des pétales dans un raz-de-marée, ou les deux à la fois, ou si la vérité n’est pas quelque part entre les deux. Nous ne savons pas, c’est tout ce que l’on peut dire. Et les « et si » ne nous aideront pas à y voir plus clair.
— Pourquoi les gens les apprécient-ils autant ?
Kirana haussa les épaules et s’alluma une cigarette.
— Parce qu’ils aiment les histoires.
Et en effet, ils se mirent tous à s’en raconter, en dépit du fait que Kirana les trouvait inutiles. Les gens adoraient contempler ce-qui-aurait-pu-arriver : et si la flotte perdue du Maroc, en 924, avait été poussée par les vents jusqu’aux îles du Sucre et en était revenue ? Et si le Kerala de Travancore n’avait pas conquis de si grands territoires en Asie, s’il n’avait pas construit son vaste réseau de chemins de fer, ni créé son système de lois ? Et s’il n’y avait jamais eu d’îles du Nouveau Monde ? Et si la Birmanie avait perdu sa guerre contre le Siam ? Et ainsi de suite…
Kirana se contentait de secouer la tête.
— Peut-être vaudrait-il mieux se concentrer sur le futur.
— Toi ? Une historienne, dire une chose pareille ? Mais on ne peut pas connaître le futur !
— Certes, et pourtant, il existe : dès à présent, pour nous, en tant que projet à mettre en œuvre. Depuis le siècle des lumières à Travancore, on sent bien que le futur est ce que l’on en fait. Ce nouveau rapport au temps à venir est quelque chose de très important. Cela fait de nous les fils d’une tapisserie qui a commencé d’être tissée des siècles avant nous, et continuera de l’être plusieurs siècles après. Nous nous situons à mi-chemin du tissage, c’est le présent, et ce que nous faisons envoie la navette dans telle ou telle direction, changeant le motif par la même occasion. Quand nous commencerons à essayer de tisser un motif susceptible de nous plaire, à nous et aux générations futures, alors, nous pourrons peut-être dire que nous avons une prise sur l’histoire.
19
En attendant, on pouvait s’asseoir auprès de personnes de ce genre, avoir des conversations de ce genre, et continuer à marcher dehors, sous la lumière humide, sans rien avoir à manger ni un sou valide. Budur faisait de son mieux à la zawiyya. Elle avait organisé des cours de persan et de franjic pour les pauvres filles affamées, ces nouvelles arrivantes qui ne parlaient que le berbère, l’arabe, l’andalou, le skandistanais, ou le turc. La nuit, elle continuait de hanter les cafés de toutes sortes, dont elle était devenue un pilier, et parfois les fumeries d’opium. Elle trouva un travail, dans l’une des agences gouvernementales, comme traductrice, tout en poursuivant ses études d’archéologie. Elle s’inquiéta pour Idelba quand celle-ci tomba de nouveau malade, et passa beaucoup de temps à s’occuper d’elle. Le médecin disait qu’Idelba souffrait de « fatigue nerveuse » – une fatigue qui ressemblait à celle qu’éprouvaient les soldats à la fin de la guerre. Mais pour Budur il était évident qu’elle était physiquement affaiblie, souffrant d’un mal que les médecins n’arrivaient pas à identifier. Une maladie sans cause ; Budur trouvait l’idée trop effrayante pour s’y arrêter. Le mal avait probablement une cause, mais elle se tenait cachée. Et cela aussi était effrayant.
Elle s’investit de plus en plus dans les affaires courantes de la zawiyya, remplaçant Idelba partout où celle-ci s’était impliquée. Elle avait moins de temps pour lire. D’ailleurs, lire ne lui suffisait plus, ni même écrire des comptes rendus : elle se sentait trop nerveuse pour lire, et puis, passer son temps à lire toutes sortes de textes, en extraire la substantifique moelle et en faire la synthèse lui sembla tout à coup être une activité des plus étranges ; elle avait l’impression d’être un alambic. Que l’histoire était une sorte de cognac. Elle avait envie de quelque chose de plus substantiel.
Pendant cette période, elle ne cessa jamais de sortir. Elle aimait tout particulièrement se rendre, peu après minuit, dans les cafés ou les fumeries d’opium. Là, elle écoutait Tristan jouer de l’oud (ils n’étaient plus que de simples amis, à présent), souvent dans une sorte de rêve opiacé, au cours duquel elle arpentait les longs couloirs brumeux de ses pensées sans pousser aucune porte en particulier. Elle était perdue quelque part au fond d’une rêverie tournant autour de la théorie du docteur Ibrahim sur la façon dont les civilisations, et l’histoire, progressaient en s’entrechoquant – un peu comme la tectonique des plaques, si les géologues avaient raison. Leur fusion faisait apparaître de nouvelles choses, comme à Samarkand, ou dans l’Inde des Moghols, ou chez les Hodenosaunees dans leurs rapports avec les Chinois, à l’ouest, et l’islam, à l’est, ou en Birmanie, oui – tout cela était clair à présent, un peu comme ces cailloux colorés éparpillés sur le sol qui s’assemblaient pour former l’une des mosaïques aux motifs élaborés de Sainte-Sophie. C’était sûrement un effet de l’opium, mais c’était aussi ça, l’histoire : une combinaison d’événements dus au hasard s’assemblant pour former un schéma halluciné, et il n’y avait après tout aucune raison de remettre en question la façon dont l’histoire apparaissait, même si c’était sous la forme d’une illumination. L’histoire en guise d’opium, un rêve d’opiomane…
Halali, une fille de la zawiyya, surgit dans l’arrière-salle du café, regardant autour d’elle ; en la voyant, Budur comprit tout de suite qu’il était arrivé quelque chose à Idelba, quelque chose de grave. Halali s’approcha, l’air préoccupée.
— Son état s’est mis à empirer.
Budur la suivit dehors, en titubant sous les effets de l’opium, pensant que sa panique les balaierait en un rien de temps, alors qu’en fait elle fut plongée plus loin encore, dans un délire visuel plus profond. Jamais Nsara ne lui avait paru aussi laide que cette nuit-là, avec ses trottoirs battus par la pluie, ses arabesques de lumière sur les pavés, et ces ombres… Elles avaient la forme de rats humains, nageant pour échapper à la noyade.
Idelba n’était plus à la zawiyya, on l’avait emmenée à l’hôpital le plus proche, une grande construction biscornue datant de la guerre, sur une hauteur juste au nord du port. Budur s’y traîna à grand-peine. L’endroit semblait perdu dans le nuage de pluie lui-même, et le bruit de l’eau tambourinant contre le maigre toit d’aluminium emplissait tout le bâtiment. La lumière, une sorte de blanc-jaune, intense et lancinant, donnait à tous un faciès de tête de mort. Sous un tel éclairage, les gens ressemblaient à ces tas de viande ambulants, comme on appelait, pendant la guerre, les hommes partis au front.
Idelba n’offrait pas un aspect pire que les autres. Budur se précipita à son chevet.
— Elle a du mal à respirer, dit en levant les yeux une infirmière assise sur une chaise.
Budur songea : Ces gens travaillent en enfer. Elle était très effrayée.
— Écoute…, commença calmement Idelba. (Elle se tourna vers l’infirmière :) S’il vous plaît, vous pourriez nous laisser dix minutes ?
Puis, quand l’infirmière fut partie, elle poursuivit à voix basse :
— Écoute, si je meurs, ce sera à toi d’aider Piali…
— Voyons, tante Idelba, tu ne vas pas mourir !
— Chut ! Je ne peux pas courir le risque de l’écrire, de même que je ne puis courir le risque de ne le dire qu’à une seule personne, au cas où il lui arriverait quelque chose. Tu diras à Piali d’aller à Ispahan, afin de rapporter nos résultats à Abdol Zoroush. Ensuite, qu’il aille voir Ananda, à Travancore, et Chen, en Chine. Ils ont tous beaucoup d’influence dans leurs gouvernements respectifs. Hanea saura ce qu’elle a à faire. Rappelle bien à Piali ce que nous avions décidé. Bientôt, vois-tu, les physiciens atomistes comprendront les conséquences théoriques de la fission de l’alactin. Et ses applications possibles. Si tous connaissent ses possibilités, alors ils sauront qu’ils doivent essayer d’imposer la paix éternelle. Les scientifiques pourront faire pression sur leur gouvernement, en leur expliquant la situation, et en prenant la direction des domaines scientifiques concernés. Soit ils arrivent à faire régner la paix, soit ce sera la course au désastre, total et immédiat. Placés devant ce choix, ils n’auront d’autre ressource que de faire la paix.
— Oui, dit Budur tout en se demandant si cela suffirait à les motiver.
Son esprit se cabrait à l’idée d’avoir à se charger d’un tel fardeau. En outre, elle n’aimait pas beaucoup Piali.
— Par pitié, tante Idelba, par pitié… Ne te fais pas de soucis… Tout ira bien.
— Je n’en doute pas, dit Idelba en hochant la tête.
Son état s’améliora tard dans la nuit, peu avant l’aube. Le délire opiacé de Budur commençait juste à se dissiper. Elle avait passé une longue, longue nuit, et ne se rappelait plus rien. Mais elle n’avait pas oublié ce qu’Idelba voulait qu’elle essaie de faire. L’aube arriva, aussi noire que si le jour avait été masqué par une éclipse bien décidée à s’installer.
Idelba mourut l’année d’après.
Il y eut beaucoup de monde à ses funérailles. Peut-être des centaines de personnes. La plupart venaient de la zawiyya, de la madrasa et de l’Institut, mais aussi du monastère bouddhique, de l’ambassade hodenosaunee, du panchayat, du conseil d’État, et de bien d’autres endroits de Nsara. Mais personne ne vint de Turi. Budur se tint, à demi comateuse, dans une longue file de femmes de la zawiyya, et serra des mains, une interminable suite de mains. Puis, lors de la triste veillée, Hanea vint à nouveau la trouver.
— Nous aussi nous l’aimions, dit-elle avec un sourire âpre. Nous ferons tout pour tenir les promesses que nous lui avons faites.
Quelques jours plus tard, Budur se rendit, comme d’habitude, auprès de ses soldats aveugles pour leur faire la lecture. Elle alla dans leur quartier, et se tint face à eux, les regardant, dans leur lit ou dans leur fauteuil. Elle se dit : Ce doit être une erreur. Je me sens vide, mais je dois me tromper…
Elle leur dit que sa tante était morte. Ensuite elle essaya de leur lire quelques passages des travaux d’Idelba ; mais ça n’avait rien à voir avec les écrits de Kirana. Même les résumés étaient incompréhensibles. Quant aux textes proprement dits, des articles scientifiques portant sur le comportement des choses invisibles, ils étaient pour l’essentiel composés de tableaux de chiffres. Elle renonça à les leur lire et prit un autre livre.
— C’était l’un des livres préférés de ma tante : une anthologie des écrits autobiographiques trouvés dans les travaux d’Abu Ali ibn Sina, l’un des tout premiers scientifiques et philosophes – et l’un de ses héros. D’après ce que j’ai pu lire, ibn Sina et ma tante se ressemblaient par bien des aspects. Ils étaient l’un comme l’autre très curieux, cherchant à tout savoir du monde. Ibn Sina commença par se familiariser avec la géométrie euclidienne, puis s’efforça ensuite de comprendre tout le reste. Idelba a fait exactement pareil. Quand ibn Sina était encore jeune, il se lança dans une sorte de longue quête fébrile, qui l’occupa pendant près de deux ans. Maintenant, je vais vous lire ce qu’il a lui-même écrit au sujet de cette période :
À cette époque, je n’eus pour ainsi dire pas une nuit de sommeil complète, et le jour, je ne faisais pratiquement rien d’autre que d’étudier. J’avais mis au point, à mon seul usage, un système de fiches, et pour chaque preuve que j’examinais, j’ouvrais un dossier où je notais ses principes syllogistiques, leur classification, et ce qu’on pouvait en déduire. Je réfléchissais longuement à ce qui avait pu conditionner ces principes, jusqu’à ce que j’aie vérifié, par moi-même, chacun des cas. Quand l’envie de dormir était trop forte, ou quand je sentais que mes forces m’abandonnaient, j’allais me servir une coupe de vin pour reprendre des forces. Et quand le sommeil finissait par m’emporter, je continuais à voir ces problèmes en rêve. C’est ainsi que bien des questions trouvèrent une réponse. Je travaillai de la sorte, jusqu’à ce que toutes les disciplines scientifiques fussent profondément ancrées en moi, jusqu’à ce que je les comprenne aussi bien qu’il était humainement possible de les comprendre. Tout ce que je savais alors est tout ce que je sais aujourd’hui. Car je n’ai pas trouvé grand-chose de nouveau depuis.
— Voilà le genre de personne qu’était ma tante, dit Budur.
Elle posa le livre et en prit un autre, se disant qu’il valait peut-être mieux arrêter là toute lecture inspirée des travaux d’Idelba. Cela ne l’aidait pas à se sentir mieux. Elle tira de son sac un livre intitulé Histoires de marins de Nsara. C’était un recueil d’histoires vraies arrivées à des marins ou à des pêcheurs locaux, de formidables aventures, pleines de poissons, de dangers et de mort, d’air marin, de vagues et de vent. Les soldats avaient beaucoup apprécié les premiers chapitres qu’elle leur avait lus auparavant.
Elle leur lut cette fois-ci un récit intitulé Le Vent du ramadan. Il se déroulait il y a fort longtemps, à l’époque de la marine à voile. Des vents contraires avaient empêché des navires chargés de blé de regagner le port, les obligeant à jeter l’ancre loin des côtes et des routes maritimes, dans le noir complet. Là, au beau milieu de la nuit, alors que les vents s’étaient mis à tourner, une formidable tempête, venue de l’Atlantique, s’était levée. Les navires ne pouvaient pas regagner la côte, et les gens à terre ne pouvaient rien faire d’autre que d’attendre la fin de la nuit en arpentant le rivage. La femme de l’auteur du récit s’occupait alors de trois petits enfants dont la mère était morte, et dont le père commandait l’un des bateaux bloqués en haute mer. Incapable de regarder plus longtemps les enfants jouer pour tenter de tromper leur inquiétude, l’auteur était sorti se promener sur la grève avec les autres, bravant les vents hurlants. À l’aube, ils avaient vu que le sable découvert par la marée basse était jonché de milliers de petits grains de blés. Ils surent alors que le pire était arrivé. « Pas un navire n’avait échappé à la tempête, et les vagues jouaient avec les corps des marins en les faisant rouler sur la plage. Et comme l’aube de ce matin-là était aussi celle d’un vendredi, à l’heure où le muezzin s’apprêtait à monter au sommet du minaret pour appeler à la prière, l’idiot du village, devenu fou furieux, l’avait retenu en criant : Qui pourrait louer le Seigneur en un moment pareil ? »
Budur cessa de lire. Un profond silence s’était abattu sur la pièce. Quelques hommes hochaient sombrement la tête, comme pour dire : Oui, c’est bien ce qui s’est passé ; il y a des années que je pense à tout ça. Pourtant, quelques autres firent mine de vouloir quitter leur fauteuil ou leur lit, comme pour lui prendre le livre des mains, et l’inviter, d’un geste, à quitter la pièce. Va-t’en. S’ils n’avaient pas été aveugles, ils l’auraient reconduite eux-mêmes à la porte, ou ils lui auraient fait quelque chose. Mais, étant donné la situation, nul ne savait quoi faire.
Elle bredouilla une parole, se leva et partit. Elle traversa la ville en longeant le fleuve, vers le port, puis jusqu’au bout de la jetée. La mer, d’un bleu superbe, venait se fracasser au pied des rochers, jetant dans l’air ses embruns, qui retombaient en bruine salée.
Budur s’assit sur le dernier rocher chauffé par le soleil, et regarda les nuages filer au-dessus de Nsara. Elle se sentait aussi pleine de colère que l’océan était plein d’eau, et pourtant, il y avait quelque chose dans les images et dans le brouhaha de la ville qui lui réchauffait le cœur. Elle se dit : Nsara, tu es maintenant ma seule famille. Maintenant, tu es ma tante Nsara.
20
À présent, elle devait faire plus ample connaissance avec Piali.
C’était un petit homme peu communicatif, introverti, à l’air toujours ailleurs, et apparemment assez imbu de lui-même. Budur s’était dit que son exceptionnel manque de charme devait être compensé par ses compétences en sciences physiques.
Mais elle fut très impressionnée par l’ampleur du chagrin que lui causait la mort d’Idelba. Budur s’était souvent dit qu’il la traitait comme un meuble un peu encombrant, une collaboratrice dont il avait besoin mais dont il se serait bien passé. Maintenant qu’elle était partie, il retournait souvent sur le banc au bout de la jetée, où ils allaient parfois s’asseoir, Idelba et lui, quand il faisait beau, et il soupirait, disant :
— C’était un tel bonheur de parler avec elle… Idelba était l’une de nos plus brillantes physiciennes, tu sais. Si elle avait été un homme, rien n’aurait pu l’arrêter – elle aurait changé le monde. Bien sûr, elle avait quelques petites lacunes, mais elle avait une excellente intuition de la façon dont les choses devaient marcher. Quand nous étions coincés, elle tournait et retournait le problème, obstinément, tu vois ce que je veux dire… Moi, j’aurais laissé tomber, mais elle, elle ne s’avouait jamais vaincue. Elle était particulièrement douée pour trouver de nouveaux angles d’approche, et prendre les problèmes par le flanc quand ils semblaient insurmontables. Brillante. C’était vraiment une personne brillante.
Il paraissait affreusement sérieux à présent, insistant sur le terme « personne », plutôt que sur celui de « femme », comme si Idelba lui avait montré sur les femmes des choses qu’il n’avait pu s’empêcher de remarquer, n’étant pas assez stupide pour ne pas les voir. Il ne commettait pas non plus l’erreur de penser à elle comme à une exception – aucun physicien n’aurait commis ce genre de bévue : considérer les exceptions comme une catégorie valide. Désormais, il s’adressait à Budur sur le même ton qu’il prenait pour parler à Idelba, ou à ses collègues masculins. Mais il le faisait de manière un peu trop intentionnelle, s’efforçant de paraître le plus normal, et humain, possible, et – en fait – y arrivant. Presque. Car il gardait toujours cette allure un peu ahurie, assez peu gracieuse. Mais Budur commença à l’apprécier davantage.
Ce qui n’était pas plus mal, car Piali, lui aussi, se mit à s’intéresser à elle, et, les mois passant, il se mit même à lui faire la cour à sa façon, si particulière. Il vint à la zawiyya, fit la connaissance de toutes ses colocataires, et l’écouta lui parler de ses problèmes d’histoire, tout en lui racontant, parfois si longuement que c’en devenait insupportable, ses difficultés, dans ses recherches et à l’Institut. Il aimait, comme elle, aller dans les cafés, et ne parut pas faire cas de ses possibles incartades depuis qu’elle était arrivée à Nsara ; il n’en tint pas compte, et se concentra sur les choses de l’esprit, même quand il était dans un café en train de boire un cognac, ou de griffonner sur les nappes – ce qui était une de ses manies. Ils parlaient des heures durant de la nature de l’histoire, et ce fut sous l’influence de son profond scepticisme, ou matérialisme, qu’elle finit par franchir complètement le pas de l’histoire à l’archéologie, passant des textes aux objets – en partie convaincue par son argument que les textes n’étaient jamais que les impressions de personnes, tandis que les objets étaient dotés d’une réalité qui leur était propre, immuablement. Bien sûr, les objets menaient à d’autres impressions, auxquelles ils se fondaient, dans cette toile de preuves que tout étudiant du passé devait apporter pour étayer sa thèse ; mais Budur se sentait nettement plus à l’aise quand elle travaillait à partir des outils et des bâtiments plutôt que des mots du passé. Elle en avait marre de distiller du cognac. Et elle s’aperçut qu’elle considérait le monde d’un œil beaucoup plus critique, pareil à celui d’Idelba, ce qu’elle s’appliqua à faire comme une sorte d’hommage à la mémoire de sa tante. Idelba lui manquait tant qu’elle n’arrivait pas à se l’avouer franchement. Elle abordait le problème par ces sortes d’hommages, invoquant le souvenir d’Idelba au travers de ses habitudes, devenant ainsi une sorte de madame Sururi. Elle se fit même plusieurs fois la réflexion que, d’un certain point de vue, on connaissait mieux les morts que les vivants, parce que la vraie personne n’était plus là pour distraire notre attention lorsque nous pensions à elle.
Ce qui amena Budur à se poser un grand nombre de questions, qui reliaient son travail à ce qu’elle avait compris du travail d’Idelba, puisqu’elle devait étudier les changements physiques des matériaux utilisés dans le passé : des changements dans la chimie, la physique, le ki (ou les fuites de ki) dans les choses, qui pourraient servir à les dater, comme autant d’horloges enfouies dans la texture des matériaux étudiés. Elle en parla à Piali, et il lui répondit aussitôt qu’au fil du temps le nombre de particules du noyau et de l’enveloppe changeait, de telle sorte que, par exemple, l’anneau-de-vie quatorze d’un corps se transformerait lentement en anneau-de-vie douze, à peu près dans les cinquante années suivant la mort de l’organisme, et continuerait à se dégrader pendant environ cent mille ans, jusqu’à ce que tout l’anneau-de-vie de l’organisme soit retombé à douze – étape à laquelle l’horloge s’arrêterait.
Il y avait donc largement de quoi dater la plupart des activités humaines, se dit Budur. Elle commença à élaborer une méthode de travail avec Piali et les différents chercheurs de l’Institut. Puis l’idée fut reprise et améliorée par une équipe de scientifiques de Nsara, qui avait été mise sur pied ce mois-là, et bientôt les efforts de quelques-uns devinrent ceux de tous, comme cela arrive si souvent dans le domaine de la science. Budur n’avait jamais travaillé aussi dur.
C’est ainsi qu’au fil du temps elle finit par devenir archéologue, s’occupant entre autres de dater les choses, avec l’aide de Piali. En fait, pour Piali, elle avait remplacé Idelba, et il avait même, en conséquence, en partie changé de domaine d’activité pour s’adapter à ce sur quoi elle travaillait. Il ne se liait aux autres qu’en travaillant avec eux, et c’est pourquoi, même si elle était très jeune et travaillait dans une autre spécialité, il s’était adapté à elle, et avait ensuite fait comme avant. Il poursuivait également ses recherches en physique atomique, évidemment, travaillant avec de nombreux collègues au laboratoire de l’Institut, et quelques scientifiques de l’usine du sans-fil située dans la banlieue de la ville, et dont le laboratoire commençait à rivaliser avec ceux de la madrasa et de l’Institut dans le domaine de la recherche en physique théorique.
Les militaires de Nsara étaient également impliqués. Les recherches de Piali suivaient la voie ouverte par Idelba, et même s’il y avait longtemps déjà que rien de neuf n’avait été publié sur la possibilité de déclencher une réaction en chaîne à partir de la fission de l’alactin, de nombreux physiciens musulmans, au Skandistan, en Toscane et en Iran, en avaient souvent parlé entre eux ; et ils se doutaient que de pareilles conversations devaient avoir lieu dans les laboratoires de Chine, de Travancore ou du Nouveau Monde. À Nsara, on épluchait désormais les publications internationales portant sur cet aspect de la physique, afin de voir si rien ne leur avait échappé, s’il n’y avait pas de nouveau développement, ou si un soudain silence ne signifiait pas qu’un gouvernement avait décidé de classer le sujet secret défense. Jusqu’à présent, rien ne laissait croire qu’on avait censuré ou préféré étouffer quoi que ce fut, mais Piali semblait penser que ce n’était qu’une question de temps, et que cela devait déjà se produire dans d’autres pays, voire chez eux, sans qu’on en ait vraiment conscience, ou que ce fût seulement prévu. À la première crise de politique internationale, disait-il, avant que les hostilités ne soient déclarées, il ne faudrait pas s’étonner si ce pan de la recherche disparaissait bel et bien dans les laboratoires top secret des militaires, et, en même temps que lui, un nombre significatif des physiciens de leur génération, qui se verraient alors refuser tout contact avec leurs collègues du monde entier.
Et bien sûr, les problèmes pouvaient surgir à tout moment. La Chine, malgré sa victoire, s’était effondrée presque aussi complètement que la coalition défaite, et sombrait apparemment dans l’anarchie et dans la guerre civile. L’heure de la fin avait sonné pour les chefs de guerre chinois qui avaient remplacé la dynastie Qing.
— C’est bien, dit Piali à Budur. Il n’y a qu’une bureaucratie de militaires pour essayer de construire une bombe aussi dangereuse. Mais c’est mauvais, parce que les gouvernements militaires détestent s’en aller sans livrer une dernière bataille.
— Aucun gouvernement n’aime s’en aller, dit Budur. Rappelle-toi ce que disait Idelba. Le meilleur moyen d’empêcher un gouvernement de s’approprier ces idées, c’est de les répandre dans le monde entier, aussi vite que possible. Si tout le monde sait que chacun peut fabriquer une arme pareille, alors aucun n’essaiera de la faire.
— Peut-être pas au début, dit Piali, mais cela pourrait arriver, avec les années.
— Ce n’est pas une raison pour nous décourager, dit Budur.
Et elle continua de harceler Piali pour qu’il fasse enfin ce qu’Idelba avait suggéré. Il ne semblait pas y avoir renoncé, mais il ne faisait rien non plus qui allât dans ce sens. En tout cas, Budur devait bien admettre avec lui qu’il n’était pas facile de décider comment s’y prendre au juste. Ils étaient assis sur ce secret comme des pigeons sur un œuf de coucou.
Pendant ce temps, la situation à Nsara continuait de se dégrader. Un bon été avait succédé à plusieurs mauvais, permettant d’échapper à la pire des famines. Mais les journaux ne parlaient que d’émeutes de la faim, de grèves dans les usines du Rhin, de la Ruhr et du Rhône, et même d’une « révolte contre les réparations de guerre », dans les petites montagnes de l’Atlas, révolte qu’on eut du mal à contenir. En fait, l’armée avait en son sein des éléments plutôt disposés à encourager qu’à réfréner ce type de mouvement, peut-être parce qu’ils les approuvaient. À moins que ce ne fut pour que les choses empirent au point qu’un coup d’État militaire aurait paru parfaitement justifié. D’ailleurs, on entendait bien des rumeurs allant dans ce sens.
Tout cela ressemblait de façon désespérante aux derniers jours de la Longue Guerre, et les gens se mirent à stocker de plus belle. Budur avait du mal à se concentrer sur ses lectures, et était souvent submergée par le chagrin de la mort d’Idelba. C’est pourquoi elle fut d’abord surprise, puis ravie, quand Piali lui annonça la tenue d’un colloque à Ispahan, une rencontre internationale de physiciens atomistes, qui devaient faire le point sur les derniers résultats de leurs travaux, « y compris le problème de l’alactin ». De plus, le colloque se tiendrait en même temps que la quatrième édition d’une grande réunion de scientifiques, dont la première avait eu lieu à Ganono, la grande cité portuaire des Hodenosaunees – d’où son nom, désormais, de Conférence de l’Ile-Longue. La deuxième avait eu lieu à Pyinkayaing, et la troisième à Beijing. Le colloque d’Ispahan était par conséquent le premier à se dérouler dans le Dar, et il était prévu qu’aurait lieu également toute une série de rencontres sur le thème de l’archéologie. Piali s’était déjà arrangé pour faire financer par l’Institut le fait que Budur y assiste avec lui, en tant que coauteur des articles qu’ils avaient écrits avec Idelba sur la méthode de datation à l’anneau-de-vie quatorze.
— Cela me semble l’endroit idéal où parler en privé des idées de ta tante. Une séance de travail sera même consacrée à ses recherches. Elle sera organisée par Zoroush. Chen y sera aussi, ainsi qu’un certain nombre de ses correspondants. Tu viendras ?
— Bien sûr.
21
Les trains pour l’Iran passaient tous par Turi, la ville natale de Budur. Alors, peut-être à cause de cela, Piali s’arrangea pour leur trouver deux places à bord du dirigeable qui allait de Nsara à Ispahan. C’était un appareil du même modèle que celui que Budur avait pris avec Idelba pour aller aux Orcades. Elle s’assit à côté de la vitre de la nacelle pour regarder la Franji : les Alpes, Rome, la Grèce et les îles brunes de la mer Égée ; puis l’Anatolie et les États du Moyen-Occident. Dieu que le monde est grand ! se dit Budur après plusieurs heures de vol.
Puis ils survolèrent les cimes enneigés des Zagros, jusqu’à Ispahan, située dans une haute vallée traversée par un fleuve tumultueux, le Zayandeh Rud, vallée qui dominait des plaines salines à l’est. Alors qu’ils approchaient de l’aérodrome, ils virent un immense cercle de ruines autour de la nouvelle ville. Ispahan s’était trouvée sur la route de la Soie, et plusieurs villes avaient été détruites, tour à tour par Gengis Khan, Tamerlan, les Afghans au onzième siècle, et finalement le Travancore, au cours de la Longue Guerre.
La dernière incarnation de la ville n’en était pas moins florissante. De nouveaux bâtiments s’élevaient un peu partout, si bien que lorsqu’ils traversèrent la ville en tramway ils eurent l’impression de s’aventurer dans une forêt de grues poussant dans tous les sens sur une ruche de métal et de béton. Abdol Zoroush et les autres scientifiques iraniens accueillirent la petite équipe de Nsara dans une grande madrasa au cœur du nouveau centre-ville, et la conduisirent dans les vastes appartements réservés aux invités de l’Institut de recherche scientifique. Après quoi, ils les emmenèrent dîner dans la ville, qui s’étendait alentour, au pied des monts Zagros.
Un fleuve coulait au sud de la ville basse, que l’on venait de reconstruire entièrement sur les ruines de l’ancien centre-ville. Les habitants de la ville leur apprirent que les collections archéologiques de l’Institut accueillaient une profusion d’antiquités et d’artefacts anciens, récemment récupérés. La nouvelle ville était parcourue de larges avenues bordées d’arbres, qui maillaient la ville du fleuve jusqu’au nord. À cette altitude, et même sous de plus hautes montagnes, ce serait un spectacle magnifique quand les arbres auraient enfin atteint leur taille adulte. Mais c’était déjà impressionnant.
Les Isfahanis étaient visiblement très fiers, à la fois de leur ville, de leur Institut, et de l’Iran en général. Dévasté plusieurs fois pendant la Longue Guerre, leur pays était maintenant en pleine reconstruction. Ils disaient qu’ils essayaient de lui insuffler un nouvel esprit, une façon d’être au monde typiquement persane, où leurs propres chiites ultraconservateurs se trouvaient noyés sous un afflux d’immigrants et de réfugiés plus tolérants, ainsi que d’intellectuels locaux qui se faisaient appeler cyrusiens, en hommage à celui que l’on tenait pour le premier roi d’Iran. Les Nsarais trouvèrent ce renouveau patriotique persan particulièrement intéressant, parce qu’il semblait illustrer un moyen de s’affranchir de l’islam, sans pour autant l’abandonner. Les Cyrusiens attablés avec eux se réjouirent de leur apprendre que cette année n’était plus pour eux l’an 1381 A. H., mais l’an 2561 de « l’ère du roi des rois ». Un homme se leva pour porter un toast en récitant un poème anonyme que l’on venait de découvrir, peint sur l’un des murs de la nouvelle madrasa :
Ancien Iran, Perse éternelle,
Pris dans l’étau du monde et du temps,
Auxquels tu donnes ce persan superbe,
Langue d’Hafiz, de Firdoussi et de Khayyam,
Langue de mon cœur, maison de mon âme,
C’est toi que j’aime si j’aime quelque chose,
Une fois encore, grand Iran, chante-nous cet amour.
Alors les autochtones se mirent à boire et à se congratuler. Beaucoup d’entre eux étaient en fait des étudiants venus d’Afrique, du Nouveau Monde ou d’Aozhou.
— C’est à cela que le monde entier finira par ressembler, quand les gens auront pris l’habitude de se déplacer, dit ensuite Abdol Zoroush à Budur et Piali, alors qu’il leur faisait visiter les immenses terrains de l’Institut, puis le quartier fluvial qui se trouvait juste au sud.
On était justement en train de construire au-dessus du fleuve une promenade bordée de cafés d’où l’on pouvait admirer les montagnes et le fleuve en amont. Zoroush leur dit que ce panorama avait été construit sur le modèle de la corniche surplombant l’estuaire, à Nsara.
— Nous souhaitions quelque chose qui rappellerait votre grande cité, tout entourés de terres que nous soyons. Nous voulions un symbole de notre ouverture d’esprit.
Le colloque commença le jour suivant et, pendant toute la semaine, Budur assista à diverses communications portant sur des sujets variés touchant à ce que beaucoup d’entre eux appelaient la nouvelle archéologie, une science et pas seulement un passe-temps pour antiquaires, ou concernant le nébuleux point de départ de l’histoire. Piali, pendant ce temps, disparaissait dans les bâtiments consacrés aux sciences physiques pour assister à des débats de physiciens. Ils se retrouvaient pour dîner parmi tous les autres savants, et n’avaient que peu d’occasions de se parler en privé.
Budur trouva que les différentes conférences sur l’archéologie, faites par des conférenciers venus des quatre coins du monde, constituaient une initiation passionnante. Il en ressortait clairement qu’au cours des années de reconstruction qui avaient suivi la guerre, avec la découverte et le développement de nouvelles méthodologies, et grâce à ce qu’ils savaient déjà des premiers temps de l’histoire du monde, une nouvelle science, une nouvelle façon d’envisager les profondeurs de leur passé le plus lointain, était en train d’émerger, là, sous leurs yeux. Les salles de conférences étaient bondées, et les communications se prolongeaient toujours jusque tard dans la nuit. Beaucoup avaient lieu dans les couloirs, où les conférenciers parlaient, s’agitaient, répondaient aux questions devant de grands tableaux noirs et des panneaux d’affichage couverts de photos et de documents. Il y en avait tellement que Budur ne pouvait se rendre à toutes, aussi prit-elle très vite l’habitude de se tenir au fond des salles ou derrière la foule, quand les conférences avaient lieu dans les couloirs, arrivant au beau milieu et épluchant le programme pour choisir ce qu’elle allait faire l’heure d’après.
Elle s’arrêta dans une salle pour écouter un vieil homme, apparemment d’origine chinoise, japonaise, ou de l’ouest du Yingzhou, qui parlait dans un persan maladroit des civilisations du Nouveau Monde au moment où le Vieux Monde l’avait découvert. Ce qui l’avait poussée à venir l’écouter était le fait qu’il connaissait Hanea et Ganagweh.
— En fait, en termes de mécanisation, d’architecture et ainsi de suite, les habitants du Nouveau Monde étaient déjà assez avancés. Même s’il n’y avait pas d’animaux domestiques au Yingzhou (mis à part les cochons d’Inde et les lamas en Inka), les civilisations aztèque et inka ressemblaient à celle des anciens Égyptiens, telle que nous la découvrons. On peut donc dire que les tribus du Yingzhou vivaient comme les habitants du Vieux Monde avant que n’existent les villes, c’est-à-dire il y a environ huit mille ans, alors que les empires inkas, plus au sud, rappelaient le Vieux Monde d’il y a quatre mille ans. C’est une différence de taille, qu’il serait intéressant d’expliquer, si c’était possible. Peut-être l’empire inka bénéficiait-il d’atouts topographiques, ou de ressources, comme par exemple le lama, une bête de somme qui leur donnait un avantage sur les habitants du Yingzhou – même s’il s’agit d’un avantage assez mince au regard des critères du Vieux Monde. Mais ils disposaient, grâce à lui, d’un peu d’énergie supplémentaire, et ainsi que notre hôte, Maître Zoroush, l’a clairement expliqué, l’énergie que ces lamas leur permettait de mettre en jeu pour dompter la nature constitue l’un des principaux facteurs de développement.
» Quoi qu’il en soit, l’étude des conditions de vie primitives du Yingzhou nous permet de comprendre les structures sociales qui ont pu être celles des sociétés pré-agricoles du Vieux Monde. Elles sont étrangement modernes par certains aspects : elles possédaient les bases de l’agriculture – la courge, le mais, les haricots, et ainsi de suite –, leur population n’était pas très nombreuse, et vivait dans une forêt giboyeuse, avec beaucoup d’arbres fruitiers, leur économie en était au stade pré-pénurique, même si nous découvrons aujourd’hui qu’ils avaient les moyens de développer une technologie post-pénurique. Dans chacune de ces deux civilisations, l’individu était mieux considéré, en tant que créateur de valeur, qu’il soit homme ou femme, que dans une économie de type pénurique. De même, on trouvait moins de cas de domination d’une caste par une autre. Derrière ces conditions d’abondance et d’aisance matérielle, nous voyons le grand égalitarisme des Hodenosaunees, le pouvoir qu’ont les femmes dans leur société, et l’absence d’esclavage – au contraire, les tribus défaites étaient rapidement assimilées dans le tissu même de l’État.
» À l’époque des Premiers Grands Empires, il y a quatre mille ans, tout cela avait disparu et laissé place à une structure d’une extrême verticalité, avec des rois-dieux, une caste de religieux toute-puissante, un contrôle militaire permanent, et l’asservissement des vaincus. Ces premiers développements, ou, pourrait-on dire, ces premiers symptômes, de civilisation (car l’urbanisation avait grandement accéléré ce processus) ne se rencontrent aujourd’hui, près de quatre mille ans plus tard, que dans les civilisations les plus progressistes du monde.
» Pendant ce temps, bien sûr, chacune de ces deux sociétés primitives a presque entièrement disparu de la surface de la Terre, en partie à cause des maladies du Vieux Monde qui avaient frappé leurs populations. Chose intéressante, les empires méridionaux se sont effondrés plus vite, et plus totalement, à peu près au moment même où ils étaient conquis par les armées d’or chinoises, avant d’être rapidement ravagés par la famine et les maladies, comme si un corps sans tête ne pouvait survivre un instant. Plus au nord, les choses se passèrent tout autrement, d’abord parce que les Hodenosaunees purent se défendre en s’enfonçant dans l’immense forêt à l’est de leurs terres, parvenant ainsi à échapper, du moins en partie, aux Chinois ou aux incursions islamiques venues de l’autre côté de l’Atlantique ; ensuite, parce qu’ils étaient bien moins sensibles aux maladies du Vieux Monde, peut-être parce qu’ils y avaient déjà été exposés, au contact de moines japonais itinérants, de commerçants, de trappeurs et de prospecteurs, qui contaminèrent de petits groupes d’autochtones, faisant office de vaccins humains, immunisant la population du Yingzhou, ou en tout cas la préparant à une arrivée plus massive d’Asiatiques, dont les effets dévastateurs purent ainsi être contrés, même si, bien sûr, nombre de gens et de tribus périrent.
Budur alla voir un peu plus loin, tout en réfléchissant à la notion de société post-pénurique, dont elle n’avait jamais entendu parler dans Nsara en proie à la famine. Mais une autre conférence, qu’elle ne voulait manquer à aucun prix, allait bientôt commencer, or c’était l’une des plus courues. Elle traitait de la question des anciens Francs, et de la raison pour laquelle la peste les avait si durement frappés.
Beaucoup de travaux avaient été effectués sur ce sujet, notamment par le savant zott Istvan Romani, qui avait effectué des recherches sur les régions frontalières de la peste, au Magyaristan et en Moldavie. Quant à la peste proprement dite, elle avait été étudiée en profondeur pendant la Longue Guerre, quand il avait paru possible que l’on se serve de cette maladie comme d’une arme d’un côté ou de l’autre. On savait maintenant qu’elle avait été transmise au cours des premiers siècles par les puces vivant sur les rats qui voyageaient à bord des bateaux ou suivaient les caravanes. Une ville appelée Issyk Kul, au sud du lac Balkhash, au Turkestan, avait été étudiée par des Romains et par un chercheur chinois, appelé Jiang, qui avaient mis au jour, dans un cimetière nestorien de la ville, les preuves que la peste avait durement sévi au cours de l’an 700. Cela avait été apparemment le point de départ de l’épidémie qui s’était déplacée le long des routes de la Soie, jusqu’à Sarai, alors capitale du khanat de la Horde d’Or. L’un de leurs khans, Yanibeg, avait assiégé le port génois de Kaffa, en Crimée, catapultant par-dessus les remparts des cadavres de victimes de la peste. Les Génois avaient jeté les corps à la mer, mais cela n’avait pas empêché la peste de contaminer le réseau génois de ports de commerce, puis, finalement, toute la Méditerranée. La peste s’était déplacée de port en port, entrant en sommeil pendant les hivers et recommençant à frapper de plus belle dans l’intérieur des terres au printemps. Cela dura une vingtaine d’années. Les péninsules de l’ouest du Vieux Monde avaient toutes été ravagées, en remontant vers le nord à partir de la Méditerranée, puis repartant vers l’est, jusqu’à Moscou, Novgorod, Copenhague et les ports de la Baltique. À la fin, la population de Franji n’était plus que de trente pour cent environ de ce qu’elle était avant le début de l’épidémie. Puis, vers 777, année considérée à cette époque comme cruciale par les mollahs et les soufis mystiques, une seconde vague de peste – si c’était bien la peste – avait tué la quasi-totalité des survivants de la première vague, de telle sorte que les marins du début du huitième siècle rapportèrent avoir vu, généralement depuis la mer, une terre complètement vide.
Puis des conférenciers exposèrent une théorie selon laquelle la seconde vague avait en fait été une vague d’anthrax, qui avait suivi la peste ; d’autres tenaient un discours opposé, expliquant que les récits faits à l’époque de la première épidémie correspondaient plus souvent aux symptômes de l’anthrax qu’aux bubons de la peste bubonique, et que la peste n’avait frappé qu’ensuite. On expliqua au cours de ces mêmes conférences qu’il y avait plusieurs types de peste, bubonique, septicémique et pulmonaire. La pneumonie causée par cette dernière forme était mortelle, contagieuse, et se répandait très vite. Quant à la forme septicémique, elle était encore plus mortelle. Les tristes expériences menées au cours de la Longue Guerre avaient permis d’en apprendre long sur ces différentes maladies.
Mais comment expliquer que ce fléau, quel qu’il fut, ait été si mortel en Franji et pas ailleurs ? Le colloque donnait l’occasion à toute une flopée de conférenciers d’exposer leurs théories. Grâce à ses notes, Budur put les résumer à Piali, au cours du dîner, et il s’empressa de les inscrire sur la nappe.
• Dans les années 770, des animalcules de la peste mutèrent, prenant des formes proches de la tuberculose ou de la typhoïde, d’une virulence au moins équivalente.
• Les villes de Toscane étaient particulièrement peuplées aux alentours du huitième siècle ; certaines comptaient jusqu’à deux millions d’habitants, et les systèmes sanitaires, débordés, favorisèrent la prolifération des vecteurs de la peste.
• Les ravages provoqués par la première peste furent suivis de toute une série d’inondations désastreuses qui anéantirent le système agricole, provoquant la famine.
• À la fin de la première épidémie, une forme super contagieuse de l’animalcule muta dans le nord de la France.
• La peau claire des Francs et des Celtes ne possédait pas les pigments permettant de résister à la maladie – en témoignent leurs nombreuses taches de rousseur.
• Des taches solaires perturbèrent le climat et provoquèrent des épidémies, dont la gravité alla en s’accroissant…
— Des taches solaires ? coupa Piali.
— C’est ce qu’il a dit, confirma Budur en haussant les épaules.
— Si je comprends bien, reprit Piali, en relevant son regard de la nappe, l’épidémie serait due soit à des animalcules de la peste ou d’autres types de bacilles, soit à la nature des populations, ou à leurs coutumes, ou à leur pays, ou au climat, ou à des taches solaires…
Il grimaça.
— À mon humble avis, cela couvre l’éventail des causes possibles… Peut-être aurait-il fallu y inclure également les rayons cosmiques. Eh, euh, dis-moi, n’y aurait-il pas eu une supernova, quelque part, à cette époque ?
Budur ne put s’empêcher de rire.
— Je pense qu’elle a eu lieu un peu plus tôt. De toute façon, tu dois bien reconnaître que c’est quelque chose qui mérite une explication.
— Comme bien d’autres problèmes. Mais j’ai l’impression qu’en ce qui concerne celui-là, nous ne sommes pas près d’y arriver.
Le colloque se poursuivit, avec ses conférences traitant de ce qu’on savait des premiers hommes, jusqu’à l’immédiat avant-guerre. Les travaux sur les origines de l’homme fournirent le point de départ de l’une des plus formidables controverses qui aient jamais eu lieu à ce sujet.
L’archéologie, en tant que discipline, trouvait en gros sa source dans la bureaucratie chinoise. Ensuite, elle avait été récupérée par les Dineis, qui avaient étudié avec les Chinois, avant d’aller au Yingzhou, où des chercheurs essayèrent de comprendre les origines des Anasazis, ce peuple mystérieux qui avait été le premier à fouler le sol poussiéreux de l’ouest du Yingzhou. Le savant dinei Anan et ses collègues avaient apporté une ébauche d’explication à l’histoire de l’homme et de ses migrations, en prouvant que des tribus du Yingzhou avaient exploité des mines d’étain sur l’île Jaune, une île du Manitoba, le plus grand des Grands Lacs, et avaient envoyé cet étain par-delà les océans, aux civilisations de l’âge du bronze d’Afrique et d’Asie. L’équipe d’Anan prétendait que la civilisation avait vu le jour au Nouveau Monde, avec les Inkas, les Aztèques et les plus anciennes tribus du Yingzhou, qui avaient précédé les Anasazis des déserts à l’ouest. Leurs grands et vieux empires envoyaient leur étain sur des radeaux de roseau et de sapin, et le troquaient contre des épices et différentes espèces végétales avec les ancêtres des Asiatiques. Ces commerçants du Yingzhou avaient créé les premières civilisations méditerranéennes avant même les Grecs, et notamment les civilisations égyptiennes et celles des empires du Moyen-Occident, les Assyriens et les Sumériens.
C’est en tout cas ce que disaient les archéologues dineis, qui étayaient leurs thèses à l’aide de toutes sortes d’objets venus du monde entier. Mais voilà que l’on commençait à mettre au jour en Asie, en Franji et en Afrique, de nombreuses autres preuves démontrant le contraire. La datation à l’anneau-de-vie des plus anciennes traces de présence humaine dans le Nouveau Monde les faisait remonter à une vingtaine de milliers d’années, ce qui était fort ancien, et bien antérieur aux premières civilisations connues de l’histoire du Vieux Monde – les Chinois, les Moyen-Occidentaux et les Égyptiens. Théorie qui à l’époque paraissait plausible. Mais maintenant que la guerre était terminée, les scientifiques commençaient à étudier le Vieux Monde d’une façon qui n’avait pas été possible avant l’invention de l’archéologie moderne. Et ils trouvaient d’importantes traces d’un passé humain bien plus ancien que tout ce qu’on avait cru jusqu’alors. Des grottes dans le sud de Nsara, avec de magnifiques peintures d’animaux, étaient maintenant datées de façon assez certaine d’environ quarante mille ans. On avait retrouvé dans le Moyen-Occident des squelettes vieux d’à peu près cent mille ans. Et certains savants, à Ingali, en Afrique du Sud, disaient avoir trouvé des restes humains, ou de lointains ancêtres de l’homme, qui paraissaient avoir plusieurs centaines de milliers d’années. La datation à l’anneau-de-vie n’était pas utilisable pour ces vestiges, mais ils avaient recours à d’autres méthodes de datation qu’ils estimaient tout aussi fiables.
Personne au monde n’avait formulé de revendication semblable à celle des Africains, que bien des gens considéraient avec scepticisme ; certains remettaient en question leurs techniques de datation, d’autres écartaient tout simplement leurs assertions, n’y voyant que la manifestation d’un chauvinisme continental ou racial. Bien sûr, cette réponse agaçait les savants africains, et la conférence de l’après-midi fut tellement orageuse qu’elle rappela à bien des gens l’atmosphère qui régnait à l’époque de la guerre. Il était important de s’en tenir, dans tout discours, aux bases scientifiques, et de n’interroger que les faits, sans considérations religieuses, politiques ou raciales.
— Je suppose que le patriotisme peut prendre toutes les formes, dit cette nuit-là Budur à Piali. Un patriotisme archéologique est absurde, mais apparemment, c’est sous cette forme qu’il a vu le jour au Yingzhou. Un préjugé sans nul doute inconscient, que l’on a tous pour son propre pays. Et tant que nous n’aurons pas réglé le problème de datation, la question du modèle qui remplacera le leur reste ouverte.
— Les méthodes de datation vont finir par s’améliorer, c’est certain, dit Piali.
— Certes. Mais en attendant, tout est confus.
— C’est vrai pour tout.
Les jours se suivirent, perdus dans un brouillard de conférences. Budur se levait tous les jours à l’aube, prenait son petit déjeuner au réfectoire de la madrasa et enchaînait les conférences, les réunions et les exposés jusqu’au dîner. Après quoi, elle suivait encore d’autres communications, et ne retournait dans sa chambre qu’à une heure avancée de la nuit. Un jour, elle fut intriguée par le discours d’une jeune femme qui décrivait sa découverte de ce qui semblait avoir été une branche perdue d’un féminisme des premiers temps de l’islam, une branche qui avait permis à Samarkand de renaître avant d’être détruite puis rayée de l’histoire. Apparemment, des femmes de Qom s’étaient élevées contre le pouvoir des mollahs et avaient mené leur famille vers le nord-est, dans la ville de Derbent, en Bactriane. La ville, qui avait été conquise par Alexandre le Grand, vivait depuis plus d’un millier d’années à la mode des Grecs dans une sorte de béatitude transoxianique, quand les rebelles musulmanes étaient arrivées avec leurs familles. Ensemble, ils bâtirent un mode de vie où tous les êtres vivants étaient égaux entre eux et devant Allah, quelque chose qui ressemblait à ce qu’Alexandre aurait créé, en bon disciple de la reine de Crète. C’est ainsi que les habitants de Derbent vécurent des années de bonheur, sans chercher à imposer leur mode de vie au reste du monde, mais en parlant de ce qu’ils avaient appris aux gens de Samarkand avec qui ils commerçaient. Et à Samarkand, ils prirent cette connaissance et en firent le début de la renaissance du monde. Tout cela peut se lire dans les ruines, répéta la jeune chercheuse.
Budur nota les références, se rendant compte que l’archéologie aussi pouvait être une sorte de profession de foi, ou d’engagement sur l’avenir. Elle repartit dans les couloirs en secouant la tête. Il faudrait qu’elle en parle à Kirana. Il faudrait qu’elle se plonge là-dedans elle-même. Qui savait, en réalité, ce que les gens avaient fait dans le passé ? Il était arrivé bien des choses, qui n’avaient jamais été consignées par écrit et qu’au bout d’un moment on avait complètement oubliées. Tout était possible. À peu près tout. Et il y avait ce phénomène que Kirana avait mentionné une fois en passant : les gens imaginaient que l’herbe était toujours plus verte ailleurs, ce qui leur donnait le courage d’essayer de promouvoir un certain progrès dans leur propre pays. C’est ainsi que les femmes de partout, imaginant que le sort des femmes d’ailleurs était meilleur que le leur, avaient eu le courage d’initier des changements. Et on pouvait sans doute multiplier les exemples de gens qui anticipaient une amélioration de la réalité, comme dans ces histoires de paradis mythique, découvert puis perdu, que les Chinois appelaient les histoires de « la source des fleurs de pêcher ». Histoire, fable, prophétie ; on ne savait pas ; jusqu’à ce que passent les siècles, peut-être, et que le temps en fasse des histoires d’une sorte ou d’une autre.
Elle assista à beaucoup de conférences, et cette impression de gens en lutte permanente, d’expériences interminables, d’êtres humains se démenant pour essayer de trouver un moyen de vivre ensemble, ne fit que s’approfondir. Un faux Potala, à l’échelle deux tiers, construit à l’extérieur de Beijing ; d’anciens temples, d’origine grecque peut-être, perdus dans les jungles d’Amazonie ; un autre ensemble de temples dans les jungles du Siam ; une capitale inka, là-haut dans les montagnes ; des squelettes d’hommes au crâne légèrement différent de celui de l’homme moderne retrouvés en Franji ; des huttes rondes faites avec des os de mammouth ; le calendrier formé par les cercles de pierres de Britannia ; la tombe intacte d’un pharaon égyptien ; les restes miraculeusement préservés d’un village médiéval français ; une épave sur la péninsule de Ta Shu, le continent de glace entourant le pôle Sud ; une ancienne poterie inka primitive ornée de schémas du sud du Japon ; les légendes mayas de la « grande arrivée » d’un dieu Itzamna, qui était le nom de la déesse mère Shinto de la même période ; des mégalithes du grand bassin hydrographique inka, qui ressemblaient à ceux du Maghreb ; de vieilles ruines grecques en Anatolie qui rappelaient la Troie de l’Iliade, le poème épique d’Homère ; de grandes figures linéaires tracées sur les plaines d’Inka que l’on ne voyait bien que du ciel ; le village côtier des Orcades, que Budur avait visité avec Idelba ; une cité gréco-romaine complète à Éphèse, sur la côte d’Anatolie ; ces vestiges et beaucoup, beaucoup d’autres furent passés en revue. Chaque jour apportait son fleuve de paroles, Budur prenant des notes, infatigablement, et demandant des tirés-à-part des articles quand ils étaient en arabe ou en persan. Elle prenait un intérêt particulier aux communications sur les méthodes de datation, et les chercheurs qui travaillaient dans ce domaine lui disaient souvent tout ce qu’ils devaient aux travaux précurseurs de sa tante. Ils exploraient à présent d’autres méthodes de datation, comme le décompte des anneaux concentriques des troncs d’arbre (la « dendrochronologie ») ou la mesure d’un genre particulier de luminescence due à la fuite de ki que l’on remarquait dans la poterie cuite à des températures suffisantes. Mais ces techniques étaient encore balbutiantes, et personne n’était satisfait des méthodes actuellement utilisées pour dater les objets du passé qu’on trouvait dans la terre.
Un jour, des archéologues qui avaient utilisé les travaux d’Idelba sur les méthodes de datation se joignirent à Budur, et ils traversèrent le campus de la madrasa pour assister à une réunion à la mémoire d’Idelba, organisée par les physiciens qui l’avaient connue. Cette réunion comporterait un certain nombre d’éloges, une présentation des divers aspects de ses travaux, des communications sur les travaux récents dans les domaines sur lesquels elle s’était penchée, suivis d’une petite fête ou d’une veillée en son honneur.
Budur se promena dans les salles où la manifestation devait se tenir, recevant les louanges adressées à sa tante, et les condoléances. Les hommes de l’assistance (il y avait très peu de femmes) se montrèrent plein de sollicitude à son égard, et généralement amicaux. Le seul souvenir d’Idelba suffisait à amener des sourires sur leurs visages. Budur était stupéfaite et très fière de ces témoignages d’affection, même s’ils lui faisaient souvent aussi un peu de peine ; ils avaient perdu une collègue de valeur, mais elle avait perdu l’unique membre de sa famille qui comptait pour elle, et avait parfois du mal à se concentrer sur le seul aspect professionnel qu’on lui présentait de sa tante.
À un moment donné, on lui demanda de dire quelques mots, et elle prit sur elle pour aller au pupitre sur le devant de la salle. Elle songea à ses soldats aveugles, qui étaient devenus pour elle une sorte de rempart, d’ancrage, ou d’étalon de la tristesse. Par rapport à cela, c’était vraiment une fête, et elle sourit en voyant tous ces gens réunis pour honorer sa tante. Elle n’avait plus qu’à trouver quoi dire, et en montant les marches de l’estrade, il lui vint à l’esprit qu’elle n’avait qu’à imaginer ce qu’Idelba elle-même aurait dit, puis broder dessus. C’était une forme de réincarnation à laquelle elle pouvait croire.
Elle regarda donc l’assemblée de physiciens, calmement, soudain pleine d’assurance. Elle les remercia d’être venus et ajouta :
— Vous savez tous à quel point Idelba s’impliquait dans ses recherches sur la physique atomique, que vous poursuivez actuellement. Elle pensait qu’elles devaient être utilisées pour le bien de l’humanité, et pour rien d’autre. Le meilleur tribut que vous pourriez rendre à sa mémoire serait de fonder une organisation de savants qui se consacrerait à la diffusion et à l’utilisation de ce savoir. Nous aurons l’occasion d’en reparler. L’idéal serait que cette conférence voie se concrétiser cette aspiration. Elle avait, vous le savez, la conviction que l’on pouvait compter sur les savants entre tous pour agir au mieux, parce que c’était le mieux à faire du point de vue scientifique.
On aurait entendu une mouche voler dans la salle. L’expression qu’elle lisait sur leur visage lui rappelait beaucoup celle de ses soldats aveugles : souffrance, nostalgie, vains espoirs, regrets et résolution. Beaucoup de ceux qui étaient là avaient sans nul doute été impliqués dans l’effort de guerre de leurs pays respectifs – vers la fin, forcément, quand la course aux armements s’était accélérée et que les choses étaient devenues particulièrement dures et pénibles. Les inventeurs des obus à gaz de combat qui avaient aveuglé ses soldats pouvaient très bien se trouver dans cette salle.
— Maintenant, poursuivit prudemment Budur, il est évident que ça n’a pas tout le temps été le cas. Les savants n’ont pas toujours fait ce qu’il fallait. Mais pour Idelba, la science était perfectible, et on pouvait sans cesse la rendre plus scientifique. C’est même l’une des façons de définir la science, par opposition à bien d’autres disciplines ou institutions humaines. Pour moi, cela en fait une sorte de prière ou d’adoration du monde. C’est un travail, et c’est une dévotion. Nous devrions avoir cela constamment présent à l’esprit, chaque fois que nous repensons à Idelba, et chaque fois que nous réfléchissons aux conséquences ou aux applications de notre travail. Merci.
Par la suite, de plus en plus de gens vinrent la remercier et lui exprimer leur reconnaissance, si déplacée qu’elle fut dans la mesure où c’était sa tante qui aurait dû la recevoir. Puis, comme le moment d’honorer sa mémoire prenait fin, certains d’entre eux allèrent dîner dans un restaurant proche, après quoi un groupe encore plus restreint s’attarda autour de cafés et de baklavas. Budur avait l’impression de se retrouver dans l’un de ces cafés fouettés par la pluie de Nsara.
Finalement, très tard cette nuit-là, alors qu’ils n’étaient plus qu’une douzaine et que les serveurs du restaurant donnaient l’impression de vouloir fermer, Piali parcourut la salle du regard et, sur un hochement de tête d’Abdol Zoroush, se tourna vers Budur.
— Je vous présente le docteur Chen, dit-il en indiquant un Chinois aux cheveux blancs à l’autre bout de la table. Il nous a apporté les travaux de son équipe sur l’alactin. Il a manifesté le désir de partager ses résultats avec nous. Il arrive aux mêmes conclusions que nous en ce qui concerne la fission des atomes d’alactin et la façon dont on pourrait l’exploiter pour en faire une bombe. Mais son équipe est allée plus loin dans ses calculs, ce que nous avons vérifié pendant le colloque, et notamment Maître Ananda, ici présent (un autre homme assis à côté de Chen hocha la tête). Il apparaît maintenant évident que le type particulier d’alactin nécessaire pour déclencher une réaction en chaîne est tellement rare dans la nature qu’on ne pourrait pas en réunir une quantité suffisante. Il faudrait se contenter de sa forme naturelle, et la retraiter en laboratoire, selon un process qui est pour l’instant hypothétique, et même si on le rendait applicable, il serait tellement complexe qu’il faudrait la capacité industrielle de tout un État pour en produire assez pour une bombe.
— Vraiment ? demanda Budur.
Ils acquiescèrent avec ensemble, l’air calmes et soulagés, peut-être même heureux. L’interprète du docteur Chen lui dit quelque chose en chinois. Il opina du chef, répondit, et le traducteur répéta ses paroles en persan :
— Le docteur Chen ajoute que d’après ses observations, il paraît très peu vraisemblable que, même s’il le voulait, un pays, quel qu’il soit, réussisse à créer ces matériaux avant bon nombre d’années. Nous sommes donc tranquilles. De ce côté-là tout au moins.
— Je vois, dit Budur, avec un hochement de tête approbateur en direction du vieux Chinois. Vous devez imaginer à quel point Idelba aurait été contente de vous entendre ! Elle s’en faisait beaucoup, vous le savez. Mais elle insisterait aussi pour que soit créée une organisation scientifique internationale, peut-être de physiciens atomistes. Ou d’un groupe de scientifiques plus généralistes, qui prendraient les mesures nécessaires pour que l’humanité ne soit jamais menacée par ces possibilités. Après ce que le monde vient de traverser pendant la guerre, je crois qu’il ne survivrait pas à l’invention d’une super bombe. Ce serait de la folie.
— Certainement, approuva Piali.
Et quand ses paroles eurent été traduites, le docteur Chen parla à nouveau, et son traducteur dit pour lui :
— D’après l’honorable professeur, les comités scientifiques devraient conseiller…
Le docteur Chen ajouta un commentaire.
— … les gouvernements, reprit l’interprète, et les informer de ce qui est possible, ce qui est préférable… Le professeur Chen pense que cela pourrait être fait discrètement, dans l’épuisement… de l’après-guerre. Il dit que les gouvernements devraient accepter l’existence de ce genre de comités, parce que au départ ils ne seront pas conscients de ce qu’ils signifient… et le temps qu’ils s’en rendent compte, ils ne pourront plus… les démanteler. Et alors les scientifiques pourront jouer… un plus grand rôle dans les affaires politiques. Voilà ce qu’il a dit.
Tous autour de la table hochèrent la tête pensivement, certains avec circonspection, d’autres avec inquiétude. Sans doute les travaux de la plupart des chercheurs ici présents étaient-ils financés par leur gouvernement.
— Nous pouvons toujours essayer, dit Piali. Ce serait un merveilleux hommage à Idelba. Et ça pourrait marcher. En tout cas, cela pourrait nous aider.
Tout le monde hocha la tête à nouveau, et, après traduction, le docteur Chen en fit autant.
— On pourrait les présenter comme de simples scientifiques réunis pour parler de science, proposa Budur. Un effort de coordination, pour faire avancer la science. Au début, quelque chose d’anodin, comme l’harmonisation des poids et mesures, ou la codification des mathématiques. Ou un calendrier solaire plus fidèle aux mouvements de la Terre autour du Soleil. Nous tous ici présents n’avons pas le même calendrier. Pour l’instant, nous ne sommes même pas d’accord sur les dates ou la longueur de l’année. À vrai dire, nous vivons encore dans des histoires différentes, et pourtant dans le même monde, comme la guerre nous l’a appris. Vous devriez peut-être vous réunir entre mathématiciens et astronomes, afin de définir un calendrier des plus précis, qui servirait pour tous les travaux scientifiques. Cela pourrait contribuer à forger un sentiment de communauté mondiale.
— Mais par où commencer ? demanda quelqu’un.
Budur haussa les épaules ; elle n’y avait pas réfléchi. Que dirait Idelba ?
— Et pourquoi ne pas le faire commencer maintenant, en prenant ce colloque comme année zéro ? C’est le printemps, après tout. Faisons commencer l’année à l’équinoxe de printemps, comme dans la plupart des pays, non ? Ensuite, il suffirait de numéroter les jours de chaque année en évitant tous les modes de calcul compliqués, les mois, les semaines de sept ou de dix jours, et tout ce qui s’ensuit. Il faudrait que ce soit simple, indiscutable, que ça transcende les cultures, parce que ça trouverait son origine dans la physique. Le jour deux cent cinquante-sept de l’an 1. On compterait à partir de cette date zéro, trois cent soixante-cinq jours par an, en ajoutant un jour pour les années bissextiles, enfin, ce qu’il faut pour que ce soit en conformité avec la nature. Et puis, quand ce principe sera banalisé ou standardisé dans le monde entier, si le moment vient où les gouvernements commencent à mettre la pression sur leurs savants pour qu’ils ne travaillent que pour une partie de l’humanité, ils pourront dire : Pardon, mais la science ne marche pas comme ça. Nous sommes au service de l’humanité. Notre seul souci est de faire en sorte que tout aille pour le mieux dans le meilleur des mondes possibles.
Le docteur Chen n’avait pas quitté Budur des yeux pendant son intervention. Quand elle se tut, il hocha la tête et dit quelque chose.
L’interprète traduisit sa réponse :
— Il dit : Ce sont de bonnes idées. Il dit : Essayons. On verra bien.
Par la suite, Budur continua d’aller aux conférences, de prendre des notes. Mais elle avait la tête ailleurs. Elle pensait à toutes ces conversations privées qui avaient lieu en ce moment même entre les physiciens, de l’autre côté de la madrasa : on y échafaudait bien des plans, dont Piali lui parlait. Et ses notes devinrent bientôt des listes de choses à faire. Sous le soleil d’Ispahan, cette cité à la fois ancienne et entièrement nouvelle, pareille à un jardin dans un champ de ruines, il était facile d’oublier qu’on mourait de faim en Franji, en Chine, en Afrique, et à vrai dire presque partout dans le monde. Sur le papier, on avait l’impression de pouvoir tout sauver.
Mais, un matin, elle passa devant un panneau d’affichage qui attira son attention. Il présentait un reportage photo intitulé : « On a trouvé un village tibétain, intact ! » Il ressemblait à tous les autres reportages affichés dans des centaines d’autres couloirs, mais il avait quelque chose de différent. Comme souvent, le texte principal était en persan, avec des traductions en plus petits caractères, en chinois, en tamoul, en arabe et en algonquin, les « cinq grandes » langues de la conférence. L’auteur de ce reportage était une grande jeune femme à la face plate, qui répondait nerveusement aux questions d’une demi-douzaine de personnes. Elle était elle-même tibétaine, apparemment, et faisait appel aux services d’un interprète iranien. Budur ne savait pas trop si elle parlait tibétain ou chinois.
Quoi qu’il en soit, comme elle l’expliquait, une avalanche avait recouvert un village de haute montagne au Tibet. Tout y avait été préservé, comme dans un réfrigérateur naturel géant : les meubles, les vêtements, la nourriture, et même les derniers messages que deux ou trois villageois qui savaient écrire avaient laissés avant de mourir asphyxiés. Même les corps avaient été congelés.
Les petites photos du chantier de fouille firent une drôle d’impression à Budur. Un picotement dans les sinus, ou sur la voûte du palais, comme si elle allait éternuer, vomir, ou pleurer. Ces corps que les siècles avaient épargnés, surpris par la mort et condamnés à l’attendre, avaient quelque chose de terrible. Elle regarda les photos des messages d’adieu, griffonnés en marge d’un livre religieux ; l’écriture était claire ; on aurait dit du sanskrit. La traduction en arabe de l’un de ces messages lui parut étrangement familière :
Nous avons été enfouis par une grande avalanche et ne pouvons nous dégager. Kenpo essaye encore, mais ses efforts sont voués à l’échec. Nous avons de plus en plus de mal à respirer. Je crois que c’est bientôt fini. Ici, dans la maison, il y a Kenpo, Iwang, Sidpa, Zasep, Dagyab, Tenga et Baram. Puntsok est parti juste avant l’avalanche, et nous sommes sans nouvelles de lui. « La vie n’est qu’un reflet dans un miroir, sans substance, un fantôme de l’esprit. Nous reprendrons forme ailleurs, plus tard. » Loué soit le Bouddha, le compatissant.
Les photos rappelaient un peu à Budur le spectacle de certains désastres de la guerre, la mort frappant sans laisser de traces visibles, sauf qu’après la vie était à jamais changée. En les regardant, elle eut soudain une sorte de vertige. Debout là, dans le couloir, elle eut l’impression de sentir la neige et les roches s’abattre sur le toit de la maison, l’emprisonnant. Avec toute sa famille et ses amis. C’est ainsi que cela s’était passé. C’est ainsi que cela se passait…
Elle était encore sous le choc quand Piali déboula en criant :
— Il faut rentrer, tout de suite ! L’armée a renversé le gouvernement et essaie de prendre le pouvoir à Nsara !
22
Ils rentrèrent le lendemain. Piali pesta tout le long du vol contre la lenteur de ces transports militaires, en regrettant qu’ils n’aient jamais été prévus pour les passagers civils et en se demandant s’ils ne risquaient pas d’être arrêtés à leur arrivée – Quoi ! Un couple d’intellectuels en visite à l’étranger, alors que la nation est en danger ! Enfin, sous ce prétexte ou un autre…
Mais quand leur appareil se posa, dans la banlieue de Nsara, non seulement ils ne furent pas arrêtés, mais encore rien ne permettait de dire, en regardant par les vitres du tram qui les ramenait en ville, qu’il s’était passé quoi que ce soit.
Ce ne fut qu’une fois descendus du tram, et alors qu’ils allaient à pied vers le quartier de la madrasa, qu’ils remarquèrent de subtils changements. Il y avait moins d’activité au port. Les dockers interdisaient l’accès aux quais en protestation contre le coup d’État. Et on pouvait voir des soldats monter la garde au pied des grues et des ponts roulants. Des attroupements se produisaient aux coins des rues.
Piali et Budur se rendirent directement au pavillon de physique, où les collègues de Piali les mirent au courant des derniers événements. Les généraux avaient dissous le conseil d’État nsarais et les panchayats, et décrété la loi martiale. Ils appelaient ça la charia, et ils s’étaient arrangés avec quelques mollahs pour conférer à tout ça un parfum de légitimité, qui ne faisait pas illusion une seconde. Ces mollahs étaient de sales réactionnaires, complètement en décalage avec tout ce qui s’était passé à Nsara depuis la guerre – ce qui ne les avait pas empêchés de se rallier au dernier moment au clan des « on a gagné ! », ceux qu’Hasan appelait les « on aurait gagné s’il n’y avait pas eu ces Arméniens, ces Sikhs, ces Juifs, ces Zott, bref, toute cette racaille que nous vomissons ! » ; en fait, la foule des « on aurait gagné si le reste du monde ne nous avait pas flanqué la pâtée ». S’ils avaient voulu se retrouver parmi des gens qui pensaient comme eux, il aurait fallu qu’ils fichent le camp aux Émirats Alpins ou en Afghanistan dès le début.
Ainsi, personne n’était dupe. On savait très bien qui tirait les ficelles de ce coup d’État. Et comme les choses avaient depuis peu commencé à s’améliorer, les généraux n’avaient pas très bien choisi leur moment. Cela n’avait aucun sens ; apparemment, cela ne s’était produit que parce que la solde des officiers n’avait pas été augmentée malgré l’inflation galopante, et qu’ils croyaient que tout le monde était aussi désespéré qu’eux. Mais il y avait encore beaucoup, beaucoup de gens qui ne pouvaient plus voir l’armée, même en peinture, et qui soutenaient leur panchayat, sinon le conseil d’État. Budur pensait que la résistance avait de bonnes chances de l’emporter.
Kirana était beaucoup plus pessimiste. En fait, elle était à l’hôpital, et Budur s’y précipita dès qu’elle l’apprit, se sentant à vif et terrifiée. Il ne s’agit que d’examens, lui dit sèchement Kirana, sans préciser quel genre d’examens, mais Budur crut comprendre que c’était un problème sanguin ou pulmonaire. Ce qui ne l’empêchait en tout cas pas d’organiser les choses depuis son lit d’hôpital, en appelant toutes les zawiyyas de la ville.
— Ils ont les armes pour eux, alors il se peut qu’ils l’emportent. Mais on ne va pas leur rendre la tâche facile.
Beaucoup des étudiants de la madrasa et de l’Institut étaient déjà massés sur la corniche, le port et la place principale de la grande mosquée, où ils criaient, chantaient, sifflaient et parfois lançaient des pierres. Mais tout cela ne plaisait pas beaucoup à Kirana, qui passait son temps au téléphone à essayer d’organiser un grand rassemblement politique.
— Ils vont vous obliger à remettre le voile, ils vont vouloir remonter le temps jusqu’à ce que vous redeveniez toutes de gentils animaux domestiques. Il faut descendre dans la rue, il n’y a que ça qui puisse faire peur aux organisateurs de ce coup d’État…
C’était toujours « vous » et pas « nous », remarqua Budur, comme si Kirana s’excluait ou parlait à titre posthume, même si elle était visiblement ravie de prendre une part active à tout ça. Et ravie aussi que Budur soit venue la voir à l’hôpital.
— Ils ont mal calculé leur moment, dit-elle à Budur avec une sorte d’ardente jubilation.
Non seulement les restrictions alimentaires étaient moins fréquentes, et moins sévères, mais en plus, c’était le printemps ! Et, comme cela arrivait occasionnellement à Nsara, le ciel sempiternellement nuageux s’était brusquement dégagé et le soleil brillait depuis des jours, illuminant les jeunes pousses qui verdissaient partout, dans les jardins et entre les pavés. Le ciel était d’un bleu radieux et brillait comme du lapis-lazuli. Aussi, quand vingt mille personnes se réunirent au port de commerce et descendirent le boulevard de la Sultane Katima, jusqu’à la mosquée des pêcheurs, des milliers d’autres vinrent les regarder et se joignirent au défilé. C’est alors que l’armée, qui encerclait le quartier, envoya des gaz lacrymogènes dans la foule. Les gens s’éparpillèrent dans les grandes artères adjacentes et s’engagèrent dans les médinas bordant le fleuve. On avait l’impression que la ville tout entière était à feu et à sang. Une fois les victimes des gaz soignées, la foule revenait, chaque fois plus nombreuse.
Cela se reproduisit deux ou trois fois dans la journée, jusqu’à ce que l’énorme place devant la mosquée et le vieux palais soit noire de monde. Les gens se massaient contre les barbelés qui défendaient l’entrée du palais. Et ça chantait, ça écoutait des discours, ça criait des slogans et diverses sourates du Coran qui parlaient de droit du peuple à l’autodétermination. La place ne désemplissait pas. Il y avait toujours autant de monde. Les gens rentraient chez eux pour manger ou pour toute autre raison, laissant les jeunes faire la fête la nuit durant, et s’en revenaient le lendemain pour occuper le terrain. Toute activité cessa de fait dans la ville pendant le premier mois du printemps, alors que les jours rallongeaient. Ce fut comme un ramadan de folie.
Un jour, les étudiants de Kirana l’emmenèrent sur la place en fauteuil roulant, et elle eut un immense sourire en voyant la foule assemblée.
— Voilà ! C’est ça qui marche ! dit-elle. La force du nombre !
Ils la conduisirent à travers la foule jusqu’à une estrade improvisée avec des tonneaux, sur laquelle ils la hissèrent pour qu’elle prononce un discours ; ce qu’elle fit avec délectation, dans son style habituel, malgré sa très grande fatigue. Elle s’empara du micro et s’adressa à la foule :
— Mahomet a été le premier à dire que les êtres humains avaient des droits dont on ne pouvait les priver sans offenser le Créateur. Allah a fait les hommes, Ses enfants, égaux entre eux. Et nul ne sera jamais l’esclave de quiconque. Ces paroles furent énoncées à une époque où ces pratiques n’étaient pas en vigueur, loin de là. Pour l’islam, le progrès passe par la clarification de ces principes et l’instauration d’une vraie justice. Aujourd’hui, si nous sommes là, c’est pour continuer ce chemin !
» Les femmes, en particulier, ont dû se battre contre une interprétation erronée du Coran. Elles ont été emprisonnées dans la triple prison de leur foyer, du voile et de l’ignorance, jusqu’à ce que l’islam lui-même flanche sous le coup d’un trop-plein d’ignorance. Comment, en effet, des hommes pourraient-ils devenir sages et prospères quand leurs premières années s’écoulent dans les jupes de femmes ignares ?
» C’est pourquoi nous avons livré la Longue Guerre et l’avons perdue. C’était le temps de la Nakba ! Et ce ne sont ni les Arméniens, ni les Birmans, ni les juifs, ni les Hodenosaunees, ni les Africains, qui nous ont vaincus. Ce n’est pas non plus ce qui est au cœur de l’islam ! Rappelez-vous, l’islam est la voix de Dieu, Son amour, la voix de l’humanité tout entière ! Ce qui nous a vaincus, c’est un islam dévoyé, déformé !
» Nous avons dû affronter cette réalité à Nsara depuis la fin de la guerre, et nous avons fait de grands progrès. Tous, nous avons assisté et pris part à cette explosion de bonnes choses ! Oui, tout cela nous l’avons fait, malgré la faim, la soif, la fatigue, et sous une pluie battante !
» Et aujourd’hui les généraux pensent qu’ils vont pouvoir arrêter tout ça et revenir en arrière, comme s’ils n’avaient pas perdu la guerre, nous obligeant à faire preuve d’ingéniosité et de créativité ? Comme si l’on pouvait remonter dans le temps ! Rien de tel n’arrivera jamais ! Nous avons fait de cette terre ancienne quelque chose de nouveau, sous la protection d’Allah ! Et cela, grâce à ceux qui aiment vraiment l’islam, et croient à ses chances de survie dans le monde à venir.
» C’est pourquoi nous sommes réunis ici, pour nous battre contre l’oppression, unis dans la révolte, la rébellion et la révolution. Battons-nous pour reprendre le pouvoir à l’armée, à la police, aux mollahs, et pour le rendre au peuple. Chaque victoire nous fait faire deux pas en avant pour un pas en arrière. Le combat est éternel. Mais à chaque fois nous progressons un peu, et personne ne nous fera reculer ! S’ils pensent y arriver, alors le gouvernement devra destituer le peuple et en nommer un autre ! Et ça, ce n’est pas près d’arriver !
Son discours eut un certain effet, et la foule continua de croître. Budur se réjouit de voir qu’il y avait beaucoup de femmes, des employées des cuisines et des conserveries, des femmes pour qui le voile ou le harem n’avaient jamais été une option, qui avaient eu leur lot de souffrances durant la guerre et la crise ; d’ailleurs, elles formaient la plus dépenaillée, et apparemment affamée, des foules possibles. Elles donnaient parfois l’impression de dormir debout, et pourtant elles étaient là, occupant le terrain, refusant de se rendre au travail. Le vendredi, elles restèrent sourdes aux appels du flic monté en chaire, et ne se tournèrent vers La Mecque que lorsque l’un des religieux révolutionnaires se dressa au milieu d’elles. Elles se sentaient plus proches de cet homme, qui leur rappelait ce que Mahomet avait été de son vivant. Comme c’était vendredi, ce religieux entre tous leur lut le premier chapitre du Coran, la Fatiha, que tout le monde connaissait, même les nombreux bouddhistes et Hodenosaunees qui se trouvaient là, de sorte que la foule tout entière la récita, plusieurs fois, encore et encore :
Louange à Dieu, Seigneur des univers !
Le Très miséricordieux, le Miséricordieux !
Le roi du Jour du Jugement !
C’est Toi que nous adorons, c’est Toi dont nous implorons le secours.
Guide-nous sur la voie de la rectitude,
La voie de ceux que Tu as comblés de Tes bienfaits,
Non pas celle de ceux qui osent Te défier, ni celle de ceux qui se sont égarés !
Le lendemain matin, le même religieux remonta sur l’estrade et inaugura la journée en récitant au micro un poème de Ghaleb, ce qui réveilla les gens et les fit à nouveau s’attrouper sur la place :
Je ne serai bientôt plus qu’une histoire
Mais il en va de même pour vous.
J’espère ne pas me retrouver seul dans le bardo
Mais on ne sait jamais où l’on vivra.
Le passé et l’avenir se confondent,
Ouvrez la fenêtre aux oiseaux prisonniers !
Que reste-t-il alors ? Les histoires auxquelles vous
Ne croyez plus. Vous feriez bien d’y croire.
Ce sont elles qui donnent sens à la vie.
Ce sont elles qui donnent sens à la mort.
Elles donnent sens à ceux qui viennent après nous.
Vous feriez mieux d’y croire.
Dans son histoire Rumi a vu tous les mondes,
Ils étaient Un, c’était l’Amour, il l’appela et le connut,
Ni musulman, ni juif, ni hindou, ni bouddhiste,
Rien qu’un ami, un souffle soufflant l’humain,
Racontant son histoire de bodhisattva. Le bardo
Attend que nous lui donnions forme.
Ce matin-là, Budur fut réveillée à la zawiyya par quelqu’un qui vint lui dire qu’elle avait reçu un coup de fil : c’était l’un de ses soldats aveugles. Ils voulaient lui parler.
Elle prit le tram pour l’hôpital en proie à une grande inquiétude. Lui en voulaient-ils de ne pas être venue depuis quelque temps ? Étaient-ils inquiets, à cause de la façon dont elle était partie la dernière fois ?
Non. Les plus anciens parlèrent pour les autres – pour une partie du moins ; ils voulaient participer à la manifestation contre le putsch militaire. Et ils voulaient qu’elle les conduise. Près des deux tiers du dortoir le voulaient.
C’était une demande qu’on ne pouvait pas refuser. Budur accepta et les conduisit dehors, tremblante et mal à l’aise. Ils étaient trop nombreux pour prendre le tram, aussi marchèrent-ils le long du front de mer, puis de la corniche, chacun la main sur l’épaule de celui qui le précédait, comme des éléphants à la parade. Dans le cadre de l’hôpital, Budur s’était habituée à leur aspect, mais au-dehors, en pleine lumière, elle les revoyait tels qu’ils étaient, mutilés et horribles, une vraie foire aux monstres. Il y en avait trois cent vingt-sept pour être exact, à défiler sur la corniche : ils s’étaient comptés en sortant de la salle commune.
Naturellement, les vétérans attirèrent la foule, et certains commencèrent à les suivre jusque sur la grande place, déjà noire de monde. On les laissa rapidement passer aux premiers rangs de la manifestation, juste devant le vieux palais. Ils se mirent en rang, à tâtons, et se comptèrent à nouveau, à rebours cette fois-ci, et à voix basse. Puis ils restèrent plantés là, en silence, la main sur l’épaule de leur voisin, écoutant les orateurs parler au micro. Derrière eux, la foule grandissait toujours.
Des avions de l’armée passèrent en rase-mottes au-dessus d’eux, et des voix sorties de haut-parleurs leur intimèrent l’ordre de s’en aller. Un couvre-feu général avait été décrété, beugla la voix métallique.
Cette décision avait sans nul doute été prise alors qu’on ne savait pas encore qu’il y aurait sur la place les soldats aveugles. Ils restaient là sans bouger, et la foule fit de même. L’un des soldats aveugles hurla :
— Qu’est-ce qu’ils vont nous faire ? Nous gazer ?
En réalité, c’était bien possible, puisque des gaz asphyxiants avaient déjà été employés contre le siège du Conseil d’État et les baraquements de la police, et au port. Plus tard, beaucoup de gens rapportèrent que les soldats avaient en fait été attaqués aux gaz lacrymogènes, mais qu’ils étaient restés plantés là stoïquement, parce qu’ils n’avaient plus de larmes à verser, la main sur l’épaule de leur plus proche voisin, chantant la Fatiha, et la bismallah qui ouvrait chaque sourate :
Au nom de Dieu, le Très miséricordieux, le Miséricordieux !
Au nom de Dieu, le Très miséricordieux, le Miséricordieux !
Budur, pour sa part, ne vit jamais d’attaque au gaz sur la place du palais, bien qu’elle entendît ses soldats chanter la bismallah plusieurs heures d’affilée. Mais elle n’était pas restée sur la place tout le temps, et son groupe de soldats aveugles n’avait pas été le seul à quitter l’hôpital pour aller manifester. Alors il était possible que cela se soit produit. En tout cas, peu après, plus personne n’en doutait.
Quoi qu’il en soit, au cours de cette rude semaine, les gens passèrent leur temps à réciter de longs passages de Rumi Balkhi, de Firdoussi, de ce blagueur de mollah Nasreddin, du poète épique franj, Ali, et de leur propre poète soufi, le jeune Ghaleb, qui avait été tué le dernier jour de la guerre. Budur allait souvent voir Kirana à l’hôpital des femmes, pour la tenir au courant de ce qui se passait dans la ville, maintenant vibrionnante. Les gens qui étaient descendus dans la rue ne voulaient plus rentrer chez eux, et même quand la pluie se mit à tomber, ils restèrent à battre le pavé. Kirana était avide de nouvelles. Elle mourait d’envie de sortir, irritée au-delà de toute expression d’être enfermée en ces heures historiques. Il fallait qu’elle soit gravement malade, sinon elle ne l’aurait jamais accepté. Elle avait beaucoup maigri, des cernes noirs s’étaient creusés sous ses yeux et on aurait dit un raton-laveur du Yingzhou. « Clouée là, comme elle disait, juste au moment où ça devient intéressant. » Juste au moment où sa propension à déverser d’acides discours sur la tête de ses ennemis aurait pu servir à quelque chose, et où elle aurait pu faire l’histoire autant qu’elle la commentait. Cela ne devait pas arriver ; elle était condamnée à se battre, mais contre la maladie. La seule fois où Budur se risqua à lui demander comment elle se sentait, elle fit la grimace et répondit :
— Les termites m’ont tuée.
Mais elle resta quand même proche du centre du combat. Une délégation de chefs de l’opposition comprenant un contingent de femmes des zawiyyas de la ville rencontra des représentants de la junte afin de leur faire connaître leurs protestations et de négocier avec eux – si c’était encore possible. Ces gens venaient souvent voir Kirana pour discuter de la stratégie à adopter. Dans les rues, la rumeur disait qu’on était en train d’aboutir à un compromis, mais Kirana restait allongée sur son lit, les yeux enfiévrés, le visage hâve, et secouait la tête en écoutant Budur pleine d’espoir.
— Ne sois pas si naïve, disait-elle avec un sourire sardonique. Ils essayent juste de gagner du temps. Ils pensent que s’ils se cramponnent assez longtemps le conflit pourrira, et qu’ils pourront continuer comme avant. Ils ont probablement raison. C’est eux qui ont les fusils, après tout.
C’est alors qu’une flotte de guerre hodenosaunee fit son entrée dans les eaux du port, où elle mouilla l’ancre. Hanea ! se dit Budur en la voyant. Quarante immenses navires d’acier, hérissés de canons d’une portée de quarante lis. Ils émirent sur un canal ki réservé à une station de musique populaire ; et le gouvernement eut beau s’emparer de la station, ils ne purent empêcher ce message d’arriver sur tous les récepteurs de la ville, où beaucoup l’entendirent et le répétèrent à leurs proches : les Hodenosaunees voulaient parler au gouvernement légitime, celui avec lequel ils négociaient avant. Ils refusaient de parler aux généraux qui avaient enfreint la Convention de Shanghai en renversant le gouvernement prévu par la Constitution, ce qui était une affaire très grave ; ils déclarèrent qu’ils ne quitteraient pas le port de Nsara tant que le conseil mis en place après la guerre n’aurait pas été rétabli, et qu’ils refusaient de négocier avec tout gouvernement où siégeraient les généraux. Comme le blé qui avait permis à Nsara d’échapper à la famine, l’hiver précédent, avait été convoyé essentiellement par les navires hodenosaunees, c’était un sérieux défi en vérité.
L’affaire resta trois jours en suspens, durant lesquels les rumeurs volèrent au-dessus de la ville comme des chauves-souris au crépuscule : les négociations se poursuivaient entre la flotte et la junte, le port avait été miné ; des troupes marines s’apprêtaient à débarquer ; les négociations étaient rompues…
Le quatrième jour, les chefs de la junte devinrent soudain introuvables. La flotte du Yingzhou comptait quelques bâtiments de moins. Les généraux avaient été exfiltrés, disait-on, vers des asiles dans les îles du Sucre ou aux Maldives, en échange du fait qu’ils se retireraient sans livrer combat. Les officiers restés derrière ramenèrent les unités de l’armée qui avaient été déployées à leurs baraquements, où elles restèrent terrées en attendant des instructions complémentaires du Conseil d’État légitime. Fin du coup d’État.
Les gens dans les rues se congratulèrent, poussèrent des cris et des acclamations, chantèrent, embrassèrent de parfaits inconnus, fous de joie. Budur fit tout cela, et ramena ses soldats à leur hôpital. Puis elle se précipita auprès de Kirana pour lui dire tout ce qu’elle avait vu. Elle eut un pincement au cœur en voyant à quel point Kirana était malade, alors qu’ils triomphaient. Kirana hocha la tête en entendant ces nouvelles et dit :
— Nous avons eu de la chance de recevoir une aide pareille. Le monde entier l’a vu ; ça aura un effet positif, tu vas voir. Même si maintenant, c’est reparti ! On va voir ce que c’est que d’appartenir à une ligue, on va voir de quel bois ces gens-là sont faits.
D’autres amis proposèrent de la conduire en fauteuil roulant prononcer un autre discours, mais elle refusa en disant :
— Dites seulement aux gens de se remettre au travail. Dites-leur qu’on est impatient de remanger des croissants !
23
Noir. Silence. Puis une voix dans le vide : Kirana ? Tu es là ? Kuo ? Kyu ? Kenpo ? Quoi. Tu es là ? Je suis là.
Nous sommes dans le bardo. Il n’existe rien de tel.
Si. D’ailleurs, nous y sommes. Tu ne peux pas dire le contraire. Nous n’arrêtons pas de revenir.
(Ténèbres. Silence. Refus de parler.)
Allez, tu ne peux pas dire le contraire. Nous n’arrêtons pas de revenir. On va nous renvoyer dehors, une fois encore. Comme tout le monde. C’est le dharma. Nous essayons toujours. Nous avançons toujours.
Un bruit, pareil à un feulement.
Mais si ! Regarde, il y a Idelba, et Piali, et même madame Surun.
Elle avait donc raison.
Oui.
C’est ridicule.
Ça ne change rien. Nous sommes là. Là pour être renvoyés une fois encore, renvoyés tous ensemble, notre petite jati. Je ne sais pas ce que je ferais si vous n’étiez pas là. Je crois que la solitude finirait par me tuer.
Tu es déjà morte.
Oui, mais là je me sens moins seule. Et maintenant, grâce à nous il y a eu des changements. Regarde ce que nous avons fait ! Regarde tout ce qui s’est passé ! Tu ne peux pas le nier !
Des choses ont été faites. Ce n’est pas grand-chose.
Bien sûr. Tu l’as dit toi-même, nous avons des milliers de vies de travail devant nous. Mais ça marche !
Ne t’emballe pas. Tout pourrait s’effacer.
Bien sûr. Mais nous repartons, pour essayer encore. À chaque génération son combat. Et quelques tours de roue supplémentaires. Allez – en route pour un nouvel avenir. De retour sur le ring !
Comme si on avait le choix.
Oh, allez. De toute façon, tu ne refuserais pas. Tu as toujours été la première à nous ramener en bas, la première à te battre.
… Je suis fatiguée. Je ne sais pas comment tu fais pour tenir le coup. Et tu me fatigues, d’ailleurs. Tout cet espoir, alors que tout est tellement absurde. Parfois, je me dis que cela devrait t’affecter un peu plus. Parfois, je me dis que c’est à moi de prendre la relève.
Allez. Tu redeviendras pareille à toi-même quand tout aura été arrangé. Idelba, madame Sururi, Piali, vous êtes prêts ?
Nous sommes prêts.
Kirana ?
… Bon, d’accord. Encore un tour.
LIVRE 10
LES PREMIÈRES ANNÉES

1. Toujours la Chine
Bao Xinhua avait quatorze ans quand il rencontra Kung Jianguo pour la première fois, dans son unité de travail au sud de Beijing, non loin de la Dahongmen, la Grande Porte Rouge. Kung n’avait que quelques années de plus que lui, mais était déjà à la tête de la cellule révolutionnaire située juste à côté de son unité de travail. Ce qui était quand même un sacré exploit étant donné qu’il était encore un sanwu, un « trois sans » – sans famille, sans unité de travail, sans carte d’identité –, quand il était allé frapper, tout jeune homme, à la porte du commissariat du district de Zhejiang, juste à l’extérieur de la Dahongmen. La police l’avait alors placé dans son actuelle unité de travail, mais il n’avait jamais réussi à s’y faire accepter, y gagnant même le surnom d’« individualiste », ce qui est encore considéré de nos jours comme une critique très grave en Chine, alors même que tant de choses ont changé. « Il n’en fait toujours qu’à sa tête, quoi qu’on lui dise » ; « Il s’obstine à poursuivre sa route » ; « Il est si seul qu’il n’a même pas d’ombre » : voilà ce qu’on disait de lui dans son unité de travail, de telle sorte qu’il était normal qu’il porte son regard ailleurs, et notamment dans son quartier et dans le reste de la ville. C’est ainsi qu’il devint un garçon des rues, ce qu’il était en fait depuis longtemps. Depuis quand exactement ? Nul n’aurait su le dire, pas même lui. Mais c’était un art dans lequel il excellait. Alors qu’il n’était encore qu’un gamin, il était devenu l’un des boutefeux des mouvements politiques clandestins de Beijing, et c’est à ce moment-là qu’il s’était rendu à l’unité de travail de Bao Xinhua.
— L’unité de travail est l’équivalent moderne des anciens domaines claniques de la Chine, dit-il à ceux qui s’étaient attroupés pour l’écouter. C’est autant une unité sociale et spirituelle qu’une unité économique, qui perpétue les traditions dans la modernité. Personne ne veut vraiment changer le monde, parce que tout le monde veut pouvoir reconnaître l’endroit où il reviendra après sa mort. Tout le monde a besoin d’un endroit. Mais ces gigantesques usines n’ont rien à voir avec les anciens domaines familiaux qu’elles tentent d’imiter. Elles sont des prisons, construites à l’origine pour encadrer les sacrifices faits pendant la Longue Guerre. La Longue Guerre est terminée depuis plus de cinquante ans, et pourtant nous continuons d’être ses esclaves, comme si nous travaillions pour la Chine, alors qu’en fait nous travaillons pour des gouverneurs militaires corrompus ; même pas pour l’empereur, disparu depuis longtemps, mais pour des généraux et des seigneurs de la guerre qui espèrent que nous travaillerons, encore et encore, sans jamais remarquer à quel point le monde a changé.
» Nous disons « nous sommes de telle unité de travail » comme nous dirions « nous sommes de telle famille », ou « nous sommes frères et sœurs », et c’est bien. Mais nous ne regardons jamais plus loin que les murs de nos usines, vers le vaste monde.
Beaucoup hochèrent la tête. Leur unité de travail était très pauvre, composée quasi exclusivement d’immigrants du Sud, qui souffraient souvent de la faim. Les années d’après-guerre à Beijing avaient été marquées par bien des changements, et maintenant, en l’an 29, comme les révolutionnaires se plaisaient à le dire, conformément aux pratiques des organisations scientifiques, tout commençait à foutre le camp. La dynastie Qing avait été renversée en pleine guerre, quand les choses allaient vraiment très mal ; l’empereur lui-même, qui avait six ou sept ans à l’époque, avait disparu, et maintenant tout le monde pensait qu’il était mort. La Cinquième Assemblée des Talents Militaires était encore aux commandes de la bureaucratie confucéenne, et tenait toujours le timon de leur destinée ; mais elle le tenait d’une main sénile, la main morte du passé, et partout en Chine il y avait des rébellions de toute sorte. Certaines à la solde d’idéologies étrangères, mais surtout des insurrections internes, organisées par des Chinois Han dans l’espoir de se débarrasser une bonne fois pour toutes des Qing, des généraux et des seigneurs de la guerre. D’où le Lotus Blanc, Les Singes Rebelles, le Mouvement Révolutionnaire de Shanghai, et ainsi de suite. À ces groupements se joignirent des révoltes nationales des diverses minorités et groupes ethniques de l’Ouest et du Sud – les Tibétains, les Mongols, les Xinzings, et ainsi de suite, tous désireux de se libérer du joug écrasant de Beijing. Et il ne faisait aucun doute que, malgré la grande armée que Beijing était en théorie capable de leur opposer, une armée encore très admirée et honorée par la population pour ses sacrifices pendant la Longue Guerre, le commandement militaire proprement dit avait des problèmes et ne tarderait pas à s’effondrer. La Grande Entreprise – le changement de dynastie – sévissait de nouveau en Chine et la question était : qui allait prendre le pouvoir ? Quelqu’un pourrait-il encore parvenir à réaliser l’unité de la Chine ?
Kung vanta à l’unité de travail de Bao la Ligue de l’École du Changement Révolutionnaire de Tous les Peuples, qui avait été fondée pendant les dernières années de la Longue Guerre par Zhu Tuanjie-kexue (« Tous pour la science »), un demi-Japonais dont le nom de naissance était Isao. Zhu Isao, ainsi qu’on l’appelait généralement, avait été le gouverneur chinois de l’une des provinces japonaises avant qu’elles ne se révoltent. Au moment de leur révolution, il avait négocié un compromis avec les Forces indépendantistes japonaises. Il avait donné l’ordre à l’armée chinoise qui occupait Kyushu de rentrer en Chine sans ouvrir le feu, était reparti avec elle en Mandchourie et avait déclaré le port de Tangshan « Cité Internationale de la Paix », dans le fief même des chefs Qing et au beau milieu de la Longue Guerre. La position officielle de Beijing avait été que Zhu était un Japonais et un traître, et que, le moment venu, son insurrection serait écrasée par les armées chinoises qu’il avait trahies. Les choses tournèrent de telle sorte que, quand la guerre prit fin et que les années d’après-guerre défilèrent, en une parade de mort et de famine, la ville de Tangshan ne fut jamais reprise ; au contraire, des révoltes semblables se produisirent dans beaucoup d’autres villes chinoises ; et en particulier dans les grands ports de la côte, jusqu’à Canton. Zhu Isao publia un flot continu d’articles théoriques expliquant les actions de son mouvement et détaillant la nouvelle organisation de la cité de Tangshan, qui était dirigée comme une entreprise égalitaire appartenant à tous ceux qui vivaient à l’intérieur de ses frontières, alors en guerre.
Kung parla de tout cela avec l’unité de travail de Bao, exposant la théorie de Zhu sur la création de valeur pour tous et ce qu’elle signifiait pour les Chinois ordinaires, qui s’étaient pendant si longtemps fait voler les fruits de leur travail.
— Zhu a étudié la vraie nature des choses, et analysé en détail notre économie, notre politique, la façon dont le pouvoir s’exerce et les richesses s’accumulent. À partir de là, il a proposé une nouvelle organisation de la société qui tenait compte de tout ce savoir sur la façon dont les choses marchaient, et l’a appliquée pour qu’elle serve à tous les individus d’une communauté, de toute la Chine, et de tout le monde en fait.
Pendant une pause déjeuner, Kung s’arrêta pour parler à Bao, et lui demanda son nom. Le prénom de Bao était Xinhua, « Nouvelle Chine » ; Kang s’appelait Jianguo, « Construire la nation ». Ils surent alors qu’ils étaient les enfants de la Cinquième Assemblée, qui avait encouragé les prénoms patriotiques pour compenser leur propre banqueroute morale et les sacrifices surhumains du peuple pendant les famines d’après-guerre. Tous ceux qui étaient nés une vingtaine d’années avant s’appelaient « Opposition à l’islam » (Huidi), ou « Bagarre ! » (Zandou), alors qu’à ce moment-là la guerre était finie depuis plus de trente ans. Les noms des filles avaient plus particulièrement souffert de cette toquade, leurs parents essayant de garder quelques éléments traditionnels des noms féminins au sein d’une ferveur patriotique montée en neige, de telle sorte qu’il y avait des filles de leur âge appelées « Soldate Parfumée », « Gracieuse Armée », « Fragrance Populaire » ou « Orchidée J’aime-La-Patrie », et ainsi de suite.
Kung et Bao rirent de bon cœur en évoquant certains de ces exemples et parlèrent des parents de Bao et de l’absence de parents de Kung ; Kung regarda alors Bao droit dans les yeux et lui dit :
— Pourtant, Bao est un mot ou un concept très important, tu sais. Remboursement, rétribution, honorer ses parents et ses ancêtres, tenir, et tenir bon. C’est un bon nom.
Bao approuva, déjà fasciné par l’attention que lui portait cet homme si intense, si chaleureux, aux yeux si noirs, tellement intéressé par les choses. Bao n’aurait su dire ce qui chez lui l’attirait, l’attirait si fortement qu’il avait l’impression que cette rencontre était une sorte de yuanfen, une « relation prédestinée », une chose destinée à se produire, faisant partie de son yuan, ou destin. Cela le sauvait peut-être d’un nieyuan, ou « mauvais destin ». En effet, il commençait à être frappé par l’étroitesse d’esprit de son unité de travail et le fait qu’elle était oppressive au point d’en être étouffante. Une sorte de mort de l’âme, une prison dont on ne s’échappait pas et qui était déjà pour lui comme un cercueil. En fait, il avait l’impression de connaître Kung depuis toujours.
C’est pourquoi il suivit Kung dans Beijing comme un jeune frère, et qu’à cause de lui ce fut comme s’il avait abandonné son unité de travail et était devenu en quelque sorte un révolutionnaire. Kung l’emmena à des réunions de la cellule révolutionnaire dont il faisait partie, et lui donna à lire des livres et des pamphlets de Zhu Isao. Il prit en charge son éducation, comme il l’avait fait pour bien d’autres ; et ni les parents de Bao ni son unité de travail ne purent rien y faire. Il avait une nouvelle unité de travail, maintenant, disséminée partout dans Beijing, dans la Chine et dans le monde entier – l’unité de travail de ceux qui allaient tout changer.
À Beijing, en ce temps-là, on souffrait des pires privations. Des millions de personnes s’y étaient installées pendant la guerre, dans des bidonvilles improvisés aux portes de la ville. Les unités de travail du temps de guerre s’étaient étendues loin à l’ouest et elles ressemblaient toujours à une succession de forteresses grises qui dominaient de leur hauteur les larges nouvelles avenues. Tous les arbres de la ville avaient été abattus au cours des Douze Difficiles Années, et à présent la ville était à peu près complètement dépourvue de végétation ; on avait planté de nouveaux arbres, qui étaient protégés par des chevaux de frise, et des hommes armés jusqu’aux dents montaient la garde autour toute la nuit, ce qui n’était pas toujours efficace. En se réveillant le matin, les pauvres vieux gardes trouvaient parfois les barrières mais pas l’arbre, qui avait été coupé et sans doute transformé en bois de chauffage, ou bien arraché avec les racines pour être vendu ailleurs, et ils pleuraient inconsolablement la disparition de leurs protégés et parfois même se suicidaient. La morsure de l’hiver tenaillait la ville dès l’automne, des pluies de boue, jaune à cause des poussières arrachées au lœss de l’ouest, ruisselaient sur la ville de béton sans qu’une seule feuille tombe sur le sol. On chauffait les pièces avec des radiateurs atmosphériques, mais les coupures de ki étaient fréquentes et pouvaient durer plusieurs semaines, alors tout le monde souffrait sauf les caciques du gouvernement, dont les domaines disposaient de générateurs. La plupart des gens se protégeaient du froid en bourrant leurs manteaux de papier journal, et c’était une population d’obèses empotés qui se déplaçait dans ces épais manteaux bruns, acceptant tous les petits boulots qu’ils trouvaient, l’air gras et rebondis comme des chapons bien nourris ; ce qui n’était pas le cas.
C’est ainsi que beaucoup de gens étaient mûrs pour le changement. Kung était aussi étique et affamé que la plupart d’entre eux, mais débordant d’énergie. On aurait dit qu’il n’avait plus besoin de nourriture ni de sommeil : il passait son temps à lire et à parler, à parler et à lire, et il allait à vélo de réunion en réunion, où il exhortait des groupes à s’unifier et à rejoindre le mouvement révolutionnaire initié par Zhu Isao pour changer la Chine.
— Écoutez ! disait-il d’un ton pressant à son auditoire. C’est la Chine que nous voulons changer parce que nous sommes chinois, mais si nous changeons la Chine, nous changerons le monde. Parce que tout revient toujours à la Chine, vous comprenez ? Nous sommes plus nombreux que tous les autres peuples de la Terre réunis. Et à cause des années de colonialisme impérial des Qing, toutes les richesses du monde ont afflué vers la Chine pendant de nombreuses années, en particulier l’or et l’argent. Pendant des dynasties entières, nous avons fait venir de l’or grâce au commerce, puis nous avons conquis le Nouveau Monde et pris leur or et leur argent, qui lui aussi est revenu à la Chine. Pas une seule piécette n’en est jamais repartie ! Si nous sommes pauvres, c’est à cause du système, vous comprenez ? Nous avons souffert pendant la Longue Guerre, mais ni plus ni moins que tous les autres pays, et le reste du monde se remet alors que nous pas, alors que nous avons gagné, et tout ça à cause du système ! L’or et l’argent sont cachés dans les coffres des bureaucrates corrompus et les gens gèlent et meurent de faim pendant que les bureaucrates se gobergent, bien au chaud dans leur tanière et le ventre plein. Et cela ne changera jamais si nous ne faisons rien !
Ensuite il expliquait les théories de Zhu sur la société : comment pendant de nombreuses et longues dynasties un système d’extorsion avait dominé la Chine et la majeure partie du monde, et comment, parce que les terres étaient fertiles et que les taxes des fermiers n’étaient pas accablantes, le système avait pu perdurer. Pour finir, cependant, une crise avait ébranlé les bases de ce système au sein duquel les dirigeants avaient proliféré, et la terre s’était tellement épuisée que les impôts étaient devenus trop lourds ; c’était alors une question de famine ou de révolte, et les fermiers s’étaient révoltés, comme souvent avant la Longue Guerre.
— Ils l’ont fait pour leurs enfants. On nous a toujours appris à honorer nos ancêtres, mais la tapisserie des générations s’étend dans les deux directions, et ce fut le génie du peuple que de commencer à se battre pour les générations à venir, de sacrifier leur vie pour leurs enfants, et les enfants de leurs enfants. C’est ainsi que l’on honore vraiment sa famille ! Et c’est pourquoi nous avons eu les révoltes des Ming et des Anciens Ming, et des soulèvements similaires un peu partout dans le monde, et que finalement les choses se sont cassé la gueule, tous se battant contre tous. Alors, même la Chine, la plus riche de toutes les nations de la Terre, a été dévastée. En attendant, la révolution continue. Nous devons mettre un terme à la tyrannie des dirigeants pour établir un nouveau monde basé sur le partage équitable des richesses entre tous. L’or et l’argent viennent de la terre, et la terre appartient à tous, tout comme l’air et l’eau. Il ne peut plus y avoir de hiérarchies comme celles qui nous ont opprimés pendant si longtemps. Le combat doit continuer, et chaque défaite n’est qu’une ornière inévitable dans la longue marche vers notre but.
Inévitablement aussi, quelqu’un qui passait des heures, tous les jours, à tenir ce genre de discours, comme Kung, devait finir par avoir de sérieux problèmes avec les autorités. En tant que capitale et plus grande cité ouvrière de la Chine, Beijing, qui avait moins souffert pendant la Longue Guerre que bien d’autres villes, disposait de nombreuses divisions de police militaire. Les murailles de la ville leur permettaient de fermer les portes et de procéder à des fouilles quartier par quartier. C’était, après tout, le cœur de l’empire. Les autorités pouvaient ordonner que l’on rase un quartier si l’envie les en prenait – ce qu’elles firent plus d’une fois. Des bidonvilles et même des quartiers tout ce qu’il y a de plus légaux furent rasés au bulldozer et reconstruits selon le plan standard des cités des unités de travail, dans l’intention de se débarrasser de tous les mécontents. Un boutefeu comme Kung était destiné à avoir des ennuis. Et c’est ainsi que, pendant l’an 31, alors qu’il avait à peu près dix-sept ans, et que Bao en avait quinze, il quitta Beijing pour les provinces du Sud afin d’apporter son message aux masses, ainsi que l’y avaient incité Zhu Isao et tous les autres cadres comme lui.
Bao le suivit. Il fourra dans un sac une paire de chaussettes en soie, une paire de chaussures bleues à semelle de cuir, une veste matelassée, un vieux costume à rayures, un pantalon uni, une serviette de toilette, des baguettes de bambou, un bol en laque, une brosse à dents et un exemplaire de L’Analyse du colonialisme chinois, de Zhu – et il partit.
Une année passa, pendant laquelle Bao apprit bien des choses sur la vie et les gens, et sur son ami Kung Jianguo. Les émeutes de l’an 33 étaient devenues une révolte générale contre la Cinquième Assemblée des Talents Militaires, tournant en fait à la guerre civile. L’armée essaya de garder le contrôle des villes, les révolutionnaires s’éparpillèrent dans les villages et dans les champs. Là, ils respectèrent des usages qui firent d’eux les favoris des fermiers. Ils se donnaient beaucoup de mal pour les protéger, eux, leurs récoltes et leurs animaux, ne réquisitionnant jamais ni leurs bicoques ni leur nourriture, préférant mourir de faim plutôt que de spolier les gens mêmes qu’ils s’étaient juré de libérer un jour.
Chaque bataille de cette étrange guerre diffuse avait une sorte de macabre qualité ; on aurait dit une série infinie de meurtres de civils. On ne voyait jamais d’uniformes ni de vraies batailles ; des hommes, des femmes, des enfants, des fermiers dans les champs, des marchands à la porte de leurs magasins, des animaux ; l’armée était sans pitié. Et pourtant, la révolution était en route.
Kung devint l’un des chefs importants du Collège Militaire Révolutionnaire d’Annan, dont le quartier général se trouvait dans la gorge du Brahmapoutre, mais qui s’étendait aussi à travers chaque unité de force révolutionnaire et dont les professeurs ou les conseillers s’efforçaient de tirer les leçons de chaque rencontre avec l’adversaire sur le terrain. Bientôt Kung prit la tête de cet effort, particulièrement quand il s’agissait de se battre pour des unités de travail urbaines ou côtières ; il était une source inépuisable d’idées et d’énergie.
La Cinquième Assemblée des Talents Militaires finit par abandonner le gouvernement central et éclata en plusieurs petites seigneuries. C’était une victoire, et pourtant chaque seigneur de la guerre (et sa petite armée) devait être défait l’un après l’autre. Le théâtre des opérations se déplaça donc de province en province, de façon erratique. Une embuscade ici, un pont dynamité là. Kung fut lui-même la cible de plus d’une tentative d’assassinat, et, naturellement, la vie de Bao, son camarade et son assistant, se trouva aussi menacée. Il se serait bien vengé de ces tentatives d’assassinat, mais Kung restait imperturbable.
— Bah, ça n’est pas grave. De toute façon, il faut bien mourir de quelque chose.
Il prenait cela avec un sourire que Bao ne lui avait jamais vu.
Bao ne devait voir Kung vraiment en colère qu’une seule fois, et même alors, il y avait quelque chose d’étrangement chaleureux dans sa colère, étant donné les circonstances. Cela se passa quand l’un de leurs propres officiers, un certain Shi Fandi (« Sus à l’Impérialisme ! »), fut convaincu par un témoin d’avoir violé et tué une prisonnière dont il avait la garde.
Shi avait jailli de la cellule où il était gardé en criant :
— Ne me tuez pas ! Je n’ai rien fait de mal ! Mes hommes savent que j’ai essayé de les protéger. La criminelle qui est morte était l’une des plus cruelles du Sechuan. Ce n’est pas juste !
Kung sortit de l’entrepôt où il avait dormi cette nuit-là.
— Pitié, commandant ! dit Shi. Ne me tuez pas !
— Shi Fandi, dit Kung. Pas un mot de plus ! Quand un homme fait quelque chose d’aussi grave que ce que tu as fait et que l’heure de mourir est venue pour lui, il devrait se taire et faire bonne figure. C’est la seule chose qu’il puisse faire pour préparer sa prochaine venue en ce bas monde. Tu as violé et tué une prisonnière. Trois témoins peuvent l’attester et c’est l’un des pires crimes qui soient. En outre, il y a des rapports disant que ce n’était pas la première fois. Te laisser en vie et donc te permettre de continuer à faire ce genre de chose ne servira qu’à te faire haïr des gens, et notre cause avec – ce qui ne serait pas bien. Je ne veux plus discuter avec toi. Je veillerai à ce que ta famille ne manque de rien. Essaie donc d’avoir un peu plus de courage.
— Plus d’une fois on m’a offert dix mille taels pour te tuer et je les ai toujours refusés, répondit Shi amèrement.
Kung eut un geste dédaigneux.
— Tu n’as fait que ton devoir, et pourtant tu crois que ça fait de toi quelqu’un de spécial. Comme si tu avais été obligé de résister à ton caractère pour faire ce qu’il fallait. Mais ton caractère n’est pas une excuse ! J’en ai marre de ton caractère ! Moi aussi, mon âme est en colère, mais c’est pour la Chine que nous nous battons ! Pour l’humanité ! Alors tu dois laisser ton caractère de côté et faire ce qu’il faut !
Et il s’en alla tandis que l’on emmenait Shi Fandi.
Après quoi Kung fut d’humeur maussade, n’éprouvant pas de remords pour la condamnation de Shi, se sentant juste déprimé.
— Il fallait le faire, mais cela n’a rien changé. Ce genre d’homme se retrouve souvent au sommet. Et ce sera probablement toujours pareil. Peut-être que la Chine n’échappera pas à son destin. Comme disait Zhu : « De vastes territoires, des ressources en abondance, un grand peuple – à partir d’aussi bonnes choses, sommes-nous condamnés à tourner en rond, piégés par la roue des naissances et des morts ? »
Bao ne savait pas quoi répondre ; il n’avait jamais entendu son ami tenir des propos aussi pessimistes. Pourtant, actuellement, tout cela lui paraissait assez familier. Kung était d’humeur changeante. Mais il finissait toujours par reprendre le dessus ; il soupira, se releva d’un bond.
— Enfin, il faut bien continuer ! Continuer, continuer ! Nous ne pouvons pas faire autrement que d’essayer. Il faut bien occuper sa vie d’une façon ou d’une autre. Alors autant nous battre pour le bien.
Ce fut l’alliance avec les fermiers qui fit la différence. Kung et Bao assistaient à des réunions nocturnes dans des centaines de villes et de villages, où des milliers de soldats révolutionnaires comme eux parlaient au peuple des analyses et des plans de Zhu. La plupart des gens, dans les campagnes, étaient de parfaits illettrés ; de sorte qu’on devait leur communiquer les informations de vive voix. Mais il n’y a pas de forme de communication plus rapide et plus efficace que le bouche à oreille, une fois passé un certain stade.
À cette époque, Bao se familiarisa avec tous les détails de la vie à la ferme. La Longue Guerre avait pris la plupart des hommes, et bien des femmes les plus jeunes. Où que l’on aille, il ne restait que quelques vieillards, et la population était encore inférieure à ce qu’elle avait été avant la guerre. Certains villages étaient abandonnés, d’autres habités par des squelettes en guenilles. Les semailles et les récoltes étaient donc particulièrement difficiles, et les rares jeunes passaient leur temps à travailler, s’assurant que les cultures qui leur permettraient de vivre jusqu’à la saison prochaine et de payer les taxes poussaient bien. Les vieilles femmes faisaient de leur mieux en dépit de leur âge, conformément à l’attitude impériale de toutes les fermières chinoises. Généralement, dans les villages, celles qui savaient lire et faire les comptes étaient les grand-mères qui, dans leur jeunesse, avaient été élevées dans des familles plus prospères ; maintenant, elles apprenaient aux plus jeunes à lire, à tisser et à traiter avec le gouvernement de Beijing. C’est pour cette raison qu’à chaque fois que l’armée d’un seigneur de la guerre envahissait leur région, elles étaient les premières à être tuées, en même temps que les jeunes gens qui prenaient part au combat.
Dans le système confucéen, les fermiers étaient la deuxième classe par rang d’importance et en terme de prestige, juste en dessous des bureaucrates et des lettrés, qui avaient inventé ce système, mais au-dessus des artisans et des marchands. À présent, les intellectuels de Zhu étaient en train d’organiser les fermiers dans l’arrière-pays, et les marchands et les artisans des villes attendaient de voir ce que cela allait donner. On avait l’impression que c’était Confucius lui-même qui avait identifié les classes révolutionnaires. Il y avait, à l’évidence, beaucoup plus de fermiers que d’habitants des villes. Aussi, quand les armées de fermiers commencèrent à s’organiser et à se mettre en marche, les survivants de la Longue Guerre ne purent pas y changer grand-chose. Ils avaient eux-mêmes été décimés et n’avaient ni les moyens ni la volonté de tuer des millions de leurs compatriotes. Pour la plupart, ils se réfugièrent dans les plus grandes villes et se préparèrent à les défendre comme s’ils étaient attaqués par les musulmans.
Pendant cette période difficile, Kung s’opposa à tous les assauts directs, défendant des méthodes beaucoup plus subtiles pour soumettre les derniers seigneurs de la guerre établis dans les villes. On coupa les lignes de ravitaillement de certaines cités, on détruisit leurs aéroports, on fit le blocus de leurs ports ; des tactiques de siège d’un genre éprouvé, remises à jour par les nouvelles armes de la Longue Guerre. En fait, il s’agissait d’une autre longue guerre, civile cette fois-ci, qui semblait fermenter alors que personne en Chine ne voulait d’une chose pareille. Même les plus petits enfants vivaient dans le désastre et dans l’ombre de la Longue Guerre et savaient qu’un nouveau conflit serait une catastrophe.
Kung rencontra le Lotus Blanc et d’autres groupes révolutionnaires dans les villes contrôlées par les seigneurs de la guerre. Chaque unité de travail, ou presque, avait en son sein des travailleurs favorables à la révolution et bon nombre d’entre eux se joignirent au mouvement de Zhu. En réalité, il n’y avait à peu près personne qui supportât de manière active et enthousiaste l’ancien régime. D’ailleurs, comment aurait-ce été possible ? Il était arrivé trop de choses. Pour que cela change, il n’y avait qu’à faire en sorte que tous les mécontents résistent de la même façon et appliquent la même stratégie. Et dans cet effort, Kung se révéla être un chef des plus influents.
— Dans de telles périodes, où les choses ont tellement besoin d’être repensées, disait-il souvent, tout le monde devient une sorte d’intellectuel. C’est la gloire de ces époques que de nous avoir réveillés.
Certaines de ces discussions et des réunions de l’organisation consistaient en de dangereuses visites en territoire ennemi. Kung était monté trop haut, il était allé trop loin au sein du mouvement de la Nouvelle Chine pour pouvoir être tout à fait à l’abri au cours de ces missions ; il était trop célèbre maintenant, et sa tête était mise à prix.
Un jour, au cours de la trente-deuxième semaine de l’an 35, Bao et lui rendirent clandestinement visite à leur vieux quartier de Beijing. Ils se cachèrent dans un camion de choux et descendirent non loin de la Grande Porte Rouge.
Ils virent aussitôt que tout avait changé : les quartiers qui se trouvaient juste aux portes de la ville avaient été rasés, et il y avait partout de nouvelles rues. Ils ne parvenaient pas à retrouver leurs marques près de la porte ; elles avaient disparu. À la place se dressaient un immense commissariat et de nombreux lotissements hébergeant des unités de travail alignées parallèlement à l’ancienne enceinte de la ville, que l’on voyait encore sur une certaine distance, de part et d’autre de la porte. Des arbres assez gros avaient été plantés aux nouveaux coins de rues, protégés par de lourdes grilles métalliques avec des piques en haut, et les jeunes arbres avaient l’air de bien se porter. Les fenêtres des dortoirs des unités de travail donnaient sur l’extérieur, ce qui était une nouveauté fort appréciée. Dans le temps, ces bâtiments n’avaient pas de fenêtres donnant sur le monde extérieur, et les seuls signes de vie n’étaient visibles que dans les cours intérieures. Maintenant, les rues elles-mêmes étaient pleines de marchands ambulants et de vendeurs de journaux à vélo.
— Ça a l’air bien ! dut reconnaître Bao.
Kung fit la grimace.
— Je préférais comme c’était avant. Allons voir ce qu’on peut faire.
Ils avaient rendez-vous dans une vieille unité de travail qui occupait plusieurs petits bâtiments juste au sud du nouveau quartier. Là-bas, les ruelles étaient toujours aussi étroites, et tout n’était que briques, poussière et boue, sans aucun arbre. Ils s’y promenèrent tranquillement, portant des lunettes de soleil et des casquettes d’aviateur, comme la moitié des autres jeunes gens. Personne ne fit le moins du monde attention à eux. Ils achetèrent à un coin de rue des nouilles dans des bols de papier qu’ils mangèrent au milieu de la foule et de la circulation, observant tout ce spectacle familier qui ne semblait pas avoir changé depuis qu’ils l’avaient quitté, un certain nombre d’années auparavant.
— Cet endroit me manque, dit Bao.
Kung était d’accord.
— Nous reviendrons bientôt, si nous voulons. Profite de Beijing, le cœur du monde.
Mais d’abord, ils avaient une révolution à finir. Ils se glissèrent dans l’un des ateliers de l’unité de travail et rencontrèrent un groupe de superviseurs dont la plupart étaient des vieilles femmes. Elles n’étaient pas du genre à se laisser impressionner par le premier gamin venu leur parler de changements énormes ; mais à cette époque-là, Kung était déjà célèbre, alors elles l’écoutèrent attentivement, et lui posèrent tout un tas de questions précises. Quand il eut fini d’y répondre, elles hochèrent la tête, lui tapotèrent l’épaule et le renvoyèrent dans la rue. Elles lui dirent qu’il était un gentil garçon, qu’il ferait mieux de quitter la ville s’il ne voulait pas se faire arrêter, et qu’elles le soutiendraient le moment venu. C’était toujours comme ça avec Kung : tout le monde sentait le feu qui brûlait en lui, et répondait de façon humaine. S’il avait réussi à convaincre les vieilles femmes de la Longue Guerre, alors rien n’était impossible. Bien des unités de travail étaient dirigées par ce genre de femmes, de même que les collèges et les hôpitaux bouddhiques. Kung savait tout à leur sujet, maintenant. « Le gang des veuves et des grand-mères », comme il les appelait.
— Des esprits très effrayants. Elles sont au-delà du monde, mais elles savent combien vaut un tael, et elles ne font pas de sentiment. Elles peuvent même se montrer très dures. Il y a souvent de bonnes scientifiques parmi elles, des femmes politiques très astucieuses ; mieux vaut éviter de les contrarier.
Il apprenait beaucoup à leur contact, et leur rendait hommage ; Kung savait où se trouvait le cœur du pouvoir, quelle que soit la situation.
— Si les vieilles femmes et les jeunes gens arrivent à s’entendre, alors, c’est gagné !
Kung en profita aussi pour aller à Tangshan, rencontrer Zhu Isao, le vieux philosophe en personne, et discuter avec lui de la campagne pour la Chine. Sous l’égide de Zhu, il s’envola pour le Yingzhou afin de s’y entretenir avec des représentants japonais et chinois de la Ligue du Yingzhou, y rencontrant aussi des Travancoriens. Puis il se rendit à Fangzhang. À son retour, il rapporta la promesse du soutien de tous les gouvernements progressistes du Nouveau Monde.
Peu après, l’une des grandes flottes hodenosaunees arriva à Tangshan et y débarqua de grandes quantités d’armes et de vivres. Des flottes semblables apparurent dans les ports de toutes les villes qui n’étaient pas encore sous le contrôle de la révolution, en faisant le blocus de fait, même s’il ne disait pas son nom, et les forces de la Nouvelle Chine purent, deux ans plus tard, entrer victorieusement à Shanghai, à Canton, à Hangzhou, à Nanjing, et partout dans les terres à l’intérieur de la Chine. L’assaut final sur Beijing consista plus en une entrée triomphale qu’en autre chose ; les soldats de la vieille armée disparurent dans la vaste ville ou dehors, dans leurs dernières forteresses du Gansu. Kung se trouvait avec Zhu dans les premiers camions d’une file géante de véhicules qui entra dans la capitale maintenant bien à eux. On les accueillit chaleureusement quand ils passèrent par la Grande Porte Rouge. C’était l’équinoxe de printemps qui marquait la nouvelle année 36. Plus tard, au cours de cette même semaine, ils ouvrirent la Cité Interdite au peuple, qui n’avait pu y aller qu’en de rares occasions auparavant, après la disparition du dernier empereur, quand pendant quelques années elle avait été un jardin public et des baraquements pour l’armée. Depuis quarante ans, elle avait été de nouveau fermée au public, qui, maintenant, s’y précipitait pour écouter Zhu et ses plus proches collaborateurs parler à la Chine et au monde. Bao était dans la foule qui les accompagnait, et quand ils passèrent la Porte de la Grande Harmonie, il put voir Kung regarder autour de lui, comme surpris. Kung secouait la tête, une drôle d’expression sur le visage ; expression qu’il avait toujours quand il montait sur l’estrade, à côté de Zhu, pour parler à la foule extatique massée sur la place.
Zhu était encore en train de parler quand des coups de fusil se firent entendre. Zhu tomba. Kung tomba. Et ce fut le chaos.
Bao se fraya un chemin à travers la foule hurlante jusqu’au milieu des gens qui entouraient les blessés, la plupart étant des hommes et des femmes qu’il connaissait, qui essayaient de rétablir l’ordre, de faire venir une assistance médicale et de les évacuer de la Cité Interdite pour les emmener à l’hôpital. L’un d’eux reconnut Bao et le laissa approcher. Bao se précipita maladroitement vers Kung. L’assassin s’était servi de ces grosses balles dum-dum que l’on avait mises au point pendant la guerre, et il y avait du sang partout sur l’estrade, un horrible flot de sang rouge, brillant. Zhu avait été touché au bras et à la jambe ; Kung à la poitrine. Il avait un grand trou dans le dos et son visage était gris. Il était en train de mourir. Bao s’agenouilla à côté de lui, prit sa main et l’appela par son nom. Kung semblait voir à travers lui ; Bao se demanda même s’il voyait quoi que ce soit.
— Kung Jianguo ! cria Bao.
Ces mots le déchirèrent comme jamais parole ne l’avait déchiré auparavant.
— Bao Xinhua, murmura Kung. Continue…
Ce furent ses dernières paroles. Il mourut avant même qu’on ne l’emmène de l’estrade.
2. Ce Sacré Furlong
Tout cela se passa alors que Bao était encore jeune.
Après l’assassinat de Kung, il n’alla pas bien pendant un certain temps. Il assista aux funérailles sans verser une larme ; il se croyait au-dessus de tout ça. C’était un pragmatique, seule comptait la cause, et la cause continuait. Il n’écoutait pas sa peine, et pensait qu’en fait il n’en avait pas. C’était bizarre, mais c’était comme ça. Ce ne pouvait être vrai, ce n’était pas possible. Il s’en était remis.
Il ne levait pas le nez de ses livres, lisant sans arrêt. Il suivit des cours au collège de Beijing, lut des livres d’histoire et de science politique, et accepta des postes diplomatiques pour le nouveau gouvernement, d’abord au Japon, puis au Yingzhou, puis à Nsara, puis en Birmanie. Le programme de la Nouvelle Chine continuait d’avancer, mais lentement, tellement lentement, sans changement visible de prime abord, même si ça allait généralement un peu mieux. C’était différent, et pourtant, par certains côtés, toujours pareil. Les gens continuaient à se battre, la corruption gangrenait les nouvelles institutions, le combat continuait. Tout était beaucoup plus long que prévu ; et pourtant, les années passant, tout changeait. L’histoire avançait sur un rythme lent qui n’avait rien à voir avec le temps des hommes.
Un jour, quelques années plus tard, il rencontra une femme appelée Pan Xichun, une diplomate du Yingzhou en poste à Beijing. Ils travaillaient l’un et l’autre pour la Ligue du Dahai, l’association des États entourant le Grand Océan, et dans le cadre de cette mission, ils avaient été envoyés par leurs gouvernements respectifs à une conférence à Hawaii, au beau milieu du Dahai. Là-bas, ils passèrent beaucoup de temps sur les plages, et quand ils rentrèrent à Beijing, ils étaient en couple. Pan Xichun était d’origine sino-japonaise, mais ses grands-parents avaient vécu au Yingzhou, à Fangzhang et dans la vallée juste derrière. Quand la mission de Pan se termina et qu’elle rentra chez elle, Bao s’arrangea pour être muté à l’ambassade chinoise de Fangzhang, et traversa le Dahai, vers les collines dorées et la spectaculaire côte verte du Yingzhou.
Il épousa Pan Xichun, et ils vécurent là pendant vingt ans. Ils eurent deux enfants, un garçon, Zhao, et une fille, Anzi. Pan Xichun accepta un poste de ministre du gouvernement du Yingzhou, ce qui l’amena souvent à se rendre à l’Ile-Longue, à Quito, ou dans les pays bordant le pourtour du Dahai. Bao, qui travaillait chez lui pour l’ambassade de Chine, s’occupait des enfants, écrivait et enseignait l’histoire au collège de la ville. La vie à Fangzhang, la plus belle et la plus extraordinaire de toutes les villes, était agréable. Parfois, Bao avait l’impression que sa jeunesse dans la Chine en révolution était une sorte de rêve très intense qu’il aurait fait jadis. Des chercheurs venaient de temps en temps le trouver pour s’entretenir avec lui, ce qui lui donnait l’occasion de se remémorer cette époque. À une ou deux reprises, il écrivit même quelques petites choses sur son expérience ; mais tout cela lui paraissait tellement loin…
Puis, un jour, il sentit une protubérance dans le sein droit de Pan Xichun ; le cancer. Un an plus tard, après avoir beaucoup souffert, elle mourut. Comme d’habitude, elle l’avait devancé.
Bao, éploré, se retrouva seul pour élever leurs enfants. Son fils, Zhao, qui était déjà presque adulte, trouva un travail en Aozhou, de l’autre côté de la mer, et Bao ne le vit plus que rarement. Anzi, sa fille, était plus jeune. Alors il fit de son mieux, engagea des jeunes filles au pair, mais d’une manière ou d’une autre il en fit un peu trop. Il était trop inquiet. Anzi, qui se disputait souvent avec lui, quitta leur maison dès qu’elle fut en âge de le faire, se maria, et ne le vit presque plus par la suite. D’une certaine façon, sans trop savoir comment, il avait aussi bousillé ça.
On lui proposa un poste à Beijing, alors il rentra. Mais c’était trop étrange. Il se sentait comme un prêta, se promenant dans le théâtre d’une vie passée. Il trouva un logement dans les quartiers ouest de la ville, de nouveaux quartiers qui ne ressemblaient en rien à ceux qu’il avait connus autrefois. Quant à la Cité Interdite, il s’interdit lui-même d’y aller. Il essaya de lire et d’écrire, pensant que s’il parvenait à tout coucher par écrit, alors ses fantômes le laisseraient tranquille.
Après plusieurs années de ce régime, il accepta un poste à Pyinkayaing, la capitale de la Birmanie, auprès de la Ligue de l’Agence de Tous les Peuples pour l’Harmonie Avec la Nature, en tant que représentant chinois et diplomate itinérant.
3. Écrire l’histoire birmane
Pyinkayaing se trouvait sur le canal ouest de l’embouchure de l’Irrawaddy, la grande route fluviale birmane, maintenant urbanisée sur la totalité de son delta, formant une énorme ville côtière – un agrégat de villes qui remontait vers Henzada sur tout le long de chacun de ses bras et, de là, suivait le fleuve jusqu’à Mandalay. Pyinkayaing était la mégalopole dans toute sa splendeur. Les bras du fleuve se jetaient dans la mer comme de grandes avenues, bordées d’incroyables touffes de gratte-ciel pareilles à de profonds canyons, parcourues par des centaines de rues et de ruelles qui reliaient ses nombreux canaux, formant une étonnante résille d’eau, de verre et de béton.
L’appartement de fonction de Bao était situé au cent soixantième étage de l’un des gratte-ciel dressés sur le canal principal de l’Irrawaddy, non loin du front de mer. Quand il sortit pour la première fois sur son balcon, il fut abasourdi par la vue et passa presque tout un après-midi à regarder le paysage : la mer au sud, Pagoda Rock à l’ouest, les autres embouchures de l’Irrawaddy à l’est, et en amont, dominant les toits de la mégalopole, les millions d’autres fenêtres des gratte-ciel qui bordaient le fleuve et s’étageaient sur le reste du delta. Les fondations des bâtiments plongeaient profondément dans le sol sédimentaire du delta jusqu’au lit de roche. Un célèbre système de barrages, d’écluses et de brise-lames protégeait la ville contre les inondations venant de l’amont, les marées hautes et les raz-de-marée de l’océan Indien, et les typhons. En réalité, la montée du niveau de la mer, déjà amorcée, ne menaçait pas fondamentalement la ville, qui était une sorte de collection de vaisseaux amarrés de façon permanente au lit de roche, de sorte que si, finalement, les habitants devaient abandonner leur « rez-de-chaussée » pour monter avec la mer, ce ne serait qu’un défi technologique supplémentaire, quelque chose qui occuperait l’industrie du bâtiment pendant les années à venir. Les Birmans n’avaient peur de rien.
En regardant en bas les petites jonques et les taxis d’eau tracer leur délicate calligraphie blanche sur les eaux bleues mêlées de brun, Bao avait l’impression d’y lire une sorte de message quasi surnaturel. Il comprenait maintenant pourquoi les Birmans écrivaient « l’histoire birmane » ; parce que c’était peut-être vrai : tout ce qui avait jamais été n’avait été que pour entrer en collision, ici, et donner naissance à quelque chose de plus grand que la somme de ses éléments. Comme quand les sillages de plusieurs taxis d’eau se rencontraient, projetant un geyser d’eau blanche plus haut que n’importe quelle vague n’aurait réussi à s’élever.
Cette cité monumentale, Pyinkayaing, devint le foyer de Bao pendant les sept années suivantes. Il traversait la rivière en télécabine pour aller au bureau de la Ligue pour l’Harmonie Avec la Nature. Là, il s’occupait des problèmes qui commençaient à pourrir le monde, causant de tels dégâts que même la Birmanie risquait d’en souffrir un jour, à moins que l’on n’envoie Pyinkayaing sur la Lune, ce qui ne semblait pas impossible étant donné leur énergie et leur confiance inébranlables.
Mais ils ne constituaient pas une puissance depuis assez longtemps pour avoir vu dans quel sens tournait la roue. Au fil des ans, et dans son travail, Bao avait visité une centaine de pays et beaucoup lui rappelaient que sur le long terme les civilisations s’élevaient et retombaient ; et que la plupart de celles qui retombaient ne se relevaient jamais vraiment. La scène du pouvoir se déplaçait à la surface de la Terre, suivant le soleil, comme un pauvre immortel incapable de tenir en place. La Birmanie n’était probablement pas à l’abri de ce destin.
Bao volait maintenant dans les navettes spatiales dernier cri, sillonnant la haute atmosphère comme les obus d’artillerie de la Longue Guerre, et se posait de l’autre côté du globe trois heures plus tard. Il prenait aussi les avions géants qui transportaient encore le gros des passagers et des marchandises tout autour du monde, dont la lenteur était plus que compensée par la capacité, et qui vrombissaient dans l’océan des airs comme de grands vaisseaux, apparemment insubmersibles. Il s’entretenait avec des représentants de la plupart des pays de la Terre, et finit par se dire que leurs problèmes d’harmonie-avec-la-nature étaient en partie dus à une question de nombre, la population de la planète ayant recommencé à croître si fortement, depuis la Longue Guerre, qu’elle frôlait maintenant les huit milliards d’habitants. C’était peut-être plus que la planète ne pouvait en supporter. Tel était du moins ce que disaient bien des savants, surtout les plus conservateurs, de tempérament quasi taoïste et que l’on trouvait principalement en Chine et au Yingzhou.
Mais aussi, au-delà de la simple question du nombre, il y avait le problème de l’accumulation des biens et de la répartition des richesses. Des gens de Pyinkayaing pouvaient organiser sans états d’âme une fête à Ingali ou Fangzhang, jetant dans un week-end de plaisirs dix années de revenus d’un salarié maghrébin, alors qu’il y avait en Franji et en Inka des gens qui souffraient encore fréquemment de malnutrition. Cette disparité persistait en dépit des efforts de la Ligue de Tous les Peuples et des mouvances égalitaires, en Chine, en Franji, à Travancore et au Yingzhou. En Chine, le mouvement égalitaire n’était pas seulement issu de la vision de Zhu, mais aussi des théories taoïstes de l’équilibre, comme le rappelait toujours Zhu. À Travancore, il découlait de la notion bouddhiste de la compassion, au Yingzhou, de la croyance hodenosaunee en l’égalité de tous, et, en Franji, de l’idée de justice devant Dieu. Partout cette idée existait, mais le monde appartenait encore à une petite minorité de riches ; la fortune avait été accumulée pendant des siècles dans quelques mains, et les gens qui avaient eu la chance de naître dans ces vieilles aristocraties vivaient à l’ancienne, les droits des rois étant maintenant étendus aux riches de la Terre. L’argent avait remplacé la terre en tant qu’assise du pouvoir, mais le vieux Zhu avait raison : le comportement de l’humanité était encore régi par de vieilles lois qui définissaient à qui appartenaient la nourriture, la terre, l’eau, les richesses excédentaires, et le travail de huit milliards d’êtres. Si ces lois ne changeaient pas, la surface de la Terre pourrait bien n’être plus qu’une épave dont hériteraient les mouettes, les fourmis et les cafards.
Ainsi, Bao voyageait, parlait, écrivait, et voyageait encore. Il fit la majeure partie de sa carrière dans l’Agence pour l’Harmonie Avec la Nature, et pendant des années il essaya de coordonner les efforts dans le Vieux Monde et le Nouveau pour préserver certains des plus grands mammifères. Beaucoup étaient menacés de disparition, et si on ne faisait rien, la plupart seraient victimes d’une extinction anthropogénique comparable aux effondrements massifs dont on retrouvait la trace dans les enregistrements fossiles.
Il rentrait de ces diverses missions diplomatiques après avoir voyagé dans ces grands nouveaux avions qui étaient une combinaison de dirigeables et d’avions, d’hovercrafts et de catamarans, qui filaient sur l’eau ou dans l’air en fonction des conditions climatiques et de leur cargaison. Il regardait le monde depuis son appartement de Pyinkayaing et voyait la relation de l’homme à la nature s’écrire en signes cabalistiques dans les sillons des taxis d’eau, des avions et dans les grands canyons formés par les gratte-ciel. C’était son monde, changeant année après année. Quand il allait en visite à Beijing et qu’il essayait de se rappeler sa jeunesse, ou à Kwinana, en Aozhou, voir son fils Zhao et sa famille, ou même quand il essayait de se rappeler Pan Xichun, il avait le sentiment que ces choses étaient parties, complètement parties, mangées par les années. Une fois, même, il alla à Fangzhang, où il avait vécu tellement de temps, et c’est à peine s’il put se remémorer ce qui s’y était passé. Ou, pour être plus précis, il se rappelait bien des choses, mais c’était comme si elles étaient arrivées à quelqu’un d’autre que lui. Comme si elles avaient été des incarnations précédentes.
Quelqu’un dans les bureaux de la Ligue proposa d’inviter Zhu Isao à venir donner des cours aux employés de la Ligue et à tous ceux qui auraient envie d’y assister. Bao fut surpris. Il avait fini par se dire que Zhu devait être mort. Cela faisait tellement de temps qu’ils avaient changé la Chine tous ensemble ; et Zhu était déjà vieux, à l’époque. En fait, il s’avéra que c’était une erreur de jeunesse de la part de Bao. On lui dit que Zhu avait maintenant quatre-vingt-dix ans, ce qui voulait dire qu’il n’en avait qu’une soixantaine à l’époque. Bao rit en pensant à son erreur d’appréciation, si caractéristique de la jeunesse. Il fut l’un des premiers à s’inscrire à ses cours, et il était très impatient d’y assister.
Zhu Isao se révéla être un vieil homme enjoué, aux cheveux blancs, petit, mais pas plus que pendant toutes ces années, avec quelque chose de curieux et de pétillant dans le regard. Il serra la main de Bao quand Bao alla le trouver, juste avant le début de son cours, et lui adressa un sourire léger mais amical.
— Je te reconnais, dit-il. Tu étais l’un des officiers de Kung Jianguo, n’est-ce pas ?
Bao lui serra très fort la main, en hochant la tête. Il alla s’asseoir avec une impression de chaleur. Le vieil homme avait toujours en marchant l’ombre d’une claudication qui datait de ce jour funeste. Mais il était heureux de revoir Bao.
Son premier cours consista en une exposition du plan de ses leçons, dont il espérait qu’elles seraient une suite de conversations sur l’histoire, une discussion sur la façon dont elle se construisait, ce qu’elle signifiait, et comment ils pourraient s’en servir pour rechercher la trajectoire qui leur permettrait de surmonter les difficultés des prochaines décennies, « quand nous serons bien obligés, enfin, d’apprendre à habiter la Terre ».
Bao écouta le vieil homme en prenant des notes, tapotant sur le clavier de son scripto, comme beaucoup d’autres dans la classe. Zhu expliqua qu’il souhaitait d’abord décrire les différentes théories historiques qui avaient été proposées au travers des siècles, puis analyser ces théories, non seulement en les mettant à l’épreuve des événements présents, « ce qui est difficile dans la mesure où bien souvent nous nous souvenons des événements parce qu’ils ont été le point de départ de la plupart des théories », mais aussi en étudiant la façon dont ces théories sont structurées, et quelle sorte de futur elles impliquent.
— Ce sera d’ailleurs la principale utilisation que nous en ferons. Pour moi, ce qui compte dans l’histoire, c’est ce que nous pouvons y trouver d’utile, conclut Zhu.
Ainsi, au fil des mois, ils eurent une sorte de rituel, et tous les trois jours, le groupe se réunissait dans une pièce située en haut de l’un des bâtiments de la ligue dominant l’Irrawaddy : quelques vingtaines de diplomates, des étudiants du crû, et de jeunes historiens du monde entier, dont la plupart étaient venus à Pyinkayaing spécialement pour ce cours. Tous s’asseyaient et écoutaient parler Zhu. Et bien qu’il n’arrêtât pas de les encourager à prendre la parole, beaucoup se contentaient de l’écouter penser tout haut, l’incitant à aller plus loin en lui posant des questions.
— Oui, mais je suis venu vous écouter, moi aussi, objectait-il.
Quand vraiment ils insistaient, il devenait réticent :
— J’imagine que je dois être comme Pao Ssu, qui avait l’habitude de dire : « J’écoute très bien, j’écoute en parlant. »
C’est ainsi qu’ils parlèrent de la théorie des quatre civilisations rendue fameuse par al-Katalan ; de la théorie du choc des civilisations d’al-Lanzhou, qui supposait le progrès par le conflit (« théorie amplement justifiée, vous avouerez, vu le nombre de conflits et de progrès que la Terre a connus ») ; et de celles, similaires, de la conjonction, selon lesquelles certaines conjonctions, passées inaperçues, de développement, souvent dans des domaines sans rapports entre eux, avaient eu de grandes conséquences. Zhu leur exposa avec un petit sourire l’un des nombreux exemples de ces théories : l’introduction du café et de l’imprimerie à peu près au même moment dans l’Iran des califes, provoquant une grande diarrhée de littérature. Ils discutèrent de la théorie de l’éternel retour, qui faisait appel aux cosmologies hindoues et aux dernières découvertes en physique pour suggérer que l’univers était si vaste et si ancien que tout ce qui était possible ne s’était pas seulement déjà produit, mais s’était produit un nombre infini de fois.
— J’avoue que ça, c’est un peu inutile, si ce n’est pour expliquer ce fameux sentiment de déjà-vu…
Enfin, ils abordèrent les autres théories cycliques, fondées sur le cycle des saisons ou sur la vie du corps.
Il mentionna ensuite « l’histoire du dharma », ou « l’histoire birmane », c’est-à-dire une histoire croyant à la marche vers un but, qui se révélait au monde soit directement, soit à travers des plans pour l’avenir. Zhu leur parla également de « l’histoire du Bodhisattva », basée sur l’existence de civilisations plus avancées que les autres, et qui étaient revenues en arrière pour aider le monde à progresser – la Chine ancienne, Travancore, les Hodenosaunees, la diaspora japonaise, l’Iran –, toutes ces civilisations ayant été proposées comme de possibles exemples de cette théorie.
— Même si cela semble être plutôt une question d’appréciation individuelle ou culturelle ; ce dont on n’a pas besoin, en tant qu’historien, quand on cherche à établir un système. Ce serait donc un euphémisme que de les qualifier de tautologiques, parce qu’à vrai dire toute théorie est tautologique. Notre réalité elle-même est une tautologie.
Quelqu’un lança une question : étaient-ce les « grands hommes » ou les « mouvements de masse » qui constituaient les principales forces de changement ? Mais Zhu évacua aussitôt la question en disant que c’était un faux problème :
— Nous sommes tous de grands hommes, n’est-ce pas ?
— Vous, peut-être, murmura la personne assise juste à côté de Bao.
— Ce qui compte, ce sont les moments où nous nous exposons dans notre vie, quand les habitudes ne suffisent plus et qu’il faut faire des choix. C’est alors que tout le monde devient un grand homme, pour un temps ; et les choix faits à ces moments, qui se reproduisent bien trop fréquemment, se combinent pour faire l’histoire. En ce sens, je suppose que je me suis rangé du côté des masses, puisqu’il s’est agi d’un processus collectif, pour autant qu’on puisse en juger.
» Même si, bien sûr, l’expression « grands hommes » doit nous amener à nous poser la question des femmes ; sont-elles comprises dans cette expression ? Ou bien devrions-nous décrire l’histoire comme étant la chronique des femmes reprenant le pouvoir politique qu’elles avaient perdu avec l’introduction de l’agriculture et la création de richesses excédentaires ? La défaite graduelle et interminable du patriarcat compose-t-elle la plus grande partie de l’histoire ? Comme peut-être la défaite graduelle et incertaine de quelques maladies infectieuses, comme si nous nous étions battus contre des microparasites et des macro-parasites, hein ? Les cancrelats et les patriarches ?
Il sourit à cette idée et continua à discuter, à commenter le débat issu des Quatre Grandes Inégalités et autres concepts nés des travaux de Kang et d’al-Lanzhou.
Par la suite, Zhu consacra quelques cours à la description de divers « moments de changements de phase » de l’histoire, qu’il considérait comme signifiants – la diaspora japonaise, l’indépendance des Hodenosaunees, le passage du commerce terrestre au commerce maritime, l’épanouissement de Samarkand, et ainsi de suite. Il consacra également quelques cours à discuter du dernier mouvement à la mode chez les historiens et les spécialistes des sciences sociales qu’il appelait « l’histoire animale », l’étude de l’humanité en termes biologiques, ce qui en faisait non plus une question de religion ou de philosophie, mais plutôt une étude des primates luttant pour leur nourriture et leur territoire.
Après plusieurs semaine de cours, il dit :
— Maintenant nous sommes prêts à aborder quelque chose qui m’intéresse au premier chef ces temps-ci, qui n’est pas le contenu de l’histoire, mais sa forme.
» On voit tout de suite que ce que nous appelons l’histoire a au moins deux sens : d’abord ce qui est arrivé dans le passé, que personne ne peut connaître parce que ça disparaît avec le temps, et ensuite toutes les histoires que nous racontons sur ce qui s’est passé.
» Ces histoires sont de différentes sortes, évidemment, et des gens comme Rabindra et Blanc Sagace les ont catégorisées. D’abord, il y a les témoignages visuels et les chroniques des événements faites sur le vif, comprenant les documents et les témoignages – cette histoire-là est comme le blé dans les champs, non moissonnée, attendant d’être travaillée, attendant qu’on lui fournisse des débuts, des fins ou des causes. Ce n’est qu’après que viennent les histoires cuites, qui tentent de coordonner et de réconcilier les matériaux avec les sources, et qui ne se contentent pas de décrire mais analysent aussi.
» Encore plus tard viennent les travaux qui mangent et digèrent ces comptes rendus cuisinés, et tentent de révéler ce qu’ils font, leur relation à la réalité, comment nous nous en servons, ce genre de choses – les philosophies de l’histoire, les épistémologies, et ainsi de suite. Beaucoup de digestions utilisent des méthodes initiées par Ibrahim al-Lanzhou, même quand elles dénoncent ses résultats. Il y a assurément matière à revenir aux textes d’al-Lanzhou pour voir ce qu’il a à dire. Par exemple, dans un passage très utile, il souligne que nous pouvons faire la distinction entre les arguments explicites et, plus profondément, les préjugés idéologiques inconscients. Ces derniers peuvent être dévoilés en identifiant leur mode de narration. Le mode de narration utilisé par al-Lanzhou est inspiré de la typologie des genres d’histoires de Rabindra. C’est un mode plutôt simpliste, mais par bonheur, ainsi que le souligne al-Lanzhou, les historiens sont souvent des conteurs assez naïfs. Ils ont recours plutôt schématiquement à l’un ou l’autre des modes de narration de Rabindra, par opposition aux grands romanciers, comme Cao Xueqin ou Murasaki, qui les mélangent constamment. C’est ainsi qu’une histoire comme celle de Tan Oo, que certains appellent « l’histoire birmane », au sens littéral du terme dans ce cas, mais que je préfère appeler « l’histoire du dharma », est un roman dans lequel l’humanité se débat pour réaliser son dharma, s’améliorer, et progresser, génération après génération, se battant pour la justice – ce qui est fort louable. Cette histoire suppose que nous finirons bien par remonter jusqu’à la source des fleurs de pêcher. Ce sera alors l’avènement d’une ère de grande paix. Cette vision des choses réalise, dans le monde, le mythe du Nirvana hindou et bouddhique. Ainsi, l’histoire birmane, les contes de Shambala, et n’importe quelle histoire téléologique supposant que nous progressons tous d’une façon ou d’une autre, sont des histoires du dharma.
» L’opposé de ce mode est le mode ironique ou satirique, que j’appelle l’histoire entropique. Elle découle des sciences physiques, du nihilisme, et, via certaines vieilles légendes, du thème de la chute. Dans ce mode, tout ce que l’humanité essaie de faire échoue ou se retourne contre elle, et la combinaison de la réalité biologique et de la faiblesse morale, de la mort et du mal, signifie que rien dans les affaires humaines ne peut réussir. Poussé à l’extrême, cela mène aux Cinq Grands Pessimismes, au nihilisme de Shu Shen, ou à l’anti-dharma du rival de Bouddha, Purana Kassapa, et à des gens qui disent que tout est un chaos sans cause, et que, en gros, l’un dans l’autre, il aurait mieux valu ne jamais naître.
» Ces deux modes de narration constituent des extrêmes : l’un où l’on dit : Nous sommes les maîtres du monde et nous pouvons vaincre la mort, et l’autre où l’on dit : Nous sommes prisonniers du monde, et ne vaincrons jamais la mort. On pourrait penser que cela représente les deux seuls modes possibles, mais, entre ces extrêmes, Rabindra a identifié deux autres modes de narration, qu’il appelle la tragédie et la comédie. Deux modes métis et partiaux comparés à leur voisins absolutistes, et dont Rabindra disait qu’ils offraient tous les deux des possibilités de réconciliation. Dans la comédie, la réconciliation est celle d’individus entre eux, et avec la société au sens large. Le tissu de la famille avec la famille, de la tribu avec le clan – c’est comme ça que finissent les comédies, et c’est ce qui en fait des comédies : le mariage avec quelqu’un d’un clan différent, et le retour du printemps.
» Les tragédies proposent une forme de réconciliation plus sombre. Blanc Sagace dit qu’elles racontent l’histoire de l’humanité face à face avec la réalité elle-même, et donc face à la mort, la dissolution et l’échec. Les héros tragiques sont détruits, mais pour les survivants qui racontent l’histoire, il y a une élévation de la conscience, une prise de conscience de la réalité, et c’est valable en soi et pour soi, si sombre que puisse être la connaissance.
À ce moment de son discours, Zhu Isao s’interrompit, chercha Bao du regard dans la salle, et lui fit un signe de tête. Bien qu’il eût semblé qu’il parlait de choses abstraites, des formes que prenait l’histoire, Bao éprouva un pincement au cœur.
Zhu poursuivit :
— Maintenant, il me semble que, en tant qu’historiens, il vaut mieux ne pas se laisser emprisonner dans un mode ou un autre. C’est trop facile, et ça ne colle pas bien avec notre perception des événements. Nous devrions plutôt tisser une histoire aussi ouverte que possible ; ça devrait être comme le symbole du yin-yang des taoïstes, avec ces points de tragédie et de comédie ponctuant les champs plus larges du dharma et du nihilisme. Cette vieille figure est l’image parfaite de toutes nos histoires mises ensemble, avec le point noir de nos comédies déparant la lumière du dharma, et l’éclair de connaissance tragique émergeant des ténèbres du néant.
» L’histoire ironique en tant que telle, nous pouvons la rejeter tout de suite. Bien sûr que nous sommes mauvais, bien sûr que les choses vont mal. Mais pourquoi s’étendre là-dessus ? Et pourquoi faire comme si c’était toute l’histoire ? L’ironie c’est simplement que la mort marche parmi nous. Cela ne relève pas le défi, ce n’est pas la vie qui parle.
» Mais je suppose que nous devons aussi rejeter la version plus pure de l’histoire du dharma, le fait de transcender ce monde et cette vie, la perfection de notre façon d’être. Cela peut se produire dans le bardo, s’il y a un bardo, mais dans ce monde tout est mélangé. Nous sommes des animaux, la mort est notre destin. Au mieux, nous pouvons dire que l’histoire de l’espèce doit être réalisée autant que possible, comme le dharma, par un acte de volonté collectif.
» Reste les modes intermédiaires, la comédie et la tragédie… (Zhu s’arrêta, leva les mains, perplexe.) Et de cela, nous ne manquons assurément pas. Peut-être la façon de construire une histoire correcte est-elle de la mettre en perspective et de dire que, pour l’individu, en fin de compte, c’est une tragédie, et, pour la société, une comédie. Si nous y parvenons.
Zhu Isao avait clairement une prédilection pour la comédie. C’était un être social, il invitait toujours Bao et quelques autres élèves de la classe, dont le ministre de la Santé du Monde Naturel de la ligue, à venir dans l’appartement de fonction qu’il occupait. Ces réunions informelles étaient émaillées de ses éclats de rire et de sa curiosité dans tous les domaines. Même ses recherches l’amusaient. Il avait fait venir par bateau de nombreux livres de Beijing, et toutes les pièces de son appartement étaient aussi remplies qu’un entrepôt. À cause de sa conviction croissante que l’histoire aurait dû être l’histoire de tous ceux qui avaient vécu, il étudiait actuellement la biographie en tant que genre, et il avait chez lui de nombreux recueils de biographies. D’où le nombre phénoménal de volumes posés un peu partout en grandes piles instables. Zhu ramassa l’un des énormes volumes, presque trop lourd pour lui.
— C’est le premier tome, dit-il avec un sourire, mais je n’ai jamais retrouvé les autres. Un livre comme celui-ci n’est que l’antichambre de toute une bibliothèque non écrite.
Le recueil de biographies était un genre qui semblait avoir pris son essor, dit-il en tapotant affectueusement ses piles de livres, dans la littérature religieuse : collection de vies des saints chrétiens et des martyrs de l’islam, ou textes bouddhiques décrivant des vies à travers leurs longues suites de réincarnations, un exercice spéculatif que Zhu adorait manifestement :
— L’histoire du dharma dans ce qu’elle a de plus pur, une sorte de proto-politique. En plus, ces histoires peuvent être tellement drôles. Par exemple celles de Dhu Hsien : il prend tellement les choses au pied de la lettre qu’il essaye de faire coïncider exactement les dates de naissance et de mort de ses personnages, créant des enfilades d’acteurs historiques de premier plan, qu’il suit à travers plusieurs réincarnation, en prétendant, d’après leurs actes, qu’ils sont une seule et même âme. Mais il a tellement de mal à faire coïncider les dates qu’il doit intercaler d’étranges personnages pour que leurs vies s’enchaînent. Finalement, il est obligé de mettre au point une théorie, un principe de « travail acharné suivi de repos », afin de justifier que ces immortels alternent des vies de génie et de généraux avec des carrières de portraitistes mineurs et de savetiers. Mais les dates coïncident toujours ! fit Zhu avec un sourire extatique.
Il tapota d’autres piles gigantesques, représentatives du genre qu’il étudiait : Les Quarante-Six Transmigrations, de Ganghadara, le texte tibétain des Douze Manifestations de Padmasambhava, ce gourou qui avait amené le bouddhisme au Tibet ; et la Biographie du Gyatso Rimpoche, vies Une à Dix-neuf, qui récapitulait les dernières vies du Dalaï Lama (jusqu’à l’époque actuelle) ; Bao avait rencontré cet homme une fois et n’avait pas imaginé alors que sa biographie complète puisse occuper tant de volumes.
Zhu Isao avait aussi chez lui des exemplaires des Vies, de Plutarque, et les Biographies des femmes exemplaires, de Liu Xiang, à peu près contemporaines de Plutarque ; mais il admettait qu’il trouvait ces textes moins intéressants que les chroniques des réincarnations qui consacraient dans certains cas autant de temps de la vie de leur sujet dans le bardo et les cinq autres lokas qu’à leur vie humaine. Il aimait aussi l’Autobiographie du Juif errant, les Testaments de la jati Trivicum, et le magnifique volume des Deux Cent Cinquante-Trois Voyageurs, ainsi qu’une collection scabreuse, peut-être (probablement) pornographique intitulée Cinq Siècles de vie d’un voleur tantrique. Autant de volumes que Zhu décrivait à ses visiteurs avec un grand enthousiasme. Pour lui, ils étaient l’une des clés de l’histoire humaine, si tant est qu’une chose pareille existât : l’histoire vue comme une simple accumulation de vies.
— En fin de compte, tous les grands moments de l’histoire se sont déroulés dans la tête des gens. Les périodes de changement, ou clinamen, comme l’appelaient les Grecs.
Ce moment, disait Zhu, était le principe régulateur, et peut-être l’obsession de Vieille Encre Rouge, l’anthologiste de Samarkand qui avait collationné dans son compendium de réincarnations des vies choisies en fonction de leur clinamen : chaque entrée de son anthologie narrant un épisode où les sujets, toujours réincarnés sous des noms commençant par la même lettre et parvenus à des carrefours de leur vie, ne prenaient pas le chemin qu’on s’attendait à les voir suivre.
— J’aime cette idée des noms, remarqua Bao en feuilletant l’un des volumes de la collection.
— Eh bien, Vieille Encre Rouge explique en marge d’un de ses textes que ce n’est qu’un système mnémotechnique pour faciliter la lecture, et qu’en réalité, bien sûr, chaque âme revient avec toutes ses caractéristiques changées. Pas de « médaillon de ma mère », pas de marques de naissance, pas de noms qui en rappellent un autre – pas question que ses méthodes ressemblent à celles des vieux contes populaires, ah ça non !
Le ministre de la Santé du Monde Naturel l’interrogea sur une montagne de fascicules, et Zhu eut un sourire ravi. C’était en réaction à ces interminables sommes, expliqua-t-il. Il avait pris l’habitude d’acheter tous les livres sur lesquels il tombait dont le sujet semblait exiger qu’ils soient brefs, parfois si courts que leur titre tenait à peine sur le dos. D’où les Secrets d’un mariage réussi, ou Les Bonnes Raisons de croire en l’avenir, ou les Histoires pour ne plus avoir peur des fantômes.
— Mais j’avoue que je ne les ai pas lus. Ils ne sont ici qu’à cause de leur titre, qui dit tout. Ils pourraient aussi bien contenir des pages blanches.
Plus tard, sur son balcon, Bao s’assit à côté de Zhu pour regarder la ville couler en dessous d’eux. Ils buvaient des tasses et des tasses de thé vert en parlant de tout et de rien, et alors que la nuit avançait, et que Zhu semblait pensif, Bao lui demanda :
— Vous arrive-t-il de penser à Kung Jianguo ? Vous arrive-t-il encore de penser à cette époque ?
— Non. Pas très souvent en tout cas, reconnut Zhu en le regardant dans les yeux. Et vous ?
Bao secoua la tête.
— Je ne sais pas pourquoi. Ce n’est pourtant pas spécialement pénible, mais ça paraît tellement loin…
— Oui. Très loin.
— Je vois que vous avez gardé un boitillement de cette époque.
— Oui, en effet. Et ça ne me plaît pas. Je marche moins vite, et ce n’est pas si grave. Mais c’est toujours là. Je déclenche les détecteurs de métaux dans les zones de haute sécurité, fit-il en riant. Enfin, cela fait si longtemps. Il y a tellement de vies de ça – je les confonds toutes, pas vous ?
Et il eut un de ses fameux sourires.
L’un des derniers cours de Zhu Isao fut une discussion sur l’histoire, à quoi elle pouvait servir et comment elle pouvait les aider à surmonter leurs difficultés actuelles.
Zhu faisait preuve d’innovation dans ce domaine.
— Il se peut que cela ne serve à rien, dit-il. Même si nous parvenons à une compréhension complète de ce qui est arrivé dans le passé, nous sommes toujours limités dans nos actions présentes. D’une certaine façon, on peut dire que le passé a hypothéqué l’avenir, ou qu’il l’a acheté, ou ligoté, au moyen de lois, d’institutions et d’usages. Mais on a toujours intérêt à essayer d’en savoir le plus possible, ne serait-ce que pour imaginer de nouvelles façons d’avancer. Vous savez, la question du résiduel et de l’émergent, dont nous avons déjà parlé – chaque période de l’histoire serait composée d’éléments résiduels des civilisations passées et d’éléments émergents qui prendront une existence plus entière dans l’avenir –, cette question, donc, est une lentille à très fort grossissement. Et seule l’étude de l’histoire permet de faire cette distinction, si tant est qu’elle soit possible. Nous pouvons considérer le monde où nous vivons et nous dire : Ce sont des lois résiduelles de l’ère des Quatre Grandes Inégalités, auxquelles nous sommes toujours assujettis. Il faut en finir. D’un autre côté, nous pouvons considérer des faits moins familiers de notre époque, comme la propriété commune de la terre en Chine, et dire : Ce sont peut-être des facteurs émergents qui deviendront prééminents un jour. Ils ont l’air utiles ; je vais les soutenir. Puis, encore une fois, il peut y avoir des éléments résiduels qui nous ont toujours aidés et qu’il faut conserver. Ce n’est donc pas aussi simple que de dire : Ce qui est nouveau est bon, ce qui est vieux est mauvais. Il faut nuancer. Mais meilleure sera notre compréhension, plus affûté sera notre jugement.
» Je commence à penser que cette question de « propriétés émergentes tardives » qu’évoquent les physiciens, quand ils parlent de la complexité et des sensibilités en cascade, est un concept important pour les historiens. La justice est peut-être une propriété émergente tardive. Et peut-être pouvons-nous entrevoir les prémices de son émergence ; à moins qu’elle n’ait émergé il y a longtemps, chez les primates et les proto-humains, et ne commence à se réaliser dans le monde que maintenant, grâce aux possibilités offertes par la période post-pénurique. C’est difficile à dire.
Il eut de nouveau son fameux petit sourire.
— Et voilà un cours qui finit sur de bonnes paroles.
Sa dernière classe était intitulée : « Ce qui reste à expliquer », et consistait en une liste de questions qu’il tournait et retournait dans sa tête, après toutes ces années d’étude et de réflexion. Il fit des commentaires sur ces questions, mais pas beaucoup, et Bao dut écrire vraiment très vite pour les saisir au vol :
Ce qui reste à expliquer
Pourquoi y a-t-il des inégalités dans l’accumulation des biens depuis que l’histoire est l’histoire ? Qu’est-ce qui provoque et fait disparaître les ères glaciaires ? Le Japon aurait-il pu gagner sa guerre d’indépendance sans les effets combinés de la Longue Guerre, du tremblement de terre et de l’incendie qui a détruit Edo ? Où a fini l’or des Romains ? Pourquoi le pouvoir corrompt-il ? Les indigènes du Nouveau Monde auraient-ils pu survivre aux maladies du Vieux Monde ? Quand les premiers habitants sont-ils arrivés dans le Nouveau Monde ? Pourquoi les civilisations du Yingzhou et d’Inka sont-elles à des niveaux de développement tellement différents ? Pourquoi n’y a-t-il pas de théorie mathématique qui unifie la gravitation et la microprobabilité harmonique ? Sans le Kerala, Travancore aurait-il initié la période moderne et dominé le Vieux Monde ? Y a-t-il une vie après la mort, ou une transmigration des âmes ? L’expédition polaire de la cinquante-deuxième année de la Longue Guerre a-t-elle bien atteint le pôle Sud ? Qu’est-ce qui amène des gens bien nourris et à l’abri du besoin à réduire en esclavage et à la misère des gens qui meurent déjà de faim et vivent dans l’insécurité ? Si al-Germanie avait conquis le Skandistan, le peuple sami aurait-il survécu ? Sans les réparations prévues par la conférence de Shanghai, le monde de l’après-guerre aurait-il été plus paisible ? Combien de gens la Terre peut-elle nourrir ? Pourquoi le mal existe-t-il ? Comment les Hodenosaunees ont-ils inventé leur forme de gouvernement ? Quelle maladie, ou combinaison de maladies, a tué les chrétiens de Franji ? La technologie conditionne-t-elle l’histoire ? Les choses auraient-elles tourné différemment si l’émergence de la science, à Samarkand, n’avait pas été interrompue par la peste ? Les Phéniciens ont-ils traversé l’Atlantique pour aller dans le Nouveau Monde ? Des mammifères plus gros que le renard survivront-ils au prochain siècle ? Le Sphinx a-t-il des milliers d’années de plus que les pyramides ? Les dieux existent-ils ? Comment faire revenir les animaux sur Terre ? Comment faire pour mener une vie décente ? Comment léguer à nos enfants et aux générations suivantes un monde redevenu sain ?
Peu après ce dernier cours, il y eut une grande fête. Zhu Isao rentra à Beijing, et Bao ne le revit jamais.
Ils travaillèrent dur pendant les années suivant la visite de Zhu pour mettre sur pied des programmes susceptibles d’apporter des embryons de réponse à ces dernières questions. De même que les géologues avaient été grandement aidés dans leurs travaux par un cadre de réflexion basé sur le mouvement des plaques de coquille d’œuf brisée qu’est la croûte terrestre, les bureaucrates, les technocrates, les savants et les diplomates de la Ligue de Tous les Peuples furent aidés dans leurs travaux par les considérations théoriques de Zhu. Ça aide d’avoir un plan ! Comme disait toujours Zhu.
Et c’est ainsi que Bao sillonna le monde en tous sens, rencontrant des gens, leur parlant, aidant à mettre des structures en place, renforçant la trame et la chaîne des traités et des accords qui solidarisaient tous les peuples de la planète. Il travaillait sur toutes sortes de sujets, comme la réforme agraire, la gestion des massifs forestiers, la protection animale, les ressources en eau, la subvention des panchayats et le partage des richesses, égratignant les blocs calcifiés des anciens privilèges qui avaient survécu à la Longue Guerre et à tout ce qui était arrivé pendant les siècles précédents. Tout cela avançait très lentement, et les progrès se faisaient toujours à petits pas, mais Bao avait eu l’occasion de remarquer que des améliorations dans une partie du monde avaient souvent des répercussions positives ailleurs. C’est ainsi, par exemple, que l’instauration de panchayats en Chine et dans les États islamiques donnait de plus en plus de pouvoir à un nombre sans cesse croissant de gens, surtout aux endroits où était adoptée la loi du Travancore qui exigeait que deux membres sur cinq au moins des panchayats soient des femmes ; et cela avait, à son tour, réglé une bonne partie de la question agraire. En effet, comme bien des problèmes du monde venaient du fait qu’il y avait trop de gens qui se battaient pour trop peu de ressources, cultivées à l’aide de technologies trop rudimentaires, un autre résultat positif de la délégation des pouvoirs aux panchayats et aux femmes fut que le taux de natalité chuta en flèche. Le taux de renouvellement de la population était de 2,1 enfants par femme. Avant la Longue Guerre, le taux mondial était beaucoup plus proche de 5, et de 7 ou 8 dans les pays les plus pauvres. Maintenant, dans tous les pays où les femmes bénéficiaient de l’ensemble des droits préconisés par la Ligue de Tous les Peuples, le taux de renouvellement était tombé à moins de 3, et souvent à moins de 2 ; cela, combiné aux progrès de l’agriculture et autres technologies, augurait bien de l’avenir. C’était l’expression d’espérance ultime de la chaîne et de la trame, du principe des propriétés émergentes tardives. Il semblait, bien que tout aille très lentement, qu’ils puissent concocter une sorte d’histoire du dharma. Peut-être ; ce n’était pas très clair ; mais il y avait du boulot de fait.
Quelques années plus tard, quand Bao apprit dans le journal la mort de Zhu Isao, il gémit et jeta le journal par terre. Il passa la journée sur son balcon, se sentant inexplicablement vidé. En fait, il n’y avait pas de quoi pleurer. Mais plutôt de quoi se réjouir : le grand homme avait vécu cent ans ! Il avait aidé la Chine à changer, et le monde entier avec elle ; à la fin de sa vie, il donnait l’impression de beaucoup s’amuser, voyageant partout, et écoutant en parlant. Il semblait avoir trouvé sa place dans le monde.
Alors que Bao ne connaissait pas sa place dans le monde. Contemplant l’immense cité en dessous de lui, puis levant les yeux vers les grands canyons trempés de pluie, il se rendit compte qu’il vivait à cet endroit depuis plus de dix ans et qu’il n’en savait encore rien. Il n’arrêtait pas d’en repartir ou d’y revenir, regardant toujours les choses d’un balcon, mangeant dans les mêmes bouis-bouis, parlant à des collègues de la ligue, passant la plupart de ses matinées et de ses soirées à lire. Il avait près de soixante ans maintenant, et il ne savait ni ce qu’il faisait ni comment il était censé vivre. La gigantesque cité était comme une machine, ou un vaisseau à demi échoué dans les hauts-fonds. Cela ne l’aidait en rien. Il avait travaillé tous les jours en essayant de poursuivre les travaux de Kung et de Zhu, de comprendre l’histoire et de travailler dessus au moment même du changement, et aussi de l’expliquer aux autres, en écrivant et en lisant, en lisant et en écrivant, parce qu’il se disait que s’il arrivait à l’expliquer, alors il ne se sentirait pas aussi oppressé. Mais ça n’avait pas l’air de marcher. Il avait le sentiment que tous ceux qui avaient jamais compté pour lui étaient morts à présent.
Quand il réintégra son appartement, il trouva un message de sa fille Anzi sur l’écran de son scripto, le premier depuis longtemps. Elle avait eu une fille et demandait à Bao s’il voulait leur rendre visite et faire la connaissance de sa nouvelle petite-fille. Il répondit par l’affirmative et alla faire son sac de voyage.
Anzi et son mari Deng vivaient sur une colline, au-dessus de Shark Point, dans l’un des faubourgs populeux sur la baie de Fangzhang. Leur petite fille s’appelait Fengyun, et Bao prit un grand plaisir à l’emmener dans le tram et à la promener en poussette dans le parc au sud de la ville, au-dessus de la Porte d’Or. Quelque chose dans son expression lui rappelait très fortement Pan Xichun – la courbe de sa joue, son regard déterminé. Ces traits que nous transmettons. Il la regarda dormir. Des écharpes de brouillard roulaient dans la Porte d’Or, s’enroulaient autour de l’immense pont qu’ils venaient de construire. Il les observait en écoutant un maître de feng shui faire cours à une petite classe assise à ses pieds.
— Vous voyez que c’est le meilleur endroit de toutes les villes de la Terre, disait-il.
Ce qui paraissait assez vrai à Bao.
Même Pyinkayaing n’avait pas de perspective à côté de celle-ci. Les gloires de la capitale de la Birmanie étaient toutes artificielles, et sans elles, ce n’était qu’une embouchure de delta comme toutes les autres, contrairement à cet endroit sublime qu’il avait tellement aimé, dans une autre existence.
— … oh non, je ne crois pas, il aurait fallu être nul en géomancie pour situer la ville de l’autre côté du détroit. En dehors de considérations pratiques sur le tracé des rues, il y a le ki propre à cet endroit. Les veines du dragon sont trop exposées au vent et au brouillard, il vaut mieux que ça reste un parc.
La péninsule opposée faisait assurément un parc magnifique, avec ses mamelons verts, léchés par les vagues, miellés par le soleil qui filtrait à travers les nuages. Toute la scène était si vibrante, si magnifique, que Bao sortit le bébé de sa poussette pour la lui montrer ; il la présenta aux quatre directions ; et la scène se brouilla devant ses yeux comme si lui aussi était un bébé. Tout devint une ondulation de formes, de masses nuageuses, de couleurs brillantes, fluctuantes, vives et éclatantes, dépouillées de leur signification : de choses connues elles devenaient du bleu et du blanc en haut, du jaune en bas… Il se mit à trembler, se sentant tout drôle. C’était comme s’il avait regardé à travers les yeux du bébé ; et l’enfant semblait avoir un peu peur aussi. Alors il la remmena à la maison, et Anzi lui reprocha de l’avoir laissée prendre froid.
— En plus il faut la changer !
— Mais je le sais ! Je vais le faire !
— Non, c’est moi qui vais le faire. Toi, tu ne saurais pas.
— Mais bien sûr que je saurais ! Je t’ai assez souvent changée quand tu étais bébé.
Elle eut un reniflement réprobateur, comme si cela avait été grossier, une sorte de violation de son intimité. Il empoigna le livre qu’il lisait et sortit se promener, énervé. D’une manière ou d’une autre, il y avait toujours des tensions entre eux.
Rumeur de la grande ville. Les gratte-ciel pareils aux montagnes verticales du sud de la Chine se dressaient sur les îles de la baie, avalant jusqu’aux pentes du mont Tamalpi… La ville enserrait étroitement ces collines, la plupart du temps encore à l’échelle humaine, avec leurs maisons de un ou deux étages, et leurs toits aux coins retournés vers le ciel à la façon des maisons anciennes, comme autant de pagodes… C’était la cité qu’il avait aimée, la cité où il avait vécu, pendant des années, avec sa femme.
Il était donc un prêta, ici. Et comme n’importe quel fantôme affamé, il déambula de l’autre côté de la colline, vers l’océan, et il se retrouva bientôt dans le quartier où ils avaient habité du vivant de Pan. Il se promena un moment dans les rues sans but précis, et puis il finit par y arriver : son petit chez-lui.
Il s’arrêta devant la maison, un immeuble ordinaire, maintenant peint en jaune pâle. Ils avaient habité un appartement au dernier étage, toujours en plein vent, exactement comme maintenant. Il considéra le bâtiment. Il ne ressentait rien. Il essaya pourtant, il s’efforça de ressentir quelque chose : mais rien. La seule chose qu’il éprouvait était un étonnement devant le fait d’éprouver si peu de chose ; un sentiment plutôt fade et insatisfaisant face à quelque chose d’aussi important que son passé, mais c’était ainsi. Chaque enfant y avait eu sa propre chambre, tandis que Bao et Pan dormaient sur un futon déroulé dans le salon, le réchaud de la kitchenette à leurs pieds ; c’était un endroit pas plus grand qu’un plumier, vraiment, mais c’est là qu’ils avaient vécu, et pendant un moment ils avaient cru que ce serait toujours comme ça, le mari, la femme, le fils, la fille, dans leur petit nid de Fangzhang, et tous les jours pareils, toutes les semaines pareilles, en une ronde éternelle. Tel était le pouvoir de l’insouciance, le pouvoir que les gens avaient d’oublier l’inévitable travail du temps.
Il repartit vers la Porte d’Or, au sud, dans le brouhaha de la foule et le grincement des trams qui passaient sur la promenade surplombant l’océan. Quand il atteignit le parc qui dominait le détroit, il retourna à l’endroit où il s’était trouvé un peu plus tôt avec sa petite-fille, et il regarda à nouveau autour de lui. Tout resta pareil cette fois, tout conserva sa forme et son sens ; plus de fluctuations de couleurs, pas d’océan jaune. Cela avait été une étrange expérience, et il frissonnait en y repensant.
Il s’assit sur le muret dominant la mer et prit son livre dans la poche de son veston, un recueil de poésies traduites de l’ancien sanskrit. Il l’ouvrit au hasard, et lut ceci : « Les spécialistes du sanskrit considèrent ce poème du Sakuntala, de Kalidasa, comme le plus beau jamais écrit dans cette langue. »
Ramyani viksya madhurans ca nisamya sabdan
Paryutsuki bhavati yat sukhito pi jantuh
Tac cetasa smarati nunam abodhapurvam
Bhavasthirani jananantarasauhrdani
Même en plein bonheur l’homme est parfois touché par quelque chose
Serait-ce une chanson ?
Alors son cœur se gonfle sous le poids
D’un souvenir qui ne lui dit rien
Ce doit être qu’il se souvient
D’un endroit inaccessible où sont à présent ceux qu’il a aimés
D’une vie passée
Dont le squelette est là, encore en lui
Il leva les yeux, regarda autour de lui. C’était un endroit bizarre, cette grande porte donnant sur la mer. Il pensa : Je devrais peut-être rester là. Peut-être que ce jour me dit quelque chose. Fantôme affamé ou non, peut-être que c’est mon chez-moi. Peut-être qu’on ne peut pas éviter de devenir un fantôme affamé, où que l’on vive ; alors ça pourrait aussi bien être chez moi.
Il rentra chez sa fille. Un message était arrivé sur son scripto, de quelqu’un qu’il avait connu à l’époque où il vivait à Beijing. Cette vieille relation, qui habitait un village agricole du collège de Fangzhang, une centaine de lis à l’intérieur des terres, dans la grande vallée centrale, avait appris qu’il était en visite dans la région et lui demandait s’il voulait venir donner un cours ou deux – d’histoire de la révolution chinoise peut-être : les relations étrangères, le travail de la ligue, ce qu’il voulait… Grâce notamment à son association avec Kung, les étudiants le considéreraient comme une pièce vivante de l’histoire du monde. « Un fossile vivant, tu veux dire ! » fit-il en reniflant. Comme ce poisson qu’on avait récemment retrouvé dans un filet, au large de Madagascar, et dont l’espèce avait quatre cent millions d’années. Le vieux poisson-dragon, le cœlacanthe. Il répondit qu’il acceptait l’invitation, puis il écrivit à Pyinkayaing pour demander une prolongation de congé.
4. L’œuf rouge
Le collège se trouvait à l’ouest d’une ville appelée Putatoï. Celle-ci était située au bord de la Puta, un fleuve côtier torrentueux que suivait sur toute sa longueur un tunnel de chênes et d’arbrisseaux poussant sur une cicatrice alluviale qui balafrait la vallée. Laquelle était entièrement occupée par des rizières ; les fleuves descendant des montagnes avaient été détournés pour former un système élaboré d’irrigation, et le sol presque plan de la vallée avait été transformé en un système de larges terrasses inondées, s’étageant en escaliers, dont les marches faisaient à peine quelques pouces de hauteur. Les digues enserrant ces terrasses étaient lobées, afin de mieux résister à l’érosion, de telle sorte que le paysage ressemblait assez à ceux de l’Annam ou du Kampuchea, ou d’ailleurs du reste de l’Asie. Sauf qu’aux endroits où la terre n’était pas irriguée, elle était désespérément sèche. Des collines blondes comme les blés s’élevaient à l’ouest, formant la première des lignes côtières entre la vallée et la baie ; puis, à l’est, les hauts sommets des pics enneigés de la Montagne d’Or s’élevaient comme un lointain Himalaya.
Putatoï était nichée parmi les arbres, dans une grande étendue de vert et d’or. C’était un village de style japonais, avec des boutiques et des immeubles formant des îlots égrenés au fil de l’eau. De petits groupes de maisonnettes encerclaient le centre-ville sur la rive nord du fleuve. Après Pyinkayaing, cela paraissait petit, sans prétention endormi, vert, atone. Ce qui plaisait à Bao.
Les étudiants du collège venaient pour la plupart des fermes de la vallée, et étudiaient surtout pour devenir riziculteurs ou s’occuper des vergers. Les questions qu’ils posaient sur l’histoire de la Chine, pendant les cours de Bao, témoignaient d’une étonnante ignorance, mais elles avaient la fraîcheur et l’enthousiasme de la jeunesse. Ils ne se souciaient pas le moins du monde de savoir qui était Bao, ni de ce qu’il avait fait au cours de la Longue Guerre, il y avait si longtemps. Cela aussi plaisait à Bao.
Les étudiants plus âgés de son petit séminaire, spécialisés en histoire, étaient intrigués par sa présence parmi eux. Ils lui posèrent des questions sur Zhu Isao, bien sûr, mais aussi sur Kung Jianguo, et sur la révolution chinoise. Bao leur répondit comme s’il s’agissait d’une période de l’histoire qu’il avait particulièrement bien étudiée, et sur laquelle il aurait même écrit un livre ou deux. Il ne leur parlait jamais de ses propres souvenirs, et avait bien souvent le sentiment de ne pas en avoir à raconter. Ils le regardaient très attentivement quand il parlait.
— Ce qu’il faut que vous compreniez, leur dit-il, c’est que personne n’a gagné la Longue Guerre. Tout le monde a perdu, et personne ne s’en est encore remis.
» Rappelez-vous ce qu’on vous a appris : elle a duré soixante-sept ans, deux tiers de siècle, et l’on estime maintenant le nombre de morts à environ un milliard. Réfléchissez à ça : j’ai parlé à un biologiste, ici, qui travaille sur les questions de population, et qui s’est efforcé de calculer combien de personnes ont vécu depuis que l’histoire existe, du début de l’espèce humaine jusqu’à aujourd’hui.
Quelques étudiants rirent à cette idée.
— Vous n’en avez jamais entendu parler ? Il estime à quarante milliards environ le nombre d’êtres humains qui ont vécu depuis que notre espèce a vu le jour – même si, bien sûr, il n’y a pas de début précis, ce qui fait que tout cela n’est qu’un jeu de l’esprit. Mais cela veut dire que si quarante milliards d’êtres humains ont existé depuis les débuts de l’histoire, alors un sur quarante sont morts pendant la Longue Guerre. Cela fait un sacré pourcentage !
» Bon. Le monde entier a sombré dans le chaos, et nous vivons tous dans l’ombre de la guerre depuis si longtemps que nous ne savons même plus à quoi ressemble la vie en pleine lumière. La science continue de faire des progrès, dont beaucoup se retournent contre nous. Nous sommes si nombreux et il y a tellement d’usines mal foutues que nous empoisonnons la nature. Et si nous nous battons encore, on va tout foutre en l’air. Vous le savez probablement, la plupart des gouvernements le savent, la science est en mesure de fournir en très peu de temps des bombes extrêmement puissantes. Une bombe pour chaque ville, dit-on. Ce qui fait peser une menace sur la planète entière. Il suffirait qu’un seul pays essaie de posséder cette bombe pour que tous la veuillent à leur tour.
» Ce sont tous ces dangers qui ont inspiré la création de la Ligue de Tous les Peuples, dans l’espoir de créer un système susceptible de s’occuper des problèmes globaux. C’est venu dans la foulée des efforts de l’An Un, temps standard, et de tout le reste, pour former ce qui a été appelé depuis « la scientification » du monde, ou « la modernisation », ou « le programme hodenosaunee », entre autres appellations. Notre époque, en fait.
— Dans l’islam, ils n’apprécient pas du tout cela, fit remarquer l’un des étudiants.
— Oui, et cela a été un problème pour eux : comment réconcilier leurs croyances avec le mouvement de la science ? Mais nous avons vu les changements à Nsara s’étendre à travers presque toute la Franji, et une Franji unie implique qu’ils se sont tous entendus pour reconnaître qu’il existe plusieurs façons d’être un bon musulman. Quand votre islam est une forme de soufisme proche d’un bouddhisme qui ne dirait pas son nom, et que vous trouvez ça très bien, alors il vous est difficile de condamner les bouddhistes de la vallée voisine. Et c’est ce qui arrive dans bien des endroits. Tous les fils commencent à se nouer, voyez-vous. Bien obligés, si nous voulons survivre…
Quand il eut fini cette première série de cours, les professeurs d’histoire invitèrent Bao à rester, et à continuer. Après avoir bien réfléchi, Bao finit par accepter leur invitation. Le collège se consacrait essentiellement à l’étude de l’amélioration des rendements agricoles, tout en veillant à ce que l’homme vive de façon plus harmonieuse avec la nature. L’histoire pouvait y contribuer, et les professeurs d’histoire étaient plutôt sympathiques. Il se trouva qu’une célibataire de son âge, une assistante en linguistique, s’était montrée particulièrement amicale avec lui. Ils avaient mangé plusieurs fois ensemble, et avaient pris l’habitude de se retrouver pour déjeuner. Elle s’appelait Gao Qingnian.
Bao s’installa juste à côté de chez Gao dans une maisonnette qui venait justement de se libérer. C’était une maisonnette comme celles de Putatoï, de style japonais, aux cloisons minces et aux grandes baies vitrées, entourant une sorte de jardin communal. C’était un chouette petit quartier.
Le matin, Bao commençait par bêcher la terre et planter des légumes dans un des coins du jardin communal. Entre les maisonnettes, il voyait les grands chênes qui formaient une voûte au-dessus du fleuve, et, plus loin, les rizières vertes. Plus d’une centaine de lis au-delà, le sommet isolé du Miwok s’élançait à l’assaut du ciel, au sud du grand delta. Au nord-est un long escalier de rizières couvrait la vallée de vert. La côte s’étendait vers l’ouest, la Montagne d’Or à l’est. Il partait au collège sur une vieille bicyclette et faisait cours à ses élèves du séminaire sur de petites tables de pique-nique à côté du fleuve, sous les frondaisons de chênes gigantesques. De temps à autre, il louait un petit airboat et descendait le delta jusqu’à Fangzhang pour aller voir Anzi et sa famille. Bien que ses rapports avec Anzi fussent toujours aussi tendus et difficiles, ses visites répétées finirent par leur sembler normales et même, en un certain sens, constituer un rituel agréable. Elles ne semblaient se rattacher à rien dont ils se souvenaient, mais plutôt exister par elles-mêmes. Bien, disait Bao à Gao, je vais à Fangzhang me chamailler avec ma fille.
Amuse-toi bien, disait Gao.
La plupart du temps, il restait à Putatoï et faisait cours. Il aimait les jeunes et leur fraîcheur. Il aimait les gens qui vivaient dans le petit groupe de maisonnettes autour du jardin. La plupart des habitants travaillaient dans l’agriculture, soit dans les laboratoires d’agronomie et les champs expérimentaux du collège, soit à l’extérieur, dans les rizières et les vergers. C’est ce que les gens faisaient dans cette vallée. Les voisins lui donnaient tous des conseils sur la façon de cultiver son petit jardin, souvent des conseils contradictoires, ce qui n’était pas très rassurant compte tenu du fait qu’ils faisaient partie des experts mondiaux travaillant la question, et qu’il y avait peut-être plus de gens dans le monde qu’il n’y avait de quoi les nourrir. Mais ça aussi c’était une leçon, et même si ça l’ennuyait un peu, en même temps ça le faisait rire. Et il aimait ce travail, être assis dans la terre, arracher les mauvaises herbes et regarder pousser les légumes, en observant le Miwok de l’autre côté des rizières. Il gardait les enfants de certains des plus jeunes couples, commentait avec eux les événements en ville, et passait ses soirées sur les pelouses à jouer aux boules avec un groupe d’habitués.
Bientôt, la routine de cette vie s’imposa à lui comme s’il n’en avait jamais connu d’autre. Un matin, on lui demanda de garder une petite fille qui avait la varicelle. Alors qu’il la regardait mariner dans un bain d’avoine tiède, tapoter stoïquement l’eau avec son doigt et gémir occasionnellement comme un petit animal, il se sentit soudain emporté par une vague de bonheur : il était le vieux veuf du quartier, les gens faisaient appel à lui pour garder leurs enfants, et voilà !
Le vieux cœlacanthe !
Il y avait un homme comme ça à Beijing, qui vivait dans une anfractuosité du mur près de la Grande Porte Rouge, et qui réparait les chaussures en regardant les enfants dans la rue.
Le profond sentiment de solitude qui l’avait affligé depuis la mort de Pan commença à s’estomper. Même si les gens parmi lesquels il vivait n’étaient ni Kung, ni Pan, ni Zhu Isao, même si ce n’étaient pas les compagnons de son destin, juste des gens avec qui il s’était retrouvé par hasard, ils n’en étaient pas moins sa communauté. C’était peut-être comme ça que ça s’était toujours passé, le destin n’avait rien à voir là-dedans ; on se retrouvait simplement avec des gens autour de soi, et quoi qu’il puisse arriver dans l’histoire ou dans le vaste monde, pour l’individu c’était toujours une question de liens locaux – le village, le peloton, l’unité de travail, le monastère ou la madrasa, la zawiyya, la ferme, l’immeuble, le vaisseau ou le quartier –, ils formaient la véritable circonférence de son monde, une vingtaine de personnages, comme s’ils jouaient une pièce ensemble. Et à n’en pas douter, chaque distribution comportait les mêmes personnages, comme dans le théâtre nô, ou le théâtre de marionnettes. À présent, il incarnait le vieux veuf, celui qui gardait les enfants, le vieux poète, le vieux fonctionnaire, cassé, brisé, qui buvait du vin auprès du fleuve et chantait des chansons nostalgiques à la lune en gratouillant son jardin improductif avec une houlette. Ça le faisait sourire ; cela lui faisait plaisir. Il aimait bien avoir des voisins, et il aimait le rôle qu’il tenait parmi eux.
Le temps passa. Il continua à donner quelques cours en se débrouillant pour que ses classes aient lieu dehors, sous les chênes.
— L’histoire ! disait-il à ses élèves. Ce n’est pas une chose facile à appréhender. Il n’y a pas de façon simple de l’imaginer. La Terre tourne autour du Soleil, elle met trois cent soixante-cinq jours un quart à en faire le tour, tous les ans, année après année. Des milliers d’années ont passé comme ça. En attendant, une sorte de singe n’a pas arrêté de faire des choses, de croître et de se multiplier, s’emparant de la planète, en donnant sens à tout. Pour finir, une bonne partie de la matière et de la vie de la planète a été asservie, et puis cette espèce de singe s’est demandé quoi faire, en dehors du simple fait de survivre. Alors, ce singe s’est raconté des histoires sur la façon dont il en était arrivé là, ce qui s’était passé et ce que cela voulait dire.
Bao poussa un soupir. Ses étudiants le regardaient.
— Zhu voyait l’histoire comme une tragédie pour l’individu et une comédie pour la société. Au fil des longues pulsations de l’histoire, il pouvait y avoir réconciliation ; c’était la comédie. Mais chaque individu connaissait une fin tragique. Nous devons admettre que, quoi que nous puissions dire, pour l’individu, la mort est toujours une fin et une catastrophe.
Ses étudiants l’écoutaient, fascinés, parfaitement prêts à admettre tout cela, parce qu’ils avaient autour de vingt-cinq ans, alors qu’il en avait près de soixante-dix, et qu’ils avaient donc l’impression d’être immortels. Bao en avait conclu que c’était peut-être ce à quoi servaient les vieux dans l’évolution : ils fournissaient aux jeunes une sorte de bouclier psychique contre la réalité, les plongeant dans une sorte d’hypnose, de transe, qui leur permettait d’ignorer que l’âge et la mort les frapperaient à leur tour, et qu’ils pourraient être frappés par surprise. Une fonction très utile ! Qui avait en outre la vertu d’amuser les vieux, et d’ajouter un peu de sel à leur propre existence, pour leur rappeler de l’apprécier.
Le calme infondé de ses étudiants le faisait donc sourire.
— Bon, très bien, admettons qu’il y ait cette catastrophe et que les gens continuent de vivre. De vivre ! Ils tricotent les choses de leur mieux. Zhu Isao et mon vieux camarade Kung Jianguo avaient l’habitude de dire que chaque fois qu’une génération émergeait et se révoltait contre l’ordre établi pour essayer de rendre les choses un peu plus justes, elle était condamnée à échouer par certains côtés ; mais elle réussissait dans d’autres ; en tout cas, ça donnait du grain à moudre à la postérité, ne serait-ce que par la connaissance des difficultés traversées. Ce qui en faisait a posteriori une sorte de succès. Et permettait aux gens d’avancer…
Une jeune Aozhanienne venue là comme tant d’autres du bout du monde pour étudier l’agriculture avec les vieux du collège demanda :
— Mais puisque de toute façon nous nous réincarnons, pourquoi la mort est-elle donc si terrible ?
Bao prit une profonde inspiration. Comme la plupart de ceux qui avaient une éducation scientifique, il ne croyait pas à la réincarnation. C’était clair, ce n’était qu’une histoire, un vestige des vieilles religions. Et pourtant – comment expliquer ce sentiment de solitude cosmique, cette impression d’avoir perdu ses compagnons éternels ? Comment expliquer cette expérience à la Porte d’Or, lorsqu’il avait offert sa petite-fille aux quatre vents ?
Il y réfléchit tellement longtemps que ses étudiants commencèrent à échanger des regards. Et puis il répondit, avec circonspection :
— Bien, on va essayer quelque chose. Imaginez qu’il n’y ait pas de bardo. Pas de ciel, pas d’enfer ; rien après la mort. Pas de continuation de la conscience, ni même de l’âme. Imaginez que vous ne soyez qu’une expression de votre corps et que, quand il succombera finalement à un désordre et mourra, vous disparaîtrez pour de bon, complètement.
La fille et les autres le regardaient.
Il hocha la tête.
— Là, vraiment, il faut réenvisager ce que la réincarnation peut vouloir dire. Parce que nous en avons besoin. Nous en avons tous besoin. Et il pourrait y avoir un moyen de la reconceptualiser, de telle sorte qu’elle ait un sens, même si vous admettez que la mort du « soi » est réelle.
— Comment cela ? demanda la jeune femme.
— Eh bien, d’abord, évidemment, il y a les enfants. Nous nous réincarnons littéralement dans de nouveaux êtres, bien qu’ils soient un mélange de deux êtres préalables, deux êtres qui continueront de vivre dans les doubles échelles entrelacées qui se détachent et se recombinent, avant d’être retransmises aux générations suivantes.
— Mais ce n’est pas notre conscience.
— Non. Mais la conscience se réincarne d’une autre façon, quand les gens de l’avenir se souviennent de nous, utilisent notre langage et modèlent inconsciemment leur vie sur la nôtre, vivant une recombinaison de nos valeurs et de nos habitudes. Nous continuons de vivre dans la façon dont les gens de l’avenir pensent et parlent. Même si les choses changent tellement que seules les habitudes biologiques demeurent, elles sont réelles à cause de tout cela – peut-être plus réelles que la conscience, plus enracinées dans la réalité. Rappelez-vous, le mot réincarnation veut dire « retour à un nouveau corps ».
— Certains de nos atomes peuvent le faire au sens propre du terme, avança un jeune homme.
— En vérité, dans l’infinitude de l’éternité, les atomes qui faisaient partie de nos corps pendant un moment se déplaceront et seront incarnés dans d’autres vies sur cette Terre, et peut-être sur d’autres planètes, dans d’autres galaxies. Nous nous réincarnons donc de façon diffuse d’un bout à l’autre de l’univers.
— Mais ce n’est pas notre conscience, répéta obstinément la jeune femme.
— Pas la conscience, pas le soi, pas l’ego, l’enchaînement de pensées, le fleuve de la conscience, qu’aucun texte, qu’aucune image n’a jamais réussi à rendre – jamais.
— Mais je ne veux pas que ça finisse, dit-elle.
— Non. Et pourtant, cela finit. C’est la réalité dans laquelle nous sommes nés. Notre désir n’y changera rien.
— Le Bouddha dit que nous devrions renoncer à nos désirs, reprit le jeune homme.
— Mais ça aussi c’est un désir ! s’exclama la jeune femme.
— Alors, nous n’y renonçons jamais vraiment, acquiesça Bao. Ce que suggérait le Bouddha est impossible. Le désir, c’est la vie qui s’efforce de continuer à être la vie. Toutes les choses vivantes ont des désirs, les bactéries ont des désirs, la vie, c’est vouloir.
Les jeunes étudiants réfléchirent à cela. Il y a un âge, se disait Bao, en faisant appel à ses souvenirs, il y a une période de la vie où on est jeune, où tout semble possible, et où on veut tout ; on est simplement bouillonnant de désirs. On fait l’amour toute la nuit parce qu’on bouillonne de désir.
— Une autre façon de récupérer le concept de réincarnation, dit-il, est tout simplement de voir l’espèce comme un organisme. L’organisme survit et a une conscience collective propre – c’est l’histoire, ou le langage, ou la double échelle qui structure notre cerveau –, et peu importe en réalité ce qui arrive à l’une ou l’autre des cellules de cet organisme. En fait, leur mort est nécessaire pour que l’organisme reste en bonne santé et continue à vivre. Il s’agit de faire de la place pour de nouvelles cellules. En voyant les choses de cette façon, ça peut accroître le sentiment de solidarité et de devoir envers autrui. Cela permet de voir plus clairement que si une partie du corps souffre et qu’au même moment la partie qui commande à la bouche et au rire rit et proclame que tout va bien, qu’elle danse la tarentelle, comme ces anciens chrétiens quand ils perdaient leurs chairs par lambeaux, alors c’est qu’il est évident que cette espèce-créature ou cette créature-espèce est folle et ne peut faire face à sa propre maladie-de-mort. Cette vision des choses devrait permettre à un plus grand nombre de gens de comprendre que l’organisme doit essayer de se maintenir en bonne santé d’un bout à l’autre de son corps.
La jeune femme secouait la tête.
— Mais ce n’est pas la réincarnation non plus. Ce n’est pas ce que ça veut dire.
Bao haussa les épaules, laissant tomber.
— Je sais, je sais ce que vous voulez dire. Enfin, je crois. On dirait qu’il devrait y avoir quelque chose de nous qui dure. Et j’ai moi-même éprouvé plusieurs fois ce genre de sensation. Un jour, alors que j’étais à la Porte d’Or… (Il secoua la tête.) Mais il n’y a pas moyen de savoir. La réincarnation est une histoire que nous racontons, et à la fin, c’est l’histoire elle-même qui est la réincarnation.
Le temps passant, Bao en vint à comprendre qu’enseigner aussi était une forme de réincarnation, en ce sens que les années filaient, que les étudiants allaient et repartaient, de nouveaux jeunes, tout le temps, toujours du même âge, suivant le même cours ; les cours sous les chênes, réincarnés. Il en vint à apprécier cet aspect de la chose. Il commençait toujours son premier cours en disant :
« Regardez, nous revoilà… »
Ils ne savaient jamais ce qu’il fallait comprendre. La même réaction, chaque fois.
Il apprit, entre autres choses, qu’enseigner était la façon la plus rigoureuse d’apprendre. Il apprit à apprendre plus de ses étudiants qu’ils n’apprenaient de lui. Comme tant d’autres choses, c’était le contraire de ce que ça paraissait être, et les collèges existaient pour rassembler des groupes de jeunes gens, pour enseigner à quelques-uns de leurs aînés choisis les choses qu’ils savaient sur la vie, que les vieux professeurs auraient risqué d’oublier. Bao aimait donc ses étudiants, et les étudiait assidûment. Il avait l’impression que la plupart d’entre eux croyaient en la réincarnation ; c’était ce qu’on leur avait appris chez eux, même quand ils n’avaient pas reçu d’éducation religieuse à proprement parler. Ça faisait partie de leur culture, une idée récurrente. Alors ils soulevaient ce problème, et il en parlait avec eux, dans une conversation maintes fois réincarnée. Avec le temps, les étudiants ajoutaient à sa liste personnelle de nombreux exemples prouvant que la réincarnation était quelque chose de réel : on pouvait vraiment revenir dans une autre vie, les différentes périodes de la vie étaient des réincarnations karmiques, tous les matins on s’éveillait à une nouvelle conscience, et donc on se réincarnait dans une nouvelle vie.
Tout cela plaisait à Bao. Dans sa dernière vie, il avait essayé au quotidien de considérer son jardin du matin comme s’il le voyait pour la première fois, s’émerveillant de son étrangeté et de sa beauté. Pendant ses cours, il s’efforçait de parler d’une façon nouvelle de l’histoire, réenvisageant les choses sous un angle différent, ne se permettant pas de répéter ce qu’il avait dit auparavant ; c’était difficile, mais intéressant. Un jour, dans une de ses classes normales (c’était l’hiver et il pleuvait), il dit :
— Le plus difficile à saisir, c’est la vie quotidienne. Je pense que c’est ce qui fait le plus rarement l’objet de notations, et c’est ce dont on se souvient le moins – ce qu’on faisait les jours où l’on faisait des choses ordinaires, l’impression que cela faisait, les petites successions de moments, jusqu’à ce que les années aient fini de passer. Une question de répétition, ou de quasi-répétition. Rien, en d’autres termes, qui puisse être facilement systématisé, ce n’est ni le dharma, ni le chaos, ni même la tragédie ou la comédie. Rien que… le quotidien.
Un jeune homme au regard intense, avec de gros sourcils noirs, lança, comme pour le contredire :
— Mais tout n’arrive qu’une seule fois !
De cela aussi il devait se souvenir. Aucun doute, c’était vrai. Tout n’arrivait qu’une seule fois !
Et c’est ainsi qu’un jour particulier arriva : le premier jour du printemps, le jour un de l’an 87, un jour de fête, le premier matin de cette vie, la première année de ce monde. Bao se leva tôt avec Gao et alla avec quelques autres cacher des œufs peints et des bonbons dans l’herbe de la pelouse, de la prairie et des berges du fleuve. C’était un rite des habitants de leur petit cercle de maisonnettes. Chaque premier de l’an, les adultes allaient cacher des œufs qu’ils avaient peints la veille et des bonbons enveloppés dans des papiers métallisés aux couleurs chatoyantes, et, l’heure venue, le lendemain matin, tous les enfants du voisinage étaient lâchés dans la nature. Un panier à la main, les plus vieux courant devant les autres, bondissant de trouvaille en trouvaille, les entassant dans leur panier, les plus petits trébuchant rêveusement d’une grande découverte à la suivante. Bao avait appris à aimer ce matin-là, surtout le dernier tronçon de marche en aval du fleuve, vers le point de rendez-vous, après que tous les œufs et les bonbons ont été cachés : il baguenaudait dans les hautes herbes, humides. Il lui arrivait d’enlever ses lunettes. Alors, les vraies fleurs se confondaient avec les couleurs artificielles des œufs et des papiers de bonbons, piquetant le vert omniprésent, éclatant. Et la prairie et la rive du fleuve se transformaient en un tableau, ou un rêve : de l’herbe et des berges hallucinées, plus colorées et plus étranges que la nature ne l’avait jamais été.
Il refaisait donc cette promenade, comme il la faisait depuis tellement d’années maintenant, un bol de ciel d’un bleu parfait au-dessus de la tête, tel un autre œuf géant. L’air était frais, la rosée courbait les herbes. Il avait les pieds trempés. Les papiers brillaient à la périphérie de sa vision, d’un éclat plus vif que les années précédentes, se dit-il : bleu cyan, fuchsia, jaune citron, cuivre. Le niveau de l’eau de la Puta était particulièrement haut et bondissait par-dessus les déversoirs à saumons. Une biche et un faon se tenaient sur une hauteur, statues d’eux-mêmes, et le regardaient passer.
Il arriva au lieu de rendez-vous et s’assit tandis que les enfants couraient dans tous les sens à la recherche des œufs, en poussant des cris et des hurlements. Il se dit : Si tu vois que tous les enfants sont heureux, alors peut-être que ça ira, après tout.
De toute façon, il y a cette heure de plaisir. Les adultes se tenaient dans les parages, en buvant du thé vert et du café, en mangeant des gâteaux et des œufs durs, se saluant, s’embrassant.
« Bonne année ! Bonne année ! »
Bao s’assit dans une chaise longue et les regarda.
L’un des enfants qu’il gardait parfois, une petite fille de trois ans, s’approcha sans faire attention, distraite par le contenu de son panier.
— Tiens ! dit-elle en le voyant. N’œuf !
Elle prit un œuf rouge dans son panier et le lui fourra sous le nez. Il recula la tête, par prudence ; comme beaucoup des enfants du voisinage, celle-ci était venue au monde sous l’avatar d’une parfaite excitée, et il n’aurait pas été étonné qu’elle lui flanquât un coup sur le front avec l’œuf, juste pour voir ce qui allait arriver.
Mais, ce matin-là, elle était calme ; elle se contenta de tenir l’œuf entre eux deux pour qu’ils l’inspectent ensemble, l’un et l’autre absorbés dans sa contemplation. L’œuf était resté longtemps dans une solution de vinaigre et de teinture, et il était d’un rouge aussi vif que le ciel était bleu. Cercle de rouge dans un cercle de bleu, rouge et bleu, côte à côte…
— Très joli ! dit Bao en reculant la tête pour mieux le voir. Un œuf rouge, c’est signe de bonheur.
— N’œuf !
— Oui, oui. N’œuf rouge !
— Tiens, dit-elle en le lui fourrant dans la main.
— Hum ! Merci !
Elle s’éloigna. Bao regarda l’œuf. Il était vraiment très rouge – Bao ne se souvenait pas que la teinture l’était autant –, tacheté comme toutes les coquilles d’œuf quand on les teignait, mais d’un rouge très profond.
Le petit déjeuner champêtre touchait à sa fin, les enfants, assis un peu partout, mastiquant consciencieusement leurs trouvailles, les adultes ramassant les assiettes en carton. Tout était en paix. Bao regretta l’espace d’une seconde que Kung n’ait pas vécu pour voir cette scène. Il avait combattu pour quelque chose qui ressemblait à ce petit moment de paix, s’était battu, si plein de colère et de gaieté. Il aurait semblé juste qu’il vive pour voir ça. Enfin… juste, non. Non, il y aurait un autre Kung dans le village, un autre jour, peut-être cette petite fille, soudain tellement intense et grave. Ils se répétaient tous, à n’en point douter, encore et encore, la distribution tout entière : dans chaque groupe se trouvaient un Ka et un Ba, comme dans l’anthologie de Vieille Encre Rouge, Ka se plaignant toujours de son croassement de corbeau, de son feulement de félin, et de son cri de coyote, croa, croa, ce cri du ventre ; et puis Ba, toujours Ba, le baaanal bhaaa du buffle d’eau, le bruit du soc de la charrue fendant la terre, le bêlement de l’espoir et de la peur, l’os à l’intérieur. Celui à qui manquait tellement Ka, qui ressentait si douloureusement sa perte, mais par intermittence, quand la vie n’était pas assez forte ; celui aussi qui devait faire tout ce qu’il était possible de faire pour faire aller les choses en son absence. Allez, vivons ! Le monde était changé par les Kung, mais c’étaient les Bao qui l’empêchaient de se déliter, en bêlant tout du long. Et tous jouaient leur rôle, ensemble, accomplissant leur mission dans un dharma qu’ils n’arrivaient jamais tout à fait à comprendre.
Pour le moment, sa mission était d’enseigner. Troisième cours de cette année, le moment où il commençait à entrer dans le vif du sujet. Il était impatient de s’y mettre.
Il emporta l’œuf rouge avec lui dans sa maisonnette et le posa sur son bureau. Il mit ses papiers dans son havresac, dit au revoir à Gao, enfourcha son vieux vélo et prit la route pour le collège. Le sentier à bicyclette suivait la Puta, et les jeunes feuilles toutes neuves des arbres ombrageaient la route, de telle sorte qu’il y avait encore de la rosée sur le goudron. Les fleurs dans l’herbe lui rappelaient les œufs colorés et les bonbons. Les couleurs étaient comme saturées, le ciel particulièrement clair et d’une couleur intense pour la vallée, d’un bleu presque cobalt. L’eau opaque dans le fleuve était d’un vert de jade. Des chênes aussi gros que des villages surplombaient ses rives.
Il gara sa bicyclette et, avisant une bande de singes des neiges dans un arbre juste au-dessus de sa tête, la cadenassa à un piquet. Les singes adoraient faire rouler les bicyclettes sur la rive du fleuve et les pousser dans l’eau. Deux ou trois d’entre eux s’emparaient de la bicyclette, lui imprimaient un élan, et en avant ! Cela était arrivé à Bao plus d’une fois, jusqu’à ce qu’il achète une chaîne et un cadenas.
Il marcha le long du fleuve, vers la table de pique-nique où il disait toujours à ses classes de printemps de le retrouver. Jamais l’herbe ni les feuilles n’avaient été si vertes auparavant, d’un vert si profond qu’il en était soûlé. Il repensa à la petite fille et à son œuf, à la paix de la petite fête, chacun faisant ce qu’on faisait toujours en ce premier jour. Sa classe serait la même que d’habitude. Pour changer ! Ils étaient là, réunis sous le chêne géant, autour de la table ronde, et il s’apprêtait à s’asseoir et à leur dire tout ce qu’il pourrait de son expérience, essayant de la leur transmettre, partageant avec eux autant de bribes que possible de son savoir. Il leur dirait :
« Venez, asseyez-vous, j’ai des histoires à vous raconter, sur la façon dont les gens vont de l’avant. »
Mais il était là aussi pour apprendre. Et cette fois, sous les feuilles de jade et d’émeraude, il repéra une jeune femme d’une beauté frappante, une nouvelle élève, une étudiante de Travancore qu’il n’avait encore jamais vue, à la peau sombre, aux cheveux noirs, aux sourcils épais, aux yeux ardents, qui lui jeta un bref regard par-dessus la table.
Un regard acéré, plein d’un profond scepticisme ; et rien que par ce seul regard, il comprit qu’elle ne croyait pas aux professeurs, qu’elle ne leur faisait pas confiance, qu’elle n’était pas disposée à croire une seule des choses qu’il lui dirait. Il aurait beaucoup à apprendre d’elle.
Il s’assit avec un sourire et attendit qu’ils fassent silence.
— Je vois que nous avons une nouvelle élève, dit-il avec un hochement de tête poli en direction de la jeune femme.
Les autres étudiants la considérèrent avec curiosité.
— Si vous vous présentiez ?
— Bonjour, dit la jeune femme. Je m’appelle Kali.