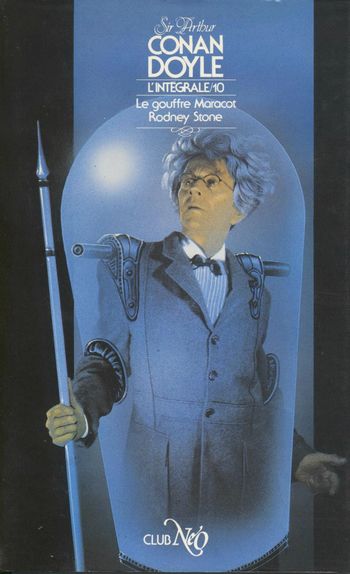
Arthur Conan Doyle
Le Gouffre Maracot
(OU LE MONDE PERDU SOUS LA MER)
(1928)
Table des matières
CHAPITRE PREMIER
CHAPITRE II
CHAPITRE III
CHAPITRE IV
CHAPITRE V
CHAPITRE VI
CHAPITRE VII
CHAPITRE PREMIER
Puisque ces papiers m’ont été remis en vue de leur publication, je commencerai par rappeler au lecteur le triste destin du Stratford. Ce navire avait appareillé l’an dernier pour une croisière dont le but était l’océanographie et l’étude des grands fonds marins. L’expédition était dirigée par le docteur Maracot, auteur réputé des « Formations pseudo-coralliennes » et de la « Morphologie des lamellibranches ». Le docteur Maracot était accompagné de Monsieur Cyrus Headley, ex-assistant à l’Institut de Zoologie de Cambridge, Massachusetts, et, à l’époque de la croisière, boursier à Oxford. Le capitaine Howie, marin expérimenté, commandait le Stratford et son équipage de vingt-trois hommes, parmi lesquels un mécanicien américain des Usines Merribank à Philadelphie.
Tout ce monde a disparu. La seule information reçue sur l’infortuné steamer provient d’un petit bateau norvégien dont les matelots ont vu sombrer, au cours de la grande tempête de l’automne 1926, un navire dont la description correspondait approximativement à celle du steamer. Un canot de sauvetage portant l’inscription Stratford a été découvert ultérieurement non loin du lieu de la tragédie, ainsi que des caillebotis, une bouée de sauvetage, et un espar. Ce rapport, la découverte qui a suivi, un long silence persistant, ont accrédité la conviction que l’on n’entendrait plus jamais parler du navire et des hommes qui se trouvaient à son bord. Un étrange message par sans-fil, capté le jour de la tempête, avait déjà pratiquement anéanti tout espoir. Je reviendrai sur ce message.
Certains détails assez remarquables à propos de la croisière du Stratford avaient suscité quelques commentaires : notamment l’excessive discrétion observée par le professeur Maracot. Certes, il était célèbre pour l’aversion et la méfiance qu’il vouait généralement à la Presse, mais jamais il ne les avait poussées jusque-là : il s’était refusé à donner le moindre renseignement aux journalistes, et il n’avait permis à aucun d’entre eux de monter à bord pendant que le steamer était ancré à l’Albert Dock. Par ailleurs des bruits avaient couru touchant une conception aussi nouvelle qu’insolite dans la construction du navire, conception destinée à l’adapter aux nécessités de l’exploration sous-marine. Ces bruits avaient trouvé confirmation aux chantiers Hunter and C° de West Hartlepool, où avaient été exécutées les modifications structurales. N’avait-on pas affirmé que tout le fond du steamer était détachable ? Pareille particularité avait attiré l’attention des assureurs des Lloyd’s, qui avaient éprouvé quelques difficultés à recevoir les apaisements qu’ils réclamaient. Et puis on n’en avait plus parlé. Mais ces détails revêtent maintenant une importance nouvelle puisque le sort de l’expédition revient, d’une manière absolument sensationnelle, au premier plan de l’actualité.
Passons à présent aux quatre documents se rapportant aux faits connus. Le premier est une lettre qui a été écrite de la capitale de la Grande Canarie par Monsieur Cyrus Headley à son ami Sir James Talbot, du Trinity College d’Oxford, la seule fois (d’après, du moins, ce que l’on sait) où le Stratford a touché terre après son départ de Londres. Le deuxième est l’étrange message par sans-fil auquel j’ai fait allusion. Le troisième est un fragment du journal de navigation de l’Arabella Knowles, qui concerne la boule vitreuse. Le quatrième et dernier est le contenu stupéfiant de ce réceptacle : ou bien il représente une mystification aussi cruelle que machiavélique, ou bien il ouvre un chapitre neuf de l’aventure humaine, dont l’importance ne saurait être exagérée.
Après ce préambule, je vais maintenant donner connaissance de la lettre de Monsieur Headley ; je la dois à la courtoisie de Sir James Talbot ; elle n’a jamais été publiée ; elle est datée du 1er octobre 1926.
* * *
Je poste ce courrier, mon cher Talbot, de Porta de la Luz, où nous avons relâché pour nous reposer quelques jours. Mon meilleur compagnon de voyage a été Bill Scanlan, chef-mécanicien ; je me suis lié tout naturellement avec lui, d’abord parce qu’il est mon compatriote et ensuite parce qu’il m’amuse. Toutefois ce matin je suis seul ; il a ce qu’il appelle « un rendez-vous avec un jupon ». Vous voyez qu’il s’exprime tout à fait comme un Américain de pure race.
Vous connaissez Maracot ; vous savez donc de quel bois sec il est fait. Je vous avais raconté, je crois, les circonstances de ma désignation ; il s’était renseigné auprès du vieux Somerville de l’Institut de Zoologie, qui lui avait envoyé mon essai couronné sur les crabes pélagiques, et l’affaire s’était trouvée conclue. Bien sûr, je ne me plains pas d’accomplir une mission aussi agréable, mais j’aurais préféré la faire avec quelqu’un d’autre que cette momie animée de Maracot. Il est inhumain dans son splendide isolement, et dans la dévotion qu’il consacre à son œuvre. « Le dur des durs », dit Bill Scanlan. Et pourtant on ne peut qu’admirer une dévotion aussi totale. Rien n’existe en dehors de sa science. Je me rappelle que vous aviez bien ri quand, lui ayant demandé ce que je devais lire pour me préparer, je m’étais entendu répondre que pour des études sérieuses il me recommandait l’édition complète de ses œuvres, mais que pour me détendre, les « Plankton-Studien » de Haeckel étaient tout indiqués.
Je ne le connais pas mieux aujourd’hui que lorsque je lui ai été présenté dans son petit salon avec vue sur le haut Oxford. Il ne dit rien. Son visage décharné, austère (le visage d’un Savonarole, à moins que ce ne soit celui de Torquemada) ignore la douceur ou la bienveillance. Le long nez maigre et agressif, les deux petits yeux gris très rapprochés qui luisent sous les sourcils en broussailles, la bouche aux lèvres minces, les joues creusées par une vie ascétique et une méditation constante ne constituent point une société relaxante. Il habite une cime mentale ; il s’y tient hors de l’atteinte des mortels ordinaires. Parfois je pense qu’il est un peu fou. Par exemple, ce truc extraordinaire qu’il a fabriqué … Mais je vais commencer par le commencement ; quand je vous aurai tout dit, vous jugerez par vous-même.
Je prends notre croisière à son départ. Le Strafford est un bon petit navire qui tient bien la mer, et qui a été spécialement équipé pour sa tâche. Douze cents tonneaux, des ponts bien dégagés, de larges baux, tout ce qu’il faut pour sonder, chaluter, draguer, remorquer. Il a aussi, naturellement, de puissants treuils à vapeur pour haler les chaluts, ainsi qu’un certain nombre de divers accessoires, les uns assez connus, les autres singuliers. En bas, nos cantonnements sont confortables, et un laboratoire est bien outillé pour nos travaux.
Nous avions déjà la réputation d’un bateau-mystère avant notre appareillage ; j’ai eu tôt fait de découvrir qu’elle n’était pas usurpée. Nos débuts ont été d’une banalité écœurante. Nous avons remonté la Mer du Nord et nous avons largué les chaluts pour deux ou trois raclages ; mais, comme la moyenne des fonds ne dépassait guère vingt mètres, et comme nous sommes équipés pour des profondeurs beaucoup plus considérables, j’ai eu l’impression que c’était là un gaspillage de temps. Quoi qu’il en soit, en dehors de poissons de table familiers, de chiens de mer, de calmars, de méduses, et de quelques dépôts alluvionnaires, nous n’avons rien amené qui vaille un rapport. Puis, nous avons contourné l’Écosse, aperçu les Feroë, et nous avons longé le banc de Wyville-Thomson où nous avons eu plus de chance. De là nous avons mis le cap au sud, vers notre propre champ de croisière, c’est-à-dire entre la côte d’Afrique et les Canaries. Nous avons failli nous échouer à Fuert-Eventura par une nuit sans lune ; cette alerte mise à part, notre voyage s’est déroulé sans le moindre incident.
Pendant ces premières semaines, j’ai essayé de gagner l’amitié de Maracot. Tentative difficile ! En premier lieu, il est l’homme le plus distrait et le plus absorbé qui soit au monde. Vous vous rappelez votre rire rentré quand vous l’avez vu donner un penny au liftier parce qu’il se croyait dans un autobus. La moitié du temps il se plonge dans ses pensées, et il a l’air de ne plus savoir où il est, ni pourquoi il est là. En deuxième lieu, je le trouve terriblement cachottier. Il travaille beaucoup sur des papiers et sur des cartes qu’il essaie de me dissimuler chaque fois que je pénètre dans sa cabine. Je crois fermement qu’il nourrit un dessein secret ; mais tant que nous serons susceptibles de relâcher dans un port, il ne le communiquera à personne. Telle est mon impression ; Bill Scanlan la partage. Bill est venu me trouver un soir dans le laboratoire où je vérifiais la salinité des échantillons de nos sondages hydrographiques.
— Dites donc, Monsieur Headley, à votre avis, qu’est-ce que ce type a dans la tête ? Qu’est-ce qu’il mijote ?
— Je suppose, ai-je répondu, que nous ferons ce qu’ont fait avant nous le Challenger et une douzaine d’autres navires d’exploration : nous ajouterons au répertoire des poissons quelques espèces nouvelles, et quelques précisions à la carte bathymétrique.
— Allons, allons ! Vous ne le jureriez pas sur votre vie ! En tout cas, si c’est là votre opinion, creusez-vous la cervelle pour trouver autre chose. D’abord, pourquoi suis-je ici, moi ?
— Pour le cas où les machines tomberaient en panne, non ?
— Zéro pour les machines ! Les machines du navire, c’est l’affaire de MacLaren, l’ingénieur écossais. Non, Monsieur, ce n’est pas pour m’occuper de ces machines à âne que les patrons de Merribank ont désigné leur meilleur spécialiste. Croyez-vous que je gagne cinquante dollars par semaine pour des prunes ? Venez par ici : je vais vous affranchir.
Il a tiré une clef de sa poche et il a ouvert une porte, au fond du laboratoire ; nous avons descendu une échelle jusqu’à une partie de la cale qui avait été complètement dégagée ; quatre objets volumineux et brillants émergeaient de la paille dans leurs caisses. C’étaient des feuilles plates d’acier avec des chevilles et des rivets compliqués le long des arêtes. Chaque feuille avait à peu près un mètre carré en surface, quatre centimètres d’épaisseur, et elle était percée en son milieu d’un trou circulaire de trente centimètres de diamètre.
— Qu’est-ce que c’est que ça ? ai-je demandé.
La physionomie peu ordinaire de Bill Scanlan (il ressemble à la fois à un comique de vaudeville et à un boxeur professionnel) s’est éclairée d’un sourire.
– Ça ? C’est mon bébé, Monsieur, a-t-il chantonné. Oui, Monsieur Headley, voilà pourquoi je suis ici. Il y a un fond en acier pour compléter ce truc, là, dans la grosse caisse. Et puis il y a un haut, comme un couvercle, avec un grand anneau pour une chaîne ou pour un câble. Maintenant, regardez le fond du navire …
J’ai vu une plateforme carrée, en bois ; elle avait des écrous à chaque angle ; elle était donc détachable.
— … Il y a un double fond, m’a expliqué Scanlan. Peut-être que le type est complètement cinglé ; peut-être en a-t-il plus dans la cervelle que nous le supposons. Mais si je devine juste, il a l’intention de construire une sorte de chambre (les fenêtres sont entreposées ici) et de la descendre par le fond du navire. Il a embarqué des projecteurs électriques ; je parie qu’il les disposera près des hublots ronds pour voir ce qui se promène tout autour.
— Il aurait pu étaler au fond du navire une feuille de cristal comme dans les bateaux de l’île Catalina, si c’était là son idée, ai-je murmuré.
— Vous m’ouvrez des horizons ! a répondu Bill Scanlan en se grattant la tête. La seule chose dont je sois sûr, c’est que j’ai été mis à sa disposition et que je dois faire de mon mieux pour l’aider dans ce truc idiot. Jusqu’ici il ne m’a rien dit ; je ne lui ai rien dit non plus ; mais j’ouvre l’œil, et si j’attends assez longtemps j’apprendrai tout ce qu’il y a à savoir.
Voilà comment j’ai mis le nez dans notre mystère. Ensuite nous avons traversé une zone de vilain temps ; après quoi nous avons traîné quelques chaluts en eau profonde au nord-ouest du cap Juby, juste à côté de la côte ; nous avons lu des températures et enregistré des salinités. C’est assez sportif, ce dragage dans l’eau profonde avec un chalut qui ouvre une gueule de six mètres de large pour avaler tout ce qui se trouve sur son chemin. Parfois il plonge à quatre cents mètres et ramène tout un éventaire de poissonnerie. Parfois, à huit cents mètres de fond, il récolte un lot tout à fait différent ; chaque couche océanique possède ses propres habitants, aussi distincts que s’ils vivaient dans des continents différents. Il nous est arrivé de remonter une demi-tonne de gélatine rose, la matière brute de la vie. Il nous est arrivé aussi de ramener une épuisette de limon qui sous le microscope se divisait en millions de petites boules rétiformes séparées par de la boue amorphe. Je ne vous fatiguerai pas avec les brotulides et les macrurides, les ascidies et les holothuries, les polyzoaires et les échinodermes. Vous pensez bien que nous avons agi en moissonneurs diligents de la mer. Mais j’ai eu constamment l’impression que Maracot ne s’intéressait guère à ce travail, et qu’il avait d’autres plans dans sa momie de tête. J’aurais parié qu’il expérimentait ses hommes et son matériel avant de se lancer dans une entreprise d’envergure.
J’en étais à cet endroit de ma lettre quand je me suis rendu à terre pour une dernière petite marche à pied, car nous appareillons demain matin de bonne heure. J’ai d’ailleurs aussi bien fait : sur la jetée une bagarre menaçait, et Maracot avec Bill Scanlan s’y trouvaient fortement compromis. Bill est un peu boxeur, et il possède ce qu’il appelle le K. O. dans chaque mitaine ; mais ils étaient entourés d’une demi-douzaine d’indigènes du cru armés de couteaux, et il était temps que je misse mon grain de sel. Le Professeur avait loué l’une de ces boîtes locales baptisées fiacres, il s’était fait voiturer sur la moitié de l’île pour en examiner la géologie, mais il avait complètement oublié d’emporter de l’argent sur lui. Au moment de payer la course, il n’avait pu se faire comprendre par ces rustres, et le cocher lui avait chapardé sa montre pour être sûr de ne rien perdre. Sur quoi, Bill Scanlan était entré en action. Mais ils se seraient retrouvés étendus pour le compte avec le dos comme des pelotes à épingles si je n’étais intervenu avec quelques dollars. Tout s’est bien terminé, et pour la première fois Maracot s’est montré humain. De retour à bord, il m’a introduit dans la petite cabine qu’il s’est réservée, et il m’a remercié.
– À propos, Monsieur Headley, m’a-t-il demandé, je crois que vous n’êtes pas marié ?
— Non, Monsieur. Je ne suis pas marié.
— Vous n’êtes pas non plus chargé de famille ?
— Non.
— Bravo ! s’est-il exclamé. Je ne vous ai pas encore parlé du but précis de cette croisière parce que, pour certaines raisons, je désirais le garder secret. L’une de ces raisons était que je craignais d’être devancé. Quand un projet scientifique court les rues, on risque de se voir servi comme Scott l’a été par Amundsen. Si Scott avait été aussi muet que moi, ç’aurait été lui, et non Amundsen, qui aurait planté le premier drapeau au pôle sud. Pour ma part, j’ai un dessein aussi important que le pôle sud ; voilà pourquoi j’ai observé le silence. Mais maintenant nous sommes à la veille de notre grande aventure, et aucun concurrent ne dispose du temps nécessaire pour me voler mon idée. Demain nous partons vers notre but.
— Qui sera ? … lui ai-je demandé.
Il s’est penché en avant. Toute sa figure d’ascète s’est illuminée de l’enthousiasme du fanatique.
— Notre but, c’est le fond de l’Océan Atlantique …
Ici je devrais faire une pause, car je suppose que vous avez le souffle coupé. Si j’étais feuilletoniste, j’arrêterais là mon chapitre, avec la suite au prochain numéro. Mais je ne suis qu’un chroniqueur ; je peux donc ajouter que je suis resté une grande heure dans la cabine de notre vieux Maracot, et que j’en ai appris long ; j’aurai à peine le temps de tout vous dire avant le départ du dernier courrier.
— … Oui, jeune homme, vous pouvez écrire librement à présent, car quand votre lettre parviendra en Angleterre, nous serons déjà dans le grand bain …
Il s’est mis à ricaner doucement, car il possède un sens particulier de l’humour.
— … Oui, Monsieur ! Nous aurons déjà effectué la plongée. Plongée est le mot juste en l’occurrence. Notre plongée sera une date historique dans les annales de la Science. Mais apprenez d’abord que j’ai acquis une conviction : la thèse courante selon laquelle la pression de l’océan serait extrêmement considérable aux grandes profondeurs est une erreur grossière. Il me paraît évident que d’autres facteurs neutralisent l’effet, encore que je ne sois pas prêt à préciser lesquels. C’est un problème que nous pourrons résoudre. Voyons, puis-je vous demander quelle pression vous vous attendez à trouver sous quinze cents mètres d’eau ?
Il m’a dévisagé de ses yeux brillants derrière ses lunettes d’écaille.
— Pas moins d’une tonne par pouce carré, ai-je répondu. D’ailleurs la démonstration en a été faite.
— La tâche du pionnier a toujours consisté à prouver le contraire de ce qui a été démontré. Servezvous de votre cervelle, jeune homme ! Ces derniers temps, vous avez pêché quelques formes délicates de la vie bathyque : des créatures si délicates que vous aviez du mal à les transférer du filet dans le réservoir sans les abîmer. Avez-vous trouvé qu’elles apportaient la preuve de cette pression considérable ?
— La pression s’égalisait. Elle était la même à l’intérieur qu’à l’extérieur.
— Des mots ! Rien que des mots ! s’est-il écrié en secouant la tête avec impatience. Vous avez ramené des poissons ronds, par exemple le gastrotomus globulus. N’auraient-ils pas été aplatis si la pression avait été celle que vous supposez ?
— Mais l’expérience des plongeurs ?
— Elle se vérifie jusqu’à un certain point. Les plongeurs se heurtent effectivement à une augmentation de pression pouvant affecter l’organe qui est peut-être le plus sensible du corps humain, je veux dire l’intérieur de l’oreille. En tout cas, selon mon plan, nous ne serons exposés à aucune pression. Nous serons descendus au fond de l’Océan dans une cage d’acier munie de fenêtres en cristal pour l’observation. Si la pression n’est pas assez forte pour venir à bout de quatre centimètres d’acier renforcé par un double nickelage, elle ne nous fera aucun mal. C’est une application de l’expérience des frères Williamson à Nassau, dont vous avez peut-être entendu parler. Si mon calcul se révèle faux … Hé bien, vous m’avez dit que vous n’aviez pas de charges de famille, n’est-ce pas ? Nous mourrons dans une grande aventure. Bien entendu, si vous préférez vous tenir à l’écart, je me débrouillerai tout seul.
Ce plan me semblait démentiel ; mais vous savez comme il est difficile de se dérober devant un défi. J’ai cherché à gagner du temps en réfléchissant.
— Jusqu’à quelle profondeur envisagez-vous de descendre, Monsieur ? lui ai-je demandé.
Il avait une carte épinglée sur la table ; il a posé son compas sur un point situé au sud-ouest des Canaries.
— L’année dernière j’ai procédé par là à quelques sondages, m’a-t-il répondu. Il y a une fosse très profonde. Nous sommes arrivés à sept mille six cents mètres. J’ai été le premier à la signaler. J’espère bien que les cartes de l’avenir la baptiseront « Gouffre Maracot ».
— Seigneur ! me suis-je exclamé. Vous n’avez pas l’intention de descendre dans une fosse pareille ?
— Non, non ! m’a-t-il répondu en souriant. Notre câble de largage et nos tubes d’air ne vont pas au-delà de huit cents mètres. J’allais d’ailleurs vous expliquer que tout autour de ce gouffre, qui s’est sans aucun doute creusé il y a très longtemps, sous l’action de forces volcaniques, s’étend une crête élevée, un plateau étroit, qui ne se trouve qu’à trois cents brasses au-dessous de la surface de la mer.
— Trois cents brasses ! Plus de cinq cents mètres !
— Oui. En gros, cinq cents mètres. Mon intention est que nous soyons déposés dans notre petit observatoire étanche sur ce plateau sous-marin. Là nous nous livrerons à toutes les observations possibles. Un tube acoustique nous reliant au navire nous permettra de transmettre nos directives. L’affaire ne devrait pas soulever de difficultés. Quand nous voudrons remonter, nous n’aurons qu’à le dire.
— Et l’air ?
— Une pompe nous en enverra.
— Mais il fera complètement noir !
— J’en ai peur. Les expériences de Fol et de Sarasin dans le lac de Genève montrent que les rayons ultraviolets eux-mêmes font défaut à cette profondeur. Mais qu’importe ? Nous serons approvisionnés en lumière par la puissante énergie électrique des machines du navire, à laquelle s’ajouteront six piles sèches Hellesens de deux volts qui, reliées ensemble, nous procureront un courant de douze volts. Cela, plus une lampe Lucas de signalisation de l’armée que nous utiliserons comme réflecteur mobile, devrait suffire. Pas d’autres objections ?
— Et si nos tubes d’air fonctionnent mal ?
— Pourquoi fonctionneraient-ils mal ? En réserve, j’emporte de l’air comprimé en bouteilles : elles nous prolongeraient d’au moins vingt-quatre heures. Alors, vous ai-je rassuré ? M’accompagnerez-vous ?
Ce n’était pas une décision facile. Le cerveau travaille vite, et l’imagination est bougrement alerte. Déjà je me représentais cette boîte noire au sein des profondeurs vierges, je m’imaginais respirer un air malsain, je croyais voir les cloisons fléchir, se ployer vers l’intérieur, se fendre aux jointures avec l’eau jaillissant par tous les trous de rivets et grimpant à l’assaut de nos corps. Notre mort serait lente, terrible !.. Mais j’ai levé les yeux, et j’ai vu le regard farouche du vieil homme fixé sur moi avec l’exaltation d’un martyr de la science. Contagieuse, cette sorte d’enthousiasme ! Folie ? Peut-être ! Mais au moins folie noble, désintéressée ! Cette grande flamme m’a embrasé. Je me suis levé d’un bond, la main tendue.
— Docteur, vous pouvez compter sur moi jusqu’au bout !
— Je le savais, m’a-t-il répondu. Ce n’est pas pour vos quelques notions scientifiques que je vous ai choisi, mon jeune ami …
Et il a ajouté dans un sourire :
— … Ni pour votre intimité avec les crabes pélagiques. D’autres qualités me sont plus immédiatement utiles : la loyauté et le courage.
Sur ce petit morceau de sucre il m’a renvoyé, avec mon avenir engagé et tous mes projets à vau-l’eau. Mais le dernier courrier va partir. On appelle pour la poste. Ou bien vous n’entendrez plus jamais parler de moi, mon cher Talbot, ou bien vous recevrez une lettre qui vaudra la peine d’être lue. Si vous n’avez plus de mes nouvelles, vous pourrez toujours acheter une pierre tombale flottante, et la lancer quelque part au sud des Canaries avec l’inscription suivante : « Ici, ou dans les environs, repose tout ce que les poissons ont laissé de mon ami,
Cyrus J. Headley. »
* * *
Le deuxième document de l’affaire est l’inintelligible message par sans-fil qui a été capté par plusieurs navires, parmi lesquels le steamer Arroya. Reçu à 15 heures le 3 octobre 1926, il a donc été diffusé deux jours seulement après que le Strafford ait quitté la Grande Canarie, ainsi qu’en témoigne la lettre ci-dessus. Or cette date correspond bien au jour où le petit bateau norvégien a vu sombrer un steamer dans une tempête à trois cents kilomètres au sud-ouest de Porta de la Luz. Ce message était conçu comme suit :
« Navire couché. Craignons notre position sans espoir. Avons déjà perdu Maracot, Headley, Scanlan. Situation incompréhensible. Mouchoir Headley au bout de la sonde grands fonds. Que Dieu nous aide !
S. S. Strafford. »
Tel a été le dernier message, incohérent, émis par l’infortuné navire ; la phrase relative au mouchoir a été attribuée à un accès de délire de l’opérateur. L’ensemble paraissait néanmoins décisif.
* * *
L’explication (en admettant qu’elle puisse être acceptée pour telle) de toute l’affaire réside dans le récit trouvé à l’intérieur de la boule vitreuse. Mais il vaudrait mieux commencer par ajouter quelques détails au très bref compte rendu publié dans la presse sur la découverte de la boule. Je les emprunte au journal de navigation de l’Arabella Knowles, capitaine Amos Green, qui transportait un chargement de charbon de Cardiff à Buenos Aires. Je recopie le journal sans en changer un mot.
« Mercredi 5 janvier 1927. Lat. 27° 14’. Long. 28° W. Temps calme. Ciel bleu avec touffes de cirrus. Mer comme du verre. Au deuxième coup de cloche du quart du milieu, le premier lieutenant a déclaré avoir vu un objet brillant jaillir hors de la mer et retomber. Il a d’abord cru qu’il s’agissait d’un poisson bizarre ; mais en l’examinant à la lunette il s’est aperçu que c’était un globe argenté, ou une boule qui était si légère qu’elle reposait, plus qu’elle ne flottait, à la surface de l’eau. J’ai été averti et je l’ai vue : elle était aussi grosse qu’un ballon de football ; elle brillait à un demi-mille sur notre tribord. J’ai fait arrêter les machines, j’ai ordonné au chef d’équipage de descendre le canot ; il est allé pêcher l’objet et l’a rapporté à bord.
« L’examen a révélé que c’était une boule faite d’un verre très résistant et rempli d’une substance si légère que lorsqu’on la lançait en l’air, elle demeurait en suspension comme un ballon rouge d’enfant. Elle était presque transparente, et nous pouvions voir à l’intérieur quelque chose qui ressemblait à un rouleau de papier … Sa matière était néanmoins si dure que nous avons eu beaucoup de mal pour la briser et en extraire le contenu. Un marteau n’ayant donné aucun résultat, il a fallu que le chef mécanicien la pince dans la course de la machine pour que nous puissions la casser. J’ai le regret de dire qu’elle s’est réduite en une poussière étincelante, et qu’il a été impossible d’en garder un débris de taille suffisante pour le faire analyser. Nous avons toutefois récupéré le papier ; après l’avoir parcouru, nous avons conclu qu’il était d’une grande importance, et nous avons l’intention de le remettre au consul d’Angleterre quand nous atteindrons le Rio de la Plata. Voilà trente-cinq ans que je suis marin ; c’est l’aventure la plus étrange qui me soit arrivée. Je laisse à plus savant que moi le soin d’en tirer la signification. »
* * *
Voici donc maintenant le nouveau récit de Cyrus J. Headley, que nous reproduisons textuellement.
À qui suis-je en train d’écrire ? Hé bien, je suppose que c’est à l’univers entier ; mais comme cette adresse est un peu vague, je songe à mon ami Sir James Talbot, de l’Université d’Oxford, pour la simple raison que ma dernière lettre lui était destinée et que celle-ci peut être considérée comme une suite. Il y a quatre-vingt-dix-neuf chances sur cent pour que la boule, même si elle parvient à la lumière du jour et si elle n’est pas avalée au passage par un requin, se promène de vague en vague sans être jamais repérée par un marin. N’importe : l’essai en vaut la peine. Maracot en a expédié une deuxième. Il se peut donc que grâce à lui ou à moi, le monde apprenne notre merveilleuse histoire. Le monde nous croira-t-il ? C’est une autre affaire. Tout de même, quand des habitants de la Terre examineront la boule avec son enveloppe vitreuse et découvriront le gaz lévigène qu’elle renferme, ils verront bien qu’ils ont là quelque chose sortant de l’ordinaire. En tout cas, vous, Talbot, vous ne ferez pas une boulette de ce papier sans l’avoir lu.
Si quelqu’un désirait savoir l’origine et le but de notre aventure, il n’aurait qu’à se reporter à la lettre que je vous ai écrite le 1er octobre de l’an dernier, juste avant de quitter Porta de la Luz. Par saint George ! Si je m’étais douté de ce que le destin nous tenait en réserve, je crois que je me serais glissé dans la vedette du courrier ce soir-là. Et pourtant … Oui, hé bien, sachant ce que je sais, je serais demeuré avec le docteur jusqu’au bout. Tout bien réfléchi, oui, je le jure !
Je vais maintenant relater mes aventures depuis notre départ de la Grande Canarie.
Dès que le port s’est fondu dans la brume, le vieux Maracot s’est mis à cracher des flammes. L’heure de l’action avait sonné : toute l’énergie de l’homme, contenue depuis si longtemps, s’est embrasée. Ah, je vous jure qu’il a pris le navire en mains, nous tous compris, et qu’il a plié les hommes et les choses à sa volonté ! Le savant distrait, sec, plus ou moins timbré avait disparu : nous étions commandés par une machine humaine électrique qui crépitait de vitalité et qu’animait une formidable énergie intérieure. Derrière de grosses lunettes ses yeux brillaient comme des flammes dans une lanterne. Il donnait l’impression d’être partout à la fois, calculant ses distances sur la carte, comparant ses relevés avec ceux du pilote, bousculant Bill Scanlan, m’accablant de cent besognes invraisemblables, mais le tout avec une méthode parfaite et dans un but bien défini. Il a révélé des connaissances inattendues en électricité et en mécanique. Il consacrait beaucoup de temps à travailler à l’assemblage de la cage que Scanlan, sous sa supervision, confectionnait en ajustant les pièces détachées que nous avions vues dans la cale.
— Dites donc, Monsieur Headley, c’est épatant ! m’a déclaré Bill le surlendemain matin. Venez voir ! Le doc est un champion, en mécanique de précision.
J’ai été désagréablement impressionné, comme si je regardais mon cercueil, Mais tout de même j’ai dû convenir que le mausolée était rudement bien conçu. Le plancher avait été agrafé aux quatre parois d’acier et les hublots vissés au centre de chaque cloison. On accédait dans la cage par deux petites trappes, l’une sur le toit, l’autre sur la base. Un câble d’acier, mince mais très robuste, la soutenait : il passait sur un tambour et il était filé ou roulé par la machine puissante que nous utilisions pour nos chaluts de pêche de grands fonds ; il avait huit cents mètres de long, et son ballant était enroulé autour des bittes sur le pont. Les tubes d’air caoutchoutés, de la même longueur, étaient reliés au tube acoustique et au fil qui transmettait aux lampes électriques l’énergie des batteries du navire ; en supplément nous disposions d’une installation autonome.
Au soir du deuxième jour après notre départ, les machines ont été stoppées. Le baromètre était bas ; un gros nuage noir se levant au-dessus de l’horizon annonçait des ennuis prochains. En vue, un seul petit bateau battant pavillon norvégien ; j’ai remarqué qu’il avait serré les ris comme si son équipage s’attendait à du mauvais temps. Pour l’heure cependant, les conditions atmosphériques étaient propices, et le Strafford roulait gentiment sur un océan bleu foncé, ça et là coiffé de blanc par le souffle des vents alizés. Bill Scanlan a pénétré dans mon laboratoire ; il était très énervé.
— Dites donc, Monsieur Headley, on a descendu le dispositif machin dans le fond du navire. Croyez-vous que le patron va descendre dedans ?
— Tout à fait sûr, Bill. Et moi, je l’accompagne.
— Vous êtes cinglés, tous les deux, c’est sûr ! Seulement moi, je me sentirais un tantinet dégonflé si je vous laissais descendre seuls.
— Ce n’est pas votre boulot, Bill, voyons !
— Hé bien, figurez-vous que si. Je serais un vrai jaune, jaune comme un Chinetoque avec la jaunisse, si je vous laissais tomber ! Les Merribank m’ont expédié ici pour m’occuper de leur cage. Si leur cage descend jusqu’au fond de la flotte, il faut bien que je la suive. Là où va ce joujou d’acier, c’est l’adresse de Bill Scanlan ; et tant pis si ses locataires sont mabouls !
Il était inutile de discuter plus avant. Notre petit Suicide Club a donc compté un membre de plus. Nous n’avions qu’à attendre les ordres.
Toute la nuit on a travaillé ferme pour la mise au point, et c’est après un petit déjeuner fort matinal que nous sommes descendus dans la cale, prêts à l’aventure.
La cage d’acier avait été abaissée à mi-hauteur dans le double fond. Nous y sommes entrés l’un après l’autre par la trappe supérieure ; celle-ci a été fermée et vissée derrière nous. Lugubre, le capitaine Howie nous avait serré la main lorsque nous étions successivement passés devant lui. On nous a abaissés d’un mètre ou deux, le volet a été tiré au-dessus de nos têtes, et on a ouvert une vanne pour vérifier l’étanchéité de la cage. La cage a bien supporté ce premier contact avec l’eau ; les joints étaient parfaitement ajustés ; nous n’avons décelé aucun signe d’infiltration. Le battant inférieur de la cale s’est ouvert : nous nous sommes alors trouvés en suspension dans l’océan au-dessous du niveau de la quille.
Pour dire vrai nous avions pour cage une petite chambre fort douillette, et j’ai été émerveillé de la prévoyance et de l’organisation qui avaient présidé à son aménagement. L’éclairage électrique n’était pas allumé, mais le soleil semi-tropical brillait à travers l’eau verte à chaque hublot. Des petits poissons scintillaient comme des fils d’argent sur ce fond d’émeraude. À l’intérieur de la cage un canapé faisait le tour des parois, où étaient suspendus un cadran bathymétrique, un thermomètre et divers instruments. Sous le canapé, des bouteilles d’air comprimé nous approvisionneraient en oxygène pour le cas où les tubes reliés au navire fonctionneraient mal ; ces tubes débouchaient au-dessus de nos têtes, et à côté pendait le tube acoustique. Nous entendions au-dehors la voix endeuillée du capitaine.
– Êtes-vous réellement décidés à descendre ? a-t-il demandé.
— Très décidés ! a répondu le Professeur avec impatience. Vous nous descendrez lentement et vous laisserez quelqu’un de garde au téléphone. Je vous tiendrai au courant. Quand nous aurons atteint le fond, vous demeurerez sur place jusqu’à ce que je vous donne des instructions. Ne faites pas supporter au câble une tension trop forte ; une descente à deux nœuds à l’heure devrait être tout à fait dans ses limites. Paré ? Alors, laissez aller !
Il a crié ces deux derniers mots, il les a hurlés comme un dément. Le moment suprême de son existence était arrivé ; tous les rêves qu’il caressait depuis longtemps allaient se réaliser. Pendant quelques instants, je me suis demandé si nous n’étions pas à la merci d’un monomane enjôleur et rusé. Bill Scanlan a eu la même idée : il m’a lancé un regard de biais en l’accompagnant d’un sourire morose. Mais aussitôt après cette explosion sauvage, notre chef est redevenu lui-même.
Notre attention s’est d’ailleurs tournée vers la merveilleuse et nouvelle aventure que chaque minute nous prodiguait. Lentement la cage s’enfonçait dans les profondeurs de l’Océan. De vert clair, l’eau est devenue olive foncé. Puis le vert olive s’est transformé en un bleu magnifique, riche, grave, qui à son tour s’est progressivement épaissi en rouge pourpre. Nous descendions de plus en plus bas : trente mètres, cinquante mètres, cent mètres. Les valves fonctionnaient à la perfection. Nous respirions aussi librement et aussi normalement que sur le pont du navire. L’aiguille faisait majestueusement le tour du cadran lumineux du bathymètre. Cent cinquante mètres. Deux cents mètres.
— Comment allez-vous ? a rugi une voix angoissée au-dessus de nous.
— Mieux que jamais ! a répondu Maracot dans le tube acoustique.
Mais la lumière décroissait. À un crépuscule gris terne la nuit noire a rapidement succédé.
— Stop ! a crié notre chef.
Nous avons cessé de bouger et nous sommes restés suspendus à deux cent vingt mètres au-dessous de la surface de l’Océan. J’ai entendu le bruit sec de l’interrupteur ; une glorieuse lumière dorée nous a inondés : se répandant de l’autre côté de nos hublots, elle projetait de longues trouées scintillantes dans l’immensité des eaux qui nous entouraient. Le visage collé aux vitres, nous avons été alors gratifiés d’un spectacle comme jamais homme n’en avait vu.
Jusqu’à ce moment précis, qu’avions-nous connu de ces couches en profondeur ? Uniquement les quelques poissons qui s’étaient montrés trop lents pour éviter notre chalut maladroit, ou trop stupides pour échapper au filet de dragage. Or, voilà que se découvrait pour nous le monde de l’eau, tel qu’il était en réalité. Si la création a eu pour objet l’homme et sa reproduction, il est incompréhensible que l’océan soit tellement plus peuplé que la terre. Dans Broadway un samedi soir, à Lombard Street un après-midi de semaine, il n’y a pas plus d’encombrement que dans les grands espaces marins qui s’étendaient devant nous. Nous avions dépassé les couches de surface où les poissons sont soit incolores, soit bleus au-dessus et argentés au-dessous. Maintenant défilaient sous nos yeux des créatures marines dotées des couleurs et des formes les plus diverses que puisse exhiber la vie pélagique. Des leptocéphales délicats ou des larves d’anguille jaillissaient comme des sillons d’argent poli à travers le tunnel de lumière. Les murènes à forme de serpent, les lamproies des grands fonds, tordues et repliées sur elles-mêmes, les ceratia noirs, tout piquants et bouche, se sauvaient devant notre intrusion. Parfois une seiche trapue traversait l’un de nos faisceaux lumineux et nous observait de ses yeux humains, sinistres. Ou bien un cystome, un glaucus prêtait au décor son charme floral. Un gros caranx a voulu forcer l’un de nos hublots, et il s’est lancé dessus à plusieurs reprises jusqu’à ce qu’un requin de trois mètres l’engloutisse entre ses mâchoires béantes. Le docteur Maracot était en extase ; il avait un carnet de notes sur ses genoux ; il griffonnait ses observations qu’il accompagnait d’un monologue ininterrompu.
— Qu’est celui-là ? l’entendais-je marmonner. Oui, oui, un lepidion, mais d’une espèce inconnue, pour autant que je puisse en juger. Regardez ce macroure, Monsieur Headley : sa couleur ne ressemble absolument pas à celle du spécimen que nous avons ramené avec le filet.
Une fois seulement il a été pris de court. Un long objet ovale animé d’une grande vitesse a glissé de haut en bas devant son hublot en laissant derrière lui une queue vibrante qui se prolongeait à perte de vue au-dessus et au-dessous de nous. J’admets que j’ai été aussi intrigué que le Professeur ; c’est Bill Scanlan qui a élucidé le mystère.
— Je parie que cet imbécile de John Sweeney a jeté sa sonde à côté de nous. Manière de plaisanterie, peut-être, pour que nous nous sentions moins seuls !
— Certainement ! dit Maracot en ricanant. Plumbus longicaudatus ! Une nouvelle espèce, Monsieur Headley, avec une queue en corde de piano et un plomb dans le nez. Que voulez-vous ! Il faut bien qu’ils effectuent des sondages afin de nous maintenir au-dessus du plateau, qui est d’une taille limitée. Tout va bien, capitaine ! a-t-il crié. Vous pouvez reprendre la descente.
Et la descente a recommencé. Le docteur Maracot a éteint l’électricité ; tout est redevenu d’un noir d’encre à l’exception du cadran lumineux du bathymètre, qui mesurait notre chute régulière. À part une légère oscillation, nous ne nous rendions pour ainsi dire pas compte que nous bougions. Seule cette aiguille mouvante sur le cadran nous révélait notre situation périlleuse, inconcevable. À trois cent cinquante mètres de fond, l’air commençait incontestablement à se vicier : Scanlan a huilé la valve du tube d’expulsion, et nous nous sommes sentis mieux. À cinq cents mètres, nous nous sommes arrêtés, et nous nous sommes balancés au milieu de l’Océan après avoir rallumé nos lampes. Une grosse masse noire est passée près de nous ; nous n’avons pas pu déterminer si c’était un poisson-sabre, ou un requin des grands fonds, ou un monstre d’une espèce inconnue. Le Professeur s’est hâté d’éteindre.
— Voilà notre plus grand danger, a-t-il expliqué. Dans les profondeurs de l’Océan, il existe des bêtes dont la charge sur cette chambre d’acier ne nous laisserait pas plus de chances qu’à une ruche chargée par un rhinocéros.
— Des baleines, peut-être ? a dit Scanlan.
— Les baleines peuvent plonger à une grande profondeur, a répondu le savant. Une baleine du Groënland a été observée pendant qu’elle plongeait perpendiculairement en entraînant quinze cents mètres de filin. Mais à moins d’être blessée ou épouvantée, aucune baleine ne descendrait si bas. Ce devait être un calmar géant. On en trouve à n’importe quelle profondeur.
— J’imagine que les calmars sont trop mous pour nous faire du mal. Les rieurs seraient du côté du calmar s’il perçait un trou dans l’acier nickelé de Merribank.
— Ils ont le corps mou, a répliqué le Professeur. Mais le bec d’un gros calmar fendrait une barre de fer, et un seul coup de ce bec traverserait ce hublot aussi facilement que du parchemin.
Nous avons poursuivi notre descente. Et puis enfin, tout doucement, tout gentiment, nous nous sommes posés. Le choc a été si insignifiant que nous nous en serions à peine aperçus si, rallumant l’électricité, nous n’avions vu de grands rouleaux du câble autour de nous. Ces rouleaux représentaient un péril, car ils pouvaient s’emmêler avec nos tubes d’aération. Sur l’ordre impérieux de Maracot, le câble a été aussitôt embarqué par l’équipage du navire. Le cadran indiquait six cents mètres. Nous reposions immobiles sur une crête volcanique au fond de l’Atlantique.
CHAPITRE II
Je crois que pendant quelques instants, nous avons partagé tous les trois le même sentiment. Nous n’avons pas voulu faire ni voir la moindre chose. Sans bouger, nous essayions de réaliser notre miracle : nous reposions juste au milieu de l’un des plus grands océans du monde. Mais bientôt l’étrange décor qui nous entourait et que révélaient nos lampes nous a attirés vers les hublots.
Nous nous étions posés sur un lit d’algues hautes (d’après Maracot, des cutleria multifida) ; leurs frondes jaunes s’agitaient sous l’action d’un courant sous-marin, exactement comme des branches sous une brise d’été. Elles n’étaient pas suffisamment longues pour gêner nos observations ; et cependant leurs grandes feuilles plates, dorées par notre éclairage, passaient par intermittence dans notre champ visuel. Au-delà de leur barrière mouvante, les déclivités d’un terrain couleur de machefer étaient parsemées de mollusques aux nuances magnifiques : holothuries, ascidies, échinodermes se serraient comme jacinthes et primevères au printemps dans un parterre d’Angleterre. Ces fleurs vivantes de la mer, écarlates, empourprées ou roses s’étalaient le plus décorativement du monde sur le fond noir. Par des crevasses, de grandes éponges émergeaient tout hérissées dans les rocs sombres. Quelques poissons des profondeurs moyennes surgissaient tels des éclairs de couleur dans notre cercle de lumière : Pendant que nous contemplions ce spectacle féerique, une voix angoissée a résonné dans le tube acoustique :
— Alors, comment trouvez-vous le fond ? Tout se passe-t-il bien ? Ne restez pas trop longtemps, car le baromètre dégringole, et je n’aime pas l’aspect du ciel. Avez-vous assez d’air ? Pouvons-nous faire quelque chose pour vous ?
— Tout va bien, capitaine ! a crié joyeusement Maracot. Nous ne resterons pas longtemps. Vous nous avez admirablement soignés. Nous sommes aussi bien ici que dans nos cabines. Tenez-vous prêt à nous déplacer lentement vers l’avant.
Nous avions pénétré dans le royaume des poissons lumineux ; nous nous sommes amusés à éteindre nos lampes et, dans le noir absolu (un noir dans lequel une plaque sensible aurait pu être exposée pendant une heure sans enregistrer la moindre trace d’un rayon ultra-violet) nous avons observé l’activité phosphorescente de l’Océan. Une bête terrifiante avait des dents lumineuses qui luisaient d’une manière biblique dans les ténèbres de la mer. Une autre avait une longue antenne dorée ; une troisième un panache de flammes au-dessus de la tête. À perte de vue, des points brillants se déplaçaient ; chaque petit être vaquait à ses propres affaires et éclairait sa route avec autant d’efficacité qu’un taxi de nuit à l’heure des théâtres dans le Strand. Nous avons rallumé nos lampes ; le docteur Maracot s’est livré à ses observations sur le fond de la mer.
— Nous ne sommes pas assez bas pour déterminer les couches caractéristiques des grands fonds, a-t-il déclaré. Ils se trouvent loin de notre rayon d’action. Peut-être une autre fois, avec un câble plus long …
— Rayez cette idée de votre tête ! a grogné Scanlan. Oubliez-la !
Maracot a souri.
— Vous ne tarderez pas à vous acclimater aux grands fonds, Scanlan. Cette première descente ne sera pas la dernière.
— Vous voulez nous envoyer aux enfers ! a protesté Bill.
— Vous n’y attacherez pas plus d’importance que pour descendre dans la cale du Stratford. Vous remarquerez, Monsieur Headley, que le terrain ici, pour autant que nous puissions l’observer à travers cette épaisseur d’hydrozoaires et d’éponges, est de la pierre ponce avec de la crasse noire de basalte, ce qui indique d’anciennes activités plutoniques. Réellement, j’incline à voir là une confirmation de mon opinion antérieure : cette crête fait partie d’une formation volcanique, et le gouffre Maracot …
Il a articulé ces deux mots avec une tendresse infinie.
— … représente la pente extérieure de la montagne. Je pense qu’il serait intéressant de déplacer notre cage lentement et en avant, jusqu’à ce que nous arrivions au bord du gouffre et que nous constations le genre de formation que nous trouverons à cet endroit. Je m’attends à découvrir un précipice de dimensions majestueuses plongeant presque à la verticale dans les profondeurs extrêmes de l’Océan.
Cette expérience me semblait assez dangereuse, car je me demandais jusqu’à quel point notre câble mince pourrait supporter la tension d’un déplacement latéral. Mais avec Maracot le danger, pour lui ou pour quiconque, n’existait pas à partir du moment où une observation scientifique était à faire. J’ai retenu mon souffle (Bill Scanlan aussi) quand un lent déplacement de notre coquille d’acier, écartant devant elle les frondes d’algues, nous a avertis que le câble se tendait au maximum ; vaillamment toutefois, il a résisté, et nous avons commencé à glisser en douceur sur le plateau. Maracot, un compas à la main, dirigeait la manœuvre en criant ses ordres dans le tube ; il n’hésitait pas à faire soulever notre cage chaque fois qu’un obstacle se présentait sur notre route.
— Cette crête basaltique ne doit pas avoir plus de quinze cents mètres de large, nous expliquait-il. D’après mes repères le gouffre se trouve à l’ouest du point d’où nous avons plongé. À cette allure, nous ne tarderons pas à arriver au bout.
Nous avons glissé sans heurt sur la plaine volcanique, toute floconneuse d’algues dorées et parée des somptueux joyaux que la nature avait taillés, jusqu’à ce que le Professeur se précipite vers le téléphone.
— Stop ! Nous y sommes !
Soudainement un trou monstrueux s’était ouvert devant nous. L’endroit était terrifiant : vraiment une vision de cauchemar ! Des falaises de basalte, noires et luisantes, tombaient à pic dans l’inconnu. De leurs bords pendaient des laminaires, comme des fougères pendent parfois en haut d’un ravin de la terre, avec cette différence que là, sous cette frange mouvante et oscillante, il n’y avait rien que les parois d’un abîme. L’arête rocheuse du rebord des falaises décrivait une courbe sur notre droite, et sur notre gauche comme pour fermer un cercle ; nous en ignorions le diamètre, car nos lumières ne parvenaient pas à percer les ténèbres qui nous faisaient face. Quand nous avons dirigé vers le bas notre lampe de signalisation Lucas, elle a projeté un long faisceau de rayons dorés et parallèles qui est descendu, descendu, pour se perdre dans le gouffre qui s’ouvrait à nos pieds.
— C’est vraiment merveilleux ! s’est écrié Maracot qui contemplait le décor avec le regard satisfait du propriétaire. En ce qui concerne la profondeur, je n’ai pas besoin de vous préciser que ce gouffre n’occupe pas le premier rang. Le gouffre Challenger atteint huit mille deux cents mètres, près des îles Ladrone, le gouffre Planet au large des Philippines atteint neuf mille sept cent cinquante mètres, et d’autres encore le précèdent sur ce plan-là ; par contre le gouffre Maracot est le seul à posséder une déclivité aussi accentuée ; il est également remarquable pour avoir échappé à l’observation de tant d’explorateurs hydrographes qui ont dressé la carte de l’Atlantique. On peut à peine douter …
Au milieu de sa phrase il s’est interrompu, et son visage a exprimé une surprise et un intérêt intenses. Bill Scanlan et moi nous avons regardé par-dessus ses épaules, et nous sommes restés pétrifiés par ce que nous avons vu.
Une grande bête remontait le tunnel de lumière que nous avions projeté dans le gouffre. Au plus loin, là où la lumière se diluait dans l’obscurité de l’abîme, un corps noir avait émergé et progressait lentement par embardées et par sauts. Quand il est venu en pleine lumière, nous avons mieux distingué sa conformation redoutable. Bête ignorée de la science, elle présentait certaines analogies avec d’autres qui nous étaient familières : trop allongée pour être un crabe géant, trop grosse pour un homard géant, elle était bâtie sur le modèle de l’écrevisse, avec deux pinces monstrueuses déployées sur le côté, et une paire d’antennes de cinq mètres de longueur qui frémissaient devant ses yeux noirs et ternes. La carapace, jaune clair, avait bien trois mètres de diamètre et dix mètres de long, sans parler des antennes.
— … Merveilleux ! s’est enfin exclamé Maracot en prenant force notes sur son carnet. Yeux semi-pédiculés, lamelles élastiques, famille des crustacés, espèce inconnue. Le crustaceus maracoti ; pourquoi pas ? Pourquoi pas ?
— Sapristi, je me passerais bien de savoir comment il s’appelle ! a crié Bill. Le voici qui vient sur nous ! Dites, donc, si nous éteignions nos lumières ?
— Encore un petit moment, afin que je note les réticulations !.. Voilà, cela ira.
Il a tourné l’interrupteur, et nous nous sommes retrouvés dans l’obscurité totale, que ne trouaient que des lueurs fugitives dans la mer : on aurait dit des météores par une nuit sans lune.
— Cette bête est sûrement la pire qui existe au monde, a soupiré Bill en s’épongeant le front. En la regardant, je me sentais comme un lendemain de cuite, après avoir bu une bouteille d’alcool prohibé.
— Elle n’était certes pas plaisante à considérer, a convenu le naturaliste. Et il doit être terrible d’avoir affaire à elle si l’on s’expose à ses pinces formidables. Mais à l’intérieur de notre cage, nous pouvons nous offrir le luxe de l’examiner en toute sécurité et à notre aise.
À peine avait-il fini sa phrase que nous avons entendu sur l’acier de notre paroi un coup sec et dur, un vrai coup de pioche, suivi d’un long grattement puis d’un nouveau coup.
— Mais c’est qu’elle demande à entrer ! s’est écrié Bill Scanlan tout alarmé. Il manque un écriteau « Défense d’entrer » sur cette cabane.
Un léger tremblement dans sa voix attestait qu’il se forçait à plaisanter ; j’avoue que mes genoux s’entrechoquaient à la pensée que ce monstre essayait d’étreindre nos hublots les uns après les autres pour explorer cette étrange coquille qui, s’il parvenait à la fendre, lui offrirait un dîner tout prêt.
— Il ne peut pas nous faire de mal, a répondu Maracot qui avait perdu de son assurance. Mais peut-être vaudrait-il mieux nous débarrasser de cette brute …
Il a appelé le capitaine par le tube.
— … Relevez-nous de huit ou dix mètres !
Quelques secondes plus tard, nous avons quitté la plaine de lave et nous avons doucement oscillé dans l’eau calme. Mais la terrible bête avait de la suite dans les idées. Au bout d’un temps assez court, nous avons à nouveau entendu le grattement de ses antennes et ses coups de pinces tout autour de nous. C’était épouvantable de rester silencieusement assis dans le noir tout en sachant que la mort était aussi proche ! Si cette pince puissante s’abattait sur le hublot, le verre résisterait-il ? Telle était la question muette que chacun de nous se posait.
Mais tout à coup un autre danger, aussi imprévu mais plus pressant, s’est présenté. Les petits coups secs et durs ont retenti au-dessus de nos têtes, et nous nous sommes mis à nous balancer à une cadence soutenue.
— Mon Dieu ! me suis-je écrié. Elle a saisi le câble. Elle va sûrement le couper !
— Dites donc, doc, le moment est venu de faire surface. Je pense que nous en avons vu assez, et pour Bill Scanlan, c’est l’heure de « Home, sweet home » ! Réclamez l’ascenseur, et en route !
— Mais nous n’avons même pas accompli la moitié de notre travail ! a protesté Maracot. Nous n’avons fait que commencer l’exploration des arêtes du gouffre. Il faut au moins voir quelle est sa largeur ! Quand nous aurons atteint l’autre versant, je consentirai à remonter …
Il s’est penché vers le tube acoustique.
— … Tout va bien, capitaine. Avancez à la vitesse de deux nœuds jusqu’à ce que je donne l’ordre de stopper.
Lentement nous avons franchi le rebord du gouffre. Comme l’obscurité ne nous avait pas empêchés d’être attaqués, nous avons rallumé nos lampes. L’un des hublots était complètement obstrué par ce qui nous a semblé être le bas-ventre de la bête. Sa tête et ses grandes pinces travaillaient sur le haut de notre cage, et nous étions secoués comme une cloche carillonnée : le monstre devait avoir une force gigantesque. Des mortels se trouvèrent-ils jamais placés dans une situation analogue, avec huit mille mètres d’eau sous leurs pieds et un abominable monstre au-dessus de leurs têtes ? Nos oscillations devenaient de plus en plus violentes. Un cri de panique a retenti dans le tube : le capitaine s’était rendu compte des secousses imprimées au câble. Désespéré, Maracot a bondi en levant les bras au ciel. Même de l’intérieur de notre coquille, nous avons senti le choc provoqué par la rupture du câble. Dans la seconde qui a suivi, notre chute a commencé.
Quand ma mémoire se reporte à cet instant affreux, j’entends encore le cri sauvage poussé par Maracot.
— Le câble s’est rompu ! On ne peut rien faire ! Nous sommes tous des hommes morts ! a-t-il hurlé en empoignant le tube acoustique. Au revoir ! capitaine ! Adieu à tous !..
Tels ont été nos derniers mots au monde des hommes.
Nous ne sommes pas tombés comme une pierre, ainsi que vous pourriez le supposer. En dépit de notre poids, notre coquille creuse nous procurait une sorte de flottabilité qui nous soutenait. Nous avons sombré dans le gouffre lentement et en douceur. J’ai entendu un long coup de racloir, quand nous avons échappé aux pinces de l’ignoble bête qui avait été la cause de notre malheur ; puis dans un mouvement giratoire sans secousses, nous sommes descendus en dessinant des cercles. Au bout de cinq bonnes minutes (qui nous ont paru une heure) nous avons atteint la limite extrême de notre tube acoustique qui s’est cassé comme du fil. Notre tube d’aération s’est rompu au même moment. L’eau salée s’est précipitée à travers les ouvertures. De ses mains expertes, Bill Scanlan a fait une ligature avec des cordes autour de chacun des tubes en caoutchouc et a arrêté l’irruption de l’eau, tandis que le docteur Maracot dévissait le col de nos bouteilles d’air comprimé ; l’oxygène a fusé en sifflant. Quand le câble s’était rompu, la lumière s’était éteinte ; dans l’obscurité Maracot est parvenu à relier les piles Hellesens, et des lampes se sont allumées au plafond.
— … Elles devraient durer une semaine, a-t-il dit en grimaçant un sourire. Nous aurons au moins de la lumière pour mourir …
Hochant la tête, il nous a regardés avec une grande gentillesse.
— … Pour moi, aucune importance : je suis un vieillard, et j’ai accompli ma tâche en ce monde. Mon unique regret est d’avoir permis à deux jeunes hommes de m’accompagner. J’aurais dû courir le risque tout seul …
Je me suis contenté de lui serrer la main. Vraiment j’aurais été incapable de parler. Bill Scanlan est resté silencieux lui aussi. Nous sombrions lentement ; des ombres noires de poissons surpris s’écartaient de notre cage. Comme nos oscillations continuaient, je me disais que rien ne pourrait nous empêcher de basculer sur le côté ou même de tomber la tête en bas. Heureusement notre poids avait été bien équilibré, ce qui nous a permis de garder une certaine stabilité. En regardant le bathymètre, j’ai constaté que nous étions déjà à seize cents mètres.
— … Vous voyez que j’avais raison, a fait observer Maracot non sans complaisance. Vous avez lu mon article dans le bulletin de la Société Océanographique sur le rapport de la pression avec la profondeur, n’est-ce pas ? Je voudrais pouvoir réapparaître sur la terre, ne serait-ce que pour confondre Bülow de Giessen, qui s’est permis de me contredire.
— Ma parole ! Si seulement je pouvais encore dire un mot aux gens de la terre, je ne le gaspillerais pas avec une tête carrée ! a dit le mécanicien. À Philadelphie, je connais une jolie fille qui aura des larmes plein ses beaux yeux, quand elle apprendra que Bill Scanlan n’est plus de ce monde. En tout cas, nous avons une drôle de manière d’en sortir, de ce monde !
— Vous n’auriez pas dû venir ! ai-je murmuré en posant ma main sur la sienne.
— J’aurais été un bien piètre sportif si je vous avais laissés tomber ! Non, j’ai fait mon devoir. Je suis content de ne pas avoir flanché.
— Pour combien de temps en avons-nous ?
Je m’étais retourné vers le docteur Maracot. Il a haussé les épaules.
— De toutes façons, nous aurons le temps de voir le véritable fond de la mer, m’a-t-il répondu. Les bouteilles ont de l’air pour quatorze ou quinze heures encore. Par contre les déchets vont nous asphyxier lentement. Si nous pouvions nous débarrasser de notre bioxyde de carbone … !
— Impossible !
— Il y a une bouteille d’oxygène pur. Je l’avais prise en cas d’accidents. Un peu d’oxygène pur de temps à autre nous maintiendra en vie. Vous remarquerez que nous avons déjà dépassé trois mille trois cents mètres de profondeur.
— Pourquoi essayer de nous maintenir en vie ? Plus tôt nous en aurons fini, mieux cela vaudra !
— Voilà le bon tuyau ! s’est écrié Scanlan. Abrégeons tout, et que ce soit fini !
— Et nous manquerions le plus merveilleux spectacle que l’homme ait jamais vu !..
Maracot s’insurgeait.
— … Ce serait une trahison à l’égard de la science ! Enregistrons au contraire les faits jusqu’au bout, même s’ils doivent être ensevelis avec nos corps. Jouez le jeu à fond !
— Voilà qui est parlé, doc ! a opiné Scanlan. C’est vous qui avez les meilleures tripes de l’équipe ! Nous assisterons au spectacle jusqu’au baisser de rideau.
Nous étions tous les trois assis sur le canapé ; nous nous y cramponnions de toute la force de nos doigts quand la cage se penchait ou se balançait ; les poissons continuaient à tracer des traînées lumineuses de bas en haut de l’autre côté des hublots.
— Nous sommes maintenant à cinq mille mètres, a fait observer Maracot. Je vais nous donner de l’oxygène, Monsieur Headley, car l’atmosphère sent un peu trop le renfermé. Au fait, ajouta-t-il avec son petit rire sec, ce gouffre sera certainement le gouffre Maracot jusqu’à la fin des temps : quand le capitaine Howie ramènera la nouvelle, mes collègues veilleront à ce que mon tombeau soit aussi mon monument ! Bülow de Giessen lui-même …
Il a marmonné un grief scientifique incompréhensible.
Nous surveillions l’aiguille qui rampait vers les six mille mètres. À un moment donné, nous sommes entrés en collision avec quelque chose de lourd, et nous avons éprouvé une telle secousse que j’ai craint que nous ne basculions sur le flanc. Peut-être était-ce un énorme poisson ? À moins que nous n’ayons heurté une saillie de la falaise du sommet de laquelle nous avions été précipités. Dire que ce plateau nous avait semblé situé si bas ! À présent, du sein de notre gouffre, il nous paraissait tout près de la surface … Nous continuions à dessiner des cercles, à tomber de plus en plus bas à travers une immensité opaque. Le cadran enregistrait sept mille cinq cents mètres.
— Nous approchons du terme de notre croisière, a déclaré Maracot. L’an dernier mon enregistreur m’avait indiqué une profondeur de huit mille mètres. Dans quelques minutes, nous serons fixés sur notre sort. Il se peut que le choc nous réduise en bouillie. Il se peut aussi …
À ce moment précis nous avons atterri.
Jamais bébé couché par sa tendre mère sur un lit de plumes ne s’est posé plus doucement que nous, sur l’extrême-fond de l’océan Atlantique. La vase tendre, épaisse, élastique qui nous a recueillis s’est révélée un nid parfait qui nous a épargné la plus petite secousse. C’est à peine si nous avons chancelé sur notre siège ; heureusement d’ailleurs, car nous étions perchés sur une sorte de proéminence, de tertre recouvert d’une boue épaisse, gélatineuse et visqueuse : nous nous sommes balancés en équilibre instable : une bonne partie de notre base ne reposant sur rien, nous risquions de chavirer ; en fin de compte, notre cage s’est légèrement enlisée et immobilisée. Alors le docteur Maracot a regardé à travers son hublot, il a poussé un cri de surprise et il s’est précipité vers l’interrupteur pour éteindre nos lampes.
Nous avons été stupéfaits : au lieu d’être plongés dans les ténèbres, nous voyions clair. À l’extérieur il existait une lumière confuse, brumeuse, qui ressemblait au froid rayonnement d’un matin d’hiver, qui nous ouvrait un champ visuel sur quelques centaines de mètres dans chaque direction. Phénomène impossible, inconcevable ! Mais le témoignage de nos sens était là pour nous prouver la réalité. Le fond du grand Océan est lumineux.
— Pourquoi pas ? s’est écrié Maracot après deux minutes d’observation admirative. J’aurais bien dû le prévoir ! Ce limon de glorigérine ou de ptéropode n’est-il pas le produit de la décomposition de milliards de milliards de créatures organiques ? Qui dit décomposition dit luminosité phosphorescente ! Où, dans toute la création, le verrait-on mieux qu’ici ? Ah, c’est tout de même pénible d’avoir une telle démonstration sous les yeux, et de ne pas pouvoir communiquer notre science au monde !
— Et pourtant, lui ai-je fait observer, nous avons pêché une demi-tonne de gélatine de radiolaires, et nous n’avons pas détecté un rayonnement pareil.
— Ils l’avaient perdu au cours de leur long voyage jusqu’à la surface. Et qu’est-ce qu’une demi-tonne à côté de cette immensité de plaines en putréfaction lente ? Et voyez, regardez ! Les animaux des grands fonds marins pâturent sur ce tapis organique exactement comme nos vaches paissent dans les prés !
Tout un troupeau de gros poissons noirs, lourds et trapus, traversait en effet lentement le lit de l’Océan pour se diriger vers nous ; ils fouillaient comme des porcs parmi les excroissances spongieuses, et ils grignotaient tout en avançant. Une grosse bête rouge, qui avait bien l’air d’une stupide vache des océans, ruminait devant mon hublot ; d’autres paissaient et broutaient ici et là ; de temps à autre elles levaient la tête pour regarder l’objet bizarre qui venait de faire son apparition parmi elles.
Je ne pouvais qu’être émerveillé par Maracot. Dans cette atmosphère viciée, assis sous l’ombre même de la mort, il obéissait encore à sa vocation de savant, et il se hâtait de transcrire diverses observations sur son carnet. Sans suivre une méthode aussi scrupuleuse, je n’en prenais pas moins force notes mentales, qui demeureront pour toujours gravées dans ma mémoire. Les plus basses plaines de l’Océan sont faites d’argile rouge ; mais ici cet argile était enduit d’alluvions gris qui formaient à perte de vue une plaine ondulée. Cette plaine n’était pas lisse ; sa surface était brisée par de nombreux mamelons bizarres comme celui où nous étions perchés ; ces accidents de terrain se détachaient dans la lumière spectrale. Entre eux flottaient et dérivaient de grands nuages de poissons étranges ; la plupart étaient inconnus de la science ; ils exhibaient toutes les couleurs de l’arc-en-ciel, avec une prédominance du noir et du rouge. Maracot les examinait avec passion.
L’air commençant à devenir irrespirable, nous avons eu recours à une nouvelle émission d’oxygène. Fait curieux : nous avions faim, tous les trois. Je serais plus exact si j’écrivais que nous éprouvions les affres d’une faim dévorante. Nous nous sommes jetés sur du bœuf en conserve, du pain et du beurre, et nous avons arrosé ce repas d’un bon whisky, dû à la prévoyance de Maracot. Mes perceptions se trouvant stimulées, je m’étais assis devant mon hublot et je mourais d’envie de fumer une dernière cigarette, quand mes yeux ont distingué quelque chose qui a déclenché dans ma tête un tourbillon de pensées et d’anticipations.
J’ai dit que la plaine grise ondulée de chaque côté de notre cage était parsemée de mamelons. L’un d’eux, particulièrement important, était situé juste devant mon hublot, à une dizaine de mètres environ. Il portait sur son flanc une certaine tache. En l’observant plus attentivement, j’ai constaté à mon vif étonnement que cette tache se prolongeait et faisait le tour du renflement. Quand on est si près de la mort, il en faut beaucoup pour s’émouvoir à propos de choses de ce monde. Toutefois le souffle m’a manqué, et mon cœur s’est arrêté de battre, quand j’ai tout à coup compris qu’il s’agissait d’une frise et que, tout abîmée et couverte de barnacles qu’elle était, elle avait sûrement été sculptée autrefois par une main humaine. Maracot et Scanlan se sont précipités à mon hublot et ils ont contemplé avec un égal ahurissement cette trace des activités omniprésentes de l’homme.
— C’est de la sculpture, pour sûr ! s’est exclamé Scanlan. Je parie que cette grosse bosse a été le toit d’une maison. Mais dans ce cas, les autres seraient aussi des maisons. Dites donc, patron, nous sommes tombés pile sur une vraie ville !
— Oui, vraiment c’est une ancienne cité, a opiné Maracot. La géologie nous enseigne que les mers ont été jadis des continents et les continents des mers ; mais j’avais toujours repoussé l’idée qu’à une époque aussi récente que l’ère quaternaire un effondrement atlantique avait pu se produire. La relation par Platon des racontars égyptiens aurait donc un fondement de vérité ? Ces formations volcaniques indiqueraient que l’effondrement en question a été provoqué par un séisme.
— Ces dômes sont disposés avec une régularité évidente, ai-je remarqué. Je commence à penser qu’il ne s’agit pas de maisons séparées, mais de coupoles qui ornent le toit d’un énorme édifice.
— Je crois que vous avez raison, a dit Scanlan. Il y en a quatre gros aux angles et des plus petits dans les alignements intermédiaires. Si nous pouvions voir l’ensemble, nous constaterions là que c’est bel et bien un bâtiment. Vous pourriez y loger toute l’usine Merribank, et pas mal d’autres par surcroît !
— Il a été enseveli jusqu’au toit par le dégouttement continu d’en haut, a expliqué Maracot. D’autre part, il s’est conservé sans se pourrir. Nous avons une température constante légèrement supérieure à zéro degré dans les grands fonds ; elle arrêterait le processus de destruction. Même la dissolution des dépôts bathyques qui pavent le lit de l’Océan et qui nous donnent incidemment de la luminosité doit être très lente. Mais, mon Dieu, ce marquage n’est pas une frise ; c’est une inscription !..
Sans aucun doute, il ne se trompait pas. Le même symbole se retrouvait un peu partout. Ces taches étaient indiscutablement des lettres d’un alphabet archaïque.
— … J’ai un peu étudié l’antiquité phénicienne, et dans ces caractères je trouve quelque chose qui éveille en moi des souvenirs ! a ajouté notre chef. Hé bien, nous avons vu une cité engloutie des temps anciens, mes amis, et nous emporterons dans la tombe de merveilleuses connaissances ! Il n’y a plus rien à apprendre. Notre livre de science est fermé. Je suis d’accord avec vous : plus tôt viendra la fin, mieux cela vaudra.
Elle ne pouvait plus tarder. L’air était stagnant, irrespirable, si chargé de gaz carbonique que l’oxygène pouvait à peine se frayer son chemin contre la pression. En nous mettant debout sur le canapé, nous pouvions aspirer un peu d’air plus pur, mais les vapeurs méphitiques s’élevaient peu à peu. Le docteur Maracot s’est croisé les bras avec résignation, et sa tête s’est inclinée sur sa poitrine. Vaincu par le bioxyde de carbone, Scanlan était déjà étalé de tout son long sur le plancher. Moi, j’avais la tête qui tournait, et je sentais un poids intolérable m’oppresser. J’ai fermé les yeux, et j’ai compris que j’allais perdre connaissance. Alors j’ai soulevé mes paupières pour adresser un dernier coup d’œil au monde que je quittais … et j’ai bondi en poussant une exclamation de stupéfaction.
Un homme nous regardait par le hublot !
Était-ce du délire ? J’ai empoigné Maracot par l’épaule et je l’ai secoué violemment. Il s’est redressé, et bouche bée, incapable d’émettre un son, il a contemplé cette apparition. Puisqu’il voyait la même chose que moi, il ne s’agissait donc pas d’une fiction jaillie de mon cerveau. La tête qu’encadrait le hublot était longue, mince, bronzée ; elle se terminait par une courte barbe en pointe ; deux yeux vifs furetaient dans notre cage, pour bien noter tous les détails de notre situation. Notre stupéfaction n’avait d’égale que celle que nous lisions dans le regard de l’homme. Nos lampes étaient allumées. Vraiment, ce devait être pour l’inconnu un tableau bien extraordinaire que cette chambre de mort dans laquelle un homme inanimé gisait par terre, tandis que deux autres le dévisageaient avec les traits torturés, déformés d’agonisants par asphyxie ! Maracot et moi, nous avions la main à notre gorge, et nos poitrines haletantes exprimaient un message de désespoir. L’homme a fait un geste de la main et il s’est éloigné précipitamment.
— Il nous abandonne à notre sort ! s’est écrié Maracot.
– À moins qu’il ne soit allé chercher du secours. Transportons Scanlan sur le canapé. Il va mourir si nous le laissons par terre …
Nous avons relevé et transporté le mécanicien, et nous avons calé sa tête contre des coussins. Il avait le visage gris et il délirait doucement ; mais son pouls, bien que faible, battait régulièrement.
— … Il ne faut pas encore désespérer, ai-je grogné.
— Mais c’est de la folie ! s’est exclamé Maracot. Comment un homme pourrait-il vivre au fond de l’Océan ? Comment respirerait-il ? C’est une hallucination collective. Mon jeune ami, nous sommes en train de devenir fous !
J’ai regardé le paysage gris, désert, qu’éclairait cette sinistre lumière spectrale, et je me suis dit que Maracot devait avoir raison. Mais soudain, j’ai eu l’impression que le décor s’agitait. Des ombres se dessinaient dans l’eau, au loin. Et puis leurs formes ont pris de la consistance, se sont affirmées, solidifiées, jusqu’à devenir des silhouettes en mouvement. Oui, c’étaient des hommes, c’était une véritable foule qui se précipitait dans notre direction à travers l’eau, qui arrivait devant nos hublots, s’y pressait et s’y bousculait, nous montrait du doigt et gesticulait dans une discussion animée. Plusieurs femmes s’étaient mêlées aux hommes. L’un de ceux-ci, solidement bâti, avait une très grosse tête et une longue barbe noire ; incontestablement il détenait de l’autorité. Il a procédé à un rapide examen de notre coquille d’acier ; comme une partie de notre base débordait du mamelon sur lequel nous nous étions immobilisés, il a pu voir qu’une trappe était aménagée dans le fond. Il a fait partir un messager, pendant qu’il multipliait des signes énergiques, impératifs pour que de l’intérieur, nous ouvrions la trappe.
— Pourquoi pas ? ai-je demandé à Maracot. Nous avons le choix entre deux morts : la noyade ou l’asphyxie. Je suis incapable de demeurer ici plus longtemps.
— Nous pouvons fort bien éviter la noyade. L’eau pénétrant par la base ne pourra pas s’élever au-dessus du niveau de l’air comprimé. Donnez à Scanlan un peu de whisky. Il faut qu’il fasse un effort, même si ce doit être le dernier …
J’ai fait ingurgiter de force un peu d’alcool à notre mécanicien. Il a tout avalé, et il a regardé autour de lui avec des yeux ahuris. Nous l’avons installé et maintenu sur son séant. Il était encore à demi étourdi ; en quelques mots je lui ai expliqué la situation.
— … Nous courons le risque d’un empoisonnement par le chlore si l’eau atteint les batteries, a expliqué Maracot. Ouvrez toutes les bouteilles d’air, car plus nous aurons de pression, moins nous aurons d’eau. Bien ! Aidez-moi maintenant à tirer sur le levier.
Nous avons réuni nos forces pour actionner le levier, et nous avons levé la plaque circulaire qui constituait le fond de notre petite maison. J’avais l’impression que je me suicidais délibérément. L’eau verte, qui brillait et miroitait sous nos lampes, s’est ruée à l’intérieur avec force glouglous. Elle a grimpé jusqu’à nos pieds, jusqu’à nos genoux, jusqu’à notre taille ; puis elle s’est arrêtée. Mais la pression de l’atmosphère devenait intolérable. Nous avions des bourdonnements dans la tête, on battait le tambour dans nos oreilles. Nous n’aurions certainement pas survécu longtemps.
Pour ne pas tomber dans l’eau, nous nous étions agrippés au porte-bagage. Dans cette position, nous ne pouvions plus regarder par les hublots, ni surveiller les préparatifs qui précédaient notre délivrance. En fait, il nous semblait incroyable que nous pussions être effectivement secourus ; mais l’air réfléchi et résolu de ces inconnus, et spécialement de leur chef barbu, autorisait une vague espérance. Tout à coup nous avons aperçu sa tête dans l’eau, à nos pieds ; quelques secondes plus tard, il était debout à côté de nous. Il n’était pas grand, mais très robuste ; il m’arrivait à l’épaule ; il nous examinait avec de grands yeux bruns pleins d’une confiance amusée, qui avaient l’air de nous dire : « Pauvres types ! Vous croyez que vous êtes dans le pétrin ? Rassurez-vous : nous allons vous en sortir ! »
Un détail m’a laissé pantois : l’homme, en admettant qu’il fût un échantillon de la même humanité que la nôtre, avait tout autour de lui une enveloppe transparente qui protégeait sa tête et son buste en ne laissant dégagés que ses bras et ses jambes. Si transparente que dans l’eau elle était invisible. À l’air elle scintillait comme de l’argent, mais elle était aussi claire que le verre le plus fin. J’ai remarqué qu’il portait une curieuse bosse sur chaque épaule, à l’intérieur de sa gaine protectrice : elle ressemblait à une boîte oblongue percée de nombreux trous. Il avait l’air de porter des épaulettes.
Quand notre nouvel ami nous a rejoints, un autre homme est apparu par la trappe ouverte du fond, et il a lancé successivement trois grosses bulles de verre qui sont venues flotter à la surface de l’eau. Puis six petites boîtes ont été passées au chef de la main à la main ; il nous les a fixées aux épaules par des courroies. Déjà je commençais à comprendre que la vie de ce peuple étrange ne comportait aucune infraction aux lois naturelles, et que l’une des deux boîtes devait produire de l’air, l’autre absorbant les déchets de notre organisme. Ensuite il nous a recouverts chacun d’une bulle de verre : c’était un costume transparent, analogue au sien, qui se refermait étroitement sur les avant-bras et à la taille par des bandes élastiques, si bien que l’eau ne pouvait pénétrer. À l’intérieur de ce costume, nous pouvions enfin respirer tout à notre aise. Ç’a été pour moi une grande joie que de voir Maracot m’adresser son vieux clin d’œil derrière ses grosses lunettes, tandis que le large sourire de Bill Scanlan me rassurait sur sa résurrection. Notre sauveteur nous a soigneusement inspectés l’un après l’autre avec un air de satisfaction grave ; puis il nous a fait signe de le suivre par la trappe et de sortir sur le lit de l’océan. Une douzaine de mains se sont tendues vers nous pour nous aider à passer par la trappe, et nous avons fait nos premiers pas vacillants sur le limon visqueux.
Aujourd’hui encore ce souvenir m’électrise ! Nous nous trouvions donc là, tous les trois, indemnes et à notre aise au fond d’un gouffre d’eau de huit mille mètres de haut ? Où était la pression terrifiante sur laquelle tant de savants avaient débridé leur imagination ? Elle ne nous affectait pas davantage que les poissons raffinés qui nageaient autour de nous. Certes, nos corps étaient protégés par ces légères cloches de matière vitreuse qui était plus robuste, plus solide que l’acier le mieux trempé ; mais nos membres, qui étaient, eux, exposés directement à l’eau, n’éprouvaient rien de plus que la ferme résistance du liquide, à la longue négligeable. C’était merveilleux de nous sentir bien en vie, tous les trois, et de regarder derrière nous la coquille d’où nous avions émergé ! Les piles n’avaient pas épuisé leur charge : notre cage présentait une apparence de féerie avec les faisceaux de lumière jaune qui s’en échappaient par chaque hublot, tandis qu’une foule de poissons se rassemblait devant les vitres. Le chef a pris Maracot par une main, et nous nous sommes mis en route à travers la fondrière aqueuse.
C’est à ce moment que s’est produit un incident tout à fait surprenant, qui visiblement a étonné autant que nous nos nouveaux compagnons. Au-dessus de nos têtes, un petit objet noir est descendu de l’obscurité des eaux supérieures et se balançant doucement, s’est posé sur le lit de l’océan à peu de distance de l’endroit où nous marchions. C’était, bien sûr, la ligne de sonde des grands fonds du Strafford ; le capitaine procédait au sondage de ce gouffre auquel serait associé le nom de notre expédition. Nous l’avions déjà vue en cours de descente ; le drame de notre disparition avait suspendu l’opération ; mais elle avait repris ; personne à bord ne devait se douter que la ligne de sonde était tombée presque à nos pieds. Le capitaine ne devait pas non plus se rendre compte qu’elle avait touché le fond, car elle demeurait immobile dans la vase. Au-dessus de moi s’étirait la corde de piano tendue qui me reliait par huit mille mètres d’eau au pont de notre navire. Oh, si je pouvais écrire un billet et l’attacher à cette sonde ! L’idée certes était absurde ; mais pourquoi tout de même ne pas faire parvenir un message prouvant que nous n’étions pas morts ? Ma veste était recouverte par la cloche de verre, et je ne pouvais pas fouiller dans mes poches. Mais au-dessous de la taille rien ne me gênait : mon mouchoir se trouvait par hasard dans la poche de mon pantalon. Je l’ai tiré et je l’ai attaché au fil de sonde. Aussitôt après le poids s’est libéré grâce à son mécanisme automatique et j’ai vu mon tortillon blanc remonter vers le monde que je ne reverrais plus. Nos nouveaux amis ont examiné les soixante-quinze livres de plomb avec un vif intérêt : finalement ils ont décidé de les emporter avec eux.
À peine avions-nous franchi deux cents mètres en nous faufilant entre les mamelons, que nous nous sommes arrêtés devant une petite porte carrée, encadrée par des colonnes solides. En travers du linteau il y avait une inscription. La porte était ouverte : nous avons pénétré dans une grande salle nue. Une manivelle actionnait de l’intérieur un panneau glissant qui a été tiré derrière nous. Nous ne pouvions rien entendre sous nos casques de verre ; mais au bout de quelques minutes, nous nous sommes aperçus qu’une pompe puissante devait fonctionner quelque part, car le niveau de l’eau descendait avec rapidité. Moins d’un quart d’heure après, nous nous trouvions sur un dallage légèrement en pente, tandis que nos amis s’affairaient à nous retirer nos costumes transparents, Bientôt nous avons respiré de l’air pur dans une atmosphère chaude, bien éclairée. Les bruns habitants du gouffre nous souriaient, nous caressaient amicalement, nous serraient la main. Ils parlaient une langue rauque, dont le sens nous échappait totalement ; mais ce que nous comprenions bien, c’était leur sourire, et la lueur qui s’était allumée dans leurs yeux : de tels signes ne trompent nulle part dans le monde, même pas à huit mille mètres sous la surface des eaux. Nos costumes transparents ont été accrochés à des porte-manteaux scellés aux murs, et nos amis nous ont dirigés vers une porte intérieure qui ouvrait sur un long couloir en pente. Quand elle s’est refermée derrière nous, plus rien ne nous rappelait le fait stupéfiant que nous étions les hôtes involontaires d’une race inconnue au fond de l’océan Atlantique, retranchés à jamais du monde auquel nous appartenions.
Nous sentions maintenant notre fatigue, puisque cette tension effroyable avait cessé. Bill Scanlan lui-même, bien qu’il fût un Hercule de poche, traînait les pieds sur le plancher, tandis que Maracot et moi n’étions que trop heureux de nous appuyer lourdement sur nos guides. Cependant, malgré mon épuisement, je notais au passage quantité de détails. L’air provenait certainement d’une machine pneumatique, car il était diffusé par bouffées à travers des ouvertures circulaires pratiquées sur les murs. La lumière artificielle trouvait sa source à coup sûr dans une application du système de fluorescence qui commençait à retenir l’attention de nos ingénieurs européens : elle se diffusait à partir de cylindres allongés en verre clair, qui étaient suspendus le long des corniches des couloirs. Et puis nous avons été introduits dans un grand salon aux tapis épais, meublé de fauteuils dorés et de canapés inclinés évoquant confusément des tombeaux égyptiens. La foule est demeurée à l’extérieur. Seuls le chef barbu et deux serviteurs sont restés avec nous.
— Manda !
Le chef a répété ce mot à plusieurs reprises, en se frappant la poitrine. Ensuite il nous a désignés à tour de rôle, et il a répété Maracot, Headley, Scanlan jusqu’à ce qu’il les prononce parfaitement. Ces présentations faites, il nous a conviés d’un geste à nous asseoir, et il a dit quelque chose à l’un des serviteurs. Celui-ci a quitté la pièce pour revenir peu après en compagnie d’un très vieux gentleman aux cheveux blancs et à la barbe fleurie qui était coiffé d’un bizarre chapeau conique en drap noir. J’aurais déjà dû expliquer que les habitants de ce monde inconnu portaient des tuniques de couleur qui descendaient jusqu’au genou, avec de hautes bottes en peau de poisson ou en galuchat. Apparemment le vénérable vieillard était médecin, puisqu’il nous a examinés successivement. Il plaçait une main sur notre front et il fermait les yeux comme pour recevoir une impression mentale sur notre santé. Il n’a pas paru très satisfait de son examen : il a hoché la tête et a prononcé quelques paroles graves à l’adresse de Manda. Aussitôt le chef a donné un nouvel ordre à son serviteur, qui est sorti pour rapporter un plateau chargé de comestibles et d’une bouteille de vin. Nous étions trop las pour nous enquérir de ce que nous mangions, mais après ce repas nous nous sommes sentis beaucoup mieux. Nous avons été ensuite conduits dans une autre chambre ; trois lits y avaient été préparés ; je me suis laissé tomber sur le premier à ma portée. J’ai le souvenir confus de Bill Scanlan venant s’asseoir à côté de moi.
— Vous savez, cette gorgée de whisky m’a sauvé la vie ! m’a-t-il murmuré. Mais enfin, où sommes-nous ?
— Je n’en sais pas plus que vous.
— Hé bien, je me passerai du nom ! m’a-t-il répondu en bâillant et en gagnant son lit. Mais dites donc, il était fameux, leur vin ! Dieu merci, Bacchus n’est jamais descendu par ici …
Voilà les derniers mots que j’ai entendus, avant de sombrer dans le plus profond sommeil de toute ma vie.
CHAPITRE III
Quand je me suis réveillé, j’ai tout d’abord été incapable d’imaginer où je me trouvais. Les événements de la veille ressemblaient à des cauchemars confus, et je ne parvenais pas à croire que je devais les accepter en tant que faits. Émergeant de mon scepticisme, j’ai regardé autour de moi ; j’ai vu cette grande chambre aux murs nus, sans fenêtres, ces tubes de lumière rougeâtre, palpitante, qui couraient le long des corniches, ces quelques meubles, ces deux autres lits ; j’ai entendu le ronflement sonore, sur le mode aigu, que j’avais si souvent surpris à bord du Stratford dans la cabine de Maracot … C’était trop invraisemblable pour être vrai ! Il a fallu que je tâte la couverture de mon lit, que je constate l’étrange matière tissée et les fibres séchées de quelques plantes marines dont elle était faite, pour que je puisse réaliser enfin l’aventure inconcevable qui nous était arrivée. J’étais en train d’y réfléchir quand a retenti un grand éclat de rire : Bill Scanlan s’était dressé sur son séant.
— Salut, patron ! a-t-il crié en voyant que j’étais réveillé.
— Vous me semblez en pleine forme, lui ai-je répondu avec humeur. Je ne trouve pas pourtant que nous ayons tellement de sujets de rigolade !
— Hé bien, j’avais un soupçon de cafard, tout comme vous, quand j’ai ouvert les yeux ! Et puis il m’est venu une idée assez originale ; c’est elle qui m’a fait rire.
— Je ne demanderais pas mieux que de rire moi aussi ! ai-je soupiré. Quelle a été votre idée ?
— Hé bien, patron, je pensais que ç’aurait été rudement drôle si nous nous étions tous attachés à cette sonde de grands fonds. Avec nos cuirasses de verre et nos épaulettes, nous aurions pu respirer tout au long de la remontée. Alors notre vieux bonhomme Howie aurait regardé par-dessus bord, et il nous aurait vus tous les trois. Pour sûr, il se serait imaginé qu’il nous avait pris à l’hameçon. Sapristi, il en aurait fait une tête !
Nos rires conjugués ont tiré le docteur Maracot de son sommeil ; il s’est soulevé sur son lit avec une expression de stupéfaction égale à la mienne. J’ai oublié nos soucis en l’écoutant ; à ses commentaires se mêlaient tantôt une joie extasiée devant la perspective d’un champ d’études aussi vaste, tantôt un chagrin profond car il ne pouvait absolument pas espérer communiquer ses découvertes à ses confrères de la terre. Néanmoins il a condescendu à revenir aux nécessités du moment.
— Il est neuf heures … a-t-il dit.
Nous avons confronté nos montres : toutes trois indiquaient neuf heures ; mais était-ce neuf heures du matin ou neuf heures du soir ?
— … Il faut que nous tenions à jour un calendrier, a repris Maracot. Nous sommes descendus le 3 octobre. Nous sommes arrivés ici le soir du même jour. Combien de temps avons-nous dormi ?
— Ma foi, peut-être bien un mois ! a répondu Scanlan. Je ne me rappelle pas avoir dormi aussi profondément depuis le jour où Mickey Scott m’a knock-outé au sixième round !
Nous nous sommes habillés et nous avons fait notre toilette, car nous disposions de toutes les commodités de la civilisation. La porte était verrouillée ; donc nous étions prisonniers. En dépit de l’absence apparente de toute ventilation, l’atmosphère demeurait très agréable ; nous avons découvert que l’air était renouvelé par de petits trous percés dans le mur. Il y avait certainement aussi une source de chauffage central, puisqu’aucun poêle n’était visible et que la température était douce. J’ai remarqué sur l’un des murs un bouton ; je l’ai pressé ; c’était, comme je m’y attendais, une sonnette ; la porte s’est ouverte aussitôt, et un petit homme brun, vêtu d’une robe jaune, s’est encadré sur le seuil. Il nous a regardés avec affabilité ; ses yeux nous ont interrogés.
— Nous avons faim, a déclaré Maracot. Pourriez-vous nous apporter à manger ?
L’homme a secoué la tête en souriant. De toute évidence il n’avait pas compris un mot.
Scanlan a alors tenté sa chance en lui déversant à l’oreille un flot de slang très américain, mais il n’a obtenu en réponse que le même sourire aimable. À mon tour, j’ai ouvert ma bouche, y ai enfoncé un doigt : notre visiteur a vigoureusement approuvé de la tête, et en hâte il a refermé la porte.
Dix minutes plus tard, elle se rouvrait ; deux serviteurs ont roulé une petite table devant nous. Si nous nous étions trouvés au Biltmore Hotel, nous n’aurions pas fait meilleure chère. Il y avait du café, du lait chaud, des petits pains, d’exquis poissons plats, et du miel. Pendant une demi-heure nous avons été trop occupés pour discuter de la provenance de ces aliments. Les deux serviteurs ont reparu ; ils ont remporté la table, et ils ont soigneusement refermé la porte derrière eux.
– À force de me pincer, a dit Scanlan, je suis couvert de bleus. Est-ce un rêve ou quoi ? Dites, doc, c’est vous qui nous avez entraînés dans cette aventure ; il me semble qu’il vous appartient de nous dire comment vous voyez les choses.
Le docteur Maracot a hoché la tête.
— Moi aussi, je vis un rêve ; mais quel rêve merveilleux ! Quelle histoire pour le monde, si seulement nous pouvions la lui faire connaître !
— Une chose est sûre, ai-je déclaré. C’est qu’il y avait du vrai dans la légende de l’Atlantide, et que certains êtres ont admirablement réussi à la continuer dans la réalité.
— Même en admettant qu’ils l’aient continuée, a dit Bill en se grattant la tête, que je sois damné si je comprends comment ils ont de l’air, de l’eau pure et le reste ! Si le canard barbu que nous avons vu hier soir venait prendre de nos nouvelles, il nous donnerait peut-être la clef de l’énigme.
— Comment le pourrait-il, puisque nous ne parlons pas la même langue ?
— Hé bien, nous nous servirons de nos facultés d’observation ! a répondu Maracot. J’ai déjà appris une chose, en goûtant le miel du petit déjeuner. C’était du miel synthétique, comme on en fabrique sur la terre. Mais si c’est du miel synthétique, pourquoi le café et la farine ne seraient-ils pas également synthétiques ? Les molécules des éléments sont comme les pièces d’une boîte de construction, et ces pièces se trouvent tout autour de nous. Nous n’avons qu’à savoir en choisir certaines, ou parfois une seule, pour fabriquer une nouvelle substance. Le sucre devient de l’amidon, ou de l’alcool, rien qu’en changeant de pièces. Qu’est-ce qui change les pièces ? La chaleur. L’électricité. Ou autre chose peut-être que nous ignorons. Quelques pièces se modifient toutes seules : le radium devient du plomb, l’uranium devient du radium sans que nous ayons besoin d’y toucher.
— Vous croyez donc qu’ils sont très avancés en chimie ?
— J’en suis sûr ! Après tout, ils ont tout à portée de la main. L’hydrogène et l’oxygène proviennent de l’eau de mer. Ces masses de végétation constituent de l’azote et du carbone. Dans les dépôts bathyques il y a du phosphore et du calcium. Avec des préparations adroites et des connaissances suffisantes, que ne pourraient-ils pas produire ici ?
Maracot allait se lancer dans une conférence de chimie, mais la porte s’est ouverte, et Manda est entré en nous adressant de la main un signe amical. Il était accompagné du même gentleman très vénérable que nous avions vu la veille au soir. Sans doute ce dernier avait-il une réputation de savant, car il a prononcé plusieurs phrases, sans doute la même en langues différentes ; mais elles nous sont toutes demeurées incompréhensibles. Alors il a haussé les épaules et a dit quelques mots à Manda. Celui-ci a donné un ordre aux deux serviteurs vêtus de jaune, qui étaient restés à la porte. Ils ont disparu, mais ils sont revenus peu après, portant un curieux écran pourvu d’un montant de chaque côté. On aurait dit l’un de nos écrans de cinéma ; mais il était enduit d’une matière brillante qui scintillait à la lumière. L’écran a été placé contre l’un des murs. Le vieillard s’est alors placé à une certaine distance, et il a fait une marque sur le plancher. Se tenant à cet endroit, il s’est tourné vers Maracot et il s’est touché le front en montrant l’écran.
— Complètement cinglé ! a murmuré Scanlan. Il a des chauves-souris plein le beffroi.
Maracot a secoué négativement la tête pour montrer que nous ne comprenions toujours pas. Le vieillard a été déconcerté ; mais une idée lui est venue, et il a posé un doigt sur son propre corps ; puis il s’est tourné vers l’écran qu’il a regardé fixement en concentrant toute son attention. Presque aussitôt son image est apparue sur l’écran. Alors il nous a montrés du doigt, et notre petit groupe a pris sur l’écran la place de son image. En fait, nous ne ressemblions guère à notre réalité. Scanlan avait l’air d’un comique chinois, et Maracot d’un cadavre en décomposition avancée. Mais il était clair que cette image nous représentait tels que nous voyait l’opérateur.
— C’est une réflexion de pensée ! me suis-je écrié.
— Exactement ! a dit Maracot. Il s’agit là d’une invention extraordinaire, qui n’est pourtant, en somme, qu’une combinaison de la télépathie et de la télévision.
— Je n’aurais jamais cru que je me verrais un jour aux actualités, en admettant que cette tête de Chinetoque soit réellement la mienne, a déclaré Scanlan. Une supposition que nous rapportions toutes ces nouvelles au rédacteur en chef du Ledger ; hé bien, il cracherait assez pour me permettre de terminer mes jours en beauté ! Nous gagnerions le gros lot si seulement nous pouvions faire parvenir là-haut leurs machines.
— Voilà où réside la difficulté, ai-je murmuré. Par saint George, nous bouleverserions le monde entier si nous y revenions un jour ! Mais pourquoi nous fait-il des signes ?
— Le vieux bonhomme voudrait que vous vous essayiez au truc, doc !
Maracot a pris la place que lui indiquait le vénérable, et son cerveau puissant, clair, a aussitôt réfléchi ses pensées à la perfection. Nous avons vu une image de Manda, puis l’image du Stratford tel que nous l’avions quitté.
Manda et le vieux savant approuvaient de la tête ; Manda a esquissé un grand geste avec ses mains : d’abord vers nous, ensuite vers l’écran.
— Ils veulent que nous leur disions tout, voilà leur idée ! me suis-je écrié. Ils veulent connaître par des images qui nous sommes et comment nous sommes arrivés ici.
Maracot a fait un signe de tête affirmatif pour montrer à Manda qu’il avait compris, et il a commencé à projeter une image de notre voyage ; alors Manda a levé un bras et l’a arrêté ; il a donné un ordre ; les serviteurs ont enlevé l’écran, et les deux Atlantes nous ont fait signe de les suivre.
Le bâtiment était immense ; après une interminable enfilade de couloirs, nous sommes arrivés dans une grande salle avec des sièges disposés en gradins. Sur un côté se trouvait un large écran analogue à celui que nous avions vu. Face à cet écran mille personnes au moins étaient rassemblées, et ont salué notre arrivée d’un murmure bienveillant. Elles étaient des deux sexes et de tout âge ; les hommes, bruns, portaient la barbe ; les jeunes femmes étaient très belles ; les moins jeunes pleines de dignité. Nous n’avons pas eu beaucoup de temps pour les examiner, car nous avons été conduits au premier rang, et Maracot convié à prendre place sur une estrade devant l’écran. Les lumières se sont éteintes ; Manda l’a invité à commencer.
Le Professeur a magnifiquement joué son rôle. Nous avons vu notre navire descendre la Tamise, et la foule attentive a fait entendre un bourdonnement passionné devant cette image d’une grande ville moderne. Puis une carte est apparue pour expliquer notre route. Ensuite s’est dessinée la cage d’acier avec tout son équipement ; un long murmure prouvait que l’assistance la reconnaissait. Nous nous sommes revus au cours de notre plongée et quand nous avons atteint le plateau bordant le gouffre. Puis est apparu le monstre qui avait ruiné nos espoirs.
— Marax ! Marax ! ont crié les spectateurs.
Oui, ils connaissaient bien cette bête, et ils la redoutaient ! Un silence terrifié a accueilli l’image du monstre aux prises avec notre câble, et un gémissement horrifié a rempli la salle quand le câble s’est rompu et quand nous sommes tombés dans le gouffre. En un mois d’explications, nous n’aurions pas mieux exposé toute notre aventure que dans cette demi-heure de démonstration par l’image.
Quand l’assistance s’est levée, elle nous a accablés de nombreuses marques de sympathie ; très entourés, nous avons reçu quantité de caresses destinées à nous montrer que nous étions les bienvenus en Atlantide. Nous avons été ensuite présentés à quelques notabilités, mais les chefs ne se distinguaient sans doute dans ce pays que par leur sagesse, car tous les habitants semblaient appartenir à la même catégorie sociale, et ils étaient généralement habillés de la même manière. Les hommes portaient une tunique safran tombant jusqu’aux genoux, avec une ceinture et de hautes bottes en une rude matière écailleuse qui devait provenir de la peau d’un animal marin. Les femmes suivaient une mode classique : des robes amples roses, bleues ou vertes, ornées de bouquets de perles ou de coquilles opalescentes ; beaucoup étaient d’une beauté dépassant toute comparaison terrestre ; j’en ai vu une … Mais pourquoi alourdirais-je d’une affaire privée un récit destiné au public ? Sachez simplement que Mona est la fille unique de Scarpa, l’un des chefs du peuple, et que dès notre première rencontre, j’ai lu dans ses yeux noirs un message de sympathie et de compréhension qui m’est allé droit au cœur, de même que ma gratitude et mon admiration trouvaient sans doute le chemin du sien. Je n’ai pas besoin pour l’instant d’en dire plus long sur cette exquise jeune fille ; une influence nouvelle, et puissante, était entrée dans ma vie, voilà tout. Quand j’ai vu Maracot gesticuler avec une animation inaccoutumée devant une dame aimable, Scanlan traduire son émerveillement par une pantomime qui a fait rire un groupe de jeunes filles, je me suis dit que mes compagnons commençaient eux aussi à trouver que notre situation tragique comportait au moins un aspect agréable. Si nous étions morts au monde, au moins avions-nous découvert hors de ses limites une autre vie qui nous promettait quelques compensations à ce que nous avions perdu.
Dans le courant de la journée, nous avons été guidés par Manda et d’autres amis à travers l’immense édifice que nous habitions. Au cours des siècles accumulés, il s’était tellement enfoncé dans le lit de la mer qu’on ne pouvait y accéder que par le toit ; à partir du toit, des couloirs descendaient jusqu’à deux ou trois cents mètres au-dessous du hall d’arrivée. Le lit de la mer à son tour avait été creusé : des tunnels ouverts dans toutes les directions descendaient dans les entrailles de la terre. On nous a montré la machine à fabriquer de l’air et les pompes qui le répandaient partout. Maracot a souligné que cet air n’était pas uniquement composé d’oxygène et d’azote, mais que des petites cornues fournissaient d’autres gaz, qui ne pouvaient être que de l’argon, du néon, et d’autres constituants de l’atmosphère dont les savants de la terre commençaient à mesurer l’importance. Les bacs de distillation pour obtenir de l’eau pure et les gigantesques générateurs d’électricité étaient dignes d’intérêt, mais les appareils utilisés étaient si compliqués qu’il nous a été difficile d’en suivre le fonctionnement. Je peux seulement dire ce que j’ai vu de mes propres yeux, et goûté avec ma propre langue : des produits chimiques, gazeux ou liquides, étaient versés dans des appareils variés, puis traités à la chaleur, à la pression, ou à l’électricité, pour donner de la farine, du thé, du café ou du vin.
Au cours de nos promenades dans la partie de l’édifice que l’on nous faisait visiter, une chose nous a sauté aux yeux : c’est que l’existence dans la mer avait été prévue, et l’étanchéité du bâtiment réalisée bien avant que le pays ne sombrât sous les vagues. Évidemment la logique nous interdisait de penser que de telles précautions avaient été prises après ; mais nous avons bel et bien relevé à de nombreux signes que l’ensemble de l’édifice avait été construit dans le seul but de constituer une arche pouvant servir de refuge. Les énormes cornues et les cuves dans lesquelles l’air, l’alimentation, l’eau distillée et les autres produits de nécessité étaient fabriqués se trouvaient encastrées dans les murs et dataient certainement de l’aménagement originel. Il en était de même pour les chambres d’évacuation, pour les ateliers de silice où se façonnaient les cloches vitreuses, ainsi que pour les formidables pompes qui manœuvraient l’eau. Tout avait été préparé par l’habileté et la prévoyance de ce peuple antique qui, d’après ce que nous avons pu apprendre, avait allongé un bras vers l’Amérique Centrale et l’autre vers l’Égypte, laissant ainsi des traces sur la terre, même après sa disparition dans l’Atlantique. Quant à ses descendants qui se trouvaient à notre contact, nous les avons jugés quelque peu dégénérés par rapport à leurs ancêtres, dont ils n’avaient conservé qu’un peu de science sans avoir eu l’énergie d’y ajouter quelque chose de leur cru. Bien qu’ils possédassent des pouvoirs merveilleux, ils nous donnaient l’impression de manquer étonnamment d’initiative, puisqu’ils n’avaient pas fait fructifier l’héritage qu’ils avaient reçu. Je suis sûr que si Maracot avait bénéficié au départ de leurs connaissances, il aurait obtenu en peu de temps de bien plus grands résultats. Scanlan en tout cas émerveillait les Atlantes par sa vivacité d’esprit et son adresse manuelle ; lorsque nous avions quitté le Stratford il avait mis un harmonica dans la poche de sa veste, et il en jouait pour la plus grande joie de nos compagnons : ils faisaient cercle autour de lui et ils l’écoutaient en extase, comme nous aurions pu écouter Mozart, tandis qu’il modulait les chansons populaires de son pays.
J’ai dit que nous n’avions visité qu’une partie de l’édifice. En fait, il y avait un couloir aux dalles bien usées, fort fréquenté par les Atlantes, mais que nos guides évitaient toujours. Bien entendu, notre curiosité a été éveillée et, un soir, nous avons décidé que nous procéderions à une petite exploration pour notre compte. Nous nous sommes donc glissés hors de notre chambre et nous nous sommes dirigés vers ce quartier inconnu à une heure où nous ne risquions pas de rencontrer grand monde.
Le couloir aboutissait à une haute porte voûtée en or massif. Nous l’avons poussée et nous nous sommes trouvés dans une grande salle carrée qui avait bien soixante mètres de côté. Les murs étaient peints de couleurs vives, décorés de tableaux et de statues représentant des créatures grotesques surmontées de coiffures énormes, comme en portent pour les cérémonies nos Indiens d’Amérique. Au fond de cette grande salle, s’élevait une colossale statue assise, jambes croisées comme un Bouddha, mais absolument dépourvue de la bienveillance généralement inscrite sur les traits placides de la divinité hindoue. C’était au contraire une figure de colère qui ouvrait la bouche et qui avait des yeux féroces ; d’autant plus féroces qu’ils étaient rouges, et que deux lampes électriques brillaient dans leur cavité. Sur ses genoux un grand four était posé ; en approchant, nous nous sommes aperçus qu’il était rempli de cendres.
— Moloch ! s’est écrié Maracot. Moloch ou Baal. Le vieux dieu des races phéniciennes !
— Seigneur ! me suis-je exclamé à mon tour en me rappelant quelques souvenirs remontant à l’antique Carthage. Ne me dites pas que ce peuple si aimable se livre à des sacrifices humains !
— Oh, oh, patron ! a protesté Scanlan. J’espère que ces pratiques sont réservées à leurs familles ! Nous ne tenons absolument pas à ce qu’ils essaient ce petit jeu sur nous.
— Non, ai-je répondu. Je pense qu’ils ont appris leur leçon. Le malheur enseigne à l’homme d’avoir pitié de son prochain.
— Très juste ! a opiné Maracot en remuant les cendres. C’est le vieux dieu traditionnel, mais son culte a gagné en douceur. Ce sont des miches de pain calcinées, ou quelque chose comme cela. Mais peut-être en d’autres temps …
Nos spéculations ont été interrompues par une voix tonitruante ; plusieurs hommes en robe jaune, coiffés de chapeaux à haute calotte, nous ont entourés : manifestement c’étaient les prêtres du temple. Je crois que nous avons été tout près d’être offerts en suprême holocauste à Baal ; l’un d’entre eux avait même tiré un couteau de sa ceinture. À grand renfort de gestes et de cris, ils nous ont rondement chassés de l’enceinte sacrée.
— Sapristi ! s’est écrié Scanlan. Je vais me débarrasser de ce canard-là, moi, s’il continue à me bousculer. Attention, toi, bas les pattes !
J’ai craint quelque temps ce que Scanlan appelait « une maison à l’envers » à l’intérieur de leur temple. Heureusement, nous sommes parvenus à calmer notre mécanicien et nous avons regagné notre chambre ; mais nous nous sommes rendus compte le lendemain, par certaines réactions de Manda et de quelques Atlantes, que notre escapade les avait froissés.
Il y avait un autre lieu sacré ; celui-ci nous a été librement montré avec un résultat tout à fait inattendu, car il a inauguré un mode (oh, lent et imparfait !) de communication entre nos compagnons et nous. Dans le bas quartier du temple, une salle n’avait pour tout ornement qu’une statue d’ivoire jaunie par le temps ; elle représentait une femme tenant une lance, avec un hibou perché sur son épaule. Le gardien de cette salle était un très vieil homme ; son âge ne nous a pas empêchés de deviner qu’il appartenait à une race notablement différente ; il était d’un type plus fin, et d’une taille plus grande que les prêtres du temple. Comme nous contemplions la statue d’ivoire, Maracot et moi, en nous demandant où nous avions vu quelque chose qui lui ressemblait, le vieillard nous a parlé.
— Thea, a-t-il dit en désignant la statue.
— Par saint George ! me suis-je exclamé. Il parle grec !
— Thea ! Athena ! a répété le gardien.
Il n’y avait aucun doute. « Thea, Athena », impossible de se tromper : « Déesse, Athena ». Maracot, dont le cerveau merveilleux avait absorbé une parcelle de toutes les sciences humaines, a aussitôt commencé à poser des questions en grec classique ; mais le vieillard n’en a compris qu’une partie, et il a répondu dans un dialecte archaïque à peu près inintelligible. Cependant Maracot a réussi à obtenir quelques renseignements, et il s’est déclaré ravi d’avoir trouvé un intermédiaire grâce à qui il pourrait transmettre quelque chose à nos compagnons.
— C’est une preuve remarquable, nous a-t-il dit le soir de sa voix pointue et avec les intonations d’un professeur s’adressant à cinq cents étudiants, de la véracité de la légende. Une légende comporte toujours une base de faits, même si au cours des années les faits ont été tronqués. Vous savez, ou probablement vous ne savez pas …
— Je parie votre tête que je le sais ! a interrompu Scanlan.
— … Qu’une guerre opposait les premiers Grecs aux Atlantes lorsque cette grande île a été anéantie. Le fait est rapporté dans la relation par Solon de ce qu’il apprit des prêtres de Saïs. Nous pouvons conjecturer qu’il y avait des prisonniers grecs aux mains des Atlantes, que certains d’entre eux étaient des fonctionnaires du temple, et qu’ils ont apporté leur religion avec eux. Pour autant que j’aie compris ce vieillard, il était héréditairement prêtre du culte ; peut-être obtiendrons-nous un jour des détails sur les anciens Atlantes.
— Pour ma part, je leur laisse leurs dévotions, a dit Scanlan. Si l’on a envie d’un dieu en plâtre, mieux vaut une jolie femme que cet épouvantail aux yeux rouges avec un seau de cendres sur les genoux.
— C’est une chance qu’ils ne nous comprennent pas, lui ai-je fait observer. S’ils nous comprenaient, vous pourriez subir le martyre des premiers Chrétiens.
— Pas tant que je leur jouerai du jazz, m’a-t-il répondu. J’ai l’impression qu’ils m’ont à la bonne, et qu’ils ne pourraient plus se passer de ma personne.
C’étaient de braves gens, et c’était une vie facile ; mais parfois tout notre cœur se reportait vers la terre natale que nous avions perdue ; alors les chères vieilles cours d’Oxford, ou les ormes antiques et la plaine familière de Harvard me hantaient l’esprit. Dans les premiers jours en Atlantide ces images me semblaient aussi éloignées qu’un paysage lunaire ; maintenant au contraire un espoir confus et incertain de les revoir commence à germer dans mon âme.
CHAPITRE IV
Quelques jours après notre arrivée, nos hôtes ou nos ravisseurs (parfois nous nous demandions comment les appeler) nous ont emmenés dans une expédition sur le fond de l’Océan. Ils étaient six, dont Manda, le chef. Nous nous sommes rassemblés dans le hall où nous avions pénétré après notre sauvetage, et nous étions à présent en état de l’examiner d’un peu plus près. Il était vaste : il mesurait au moins trente mètres dans les deux sens ; ses murs bas et son plafond étaient verdis de moisissure et de flore marine. Une longue rangée de porte-manteaux, portant des signes que j’ai supposé être des numéros, faisait le tour des murs ; à chacun était suspendue une cloche vitreuse semi-transparente et une paire d’épaulettes qui assuraient la respiration. Le plancher était formé de dalles de pierre usées, concaves. L’ensemble était brillamment éclairé par des tubes fluorescents. Nous avons endossé nos enveloppes vitreuses, et on nous a remis à chacun un solide bâton pointu d’un métal léger. Puis, par signes, Manda nous a recommandé de nous accrocher à une rampe circulaire ; lui et ses amis nous ont donné l’exemple. Nous avons vite compris pourquoi : dès que la porte extérieure s’est lentement entrouverte, l’eau de mer a déferlé à l’intérieur avec une telle force que nous aurions perdu l’équilibre si nous n’avions pas pris cette précaution. Elle nous a complètement submergés, mais sa pression était très supportable. Manda a pris la tête du groupe. Nous avons franchi la porte. L’instant d’après, nous nous retrouvions sur le lit de l’Océan ; derrière nous la porte était restée ouverte pour notre retour.
En regardant autour de nous dans cette lumière spectrale et froide qui éclaire la plaine bathybienne, nous pouvions voir sur un rayon d’au moins quatre cents mètres. Nous avons aperçu, à la limite même de ce champ visuel, une lueur très brillante qui nous a surpris. Notre guide s’est dirigé vers elle, et nous l’avons suivi en file indienne. Nous marchions lentement, à cause de la résistance de l’eau, et aussi parce que nos pieds s’enterraient à chaque pas dans le limon. Bientôt nous avons mieux distingué le phare qui nous avait intrigués. C’était notre cage, dernier vestige de notre vie terrestre, perchée sur l’une des coupoles de l’immense édifice ; ses lampes brûlaient encore. Elle était aux trois-quarts pleine d’eau ; mais l’air emprisonné avait préservé la partie qui contenait notre installation électrique. Spectacle étrange en vérité, que notre intérieur familier, avec le canapé et les instruments encore en place, tandis que plusieurs poissons de bonne taille, comme des vairons dans une bouteille, faisaient à la nage le tour de notre coquille. Les uns après les autres, nous nous sommes hissés à l’intérieur à travers la trappe ouverte ; Maracot a sauvé un carnet de notes qui flottait sur la surface de l’eau ; Scanlan et moi avons ramassé quelques affaires personnelles. Manda a examiné le thermomètre et le bathymètre avec un grand intérêt. Nous avons retiré du mur le thermomètre et nous l’avons emporté. Des savants apprendront peut-être avec curiosité que quatre degrés au-dessus de zéro représentent la température du plus bas fond marin où soit jamais descendu un homme, et qu’elle est plus élevée, à cause de la décomposition chimique du limon, que les couches supérieures de la mer.
Notre petite expédition avait, semble-t-il, un objectif plus précis qu’une banale promenade sur le lit de l’Océan. Nous étions en mission de ravitaillement. À chaque instant, je voyais nos camarades ficher d’un coup sec leurs bâtons pointus dans le limon pour empaler à chaque fois un grand poisson plat et brun, qui ressemblait un peu à notre turbot, mais qui se dissimulait si profondément dans la vase qu’il fallait des yeux exercés pour le repérer. Les petits hommes qui nous accompagnaient en ont bientôt eu deux ou trois attachés à la ceinture. Scanlan et moi avons attrapé le truc, et nous en avons capturé deux chacun ; Maracot, lui, marchait comme perdu dans un rêve, émerveillé par les beautés de l’Océan qui l’entouraient ; il se lançait dans des conférences passionnées, inaudibles sous la cloche vitreuse, mais ponctuées de vifs coups de mâchoire.
Nous avions d’abord éprouvé un sentiment de monotonie, mais nous n’avons pas tardé à constater que les plaines grises se fragmentaient en formations variées sous l’action des courants des grands fonds qui circulaient entre elles comme des fleuves sous-marins : ils découpaient des canaux dans la vase molle, et mettaient à découvert les couches inférieures, constituées par l’argile rouge qui forme la base de toutes choses sur le lit de l’Océan, et parsemées d’objets blancs ; j’ai cru que c’étaient des coquillages ; après examen, ils se sont révélés comme étant des os d’oreille de baleines, des dents de requins ou d’autres monstres marins. J’ai ramassé l’une de ces dents : elle avait quarante centimètres de long, et nous n’avons pu que remercier la Providence qu’une bête aussi redoutable fréquentât seulement les couches supérieures de l’Océan. À en croire Maracot, elle appartenait à un épaulard meurtrier ou gladiateur d’Orca. Elle m’a rappelé une observation de Mitchell Hedges : les plus gros requins qu’il avait capturés portaient sur leurs corps des traces qui montraient qu’ils avaient rencontré des bêtes encore plus formidables qu’eux.
Les grand fonds de l’Océan présentent une particularité impressionnante : j’ai dit qu’une lumière froide et constante s’élève de la lente décomposition phosphorescente des immenses étendues de matière organique ; mais plus haut, il fait nuit noire. L’effet produit est celui d’une journée d’hiver, avec un gros nuage d’orage immobile au-dessus de la terre. De ce dais sombre, tombent lentement et d’une façon ininterrompue de minuscules flocons blancs, qui miroitent sur ce sombre décor. Flocons qui ne sont pas autre chose que des coquilles d’escargots de mer ou d’autres petits animaux qui vivent et meurent dans les huit mille mètres d’eau nous séparant de la surface ; bien que beaucoup de ces coquilles se dissolvent en tombant et accroissent la quantité de sels calcaires dans l’Océan, le reste constitue au cours des siècles ce dépôt qui a enseveli la grande cité où nous habitons maintenant.
Laissant derrière nous notre cage d’acier, nous avons avancé dans la lumière incertaine du monde sous-marin et un spectacle imprévu nous est apparu. Face à nous, une tache mouvante s’est dessinée : quand nous nous sommes rapprochés, elle s’est transformée en une foule d’hommes qui portaient tous la même enveloppe vitreuse, et tiraient de larges traîneaux chargés de houille. C’était un travail pénible ; les pauvres diables, courbés en deux, halaient de toutes leurs forces les cordes en peau de requin qui leur servaient de traits. Chaque équipe avait un chef ; les chefs et les travailleurs n’étaient pas de la même race. Les travailleurs étaient grands, blonds ; ils avaient les yeux bleus et un corps athlétique. Les chefs étaient, comme je l’ai déjà indiqué, bruns et presque négroïdes ; ils avaient une charpente trapue. Sur le moment nous n’avons pas pu approfondir ce problème, mais je crois que de ces deux races l’une était héréditairement l’esclave de l’autre ; Maracot pensait qu’il s’agissait des descendants de ces prisonniers grecs dont nous avions vu la divinité Athena.
Nous avons croisé plusieurs groupes d’esclaves avant d’arriver à la mine. À cet endroit les dépôts des grands fonds et les couches argileuses qu’ils recouvraient avaient été creusés ; la grande fosse ainsi découverte consistait en couches alternées d’argile et de houille. Aux divers étages de l’excavation, des équipes étaient au travail ; les unes piquaient la houille, les autres la récoltaient pour en faire des tas qu’elles plaçaient dans des paniers hissés ensuite jusqu’au carreau. La mine était si vaste que nous ne distinguions pas l’autre face de cette fosse que tant de générations de travailleurs avaient creusée dans le lit de l’Océan. La houille, transformée par la suite en électricité, était à l’origine de la puissance motrice qui actionnait toutes les machines de l’Atlantide. À ce propos, il est intéressant de mentionner que le nom de la vieille ville a été correctement conservé dans les légendes : lorsqu’en effet nous l’avons prononcé devant Manda et d’autres, ils ont été bien surpris que nous le connaissions, et ils ont fait de grands signes de tête affirmatifs pour montrer qu’ils comprenaient.
Nous avons bifurqué sur la droite de la mine, et nous sommes arrivés devant une ligne de petites falaises basaltiques, aussi nettes et aussi luisantes que le jour où elles avaient émergé des entrailles de la terre ; leurs sommets, qui surplombaient à cent ou cent cinquante mètres, se dessinaient confusément. La base de ces falaises volcaniques plongeait dans une jungle de hautes algues, qui poussaient sur des masses de coraux crinoïdes. Nous nous sommes promenés quelque temps le long de cette jungle ; nos compagnons la battaient avec leurs bâtons et en chassaient pour nous amuser un extraordinaire assortiment de poissons et de crustacés ; de temps à autre ils en mettaient un de côté pour leur table familiale. Nous avions marché pendant près de deux kilomètres en toute insouciance quand j’ai vu Manda s’immobiliser soudainement et regarder autour de lui en manifestant par des gestes autant d’alarme que de surprise. Le sens de ce langage sous-marin, vite compris de ses compagnons, ne nous a pas échappé non plus : le docteur Maracot avait disparu.
Il nous avait certainement accompagnés à la mine de houille et jusqu’aux falaises basaltiques. Et non moins certainement il ne nous avait pas dépassés ; il devait donc se trouver quelque part derrière nous, près de la jungle d’algues marines. Nos amis étaient bouleversés ; mais Scanlan et moi, qui connaissions l’excentricité et les distractions du savant, étions persuadés qu’il n’y avait pas lieu de nous inquiéter, et que nous le découvririons bientôt, flânant autour de quelque nouveauté océanique qui l’avait captivé. Nous sommes donc revenus sur nos pas, et nous n’avions pas fait une centaine de mètres que nous l’apercevions.
Mais il courait ! Et il courait avec une agilité inattendue de la part d’un homme de science. Il est vrai que le moins athlétique des hommes peut courir quand la peur l’y oblige. Le Professeur courait, mains tendues pour demander du secours ; il butait, il chancelait, mais il courait de toute la vitesse de ses jambes. Il avait pour cela un bon motif : trois bêtes horribles le talonnaient ; c’étaient des crabes tigrés à carapace rayée de bandes noires et blanches ; leur taille valait bien celle d’un gros terre-neuve. Par chance ils ne se hâtaient que lentement en se déplaçant sur le flanc, mais ils gagnaient de vitesse notre Professeur terrorisé.
Leur souffle étant meilleur, ils auraient sans doute refermé sur lui leurs horribles pinces si nos amis n’étaient intervenus d’extrême justesse. Ils se sont élancés en brandissant leurs bâtons pointus, et Manda a allumé la puissante lampe électrique qu’il portait à sa ceinture ; surpris, les monstres ont alors préféré se réfugier dans la jungle, et nous les avons perdus de vue. Notre camarade s’est effondré sur un bouquet de corail ; son visage ravagé traduisait son épuisement. Il nous a raconté qu’il avait pénétré dans la jungle pour s’approprier un spécimen rare des chimères des grands fonds, et qu’il était tombé sur le nid de ces féroces crabes tigrés, lesquels s’étaient immédiatement lancés à sa poursuite. Ce n’est qu’après un long repos qu’il s’est déclaré prêt à se remettre en route.
Après avoir longé les falaises basaltiques, nous sommes arrivés au but de notre excursion. La plaine grise était recouverte à cet endroit par des proéminences irrégulières, et de larges mamelons ; sous leur masse reposait la cité antique. Elle aurait été complètement ensevelie sous le limon, comme Herculanum le fut par la lave du Pompéi par les cendres, si une voie d’accès n’avait pas été creusée par les survivants du temple. Cette voie était une entaille longue, en pente inclinée, qui aboutissait à une large rue bordée de grands bâtiments. Les murs de ces bâtiments étaient par endroits craquelés et fracassés, car ils n’avaient pas été construits aussi solidement que le temple, mais leur intérieur était presque partout dans le même état qu’au jour de la catastrophe, à cette exception près que la mer avait modifié, merveilleusement dans certains cas et horriblement dans d’autres, l’aspect des salles. Nos guides nous ont fait signe de ne pas visiter les premières que nous avons aperçues ; ils nous ont conduits jusqu’à ce qui avait certainement été la grande citadelle centrale, ou le palais autour duquel toute la ville s’était agglomérée. Piliers, colonnes, corniches sculptées, bas-reliefs, escaliers, dépassaient en dimensions tout ce que j’avais vu sur la terre. Les restes du temple de Karnak à Louqsor en Égypte sont ce qui s’en rapproche le plus. D’ailleurs, fait curieux, les décorations et les inscriptions à demi-effacées ressemblaient par certains détails à celles des célèbres ruines à côté du Nil, et les chapiteaux des colonnes, en forme de lotus, étaient identiques. Il n’était pas banal, croyez-moi, de marcher sur ces dalles de marbre disposées en damier, d’arpenter ces immenses salles où des statues gigantesques nous dominaient de toute leur taille, et de voir en même temps de grandes anguilles argentées glisser au-dessus de nos têtes, tandis que des poissons épouvantés s’écartaient en hâte de la lumière que nous projetions pour nous éclairer. Nous avons fait le tour des salles, non sans remarquer tous les indices du luxe et parfois même de la lascivité démentielle qui, si l’on en croit la légende, aurait entraîné sur le peuple la malédiction divine. Une petite chambre, adorablement incrustée de nacre, scintillait encore maintenant de toutes ses teintes opalescentes sous l’effet de la lumière ; une estrade décorée d’un métal jaune supportait un lit doré : nous nous trouvions peut-être dans la chambre à coucher d’une reine ; mais à côté du lit un hideux calmar noir soulevait son corps sur un rythme lent et furtif, comme si un mauvais cœur battait encore dans la pièce. J’ai été content quand nos guides nous ont fait sortir. Nous avons vu un amphithéâtre en ruines, puis une jetée avec un phare à son extrémité : la ville avait été un port de mer. Finalement nous avons quitté ces lieux sinistres pour nous retrouver dans la plaine bathybienne.
Nos aventures n’étaient pas terminées : nous allions en vivre une, alarmante pour nos compagnons comme pour nous-mêmes. Nous étions presque rentrés, quand l’un de nos guides a désigné en l’air un objet qui avait l’air de l’inquiéter. Levant le nez, nous avons vu quelque chose d’extraordinaire : des ténèbres des eaux, une énorme silhouette sombre se détachait rapidement ; tout d’abord elle a pris l’aspect d’une masse informe, mais quand elle a émergé à la lumière, nous avons vu qu’il s’agissait du cadavre d’un poisson monstrueux, qui avait littéralement éclaté puisqu’il traînait derrière lui ses entrailles. Sans doute les gaz l’avaient maintenu dans les couches supérieures de l’Océan jusqu’à ce qu’ils eussent été libérés par la putréfaction, ou par les morsures des requins ; il n’était plus resté alors que son poids brut qui avait précipité cette grosse masse au fond de la mer. Déjà au cours de notre promenade nous avions observé plusieurs grands squelettes curés par les poissons ; mais cette bête inconnue donnait l’impression qu’elle vivait encore, malgré son éventration. Nos guides nous ont poussés à l’écart du chemin emprunté par cette masse en chute libre. Nos cloches vitreuses nous ont empêchés d’entendre le bruit mat du choc contre le lit de l’Océan, mais il a dû être prodigieux, car le limon a volé en l’air en projetant mille éclaboussures. C’était un cachalot qui mesurait vingt-cinq mètres de longueur. D’après la mimique allègre de nos compagnons, j’ai deviné qu’ils sauraient fort bien utiliser les spermacetis et la graisse de l’animal. Pour l’instant, nous avons laissé là son cadavre et, ravis de notre excursion mais fourbus par manque d’entraînement, nous nous sommes débarrassés peu après de nos costumes transparents sur le plancher en pente du hall d’arrivée.
Quelques jours après notre communication cinématographique à la communauté touchant notre propre origine, nous avons assisté à une séance beaucoup plus auguste et solennelle, au cours de laquelle nous avons appris avec une grande clarté l’histoire de ce peuple remarquable. Je n’irai pas jusqu’à me vanter qu’elle ait été donnée spécialement à notre intention ; je crois plutôt que, à intervalles réguliers, les événements étaient publiquement retransmis afin que leur souvenir fût conservé, et que la séance à laquelle nous avions été conviés n’était que l’intermède d’une longue cérémonie religieuse. Quoi qu’il en soit, je vais décrire exactement ce que j’ai vu.
Nous avons été conduits dans la même grande salle où le docteur Maracot avait projeté nos propres aventures sur l’écran. Toute la communauté se trouvait réunie ; comme la première fois, des places d’honneur nous étaient réservées, juste en face du grand écran lumineux. Puis, après un long chant qui pouvait être un hymne patriotique, un très vieil homme à cheveux blancs, l’historien ou le chroniqueur de la nation, s’est levé sous les applaudissements de l’assistance ; il s’est avancé jusqu’au point d’où il pouvait émettre le plus nettement possible, et il a projeté sur l’écran une succession d’images représentant l’essor et la décadence de son peuple. Je voudrais être capable de vous communiquer leur intensité dramatique. Mes deux compagnons aussi bien que moi-même, nous avions perdu toute notion de temps et de lieu, tant nous étions absorbés par la contemplation de ces images. Quant au public, il était ému au plus profond de l’âme ; les hommes et les femmes gémissaient, versaient des larmes tandis que se déroulait la tragédie qui dépeignait l’anéantissement de leur patrie et la destruction de leur race.
Les premières images nous ont montré le vieux continent dans toute sa gloire, tel que son souvenir en a été transmis de père en fils. Nous avons en quelque sorte survolé un pays riche, légèrement accidenté, immense, bien arrosé et intelligemment irrigué, avec de grands champs de céréales, des vergers, de jolis cours d’eau, des collines boisées, des lacs paisibles et quelques montagnes pittoresques. Ce pays était parsemé de villages, de fermes, de magnifiques résidences. Puis notre attention a été sollicitée par la capitale, splendide cité située au bord de la mer ; le port était encombré de galères, ses quais disparaissaient sous les marchandises ; la sécurité de la ville était assurée par de hautes murailles, des tourelles, des douves qui en faisaient le tour, le tout sur une échelle gigantesque. Les maisons se prolongeaient sur de nombreux kilomètres à l’intérieur des terres ; au centre de la capitale se dressait un château crénelé ou une citadelle, si large, si imposante qu’elle aurait pu passer pour la création d’un rêve. On nous a montré ensuite quelques-uns des habitants qui vivaient à cet âge d’or : des vieillards sages et vénérables, des guerriers virils, des prêtres, des femmes aussi belles que distinguées, de jolis enfants, bref une race à son apogée.
Des images d’un tout autre genre ont suivi. Nous avons vu des guerres, des guerres incessantes : guerres sur terre et guerres sur mer. Nous avons vu des êtres nus et sans armes piétinés, foulés, écrasés par de grands chars ou des cavaliers revêtus d’une armure. Nous avons vu des trésors entassés par les vainqueurs. Mais au fur et à mesure que s’accroissait le nombre des riches, les visages sur l’écran devenaient plus cruels, s’imprégnaient de bestialité. D’une génération à l’autre, la race s’avilissait. Nous avons vu surgir les symboles d’une dissipation voluptueuse, d’une débauche latente, d’une dégénérescence morale, d’un progrès de la matière au détriment de l’esprit. Des jeux de brute remplaçaient les exercices virils d’autrefois. La vie de famille n’existait plus ; la culture spirituelle et intellectuelle était abandonnée. Nous avons eu devant les yeux l’image d’un peuple incapable de rester en repos et frivole, passant sans cesse d’un but à un autre, courant constamment à la conquête du bonheur et le manquant non moins constamment, mais en s’imaginant toujours qu’il pourrait le trouver dans des manifestations plus compliquées et anormales. Deux classes s’étaient développées : une classe de super-riches qui ne recherchaient que la satisfaction de leurs sens, et une classe de prolétaires dont la vie entière était consacrée à servir leurs maîtres, pour le mal comme pour le bien.
À ces tableaux en ont succédé d’autres d’une inspiration nouvelle. Des réformateurs essayaient de détourner la nation de ses détestables habitudes et de la ramener sur les voies supérieures auxquelles elle avait renoncé. Nous les avons vus, graves, sérieux, raisonnant avec le peuple, mais nous les avons vus aussi accablés par les sarcasmes et les ricanements de ceux qu’ils tentaient de sauver. Les prêtres de Baal, qui avaient progressivement permis à des spectacles, à des cérémonies irréligieuses de remplacer l’épanouissement spirituel désintéressé, menaient l’opposition aux réformes. Les réformateurs pourtant ne s’inclinaient pas. Ils continuaient à lutter pour le salut de leur peuple ; leurs visages se faisaient de plus en plus graves, inspiraient même de l’effroi : c’étaient vraiment des hommes qui lançaient des avertissements terribles, comme s’ils entrevoyaient en esprit une vision horrible. Bien peu de leurs auditeurs semblaient leur prêter une oreille attentive ; la plupart se détournaient en riant pour sombrer davantage dans le péché. Et puis le temps est venu où les réformateurs se sont découragés ; incapables de se faire entendre, ils abandonnaient ce peuple dégénéré à son destin.
Nous avons vu un spectacle étrange. Il y avait un réformateur, un homme d’une singulière force morale et physique, qui était le chef de tous les autres. Il était riche, il disposait d’influence et de pouvoirs dont certains ne semblaient pas tout à fait de cette terre. Nous l’avons vu transporté dans une sorte d’extase, en communion avec des esprits supérieurs. C’est lui qui a employé toute la science de son pays (une science qui dépassait de loin tout ce que nous, modernes, connaissons) à construire une arche destinée à servir de refuge contre les troubles à venir. Nous avons vu des myriades d’ouvriers au travail et des murs s’élever, tandis que des citoyens insouciants se gaussaient de précautions aussi compliquées qu’inutiles. D’autres personnages avaient l’air de discuter avec lui et de lui dire que s’il redoutait quelque chose, il ferait mieux de se sauver dans un lieu plus sûr. Sa réponse a été, du moins à ce que nous avons compris, que certains devaient être sauvés à ce moment décisif, et que, pour l’amour de ceux-là, il devait rester dans ce temple de sûreté. En attendant, il rassemblait ses partisans dans le temple, et il les y maintenait, car il ignorait lui-même le jour et l’heure, bien que des avertissements venus de l’au-delà lui eussent donné l’assurance que les temps étaient proches. Quand l’arche a été terminée, quand l’étanchéité des portes a été vérifiée, il a attendu la catastrophe, en compagnie de sa famille, de ses amis, de ses disciples, de ses serviteurs.
Et la catastrophe s’est produite. Même sur cet écran, elle a été terrible à observer. Dieu sait ce qu’elle a été dans la réalité ! Tout d’abord, nous avons vu une énorme montagne d’eau s’élever à une altitude incroyable au-dessus d’un océan paisible. Et puis nous l’avons vue avancer pendant des kilomètres. C’était une grande montagne luisante, lisse, coiffée d’écume ; elle s’approchait de plus en plus vite. Deux petits copeaux de bois se balançaient sur sa cime couleur de neige : quand les vagues les ont roulés vers nous, nous les avons identifiés : c’étaient deux galères fracassées. Nous avons vu la montagne frapper le rivage, se ruer sur la ville : les maisons pliaient devant elle comme un champ de blé se courbe quand une tempête le fouette. Nous avons vu des hommes, des femmes et des enfants juchés sur des toits et regardant la mort impitoyable qui survenait ; leurs visages étaient déformés par l’épouvante ; ils se tordaient les mains, ils hurlaient de terreur. Ceux-là mêmes qui avaient ri des avertissements prodigués imploraient à présent le Ciel, baisaient la terre ou tombaient à genoux en levant les bras dans un suprême appel à la pitié divine. Ils n’avaient plus le temps d’atteindre l’arche, qui se dressait au-delà de la cité : mais par milliers ils couraient s’installer dans la citadelle, qui avait été édifiée sur une hauteur ; les murailles étaient noires de monde. Et puis, tout à coup le château a commencé à s’enfoncer. Et tout a commencé à s’enfoncer. L’eau s’était répandue dans les recoins les plus profonds de la terre et les feux du centre du globe l’avaient transformée en vapeur : les fondations du sol ont été littéralement soufflées. La cité a sombré, sombré toujours, toujours plus bas … L’assistance, nous-mêmes, n’avons pu réprimer un cri devant ce spectacle horrible. La jetée s’est brisée en deux et a disparu. Le haut phare a été englouti sous les vagues. Les toits ont quelque temps ressemblé à une rangée de récifs ; puis ils ont été engloutis eux aussi. Seule la citadelle émergeait encore, tel un navire monstrueux ; elle a glissé lentement sur le côté, dans le gouffre ; sur les tourelles des mains s’agitaient désespérément. Le drame a pris fin. Une mer toute unie recouvrait le continent entier ; c’était une mer où plus rien ne vivait ; des remous fumants ont laissé apparaître des épaves : cadavres d’hommes et d’animaux, chaises, tables, vêtements, chapeaux et diverses marchandises étaient soulevés et brassés par une gigantesque fermentation liquide. Lentement elle s’est calmée, et nous avons vu une immensité d’eau qui avait la couleur et le poli du mercure, sous un soleil brouillé et bas à l’horizon ; c’était le tombeau d’un peuple que Dieu avait pesé dans Sa justice et jugé criminel.
L’histoire était complète. Nous n’avions pas besoin d’en réclamer davantage, car nos cerveaux et l’imagination pouvaient nous expliquer le reste. Nous nous sommes représenté la lente descente de cette grande ville, de plus en plus bas, dans le gouffre de l’océan, parmi des convulsions volcaniques qui faisaient jaillir autour d’elle des pics sous-marins. Nous avons deviné comment la cité engloutie s’était posée à côté de l’Arche de refuge où une poignée de survivants aux nerfs brisés s’était rassemblée, au fond de l’Atlantique. Et finalement nous avons compris comment ces survivants avaient continué à vivre, comment ils avaient utilisé les moyens variés dont les avaient pourvus la science et la prévoyance de leur grand chef, comment il leur avait enseigné tout son art avant de disparaître, et comment une soixantaine d’Atlantes s’étaient développés en une large communauté qui avait eu à tailler sa route dans les entrailles de la terre pour se constituer son espace vital. Aucune bibliothèque n’aurait retracé le cours des événements plus clairement que cette succession d’images. Tel avait été le destin, telles avaient été les causes de ce destin qui avait submergé la grande terre de l’Atlantide. Un jour lointain, quand ce limon bathybien se sera transformé en craie, cette grande cité sera projetée une fois de plus par un nouveau souffle de la nature, et le géologue de l’avenir n’exhumera pas des silex ou des coquillages, mais les restes d’une civilisation évanouie et les traces d’une catastrophe vieille comme le monde.
Un seul point demeurait obscur : à quelle date avait eu lieu cette tragédie ? Le docteur Maracot a découvert une méthode rudimentaire de calcul. Parmi les nombreuses annexes du grand édifice, il y avait un souterrain qui était le cimetière des chefs. Comme en Égypte et dans le Yucatan, la momification était pratiquée ; dans les niches des murs ces sinistres reliques du passé étaient alignées en rangs interminables. Manda nous avait montré avec fierté une niche vide, en nous faisant comprendre qu’elle lui était destinée.
— Si vous prenez la moyenne des souverains européens, m’a dit Maracot, vous constaterez qu’ils se sont succédés à cinq par siècle. Nous pouvons adopter ici cette moyenne. Nous ne pouvons pas prétendre à une exactitude scientifique, mais nous obtiendrons une approximation. J’ai compté les momies ; il y en a quatre cents.
— Alors la catastrophe remonterait à huit mille ans ?
— En effet. Et cette date correspond à peu près au calcul de Platon. Elle s’est certainement produite avant que les Égyptiens ne tiennent des archives écrites ; les plus anciennes remontent à sept mille ans. Oui, je pense que nous pouvons dire que nous avons vu, de nos yeux vu, la reproduction d’une tragédie qui s’est déroulée il y a au moins huit mille ans. Mais, bien sûr, pour édifier une civilisation comme celle dont nous avons vu les vestiges, il a fallu plusieurs milliers d’années. C’est pourquoi nous avons reculé l’horizon de l’histoire humaine authentique beaucoup plus loin que ne l’ont fait des hommes depuis qu’il y a une histoire humaine.
CHAPITRE V
C’est environ un mois après notre visite à la cité engloutie, selon nos calculs, que s’est produit une chose imprévue et saisissante. Nous croyions que nous étions désormais immunisés contre les chocs, et qu’aucun fait nouveau ne pourrait nous émouvoir grandement. Or ce que je vais maintenant vous raconter a dépassé les prévisions de notre imagination.
La nouvelle qu’un événement important avait eu lieu nous a été rapportée par Scanlan. Il faut que vous compreniez bien que nous étions dans l’arche, jusqu’à un certain point, comme chez nous. Que nous savions où étaient situées les salles de repos collectif et les salles de spectacles. Que nous assistions à des concerts (leur musique était aussi étrange que compliquée) et à des représentations théâtrales où les mots incompréhensibles trouvaient leur traduction dans des gestes très vivants et très dramatiques. Enfin que nous faisions partie de la communauté. Nous rendions visite à diverses familles, et notre existence (la mienne, en tout cas) était éclairée par le charme qui émanait de ce peuple en général, et en particulier d’une chère jeune fille dont j’ai déjà parlé. Mona était la fille de l’un des chefs de la tribu, et j’ai trouvé dans sa famille un accueil chaleureux qui faisait oublier les différences de race et de langue. Quand nous en sommes venus au plus tendre des langages, je n’ai pas constaté d’ailleurs beaucoup de différences entre la vieille Atlantide et la jeune Amérique. Il me semble que ce qui aurait plu à une jeune fille du Brown’s College dans le Massachusetts ne plaisait pas moins à une jeune fille habitant sous les eaux.
Mais je reviens à l’arrivée de Scanlan dans notre chambre.
— Dites donc, il y en a un qui vient juste de rentrer, et si excité qu’il en oubliait de retirer sa cloche ! Il pérorait depuis plusieurs minutes avant d’avoir compris que personne ne l’entendait. Quand il l’a retirée, alors ç’a été un bla-bla-bla débité tout d’une haleine, et à présent ils le suivent tous vers la base avancée. Je vous invite à foncer dans l’eau, car il se passe certainement quelque chose qui vaut la peine d’être vu.
Nous sommes sortis en courant, et nous avons découvert que tous nos amis se précipitaient dans le couloir ; nous nous sommes joints à la procession, nous nous sommes « mis sous cloche » et nous nous sommes mêlés à la foule qui s’élançait sur le lit de l’Océan, conduite par le messager. Nous avions du mal à suivre l’allure des Atlantes ; mais ils avaient emporté des lampes électriques, dont la réverbération nous a guidés, malgré nos nombreuses chutes. Ils longeaient la base des falaises basaltiques ; puis ils se sont engagés dans une sorte d’escalier aux marches creusées par les pas ; cet escalier menait au sommet des falaises ; le relief y était accidenté, parsemé de pics déchiquetés et aussi de profondes crevasses. Notre marche n’en a pas été favorisée. Au sortir de ce chaos de lave antique, nous avons débouché sur une plaine circulaire, éclairée par la phosphorescence ; en son milieu j’ai distingué quelque chose dont l’aspect m’a cloué sur place. J’ai regardé mes compagnons : leurs physionomies reflétaient une émotion aussi intense que la mienne.
À demi-enseveli dans le limon, un steamer de bonne taille était couché. Sa cheminée était cassée à angle droit, et le mât de misaine coupé ras ; à part cela, le navire paraissait intact, aussi propre et net que s’il venait de quitter le quai. Nous avons couru sous l’étrave. Jugez de nos sentiments quand nous avons lu « Stratford, London » Notre navire nous avait suivis dans le gouffre Maracot !
Bien sûr, après le premier choc, nous avons été moins surpris … Nous nous sommes rappelé le baromètre qui tombait, les voiles rentrées du petit bateau norvégien, le gros nuage noir à l’horizon. Un cyclone subit avait dû éclater, assez violent pour envoyer par le fond notre Stratford. Il n’était que trop évident que tout l’équipage avait péri, car la plupart des canots pendaient des bossoirs dans un état plus ou moins avancé de destruction ; par ailleurs, aucun canot n’aurait survécu à un ouragan pareil. La tragédie avait dû se dérouler une ou deux heures après notre drame personnel. Peut-être la ligne de sonde que nous avions vue avait-elle été ramenée juste avant le coup fatal ? C’était terrible, mais fantastique, de penser que nous étions encore en vie, tandis que ceux qui nous avaient pleurés étaient eux-mêmes anéantis. Nous avons été incapables de préciser si le navire avait été dérivé entre deux eaux ou s’il gisait depuis quelque temps déjà là où un Atlante venait de le découvrir.
Le pauvre capitaine Howie, ou plutôt ce qui restait de lui, était encore à son poste sur le pont, avec les mains crispées sur le bastingage. Son corps, les corps de trois chauffeurs dans la salle des machines étaient les seuls à avoir sombré avec le navire. Ils ont été retirés selon nos directives, et ensevelis sous le limon ; des couronnes de fleurs marines ont été déposées sur leur tombe. Je fournis ces détails avec l’espoir qu’ils pourront apporter un peu de réconfort à Madame Howie dans son chagrin. Nous ignorions les noms des chauffeurs.
Pendant que nous accomplissions ce dernier devoir, les petits Atlantes se répandaient sur le Strafford. Ils se faufilaient partout ; on aurait dit des souris sur un fromage. Leur nervosité, leur curiosité nous ont révélé que c’était sans doute le premier navire moderne, le premier steamer, qui avait sombré près d’eux. Nous avons en effet constaté plus tard que leur appareil d’oxygène sous la cloche vitreuse ne leur permettait pas de demeurer longtemps éloignés du poste de recharge ; leur champ d’action pour explorer le fond de la mer était donc limité à quelques kilomètres. Ils se sont affairés immédiatement à démolir l’épave et à emporter tout ce qui leur semblait d’une utilité quelconque. Nous avons été assez satisfaits, pour notre part, de faire un tour jusqu’à nos cabines afin d’en retirer des vêtements et des livres qui n’étaient pas complètement hors d’usage.
Parmi les divers objets que nous avons récupérés, figurait le journal de navigation du Stratford ; le capitaine l’avait scrupuleusement tenu à jour jusqu’au moment du sinistre. Vraiment il était étrange que nous pussions le lire, tandis que son auteur avait péri ! Voici la dernière page :
« 3 octobre. — Courageux mais téméraires, les trois explorateurs sont aujourd’hui descendus, contre ma volonté et malgré mes conseils, dans leur cage d’acier vers le fond de l’Océan, et l’accident que j’avais prévu s’est produit. Que leurs âmes reposent en paix ! Leur descente a commencé à onze heures du matin, et je me demandais si je ne ferais pas mieux de leur interdire cette expérience, car un grain s’annonçait. Je regrette de ne pas avoir obéi à mon impulsion, mais je n’aurais fait que retarder une tragédie inévitable. Je leur ai dit adieu à chacun, avec la certitude que je ne les reverrais jamais. Pendant quelque temps, tout s’est bien passé ; à onze heures quarante-cinq ils avaient atteint une profondeur de trois cents brasses, et ils touchaient le fond. Le docteur Maracot a envoyé plusieurs messages ; tout semblait se dérouler normalement, quand j’ai tout à coup entendu sa voix bouleversée, et le câble s’est mis à s’agiter avant de se rompre, brutalement. Il sembla qu’ils se trouvaient à cet instant au-dessus d’un gouffre profond, car sur l’ordre du docteur Maracot le navire s’était très lentement avancé. Les tubes d’air ont continué à fonctionner jusqu’à une distance que j’évalue à huit cents mètres ; puis ils se sont rompus eux aussi. Nous n’avons désormais plus aucun espoir d’avoir des nouvelles du docteur Maracot, de Monsieur Headley ou de Monsieur Scanlan.
« Et cependant il me faut relater une chose extraordinaire, mais sur laquelle je n’ai pas le temps de m’appesantir, car le temps se gâte et un orage menace. Une sonde de grands fonds avait été descendue en même temps ; la profondeur enregistrée a été de l’ordre de huit mille mètres. Le poids a été, comme de juste, abandonné au fond, mais le filin a été remonté et, pour aussi incroyable que cela paraisse, le mouchoir de Monsieur Headley y était accroché. L’équipage en a été tout surpris ; personne n’a pu s’expliquer comment ce miracle s’était produit. J’y reviendrai plus tard. Nous sommes restés quelques heures dans les parages dans l’espoir d’apercevoir quelque chose à la surface, et nous avons remonté le câble, dont le bout était déchiqueté. Mais il faut que je m’occupe du navire : je n’ai jamais vu un ciel plus redoutable ; le baromètre dégringole. »
Voilà comment nous avons reçu les dernières nouvelles de nos anciens compagnons. Un cyclone terrible s’est sans aucun doute abattu sur le navire et l’a coulé.
Nous avons tourné autour de l’épave jusqu’à ce qu’un certain manque d’air sous nos cloches de verre et la sensation d’un poids oppressant sur nos poitrines nous aient avertis qu’il était grand temps de songer à notre retour. C’est au cours de ce retour qu’une aventure nous a montré les dangers imprévisibles auxquels sont exposés les habitants des grands fonds marins, et nous a expliqué pourquoi leur nombre, en dépit des siècles écoulés, avait relativement peu augmenté : y compris les esclaves grecs, la population n’excédait pas plus de quatre ou cinq mille âmes. Nous avions donc redescendu les marches, et nous longions la jungle qui borde les falaises de basalte, quand Manda a levé le bras en l’air pour désigner quelque chose et il a fait de grands signes à l’un des membres de notre groupe qui se trouvait à quelque distance. En même temps, avec ceux qui l’entouraient, il a couru vers de grosses pierres ; nous nous sommes tous abrités derrière elles. C’est alors que nous avons compris la cause de leur frayeur. À quelques mètres au-dessus de nos têtes, descendant rapidement, un énorme poisson d’une forme tout à fait exceptionnelle, était apparu. On aurait dit un grand lit de plumes flottant, moelleux et rembourré, blanc par en-dessous, avec une longue frange rouge dont la vibration le propulsait dans l’eau. Il ne semblait posséder ni bouche ni yeux ; mais il n’a pas tardé à nous prouver son agilité extraordinaire. Le membre de notre groupe qui se trouvait à découvert a voulu rejoindre notre abri, mais il s’y était pris trop tard. J’ai vu son visage convulsé de terreur. Le monstre l’a enlacé de tous côtés ; il palpitait d’une manière épouvantable en l’enveloppant ; il le serrait comme s’il voulait l’écraser contre les rochers de corail. La tragédie se déroulait à quelques mètres de nous ; cependant nos compagnons étaient tellement surpris par sa soudaineté qu’ils semblaient paralysés. C’est Scanlan qui a effectué une sortie et qui, sautant sur le large dos du monstre (un dos taché de rouge et de brun) a enfoncé le bout pointu de son bâton de métal dans l’enveloppe molle de la bête.
J’ai suivi l’exemple de Scanlan ; finalement Maracot et les autres ont attaqué le monstre qui a battu lentement en retraite en laissant derrière lui une trace d’excrétion huileuse et glutineuse. Notre aide n’avait pu sauver la victime, car l’étreinte du grand poisson avait brisé sa cloche vitreuse, et il avait péri noyé. Quand nous avons ramené son cadavre dans l’Arche du refuge, ç’a été un jour de deuil, mais aussi pour nous un jour de triomphe, car la promptitude de notre action nous avait valu les louanges admiratives de nos compagnons. Quant au poisson, le docteur Maracot nous a affirmé qu’il s’agissait d’un spécimen connu des ichtyologues, mais d’une taille absolument colossale.
Je mentionne ce monstre parce qu’il a été la cause d’un drame ; mais je pourrais (et peut-être le ferai-je) écrire un livre sur les formes de vie que nous avons vues. Le rouge et le noir sont les couleurs prédominantes dans la vie des grands fonds, tandis que la végétation est d’un pâle vert olive ; sa fibre est si coriace que nos chaluts l’arrachent rarement : voilà pourquoi la science croit que le lit de l’Océan est nu. De nombreux animaux marins sont d’une beauté adorable ; d’autres au contraire arborent une horreur si grotesque qu’ils ressemblent à des images nées d’un délire, mais ils constituent un danger que ne peut égaler aucun animal de la terre. J’ai vu une torpille noire qui avait dix mètres de long avec un croc abominable sur la queue ; un seul coup de cette queue aurait tué n’importe quelle créature vivante. J’ai vu aussi une grenouille géante, avec des yeux verts saillants, qui n’était qu’une gueule béante avec un énorme estomac par derrière ; la rencontrer c’était la mort pour quiconque n’était pas muni d’une lampe électrique dont le rayon la faisait fuir. J’ai vu l’anguille aveugle et rouge des rochers, qui tue par une émission de poison, et j’ai vu encore le scorpion de mer géant, l’une des terreurs des bas-fonds.
Une fois j’ai eu le privilège de voir le vrai serpent de mer ; cette bête n’apparaît presque jamais aux yeux des hommes, car elle vit dans les grands fonds et on ne la trouve en surface que lorsqu’une convulsion sous-marine l’a chassée de ses repaires. Deux serpents de mer nageaient, ou plutôt glissaient, près d’un endroit où je m’étais isolé avec Mona. Nous nous sommes blottis parmi des bouquets de laminaires. Ils étaient énormes : à peu près hauts de trois mètres et longs de soixante-dix. Noirs au-dessus, blancs au-dessous, avec une sorte de frange sur le dos, ils avaient de petits yeux guère plus gros que ceux d’un bœuf. Mais le récit du docteur Maracot, s’il vous parvient jamais, vous donnera bien d’autres détails sur ces serpents et sur quantité d’autres choses.
Les semaines se succédaient paisiblement. Notre nouvelle existence se révélait très agréable, et nous commencions à manier suffisamment cette langue depuis longtemps oubliée pour pouvoir converser avec nos compagnons. L’arche offrait toutes sortes de sujets d’études et de distractions ; déjà Maracot s’était assimilé assez de vieille chimie pour déclarer qu’il pourrait révolutionner toutes les idées du monde s’il était un jour capable de lui transmettre ce qu’il avait appris. Entre autres choses, les Atlantes connaissaient la désintégration de l’atome, et bien que l’énergie libérée fût inférieure à ce que nos savants avaient prédit, elle suffisait en tout cas à leur procurer un grand réservoir de puissance. De même ils nous dépassaient de loin dans la connaissance de l’énergie ou de la nature de l’éther : leur étrange traduction de la pensée sous forme d’images, procédé qui nous avait permis de nous raconter mutuellement notre histoire, était l’effet d’une impression éthérisée transmutée en termes de matière.
Et pourtant, malgré leur science, les ancêtres des Atlantes avaient négligé certains aspects du développement de la science moderne.
Il a appartenu à Scanlan de le démontrer. Depuis des semaines il était dans un état d’excitation contenue ; un grand secret le consumait, et il gloussait de joie quand il réfléchissait. Nous ne le voyions que par intermittence pendant cette période, car il était extrêmement occupé ; son unique ami et confident était un Atlante gras et jovial qui s’appelait Berbrix et qui était chargé d’une partie des machines. Scanlan et Berbrix, qui conversaient surtout par signes et par grandes claques dans le dos, étaient devenus très intimes, et ils ne se quittaient pour ainsi dire jamais. Un soir Scanlan est arrivé radieux.
— Dites donc, docteur, a-t-il déclaré à Maracot, j’ai un bon petit tuyau personnel que je voudrais communiquer à ces braves gens. Ils nous ont montré deux ou trois trucs ; j’estime que c’est notre tour de faire une exhibition. Que diriez-vous si nous les conviions tous demain soir pour un petit spectacle ?
— Jazz ou charleston ? ai-je demandé.
— Rien à voir avec le charleston. Attendez, et vous verrez. Mon ami, c’est le truc le plus formidable … Mais non, plus un mot ! Simplement ceci, patron : je ne vous décevrai pas ! J’ai de la bonne camelote, et je voudrais en faire profiter nos amis.
Toute la communauté s’est donc réunie le lendemain soir dans la salle habituelle. Scanlan et Berbrix étaient sur l’estrade, rayonnants de fierté. L’un des deux a touché un bouton, et alors …
— This is London calling, a crié une voix bien claire. Londres qui appelle les îles Britanniques. Prévisions du temps …
Suivaient alors les phrases habituelles sur les dépressions et les anticyclones.
— Premier bulletin d’informations. Sa Majesté le Roi a inauguré ce matin la nouvelle aile de l’hôpital d’enfants à Hammersmith …
Etc. Etc. Sur le rythme familier. Pour la première fois nous nous retrouvions dans l’Angleterre de tous les jours qui faisait bravement son petit bonhomme de chemin, le dos courbé sous ses dettes de guerre. Et puis nous avons entendu les nouvelles de l’étranger, les informations sportives. Le vieux monde continuait de bourdonner comme auparavant. Nos amis les Atlantes écoutaient avec stupeur, mais sans comprendre. Quand, toutefois, immédiatement après les informations, la musique des Gardes a entamé la marche de Lohengrin, ils ont poussé un cri unanime de ravissement, et nous nous sommes bien amusés à les voir courir sur l’estrade, soulever les rideaux, regarder derrière les écrans pour découvrir la source de la musique. Nous avions laissé pour toujours notre marque sur la civilisation sous-marine !
— Non, Monsieur, nous a dit Scanlan un peu plus tard. Je ne pourrais pas construire un poste émetteur. Eux n’ont pas le matériel, et moi pas le cerveau. Mais chez moi j’avais fabriqué un poste à deux lampes avec l’antenne dans la cour à côté des fils pour sécher le linge ; j’avais appris à le manipuler et j’attrapais n’importe quel poste américain. Je me suis dit que ce serait amusant si, avec toute l’électricité disponible ici, et avec leur verrerie en avance sur la nôtre, je pouvais fabriquer quelque chose qui capterait une onde de l’éther, parce qu’une onde voyage aussi bien par eau que par air. Le vieux Berbrix a presque piqué une crise quand nous avons capté le premier concert ; mais il s’y connaît maintenant, et je parierais bien que nous avons fondé là une institution permanente.
Au nombre des découvertes des chimistes de l’Atlantide figurait un gaz neuf fois plus léger que l’hydrogène et que Maracot a baptisé lévigène. Ce sont ses expériences qui nous ont donné l’idée d’expédier à la surface de l’Océan des boules vitreuses contenant des renseignements sur notre existence.
— J’ai fait comprendre l’idée à Manda, nous a-t-il dit un jour. Il a donné des ordres aux spécialistes de la silice, et les boules seront prêtes dans vingt-quatre ou quarante-huit heures.
— Mais comment pourrons-nous mettre à l’intérieur quelque chose ? ai-je demandé.
— Il y a une petite ouverture par laquelle le gaz est injecté. Nous pourrons y glisser des papiers. Puis ces ouvriers scelleront la fente. Je suis certain que lorsque nous les lâcherons, elles iront trouer la surface.
— Et elles vogueront sur l’eau pendant une année sans être repérées par quiconque.
— Possible. Mais la boule réfléchira les rayons du soleil. Cela éveillera l’attention. Nous sommes sur la ligne qu’empruntent les bateaux qui font la navette entre l’Europe et l’Amérique du Sud. Je ne vois pas pourquoi, si nous en envoyons plusieurs, l’une au moins ne serait pas découverte.
Et cette boule, mon cher Talbot ou tous autres qui lisez mon récit, est parvenue entre vos mains. Mais un projet plus sensationnel est en train. L’idée a surgi dans la cervelle féconde du mécanicien américain.
— Dites, les amis, a-t-il commencé un soir où nous étions seuls dans notre chambre, c’est charmant par ici : on boit bien, on mange à sa faim, et j’ai rencontré une fille qui surclasse toutes celles de Philadelphie, mais tout de même il y a des fois où je me sens comme si je voulais bien revoir mon pays avant de mourir.
— Nous ressentons la même chose, lui ai-je répondu. Mais je ne vois pas comment vous pouvez espérer encore retourner sur la terre.
– Écoutez-moi, patron ! Si ces boules de gaz peuvent transporter notre message, peut-être pourraient-elles nous transporter nous aussi ? Ne croyez pas que je plaisante. Je parle très sérieusement. Supposons que nous en réunissions trois ou quatre pour faire un bon ascenseur. Vous voyez ? Nous avons nos cloches vitreuses et nous nous harnachons aux boules. Au coup de sifflet, nous coupons les amarres et nous grimpons. Qu’est-ce qui pourrait nous arrêter entre ici et la surface ?
— Un requin, par exemple.
— Bah ! zéro pour les requins ! Nous foncerions parmi des requins à une telle vitesse qu’ils ne se douteraient même pas de notre présence. Ils croiraient avoir vu trois éclairs lumineux. Nous bénéficierions d’une telle force ascensionnelle que nous terminerions par un bond de vingt mètres au-dessus de la surface. Je vous assure que la vigie qui nous verrait apparaître tomberait à genoux pour dire ses prières !
— Mais, en admettant que ce soit possible, qu’arrivera-t-il ensuite ?
— Oh, de grâce, ne parlons pas de « ensuite » ! Tentons notre chance ; sinon, nous sommes ici pour l’éternité.
— Je désire certainement retourner dans le monde, ne serait-ce que pour communiquer nos résultats aux sociétés savantes, a dit Maracot. C’est seulement mon influence personnelle qui pourra leur faire mesurer la somme de connaissances neuves que j’ai acquises. Par conséquent, je suis tout disposé à participer à une tentative dans le genre de celle que Scanlan vient de nous exposer.
Pour certaines bonnes raisons, comme je l’indiquerai plus tard, j’étais le moins ardent des trois.
— Votre proposition relève de la pure folie ! À moins qu’on nous attende à la surface, nous voguerons indiscutablement à la dérive et nous périrons de faim et de soif.
— Voyons, mon vieux, comment quelqu’un pourrait-il nous attendre ?
— Peut-être cela même pourrait-il s’arranger, a dit Maracot. Nous pouvons donner à un mille près notre latitude et notre longitude.
— Et on nous descendrait une échelle ? ai-je ajouté avec âpreté.
— Pas besoin d’échelle ! Le patron a raison. Écoutez, Monsieur Headley, vous mettrez dans cette lettre que vous allez adresser à tout l’univers … Oh là là ! Je vois d’ici les manchettes des journaux !.. que nous sommes à 27° Lat. N et 28° 14’ Long. W ou tous autres chiffres plus exacts. Compris ? Puis vous dites que les trois plus importants personnages de l’histoire, le grand homme de science Maracot, l’étoile montante du naturalisme Headley, et le roi de la mécanique Bill Scanlan, orgueil de Merribank, appellent au secours du fond de la mer. Vous me suivez ?
— Et alors ?
— Alors, à eux de jouer ! C’est un défi qu’ils seront forcés de relever. La même chose que ce que j’ai lu sur Stanley trouvant Livingstone. À eux de trouver un moyen pour nous tirer de là, ou pour nous accueillir à l’autre bout si nous faisons le grand saut nous-mêmes.
— Nous pourrions leur suggérer le moyen, a dit le Professeur. Qu’ils descendent une sonde de grands fonds par ici ; nous la chercherons. Quand elle sera arrivée, nous pourrons attacher un message et leur dire de se tenir prêts à nous recevoir.
— Vous avez parlé comme un champion ! s’est exclamé Bill Scanlan. Voilà certainement le bon moyen.
— Et si une demoiselle désire partager notre sort, nous pourrions partir à quatre aussi facilement qu’à trois, a ajouté Maracot avec un sourire malicieux à mon adresse.
— Et pourquoi pas à cinq ? a dit Scanlan. Mais vous avez pigé, maintenant, n’est-ce pas, Monsieur Headley ? Vous allez écrire tout ça, et dans six mois nous serons de retour sur la Tamise.
Nous allons donc lancer nos deux boules dans cette eau qui est pour nous ce que l’air est pour vous. Nos deux petites boules vont grimper vers le ciel. Se perdront-elles en route toutes les deux ? C’est possible. Ou pouvons-nous espérer qu’une au moins fera surface ? Nous laissons la décision entre les mains divines. Si rien ne peut être fait pour nous, alors prévenez ceux qui ne nous ont pas oubliés que nous sommes sains et saufs, et heureux. Si, par contre, notre suggestion peut recevoir exécution, nous vous avons fourni le moyen de réussir. En attendant, adieu ! Ou au revoir ?
* * *
Ainsi se terminait le récit trouvé dans la boule vitreuse.
J’en étais demeuré là, moi aussi, lorsque j’avais entrepris de relater les faits connus ; mais pendant que mon manuscrit se trouvait chez l’imprimeur, un épilogue sensationnel est intervenu. Je veux parler du sauvetage des explorateurs par le yacht à vapeur de Monsieur Faverger, la Marion, et du récit transmis du bateau par radio et capté par la station du cap des Îles Vertes, qui vient de le retransmettre pour l’Europe et l’Amérique. Ce récit est dû à la plume de Monsieur Key Osborne, le représentant de l’agence Associated Press.
Nous avons donc appris que sitôt connues en Europe les aventures du docteur Maracot et de ses amis, une expédition s’était secrètement montée dans le but de tenter leur sauvetage. Monsieur Faverger avait généreusement mis son yacht Marion à la disposition des sauveteurs, et il avait décidé de les accompagner personnellement. La Marion a appareillé de Cherbourg en juin, a fait escale à Southampton pour embarquer Monsieur Key Osborne ainsi qu’un opérateur de cinéma, et elle a foncé ensuite à toute vapeur vers la région de l’Océan délimitée par Cyrus Headley. Elle l’a atteinte le 1er juillet.
Une sonde de grands fonds a alors été larguée et promenée au fond de l’Océan. À l’extrémité du filin, à côté du plomb, une bouteille était suspendue ; elle contenait un message ainsi conçu : « Votre récit a été recueilli, et nous sommes ici pour vous aider. Nous répétons ce message par notre émetteur radio, avec l’espoir que vous pourrez le capter. Nous allons traverser lentement votre région. Quand vous aurez détaché la bouteille, ayez l’obligeance d’y enfermer votre propre message. Nous agirons conformément à vos instructions. »
Pendant deux jours la Marion a quadrillé la région sans résultat. Le troisième jour, une grosse surprise attendait les sauveteurs. Une petite boule lumineuse a jailli de l’eau à quelques centaines de mètres du yacht : c’était un réceptacle vitreux analogue à celui que décrivait le document original. Il a fallu quelque temps pour le briser ; il contenait le message suivant : « Merci, chers amis. Nous apprécions grandement votre fidélité et votre énergie. Nous recevons facilement vos messages par sans-fil, et nous avons choisi pour vous répondre le moyen de cette boule ; nous avons essayé de capturer votre filin, mais les courants le soulèvent trop haut, et il se déplace plus rapidement que ne peut le faire le plus agile d’entre nous à cause de la résistance de l’eau. Nous nous disposons à tenter l’aventure à six heures demain matin, selon nos calculs, le mardi 5 juillet. Nous arriverons l’un après l’autre, afin que vous puissiez, le cas échéant, transmettre par radio des conseils à ceux qui monteront en dernier. Nouveaux remerciements chaleureux. »
Le message était signé : « Maracot. Headley, Scanlan ».
Monsieur Key Osborne raconte alors :
« La matinée s’annonçait radieuse ; la mer de saphir reposait aussi lisse qu’un lac sous un ciel bleu foncé dont la voûte était dégagée de tout nuage. L’équipage de la Marion, au grand complet, était de bonne heure sur le pont et attendait les événements avec un vif intérêt. Plus l’heure fatidique approchait, plus l’anxiété étreignait notre cœur. Une vigie avait grimpé sur notre mât de signaux. À six heures moins cinq, nous l’avons entendu crier, et nous l’avons vu désigner l’eau sur notre bâbord. Nous avons tous couru de ce côté, et j’ai pu me percher sur l’un des canots pour mieux voir. J’ai distingué à travers l’eau calme quelque chose qui ressemblait à une bulle d’argent et qui surgissait avec une rapidité extraordinaire des profondeurs de l’Océan pour crever la surface à deux cents mètres du yacht et poursuivre dans l’air sa course ascendante : c’était un globe brillant, magnifique, qui avait un mètre de diamètre ; il s’est élevé à une grande hauteur, puis il s’est éloigné à la dérive, emporté par une bouffée de vent, exactement comme un ballon d’enfant. Ce spectacle était merveilleux, mais il nous a glacés d’appréhension ; sa charge ne s’était-elle pas détachée en route et perdue ? Un message a été aussitôt diffusé :
« — Votre globe a fait surface près du bateau. Rien n’y était attaché, et il s’est envolé au loin.
« En même temps, nous avons mis à l’eau un canot afin de nous tenir prêts à toute éventualité.
« Juste après six heures notre vigie nous a alertés une deuxième fois. Un instant plus tard j’ai aperçu un autre globe d’argent qui émergeait des profondeurs, mais beaucoup plus lentement que le premier. Une fois parvenu à la surface, il a flotté dans l’air, mais son frêt est resté posé sur l’eau. Nous l’avons repêché et examiné. Il était constitué par un gros paquet de livres, de papiers et d’objets divers, tous enveloppés dans une bâche en peau de poisson. Nous avons transmis la nouvelle par sans-fil, et nous avons attendu avec une impatience fébrile la prochaine arrivée.
« Elle n’a pas tardé. À nouveau une bulle d’argent, à nouveau la surface de l’eau crevée ; mais cette fois, la boule brillante s’est élevée dans les airs, et, ô stupeur, la mince silhouette d’une femme y était suspendue ! Seule la vitesse acquise l’avait ainsi projetée en altitude ; quelques minutes plus tard, nous l’avions remorquée et amarrée au flanc du bateau. Un anneau de cuir avait été solidement fixé autour de la courbure supérieure de la boule vitreuse ; de cet anneau pendaient de longues courroies, rattachées à une large ceinture de cuir qui faisait le tour de la taille de la femme. La partie supérieure de son corps était recouverte d’une sorte de globe en verre en forme de poire (je l’appelle verre, mais il était fait de la même substance légère et très résistante que la boule vitreuse ; il était presque transparent avec des veines argentées). Ce globe était pourvu d’élastiques serrés à la taille et aux épaules, qui le rendaient parfaitement étanche ; il contenait, ainsi que l’indiquait Headley dans son manuscrit original, un nouvel appareil très léger et très pratique pour le renouvellement de l’air. Nous avons eu du mal à retirer la cloche vitreuse, puis sa propriétaire a été transportée sur le pont. Elle était évanouie, mais la régularité de sa respiration nous a autorisés à penser qu’elle triompherait rapidement des effets de son voyage accéléré et du changement de pression, changement qui du reste avait été minimisé par le fait que la densité de l’air à l’intérieur de l’enveloppe protectrice était nettement plus élevée que notre atmosphère : disons qu’elle représentait ce point à mi-chemin où les plongeurs humains ont l’habitude de faire une pause. Il s’agit sans doute de l’Atlante mentionnée sous le nom de Mona dans le premier message. Si nous pouvons la considérer comme un spécimen de sa race, celle-ci mérite assurément d’être réintroduite sur la terre. Elle a le teint mat, des traits fins et racés, de longs cheveux noirs, ainsi que de magnifiques yeux noisette qui n’ont pas tardé à regarder autour d’elle avec un étonnement ravissant. Des coquillages marins et de la nacre étaient incrustés dans sa tunique crème ou mêlés à sa chevelure. On ne saurait imaginer une plus parfaite Naïade des Grands Fonds ! Elle est le symbole même du mystère et du charme de la mer. Nous avons assisté au retour de la vie dans ses yeux merveilleux ; dès qu’elle a repris connaissance, elle s’est dressée d’un bond avec l’agilité d’une biche, et elle s’est précipitée vers la rampe du bastingage, en appelant : « Cyrus ! Cyrus ! »
« Nous avions déjà dissipé l’anxiété de ceux d’en bas par un message radio. Bientôt, se suivant de près, ils ont émergé tous les trois, projetés en l’air d’une douzaine de mètres, puis retombant dans la mer, d’où nous les avons rapidement repêchés. Tous trois étaient sans connaissance ; Scanlan saignait du nez et des oreilles. Mais en moins d’une heure, ils étaient debout, plus ou moins chancelants, mais souriants. Le premier acte de chacun a été, m’a-t-il semblé, caractéristique. Scanlan s’est laissé emmener au bar par un groupe joyeux ; des cris et des rires en fusent et retentissent sur tout le yacht, au grand dam de mon style. Le docteur Maracot s’est emparé du paquet de papiers ; il en a arraché un qui était surchargé, je crois de symboles algébriques, et il a disparu dans une cabine. Cyrus Headley, lui, s’est jeté dans les bras de la jeune étrangère et, aux dernières nouvelles, il ne paraissait pas avoir l’intention d’en sortir jamais. Voilà où en sont les choses. Nous espérons que notre faible radio transmettra notre message jusqu’à la station du cap des Îles Vertes. De plus amples détails sur cette merveilleuse aventure seront fournis ultérieurement, comme il se doit, par les explorateurs eux-mêmes. »
CHAPITRE VI
Nous avons reçu beaucoup de lettres, moi Cyrus Headley, boursier à Oxford, le Professeur Maracot, et même Bill Scanlan, depuis notre très remarquable aventure au fond de l’Atlantique. Je vous rappelle que nous avons pu effectuer, à trois cents kilomètres au sud-ouest des Canaries, une plongée sous-marine qui non seulement a entraîné une révision des opinions scientifiques sur la vie des grands fonds et les pressions, mais encore a établi la survivance d’une vieille civilisation dans des conditions incroyablement difficiles. Ces lettres réclamaient instamment des détails complémentaires. Je conviens que mon premier document était très superficiel ; il rend compte pourtant de la plupart des faits. Quelques-uns, je le reconnais, ont été passés sous silence : entre autres l’épisode sensationnel du Seigneur de la Face Noire. Pourquoi ? Parce que celui-ci notamment révélait certains faits et impliquait des conclusions d’une nature si extraordinaire que tous, nous avons été d’avis de n’en point faire état. Mais puisque la Science a maintenant admis nos résultats (et je puis ajouter : puisque la Société a admis ma femme) nous pouvons considérer comme établies notre sincérité et notre véracité ; nous pouvons donc rendre publique une histoire qui, trop tôt publiée, nous aurait aliéné la sympathie du public. Avant d’en venir à l’épisode lui-même, je voudrais vous y préparer par quelques évocations des mois admirables que nous avons passés dans la cité engloutie des Atlantes qui, au moyen de leurs cloches vitreuses, sont capables de se promener sur le fond de l’Océan avec la même facilité que les Londoniens que je vois déambuler de mes fenêtres du Hyde Park Hotel parmi des parterres de fleurs.
Tout au début, quand nous avons été sauvés par les Atlantes, après notre chute terrible, nous nous sommes trouvés dans une posture de prisonniers plutôt que d’hôtes. Je vais donc vous expliquer comment nos rapports se sont transformés, et comment, grâce au docteur Maracot, nous avons laissé là-bas une telle réputation que notre passage en Atlantide s’inscrira dans leurs annales comme une sorte de visitation céleste. Ils n’ont rien su de nos préparatifs de départ, car ils auraient tout fait pour nous retenir ; aussi la légende a-t-elle déjà dû se répandre que nous sommes retournés dans une sphère supérieure, en emmenant la fleur la plus douce et la plus adorable de leur race.
Voici dans l’ordre, quelques détails sur ce monde merveilleux ; nous terminerons par l’aventure suprême, qui laissera sur chacun de nous une trace indélébile : l’arrivée du Seigneur de la Face Noire. D’une certaine manière je regrette que nous ne soyons pas demeurés davantage dans le gouffre Maracot, car nous n’avons pas eu le temps d’en éclaircir tous les mystères. Comme nous nous étions mis à baragouiner leur langue, nous y serions infailliblement parvenus.
L’expérience avait enseigné à ce peuple ce qui était terrible et ce qui était inoffensif. Un jour, je m’en souviens, une alerte soudaine a été sonnée ; tous, nous nous sommes élancés sur le lit de l’Océan, enveloppés de nos cloches vitreuses, mais nous ignorions tout des motifs de cette alerte. Par contre, nous ne pouvions pas nous méprendre sur l’expression des visages qui nous entouraient : ils étaient hagards, horrifiés. Quand nous sommes arrivés sur la plaine, nous avons rencontré de nombreux mineurs grecs qui se hâtaient vers la porte de l’arche. Ils avaient couru si vite, ils étaient si épuisés qu’ils s’affalaient dans le limon ; nous avons alors compris que nous étions là pour sauver ces hommes fourbus et pour presser les traînards ; mais nous avions beau examiner nos compagnons : ils étaient sans armes. Quel était donc ce danger ?
Les mineurs avaient tous déserté la mine ; quand ils se sont trouvés à l’abri, nous avons regardé dans la direction d’où ils étaient venus. Nous n’avons vu que deux sortes de nuages verdâtres en tortillons, lumineux au centre, déchiquetés sur les bords, qui dérivaient plus qu’ils ne se déplaçaient vers nous. Quand les Atlantes les ont repérés, à huit cents mètres d’eux, ils ont été pris d’une panique folle et ils ont cogné de toutes leurs forces sur la porte pour rentrer le plus vite possible dans l’arche. Il était évidemment assez énervant de voir ces mystérieux phénomènes se rapprocher ! Les pompes ont fonctionné avec célérité et à notre tour nous nous sommes mis à l’abri. Sur le linteau de la porte une grande plaque de cristal transparent, de trois mètres de long et de quatre-vingts centimètres de large, était encastrée ; des lampes avaient été aménagées de telle sorte qu’elles projetaient au dehors l’éclat d’un phare. Plusieurs Atlantes sont montés sur des échelles disposées à dessein ; je les ai imités et nous avons regardé par cette fenêtre rudimentaire. Les bizarres cercles verts scintillants se sont immobilisés devant la porte. Les Atlantes qui étaient à côté de moi ont commencé à trembler de tous leurs membres. Puis l’un des monstres a fendu l’eau et s’est approché de notre fenêtre de cristal. Mes compagnons m’ont aussitôt tiré en bas, mais j’avoue ne pas m’être pressé et, du fait de ma négligence, une partie de ma tête n’a pas échappé à une influence maléfique certaine : j’arbore sur les cheveux une tache blanche qui ne s’est pas encore effacée.
Les Atlantes ont longtemps attendu avant d’oser ouvrir la porte ; finalement un éclaireur a été désigné ; avant qu’il sorte, tout le monde est venu lui serrer la main et lui administrer de grandes claques dans le dos comme s’il était un héros. Il est rentré nous dire que les monstres avaient disparu ; alors la joie a refleuri dans la communauté qui a eu tôt fait d’oublier cette étrange visite. Nous avons retenu le mot « Praxa », répété avec des intonations d’horreur ; c’était sûrement le nom de ces monstres. Une seule personne s’est déclarée ravie de l’incident : le professeur Maracot ; nous avons eu du mal à l’empêcher de sortir avec un petit filet et un pot en verre. Il a commenté la chose en ces termes : « Une nouvelle forme de vie, partiellement organique, partiellement gazeuse, mais intelligente ». Scanlan en a donné une définition moins scientifique : « Un phénomène sorti de l’enfer ».
Le surlendemain, nous sommes sortis pour ce que nous appelions une partie de pêche aux crevettes. Entendez par là que nous nous promenions parmi le feuillage des grands fonds et que nous capturions dans des filets à manche des échantillons de petits poissons. En furetant à droite et à gauche nous sommes tombés sur le cadavre d’un mineur ; l’infortuné avait sans doute été surpris dans sa fuite par les monstres. Sa cloche vitreuse était en miettes. Ces monstres disposaient donc d’une force exceptionnelle, car cette substance vitreuse est extrêmement résistante, comme vous avez pu vous en rendre compte quand vous avez voulu prendre connaissance de mes premiers documents. Les yeux du mineur avaient été arrachés ; à part cela, il ne présentait aucune trace de blessure.
— Un gourmet ! a déclaré le Professeur. Il y a en Nouvelle-Zélande un perroquet-faucon qui tue les agneaux pour leur retirer un morceau spécial de graisse au-dessus du rein. Ici, notre monstre a tué cet homme pour ses yeux. Dans les cieux et dans les eaux, la nature ne connaît qu’une loi, et elle est, hélas, d’une cruauté impitoyable.
Les exemples de cette loi cruelle ne nous ont pas manqué, au sein de l’Océan. Je me rappelle notamment qu’à plusieurs reprises nous avions observé un curieux sillon sur la molle boue bathybienne, comme si on y avait roulé un tonneau. Nous l’avons montré aux Atlantes, et nous avons essayé d’obtenir d’eux une description de l’animal en cause. Pour le nommer, nos amis ont fait entendre quelques-uns de ces clappements de langue si caractéristiques de leur langage, et que ne peuvent reproduire ni l’alphabet européen ni un langage européen. Krixchok est peut-être ce qui s’en rapprocherait le mieux. Mais pour une description précise, nous avons utilisé le procédé par lequel les Atlantes projetaient une vision claire de l’objet de leurs pensées. Ils nous ont alors montré l’image d’une bête marine très étrange que le Professeur n’a pu que définir que comme une gigantesque limace de mer. De grande taille, elle avait la forme d’une saucisse, des yeux sur des pédoncules, un épais revêtement de poils rudes ou de piquants. En nous montrant son image, nos amis nous ont exprimé par gestes une répulsion et une horreur intenses.
Ce portrait, comme pouvaient le supposer tous ceux qui connaissaient Maracot, n’a servi qu’à enflammer sa passion scientifique, et à accroître son désir de déterminer l’espèce et le genre exacts du monstre inconnu. Je n’ai donc pas été surpris quand, au cours de notre excursion suivante, je l’ai vu s’arrêter à l’endroit où nous avions repéré les traces de la limace sur le limon, puis se diriger délibérément vers le chaos d’algues et de rocs basaltiques où elle devait se dissimuler. À partir du moment où nous avons quitté la plaine, les traces ont cessé, bien entendu ; mais nous avons aperçu une sorte de couloir naturel entre les rocs : sans doute menait-il au repaire du monstre. Nous étions tous les trois armés de l’épieu que portaient généralement les Atlantes ; mais le mien me paraissait bien frêle pour affronter un danger nouveau. Le Professeur s’est néanmoins engagé dans le couloir ; il ne nous restait plus qu’à le suivre.
La gorge grimpait raide ; elle était encadrée par d’énormes entassements de débris volcaniques que drapaient diverses formes de laminaires noires et rouges qui poussent à profusion dans les grands fonds. Ces plantes fourmillaient de centaines d’ascidies et d’échinodermes richement chamarrés, de crustacés et de diverses formes inférieures de la vie reptilienne. Nous progressions avec lenteur, car il n’est jamais facile de marcher au fond de l’Océan, et la côte nous essoufflait. Brusquement, nous avons vu le monstre que nous chassions ; le spectacle qu’il nous offrait n’avait rien de rassurant.
Il était à demi sorti d’une cuvette dans un tas basaltique, exposant à peu près un mètre cinquante de son corps poilu ; ses yeux, larges comme des soucoupes, luisants comme des agates jaunâtres, tournaient doucement sur leurs longs pédoncules parce qu’il nous avait entendus approcher. Il a commencé à se déplier pour sortir de son repaire, en agitant son long corps à la manière d’une chenille. Il a dressé sa tête à un bon mètre au-dessus des rochers, comme pour mieux nous regarder ; j’ai alors remarqué qu’il portait de chaque côté du cou quelque chose qui ressemblait à des semelles de sandales de tennis : même couleur, même taille, même aspect rayé. Je me demandais ce que c’était ; mais nous n’avons pas tardé à apprendre objectivement leur utilité.
Le Professeur s’était raidi, son épieu pointé en avant et le visage plein d’une résolution virile. L’espoir de capturer un spécimen rare avait balayé toute appréhension. Scanlan et moi n’étions pas du tout aussi assurés ; mais nous ne pouvions pas abandonner notre vieux chef ; nous nous sommes donc plantés à côté de lui. Le monstre, après nous avoir contemplés un bon moment, s’est mis en demeure de descendre la côte ; se frayant gauchement son chemin parmi les rocs il levait de temps à autre ses yeux sur pédoncules pour voir ce que nous faisions. Il venait si lentement à notre rencontre que nous avons éprouvé un sentiment réconfortant de sécurité : sans aucun doute, nous serions capables de le battre à la course. Et néanmoins, mais nous l’ignorions, nous étions à deux doigts de la mort.
La suite est sûrement l’œuvre de la Providence. Le monstre s’avançait avec lourdeur ; il pouvait être à soixante mètres de nous quand un très gros poisson est sorti de la jungle d’herbes et a voulu traverser la gorge. Nageant sans hâte, il se trouvait à mi-chemin entre le monstre et nous quand brusquement il a été secoué par un bond convulsif, s’est retourné le ventre en l’air et est tombé mort au fond du ravin. Au même instant, nous avons ressenti tous les trois un picotement extraordinaire et fort désagréable dans tout le corps, tandis que nos genoux fléchissaient. Le vieux Maracot, aussi perspicace qu’audacieux, a immédiatement compris de quoi il retournait, et qu’il valait mieux renoncer à notre chasse. Nous avions en face de nous un monstre qui diffusait des ondes électriques capables de tuer sa proie, et nos épieux auraient été aussi vains contre lui que contre une mitrailleuse. Si nous n’avions pas eu la chance que le poisson eût reçu sa première décharge, nous aurions attendu qu’il fût assez près pour décharger toutes ses batteries, et nous aurions proprement péri. Sans perdre un moment, nous avons fait demi-tour, bien décidés à laisser dorénavant en paix ce ver de mer électrique géant.
Tels étaient quelques-uns des plus terribles dangers des grands fonds. Il y en avait encore un autre, le petit hydrops noir féroce, pour reprendre le nom que lui a attribué le Professeur. C’était un poisson rouge à peine plus gros qu’un hareng ; il avait une grande bouche et des dents formidables ; ordinairement il était inoffensif ; mais le moindre sang répandu l’attirait aussitôt, et le blessé était alors impuissant à se dégager d’un essaim de ces petites bêtes qui littéralement le déchiquetaient. Une fois, aux mines de houille, nous avons assisté à un spectacle horrible : un travailleur avait eu la malchance de se couper à la main ; en quelques instants, surgissant de toutes parts, des milliers de petits poissons rouges affluaient vers lui ; il avait beau se débattre, et ses compagnons épouvantés tenter de les repousser à coups de pics et de pioches, la moitié inférieure de son corps, que ne protégeait pas la cloche vitreuse, a été réduite en poussière sous nos yeux, en plein milieu de ce nuage vivant qui l’avait assailli. Il n’a pas fallu plus d’une minute pour que cet homme devienne une masse rouge avec des os blancs. Pas plus d’une minute encore pour qu’il ne lui reste plus que les os au-dessous de la ceinture et pour que la moitié d’un squelette dûment curé repose au fond de la mer. Cette scène a été si épouvantable que nous en avons été malades ; Scanlan l’endurci s’est évanoui pour de bon, et nous avons eu du mal pour le ramener dans l’arche.
Mais nous n’avons pas vu que des spectacles horribles. Je garde le souvenir d’une vision que ma mémoire n’oubliera jamais. Nous étions toujours ravis de partir en promenade, tantôt avec les Atlantes, tantôt tout seuls. Pendant que nous traversions une partie de la plaine que nous connaissions bien, nous nous sommes aperçus, à notre vif étonnement, qu’une grande plaque de sable jaune clair, qui avait bien deux mille mètres carrés de superficie, s’était déposée ou découverte depuis notre dernier passage. Nous nous demandions quel courant sous-marin, ou quel mouvement sismique l’avait apportée, quand nous avons eu la surprise de la voir se lever et se mettre à nager avec de lentes ondulations. Elle était si grande qu’il lui fallut une bonne minute pour défiler entièrement au-dessus de nos têtes. C’était un poisson plat géant, assez semblable, nous a déclaré le Professeur, à nos petites limandes, mais qui avait atteint cette taille énorme par l’absorption des produits des dépôts bathybiens. Elle a disparu dans l’obscurité ; nous ne l’avons jamais revue.
Un autre phénomène des grands fonds marins était a priori assez surprenant : je veux parler des tornades. Elles étaient fréquentes. Sans doute sont-elles causées par l’arrivée périodique de puissants courants sous-marins qui déferlent sans avertissement et ont des effets terribles quand leur passage se prolonge : ils provoquent autant de dégâts qu’une violente tempête sur la terre. Sans leurs visites brutales, les grands fonds auraient été victimes de la putréfaction et de la stagnation que procure l’immobilité absolue. Excellent en soi, ce procédé de la nature n’en était pas moins alarmant dans son exécution.
La première fois que je me suis trouvé pris dans un cyclone d’eau, j’étais sorti avec Mona, cette très chère jeune fille dont j’ai parlé. Un très joli tertre surchargé d’algues aux mille couleurs était situé à quinze cents mètres du refuge ; c’était le jardin très particulier de Mona. Elle l’aimait beaucoup, et elle m’avait emmené ce jour-là pour le visiter ; pendant qu’elle m’en faisait les honneurs, la tempête a éclaté. Le courant qui a subitement déferlé sur nous était si fort que nous n’avons été sauvés de la noyade qu’en allant nous réfugier derrière des rochers faisant fonction de brise-lames. J’ai remarqué que l’eau du courant était chaude, d’une chaleur presque insupportable, ce qui prouve l’origine volcanique de ces désordres qui ne sont en quelque sorte que l’écho amorti d’un bouleversement sous-marin situé à une grande distance dans le lit de l’Océan. La boue de la grande plaine était arrachée et soulevée en l’air par le flux ; un nuage épais de matière en suspension dans l’eau obscurcissait la lumière. Trouver notre chemin pour rentrer était impossible : nous avions complètement perdu toute orientation, de plus nous aurions été incapables de nous déplacer à contre-courant. Comble de malchance : un poids croissant sur la poitrine et des difficultés pour respirer m’ont bientôt averti que notre provision d’oxygène touchait à sa fin.
C’est à de tels instants, quand on se trouve au seuil de la mort, que les grandes passions primitives émergent et submergent toutes les émotions inférieures. J’ai donc su en cette minute que j’aimais ma gentille camarade, que je l’aimais de tout mon cœur, de toute mon âme, que je l’aimais d’un amour enraciné au plus profond de moi-même. Quelle chose étrange que cet amour-là ! Comment l’analyserait-on ? Je ne l’aimais pas pour son visage ou sa silhouette, pourtant adorables. Je ne l’aimais pas pour sa voix, bien qu’elle eût la voix la plus mélodieuse que j’eusse jamais entendue. Je ne l’aimais pas pour notre communion mentale, puisque je ne connaissais de ses pensées que ce que m’en traduisait sa physionomie expressive et mobile. Non, il y avait quelque chose dans l’eau de ses yeux noirs et rêveurs, quelque chose aussi dans le fond de son âme et de la mienne qui nous liait pour la vie. J’ai placé sa main entre mes mains, et j’ai lu sur son visage que mes pensées, mes sentiments avaient en elle leur prolongement naturel, qu’ils s’épanouissaient dans son esprit réceptif et coloraient ses joues mates. Je sentais qu’elle n’aurait pas eu peur de mourir à côté de moi : cette idée a fait battre mon cœur plus vite et plus fort.
Mais nous ne devions pas mourir ce jour-là. N’allez pas croire que nos cloches étaient absolument imperméables aux sons : certaines vibrations de l’air les pénétraient, ou du moins leur choc sur la substance vitreuse déclenchait à l’intérieur des vibrations similaires. Nous avons entendu au loin des coups de gong. Je me demandais ce que ce bruit signifiait ; mais Mona n’a pas hésité. Laissant encore sa main dans les miennes, elle s’est levée et, après avoir écouté attentivement, elle s’est pliée en deux et a commencé à marcher contre la tempête. C’était une course contre la mort, car de minute en minute l’oppression sur ma poitrine devenait de plus en plus intolérable. J’ai vu ses chers yeux plonger anxieusement dans mes yeux, et je l’ai suivie en titubant. Ses traits, ses gestes m’indiquaient que sa provision d’oxygène était moins épuisée que la mienne. J’ai tenu jusqu’à la limite de mes forces ; puis tout s’est mis à tourner autour de moi ; j’ai tendu les bras et je suis tombé évanoui sur le lit de l’Océan.
Quand j’ai repris connaissance, j’étais couché sur mon propre lit à l’intérieur de l’arche. Le vénérable prêtre en robe jaune était à mon chevet, avec une fiole à la main. Maracot et Scanlan, consternés, étaient penchés au-dessus de moi, tandis que Mona agenouillée au pied du lit me dédiait l’expression de sa tendresse angoissée. La courageuse jeune fille avait couru jusqu’à la porte de l’arche, d’où l’on battait habituellement un grand gong pour guider les promeneurs surpris par la tempête. Là, elle avait expliqué ma situation et avait guidé un groupe de sauveteurs auxquels mes deux compagnons s’étaient joints ; ils m’avaient ramené en me transportant à bras. Quoi que je fasse plus tard, ce sera Mona qui l’aura accompli, puisqu’elle m’a fait cadeau de cette vie.
À présent que par miracle elle est devenue ma femme dans le monde des hommes sous le soleil, il est étrange de réfléchir au fait que mon amour me commandait de demeurer dans les profondeurs de l’Océan tant qu’elle serait tout mon bien. Pendant longtemps je n’ai pas pu comprendre la nature du lien intime et si profond qui nous réunissait, et qu’elle ressentait, je le voyais bien, aussi fortement que moi. C’est Scarpa, son père, qui m’a fourni une explication aussi imprévue que satisfaisante.
Il avait souri avec gentillesse devant notre roman. Souri avec l’air indulgent, à demi amusé de quelqu’un qui voit survenir ce qu’il attendait. Un jour il nous a pris à part, et il nous a emmenés dans sa propre chambre où était disposé l’écran d’argent sur lequel ses pensées et son savoir pouvaient se réfléchir. Tant qu’il me restera un souffle de vie, je n’oublierai jamais ce qu’il m’a montré. Mona non plus. Assis côte à côte, la main dans la main, nous avons assisté dans une sorte d’enchantement au défilé des images formées et diffusées par cette mémoire raciale du passé que possèdent les Atlantes.
Une péninsule rocheuse pointait dans un bel Océan bleu. Peut-être ne vous ai-je pas dit que, dans leurs films de pensées, la couleur apparaissait aussi exactement que les formes ? Sur cette avancée donc, il y avait une maison pittoresque d’autrefois : toit rouge, murs blancs, spacieuse, magnifique. Elle était au centre d’un bois de palmiers. Ce bois devait abriter un camp, car nous apercevions des tentes blanches et, par instants, un scintillement d’armes comme si une sentinelle montait la garde. Du bois est sorti un homme d’âge moyen, revêtu d’une cotte de mailles, le bras ceint d’un léger écu rond ; dans l’autre main il tenait une épée ou un javelot. Il a regardé de notre côté, et j’ai tout de suite vu qu’il appartenait à la race des Atlantes. En vérité il aurait pu être le frère jumeau de Scarpa, à cela près qu’il avait le visage rude et menaçant. Un brutal, pas brutal par ignorance, mais brutal par tempérament et par nature. S’il s’agissait là d’une précédente incarnation de Scarpa (et par ses gestes il semblait vouloir nous faire comprendre qu’il en était réellement ainsi) il s’était grandement élevé depuis lors, par l’âme sinon par l’esprit.
Pendant qu’il se rapprochait de la maison, nous avons vu sur l’écran qu’une jeune femme en sortait pour aller à sa rencontre. Elle était habillée comme les Grecques d’autrefois, dans ce long vêtement blanc collant qui est bien le plus simple mais le plus beau et le plus distingué qu’une femme ait jamais conçu. En avançant vers l’homme, son attitude était toute de soumission et de respect : l’attitude d’une fille de devoir envers son père. Il l’a cependant repoussée sauvagement, et il a levé une main comme s’il voulait la frapper. Quand elle a reculé devant lui, le soleil a éclairé son joli visage couvert de larmes : c’était ma Mona.
L’écran s’est brouillé. Un instant plus tard un autre décor est apparu : une petite baie entre des rochers ; elle devait faire partie de la péninsule que j’avais déjà vue. Un bateau de forme bizarre, aux extrémités hautes et pointues, était au premier plan. Il faisait nuit, mais la lune brillait sur l’eau. Les étoiles familières scintillaient dans le ciel. Lentement, avec précautions, le bateau s’est rapproché du rivage. Deux rameurs étaient à bord, plus un homme enveloppé d’une cape sombre. Il s’est dressé pour jeter des regards anxieux autour de lui. J’ai vu sa figure pâle et ardente au clair de lune. Je n’ai pas eu besoin de l’étreinte convulsive de Mona ni de l’exclamation de Scarpa pour m’expliquer le frisson qui m’a secoué. L’homme, c’était moi.
Oui, moi, Cyrus Headley, aujourd’hui de New York et d’Oxford. Moi, le plus récent produit de la culture moderne, j’avais déjà participé à cette puissante civilisation antique. Je comprenais maintenant pourquoi plusieurs symboles et hiéroglyphes que j’avais vus autour de moi m’avaient donné une impression de déjà vu. À différentes reprises je m’étais aperçu que je ressemblais à un homme faisant effort sur sa mémoire parce que se sentant au bord d’une grande découverte qui l’attendait constamment mais qui se maintiendrait toujours hors d’atteinte. Et maintenant, je comprenais aussi le frémissement de toute mon âme que j’avais éprouvé quand mes yeux avaient rencontré ceux de Mona. Tout cela provenait des profondeurs de mon subconscient où flânaient encore les souvenirs de douze mille années.
Le bateau avait accosté ; une silhouette blanche avait surgi, était sortie des buissons. Je lui ai tendu les bras, je l’ai soulevée, transportée dans le bateau. Et puis une alarme soudaine m’a envahi. Avec des gestes frénétiques j’ai ordonné aux rameurs de quitter le rivage. Trop tard ! Des hommes ont à leur tour émergé des buissons. Des mains furieuses se sont cramponnées au flanc du bateau. J’ai tenté de leur faire lâcher prise. Une hache a brillé en l’air et s’est abattue sur ma tête. Je suis tombé mort sur la jeune fille, en inondant sa robe de mon sang. Je l’ai vue qui hurlait, j’ai vu ses yeux sauvages, sa bouche ouverte ; et j’ai vu son père qui la tirait par les cheveux de dessous mon cadavre. Sur cette vision le rideau est tombé.
Pas pour longtemps. Une nouvelle image a animé l’écran : l’intérieur de l’arche du refuge qu’avait construite le sage Atlante pour servir d’abri le jour du malheur (la maison même où nous étions). J’ai vu ses habitants terrifiés au moment de la catastrophe. J’ai alors revu ma Mona ; et j’ai revu aussi son père qui, devenu plus sage et meilleur, avait trouvé place parmi les élus qui allaient être sauvés. Nous avons vu le grand hall tanguer comme un navire dans la tempête, les malheureux réfugiés s’accrocher aux colonnes ou tomber par terre. Et puis nous avons vu une embardée et la chute à travers les vagues. Une fois de plus la lumière s’est estompée, et Scarpa s’est tourné vers nous en souriant pour nous indiquer que tout était fini.
Oui, nous avions vécu des vies antérieures, Scarpa, Mona et moi. Peut-être revivrons-nous encore une fois, pour agir et réagir sur la longue chaîne de nos existences. J’étais mort dans le monde d’en-haut ; mes propres réincarnations avaient donc eu lieu sur la terre. Scarpa et Mona étaient morts au fond de la mer ; voilà pourquoi leur destinée cosmique s’était poursuivie sous les eaux. Pendant un moment un coin du voile obscur de la nature s’était soulevé, et un rapide éclair de vérité avait surgi parmi les mystères qui nous environnaient. Chaque vie n’est qu’un chapitre d’une histoire que Dieu a conçue. On ne pourra juger de sa justice ou de sa sagesse que le jour suprême où, du haut d’une cime de connaissance, on regardera en arrière et on verra enfin la cause et les effets, l’action et la réaction, tout au long des longues chroniques du Temps.
Ce nouveau lien de parenté, si délicieux, nous a peut-être sauvés un peu plus tard, quand a éclaté la seule grave querelle qui nous ait opposés à la communauté au sein de laquelle nous vivions. En fait, les choses auraient probablement très mal tourné pour nous, si une affaire beaucoup plus importante n’avait accaparé l’attention générale, et ne nous avait permis de remonter très haut dans l’estime des Atlantes.
Un matin, si l’on peut employer ce terme alors que les heures du jour n’étaient clairement définies que par nos occupations, le Professeur et moi étions assis dans notre grande chambre commune. Il en avait équipé un coin en laboratoire, et il disséquait un gastrostomus qu’il avait pris la veille au filet. Sur sa table s’étalaient en grand désordre des amphipodes, des copépodes et quantité d’autres petites créatures dont l’odeur était beaucoup moins agréable que leur apparence. Installé auprès de lui, j’étudiais une grammaire atlante, car nos amis disposaient de nombreux livres imprimés de droite à gauche sur une matière que j’avais d’abord prise pour du parchemin mais qui était en réalité de la vessie de poisson pressée et conservée. Je cherchais à posséder la clef qui m’ouvrirait toute leur science ; je consacrais donc beaucoup de temps à l’étude de leur alphabet et des éléments de leur langage.
Nos occupations pacifiques se sont trouvées compromises par l’irruption d’une étrange procession. En tête venait Bill Scanlan, très rouge et très excité ; sous un bras il tenait, à notre stupéfaction, un bébé aussi dodu que bruyant. Derrière lui courait Berbrix, l’ingénieur qui avait aidé Scanlan à construire un poste de radio ; c’était un gros Atlante habituellement jovial, mais il était défiguré par le chagrin. Enfin suivait une femme dont les cheveux filasse et les yeux bleus montraient qu’elle n’était pas une Atlante, mais une fille de la race esclave dont l’origine nous semblait être grecque.
– Écoutez-moi, patron ! a crié Scanlan. Ce Berbrix, qui est un type régulier, va écoper, ainsi que ce jupon avec qui il s’est marié. J’estime que nous avons le droit de veiller à ce qu’on leur rende justice, Pour autant que j’aie compris, cette femme est ici ce qu’un nègre est dans le Sud, et il a fait une bêtise quand il a voulu l’épouser ; mais après tout, c’est son affaire et cela ne nous regarde pas.
— Naturellement, cela ne regarde que lui, ai-je répondu. Quelle mouche vous a piqué, Scanlan ?
— Une drôle de mouche, patron ! Un bébé est né de ce mariage. Or il paraît que les gens d’ici ne veulent pas de sangs mêlés ; les prêtres sont aux cent coups : ils sont décidés à offrir ce bébé à la statue d’en bas. Le chef au grand pif s’était emparé du bébé et filait déjà, quand Berbrix le lui a repris, et moi je l’ai un peu bousculé, si bien que toute la meute est à nos trousses, et …
Scanlan n’a pas pu compléter son explication : notre porte s’est brusquement ouverte, et plusieurs serviteurs du temple se sont précipités chez nous. Derrière eux, farouche et austère, est apparu le formidable grand-prêtre au grand nez. Il a fait un geste ; ses serviteurs se sont élancés pour se saisir de l’enfant. Ils se sont immobilisés toutefois, quand ils ont vu Scanlan déposer le bébé parmi les spécimens du docteur Maracot et ramasser un épieu avec lequel il a fait front. Les assaillants ayant tiré leurs couteaux, j’ai empoigné moi aussi un épieu et j’ai couru au secours de Scanlan ; Berbrix m’avait imité. Nous étions si menaçants que les serviteurs du temple ont reculé. Nous nous trouvions dans une impasse.
— Monsieur Headley, mon bon Monsieur, vous parlez un peu de leur idiome ! m’a crié Scanlan. Dites-leur qu’ici on n’a pas l’habitude de se laisser cambrioler. Dites-leur qu’on ne donne pas de bébés ce matin, non, merci ! Dites-leur que s’ils approchent, nous mettrons leur cabane à l’envers … Là ! Vous l’avez voulu, vous en avez eu pour votre argent ! Je vous souhaite beaucoup de plaisir !
Les dernières phrases de Scanlan visaient l’un des serviteurs qui avait voulu nous tourner et qui avait levé son couteau pour poignarder Scanlan : Maracot avait bondi et avait plongé son scalpel de dissection dans le bras de l’assassin manqué. Celui-ci s’est mis à hurler, à gigoter de frayeur et de douleur ; mais ses compagnons, excités par le grand-prêtre, allaient se lancer à l’assaut. Le Ciel sait ce qui serait advenu si Manda et Mona n’étaient entrés dans notre chambre. Stupéfait, le chef a posé au grand-prêtre un certain nombre de questions passionnées. Mona s’était placée à côté de moi : une inspiration heureuse m’a incité à prendre le bébé et à le lui remettre : sitôt dans ses bras, il s’est mis à gazouiller de béatitude.
Le front de Manda s’était assombri ; il était visiblement embarrassé. Il a commencé par renvoyer le grand-prêtre et ses acolytes dans leur temple ; puis il s’est lancé dans une longue explication dont je n’ai pu traduire qu’une partie à mes compagnons.
— Il faut que vous abandonniez l’enfant, ai-je dit à Scanlan.
— L’abandonner ? Non, Monsieur. Rien à faire !
— Cette jeune fille va prendre en charge la mère et l’enfant.
— C’est différent ! Si Mademoiselle Mona s’en occupe, ça va. Mais si ce gredin de grand-prêtre …
— Non. Il ne pourra pas intervenir. L’affaire sera tranchée par le Conseil. Elle est très grave, car Manda m’a dit que le grand-prêtre était dans la limite de ses droits ; il s’agit d’une ancienne coutume de la nation. Manda prétend qu’ils ne pourraient jamais distinguer entre la race supérieure et la race inférieure s’il y avait toutes sortes d’intermédiaires. Quand des enfants naissent d’un Atlante et d’une Grecque, ils doivent mourir. Telle est la loi.
— Oui ? Hé bien, moi je vous assure que le bébé ne mourra pas !
— J’espère que non. Il m’a dit qu’il tenterait l’impossible devant le Conseil. Le Conseil ne se réunira pas avant huit ou quinze jours. Jusque-là il sera en sécurité, et qui sait ce qui peut se produire entre temps ?
Oui, et qui savait ce qui pourrait se produire ? Qui même aurait imaginé ce qui allait réellement se produire, ce que je garde pour le chapitre suivant de nos aventures ?
CHAPITRE VII
J’ai déjà indiqué qu’à une courte distance de l’arche des Atlantes, s’étendaient les ruines de la grande capitale de l’Atlantide. J’ai aussi relaté notre visite, sous nos cloches vitreuses ; mais comment traduire l’impression produite par ces immenses colonnes sculptées et ces bâtiments démesurés, gisant dans le silence et dans la lumière grise phosphorescente des profondeurs bathybiennes qui ne connaissaient d’autres mouvements que le lent balancement des frondes géantes sous l’action des courants, ou le volètement des ombres des grands poissons ? C’était l’une de nos excursions favorites ; guidés par notre ami Manda, nous avons passé bien des heures à examiner l’architecture étrange et les autres vestiges de cette civilisation disparue qui avait été, sur le plan des connaissances pratiques, bien en avance sur la nôtre.
J’ai dit : connaissances pratiques. Mais nous avons eu bientôt la preuve que sur le plan de la culture spirituelle un vaste abîme les séparait de nous. La leçon à tirer de leur essor et de leur déclin est que le plus grand danger que court un État se déclare lorsque l’esprit y distance l’âme. Il a détruit cette vieille civilisation ; il pourrait aussi bien ruiner la nôtre.
Nous avions remarqué que dans une partie de l’ancienne cité, un grand bâtiment avait dû être situé sur une colline, car il était encore surélevé par rapport au niveau général. Un long escalier de larges marches en marbre noir y donnait accès ; ce matériau avait été également utilisé pour la construction de presque tout l’édifice ; mais d’affreux champignons jaunes, véritable masse lépreuse, pendaient maintenant des corniches et de toutes les parties saillantes. Au-dessous de la porte principale une terrible tête de Méduse crachait des serpents ; ce même symbole se répétait sur les murs. À plusieurs reprises nous avions voulu explorer ce bâtiment, mais chaque fois notre ami Manda avait manifesté, un trouble extrême, et à grand renfort de gestes il nous avait suppliés de ne pas entrer. Nous ne pouvions que déférer à ses désirs, et cependant nous étions dévorés de curiosité. Un matin, Bill Scanlan et moi avons tenu un conseil de guerre.
– Écoutez-moi, patron, m’a-t-il dit. Il y a là quelque chose que ce type ne veut pas nous montrer ; mais plus il le cache et plus j’ai envie de le voir. Nous n’avons plus besoin de guides pour sortir. Je pense que nous pourrions mettre nos chapeaux de verre et aller nous promener par là comme n’importe quel citoyen. Nous explorerons le coin.
— Pourquoi pas ? …
J’étais aussi impatient que Scanlan. Mais le docteur Maracot étant entré sur ces entrefaites, je me suis tourné vers lui.
— … Voyez-vous une objection quelconque, Monsieur ? Peut-être voudriez-vous nous accompagner et élucider l’énigme du Palais du Marbre Noir ?
— Qui pourrait s’appeler aussi bien le Palais de la Magie Noire, m’a-t-il répondu. Avez-vous entendu parler du Seigneur de la Face Noire ? …
J’ai avoué que non. Je ne sais plus si j’ai déjà précisé que le Professeur était un spécialiste des religions comparées et des anciennes croyances primitives. La lointaine Atlantide n’avait pas échappé à son appétit de savoir.
— … C’est par le truchement de l’Égypte que nous avons appris quelque chose sur l’Atlantide, m’a-t-il expliqué. Ce que les prêtres du temple de Saïs ont dit à Solon est le noyau solide autour duquel s’est agglutiné le reste, moitié réalité, moitié fiction.
— Et qu’ont raconté ces saints prêtres ? a interrogé Scanlan.
— Oh, pas mal de choses ! Mais entre autres, ils ont transmis une légende sur le Seigneur de la Face Noire. Je ne peux pas m’empêcher de faire un rapprochement : n’aurait-il pas été le maître du Palais de Marbre Noir ? Certains assurent qu’il y a eu plusieurs Seigneurs de la Face Noire ; un au moins a laissé un souvenir durable.
— Quelle espèce de canard était-il ? a demandé Scanlan.
— Hé bien, d’après ce qu’on en a dit, il était plus qu’un homme, tant par ses pouvoirs que par sa méchanceté. En réalité, ce serait à cause de la corruption dont il avait contaminé le peuple, que tout le pays a été détruit.
— Comme Sodome et Gomorrhe.
— Exactement. Tout se passe comme si à partir d’un certain point, il devenait impossible d’aller plus loin. La patience de la nature est épuisée, et il ne reste qu’une solution : tout démolir et tout recommencer. Cette créature, que l’on peut difficilement appeler un homme, a trafiqué dans des sciences profanes pour acquérir des pouvoirs magiques extraordinaires qu’il a utilisés pour des fins mauvaises. Telle est la légende du Seigneur de la Face Noire. Elle expliquerait pourquoi sa demeure est encore pour ces pauvres gens un sujet d’abomination et d’horreur, et pourquoi ils ne tiennent pas à ce que nous en approchions.
— Voilà qui ajoute à mon envie d’y aller ! me suis-je écrié.
– À moi aussi ! a ajouté Bill.
— J’avoue, a dit le Professeur, que je serais très intéressé si je pouvais la visiter. Je ne pense pas que nos hôtes si complaisants nous reprocheraient une petite exploration privée, du moment que leurs superstitions les empêchent de nous accompagner. Nous n’aurons qu’à saisir la première occasion.
Il a fallu laisser passer plusieurs jours, car notre petite communauté vivait dans une intimité qui interdisait tout secret. Mais un matin, un rite religieux a réuni tous les Atlantes. Bien entendu nous en avons profité et, après avoir rassuré les deux gardiens qui actionnaient les pompes du hall, nous nous sommes trouvés seuls sur le lit de l’Océan et en route pour la vieille ville. Dans l’eau salée, la progression est lente, et la moindre des promenades fatigante. Toutefois nous n’avons pas mis une heure pour arriver devant la grande porte de ce palais du mal.
Il était beaucoup mieux conservé que les autres bâtiments de la cité ; le marbre extérieur n’était pas abîmé ; à l’intérieur, par contre, les meubles et les tentures avaient cruellement souffert. D’autre part, la nature avait prodigué au palais toutes sortes de décorations horribles. Par lui-même l’endroit était déjà sinistre ; mais dans les recoins ombreux se tapissaient des polypiers et d’affreuses bêtes qui semblaient surgir d’un cauchemar. Je me rappelle une énorme limace de mer pourpre répandue à de multiples exemplaires, et de gros poissons plats et noirs, posés sur le plancher comme des nattes, et dotés de longues tentacules vibrantes aux extrémités rouge feu. Nous étions obligés d’avancer avec précaution, car tout le bâtiment était rempli de monstres qui pouvaient fort bien se révéler aussi venimeux qu’ils en avaient l’air.
Sur les couloirs somptueusement décorés, ouvraient de petites chambres latérales ; mais le centre de l’édifice était occupé par une salle magnifique qui, au temps de sa splendeur, avait dû être l’une des salles les plus belles que des mains d’hommes aient édifiées. Dans cette lumière détestable, nous n’apercevions ni le plafond ni tous les murs ; mais en faisant le tour, nous avons pu apprécier grâce à nos lampes électriques ses proportions grandioses et la richesse de ses ornements. Ces ornements étaient des statues et des bas-reliefs, sculptés avec un art absolument parfait, mais atroces ou révoltants par la nature des sujets traités. Tout ce que l’esprit humain le plus dépravé pouvait concevoir en fait de cruauté sadique ou de luxure bestiale était étalé sur les murs. Des images monstrueuses et des créations abominables de l’imagination se profilaient de tous côtés dans l’ombre. Si jamais un temple a été érigé en l’honneur du diable, il l’a été là. D’ailleurs le diable lui-même était présent : au fond de la salle, sous un dais de métal décoloré qui avait pu être de l’or et sur un trône élevé en marbre rouge, une divinité était assise : véritable personnification du mal, sauvage, impitoyable, menaçante, taillée sur les mesures du Baal que nous avions vu dans l’arche, mais infiniment plus répugnante. La splendide vigueur de cette terrible image de marbre avait de quoi fasciner. Pendant que nous promenions sur elle les faisceaux lumineux de nos lampes et que nous méditions, nous avons brusquement sursauté : derrière nous venait d’éclater un rire humain, ironique et bruyant.
Nous avions la tête enserrée sous nos cloches vitreuses ! nous ne pouvions guère entendre ni proférer des sons. Et cependant nous avions tous les trois perçu ce rire satanique aussi distinctement que si nous avions eu l’ouïe libre. Nous nous sommes retournés d’un même élan, et la stupéfaction nous a cloués sur place.
Adossé contre une colonne de la salle, un homme avait croisé les bras sur sa poitrine, et ses yeux méchants nous observaient de façon menaçante. J’ai dit : un homme. En réalité il ne ressemblait pas à un homme normal ; d’ailleurs le fait qu’il respirait et parlait comme aucun homme n’aurait pu respirer ou parler au fond de la mer, et que sa voix portait là où aucune voix humaine n’aurait pu porter, nous confirmait qu’il était très différent de nous-mêmes. Physiquement c’était un être magnifique ; il ne mesurait pas moins de deux mètres quinze, et il était bâti comme un athlète complet ; nous le constations d’autant mieux qu’il portait un costume très collant, apparemment en cuir noir glacé. Il avait le visage d’une statue de bronze : cette statue aurait été le chef-d’œuvre d’un sculpteur s’il avait cherché à représenter toute la force et aussi tout le mal que peut exprimer une figure humaine. Cette face n’était ni bouffie ni sensuelle ; de tels défauts auraient en effet signifié une certaine faiblesse, et la faiblesse n’aurait pas été à sa place sur cette face-là. Au contraire, elle était extraordinairement ferme, bien découpée, avec un nez en bec d’aigle, des sourcils noirs hérissés, et des yeux sombres où couvait un feu qui pouvait s’embraser d’une méchanceté impitoyable. C’étaient ses yeux et sa bouche cruelle, droite, dure, scellée comme le destin, qui lui donnaient un air terrifiant. Quand on le détaillait, on sentait que, tout beau qu’il fût, il n’en était pas moins intrinsèquement mauvais jusque dans la moëlle des os, que son regard était une menace, son sourire un ricanement, son rire une raillerie.
— Hé bien, Messieurs, nous a-t-il dit en excellent anglais et d’une voix aussi audible que si nous étions de retour sur la terre, vous avez été les héros d’une aventure exceptionnelle, et vous vous préparez à en vivre une autre encore plus passionnante, mais mon bon plaisir l’interrompra peut-être brusquement. Cette conversation sera, j’en ai peur, un monologue ; comme toutefois je suis parfaitement capable de lire vos pensées, comme je connais tout de vos personnes, vous n’avez pas à redouter une méprise. Mais vous avez beaucoup, oui, beaucoup à apprendre ici …
Nous nous sommes regardés les uns les autres, complètement abasourdis. Il était vraiment pénible de ne pas pouvoir échanger nos réactions devant un pareil événement ! À nouveau son rire grinçant a retenti.
— … Oui, c’est vraiment pénible ! Mais vous pourrez bavarder quand vous serez de retour, car je désire que vous repartiez et que vous emportiez un message. Je crois que, sans ce message, votre intrusion chez moi aurait sonné votre glas. Mais d’abord j’ai différentes choses à vous dire. Je m’adresserai à vous, docteur Maracot, puisque vous êtes le plus âgé et sans doute le plus sage de votre groupe ; la sagesse pourtant aurait dû vous interdire une promenade comme celle-ci ! Vous m’entendez bien, n’est-ce pas ? Parfait ! Je ne vous demande qu’un signe de tête affirmatif ou négatif.
« Vous savez naturellement qui je suis. Je crois que vous m’avez découvert depuis peu. Personne ne peut penser à moi, ou parler de moi, sans que je le sache. Personne ne peut entrer dans cette vieille maison qui m’appartient et qui est mon sanctuaire le plus intime, sans que je n’y sois appelé. Voilà pourquoi ces pauvres misérables de là-bas l’évitent, et voulaient que vous vous absteniez d’entrer. Vous auriez été plus avisés en suivant leurs conseils. Vous m’avez fait venir ; une fois que je suis venu, je ne pars pas facilement.
« Votre esprit, doté de son petit grain de science terrestre, se tracasse sur les problèmes que soulève ma présence. Comment puis-je vivre ici sans oxygène ? Je ne vis pas ici. Je vis dans le grand monde des hommes sous la lumière du soleil. Je ne viens ici que lorsque l’on m’appelle, comme vous m’avez appelé. Mais je suis un être qui respire dans l’éther. Il y a ici autant d’éther que sur le sommet d’une montagne. Certains hommes peuvent vivre sans air. Le cataleptique passe des mois sans respirer. Je suis comme lui, mais en restant, vous vous en apercevez, conscient et actif.
« Vous vous demandez aussi comment il se fait que vous m’entendiez. N’est-ce pas l’essence même de la transmission par sans-fil qu’elle retourne de l’éther dans l’air ? Moi aussi, je peux transformer l’articulation éthérique de mes paroles pour les porter à vos oreilles à travers l’air qui remplit vos cloches stupides.
« Et mon anglais ? Hé bien, j’espère qu’il est à peu près correct. Je vis depuis quelque temps sur terre. Oh, une époque bien fatigante ! Depuis quand ? Est-ce onze mille ou douze mille ans ? Douze mille, je crois. J’ai eu le temps d’apprendre toutes les langues humaines. Mon anglais n’est ni meilleur ni pire que les autres.
« Ai-je résolu quelques-uns de vos problèmes ? Oui. Je le vois, même si je ne vous entends pas. Mais maintenant j’ai quelque chose de plus sérieux à vous dire.
« Je suis le Baal-seepa. Je suis le Seigneur de la Face Noire. Je suis celui qui a pénétré si avant dans les secrets de la nature que j’ai pu défier la Mort. J’ai organisé les choses de telle sorte que je ne pourrais pas mourir même si je voulais mourir. Pour me faire mourir, il faudrait que je rencontre une volonté plus forte que la mienne. Oh, mortels, ne priez jamais pour être délivrés de la mort ! La mort peut vous paraître terrible, mais la vie éternelle l’est bien davantage, et infiniment. Continuer, continuer, continuer à vivre pendant que passe l’interminable cortège des hommes ! Toujours être assis au bord de la route de l’histoire et la voir se faire, allant toujours de l’avant et vous laissant derrière ! Faut-il s’étonner que mon cœur soit sombre et amer, et que je maudisse le troupeau imbécile des hommes ? Je leur fais du mal quand je le peux. Pourquoi pas ?
« Vous vous demandez comment je peux leur faire du mal. Je détiens quelques pouvoirs, qui ne sont pas petits. Je peux incliner les esprits des hommes. Je suis le maître de la foule. Je me suis toujours trouvé là où le mal a été projeté et commis. J’étais avec les Huns quand ils ont dévasté la moitié de l’Europe. J’étais avec les Sarrazins quand au nom de la religion ils ont passé au fil de l’épée tous ceux qui les contredisaient. J’étais dehors la nuit de la Saint-Barthélemy. Derrière le trafic d’esclaves, c’était moi. C’est parce que j’ai chuchoté quelques mots que dix mille vieilles bonnes femmes, que des idiots appelaient des sorcières, ont été brûlées. J’étais le grand homme noir qui conduisait la populace de Paris quand les rues baignaient dans le sang. Quelle époque ! Mais j’ai récemment vu mieux en Russie. Voilà d’où j’arrive. J’avais presque oublié cette colonie de rats de mer qui se terrent sous la boue et qui perpétuent quelques-uns des arts et des légendes du grand pays où la vie s’était épanouie comme jamais elle ne s’est épanouie depuis. C’est vous qui les avez rappelés à mon souvenir, car cette vieille maison qui m’appartient est encore unie, par des vibrations personnelles dont votre science ne sait rien, à l’homme qui l’a édifiée et aimée. J’ai su que des étrangers y avaient pénétré, je me suis enquis, et me voici. Puisque maintenant je suis chez moi (et c’est la première fois depuis des milliers d’années) je me souviens de ce peuple. Il y a assez longtemps qu’il s’attarde. Il est temps qu’il disparaisse. Il est issu du pouvoir de quelqu’un qui m’a défié quand il vivait, et qui a construit cet instrument pour échapper à la catastrophe qui a englouti tous les habitants, sauf ses amis et moi. Sa sagesse les a sauvés ; mes pouvoirs m’ont sauvé. Mais maintenant mes pouvoirs vont écraser ceux qu’il a sauvés, et l’histoire ainsi sera complète …
Il a glissé une main contre sa poitrine, et il en a tiré un document.
— … Vous remettrez ceci au chef des rats de mer, a-t-il ajouté. Je regrette que vous, Messieurs, soyez amenés à partager leur destin ; mais puisque vous êtes la cause première de leur malheur, ce ne sera après tout que justice. Je vous reverrai ultérieurement. En attendant, je vous recommande l’étude de ces images et de ces sculptures ; elles vous donneront une idée de la cime où j’avais hissé l’Atlantide quand je la gouvernais. Vous trouverez là quelques traces des mœurs et coutumes du peuple quand il subissait mon influence. La vie était pleine de pittoresque, d’imprévu, de charme. À votre époque sinistre, on la qualifierait d’orgie de débauches. Ma foi, qu’on l’appelle comme on voudra ! Moi, je l’ai créée et répandue, j’en ai été heureux, je ne regrette rien. Si j’avais le temps, je recommencerais, et même je ferais mieux sans toutefois accorder le don fatal de la vie éternelle. Warda, que je maudis et que j’aurais dû exterminer avant qu’il eût le pouvoir de tourner des gens contre moi, a été plus intelligent : il lui arrive de revisiter la terre, mais c’est en esprit qu’il revient, pas en homme. Maintenant, je pars. Votre curiosité vous a conduits ici, mes amis : j’espère qu’elle a été satisfaite.
Alors nous l’avons vu disparaître. Oui, il s’est dissipé devant nous. Pas immédiatement. Il a commencé par s’éloigner de la colonne à laquelle il était adossé. Sa silhouette imposante a paru se brouiller sur les bords. Toute lumière s’est éteinte dans son regard, et ses traits sont devenus troubles, puis indistincts. Il s’est fondu en un nuage sombre qui est monté en tourbillonnant à travers l’eau stagnante de cette salle d’épouvante. Et puis nous n’avons plus rien vu. Nous étions à nouveau entre nous, mais émerveillés par les étranges possibilités de la vie.
Nous ne nous sommes pas attardés dans le Palais du Seigneur de la Face Noire. Ce n’était pas un lieu propice aux flâneries. J’ai retiré une dangereuse limace pourpre qui s’était posée sur l’épaule de Bill Scanlan, et moi-même j’ai été cruellement piqué à la main par le venin que m’a craché au passage un grand lamellibranche jaune. Quand nous nous sommes retrouvés dehors, maudissant notre folie, nous avons goûté avec joie la lumière phosphorescente de la plaine bathybienne, ainsi que l’eau limpide et translucide qui nous enveloppait. Nous avons mis moins d’une heure pour rentrer. Une fois débarrassés de nos cloches vitreuses, nous avons tenu conseil. Le Professeur et moi étions trop accablés pour exprimer en mots ce que nous pensions. La vitalité de Bill Scanlan s’est révélée encore une fois invincible.
— Sacrée fumée ! a-t-il murmuré. Voilà à quoi nous avons affaire maintenant. Ce type est sorti tout droit de l’enfer. Avec ses statues, ses bas-reliefs et le reste, il jouerait assez bien les tauliers dans une maison à lanterne rouge ! Comment en venir à bout ? Voilà la question !
Le docteur Maracot réfléchissait. Puis il s’est levé pour sonner ; notre serviteur habillé de jaune est entré.
— Manda ! a-t-il commandé.
Quelques instants plus tard, notre ami arrivait dans notre chambre. Maracot lui a tendu le message décisif.
Jamais je n’ai admiré un homme comme j’ai admiré Manda ce jour-là. Nous étions la cause d’une menace d’anéantissement de son peuple et de lui-même, du fait de notre curiosité injustifiable. Nous, des étrangers qu’il avait sauvés alors que tout leur semblait perdu ! Et pourtant, bien qu’il soit devenu blanc à la lecture du message, ses yeux n’ont pas exprimé le moindre reproche quand il les a tristement tournés vers nous. Il a secoué la tête ; le désespoir était entré dans son âme.
— Baal-seepa ! Baal-seepa ! s’est-il écrié en portant ses mains à ses yeux comme pour en chasser une vision horrible.
Il a arpenté la chambre, puis il s’est précipité dehors pour lire le message à la communauté. Nous avons entendu la grosse cloche convoquer tous les Atlantes dans la grande salle.
— Irons-nous ? ai-je demandé.
Le docteur Maracot a hoché la tête.
— Que pourrons-nous faire ? Et eux, que pourront-ils faire ? Quelle chance ont-ils contre quelqu’un qui a la puissance d’un démon ?
— Aussi peu qu’une famille de lapins contre une belette, a répondu Scanlan. Mais, sapristi, c’est à nous de trouver une issue ! Nous ne pouvons pas en rester là : avoir fait dresser le diable, et laisser périr ceux qui nous ont sauvés.
— Que proposez-vous ?
Je l’avais interrogé avec âpreté, car sous la façade de sa légèreté et de son argot, je savais qu’il possédait toutes les qualités pratiques de l’homme moderne.
— Hé bien, je n’en ai pas la plus petite idée ! Pourtant ce type n’est peut-être pas invulnérable autant qu’il le croit. L’âge a peut-être usé quelques-unes de ses malices ; or il n’est plus très jeune, d’après ce qu’il nous a dit.
— Vous croyez que nous pourrions l’attaquer ?
— Folie ! a crié le Professeur.
Scanlan a ouvert son tiroir. Quand il s’est retourné vers nous, il tenait un gros revolver à six coups.
— Que pensez-vous de ceci ? Je l’ai retiré de l’épave du Stratford. Je m’étais dit que nous pourrions en avoir besoin un jour. J’ai aussi une douzaine de balles. Je pourrais lui faire douze trous dans le collant, histoire de lui faire perdre un peu de sa magie ? Oh, mon Dieu ! Qu’est-ce que j’ai ?
Il a lâché le revolver qui est tombé sur le plancher, et il s’est tordu de douleur, sa main gauche étreignant son poignet droit. Des crampes terribles avaient attaqué son bras ; quand nous avons voulu le masser, nous avons senti que ses muscles étaient noués, aussi durs que les racines d’un arbre. La souffrance lui arrachait des gouttes de sueur sur le front. Finalement, dompté et épuisé, il est allé se jeter sur son lit.
— Je suis fini ! a-t-il déclaré. Oui, merci, ça va mieux. Mais c’est le K. O. pour Bill Scanlan. J’ai appris ma leçon. On ne se bat pas contre l’enfer avec un revolver à six coups ; inutile de jouer à ça. Je m’incline devant plus fort que moi, de ce jour jusqu’à la fin de l’éternité.
— Oui, a dit Maracot, vous avez eu votre leçon, et elle a été sévère !
— Alors vous pensez qu’il n’y a aucun espoir ?
— Que pouvons-nous tenter si, comme il le semble, il est au courant de tout ce qui se fait, de tout ce qui se dit ? Et pourtant, ne désespérons pas encore …
Il est demeuré assis silencieusement pendant quelques minutes.
— … Je pense que vous, Scanlan, vous feriez mieux de rester quelque temps où vous êtes. Vous avez eu une secousse dont vous ne vous rétablirez pas tout de suite.
— S’il y a quelque chose à faire, je suis votre homme, a répondu bravement notre camarade dont les traits tirés et les membres tremblants montraient la violence du choc qu’il avait subi.
— En ce qui vous concerne, je ne vois rien à faire. En tout cas, nous venons d’apprendre comment il ne fallait pas opérer. Toute violence serait vaine. Nous œuvrerons donc sur un autre plan : le plan de l’esprit. Restez ici, Headley. Je vais dans la pièce dont j’ai fait mon bureau. Peut-être, dans la solitude, verrai-je un peu plus clair.
Scanlan et moi avions appris par expérience à avoir la plus grande confiance en Maracot. Si un cerveau d’homme pouvait résoudre nos difficultés, c’était bien le sien. Mais n’avions-nous pas atteint un point qui se situait au-delà de toute capacité humaine ? Nous étions aussi impuissants que des enfants, face à ces forces que nous ne pouvions ni comprendre ni contrôler … Scanlan a sombré dans un sommeil troublé. Assis à côté de son lit, je ne pensais pas à la façon dont nous pourrions être sauvés, mais j’essayais de prévoir la forme que revêtirait le coup fatal et l’heure à laquelle il serait assené. À tout moment je m’attendais à voir se crever le toit solide qui nous abritait, s’écrouler les murs, tandis que les eaux sombres des plus grands fonds se refermeraient sur ceux qui les défiaient depuis si longtemps.
Et puis tout à coup la grosse cloche a sonné encore une fois. Son lourd carillon m’a secoué d’un frisson d’inquiétude. Je me suis levé d’un bond ; Scanlan s’est redressé sur son séant. Ce n’était pas une convocation ordinaire. Les battements irréguliers de la cloche annonçaient une alerte, réclamaient tout le monde, et tout de suite. Scanlan m’a interpellé.
— Dites donc, patron, m’est avis qu’ils ont affaire avec lui, maintenant.
— Et alors ?
— Peut-être que ça leur donnerait un peu de courage de nous voir. De toutes façons, il ne faut pas qu’ils nous prennent pour des dégonflés. Où est le doc ?
– À son bureau. Mais vous avez raison, Scanlan. Il faut que nous soyons à leurs côtés et que nous leur montrions que nous sommes prêts à partager leur sort.
— Ces pauvres types paraissent s’appuyer sur nous dans un certain sens. Peut-être en savent-ils plus que nous, mais nous avons l’air d’avoir un peu plus d’esprit d’entreprise. Eux, ils ont pris ce qui leur a été donné ; nous, nous avons dû trouver nous-mêmes. Hé bien, il est temps d’aller au déluge … en admettant qu’il y ait un déluge !
Tandis que nous allions vers la porte, le docteur Maracot est entré. Mais était-ce vraiment le docteur Maracot que nous connaissions ? Nous avons vu un homme sûr de soi, un visage dominateur dont chaque trait brillait de force et de résolution … Le savant paisible s’était effacé devant un surhomme, un grand chef, une âme forte, capable de soumettre l’humanité à ses désirs.
— Oui, mes amis, notre présence sera nécessaire. Tout peut encore s’arranger. Mais venez tout de suite, sinon il serait trop tard. Je vous expliquerai tout par la suite, si tant est qu’il y ait une suite … Oui, oui, nous venons !
Ces derniers mots, accompagnés des gestes appropriés, s’adressaient à quelques Atlantes terrorisés qui étaient apparus sur le seuil et qui nous faisaient signe de les suivre. De fait, comme Scanlan l’avait dit fort justement, nous nous étions révélés en diverses occasions plus prompts à l’action et plus énergiques que ces êtres habitués à vivre entre eux ; à l’heure du plus grand danger, ils avaient l’air de se raccrocher à nous. Quand nous sommes entrés dans la salle bondée, j’ai entendu un murmure de satisfaction et de soulagement. Nous avons occupé les places qui nous étaient réservées au premier rang.
Il était temps ! Si toutefois nous pouvions être d’un secours quelconque … Le terrible personnage se tenait déjà sur l’estrade ; il contemplait la foule tremblante de son sourire cruel, démoniaque. La comparaison de Scanlan d’une famille de lapins devant une belette m’est revenue en mémoire quand je me suis retourné : les Atlantes étaient effondrés, ils se cramponnaient les uns aux autres tant ils avaient peur, ils regardaient de tous leurs yeux la silhouette puissante qui les dominait et la face de granit qui les observait. Jamais je n’oublierai ces gradins pleins d’une foule hagarde, horrifiée, pétrifiée d’épouvante. C’était à croire qu’il avait déjà statué sur leur sort, et qu’ils attendaient à l’ombre de la mort l’exécution de sa sentence. Manda avait adopté une attitude de soumission indigne : il plaidait pour son peuple d’une voix brisée ; mais ses paroles ne faisaient qu’ajouter au contentement du monstre qui ricanait. Brusquement le Seigneur de la Face Noire l’a interrompu par quelques mots rauques, et il a levé sa main droite en l’air : un cri de désespoir a jailli de l’assistance.
À cet instant précis, le docteur Maracot a sauté sur l’estrade. Il était extraordinaire à voir ! Un miracle l’avait transformé. Il avait la démarche et l’attitude d’un jeune homme ; mais sur son visage rayonnait l’expression d’une puissance comme je n’en avais jamais vu chez quiconque. Il s’est avancé vers le géant basané, qui l’a regardé avec étonnement.
— Hé bien, petit homme, qu’avez-vous à dire ? a-t-il demandé.
— Simplement ceci, a répondu Maracot. Ton temps est révolu. Tu as laissé passer l’heure. Descends ! Descends dans l’Enfer qui t’attend depuis si longtemps. Tu es un Prince des Ténèbres. Retourne dans ton royaume de ténèbres.
Les yeux du démon ont lancé des flammes.
— Quand mon temps sera révolu, en admettant qu’il le soit un jour, ce n’est pas des lèvres d’un misérable mortel que je l’apprendrai ! Quels sont tes pouvoirs pour que tu puisses t’opposer un instant à celui qui connaît tous les secrets de la nature ? Je pourrais t’anéantir sur place !
Maracot a fixé sans ciller ces yeux terribles. J’ai cru discerner qu’au contraire c’était le géant qui paraissait mal à son aise.
– Être mauvais ! a répliqué Maracot. C’est moi qui détiens la puissance et la volonté de t’anéantir sur place. Trop longtemps tu as souillé le monde de ta présence. Tu as infecté tout ce qui était beau et bon. Le cœur des hommes sera plus léger quand tu seras parti, et le soleil brillera avec une clarté plus grande.
— Qui es-tu ? Que dis-tu ? a bégayé le monstre.
— Tu parles de connaissances secrètes. Te dirai-je ce qui est à la base de la science ? C’est que sur tous les plans, le bien peut être plus fort que le mal. L’ange vaincra encore le diable. Pour l’instant je suis sur ce même plan où tu t’es tenu si longtemps, et je détiens le pouvoir conquérant. Il m’a été donné. Voilà pourquoi je te répète : « Descends ! Redescends dans l’Enfer auquel tu appartiens ! Descends, démon ! Descends, je te dis ! Descends ! »
Et le miracle s’est produit. Pendant une minute ou deux (comment compter le temps en de pareils instants ?) les deux êtres, le mortel et le démon, se sont fait face sans parler ; leurs yeux immobiles s’affrontaient, armés de la même volonté inexorable. Tout à coup le monstre a flanché. La figure convulsée de rage, il a brandi ses deux bras en l’air.
— C’est toi, Warda ! Toi, maudit ! Je reconnais tes œuvres ! Oh, je te maudis. Warda ! Je te maudis ! Je te maudis !
Sa voix s’est éteinte, les contours de sa longue silhouette noire se sont brouillés, sa tête est retombée sur sa poitrine, ses genoux ont vacillé, et il s’est affaissé peu à peu. En s’affaissant il changeait de forme : il a été d’abord un être humain qui s’accroupissait, puis une masse noire informe ; enfin, dans une brusque secousse, il s’est liquéfié en un tas de putréfaction noire qui a taché l’estrade et empuanti l’air. Alors Scanlan et moi, nous nous sommes précipités vers notre chef, car le docteur Maracot, ayant épuisé ses pouvoirs, était tombé en avant, à demi-mort.
— Nous avons gagné ! Nous avons gagné ! a-t-il murmuré avant de s’évanouir.
* * *
Voilà comment les Atlantes ont été sauvés du plus horrible danger qui pouvait les menacer, et comment une présence maléfique a été bannie du monde à jamais. Il a fallu que nous attendions quelques jours pour que le docteur Maracot soit en état de nous raconter son histoire ; elle était d’ailleurs tellement extraordinaire que, si nous n’avions pas assisté à son épilogue, nous l’aurions attribuée au délire. Ses pouvoirs l’avaient abandonné sitôt passée l’occasion de les manifester, et il était redevenu l’homme de science doux et paisible que nous avions connu.
— Que cela me soit arrivé à moi ! s’est-il exclamé. À moi, un matérialiste, un homme si absorbé par la matière que dans ma philosophie l’invisible n’existait pas ! J’ai entendu crouler en miettes les théories de toute ma vie.
— Il paraît que nous sommes tous retournés à l’école, a dit Scanlan. Si jamais je rentre dans mon petit pays, j’aurai quelque chose à dire aux enfants !
— Moins vous leur direz, mieux cela vaudra, à moins que vous ne teniez à acquérir la réputation du plus grand menteur d’Amérique, ai-je répondu. Auriez-vous cru, aurais-je cru moi-même tout ce que nous avons vu, si un autre nous l’avait raconté ?
— Peut-être que non. Mais vous, doc, vous avez rudement bien mené votre affaire ! Ce grand dogue noir a été déclaré « out » au bout des dix secondes réglementaires. Pas moyen qu’il se relève. Et il ne se relèvera plus. Vous l’avez rayé de la carte. Je ne sais pas sur quelle autre carte il a trouvé un appartement, mais en tout cas Bill Scanlan n’ira pas loger chez lui !
— Je vais vous dire exactement ce qui s’est passé, a murmuré le Professeur. Vous vous rappelez que je m’étais retiré dans mon bureau. J’avais bien peu d’espoir dans le cœur, mais j’avais beaucoup lu à différents moments de mon existence sur la magie noire et les sciences occultes. Je savais que le blanc peut toujours dominer le noir s’il parvient à se hisser sur le même plan. Or il se trouvait sur un plan beaucoup plus fort (je n’ai pas dit : supérieur) que nous. C’était l’élément fatal.
« Ne voyant aucun moyen de franchir l’obstacle, je me suis jeté sur le canapé, et j’ai prié. Oui, moi, matérialiste endurci, j’ai prié ! J’ai imploré une aide. Quand on se trouve au bout de tout pouvoir humain, que faire sinon lever des mains suppliantes dans les brumes qui nous entourent ? J’ai prié, et ma prière a été miraculeusement exaucée …
« J’ai soudain pris conscience d’une présence : je n’étais plus seul dans la pièce. Devant moi se dressait une grande silhouette, aussi basanée que le maudit que nous avons combattu, mais son visage resplendissait de bienveillance et d’amour. Il détenait un pouvoir aussi fort que l’autre ; mais c’était le pouvoir du bien, le pouvoir sous l’influence duquel le mal se dissiperait comme le brouillard se dissipe devant le soleil. Il m’a regardé avec douceur ; moi j’étais trop surpris pour parler. Une inspiration, ou une intuition, m’a averti qu’il était l’esprit du grand sage de l’Atlantide qui avait combattu le mal pendant sa vie et qui, ne pouvant empêcher la destruction de son pays, avait pris ses précautions pour que les plus dignes de ses compatriotes pussent survivre même s’ils sombraient dans l’Océan. Cet être merveilleux allait maintenant s’interposer pour empêcher la ruine de son œuvre et la destruction de ses enfants. L’espoir m’est revenu ; j’ai tout compris comme s’il m’avait parlé. En souriant, il s’est avancé et il m’a imposé ses deux mains sur la tête. Sans doute m’a-t-il transféré sa propre vertu et sa propre force. Je les ai senties parcourir mes veines comme du feu. Rien ne me semblait plus impossible. J’avais la volonté et le pouvoir d’accomplir des miracles. J’ai entendu sonner la cloche, qui annonçait l’imminence du drame. Quand je me suis levé, l’esprit a disparu sur un dernier sourire d’encouragement. Je vous ai rejoints ; vous savez le reste.
— Hé bien, Monsieur, lui ai-je répondu, je crois que votre réputation est faite ici. Si vous voulez vous établir comme dieu, rien de plus facile !
— Vous vous en êtes mieux tiré que moi, doc ! a murmuré Scanlan d’une voix maussade. Comment se fait-il que ce type n’ait pas su ce que vous faisiez ? Il s’était pourtant montré assez rapide à mes dépens quand j’ai empoigné mon revolver !
— Je suppose que vous vous étiez placé sur le plan de la matière alors que nous nous sommes trouvés, un moment, sur le plan de l’esprit, a répondu pensivement le Professeur. Ces choses-là enseignent l’humilité. C’est seulement quand on touche au supérieur que l’on mesure l’infériorité de notre qualité par rapport aux possibilités de la création. J’ai eu ma leçon. Puisse l’avenir démontrer que je l’ai retenue !
Ainsi s’est terminée notre aventure capitale. C’est un peu plus tard que nous avons conçu l’idée d’envoyer de nos nouvelles à la surface, et qu’ensuite, au moyen de boules vitreuses remplies de lévigène, nous avons fait notre ascension comme je l’ai raconté. Le docteur Maracot envisage de retourner en Atlantide : quelques problèmes d’ichtyologie le tracassent encore ; il souhaite parfaire ses observations. Mais Scanlan s’est marié à Philadelphie où il a été promu directeur des usines Merribank ; l’aventure ne le tente plus. Quant à moi … Hé bien, les grands fonds de la mer m’ont fait cadeau d’une perle rare, et je n’en demande pas davantage !
FIN